15/01/2009
La fin d'un monde
Texte sombre, des jours de guerre, dédié aux victimes de tous les conflits.
Nous étions là, au bord du fleuve tranquille, à vivre des jours heureux. Dans les champs alentour poussait le blé tendre, que nous avions semé au début du printemps. Le village prospérait, dans la douce lumière de juin et les femmes, partout, vaquaient à leurs occupations, tout en marchant d’une démarche ondulante, jolies comme des déesses. Nous, quand nous étions las de les regarder, nous partions à la chasse dans la forêt profonde et ramenions du gibier en abondance: sangliers noirs, cerfs à la ramure démesurée, biches au regard tendre ou daims roux tachetés d’étoiles. Le soir, sur des feux gigantesques, on grillait la viande et l’air embaumait de cette cuisson offerte aux dieux. Le village s’assemblait et le festin commençait dans l’odeur acre de la fumée, égaillé de chansons, d’éclats de rire et d’histoires du temps passé que racontaient les anciens. On mettait en perce une barrique de vin achetée aux rares marchands romains qui s’étaient aventurés jusqu’ici et nous buvions à notre santé et à celle de l’Empire auquel, finalement, nous appartenions nous aussi, étant de ce côté-ci du fleuve. Cela durait comme cela toute la nuit et l’aube venait nous surprendre alors que nous écoutions encore ce poème épique qui disait la passion d’un roi pour une belle princesse aux cheveux d’or.
Puis un jour ils sont arrivés, comme cela, sur leurs grands chevaux. D’abord il n’y en eut qu’un ou deux, en face, sur l’autre rive, là où tout est sauvage. On distinguait leur pelisse en peau d’aurochs et leur casque orné de cornes de taureau. On voyait surtout la grande lance qu’ils tenaient en main et comment ils regardaient par ici, scrutant la profondeur du fleuve, estimant sa largeur. Puis ils sont partis en remontant le courant, ce qui ne présageait rien de bon car là-haut, à trois jours de marche, il y avait les cascades. L’eau était rapide mais peu profonde et en sautant de rocher en rocher il y avait sûrement moyen de traverser. On disait que certains des nôtres l’avaient fait, autrefois. Qui sait ?
Alors on a préparé nos armes de chasse et on les a aiguisées avec soin. On a aussi préparé des lances de bois, taillées bien en pointe, puis on a rassemblé la volaille et les cochons, qu’on a enfermés tous ensemble dans un grand enclos. Personne ne disait rien, mais il n’y avait plus aucun chant dans le village. Les femmes rasaient les murs ou se terraient chez elles. Nous, nous parlions de nos exploits de chasse, comme si nous voulions nous rassurer sur notre propre valeur. L’Empire était vaste et Rome était loin. Il ne fallait compter que sur nous-mêmes ou sur la providence. Peut-être, finalement, que le fleuve était infranchissable, comme le disait le chaman, qui parlait avec les dieux.
Puis la terre a tremblé sous les sabots des chevaux et ils sont arrivés.
Ils sont arrivés dans un nuage de poussière, criant, gesticulant, les lances brandies en avant et le regard terrible. Alors ce fut le carnage. Que faire à pied devant des hommes à cheval ? Que faire pour se défendre devant des guerriers dont c’est le métier de voler et de tuer ? Les premiers corps tombèrent dans la poussière, les premières flammes s’élevèrent des toitures de chaume. Tandis qu’ils revenaient dans un galop infernal, on entendait les femmes qui criaient dans les maisons, terrorisées à l’idée de ce qui les attendait. On n’a rien pu faire et tout fut vite terminé. Trente corps gisaient maintenant à terre, répandant un sang aussi rouge que le soleil quand il se couche. Ils nous ont tout pris. D’abord la volaille et les cochons, qu’ils massacrèrent et dont ils pendirent les dépouilles aux flancs de leurs chevaux. Puis ils vidèrent les maisons de tout ce qu’elles contenaient. Meubles de bois et vaisselle s’entassèrent en un grand tas sur lequel ils jetaient tous les vêtements de lin et tous les matelas de paille qu’ils trouvaient, puis ils y mirent le feu. Cela fit de hautes flammes qui s’élevèrent vers le ciel, tellement hautes qu’on n’aurait jamais cru que ce fût possible si on ne les avait pas vues. Nous, les survivants, ils nous avaient rassemblés sur la place et nous obligeaient à regarder et à entendre. C’est que dans les maisons cela hurlait fort, à cause des femmes. On ne voyait pas ce qui se passait, mais il suffisait d’écouter pour comprendre. Soudain, un d’entre nous voulut se précipiter mais il fut aussitôt cloué au sol par une grande lance et il rendit l’âme avant d’avoir eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait.
Par signes, ils ont demandé qui était le chef du village et ils firent un cercle autour de lui, en riant à gorge déployée. Ils parlaient une langue étrange qu’on ne comprenait pas, une langue gutturale et obscène, faite d’interjections et de mots sonores. On aurait dit un bruit de cailloux roulés par une rivière. Alors, d’une des maisons, ils firent sortir la fille du chef, qui n’avait pas vingt ans. Le haut de sa robe était déjà lacéré et, d’un geste sec, un de ces sauvages la lui déchira complètement. D’une bourrade, il la força à s’agenouiller devant un des soldats et à lui baiser les pieds. Elle restait là, pliée en deux, honteuse, la poitrine nue devant tous ces hommes et elle pleurait. Eux, ils s’amusaient de voir ses seins tressaillir à chacun de ses sanglots et quelques-uns les touchèrent même du bout de leur lance aiguë. Puis, soudain, ils en eurent assez de jouer. Alors, dans un grand cri, une de ces brutes prit une hache et d’un seul coup trancha la tête de cette pauvre fille. Son père fit un pas en avant : aussitôt, il fut transpercé par une dizaine de lances et s’affala d’un coup. La place n’était plus qu’une mare de sang et ils riaient tous de plus belle, jusqu’à s’étouffer.
Puis ils remontèrent sur leurs grands chevaux, en riant toujours. Ils prirent quelques femmes, qu’ils ligotèrent ensemble et qu’ils poussèrent devant eux, comme des biches apeurées. Ils sont partis comme cela, calmement, après avoir mis le feu aux dernières maisons encore intactes. Dans le lointain, on entendait encore leurs cris et leurs rires. Nous, nous restions là, n’osant même plus bouger, dans la fumée de l’incendie qui montait jusqu’aux cieux.
"Feuilly"

23:12 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, prose, fin de l'empire
12/01/2009
Manipulation (2)
Toujours dans cette optique de la manipulation, je reviens à la manifestation qui a eu lieu à Paris le 03 janvier2009. Il s’agissait clairement de dénoncer l’attaque israélienne sur Gaza. Des militants de gauche étaient présents, ainsi que des associations laïques. Parmi la population immigrée, on retrouvait des personnes ayant dû fuir l’Algérie à au cause de l‘islamisme radical. C’est ainsi qu’étaient présentes des femmes, à qui les islamistes avaient reproché là-bas le fait qu’elles aient pu faire des études ou encore le fait qu’elles veuillent travailler. Elles ont choisi l’exil en Europe. Comme tout le monde, elles sont indignées par la situation à Gaza et elles manifestent pour le dire.
Malheureusement, la manifestation s’est vite transformée en une critique virulente d’Israël (ce qu’on peut comprendre), mais surtout en une déferlante islamique. Beaucoup de personnes se sont senties piégées : les représentations laïques, bien sûr, mais aussi toutes ces femmes arabes qui ont dû fuir leur pays à cause de l’intégrisme.
Et là est tout le problème : peut-on rester sans dénoncer ce qui se passe à Gaza ? Non, bien sûr, conserver le silence dans un tel contexte serait coupable. Faut-il manifester ? Pourquoi pas ? Mais si manifester revient à répandre à son tour la haine par des propos incendiaires et faire indirectement l’apologie du Hamas, qui quelque part récupère la manifestation à son profit, il y a un problème.
Dans un tel contexte, on se doute que les Juifs de la diaspora qui auraient peut-être pu manifester aussi contre les bombardements décidés par Israël (du moins certains d’entre eux) vont se faire rares dans les manifestations suivantes ou en tout cas vont s’y sentir pour le moins fort peu à l’aise. Pourtant, leur présence à de telles manifestations n’auraient-elles pas plus d’impact auprès du gouvernement israélien que celle des Français ou des musulmans ? Dans une situation comme celle-ci, il faut se montrer pragmatiques et efficaces. Or le danger est d’attiser la haine à son tour. On ne dénonce plus l’attitude criminelle d’un gouvernement, on crie sa haine des Juifs, ce qui est déjà autre chose. Ensuite on affiche un islamisme militant en brûlant quelques voitures, ce qui ne fait qu’apeurer la population française, qui, alors qu’elle est globalement opposée aux frappes de Gaza, va bientôt craindre une extension du conflit dans l’Hexagone.
Maintenant, qui étaient ces casseurs ? Des jeunes irresponsables ? Des casseurs professionnels, pour qui toutes les occasions sont bonnes ? Des gens manipulés qui ne se rendent pas compte qu’en agissant de la sorte ils desservent leur propre cause ? De véritables intégristes qui essaient de mettre le feu aux poudres et d’internationaliser le conflit ? Difficile à dire et chacun, selon son opinion ou sa sensibilité, jugera dans un sens ou dans un autre. En fait, ce qui compte, ce n’est pas ce qui s’est réellement passé, mais la manière dont cela a été perçu par le public.
Quant au Hamas lui-même comment faut-il le voir ? Une organisation terroriste qui s’est emparée du pouvoir et qui profite du malheur des Palestiniens pour étendre sa cause ? Ou bien comme un groupement combattant qui a compris que la négociation pacifique n’aboutirait jamais à rien et qui a décidé de prendre les armes après s’être fait élire démocratiquement ?
Le seule chose dont on soit vraiment certain, ce sont ces enfants, ces jeunes, ces femmes, ces parents qui meurent à Gaza. Ce sont ces nouvelles armes que l’on essaie et qui sectionnent les membres ou brûlent atrocement. Ce sont ces enfants que la croix rouge a retrouvés, hagards, à côté des corps de leurs parents morts depuis deux jours.
Mais brandir ces images, c’est encore faire le jeu de la haine, c’est favoriser la guerre des civilisations si chère à Bush, c’est préparer la vengeance qui va suivre. D’un autre côté, taire ces images, c’est se rendre complices, c’est approuver le massacre par son silence. Et puis comment pourrait-on cacher de telles atrocités ?
Le risque, pourtant, c’est de voir la violence gagner l’Europe. On commence à vouloir incendier des synagogues, bientôt on s’en prendra aux personnes, cela renforcera le sentiment d’insécurité que les Juifs gardent ancrés en eux depuis toujours, ce qui amènera de leur part à de nouvelles mesures de protection, puis d’agression. Une fois que le sang a coulé, il ne s’arrête plus de couler.
23:53 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : gaza
11/01/2009
Manipulation générale
En fait, dans ces conflits du Proche-Orient, je me dis que tout le monde manipule tout le monde et que tout le monde exploite tout le monde.
Les Américains, par haine du communisme, ont armé et entraîné les musulmans intégristes afin qu’ils se battent à leur place contre les Russes en Afghanistan.
Les mêmes Américains se sont servis de l’Irak, qu’ils ont armé, pour combattre l’Iran.
Israël, de son côté, s’est servi de l’Occident lors de la première guerre du golfe. En effet, il fallait ruiner l’Irak et l’empêcher de devenir une puissance de frappe nucléaire. Pour cela, il ne suffisait pas de bombarder une centrale, il fallait beaucoup plus, mais Israël ne pouvait pas mener cette guerre lui-même contre un pays musulman sans avoir tout le monde arabe contre lui. Il a donc délégué. La France, pourtant à gauche à l’époque, a suivi.
Les Américains, cependant, ont stoppé leur progression militaire et ne sont pas rentrés dans Bagdad, sans doute par crainte de trop grandes pertes dans les troupes de la coalition. Ils ont alors manœuvré les Populations du Sud de l’Irak, en les invitant à se rebeller contre Sadam Hussein. Ce dernier leur infligea des représailles sanglantes, ce qui n’émut pas beaucoup l’oncle Sam.
Mais le problème n’était pas réglé. Il fallait anéantir l’Irak. Pendant 10 ans l’aviation américaine et anglaise se sont donné le droit d’effectuer des frappes sporadiques en dessus du 36° parallèle. Puis ce fut la deuxième guerre d’Irak, pour le plus grand soulagement d’Israël. Comme la France et l’Allemagne refusèrent d’y participer, les Usa firent le travail eux-mêmes (non sans recevoir l’appui d’anciens pays de l’Est, comme la Pologne). Il faut dire qu’ils mettaient au passage la main sur les puits de pétrole, permettaient aux actionnaires de ce secteur de s’enrichir et faisaient tout payer par le contribuable américain, celui qu’on envoyait au front en fait. Enfin, pas vraiment, car pour cela on avait trouvé les latinos récemment arrivés du Sud, tout contents, eux, de devenir américains. Ils pouvaient bien, pour cet honneur, aller donner leur vie dans le désert irakien.
Ensuite, les Etats-Unis soutinrent les Kurdes du Nord et mirent en place la plus belle guerre civile qu’on avait connue depuis longtemps, qui réduisit un pays prospère et riche, qui s’occidentalisait et où le niveau d’instruction était élevé, en une ruine fumante jonchée de morts.
Malheureusement les Kurdes en question commencèrent à s’agiter un peu chez l’allié turc, qui se mit à les pourchasser jusqu’en Irak même, avec l’accord tacite de ces mêmes Américains qui s’étaient appuyés sur eux.
Ensuite, pour grignoter la Russie, on se servit des Géorgiens (armés par Israël, tiens, tiens) et on provoqua le vieil ours russe jusqu’au moment où celui-ci estima qu’il devait réagir s’il voulait conserver son ancienne zone d’influence. Mais les russes ne font pas mieux, tentant de mettre l’Ukraine à genou en réduisant l’approvisionnement en gaz pour punir cette ancienne province de se tourner vers l’Occident.
Tout le monde, c’est la règle, exploite donc tout le monde. Le Hezbollah se sert du soutien de la Syrie, laquelle se sert du Hezbollah pour maintenir sa zone d’influence et contrer Israël. Le Hamas se sert des Palestiniens pour imposer sa nouvelle conception de l’Islam et Israël se sert des tirs de roquettes du Hamas pour massacrer les Palestiniens. Le Hamas se sert aussi de notre émotion pour qu’on condamne Israël et Israël se sert de notre culpabilité face au massacre de la Shoa pour que nous approuvions son action.
Je suis atterré quand je me mets à réfléchir de la sorte. Sur les événements en eux-mêmes, d’abord, qui sont toujours atroces comme on peut le voir en ce moment. Sur la complexité des phénomènes, dont nous ne percevons qu’une partie. Sur la mauvaise foi qui règne de tous côtés. Et finalement sur la nature humaine, dont on se dit qu’elle est vraiment bien mauvaise. La vie est déjà si courte et nous n’en avons qu’une. Il faut encore que nous nous fassions souffrir les uns les autres et que nous nous massacrions.
Restent les victimes, qui en tant que victimes ont tout perdu dans ce jeu de dupe. Restent ces morts de Gaza, hommes, femmes, enfants. Et même le soldat israélien qu’on aura envoyé là-bas pour des raisons politiques et électoralistes et qui va peut-être mourir également, même ce soldat mérite aussi notre compassion car rien ne dit qu’il avait envie d’aller la-bas, lui.
Il y a tant de haine de part et d’autre, tant d’injustices et de violence, tant de choses à reprocher à l’autre, qu’on ne peut que se dire qu’on n’en verra jamais la fin.
Je suis atterré. Pas seulement devant ce conflit, mais devant l’espèce humaine en général.
Que faire alors ? Continuer à élever la voix ? Se taire ? Tout oublier, se cacher dans son coin et ne plus contempler le monde, ne plus rien voir ? Trouver l’apaisement intérieur dans l’oubli, en refusant de regarder ? Ou au contraire crier plus fort que les autres ? Cela pourrait amener les plus radicaux d’entre nous à aller très loin dans la défense de leurs idées. Avec le risque de se faire manipuler à leur tour car toute bonne action est toujours récupérée par un plus malin qui s’en sert pour sa propre cause.
Mais se dire cela, c’est refuser d’agir, de parler, d’écrire et de clamer notre colère. Si les Allemands avaient montré un peu plus de désobéissance entre 1933 et 1939, on aurait évité bien des morts… Alors il nous faut bien nous concentrer sur l’événement du moment, sur ces morts injustes de Gaza, rien que pour conserver notre dignité d’homme. Mais en faisant cela nous ne réglons rien du problème en lui-même. Nous parons au plus pressé, c’est tout.
Et si l’Irak avait eu la bombe nucléaire (pourquoi pas après tout, nous l’avons bien, nous) et si Israël avait été frappé, nous aurions pleuré les victimes israéliennes. Allant d’une victime à l’autre, nous ne savons rien faire d’autre qu’apporter notre compassion. C’est le moins que l’on puisse faire, mais cela ne sert finalement pas à grand chose car les grands de ce monde continuent à jouer sur le grand échiquier qui leur a été donné.
En attendant, ce qui est sûr et certain, c’est le nombre des victimes innocentes à Gaza. Et nous n’avons rien pu faire. Et cela continue. Et nous ne pourrons rien faire.


00:42 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : israël, gaza
10/01/2009
Un autre Israël?
Pour terminer cette évocation de la guerre au Proche-Orient, je voudrais préciser, après avoir bien critiqué ici la position du gouvernement israélien, qu’il ne faudrait pas non plus, par nos propos à tous (qui partent certes de bons sentiments) en arriver à diaboliser l’une ou l’autre nation et donc indirectement contribuer à aviver la haine. En d’autres termes, je voudrais dire, comme je l’ai déjà fait dans le passé, qu’il ne faudrait pas assimiler l’ensemble des Israéliens à la politique de leur gouvernement (de même que tous les Américains ne pensent pas comme Bush ou tous les Français comme Sarkozy, loin s’en faut).
Voici donc un article qu’une connaissance m’a envoyé et qui prouve à suffisance qu’en Israël même il est des personnes qui osent prendre la parole pour dénoncer ce qui se passe, tout en ayant la clairvoyance de dire que du côté palestinien tout n’est pas très clair non plus dans la politique qui est menée.
"Israël a manqué un rendez-vous avec l’histoire"
Ce qui est fascinant, c’est que je retrouve dans cet article beaucoup de points qui ont été soulevés ici. La différence, c’est que c’est un Israélien qui le dit et cela fait plaisir. Tout espoir n’est peut-être pas perdu.
Uri Avnery est né en Allemagne en 1923. Ecrivain et journaliste, il est membre de la Knesset.
Sa famille fuyant Hitler, est arrivée en Palestine en 1933 (tiens, tiens). A quatorze ans il est membre de l’Irgoun de Menahem Begin et combat les Britanniques. Il quitte cette organisation dès 1941, car il se rebelle contre ses positions anti-arabe et anti-sociale. Il fera la guerre de 1948 comme soldat, puis devient journaliste. Il quitte le quotidien Haaretz, estimant qu’on ne le laissait pas parler à sa guise de l’expropriation des terres appartenant aux Arabes. Il rachète alors l'hebdomadaire israélien Haolam Hazeh, journal qui critiquera l’opération militaire de Sharon contre le village de Qibya, ce qui vaudra à Uri Avnery un passage à tabac par des militaires ayant participé à l’opération. Plus tard, c’est un attentant à la bombe qui vise le siège du journal suite à un article contre le maire de Haïfa.
En 1965, il est de ceux qui fondent le parti Haolam-Hazeh et il deviendra député à la Knesset . En 1982, il va rencontrer Arafat au Liban. En 1933, il fonde le « Bloc de la paix ». (Gush Shalom en hébreu). C’est un mouvement israélien, fort à gauche, qui milite pour la paix et en vue de la création d'un Etat palestinien (un peu comme Shalom Archav)

01:18 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : israël, gaza, gush shalom
08/01/2009
Religion et société (3)
Poursuivons notre réflexion sur l’importance et l’éventuelle implication de la religion dans les rapports actuels entre les peuples. Nous avons dit en ce qui concerne l’Occident que l’affadissement des pratiques religieuses prouve à suffisance que ce n’est pas dans la foi qu’il faut chercher le moteur des politiques menées.
Pour la religion juive, nous avons dit que même s’il n’y a que 15% des Juifs qui ont une foi vraiment profonde, il semblerait bien cependant que l’ancienne conception biblique de la terre promise continue à justifier l’existence même de l’état d’Israël auprès de tous les Juifs (voir cependant les nuances apportées par Pascal Janovjak dans la note précédente). La conséquence, c’est évidemment le refus de voir que cette terre promise était habitée par les Palestiniens et que donc il faudrait peut-être se résoudre à leur en concéder au moins une partie. Cela débouche forcément sur des conflits sans fin, augmente la violence de part et d’autre et justifie finalement tout agrandissement du territoire pour des raisons sécuritaires. Ainsi l’invasion du Liban dans les années 80 et encore en 2006 s’expliquait par la volonté de créer une zone tampon afin de protéger l’état israélien des tirs de roquettes. Quant à l’implantation de nouvelles colonies, elle entre dans la même logique : protéger le centre de l’état en en reculant continuellement les frontières et ceci afin de ne pas laisser « l’ennemi » à proximité des centres vitaux (car toujours il y a cette idée que l’état juif pourrait disparaître). Le problème, c’est qu’une fois une nouvelle colonie établie, il faut la protéger à son tour et donc pour cela agrandir encore la zone d’influence par la construction d’une autre colonie. On n’en finit donc jamais et toute la politique se définit en termes de défense et d’agression. Les résultats, on les voit en ce moment-même à Gaza.
Maintenant, qu’en est-il du coté arabe ? Là, c’est beaucoup plus difficile de répondre. Est-ce l’Islam qui est en soi de nature belliqueuse ou bien au contraire les Arabes ont-ils trouvé dans la foi et la religion un moyen d’exprimer leur spécificité par rapport à l’Occident et à ses valeurs marchandes et matérialistes (y compris sous la forme du djihad) ? Difficile de répondre dans la mesure où nous subissons tous les jours la propagande de notre camp et que ces derniers temps le monde musulman est présenté comme une menace. Est-il menaçant en soi ou tente-t-il de se défendre avec les moyens qui sont les siens contre notre agression économique ?
Ce qu’il faudrait savoir (et que je ne sais pas), c’est la proportion de musulmans qui approuvent la violence de tous les extrémistes armés qui se basent sur le Coran pour combattre l’Occident. En soi, on est bien d’accord pour dire que le Coran est un livre de paix, mais il faudrait voir comment les gens vivent leur foi. Est-elle source d’apaisement intérieur, voire de résignation ou au contraire moyen de s’affirmer et de se défendre ?
J’aurais tendance à dire que c’est nous qui avons agi de telle sorte que certains ont pris les armes. Si on regarde les Talibans d’Afghanistan, on trouvait normale leur action quand ils se battaient contre les Russes (ils étaient même armés par les Américains comme chacun sait), mais on les déclare terroristes quand c’est l’Amérique qui veut étendre sa zone d’influence dans ce pays. Alors ? L’islam implique-t-il en lui-même la création de ces groupes armés afin d’étendre à toute la terre la parole du Prophète ou bien est-ce que la religion canalise les mécontentements et permet de justifier la violence aux yeux mêmes de ceux qui la pratiquent (ledit Prophète ayant bien dit de combattre les infidèles).
Pour répondre, il faudrait voir si c’est d’abord la foi qui anime ces djihadistes ou l’opposition à l’Occident et à Israël. Combattent-ils pour Allah ou pour se venger des colonisateurs ? Pour moi, c’est cette dernière hypothèse qui est la bonne, mais je peux me tromper.
Revenons encore au conflit de Gaza (et qui commence déjà à se banaliser : 300 morts, 400, 500, cela ne veut plus rien dire. Seules les premières victime avaient un visage, maintenant ce ne sont plus que des chiffres, comme les morts de la guerre civile irakienne). Certes Israël est coupable, mais les Etats-Unis en soutenant son action et l’Europe en ne prenant aucune sanction, le sont tout autant. Les Juifs eux-mêmes ont eu l’art de couper l’herbe sous le pied à toute tentative de paix, par exemple en continuant l’implantation des colonies au moment des accords d’Oslo. Et quand ils accordent quelque chose, on a l’impression que c’est toujours du provisoire pour calmer le jeu et que le lendemain ils passent outre à leurs promesses. Evidemment, il y a toujours un motif à ce revirement (acte terroriste, roquettes, etc.) mais n’ont-ils pas eux-mêmes suscité ces agressions par leur comportement volontairement vexatoire et expansionniste ?

D’un autre côté, après le massacre de la Shoa, ils savent qu’ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes et craignent sans arrêt de voir leur récent état disparaître. Cela suppose donc tout un arsenal militaire d’autodéfense. Malheureusement, à Gaza, ce n’est plus de l’autodéfense, même si la majorité des Juifs en sont persuadés.
Maintenant, si on se penche du côté du monde arabe, il y aurait beaucoup à dire aussi. Pourquoi la ligue arabe s’est-elle toujours montrée impuissante à imposer quoi que ce soit ? Ces gens-là ont le pétrole, ils ont donc un beau moyen de faire pression sur l’Occident pour imposer leurs vues. Or ils ne le font pas. Pourquoi ? Et pourquoi l’Egypte ferme-t-elle ses frontières en ce moment ? Pour ne pas être envahie par les Palestiniens et laisser le champ libre à Israël, bien entendu. Mais ce sont des musulmans entre eux et la situation est dramatique sur le plan humanitaire et sanitaire. Alors ? L’Egypte joue-t-elle le jeu de l’Occident contre les Palestiniens ? Peut-être que cela l’arrange après tout qu’Israël détruise le Hamas. Si elle ouvrait ses frontières, l’action de Tsahal tournerait à rien, puisque tout le monde fuirait, y compris les combattants, pour revenir ensuite.
Et la puissante Arabie, qui entretient de si bonnes relations avec les USA, pourquoi ne négocie-t-elle pas un nouveau statut pour les Palestiniens ?
Car après avoir critiqué l’Occident comme je l’ai fait, il faut aussi avoir le courage de regarder si dans l’autre camp, celui qu’on défendait pour des raisons humanitaires, il n’y a pas aussi des choses à redire. Est-ce que quelque part les états arabes n’ont pas intérêt à ne pas aider les Palestiniens ? S’ils les accueillaient à bras ouverts, tout serait vite réglé, mais non on préfère les laisser moisir dans des camps plutôt que de faire un geste. Forcément, parce qu’alors Israël aurait gagné et occuperait toute la Palestine (et commencerait à regarder du côté de l’autre rive du Jourdain, en Jordanie. N’ont-ils pas déjà conquis le Golan syrien ?) Donc, il vaut peut-être mieux pour les états arabes que les Palestiniens continuent à être des victimes.
Et ces Palestiniens eux-mêmes, acharnés certes à rester sur leurs terres, ne se complaisent-ils pas aussi dans ce rôle de victimes ? Je sais que je pousse loin et que je me fais l’avocat du diable, mais ne serait-il pas plus logique, quand on est un bon père de famille et qu’on est encerclé par Tsahal, ne serait-il pas plus logique de fuir, de créer une diaspora à l’étranger et de tenter de combattre à partir de là ? Au moins leurs enfants ne seraient pas sous les bombes en ce moment.
Et le Hamas, en se cachant parmi la population (mais que pourrait-il faire d’autre ?) ne se sert-il pas des civils comme de boucliers et n’a-t-il pas intérêt, lui aussi, à ce qu’il y ait beaucoup de victimes, donc de martyrs, non pas pour attendrir l’Occident, dont il n’attend plus rien, mais pour le plaisir de recruter de nouveaux combattants disposés à donner leur vie pour venger tous ces morts ?
Pourquoi aucune solution ne peut-elle jamais être trouvée ? Et nous sommes dans un cercle vicieux : plus Israël bombardera et plus le Hamas se renforcera. Même s’il est détruit, d’autres prendront sa place.

En en négociant pas avec Arafat (devenu modéré), Israël a propulsé le Hamas en avant. En humiliant Arafat, Israël a fait en sorte que des groupes armés radicaux voient le jour. L’a-t-il fait par ignorance ou sciemment (pour mieux pouvoir engager un combat qu’il croit pouvoir gagner vu sa supériorité militaire) ?
Et le Hamas a-t-il intérêt à ce que les Palestiniens vivent en paix dans un état à eux ? Non bien sûr. Chaque camp s’arrange donc bien pour qu’une roquette soit tirée au plus mauvais moment. On vient d’en tirer une du Liban, d’ailleurs. Le Hezbollah dément. Qui a tiré ? A qui cela profite-t-il ? A ceux qui veulent se battre. Qui veut se battre ? Les extrémistes des deux camps.
En attendant des innocents meurent à Gaza, victimes de toutes ces tractations politiques des uns et des autres. C’est tout ce que je sais et c’est tout ce que je comprends.
Mais je ne me fais aucune illusion sur la nature humaine et je sais que si demain Israël détruisait son armée, les victimes d’aujourd’hui se transformeraient à leur tour en loups sanguinaires. La violence devient donc inévitable dès qu’on a commencé à la pratiquer. Ce conflit n’aura donc jamais de fin. Et des innocents continuent et continueront de mourir. J’ai dit tout ce que j’avais à dire et je suis complètement impuissant.

Images Al Jazeera
23:07 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : religion, islam, gaza
06/01/2009
Religion et société (2)
Le conflit actuel en Palestine n’est pas à l’origine un conflit religieux, mais plutôt les suites d’une fin d’époque coloniale particulièrement mal gérée.
Avant 1917, la Palestine faisait partie de l’Empire ottoman. Au moment où les Anglais s’en emparent, ils promettent, par la déclaration de Balfour, de favoriser la création d’un foyer national pour le peuple juif. Pourquoi cette attitude ? Probablement parce que le gouvernement britannique avait besoin de l’aide des banques (anglaises et américaines), lesquelles étaient aux mains des Juifs. De plus, en faisant cette promesse, on obtenait la faveur des Juifs américains, lesquels firent aussitôt pression pour que les Etats-Unis rentrent en guerre. Rien n’est simple, comme on le voit.
Le problème, c’est que les Anglais avaient fait une autre promesse aux Arabes, à savoir la création d’un grand royaume arabe incluant la Palestine. Dès 1917, donc, ceux-ci se retrouvèrent lésés et frustrés.
Bref, c’est l’époque coloniale et les Anglais occupent la Palestine, laquelle était donc bien habitée par des Arabes et des Juifs. Mais comme on commence à favoriser l’immigration des Juifs en Palestine, le nombre de ceux-ci augmente. La société des Nations avait d’ailleurs donné un mandat au Royaume-Uni qui lui demandait de
« placer le pays dans des conditions politiques, administratives et économiques qui permettront l'établissement d'un foyer national juif et le développement d'institutions d'auto-gouvernement».
Il faut aussi
«faciliter l'immigration juive et encourager l'installation compacte des Juifs sur les terres ».
La conséquence de tout ceci, c’est que la population juive augmente sans cesse (elle est d’ailleurs passée de 83 000 habitants en 1918 à 650 000 en 1948). Les Arabes commencent à se révolter et pour ne pas avoir de problèmes, les Anglais, dès 1939, réduisent l’immigration juive et promettent l’indépendance aux Arabes dans un proche avenir. Du coup, l’empire britannique rentre en confit ouvert avec les sionistes qui n’hésitent pas à faire des attentats (voir le rôle de l’Irgoun de Menahem Begin, alors activiste terroriste avant de devenir plus tard Premier ministre d’Israël). De guerre lasse, les Anglais remettent leur mandat aux Nations Unies, lesquelles décident assez logiquement de créer un état arabe et un état juif. Les Anglais quittent définitivement la Palestine en 1948, non sans avoir de nouveau tout fait pour favoriser l’apparition d’un état juif. Dès qu’ils sont partis, les sionistes ont assez de force pour vider la région de la population palestinienne. Il y a 800.000 exilés. C’est l’époque durant laquelle on a rasé le village du poète Mahmoud Darwich, ne laissant que le cimetière dans lequel il n’a pas pu être enterré lorsqu’il est décédé l’année dernière). C’est l’époque aussi de la destruction du village de Deir Yassin: les 254 habitants de ce village (hommes, femmes, enfants, vieillards) furent massacrés par les troupes de "L’Irgoun" de Menahem Beghin.
La suite, on la connaît. Les Anglais sont à peine partis que la guerre avec les pays arabes commence aussitôt.
Peut-on donc dire que la religion est à la base de ce conflit ? Quelque part non, on vient de voir que la situation était particulièrement complexe. Pourtant, si les Juifs veulent s’établir en Palestine (et non en Argentine ou encore en Russie où avait existé autrefois un petit royaume juif), c’est bien pour des motifs religieux, celui de la Terre promise.
De tout ceci, on retiendra :
- que si on n’avait pas pratiqué une immigration massive de 1917 à 1948, la Palestine serait arabe aujourd’hui. Mais peut-être que les Juifs n’auraient toujours pas d’état. La réalité, c’est que les Palestiniens, eux, n’en ont pas.
- Que s’il n’y avait pas eu ce substrat religieux et le sentiment chez les Juifs que cette terre leur appartient de droit par volonté divine, on n’en serait peut-être pas là.
Dans la correspondance qu’il entretient avec JL Kuffer, l’écrivain Pascal Janovjak mettait en doute l’importance du phénomène religieux dans ce conflit. Il n’a pas tort, donc. Pourtant, il faut avouer que même s’il n’y a que 15% des Juifs qui sont profondément religieux, l’ensemble de cette communauté continue de se baser sur la Bible pour dire que cette terre lui appartient.
Voici d’ailleurs quelques citations éclairantes :
- «Le Seigneur conclut une Alliance avec Abraham en ces termes: C’est à ta descendance que je donne ce pays, du fleuve d’Egypte au grand fleuve, le fleuve Euphrate.» Genèse (XV, 18-21)
- "Si l’on possède la Bible, si on. se considère comme le peuple de la Bible, on devrait posséder également les terres bibliques, celles des Juges et des Patriarches, de Jérusalem, d’Hébron, de Jéricho, et d’autres lieux encore." Moshé Dayan."
- «Il n’y a pas de peuple palestinien... Ce n’est pas comme Si nous étions venus les mettre à la porte et leur prendre leur pays. Ils n’existent pas.» Madame Golda Meir. Déclaration au Sunday Times, 15 juin 1969
- «Eretz Israël sera rendue au peuple d’Israël. Tout entière et pour toujours.» Menaheni Beghin
Le paradoxe, c’est donc le fait que les partis religieux soient si importants dans la politique israélienne alors qu’une bonne partie de la population n’a qu’une foi très modérée ou même pas de foi du tout. La raison en est qu’inconsciemment cette population accepte la thèse religieuse de la Terre promise. Sans cela, comment pourrait-on justifier ce que l’on voit aujourd’hui ?
Ces bombardements n’ont pas pour seul objectif d’affaiblir le Hamas, il s’agit aussi de terroriser la population civile dans l’espoir qu’elle se décidera enfin un jour à quitter définitivement la Palestine. Sinon, pourquoi viserait-on des mosquées, des écoles, des centrales électriques ? C’est la même logique depuis le premier jour : chasser les Arabes de la Terre promise. Pour cela tous les moyens sont bons. C’est Dieu qui l’a voulu, semble-t-il.

00:35 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : religion, palestine, gaza
04/01/2009
Religion et société

Quelle est encore l’influence de la religion sur la pensée et le comportement des hommes ? Telle est la question qu’on est en droit de se poser en ce début du XXI° siècle, alors qu’en Europe les églises se vident de leurs fidèles. La difficulté que rencontre l’Eglise pour recruter de jeunes prêtres, les critiques qui s’élèvent à l’encontre de certains discours du pape (sur l’avortement, la contraception, l’homosexualité, etc.) ou tout simplement l’indifférence générale de la population sur les questions religieuses prouvent à suffisance que la foi ne fait plus recette. Certes, l’enseignement libre confessionnel connaît un grand succès, mais on sait que les parents qui choisissent ce type d’établissement justifient leur position par la qualité de l’enseignement qui selon eux y serait dispensé et ils évoquent rarement des motifs religieux. D’ailleurs il suffit d’interroger un peu son entourage pour entendre chaque fois la même réponse : « Oui, je crois en Dieu, mais je ne suis pas pratiquant. » Cela montre bien que s’il demeure un substrat confessionnel dans les mentalités, celui-ci n’est plus très vivace. On peut regretter au passage que tous ces gens n’aient pas pris la peine de réfléchir sérieusement à leur position sur le sujet. Quelque part, je préférerais quelqu’un qui me dise « je crois ou j’essaie de croire pour telle ou telle raison » ou au contraire « non, je suis devenu athée » que ce simple constat ambigu où l’on croit sans croire vraiment et qui manifeste une sorte de laisser-aller que l’on ne peut que déplorer sur un plan intellectuel.
Enfin, peu importe, ce qui est sûr, c’est que la majorité de nos concitoyens croient vaguement en l’existence d’un Dieu (sinon comment expliquer l’existence de l’univers) mais restent très méfiants sur les discours et les pratiques religieuses, qui leur semblent à mille lieues de leurs préoccupations quotidiennes. A la limite on veut bien se marier à l’Eglise (pour ceux qui se marient encore) et assister à la communion d’un neveu (tradition familiale) mais pour le reste, non, on vit dans un monde laïc. L’Etat et le pouvoir, d’ailleurs, s’inscrivent bien dans cette conception laïque, aussi a-t-on été un peu étonné d’entendre Giscard d’Estaing réclamer un ancrage chrétien à sa constitution européenne (laquelle, rappelons-le, concerne surtout la liberté du commerce) et Sarkozy affirmer la primauté du discours du prêtre sur celui de l’instituteur.
Pourtant, quant on connaît les thèses sur le choc des civilisations (Samuel P. Huntington), l’état d’esprit de l’administration Bush ou encore l’actuel conflit à Gaza, on est en droit de se demander si la religion n’est pas encore un moteur de l’action des hommes. Le monde arabe semble d’ailleurs trouver dans le fait religieux une sorte d’unité et une manière de s’opposer (pacifiquement ou non) à la domination de l’Occident.
J’aurais tendance à donner une réponse de Normand et à dire que les religions ne sont pas le phénomène essentiel permettant de comprendre les conflits dans le monde, mais qu’elles contribuent cependant à les attiser.
Ainsi, je ne vois pas bien en quoi l’Occident se penserait comme chrétien. La politique qu’il mène est celle qu’il a toujours menée, depuis le colonialisme et l’expansionnisme géographique jusqu’à son désir récent de soumettre la planète entière à son esprit mercantile pour autant, bien entendu, que ce commerce se fasse à son profit.
Donc, la théorie du choc des civilisations semble particulièrement contestable, surtout si on veut définir les grands blocs de civilisations par leur seule religion. On ne voit d’ailleurs pas comment on ferait entrer l’ancienne guerre froide (USA/URSS) dans un tel schéma, la Russie communiste ne se définissant certainement pas par rapport à la religion orthodoxe. De plus, les besoins des hommes étant partout les mêmes (se nourrir, se vêtir, se reproduire, vivre en paix), on ne voit pas non plus pourquoi un Européen devrait d’office entrer en conflit avec un Arabe, un Indou ou un Chinois sous prétexte qu’il aurait une religion différente. En fait, les différences alimentaires, vestimentaires ou culturelles sont pour le moins aussi importantes que la religion pour différencier les peuples. Mais ces différences ne sont pas non plus des obstacles insurmontables qui nous empêcheraient de bien nous entendre avec les autres. On peut parfois se sentir plus proche d’un étranger (qui aurait lu les mêmes livres que nous et qui aurait une vision humaniste fort proche de la nôtre) que de son voisin de palier. Et le fait que cet étranger ne prie pas le même dieu ou ne mange pas les mêmes aliments que moi ne change pas grand chose. Donc cette théorie du choc des civilisations en rapport à la religion ne sert qu’à justifier la politique des marchands d’armes, lesquels essaient de dresser tout le monde contre tout le monde afin de faire du profit (voir les mensonges déjà oubliés sur les armes de destruction massive en Irak).
Quand éclate un conflit, la religion semble donc être un prétexte qui masque les vrais motifs. La guerre en Irak n’est pas une guerre contre l’islam (même si officiellement elle s’est donnée comme but d’éradiquer le terrorisme islamique), c’est une mainmise pure et simple sur les puits de pétrole et un renforcement de la présence militaire US dans un endroit stratégique de la planète. La guerre en Afghanistan relève de la même logique.
Maintenant, qu’en est-il de l’actuel conflit à Gaza ? Peut-on dire que la religion en est absente ?
(à suivre)

22:23 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : religion
02/01/2009
An 9
Bonne et heureuse année à tous les lecteurs et à toutes les lectrices de ce blogue.
Feuilly, novembre 2008
Evidemment, pendant que nous parlons tranquillement ici, les bombes tombent là-bas à Gaza, étape ultime d’un processus qui a commencé il y a bien longtemps. Car si on peut comprendre que le peuple juif méritait bien d’avoir lui aussi un état (et donc qu’en 1948 certaines spoliations étaient inévitables), on comprend moins bien pourquoi cet état, depuis sa naissance, a toujours eu des visées impérialistes et qu’il n’a pas cessé de s’étendre, en 1967 et 1973 d’abord (suite à des guerres qu’on veut encore bien qualifier de défensives) mais surtout par la suite avec une politique de peuplement systématique via les fameuses colonies.
Le territoire qui avait été laissé aux Palestiniens en 1948 n’a pas cessé de se réduire comme une peau de chagrin et tout est mis en œuvre pour inciter les habitants à partir (contrôles incessants aux cheks-points, fermeture des frontières, arrestations arbitraires, incursions militaires, dynamitage de maisons, construction du mur, interdiction ou impossibilité pour les paysans d’accéder à leurs champs, confiscation des terres les plus riches, impossibilité de se rendre à son travail, etc., etc.) Parquée comme des moutons dans la bande de Gaza, la moitié du peuple palestinien a encore dû endurer les coupures d’eau, de gaz et d’électricité. La situation sanitaire est souvent catastrophique, les hôpitaux manquent de tout, l’enseignement se fait dans des conditions matérielles épouvantables, etc., etc.
Pour négocier, l’état israélien avait devant lui Yasser Arafat, dont on peut dire beaucoup de mal, y compris au sujet de la corruption généralisée qui l’entourait, mais qui offrait l’avantage d’avoir un point de vue laïque et modéré. Toutes les tentatives de paix ont avorté et quand elles ont failli réussir, cela s’est soldé par l’assassinat des négociateurs (assassinat du président égyptien Sadate par des islamistes qui lui reprochaient de négocier avec Israël et assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin par un extrémiste israélien qui lui reprochait d’avoir parlementé avec Arafat). A la fin, Arafat qui a pourtant renoncé à la violence et qui semble un interlocuteur de choix pour négocier, n’est pas écouté par les Israéliens. Il perd petit à petit de son crédit auprès de son propre peuple puisque ses concessions n’aboutissent à rien et à la fin il est même encerclé dans Ramallah par les chars de Sharon. Rien d’étonnant, donc, à ce qu’un mouvement plus dur ait fait son apparition, le Hamas, qui allie la religion pure et dure avec le combat militaire. Il n’y a évidemment rien de bon à attendre d’un tel mouvement extrémiste, mais il faut quand même souligner qu’on aurait pu éviter d’en arriver là si de vraies concessions avaient été faites de part et d’autre. On est maintenant dans une impasse : il n’y a plus que les armes qui peuvent parler. Et on voit ce que cela donne.
En attendant ce sont les populations civiles, déjà éprouvées par les différents blocus, qui vont faire les frais de ce nouveau conflit (et n’oublions pas non plus les victimes civiles israéliennes, même si elles sont moins nombreuses).
Pour ceux que cela intéresse, une pétition à signer :
01:12 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : nouvelel année
31/12/2008
Reflets
Ton eau est un miroir où se reflètent des palais d’un autre temps.
Leurs façades décrépites témoignent de splendeurs perdues et le voyageur qui les contemple s’interroge longuement devant les moulures aux ors fanés.
Quand vient le soir sur le canal, on croit parfois apercevoir l’ombre de ces hommes qui ne sont plus : un chapeau au coin d’une rue, une cape qui traverse un pont. Un parent de Casanova, peut-être ?
Passe une barque, sans bruit. Clapotis discret, froissement imperceptible, elle a déjà disparu, au point qu’on doute même qu’elle ait jamais existé. Mirage intemporel, essence de cette ville aquatique, perdue dans la lagune.
Il est, à qui sait chercher, des quartiers froids et tristes où l’eau semble morte au pied des maisons ternes. Il est des palais d’or aux volets fermés qui n’en finissent plus de mourir de leur belle mort. Il est tout au bout un front de mer aux allures estivales sous les pins qui embaument. Il est des musées aux peintures énigmatiques où les toiles pendent depuis des siècles. Il est des églises de marbre blanc qui se mirent dans l’eau bleue tandis que de grands bateaux remontent le canal principal. Il est une tour fantastique d’où l’on contemple le rêve de la mer.
L’autre soir, en arpentant la riva degli schiavoni, perdu dans ma solitude, j’ai cru voir de grands voiliers accoster en silence, remplis de toutes les épices de l’Orient. Un rêve, probablement. Quand je me suis retourné, les voiliers avaient disparu, tels des fantômes de l’Histoire. Pourtant, l’air embaumait le gingembre, la cannelle, la coriandre et la muscade au point que c’était à en perdre la tête. Je me suis enfoncé dans des ruelles étroites jusqu’au cœur de la nuit noire, me souvenant que ces bateaux apportaient parfois la peste et la mort.
Et pendant ce temps, Venise n’en finit plus de s’enfoncer dans la lagune, s’abolissant elle-même, comme prise d’un remords devant sa richesse passée.
"Feuilly"

Photo Internet
00:10 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, poésie, venise
28/12/2008
Ovide et la création de l'homme
Création de l'homme (I, 76-88)
« Un être plus noble et plus intelligent, fait pour dominer sur tous les autres, manquait encore à ce grand ouvrage. L'homme naquit : et soit que l'architecte suprême l'eût animé d'un souffle divin, soit que la terre conservât encore, dans son sein, quelques-unes des plus pures parties de l'éther dont elle venait d'être séparée, et que le fils de Japet, détrempant cette semence féconde, en eût formé l'homme à l'image des dieux, arbitres de l'univers; l'homme, distingué des autres animaux dont la tête est inclinée vers la terre, put contempler les astres et fixer ses regards sublimes dans les cieux. Ainsi la matière, auparavant informe et stérile, prit la figure de l'homme, jusqu'alors inconnue à l'univers. »
Ovide, Les métamorphoses, I
On retrouve dans ce texte une conception de la création de l’homme proche de celle de la Genèse. L’homme naît comme cela, d’un coup. Soit il est sorti du néant par la volonté divine (« l'architecte suprême » dit le texte) soit il est issu directement de la matière (ce qu’on ne trouve pas dans la version biblique. Encore que : c’est en soufflant sur de la terre que Dieu crée l’homme). Il est, nous dit Ovide, « formé à l’image des dieux », ce qui signifie qu’il se distingue des animaux par essence. La preuve, c’est qu’il n’incline pas la tête vers le sol mais qu’il fixe les cieux.
C’est amusant de voir comment l’homme se voit lui-même comme un être d’exception. Si les loups ou les lions savaient parler et écrire, il y a fort à parier qu’ils diraient la même chose de leur propre espèce, mais passons.
Voulu par les Dieux, façonné à son image, l’homme, en levant le regard vers le ciel, peut contempler la divinité pour ainsi dire d’égal à égal. Cette conviction qu’un destin exceptionnel lui a été accordé a légitimé sa domination sur les animaux et sur la nature. Se croyant élu, tout lui était permis.
On voit aujourd’hui les limites de cette conception anthropocentrique de l’univers, avec notre monde pollué, notre climat déréglé et toutes les espèces menacées…
Et si on cesse un instant de regarder le ciel et qu’on se penche vers cette partie du monde où toutes ces croyances ont pris naissance, en l’occurrence le Moyen-Orient et plus précisément la Palestine, on se dit que c’est parce qu’il s’est cru l’élu de Dieu que l’homme est devenu intransigeant, y compris envers ses semblables.
Ces massacres perpétuels où les tirs de roquettes entraînent des bombardements sanguinaires, lesquels à leur tour suscitent d’autres massacres, ont de quoi nous attrister et nous révolter. Se croyant choisi par Dieu, chaque camp voue une haine féroce à l’autre et s’apprête à l’exterminer. L’un a les moyens techniques de le faire, l’autre pas. Le premier empiète sans arrêt sur le territoire du second, qui recule en se défendant comme il peut. Partout ce ne sont que combats, guerres, attentats et sang versé.
« Homo homini lupus est » disait justement un dicton latin. L’homme est un loup pour l’homme. Se croyant l’élue des dieux, chaque race méprise l’autre et s’approprie une terre qu’elle estime lui revenir de droit divin. Comme ceux qui sont en face pensent à peu près la même chose, cela débouche sur des massacres sans fin et seule la supériorité militaire permet à un des protagonistes de faire valoir ce qu’il estime être son bon droit. Les hommes qui s’affrontent ainsi en des combats fratricides seraient-il donc les descendants de ces géants dont parle Ovide, ces mortels qui par leur audace osèrent s’en prendre à la divinité elle-même avant que d’être vaincus par Jupiter et de donner une race violente et assoiffée de sang ?
Les Géants (I, 151-162)
"Le ciel ne fut pas plus que la terre à l'abri des noirs attentats des mortels : on raconte que les Géants osèrent déclarer la guerre aux dieux. Ils élevèrent jusqu'aux astres les montagnes entassées. Mais le puissant Jupiter frappa, brisa l'Olympe de sa foudre; et, renversant Ossa sur Pélion, il ensevelit, sous ces masses écroulées, les corps effroyables de ses ennemis. On dit encore que la terre, fumante de leur sang, anima ce qui en restait dans ses flancs, pour ne pas voir s'éteindre cette race cruelle. De nouveaux hommes furent formés : peuple impie, qui continua de mépriser les dieux, fut altéré de meurtre, emporté par la violence, et bien digne de sa sanglante origine."

20:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, ovide
25/12/2008
Réflexion sur la littérature (3)
"Agir, c’est ce que l’écrivain voudrait par-dessus tout. Agir, plutôt que témoigner. Ecrire, imaginer, rêver, pour que ses mots, ses inventions et ses rêves interviennent dans la réalité, changent les esprits et les cœurs, ouvrent un monde meilleur. Et cependant, à cet instant même, une voix lui souffle que cela ne se pourra pas, que les mots sont des mots que le vent de la société emporte, que les rêves ne sont que des chimères. De quel droit se vouloir meilleur ? Est-ce vraiment à l’écrivain de chercher des issues ? N’est-il pas dans la position du garde champêtre dans la pièce du Knock ou Le Triomphe de la médecine, qui voudrait empêcher un tremblement de terre ? Comment l’écrivain pourrait-il agir, alors qu’il ne sait que se souvenir ?
La solitude sera son lot. Elle l’a toujours été. Enfant, il était cet être fragile, inquiet, réceptif excessivement, cette fille que décrit Colette, qui ne peut que regarder ses parents se déchirer, ses grands yeux noirs agrandis par une sorte d’attention douloureuse. La solitude est aimante aux écrivains, c’est dans sa compagnie qu’ils trouvent l’essence du bonheur. C’est un bonheur contradictoire, mélange de douleur et de délectation, un triomphe derisoire, un mal sourd et omniprésent, à la manière d’une petite musique obsédante. L’écrivain est l’être qui cultive le mieux cette plante vénéneuse et nécessaire, qui ne croît que sur le sol de sa propre incapacité. Il voulait parler pour tous, pour tous les temps : le voilà, la voici dans sa chambre, devant le miroir trop blanc de la page vide, sous l’abat-jour qui distille une lumière secrète. Devant l’écran trop vif de son ordinateur, à écouter le bruit de ses doigts qui clic-claquent sur les touches. C’est cela, sa forêt. L’écrivain en connaît trop bien chaque sente. Si parfois quelque chose s’en échappe, comme un oiseau levé par un chien à l’aube, c’est sous son regard éberlué – c’était au hasard, c’était malgré lui, malgré elle."
M.G. Le Clézio : Dans la forêt des paradoxes. Extrait du discours…
Nous retrouvons donc ici le problème, déjà évoqué, du rapport entre littérature et action. Puis Le Clézio continue en parlant de la solitude, qui semble souvent liée à l’écriture. Est-ce parce qu’on est solitaire de nature qu’on a tendance à écrire (dans une sorte de tentative désespérée pour parvenir à se faire entendre quand même) ou bien est-ce le fait d’écrire qui en lui-même nécessite un repli temporaire sur soi ? Un peu les deux, sans doute, car d’une part tout auteur, même amateur, écrit pour être lu et pour exprimer ce qu’il est et d’autre part son travail d’observation nécessite une distance par rapport à la société des hommes. Il observe les autres vivre plus qu’il ne vit lui-même (d’où la nécessité impérieuse d’écrire qu’il ressent, pour parvenir enfin à une réalité autre).
Ce qui me plait, dans le texte ci-dessus, c’est que cette solitude est bien comprise comme contradictoire, puisqu’elle est à la fois douleur et délectation. C’est un peu ce que j’avais dit ici, moi qui ne suis même pas écrivain. Certains lecteurs avaient pu voir de la douleur dans ma démarche. Ils ont en partie raison, mais ce serait oublier toute la jouissance qu’il y a à écrire et à entendre dans le silence de la nuit le petit bruit régulier du clavier.
Feuilly, Pyrénées, juillet 2008
01:58 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, le clézio
20/12/2008
Réflexion sur la littérature (2)
« Ayant assimilé le système de communisme primordial que pratiquent les Amérindiens, ainsi que leur profond dégoût pour l’autorité, et leur tendance à une anarchie naturelle, je pouvais imaginer que l’art, en tant qu’expression individuelle, ne pouvait avoir cours dans la forêt. D’ailleurs, rien chez ces gens qui pût ressembler à ce que l’on appelle l’art dans notre société de consommation. Au lieu de tableaux, les hommes et les femmes peignent leur corps, et répugnent de façon générale à construire rien de durable. Puis j’ai eu accès aux mythes. Lorsqu’on parle de mythes, dans notre monde de livres écrits, l’on semble parler de quelque chose de très lointain, soit dans le temps, soit dans l’espace. Je croyais moi aussi à cette distance. Et voilà que les mythes venaient à moi, régulièrement, presque chaque nuit. Près d’un feu de bois construit sur le foyer à trois pierres dans les maisons, dans le ballet des moustiques et des papillons de nuit, la voix des conteurs et des conteuses mettait en mouvement ces histoires, ces légendes, ces récits, comme s’ils parlaient de la réalité quotidienne. »
M.G. Le Clézio : Dans la forêt des paradoxes. Extrait du discours…
Le roman est mort, la littérature est morte, entend-on tous les jours. Gros mensonge, évidemment, la littérature existera toujours. Et là, dans cette forêt profonde et primitive, dès que deux hommes s’assoient au coin du feu, elle apparaît aussitôt, la littérature, sous la forme d’histoires qu’on se raconte ou qu’on invente, sous la forme de mythes fantastiques qui parlent de la création du monde. L’homme est fait pour conter, semble-t-il. Notre propre passion des livres ne remonte-t-elle pas à ces histoires merveilleuses qu’on nous lisait quand nous étions enfants ? Aux origines de notre vie comme aux origines de l’humanité, nous retrouvons les contes, issus de la grande tradition orale. La littérature existait donc avant l’écriture elle-même. Elle est tentative d’explication du monde ambiant, monde qu’elle rend par ailleurs compréhensible par l’interprétation qu’elle en donne.

23:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (8)
18/12/2008
La statue inachevée
J’ai sculpté mes rêves avec le marteau du poète
Je leur ai donné une forme impossible et les ai habillés d’illusions.
Au départ, ce n’était qu’une masse de pierre indistincte, composée de tous mes souvenirs, mais petit à petit une silhouette est apparue.
J’ai tapoté, buriné, poli, lissé cette belle pierre.
J’ai creusé là où il fallait creuser, j’ai ciselé là où il fallait ciseler.
Mes pauvres doigts étaient meurtris de tout ce travail, mais j’ai continué quand même.
A la fin, comme je l’ai dit, une image est apparue dans les dessins de la pierre
On aurait dit un visage, mais sans yeux, sans regard.
J’ai poursuivi cette chimère et j’ai repris mon travail, ciselant de plus belle et polissant à qui mieux mieux.
Les jours ont passé, puis les semaines. J’avais beau m’acharner, je ne parvenais pas à faire jaillir le moindre trait sur ce visage.
Dans la rue, je regardais les femmes que je croisais, dans l’espoir de voir une ressemblance avec ma sculpture, mais non, aucune ne semblait correspondre à cette statue endormie dans mon atelier.
Après quelques années, pourtant, le corps enfin apparut, éclatant de splendeur dans le beau marbre blanc. Les jambes fines, les hanches larges, la poitrine provocante, les doigts délicats, tout était parfait. Les yeux, pourtant, continuaient à rester inexpressifs. On aurait dit que la belle endormie restait plongée dans ses pensées, sans jamais rien en exprimer.
Je demeurais là à la contempler pendant des heures, me demandant dans quel rêve elle s’était perdue, dans quelle contrée elle s’était égarée.
J’ai encore essayé, encore et encore, mais il n’y avait rien à faire, les yeux de cette déesse de pierre restaient comme clos, inexpressifs.
Par la suite, j’ai réalisé d’autres sculptures, des dizaines et des dizaines. Beaucoup obtinrent des prix, quelques-unes furent même exposées à Paris et à New York. Moi-même, je fus nommé à l’Académie. Je suis donc devenu quelqu’un de réputé et de célèbre.
Pourtant, chaque fois que je passe dans mon vieil atelier et que je vois les formes de la statue poindre sous le drap dont je l’ai recouverte, je sais que tout mon succès repose sur un mensonge. Cette statue-là, je ne suis pas parvenu à la terminer et je sais que je n’y parviendrai jamais. J’en conserve une sorte de honte, une conscience très nette de mon incapacité en tant qu’artiste. La belle inconnue restera un rêve de poète, soit parce que je suis incapable de lui donner vie, soit tout simplement parce qu’elle n’existe pas.
"Feuilly"
19:03 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (34) | Tags : littérature
17/12/2008
Réflexion sur la littérature
"Mais les livres qui m’ont le plus marqué, ce sont les collections de récits de voyage, pour la plupart consacrés à l’Inde, à l’Afrique et aux îles Masacareignes, ainsi que les grands textes d’exploration, de Dumont d’Urville ou de l’Abbé Rochon, de Bougainville, de Cook, et bien sûr le Livre des Merveilles de Marco Polo. Dans la vie médiocre d’une petite bourgade de province endormie au soleil, après les années de liberté en Afrique, ces livres m’ont donné le goût de l’aventure, ils m’ont permis de pressentir la grandeur du monde réel, de l’explorer par l’instinct et par les sens plutôt que par les connaissances. D’une certaine façon ils m’ont permis de ressentir très tôt la nature contradictoire de la vie d’enfant, qui garde un refuge où il peut oublier la violence et la compétition, et prendre son plaisir à regarder la vie extérieure par le carré de sa fenêtre."
M.G. Le Clézio : Dans la forêt des paradoxes. Extrait du discours prononcé le 7 décembre 2008 lors de la remise du prix Nobel.
On retrouve ici le thème du voyage, de l’ailleurs, si important chez les écrivains, sans qu’on sache si ceux-ci se sont mis à écrire pour atteindre des pays sans doute imaginaires ou au contraire si, comme Le Clézio, ils se sont mis à voyager pour pouvoir visiter les contrées qu’ils avaient d’abord imaginées. Un peu les deux sans doute, car dans tous les cas cet «ailleurs» appartient au merveilleux et donne à la vie tout son sens. Dans l’extrait ci-dessus, on opposera cet «ailleurs» enchanté et prometteur à «la vie médiocre d’une petite bourgade de province endormie au soleil.»
Notons aussi l’importance d’être en dehors de la vie, ce désir d’en oublier «la violence et la compétition» pour mieux pouvoir la regarder par «le carré de sa fenêtre.» L’écrivain est donc en- dehors de l’arène et, de son observatoire, il contemple le monde ou, si vous préférez, il est au-dedans de lui et il observe ce monde qui pour lui représente l’altérité. Ce qui est important, c’est donc cette notion de regard porté sur les hommes et les choses, cette distance critique dans laquelle s’engouffre toute la sensibilité de l’écrivain.

11:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature
15/12/2008
De la littérature comme moyen de survie (2).
« Pourquoi écrit-on ? J’imagine que chacun a sa réponse à cette simple question. Il y a les prédispositions, le milieu, les circonstances. Les incapacités aussi. Si l’on écrit, cela veut dire que l’on n’agit pas. Que l’on se sent en difficulté devant la réalité, que l’on choisit un autre moyen de réaction, une autre façon de communiquer, une distance, un temps de réflexion.»
J.M.G. Le Clézio : Dans la forêt des paradoxes. Début du discours prononcé le 7 décembre 2008 lors de la remise du prix Nobel. «
"Si l’on écrit, cela veut dire qu’on n’agit pas» nous dit le nouveau Nobel. En effet et c’est le genre de question que l’on s’est déjà posée ici même, sans vraiment trouver de solution satisfaisante.
La réponse, cependant est peut-être dans ces mots «distance» et «temps de réflexion». L’écrivain serait toujours ailleurs, en retrait, en train d’observer et non en train de vivre. Il y a entre lui et l’existence une distance critique. Il regarde, il observe, puis il couche ses impressions sur le papier, ce qui lui permet de «dire» ce qu’il a ressenti face aux événements observés. C’est donc son point de vue subjectif qui l’emporte et non les faits eux-mêmes, son intériorité et non la vie qui passe. Ecrire serait donc par définition se raconter soi-même, dans une sorte d’autobiographie mentale en quelque sorte. Dès lors, c’est aussi affirmer la suprématie de sa propre sensibilité sur le monde ambiant et donc tenter de dire que l’on existe. Ecrire, ce serait donc une course de vitesse avec la mort, une course que l’individu tente désespérément de gagner, même s’il sait qu’il n’y parviendra pas. D’où sans doute ce sentiment du tragique si souvent présent dans la littérature.
14:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature, écriture, le clézio
13/12/2008
De la littérature considérée comme un voyage
Un lecteur a fait remarquer que plusieurs textes récents faisaient allusion aux voyages. C’est vrai. Pourtant à y réfléchir, il ne s’agit pas de voyages géographiques, mais plutôt poétiques et existentiels. Nous serions donc tous plus ou moins à la recherche d’un ailleurs imaginaire, autrement dit d’un monde meilleur et différent.
La littérature n’a-t-elle pas justement pour fonction de dire cette aspiration à un au-delà (sans qu’il n’y ait rien de mystique dans ce terme) ? L’individu veut s’affirmer, être pleinement lui-même, mais la réalité ne lui en donne pas toujours la possibilité. Quelques-uns y parviennent, mais ce sont des êtres d’exception. Encore que ces personnages célèbres dont l’Histoire a conservé le nom ne se sont bien souvent affirmés que dans un seul domaine et que leur personnalité et leurs aspirations profondes ne devaient sans doute pas se résumer uniquement à ce domaine.
Mais parlons des autres, c’est-à-dire tout de même des 99,99 pour cent de la population. Il y a toujours un fossé, un hiatus, entre leur for intérieur et la réalité dans laquelle ils doivent bien vivre. Certains se résignent, d’autres se révoltent, d’autres encore s’échappent par le rêve. C’est un peu ce que nous faisons tous ici en allant butiner de blogue en blogue. C’est une parenthèse dans notre journée, de petites coupures qui permettent d’aller respirer un peu d’air frais ailleurs. On va lire les pensées des autres, écouter leurs aspirations, les regarder vivre intérieurement, finalement.
D’où ces textes sur les voyages («la nef des fous», «les rêves d’Amérique ») ou sur leur inutilité (« l’antivoyage »). C’est d’un ailleurs de la conscience dont il s’agit. D’un lieu non géographique et atemporel où nous aurions enfin l’impression d’être pleinement nous-mêmes.
Utopie, certes. Les plus habiles parviennent à s’accommoder du monde ambiant en se construisant un petit nid douillet qui correspond plus ou moins à leurs désirs et pour le reste ils se résignent, sachant bien qu’ils ne changeront pas le monde et encore moins les hommes et leur folie.
D’autres, plus intransigeants (ou moins habiles) crieront leur désespoir à travers l’art. Qu’on pense aux toiles de Van Gogh ou au « Cri » de Munch.
Munch qui n’a pas peint que le « cri » mais aussi «la madone », ce qui fait resurgir la problématique déjà évoquée dans les commentaires antérieurs au sujet de la présence de la femme dans ce monde imaginaire. Encore faudrait-il voir si de leur côté les femmes artistes parlent des hommes dans leurs oeuvres…


01:49 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, voyages
10/12/2008
Recherche dans Marche romane
Je signale aux lecteurs qui n’auraient pas de blogue personnel chez Hautetfort (ou qui n’auraient pas de blogue du tout) qu’une fonction «recherche » est maintenant accessible en bas de la colonne de gauche. C’est bien pratique pour retrouver un thème qui aurait été traité dans le passé et cela devrait permettre de faire revivre un peu les anciens articles. On n’arrête pas le progrès.
21:59 Publié dans Blogue | Lien permanent | Commentaires (2)
09/12/2008
L'antivoyage
Qu’avons-nous découvert, finalement, en ces contrées lointaines ? Que sont devenus les rêves fous qui nous avaient guidés ? Cela valait-il la peine d’avoir abandonné chez nous nos amis, nos femmes, nos enfants, pour parcourir ici des milliers de kilomètres dans les déserts torrides ou les forêts sauvages ? Quel fut le sens de ce voyage impossible, aussi déraisonnable que vain ?
Aucun, manifestement. Nous avons vieilli, mais n’avons pas trouvé ce que nous cherchions.
Point d’or, point d’argent et surtout point de rencontres qui vaillent la peine. Nos navires et nos galions ont remonté des fleuves extraordinaires, certes, mais ce fut pour s’échouer ensuite dans des marais immondes aux odeurs putrides. Là, même les poissons mouraient d’asphyxie dans l’immobilité des eaux troubles. Les moustiques et la fièvre jaune furent notre lot quotidien et ceux qui ne périrent pas du choléra contractèrent la malaria. Tout n’était que forêt et marécage, néant, désolation et désespoir.
Sur les berges, nous avons vu des indiennes éventrées et d’autres que l’on vendait comme esclaves à cause de la cambrure de leurs reins et de ce sexe qu’elles dissimulaient comme elles pouvaient avec leurs mains attachées. Nous avons vu aussi des tribus sauvages se battre dans des combats inouïs jusqu’au dernier homme et enfin nous avons vu l’armée régulière exterminer des villages entiers et massacrer tous les habitants, les enfants y compris.
Dans la plaine, les compagnies pétrolières ont tout ravagé provoquant désolation et exodes. Partout les dollars règnent en maître, ainsi que l’alcool et la drogue. On dit que la mise à blanc des forêts est programmée. D’énormes volutes de fumées s’élèvent déjà jusqu’au ciel à partir de brasiers gigantesques. Le feu avance et détruit tout, la flore, la faune et tous nos espoirs d’un monde meilleur. Bientôt, il ne restera plus rien.
Dans les montagnes aux cimes enneigées, nous avons croisé les camions de la mort, qui ravitaillent les capitales en produits occidentaux en longeant des ravins vertigineux. Parfois l’un d’entre eux rate un tournant et chute dans le gouffre. On ne retrouve jamais sa carcasse et encore moins le corps du chauffeur tant le ravin est inaccessible. Les condors et les bêtes féroces se sont chargés de sa dépouille.
Sur la côte c’est le règne du commerce, de la danse et du sexe et nous avons fui cet endroit de perdition pour nous enfoncer plus au Nord dans le Delta de l’Amazone, espérant y retrouver enfin une nature vierge et pure. Hélas, des pirates et des voleurs d’épaves nous attendaient. Ils nous assaillirent aussitôt et nous ne dûmes la vie qu’à la fuite. C’est ainsi que nous vîmes nos fiers navires, désormais en des mains étrangères, s’éloigner dans les lointains brumeux, tandis que nous rampions dans ces marais infâmes.
Il nous fallut manger des cadavres d’animaux, des racines et des fruits putrides pour survivre à notre désespoir. Nos rêves d’aventures étaient loin et, comme Ulysse, nous avons commencé à penser à un retour possible vers nos chers foyers, où sans doute des Pénélopes fidèles devaient nous attendre, du moins l’espérions-nous.
Il nous fallut pourtant encore errer des années durant avant de pouvoir nous extraire de ce pays fangeux et malsain. La vie ici n’avait pas plus de sens qu’ailleurs, au contraire on pouvait même dire qu’elle n’avait aucun sens, tant elle était fragile et tant le moindre acte, même anodin, vous conduisait aux portes du néant et de la mort.
C’est dans une pirogue construite tant bien que mal de nos mains ensanglantées que nous parvînmes enfin un jour en face du grand océan, après une navigation des plus périlleuses sur ce fleuve imprévisible qui changeait de forme, de couleur et de direction selon les saisons. Nous nous sommes assis sur le sable et avons contemplé cette mer incroyablement salée qui s’étendait devant nous jusqu’à l’infini. Disparus, les chants des sirènes, disparues, les jeunes filles qui se baignaient là autrefois et dont les rires nous emplissaient de joie. Il n’y avait que cette onde froide et grise et des vagues monotones qui venaient mourir à nos pieds, aussitôt bues par un sable spongieux qui semblait rendre inutile leur éternel va-et-vient.
C’est en passagers clandestins que nous embarquâmes comme des misérables sur un vieux rafiot qui transportait illégalement une cargaison de bananes. Cachés au fond de la cale dans une obscurité moite, nous avons eu tout le temps de méditer sur notre expédition et sur nos rêves évanouis. Chacun alors raconta la tristesse de son enfance et c’est ainsi que nous découvrîmes, consternés, que tout était déjà inscrit depuis le jour de notre naissance. Nous avions tenté d’atteindre l’impossible avec l’espoir de trouver le sens caché des choses, mais nous n’avions récolté que des coups et le mépris de nous-mêmes. Amers, dans le demi-jour de la cale, nous nous récitions les « Paradis artificiels » de Baudelaire et pleurions quand son albatros venait s’affaler sur le pont d’un navire semblable à celui qui nous ramenait à notre point de départ.
Hélas, une fois arrivés au port, sous la pluie battante des hivers de l’Europe, nous avons retrouvé nos foyers désertés. Nos tendres compagnes, lassées de nous attendre, s’en étaient allées offrir à d’autres leurs charmes légendaires. Et nous sommes restés là, chacun dans notre solitude, à rêver aux caresses prodigues qu’elles nous donnaient autrefois. Nous avons imaginé les rires qu’elles devaient avoir, maintenant qu’elles s’offraient nues sous les couettes de l’amour aux barbares, aux inconnus, aux étrangers et même à des rustres qui n’avaient pas lu les poètes.
C’est avec nostalgie que nous repensions à la petite fossette qui creusait toujours leur joue quand elles riaient de contentement après l’amour. Et en imaginant leur regard d’azur sombre qui chavirait et vacillait, tout troublé, nous nous remettions à rêver, encore une fois, à des mondes impossibles dont la femme aurait été le centre. Hélas, nous ne faisions que courir après ce que nous avions définitivement perdu.

(http://photo.net/photodb/photo?photo_id=1448324)
09:42 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : littérature, prose, voyages
05/12/2008
Le calumet de la paix
Ne quittons pas encore l’Amérique. Une fois qu’ils eurent débarqué sur ce nouveau continent, les Européens se mirent à observer les mœurs des Indiens (avant de les massacrer). C’est ainsi qu’est passée en français l’expression bien connue « fumer le calumet de la paix ». Elle désignait donc la coutume des Indiens d’Amérique du Nord qui consistait à fumer avec ses ennemis pendant qu’on négociait la paix. Ce qu’on sait moins, c’est qu’il existait également un calumet de la guerre, qu’on allumait lors des négociations de la dernière chance. Ce qu’on ne sait pas du tout, c’est que ce calumet pouvait aussi avoir un usage thérapeutique, selon la sorte d’herbe qu’on y faisait brûler.
D’une manière générale, de toute façon, ce rituel relevait de l’art de l’hospitalité. Dans notre civilisation, boire un verre ou manger avec quelqu’un, lui faire partager sa table, est un signe de bienvenue, d’échange, d’acceptation. Refuser de se joindre au repas proposé fait office d’affront. Lévi-Strauss (fort à l’honneur ces derniers temps et fort justement d’ailleurs) a beaucoup parlé des manières de table dans ses «Mythologiques ». Préparer un repas, c’est introduire la culture (par la cuisson et tout le cérémonial qui tourne autour) dans la nature, autrement dit c’est affirmer la singularité de l’homme par rapport à l’animal.
Avant, c’était facile : Nul ne doutait que Dieu eût créé l’homme à son image. Ce dernier était donc un demi-dieu. D’ailleurs il occupait le centre de l’univers, à savoir la terre, autour de laquelle tournait le soleil. Une fois que cette vérité fut battue en brèche (après quelques difficultés d’ailleurs, voir par exemple la rétractation de Galilée ou la mort sur le bûcher de Giordano Bruno), l’homme n’était plus qu’un être parmi d’autres qui errait sur une planète emportée dans un cosmos infini. Bref, il devenait un animal comme les autres, ni plus ni moins et perdait toute spécificité. Et voilà qu’à ce moment on découvre là-bas, en Amérique, des sauvages dont le mode de vie se rapproche fort dangereusement de celui des animaux. Reflet d’une période historique révolue, ils offrent cependant à l’Européen le reflet de sa propre image à travers les siècles. Si certains s’extasient devant la pureté de ces sauvages innocents qui semblent vivre au paradis terrestre, d’autres comprennent l’importance de l’enjeu : à trop vouloir se rapprocher de la nature, on redevient animal. Et de brandir les deux grandes lois qui sont les fondements mêmes de l’humanité et de la culture : la cuisson des aliments et la prohibition de l’inceste.
Manger un aliment cuit, c’est donc se rattacher à la culture. Inviter quelqu’un à partager ce repas avec vous, c’est réaffirmer que l’on forme ainsi une petite société, où règne la sympathie et l’échange.
Ces sauvages qu’étaient les Indiens de l’Amérique du Nord le savaient aussi pourtant. Ils cuisaient leurs aliments et fumaient ce fameux calumet (de la paix ou de la guerre) qui symbolisait et résumait les intentions que les protagonistes avaient les uns envers les autres.
Objet de culture par excellence, le calumet, fait de bois décoré, de verroteries et de plumes, comportait un fourneau en pierre (rouge pour la paix, blanche pour la guerre).
Notons que ce mot « calumet »n’est pas d’origine indienne (comme « sachem » ou « tipi ») mais qu’il vient du mot français chalumeau via sa forme normande (ou picarde) « calumet », d’après le latin « calamus », roseau (voir « chaume »)
Comme toujours et comme nous l’enseigne la linguistique diachronique, le « ka » latin initial devient « ch » en français d’île de France (ex : capra donne chèvre) tandis qu’il reste « ka » en langue d’oc (capra donne cabra). Dès lors, « calamus » donne logiquement « chalumeau » en français tandis qu’on retrouve une forme « calumo » en Provence. Pour ce qui est du picard et du normand, c’est évidemment sous l’influence des parlers germaniques que le « ka » s’est maintenu. C’est que les mots eux aussi sont le fruit de bien des voyages. Il aura fallu les migrations et les invasions germaniques d’une part (avec leurs guerres et leurs massacres) et la découverte de l’Amérique d’autre part (avec là aussi des guerres et des massacres) pour que ce calumet arrive jusqu’à nous, symbole d’une paix sans cesse remise en question, comme nous le montre encore l’histoire contemporaine.

00:37 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (23) | Tags : langue française, calumet
01/12/2008
Les rêves d'Amérique
Qui étaient ces hommes qui découvrirent l’Amérique ? Des aventuriers, des chercheurs d’or ? Probablement. Des géographes aussi, passionnés par leur science. Des missionnaires, pressés d’aller évangéliser ces contrées. Et dans tout cela, il me plait d’imaginer quelque poète perdu, quelque fou qui croyait donner un sens à sa vie en s’embarquant vers l’inconnu.

Ainsi donc ils partirent, les fiers aventuriers.
Ils lancèrent leur nef fragile sur la mer océane, voulant quitter ce monde pour en découvrir un autre, bien meilleur.
Là-bas, on disait qu’il y avait des îles incroyables, où poussaient tout seuls des fruits savoureux. Les animaux y étaient fantastiques et étrangement doux. Des espèces de lions venaient, paraît-il, vous lécher les mains tout en vous regardant de leurs grands yeux bleus.
Là-bas, on disait aussi qu’il y avait une grande terre, un continent, peut-être, avec des fleuves aussi larges que la mer. D’étranges poissons y nageaient, avec des corps de femmes et une queue de poisson.
Plus loin, c’est la forêt, immense, impénétrable. Des serpents gigantesques l’habitent et la défendent. Ils nagent dans les mangroves et les marais putrides. Quiconque s’aventure en cette contrée est frappé de fièvres étranges et meurt dans d’atroces souffrances, en ayant oublié pourquoi il était venu.
Il faut rester sur la côte, le climat y est plus doux et les femmes fort lascives. Quant à ceux qui ne pourraient se satisfaire de ces délices, qu’ils remontent les fleuves jusqu’aux origines du monde. En amont, ils trouveront des sauvages qui dansent nus en psalmodiant des chansons insolites. Ce sont des poèmes incompréhensibles qui parlent des dieux et des hommes et puis aussi de l’amour et de la mort. Ils dansent toute la nuit en buvant des nectars inconnus et tombent dans des délires étranges dont ils sortent au matin complètement heureux.
On dit que la-bas l’argent n’existe pas et que tous les hommes sont égaux. Les fleurs y ont des parfums pénétrants et la chair des poissons est tendre et délicieuse quand on la déguste au petit matin. On vit et on mange sans horaire, parfois le jour, parfois la nuit, à la lumière blanche de la lune.
Là-bas, il y a des oiseaux qui parlent des langues inconnues et en plein midi le soleil est si fort qu’il faut se réfugier sous l’ombre salvatrice des grands arbres. On fait alors de longues siestes remplies de rêves doux. On croit voir des rivages devant la mer, des algues sur ces rivages et des filles qui se baignent au son des vagues. Ce sont des vagues immenses et déferlantes, qui se brisent sur des rochers aigus comme la mort. Souvent, les filles émergent de l’écume blanche en riant et en poussant des cris aigus. Leur peau brune appelle les caresses et on se croit au paradis, mais quand on les appelle, elles disparaissent ou se perdent dans le rêve dont elles sont issues. Il ne reste que le soleil implacable dans le ciel infini et la soif qui vous dévore, éternellement.
Là-bas, on dit qu’il est un monde étonnant qu’il faut aller découvrir un jour si on ne veut pas avoir vécu pour rien. C’est une terre vierge restée intacte depuis la création de l’univers, une terre où la vie semble avoir enfin un sens. C‘est un continent éloigné, perdu au bout de la mer et un espoir qui attend nos navires.
Encore faudrait-il se décider à embarquer. C’est qu’on dit tant de choses sur ce territoire qu’on finirait par se demander si ce n’est pas seulement un rêve.
"Feuilly"

00:39 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : poésie
27/11/2008
Origine du nom des pays d'Amérique latine
Nous avons longuement parlé de Vespucci, qui a donné son prénom à l’Amérique. Est-ce à dire que Colomb fut complètement oublié ? Pas vraiment, puisque son patronyme a été donné à la Colombie. C’est l’occasion de donner l’origine du nom de quelques pays d’Amérique latine.
Colombie :
Ce pays porta d’abord le nom de Nouvelle Grenade (Nueva Granada) étant donné que Grenade venait d’être reconquise sur les Arabes en 1492, l'année même de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb.
C’est Simón Bolívar qui lui donne le nom de Colombie en hommage au « grand amiral de la mer océane ».
Au départ, il s’agissait de la grande Colombie, qui englobait aussi le Vénézuéla et l'Équateur.
En Amérique du nord on retrouve la Colombie britannique (British Columbia), province canadienne, ainsi que le district de Colombie (District of Columbia) qui correspond en fait à, Washington, la capitale des Etats-Unis, laquelle ne fait pas partie d'un état.
Notons encore que l’origine du nom de Christophe Colomb (Cristobal el Colon) est le mot « columbus » en latin (pigeon)
Vénézuela :
Découvert le 2 août 1498 par Christophe Colomb, lors de son troisième voyage, à l'embouchure du río Orinoco, qui forme un delta. C'est la première fois qu'il met le pied sur le continent américain (lors de ses précédents voyages, il a découvert les îles des Antilles). Il nomme le pays Tierra de Gracia (Terre de Grâce). Ensuite, en 1499, Alonso de Ojeda découvre un golfe avec des maisons sur pilotis qui lui fait penser à Venise. Il nomme donc cette région « golfe de la petite Venise », autrement dit Venezuela. C’est sur le bateau de Ojeda que se trouvait, comme marchand, notre ami Vespucci.
Paraguay :
Le Paraguay est le nom d'une rivière. La capitale est Asunción, parce qu’elle aurait été fondée le jour de l'Assomption, le 15 août 1537, par Juan de Salazar, un des lieutenants de Pedro de Mendoza. Les Espagnols remontèrent le rio Parana puis le rio Paraguay, pour tenter de rejoindre le Pérou, où on croyait découvrir de l’or.
Uruguay :
L'Uruguay est le nom du fleuve frontalier qui sépare l'Argentine et l'Uruguay.
Bolivie :
La Bolivie doit son nom au vénézuélien Simon Bolivar (El Libertador – Le Libérateur), le héros de l’indépendance de l’Amérique latine. On sait qu’il souhaitait ne faire qu’un seul pays de tout ce continent. Notons que Bolivar est, à l’origine, le nom d’un village du pays basque (Bolibar en Biscaye). C’est de là que serait originaire l’ancêtre de Simon Bolivar. Le terme désignerait en basque la vallée du moulin (ibar/bolu).
Soulignons qu’en 1999, Hugo Chavez, le président du Venezuela, adopta une nouvelle constitution qui donna à son pays le nom de République bolivarienne du Venezuela.
Argentine :
Comme on s’en doute, le nom de ce pays vient du mot latin argentum signifiant « argent ». Ce sont les premiers explorateurs espagnols du Rio de la Plata qui lui donnèrent ce nom parce que les indigènes leur avaient offert des objets en argent. Ils furent bien mal avisés d’avoir ce geste de bienvenue…
Brésil :
Le brésil est un bois exotique qui, séché et pulvérisé, donne une matière tinctoriale rouge. A la fin du Moyen-Age, le « bois de braise » provenait des Indes via la Perse et c’étaient les Vénitiens qui en faisaient commerce. Au Brésil, les Portugais découvrirent des arbres « couleur de braise » (brasa en portugais) en si grande quantité qu’ils donnèrent ce nom au pays tout entier.
Chili :
L’origine du nom est incertaine :
Les conquistadors installés au Pérou auraient appelé le Chili « valle de Chile " probablement du nom d’une rivière.
Le nom pourrait aussi venir du nom d’un oiseau ayant des taches jaunes sur ses ailes (trih o chi)
Selon certains historiens, ce terme viendrait d’un groupe d’Amérindiens (les Mitimaes). Ceux-ci, capturés par les Incas, provenaient d’une région du Pérou où coulait un fleuve portant ce nom.
Equateur :
L’Équateur fut nommé ainsi à la suite d’une mission scientifique dirigée par Louis Godin (il s’agissait de mesurer un degré du méridien près de l’équateur).
Guyane :
Le Guyana signifierait « terre d'eaux abondantes » en langue indienne. Il est vrai que dans cette région, de nombreux fleuves coulent à travers la forêt tropicale.
D’autres spécialistes font remonter le terme au dialecte guanao (delta de l’Orénoque) où guai signifiait « nom », « dénomination », tandis que yana serait une négation. « Guyane » voudrait donc dire « sans nom », et désignerait une terre « qu'on n'ose nommer ». Pour nous tous qui sommes passionnés par les mots, cela semble assez incroyable et mystérieux. En quoi cette terre est-elle si mystérieuse pour qu’on n’ose pas la nommer ? Sans doute faut-il y voir une connotation religieuse : ce serait une terre sacrée, celle où séjourne les dieux. Il est vrai que l’épaisse forêt qui recouvre le territoire avait de quoi inquiéter les hommes vivant dans la région. De là à y voir le séjour des dieux, il n’y a qu’un pas.

13:48 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : langue française, amérique latine
26/11/2008
Stéfan Zweig "Amerigo" (2)
Dans la suite de son livre, Zweig démontre comment une suite de méprises a finalement imposé Vespucci au point de le faire passer pour celui qui avait découvert l’Amérique.
Il y avait eu ce « Mundus novus » où effectivement il disait bien qu’un nouveau continent avait été découvert. Mais voilà que quelques années plus tard paraît à Florence un mince cahier de seize feuilles en langue italienne, signé Amerigo Vespucci. Celui-ci, parle des quatre voyages qu’il avait réalisés (en fait comme marchand, ni comme capitaine ni comme explorateur. Il était présent sur ces bateaux, sans plus).
Ensuite, un éditeur italien, comprenant que la mode est à ce genre d’ouvrage, réunit en une seule édition le « Mundus novus » et les « quatre voyages » et il intitule ce livre « Nouveau monde et terres récemment découvertes par Vespucci ». Ce titre est ambigu. Certes il fait allusion au fait que Vespucci pense qu’on a découvert un nouveau continent, mais on peut croire, en le lisant rapidement, que c’est Vespucci lui-même qui l’a découvert. Dans l’imaginaire des foules, son nom commence à concurrencer celui de Colomb.
Plus tard encore, un autre éditeur, français celui-là (de Saint-Dié) décide de mettre à jour la « Cosmographia » de Ptolémée, en ajoutant sur les anciennes cartes les terres nouvellement découvertes. Son but est louable et logique. Le problème, c’est que dans cet ouvrage on ne cite même plus le nom de Colomb. Par contre, quand il parle du futur Brésil (où Vespucci est bien allé), on trouve cette phrase fatale : «… que l’on pourrait appeler désormais terre d’Americus ou America, puisque c’est Americus qui l’a découverte. » Et, puisque les autres continents portent des noms de femmes, il suggère le nom d’Amérique. Sur sa carte, il indique le nom « Amerique » à l’emplacement du Brésil. Quelques années plus tard, quand les contours des nouvelles terres sont mieux définis, on retrouve évidemment ce mot d’Amérique pour désigner le continent tout entier.
Ainsi donc, c’est tout à fait à l’insu de Vespucci que son nom fut mis en avant. Notons que pendant ce temps-là, Colomb continuait à affirmer qu’il avait découvert les Indes, mais plus personne ne le croyait. Lui qui avait été si célèbre, c’était maintenant un homme fini, disqualifié, répudié presque par le roi d’Espagne. Les marchands avaient perdu de l’argent à cause de ses promesses non tenues, les érudits étaient lassés de ses aberrations géographiques. Dans l’imaginaire des peuples, le grand homme c’est maintenant Vespucci. C’est lui qui allait remplacer le vrai découvreur.
Maintenant, peut-être était-ce justice que Vespucci l’emportât ainsi. Certes, il n’avait rien découvert personnellement, mais finalement il n’avait pas non plus massacré les Indiens. Il n’avait pas volé leur or. Il n’avait détruit aucun royaume. Au contraire, il avait observé ces peuples sauvages en humaniste, décrivant leurs coutumes sans les blâmer.
Le premier à montrer quelques réserves sur le rôle réel de Vespucci, c’est Michel Servet (avant d’être traîné sur le bûcher par Calvin). Puis ce sera le grand Las Casas lui-même, qui s’offusquera de cette gloire usurpée et qui dira qu’il est impossible que Vespucci ait découvert le Brésil deux ans avant que Colomb ne pose le pied sur le sol américain. Il a raison, évidemment. Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il y a eu confusion au sujet de la date du premier voyage. Erreur malheureuse des éditeurs ? Probablement. Volonté délibérée de Vespucci ? Il ne faut pas l’exclure non plus. Ce qui est certain, c’est que pendant des siècles les spécialistes vont se déchirer au sujet de l’intention réelle du commerçant-navigateur. Intrigué par cette affaire, Zweig, qui vient de débarquer au Brésil devant la montée du nazisme, décide de se pencher sur le dossier. Notons qu’affecté par ce qui se passait en Europe, il se suicidera avec son épouse en février 1942, près de Rio de Janeiro, sur cette terre à laquelle Vespucci donna son nom.

Image Internet ("Grandquebec.com")
10:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, zweig, "amerigo", vespucci
24/11/2008
Stefan Zweig "Amerigo"
Bon, revenons à notre devinette de l’autre jour. J’avais promis d’apporter des précisions sur Vespucci. En fait, je n’ai jamais lu une ligne de lui (son oeuvre est pourtant courte) et c’est via Stefan Zweig que je l’ai découvert. Zweig, que l’on connaît comme romancier, se fait historien dans son livre « Amerigo » et il s’y interroge sur le mystère qui entoure Vespucci. Cet homme, qui n’a écrit que trente-deux pages dans sa vie et qui n’était ni un romancier ni un explorateur, est parvenu à évincer Christophe Colomb de son vivant et à imposer son prénom, Amerigo, qui a été donné au nouveau continent que l’on venait de découvrir (l’Amérique).
Certains ont vu en lui un infâme imposteur, un usurpateur de premier plan. D’autres ont pris sa défense, expliquant qu’il n’avait rien fait pour s’approprier cette gloire au détriment de Colomb. Pendant plus de quatre siècles des spécialistes se sont battus pour défendre l’une ou l’autre de ces théories, sans que rien de décisif ne ressortît vraiment de leurs travaux. Zweig, lui, essaie dans ce livre de reconstituer l’enchevêtrement de circonstances, des hasards et des malentendus qui sont à l’origine de cette erreur. Pour y parvenir, il nous place d’abord dans le contexte de l’époque et nous invite à voir le monde avec les yeux d’un homme du XV° siècle. Colomb était persuadé d’avoir découvert les Indes (et il s’obstinera dans cette idée jusqu’à sa mort). Cela signifiait aussi que la terre n’était pas aussi grande qu’on l’avait cru puisqu’il suffisait de naviguer un peu vers l’Ouest pour se retrouver en Asie. Mais voilà qu’en 1503, se mettent à circuler, à Paris, à Florence, quelques feuilles imprimées, quatre ou six en tout, intitulées « Mundus novus » d’un certain Albericus (sic) Vespucius. Il s’agit d’un rapport en latin que celui-ci adresse à Petrus Franciscus de Medici au sujet d’un voyage qu’il aurait fait dans des terres inconnues sur l’ordre du roi du Portugal. Ces rapports commerciaux étaient fréquents à l’époque et permettaient aux établissements financiers de se renseigner sur d’éventuels investissements rentables. On se les volait d’une firme à l’autre et quand un de ces feuillets tombait dans les mains d’un éditeur qui avait le sens des affaires (déjà à l’époque), il le publiait aussitôt.
Mais qu’y avait-il de si extraordinaire dans le rapport de Vespucci ? D’abord on dit qu’il est traduit de l’italien en latin, ce qui intrigue déjà. Ensuite, ce Vespucci est « le premier de tous les navigateurs qui sache raconter et de manière amusante. » Les autres, ce sont des marins analphabètes, des soldats, éventuellement des juristes au style épais. Ici, le narrateur raconte avec sincérité les difficultés du voyage, comment ils ont failli périr dans leur bateau rongé des vers alors qu’aucune terre n’était en vue. Et puis finalement était apparue cette terre complètement merveilleuse : le paradis sur terre. On y trouve une nourriture abondante, les fruits poussent tout seuls, les animaux y sont extraordinaires et même les femmes se donnent sans penser à mal.
Or il se fait que les pères de l’Eglise avaient autrefois émis l’hypothèse que le paradis terrestre existerait toujours quelque part en un lieu éloigné et inaccessible. Et voilà ce Vespucius qui dit finalement qu’il en revient. Avouez qu’il y a de quoi lui prêter attention. Dans cette époque troublée où les guerres font rage, la découverte de ces sauvages du bout du monde qui vivent heureux, sans contrainte, sans morale, sans argent, fait fantasmer. Ils représentent le rêve de l’humanité, le retour aux sources, le temps d’avant la faute d’Adam.
Et ce n’est pas tout. Il n’y a pas que le contenu de la lettre qui est extraordinaire, il y aussi le titre : « mundus novus », un nouveau monde. « deux mots, quatre syllabes qui ont suscité une révolution sans précédent dans la manière de considérer l’univers » nous dit Zweig. Alors que Colomb assure qu’il est arrivé en Inde (mais il n’a pas ramené d’épices et n’a pas vu le grand Khan de Chine) Vespucci assure lui que c’est un nouveau continent qu’on a découvert là. Bouleversement dans la conception du monde, certes, mais aussi dans la conception de l’homme. Les anciens avaient affirmé qu’au-delà de Gibraltar s’étendait une mer infranchissable et voilà que cette mer, les hommes du quinzième siècle l’avaient traversée et avaient découvert des terres dont ces anciens n’avaient même pas imaginé l’existence. Epistémologiquement parlant, c’est l’image même que l’homme porte sur lui-même qui se modifie avec cette découverte. A partir de ce moment, c’en sera définitivement fini de s’en référer aux anciens.
Tout ceci explique donc pourquoi Vespucci prit soudain une importance considérable aux yeux de ses contemporains. Pourtant, probablement ne se doute-t-il pas lui-même de l’importance de ce continent qu’on vient de découvrir. Et puis, finalement, une route plus courte pour aller aux Indes, c’est une découverte qui n’intéressait que les commerçants et les armateurs. Dire subitement que le monde était plus vaste qu’on ne l’imaginait, cela concernait tout le monde. Les contemporains des événements ont soudain l’impression d’appartenir à une génération extraordinaire, celle qui va enfin explorer le monde, celle qui dépasse les anciens et qui remet en doute leur savoir.
(à suivre)

(image Internet:"ecole.free.fr")
22:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, zweig, "amerigo", vespucci
21/11/2008
Jaccottet (encore)
Pour ceux et celles qui aiment le poète Philippe Jaccottet, je signale que la revue EUROPE lui consacre son dernier numéro.
Je ne peux m’empêcher de citer ici quelques extraits de la présentation qui est faite du poète (présentation que l’on trouve sur le site Internet de la revue), tant ils sont éclairants :
« …émergeant du désastre, cette voix discrète, tâtonnante mais déterminée dans son souci de justesse et d’effacement, a toujours su se tenir à l’écart des formes modernes de l’idolâtrie, du culte du superficiel et du superflu. Cette voix continue de parler au lecteur contemporain. À la violence de notre siècle. À la violence de toute époque condamnée à naître ou à renaître dans une lumière blessée, dans l’ombre de la douleur. »
Et c’est bien cette discrétion, à l’écart des mondanités de l’univers littéraire, que l’on apprécie chez Jaccottet. Cet homme a toujours tenté de dire l’indicible. Conscient de la difficulté qu’il y a à y parvenir, il a su rester humble et modeste, préférant aux honneurs tapageurs le vrai contact avec les mots. Sa seule ambition, mais elle est de taille, consiste à trouver le mot et le ton justes, afin de faire passer l’indicible. Vaste tâche, on en conviendra, qui, même si elle est souvent tâtonnante, n’en est pas moins déterminée et obstinée.
On apprend que pour ce numéro spécial de la revue Europe, il n’a pas souhaité «voir s’ajouter un nouveau recueil d’études universitaires à ceux qui existent déjà. » On le reconnaît bien là. Joli pied de nez aux intellectuels qui tentent de l’analyser et de le faire entrer de force dans une catégorie. C’est qu’il sait que l’essentiel n’est pas dans ces études, intelligentes certes, mais souvent froides et cérébrales. Il a donc préféré laisser la parole à ses traducteurs, dont bon nombre sont par ailleurs écrivains, poètes et amis car il sait (lui qui est aussi traducteur) que ces gens-là travaillent au plus près des mots, dont ils connaissent toute la complexité.
C’est l’occasion de souligner par ailleurs le rayonnement international de notre discret poète. Lui qui se voulait un « passeur » a très bien rempli son rôle, puisque ses écrits rayonnent maintenant dans des pays étrangers où ils suscitent à leur tour des questionnements sur la manière de percevoir et de dire l’insaisissable.
Mais revenons à l’introduction de la revue Europe :
« Dans une société de consommation, de médiatisation et de profit qui exerce durement son emprise, la poésie de Philippe Jaccottet propose à qui sait l’entendre une façon de vivre et d’habiter le monde en préservant ou en retrouvant le lien à l’essentiel. » En effet, il faut sans doute voir dans cette notion « d’essentiel » une des raisons de l’intérêt que nous portons au poète. A la fois humble et ferme, Jaccottet nous trace le chemin, sans jamais s’en détourner et sans céder à la facilité. Nous qui sommes plongés, bien malgré nous, dans un tourbillon médiatique, où chaque nouvelle se veut plus sensationnelle que la précédente (pour être aussitôt oubliée), nous trouvons chez lui un regard lucide et constant, un regard qui se veut authentique et qui en cela nous émeut et nous interpelle. Moment privilégié, le poème analyse le rapport entre l’homme et le monde, tentant de décrire comme il peut tout ce qu’il y a d’invisible et d’incompréhensible dans la création (à commencer par le fait d’être en vie).
Du coup et sans même le vouloir, il est condamnation de cette société utilitariste que nous connaissons et propose d’autres voies, celles d’un « humanisme modeste, dans la conscience de ses limites. »
Notons encore, dans cette revue Europe, la présence de trois textes inédits de Jaccottet, curieusement intitulés « Trois proses »,. Titre étonnant, on en conviendra, comme si la poésie qui a été l’objet de toute sa vie était subitement niée pour laisser la place à une interrogation sur la mort. Dans ces textes, Jaccottet parle, paraît-il, de la disparition des êtres chers, ce qui l’amène à une réflexion sur le monde contemporain et la perte du sens (étant donné que notre société contemporaine nie la mort et tente de l’occulter). Mais tout demeure méconnaissance : le monde, la démarche poétique, la réflexion métaphysique (l’âme nous survit-elle ?), tout. Et comment une pensée agnostique, qui implique en elle-même son propre néant, peut-elle espérer se maintenir et être présente ?
Mais le message que personnellement je retiens de l’œuvre de Jaccottet, c’est ce face à face avec le monde et surtout l’émerveillement que ce face à face soit possible. Il y a de la stupeur chez Jaccottet, de l’étonnement devant la grandeur de la création. De l’incompréhension aussi, probablement. Maintenant que le poète a vieilli, on sent bien que le thème de la mort qui l’a toujours tracassé prend une autre dimension, qui n’est pas acceptation, mais qui n’est pas révolte non plus.
Une œuvre à lire et à relire, en tout cas.
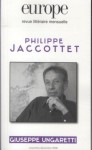
12:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, jaccottet
16/11/2008
Devinette
Quel est l’auteur (il faut bien l’appeler ainsi, puisqu’il a écrit) qui a en tout et pour tout rédigé trente-deux pages dans sa vie, qui n’était ni romancier ni inventeur, mais employé de banque et qui, avec ces trente-deux pages (et surtout grâce au titre qui leur a été donné) est devenu mondialement célèbre, non seulement de son vivant, mais encore aujourd’hui. La preuve, c’est que nous prononçons son nom (ou du moins le nom qui a été formé à partir du sien) couramment.
Personne, dans l’histoire de l’humanité, n’a connu un tel succès avec une œuvre aussi mince. Pourtant, il faut reconnaître que ce qu’il a dit (car il a dit, il n’a rien fait) a bouleversé bien des croyances. A sa manière (et malgré lui), ce fut donc un révolutionnaire.

00:15 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (71) | Tags : langue française
13/11/2008
L'écriture et la nuit
La nuit j’écris.
La nuit, c’est fait pour écrire, sans qu’on sache pourquoi, finalement.
Peut-être parce qu’il fait noir et qu’il n’y a plus personne. La maison est silencieuse, le calme est absolu. On se retrouve donc avec soi-même comme jamais on ne l’a été dans la journée. Que faire, si ce n’est coucher sur le papier tout ce que l’on a sur le cœur, tout ce qui fait un poids, là, quelque part dans la poitrine et qui nous empêche de vivre comme il faudrait ?
Alors on écrit dans cette grande solitude délicieuse. Les mots s’affichent sur l’écran un à un, comme les gouttes d’une pluie qui commencerait à tomber. Puis petit à petit ces mots se rassemblent en phrases et les phrases en paragraphes et voilà la page-écran remplie. C’est un grand fleuve de mots qui maintenant coule de lui-même et emporte celui qui tape sur le clavier. Il l’emporte vers une destinée inconnue, peut-être un immense océan où disparaître enfin. Car écrire est dangereux. Pas toujours, mais parfois. Ecrire c’est mettre à nu la vérité que l’on a au fond de soi, c’est la jeter à la face du monde par l’intermédiaire de cet écran qui scintille dans l’obscurité de la pièce comme un ciel étoilé. Ecrire, c’est toucher l’espoir de se faire enfin comprendre, c’est crier aussi l’absurdité de ce monde qu’il nous faudra un jour quitter sans savoir pourquoi ni même sans avoir compris ce que nous étions venus y faire.
Ecrire, c’est une grande consolation aussi puisque cela consiste à créer des mondes imaginaires, des mondes où il nous semble que nous pourrions peut-être vivre. Enfin, s’ils existaient. Mais ils existent pour un instant, cependant. Ils sont là, dans toutes ces phrases que j’aligne, soumises à ma volonté ou au contraire indépendantes. Peu importe : un univers est en train de se créer, un univers où je retrouve mes désirs et mes angoisses, mes craintes et mes espoirs. Et en filigrane, l’amour toujours, qui se glisse subtilement dans l’intrigue alors qu’on ne l’a pas invité. On contemple ébahi les relations qui se nouent entre les personnages et à la fin on se demande si on n’est pas un peu l’un d’eux et si on ne voudrait aussi croiser le regard de cette fille qui traverse l’histoire.
Dehors, le vent souffle en tempête. Je m’en moque bien. Ici, tout est calme, le clavier fait son petit bruit régulier et les mots grignotent patiemment l’écran. Je suis bien, en accord avec moi-même. Demain sera un autre jour.

22:43 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : prose, écriture
11/11/2008
La musique
Comme nous parlions de musique dans la note précédente, voici un vieux poème retrouvé dans mes papiers et qui aborde le même thème.
LA MUSIQUE
La musique, obsédant refrain
Aux mille aspects changeants
Non sens proclamé par mille violons complices
Violonade à rebours ;
Non à la critique et à « ses voiles sur la mer »
La musique c’est l’abstrait de l’être le plus pur
Quintessence du doute qui se cherche et se trouve
Se retrouve et repart
Reprise de l’orchestre
Quintette pour piano opus 24
Requiem allemand pour une autre Bohême
Emmanuel Kant s’est retiré en silence.
Neuf symphonies muettes
Et Monsieur Bartok
Et Monsieur Sibelius, ce poète outragé
Le cygne et son chant
Il s’appelait Tuonella.
Consonance latine pour l’Espagne de Falla :
Ses jardins andalous du pays musulman
Chant lascif des femmes dans la nuit de l’Orient
Chaleur à l’Occident du rêve.
La musique.
Ma musique.
Refrain pour l’actrice dans un film de Rohmer.
Applaudissements sur la place publique
Ecoutez tous.
Ecoutez la nostalgie de cette fille
Et son chant. Lointain.
La rumeur de la mer et le chant légendaire des sirènes
L’infini du monde dans une coquille, sur la plage.
Le vent, parfois, dans les ramures d’hiver,
L’or dans les trembles, au printemps de l’espoir.
L’été, la chaleur et les soirs
Eternel crépitement, insectes inlassables
Bruits inclassables, dans le souvenir du midi.
La musique
Des pas dans la rue qui résonnent,
Au petit matin, à la sortie des bars
Claquement sec d’une portière
Bruit de moteur.
La soirée se termine.
Tout est fini.
Voici le jour et sa tristesse infinie.
02:09 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : poésie
09/11/2008
Musique
C’est devenu la mode dans le monde des blogues de se lancer des défis les uns aux autres, un peu comme les joutes au Moyen-Age, où il fallait relever le gant. Heureusement, ici, le jeu est moins dangereux et il ne s’agit pas de participer à un tournoi mais simplement de répondre à des questions. Jusqu’ici, j’avais échappé à ce genre d’exercice périlleux mais comme il fallait s’y attendre ce qui devait arriver est arrivé. On me demande donc de donner cinq musiques qui me représentent. La demande ne pouvait venir que d’une personne qui affectionne la musique, en l’occurrence d’un insecte chanteur. J’ai cité Cigale. Comme elle est par ailleurs professeur de musique, la tâche n’est pas simple, vous en conviendrez. Néanmoins je vais essayer de faire abstraction de son métier qui est aussi sa passion et de rester honnête dans mes choix.
En premier lieu, honneur au poète qu’est Léo Ferré. On n’a que l’embarra du choix, évidemment, dans sa nombreuse production et j’aurais pu choisir les cinq titres chez lui, mais cela reviendrait à tricher (et Cigale m’en aurait voulu tout un été). Comme il fallait se limiter, voici La Mémoire et la mer, qui me semble être un sommet par la beauté du texte, difficile au demeurant et laissant la porte ouverte à de nombreuses interprétations:
Découvrez Léo Ferré!
En deuxième lieu, Jean Ferrat pour la puissance de sa voix et les sujets traités, souvent politiques. Une certaine manière de dire « non », un peu comme Brassens, mais dans un autre registre. Le sommet de sa carrière correspond à mes jeunes années aussi et j’ai parfois l’impression qu’on n’a pas retrouvé, depuis, cette force dans le milieu de la chanson.
Découvrez Jean Ferrat!
Mais j’aime beaucoup la musique classique aussi. Les plus connus, bien entendu (Mozart, Schubert, Schumann, Brahms, etc.) mais aussi Ravel, Sibelius, de Falla, Malher… Cependant, c’est Satie que je propose ici, avec ses gnossiennes. C'ets une musique calme mais qui n'est pas ennuyeuse et qui procure une sorte d'équilibre chez celui qui l'écoute :
Découvrez Eric Satie!
Ensuite, toujours dans le classique, je dois avouer une passion pour la musique sacrée, moi qui suis pourtant un athée convaincu. Ce n’est pas la religiosité que je recherche alors, mais l’aspect planant, poétique, qui semble donner un sens à la vie. En effet, cette sorte de construction théorique écrite par l’homme à partir du néant, ces notes ou ces chants (quoi de plus beau, finalement, à nos oreilles humaines, que ces voix d’hommes et de femmes qui se répondent dans un beau dialogue) qui s’élèvent, emplissent l’espace pour un instant d’éternité et retombent lentement pour disparaître dans le silence.
Voici donc Palestrina dans "Tu es petrus":
Découvrez Palestrina!
On a écouté Palestrina, j’aurais pu proposer Mouton, Josquin Desprez, Moulinié et bien sûr Hildegarde Von Bingen. Dans le même style, mais en plus sombre, pour les jours de désespoir, voici Couperin et ses leçons de ténèbres (ici la troisième leçon):
Découvrez Couperin!
La chaîne s’arrête là (sinon elle va continuer à tourner et finira bien par revenir). J’y ai répondu par amitié pour Cigale, laquelle a dû m’expliquer patiemment comment faire ces copiés/collés musicaux à partir d’un site que je ne connaissais pas. Mais cela va me permettre maintenant d’écouter de la musique sur mon PC tout en vous écrivant. Finalement, elle a eu une bonne idée.
00:30 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : errance, musique
07/11/2008
L'éternel instant

Coule la rivière, qui fuit on ne sait où.
Toi qui passes, arrête-toi et écoute le bruit de l’eau en son instant d’éternité.
C’est ici, près du pont, qu’elle sanglote en un murmure tendre et doux.
C’est ici qu’une feuille tourne sur elle-même, lentement, presque immobile, comme si le temps s’était arrêté.
Tout, alentour, n’est que silence.
Seule la musique de l’onde emplit l’espace et ton cœur.
Ecumes à la surface des pierres, vaguelettes qui longent la rive, c’est ici que ça se passe, c’est ici que tout se joue.
Quelque part dans le bois, un oiseau chante, à l’abri des regards.
Un souffle d’air agite une branche, qui doucement vers l’onde se penche.
Bruissement de feuilles, à peine perceptible, mélodie végétale : un dieu vient de passer.
C’est ici qu’elle ralentit, la belle rivière, tandis que le soleil, d’un rayon oblique, la transperce, dévoilant des secrets insoupçonnés.
Là, un peu de mousse, là une algue qui s’étire paresseusement au gré du courant, plus loin quelques pierres d’émeraude sur un lit de sable.
Hôte de ces lieux, lentement, passe un poisson, immortalisant l’instant. Il frôle des cailloux aux reflets dorés, ondoie tout en souplesse, sans se presser, savourant ce moment éphémère.
Mais soudain, le vent s’élève sans crier gare, troublant l’onde calme. Les arbres s’agitent, le poisson disparaît. Un nuage a occulté le soleil, rendant opaque la surface liquide.
Il ne reste rien du bel instant d’éternité, rien que l’eau qui fuit vers son aval et qui court à sa perte. Rien que nous ne sachions déjà, mais que nous n’avions pas voulu remarquer, fascinés que nous étions par la beauté éternelle de l’instant éphémère.
La feuille elle aussi s’en est allée, emportée par le courant. Le rêve s’est brisé et la vie a repris ses droits. Comme cette onde, elle passe, nous accordant quelques instants magiques, avant de nous emporter vers des contrées inconnues, dont on ne revient pas.

08:14 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : poésie
06/11/2008
Michel Ragon, "La Mémoire des vaincus"
Michel Ragon, dont nous avons déjà parlé l’autre jour, est né dans une famille paysanne en Vendée. A 14 ans, il travaille comme garçon de courses. Il lit l’écrivain anarchiste Henry Poulaille, qu’il retrouve à Paris quand il « monte » à la capitale. Poulaille, qui travaille chez Grasset, a toujours lutté pour l’apparition d’une littérature prolétarienne (une littérature faite par le peuple et pour le peuple, autrement dit il prône des écrivains comme le mineur wallon du borinage Constant Malva. « Pour parler de la misère, il faut l’avoir connue » déclare-il souvent). Il influencera considérablement le jeune Ragon.
Michel fréquente le groupe Cobra puis publie Les Écrivains du peuple ouvrage qui, remanié, donnera en 1974 L’Histoire de la littérature prolétarienne de langue française. Après avoir été, grâce à André Malraux, conférencier pour le ministère des Affaires étrangères, il obtient ensuite un poste de professeur à l’Ecole des Arts décoratifs (car entre-temps il est devenu historien de l’art et de l’architecture contemporaine, domaine dans lequel il publie plusieurs ouvrages). Cet ancien travailleur manuel obtient finalement un doctorat d'État ès lettres à plus de cinquante ans. On le retrouve alors comme professeur dans l'enseignement supérieur.
Personnellement, je le connais surtout pour son roman « La Mémoire des vaincus » (1989), qui offre un beau panorama des grandes figures de l’anarchie. Au fil de la lecture, on croise René Valet, Kropotkine, Doriot, Makhno et surtout Victor Serge. Le héros du roman, un certain Fred Barthélémy, sorte de gavroche du faubourg Poissonnière, devient conseiller de Zinoviev, avant de prendre ses distances avec l’étatisme russe. Ce qui m’a le plus marqué dans ce livre, c’est l’approche humaine de Ragon face à ces « oubliés de l’histoire », ces gens remplis d’un grand idéal égalitaire, mais qui ont finalement été broyés par le communisme d’état tel que l’envisageait Lénine et surtout Staline. Qui se souvient encore vraiment de leur nom aujourd’hui ? Dans quel cours d’histoire parle-t-on d’eux ?
J’ai été frappé aussi, dans ce livre, par le personnage de Victor Serge (Viktor Lvovitch Kibaltchiche, né à Bruxelles en 1890 de parents russes émigrés politiques et mort à Mexico en 1947). Il avait été impliqué dans l'affaire de la Bande à Bonnot et pour cela devra purger cinq années de prison. De son expérience, il écrira un livre : Les Hommes dans la prison. Ensuite, il adhère au parti communiste russe en mai 1919. Il renie donc l'anarchisme au profit du marxisme, ce qui sera considéré comme un reniement par ses pairs. Néanmoins, quand le régime russe tentera d’éliminer ces anarchistes gênants, qui prônent la liberté et qui ne veulent pas d’un état policier, il tentera de les défendre. Plus tard, il dénoncera la dégénérescence stalinienne de l'Etat soviétique (qu’il avait pourtant contribué à mettre sur pied, comme le montre bien Ragon), ce qui entraînera son exclusion du parti pour « activités fractionnelles ». Placé sous surveillance, les autorités l’empêchent d’émigrer hors de Russie. Finalement, il est condamné à trois ans de déportation dans l'Oural et ses manuscrits sont saisis. Il devra sa libération à une campagne internationale. Il quitte Moscou avant les premiers grands procès. Maltraité par la presse communiste, il se réfugie au Mexique où il écrit ses mémoires. Il meurt dans le dénuement, après avoir échappé à des tentatives d’assassinat.
Du livre de Ragon (revenons-y), je retiens encore le rôle (rarement connu) des agents communistes envoyés par Moscou lors de la guerre d’Espagne. Visiblement, ils étaient là plus pour éliminer les anarchistes indépendants que pour se battre contre les soldats de Franco.
Michel Ragon peut donc assurément être considéré comme un écrivain prolétarien au sens où Henry Poulaille définissait ce terme puisqu’il est issu du peuple et a connu la pauvreté. Néanmoins, il dira lui-même la difficulté qu’il a éprouvée à changer de classe sociale lorsqu’il devint un intellectuel. Il eut alors l’impression de trahir les siens tout en désirant lui-même accéder à ce monde de la culture qui l’intéressait et qui lui ouvrait de nouveaux horizons.
Quand on lui demande s’il existe encore des écrivains prolétariens, il avoue que non. Il cite François Bon, qui a été ouvrier très spécialisé et qui a écrit sur l'usine, (mais ce dernier récuse la qualification de prolétarien. Il a raison puisqu'il a une formation d'ingénieur en mécanique et s’est spécialisé dans la soudure par faisceau d'électrons). Sinon, il pense que la littérature prolétarienne a pris une autre voie, celle du polar, du roman noir (Manchette) et fait remarquer que depuis que les usines ont été fermées, le vrai milieu prolétarien aujourd'hui se rencontre dans les banlieues où vivent de nombreux immigrés.
Voilà donc la vision que j’avais de Michel Ragon et inutile de dire que celui-ci m’était particulièrement sympathique. Aussi, quelle ne fut pas ma surprise l’autre jour quand j’ai découvert qu’il était l’ami de Philippe de Villiers (lui qui avait côtoyé Noam Chomsky, Daniel Cohn-Bendit, Georges Brassens, Léo Ferré et Albert Camus…).
Etrange et incompréhensible. Sauf si on se souvient qu’il est né en Vendée et qu’il a conservé un amour profond envers sa terre natale (quel est celui d’entre nous qui n’a pas ce même amour, d’ailleurs ?). Or il se fait que Philippe de Villiers s’est toujours battu pour le développement de cette région et c’est visiblement ce qui rapproche les deux hommes, aussi différents qu’ils puissent être sur le plan politique.
Il faut savoir par ailleurs que Ragon a écrit aussi des romans qui constituent la Suite Vendéenne : Les Mouchoirs rouges de Cholet, La louve de Mervent, Le Marin des Sables, L'accent de ma mère, Le Cocher du Boiroux…
Je n’en dirai rien car je ne les ai pas lus. Visiblement, « Les Mouchoirs rouges de Cholet » traite du bocage vendéen et raconte la vie de ces paysans qui ont survécu à la guerre des Chouans. On pourrait s’étonner, une fois de plus, de voir Ragon soutenir les Vendéens contre les armées de la révolution (lui, l’anarchiste, ne peut être soupçonné d’être dans le camp du roi), mais cela s’explique par le fait qu’il défend les humbles contre le pouvoir étatique. D’ailleurs pour lui, il semblerait que la révolte des Chouans était à la base une révolution paysanne et non une révolution aristocratique.
Comme quoi tout trouve toujours une explication et le moins que l’on puisse dire c’est que Michel Ragon n’en finit pas de nous étonner dans son parcours intellectuel et idéologique.

00:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : littérature, michel ragon









