21/05/2009
Protestantisme
Le 21 mai 1536, Genève adopte la réforme et va bientôt devenir le siège européen du calvinisme. Calvin (ou Cauvin) était né en 1509 dans une famille de la petite bourgeoisie picarde. Il latinise son nom en Calvinus et montre très vite un grand intérêt pour les idées de Luther. Il publie en latin d'abord puis en français « L'Institution de la religion chrétienne », livre dans lequel on retrouve les thèses protestantes classiques : chacun est seul devant Dieu et si clergé il doit y avoir, celui-ci doit être vu comme une délégation des fidèles pour les aider dans leur recherche de Dieu et non comme une autorité qui impose sa vision de manière hiérarchique.
Jusque là, sa théorie est séduisante et si j'étais croyant, je la préférerais à la version catholique. Le problème, c'est qu'il me semble aller trop loin lorsqu'il introduit son concept de prédestination. Partant de l'idée que Dieu est amour, il affirme que le salut (la vie éternelle si on veut) est accordé gratuitement aux hommes malgré le fait que ceux-ci sont finalement bien imparfaits. C'est donc un cadeau que Dieu leur fait car dans le fond aucun être humain ne mérite vraiment ce salut si on analyse en profondeur les actes accomplis. Il faut donc s'en remettre à la volonté divine, qui distribue ses faveurs arbitrairement. A la limite, quelle que soit l'attitude adoptée pendant sa vie, l'individu sera récompensé ou non selon le bon vouloir de Dieu. Manifestement Calvin ne se sert pas de la religion pour asseoir l'autorité d'une morale. Sa démarche est plutôt du type mystique : on s'abandonne complètement aux volontés célestes et les actions que l'on pourrait poser volontairement n'interviennent en rien dans la décision finale.
Petit à petit, c'est une véritable théocratie qui dirige la ville de Genève, tant le parti de Calvin a pris de l'importance. Appelée la « Rome protestante », la ville attire des réfugiés de toute l'Europe.
Religion austère (sans luxe ni ornements), le calvinisme proscrit la musique et le théâtre (on se croirait en présence de Platon, que nous avons évoqué l'autre jour et qui méprisait les arts). Les idées développées sont parfois archaïques pour l'époque (la terre est au centre de l'univers, les femmes sont comme des objets pour l'homme...). Ne tolérant aucun esprit critique, Calvin ira jusqu'à faire brûler Michel Servet (dont nous avons déjà parlé : ce fut un des premiers à se poser des questions sur le rôle réel de Vespucci dans la découverte des Amériques. Cet homme possédait manifestement un esprit critique très affûté et par-là il dérangeait forcément).
Il faudra attendre l'invasion française de 1798 pour que les catholiques reviennent à Genève, où on dit qu'ils sont aujourd'hui majoritaires. Les ami(e)s suisses qui nous lisent peuvent apporter des précisions sur ce dernier point, elles seront les bienvenues.
Notons que le protestantisme, qui avait, à ses débuts avec Luther, ouvert des pistes de réflexions intéressantes, devient fort rigide avec Calvin. Et si, pour les catholiques de l'époque, il suffisait d'être riches pour acheter son entrée dans le paradis (cf. l'affaire de la vente des indulgences lors de la construction de St Pierre à Rome), l'idée de Calvin comme quoi la vie éternelle est accordée à certains individus seulement par une sorte de faveur divine arbitraire, est tout aussi décourageante et injuste. Tout cela laisse quand même perplexe sur le rôle intrinsèque des religions. Non seulement elles apparaissent comme un moyen facile de rassurer l'individu qui se pose des questions sur le pourquoi de la mort (car cela reste un vrai scandale que l'on puisse être et demain n'être plus), mais en plus, alors qu'elles devraient justement apporter la sérénité (d'une manière naïve et simpliste peut-être, mais qui devrait être efficace) elles finissent toujours par replonger cet individu dans la culpabilité (le péché originel) ou le désespoir (la prédétermination calviniste). On veut encore bien que certains aient recours à des moyens peu rationnels, pour autant au moins que cela les aide à vivre, mais si en plus c'est pour se retrouver tout aussi malheureux, on ne voit pas bien l'intérêt. Sans parler des conflits inter religieux.
Car on le sait, de l'intransigeance réciproque entre Catholiques et Protestants, naîtront les guerres de religion, avec des massacres comme la St Barthélemy (et même plus tard, après la révocation de l'Edit de Nantes sous Louis XIV, les dragonnades dans les Cévennes). Seul un homme comme Montaigne, qui avait tout misé sur l'humanisme, parviendra à rester en retrait et à conserver un esprit critique dans cette époque finalement fort troublée qu'était la Renaissance. Ce n'est pas pour rien qu'il demande de ne pas tout simplifier en réduisant chaque problème à une opposition binaire. Plutôt que de choisir un camp, il prône lui le scepticisme. Doutant de tout, au moins ne tombe-t-il pas dans le fanatisme.
Tous ces problèmes de nature religieuse nous semblent loin aujourd'hui et pourtant... Il suffit de voir les réactions (d'un côté comme dans l'autre, je le dis tout de suite) au sujet du port du voile à l'école pour se rendre compte que rien n'est résolu. Chacun croit détenir « La » vérité et veut l'afficher « ostensiblement », ce qui entraîne des réactions par ailleurs justifiées mais tout aussi intransigeantes. Est-ce donc une nécessité de toujours penser sur un mode binaire, entre bons et mauvais, entre riches et pauvres, entre Orient et Occident, entre hommes et femmes ? Notre mode de fonctionnement mental est-il si réduit que nous ne puissions dépasser le stade de l'opposition de deux concepts ? Il semblerait bien que oui. Alors il nous restera la poésie comme échappatoire possible. Dans le flou dont elle enveloppe tout, elle parviendra peut-être à nous offrir une autre lecture du monde, une lecture qui soit positive, même si elle est souvent désespérée.

23:07 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : histoire, protestantisme, calvin
19/05/2009
Le retour au pays natal (2)
En fait c'est une servante, la vieille nourrice d'Ulysse, qui le reconnaît à une ancienne blessure alors qu'elle lui lave les pieds dans un bassin. Elle est tellement étonnée que le bassin se renverse à terre (symbole pour dire que l'élément liquide, qui avait été un ennemi pour notre héros, perd maintenant tout pouvoir ?) Elle veut révéler la nouvelle du retour du maître, mais Ulysse lui demande de conserver le secret. On notera que cette nourrice symbolise par excellence l'élément maternel. C'est elle qui a allaité Ulysse quand il n'était qu'un bébé. Elle incarne donc bien pour lui la terre d'Ithaque. Le fait que ce soit elle qui le reconnaisse n'est donc pas anodin. C'est une manière de légitimer son retour dans la terre natale.
Il se fait ensuite reconnaître de son fils Télémaque et de quelques fidèles serviteurs. Sa femme, Pénélope, elle, ne l'a pas reconnu. Or c'et le moment qu'elle choisit pour donner sa main à celui de ses prétendants qui parviendra à bander l'arc de son époux. Lassée d'attendre celui-ci, fatiguée de repousser l'assiduité de tous ces hommes qui veulent s'emparer du royaume en montant dans la couche nuptiale, elle cède donc au moment même où Ulysse arrive. Cette coïncidence permet à l'intrigue de se poursuivre sous nos yeux, mais elle accentue encore le désespoir d'Ulysse qui risque même de perdre son épouse adorée.
On connaît la suite. Aucun des prétendants ne parviendra à tendre l'arc. Alors Ulysse, qui avait eu soin de faire fermer toutes les portes du palais, s'avance et demande l'autorisation d'essayer lui aussi l'arc du divin Ulysse. Tout le monde s'esclaffe et Pénélope elle-même, si elle l'autorise à tenter sa chance, précise tout de même qu'il n'est pas question qu'elle l'épouse si jamais il parvient à réussir. Là-dessus, elle quitte la pièce et se retire dans ses appartements. Ulysse commence alors à massacrer tous les prétendants à l'insu de la reine qui ne se rend compte de rien.

Notons qu'Ulysse n'épargne que deux personnes. Le héraut qui s'était occupé de son fis quand celui-ci était petit et un aède qui promet qu'il va chanter ses exploits. Les « littéraires » chargés de conserver la mémoire des événements sont donc épargnés. Outre qu'il s'agit là d'une belle mise en abyme (puisque ce que le poète promet d'écrire et de chanter, c'est l'Odyssée en fait, ce grand poème que nous sommes justement occupés à lire - ou à écouter pour ce qui était des Grecs de l'Antiquité), il convient de souligner le rôle exceptionnel qu'Ulysse accorde à la poésie narrative.
Enfin Ulysse paraît devant Pénélope, qui a du mal à reconnaître son mari dans ce héros qui se présente devant elle (il n'a plus alors l'apparence d'un vieux mendiant mais il est comme il est vraiment, c'est à dire avec vingt ans de plus que le jour de son départ).
Pénélope, en femme rusée, soumet Ulysse à une dernière épreuve.
« Si cet homme est bien le seul et unique Ulysse, nous nous retrouverons car entre nous il y a un signe secret et sûr, un signe irréfutable que nous sommes, lui et moi, seuls à connaître. »
Alors elle demande à ses servantes d'apporter la couche nuptiale, mais à ces mots Ulysse s'écrie que c'est impossible, car un des pieds du lit a été construit à partir du tronc d'un olivier vivant (ou si on préfère un des quatre pieds est en fait enraciné dans le sol puisque le lit a été construit autour de l'olivier vivant). A ces mots, la pauvre Pénélope tombe dans les bras d'Ulysse. Notons en passant la particularité de ce lit nuptial (c'est là sans doute que l'enfant du couple, Télémaque, a été conçu), qui est fait en partie d'un tronc d'olivier, lequel symbolise la vie par excellence (et l'olivier, toujours vert, plus qu'aucun autre arbre encore). De plus, par ses racines, il puise ses forces dans la terre d'Ithaque. La couche du couple royal semble donc l'aboutissement légitime et vital de cette terre, ce qui donne à leurs ébats amoureux un caractère pour le moins particulier, comme si la force de la terre natale se transmettait, via la sève de l'arbre, au lit nuptial et donc aux amants royaux chargés d'assurer une descendance légitime.
Quand elle est bien certaine que c'est Ulysse qui est revenu, Pénélope défaille presque :
« ...le cher cœur et les genoux de Pènélopéia défaillirent tandis qu'elle reconnaissait les signes certains que lui révélait Odysseus. Et elle pleura quand il eut décrit les choses comme elles étaient ; et jetant ses bras au cou d'Odysseus, elle baisa sa tête. »
Ulysse, lui aussi est presque en larmes. Ils s'acheminent vers le lit et Athéna retarde le lever du soleil pour que la nuit dure plus longtemps et que le couple enfin reconstitué puisse se raconter tout ce qu'il a à se dire.

L'ordre est rétabli. Ulysse est rentré chez lui, il a reconquis son sceptre, il a retrouvé sa femme. Sa descendance est déjà assurée dans la personne de son fils Télémaque. La grande aventure s'achève dans le bonheur domestique. Le temps des exploits est terminé. C'est chez lui, dans sa terre natale, qu'Ulysse va poursuivre calmement sa vie, comme s'il n'y avait qu'elle qui avait pu apaiser l'éternel voyageur, comme si l'unique sens de l'existence se trouvait là, sur ce rocher d'Ithaque, sur cette île perdue elle aussi au milieu de la mer (comme autrefois le navire d'Ulysse), mais sur laquelle il avait vu le jour.
La morale de l'histoire est donc qu'il faut partir pour accomplir des exploits et grandir, afin de devenir un homme. Mais il faut aussi savoir revenir car seul l'endroit où on est né et où on a passé sa jeunesse peut apporter l'apaisement.

00:28 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, homère, odyssée, ulysse
17/05/2009
Le retour au pays natal
Chacun a ainsi un lieu où il a vécu enfant et où il lui semble que les choses ont plus de sens qu'ailleurs, comme si l'ordre qui y règne n'était pas arbitraire mais relevait de la nécessité. Sans doute parce que tout ce que l'enfant voit avec ses yeux, il l'enregistre. La structure du monde qui l'entoure, il se l'approprie et la fait sienne. C'est par ce pays où il a vécu qu'il est devenu ce qu'il est. Plus tard, bien plus tard, quand il y reviendra, il lui semblera toujours retrouver un aspect immuable, même si les changements sont manifestes, comme partout ailleurs. Mais c'est là qu'il a fait la découverte du monde, c'est là qu'il a grandi et cela, personne ne pourra jamais le lui enlever. Cela fait partie de sa mémoire profonde.
La littérature n'est pas sans avoir fait allusion à ce pays des origines. On pourrait même dire que dès ses tous premiers textes elle s'est concentrée sur cette quête du pays natal, sur cet Eden perdu que l'adulte, emporté par les événements de la vie, essaie de retrouver malgré tous les obstacles qui s'opposent à son retour. Cette recherche désespérée et toujours différée et inaccomplie, on l'aura compris, c'est le vieil Homère qui nous en livre les secrets avec le périple d'Ulysse qui tente désespérément de rentrer chez lui à Ithaque.
Dix ans durant il a guerroyé devant les murs de Troie. Dix autres années lui seront encore nécessaires pour retrouver son chemin. Errant sans fin sur l'élément liquide, victime de la colère des dieux, il cherche désespérément le pays où il est né et où l'attendent sa femme et son fils.
Expie-t-il ainsi la ruse qu'il a imaginée en inventant le cheval de bois qui a permis aux Grecs de prendre par traîtrise la ville qu'ils assiégeaient en vain ? Ce voyage qui n'en finit plus et qui le prive de ses foyers est-il une sorte de punition pour sa fourberie ? C'est bien possible. Mais peut-être aussi se complait-il dans cette errance qui lui permet de découvrir des contrées enchantées, de jouir de l'amour de femmes exceptionnelles et de tester sa capacité à vaincre les obstacles qui se présentent. Qui dira si Ulysse est victime de son sort ou si au contraire ce cheminement lui plaît bien, même s'il ne l'avoue pas ?
A la fin, cependant, il semble se fatiguer de son périple et quand enfin il voit devant lui se dresser les rochers d'Ithaque, c'est un grand soulagement pour lui.
Vingt ans se sont donc écoulés depuis son départ et personne ne le reconnaît. Il s'enquiert des nouvelles et se rend vite compte que son royaume tombe en ruines. Sa femme est courtisée par une série de prétendants qui ne pensent qu'à manger et à boire sur son compte. Il va lui falloir rétablir son autorité sur son propre royaume dans une sorte d'ultime épreuve. Redevenir Ulysse en quelque sorte car c'est comme un mendiant qu'il a débarqué dans la cité où personne ne fait attention à lui.
"Donc, tout lui semblait changé, les chemins, le port, les hautes roches et les arbres verdoyants. Et, se levant, et debout, il regarda la terre de la patrie. Et il pleura, et, se frappant les cuisses de ses deux mains, il dit en gémissant :
- O malheureux ! Dans quelle terre des hommes suis-je venu ? Ceux-ci sont-ils injurieux, cruels et iniques ? sont-ils hospitaliers, et leur esprit est-il pieux ? où porter toutes ces richesses ? où aller moi-même ?"
Personne ne le reconnaît, sauf son chien fidèle :
"Et ils se parlaient ainsi, et un chien, qui était couché là, leva la tête et dressa les oreilles. C'était Argos, le chien du malheureux Odysseus qui l'avait nourri lui-même autrefois, et qui n'en jouit pas, étant parti pour la sainte Ilios. Les jeunes hommes l'avaient autrefois conduit à la chasse des chèvres sauvages, des cerfs et des lièvres ; et, maintenant, en l'absence de son maître, il gisait, délaissé, sur l'amas de fumier de mulets et de boeufs qui était devant les portes, et y restait jusqu'à ce que les serviteurs d'Odysseus l'eussent emporté pour engraisser son grand verger. Et le chien Argos gisait là, rongé de vermine. Et, aussitôt, il reconnut Odysseus qui approchait, et il remua la queue et dressa les oreilles ; mais il ne put pas aller au-devant de son maître, qui, l'ayant vu, essuya une larme, en se cachant aisément d'Eumaios. Et, aussitôt, il demanda à celui-ci :
- Eumaios, voici une chose prodigieuse. Ce chien gisant sur ce fumier a un beau corps. Je ne sais si, avec cette beauté, il a été rapide à la course, ou si c'est un de ces chiens que les hommes nourrissent à leur table et que les Rois élèvent à cause de leur beauté.
Et le porcher Eumaios lui répondit :
- C'est le chien d'un homme mort au loin. S'il était encore, par les formes et les qualités, tel qu'Odysseus le laissa en allant à Troie, tu admirerais sa rapidité et sa force. Aucune bête fauve qu'il avait aperçue ne lui échappait dans les profondeurs des bois, et il était doué d'un flair excellent. Maintenant les maux l'accablent. Son maître est mort loin de sa patrie, et les servantes négligentes ne le soignent point. Les serviteurs, auxquels leurs maîtres ne commandent plus, ne veulent plus agir avec justice, car le retentissant Zeus ôte à l'homme la moitié de sa vertu, quand il le soumet à la servitude.
Ayant ainsi parlé, il entra dans la riche demeure, qu'il traversa pour se rendre au milieu des illustres Prétendants. Et, aussitôt, la Kèr de la noire mort saisit Argos comme il venait de revoir Odysseus après la vingtième année."
Ulysse, qui ne veut pas encore se faire reconnaître, ne peut donc aller caresser son fidèle compagnon et après avoir essuyé une larme que personne n'a remarquée, il passe son chemin sans un regard pour le pauvre chien, qui meurt aussitôt, de désespoir sans aucun doute, lui qui avait attendu son maître pendant vingt ans ! A ce moment le vieux chien pouilleux et malade est un peu le double d'Ulysse, fatigué de son long périple de vingt ans, déguisé en mendiant et ayant quasi perdu son royaume, lequel est aux mains des prétendants de sa femme. Ce pays natal auquel il rêvait, voilà qu'il lui est refusé quand enfin il le retrouve. Tout est à refaire, donc, tout est à reconquérir.
(à suivre)

01:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, homère, odyssée, ulysse
13/05/2009
Communiqué
Pour ceux qui habiteraient dans le Sud-Ouest ou qui seraient de passage par-là, je signale que la Fédération des Œuvres Laïques des Hautes-Pyrénées organise son 31° Mai du Livre du jeudi 14 mai au vendredi 29 mai 2009 sur le thème « décolonisation et émancipation ». Tout cela se passe à Tarbes, bien entendu et la personne qui coordonne tout cela n'est autre que Michèle Pambrun, une des fidèles lectrices de Marche romane dont on a souvent pu lire ici les commentaires avisés. Bon courage à elle et qu'elle soit remerciée pour le fait de mettre ainsi sa passion des livres au service de tous.
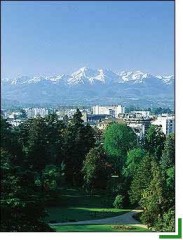
14:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, mai du livre, tarbes
12/05/2009
11 mai 330: naissance de Constantinople
L'empereur Constantin avait décidé de bâtir une nouvelle ville, qu'il appela «Nouvelle Rome». Le 11 mai 330, cette cité devient officiellement la capitale de l'Empire, ce qui n'est pas rien. Cela fait un peu penser à la construction de St Petersbourg par le Tsar Pierre le Grand, cité qui, elle aussi, a été créée à partir d'une décision politique. Et comme St Pétersbourg, qui deviendra plus tard Leningrad, la « Nouvelle Rome » antique prendra elle aussi le nom d'un chef d'état, en l'occurrence celui de l'empereur qui l'a fondée. C'est en effet sous le nom de Constantinople que la cité du Bosphore est entrée dans l'Histoire.
Mais pourquoi créer une nouvelle capitale et cela au détriment de la Rome historique ? Tout simplement parce que l'Empire s'est tellement étendu qu'il est devenu ingouvernable. Le fait d'avoir une capitale avec une position plus centrale est appréciable. De plus, Rome a déjà montré sa vulnérabilité face aux invasions germaniques, qui se font de plus en plus pressantes. Située en plaine, elle n'offre aucune défense naturelle, ce qui risque de lui être fatal. D'ailleurs, un peu avant, l'Empereur Dioclétien avait déjà déplacé le siège du gouvernement dans quatre villes : Milan, Nicomédie (sur la mer de Marmara), Sirmium (en Serbie) et Trèves (Allemagne), dans l'espoir de mieux défendre les frontières menacées. Constantin, lui, avait d'abord fait de Nicomédie son unique capitale. Puis il s'est dit qu'il lui falalit une ville facile à défendre. Il choisit alors la vieille ville de Byzance, qui avait été fondée 1000 ans plus tôt par des colons venus de Mégare (Grèce) et qui se situait de part et d'autre du détroit qui sépare l'Europe de l'Asie. Construite sur un promontoire, elle était donc facile à défendre. De plus elle permet de surveiller le Bosphore, ce chenal qui relie le Pont-Euxin (la mer Noire) à la Propontide (Προποντίς", "-ίδος") aujourd'hui appelée mer de Marmara (laquelle débouche sur la mer Egée par l'Hellespont (autrement dit le détroit des Dardanelles)
Commandant le passage entre l'Europe et l'Asie, située près de la Grèce, autrement dit près du berceau de la civilisation, la nouvelle capitale de l'Empire est également proche des frontières du Danube et de l'Euphrate. Il est donc plus facile d'organiser des expéditions militaires pour contenir les Goths et les Perses. Il paraît que le périmètre de la ville a symboliquement été délimité par un sillon tracé à l'aide d'une charrue (histoire de rappeler la légende de Romulus et Remus). La ville est forcément moderne puisqu'elle est nouvelle. Elle possède des magasins, des aqueducs, l'eau courante et le tout-à-l'égout. Très vite, on ne bâtira que des édifices religieux chrétiens. La première basilique de la Sagesse sacrée (Ste Sophie, Aγία Σοφία ) a d'ailleurs été voulue par Constantin.
La ville s'agrandit très vite et elle devient la capitale de l'empire romain d'Orient. Elle compte un million d'habitants sous le règne de l'empereur Justinien. Le Patriarche de Constantinople devient le deuxième personnage de l'Eglise. Petit à petit, la cité abandonnera ses références latines et deviendra exclusivement grecque. On parlera alors d'Empire byzantin (cf. l'origine grecque de la ville), lequel survivra à l'Empire d'Occident pendant presque 1000 ans, ce qui n'est quand même pas rien. Comme on sait, la ville ne tombera pas sous les coups des musulmans, mais des chrétiens d'Occident. En effet, l'avidité des capitalistes vénitiens était telle qu'ils parvinrent à détourner la quatrième croisade à leur profit. En 1204, la ville fut prise par traîtrise et honteusement pillée (sac de Constantinople). Ce fut le coup de grâce pour la civilisation gréco-romaine et chrétienne orthodoxe d'Orient. Mille ans d'histoire disparurent à ce moment là et même davantage si on considère que cette brillante civilisation était directement issue du génie grec du siècle classique.
C'est l'empire ottoman qui prend le pouvoir (le dernier empereur romain, Constantin XI Paléologue, meurt sur les remparts, les armes à la main) et la ville est alors appelée Istamboul.
Certains linguistes pensent que ce nom d'Istamboul viendrait de Konstinoupolis», qui aurait donné Konstantinopol ) puis Stantinopol. Les Turcs ne parvenant pas à prononcer le son « st », ils l'auraient fait précéder d'un « i » (cf. Stéphane qui devient Esteban en espagnol), ce qui aurait donc donné Istantinopol puis Istantpol, Istanbul.
Une autre version donne Stambul comme nom habituellement employé par les Turcs. Ce ne serait qu'en 1928, avec la réforme de la langue et de l'écriture turques par Atatürk, que la ville se serait définitivement appelée Istamboul.
Notons pour terminer que lors de la fondation de la République de Turquie, en 1923, la capitale fut transférée à Ankara.

Prise de Constantinople par les Croisés
22:36 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, constantinople, empire romain d'orient
Du cercle et du concept d'insularité dans la Grèce antique (2)
Notons que la cité est urbaine (activité humaine, culture) mais qu'elle se situe au milieu des terres agricoles (nature, mais nature domestiquée pour le besoin des hommes). Comme en Grèce elle se situe souvent sur un promontoire, son territoire est souvent encerclé par la mer (la vraie nature), qui l'englobe et l'isole. Elément liquide et empire du vent, la mer est donc le contraire de la cité, laquelle se caractérise par la terre (agricole) et le soleil (la chaleur).
Il semblerait donc que ce ne soit pas vraiment un hasard si le concept d'insularité a été représenté chez les anciens Grecs par le cercle et donc par le bouclier (ou la coupe), dont le centre renvoie aussi au nombril.
Mais nous n'avons jusqu'à présent parlé que de la description du bouclier d'Achille dans l'Iliade. Pourtant, il est difficile de parler d'insularité sans évoquer l'Odyssée et le voyage d'Ulysse, qui va d'île en île à la recherche de sa terre natale (de sa cité). Dans chaque île, celui-ci vit une aventure différente (preuve du caractère spécifique de chaque île, de son isolement dans la mer). Mais la multitude des îles qu'il visite (comme le héros de la « Fontaine pétrifiante » de Priest) finit par faire une longue description d'événements différents (comme le bouclier, qui représentait lui aussi une multitude de scènes). Si chaque île est singulière, leur nombre en fait une image du monde. De même que l'artiste, qui ne pouvait pas représenter le monde dans son entièreté, le résumait sur le bouclier par quelques scènes représentatives, de même Homère résume l'ensemble des possibles par quelques aventures qui se déroulent dans des îles (ou du moins le long du littoral). La mer qui isole les îles sert aussi et paradoxalement de moyen pour atteindre ces îles (cf. aussi les voyages en bateaux dans la « Fontaine pétrifiante »)
Il serait intéressant de se demander pourquoi Homère a imaginé ce périple entre des îles pour raconter le voyage d'Ulysse. Après tout, celui-ci aurait pu voyager sur la terre ferme, comme les chevaliers qui partaient à la recherche du Graal, dans la littérature moyenâgeuse.
A mon avis, c'est que l'île représente un monde à part et qu'elle est le lieu géographique idéal pour incarner l'utopie.
L'utopie est souvent un pays imaginaire dans lequel parvient un voyageur après avoir traversé différentes épreuves. Ulysse avait connu la guerre de Troie, un long périple en mer, et il avait même dû affronter le chant des sirènes. Dans « la fontaine pétrifiante » le héros a tout perdu (emploi, parents, épouse) et il s'isole pour écrire, retournant à un état primitif qui débouchera sur une nouvelle naissance : la découverte des îles (mais celles-ci ne sont que le fruit de son imagination). Sur ces îles, on trouve souvent une société idéale (l'amour pour Ulysse, l'amour et l'immortalité pour le héros de Priest). Considérée comme le terme suprême de l'Histoire (le but vers lequel elle devrait tendre), la contrée d'utopie fait l'objet d'une description qui s'apparente à la philosophie de l'histoire.
Dans cette île utopique, l'âge d'or est de retour. On remonte aux origines pour retrouver le bonheur perdu. Véritable Eden d'avant la faute, cette île entourée d'eau fait penser au fœtus qui baigne dans le liquide amniotique maternel. Régression vers un état premier, l'utopie est supposée retrouver le bien-être perdu. La seule manière d'y arriver, c'est de nier le réel.
Notons qu'il convient d'opposer l'utopie à l'idéologie. Cette dernière est conservatrice et vise à assurer la cohésion du groupe. En s'appuyant sur la tradition et le passé, elle conforte le pouvoir en place.
L'utopie, au contraire, met la réalité en question et va jusqu'à la nier. Elle représente le rêve et en cela elle peut être vue comme le complément nécessaire de l'idéologie. Pour le dire autrement, l'idéologie ne parvient à maintenir ses positions que parce que l'utopie existe avec son rôle de soupape de sécurité. Mais si l'idéologie vise la conservation et la cohésion, l'utopie vise elle la contestation puisqu'elle nie les valeurs de la société pour en proposer d'autres. En fait, elle veut surtout le bonheur de l'individu, tandis que l'idéologie veut le maintient du groupe.
Chez Priest, l'immortalité n'est accordée qu'à quelques individus. Ce bonheur individuel implique donc une grande injustice sur le plan social. L'égalité entre les citoyens est contestée.
Lieu de rêve qu'on atteint au terme d'un voyage, l'utopie reconstruit un endroit connu, mais en le modifiant. Ne visant qu'un individu ou un groupe restreint, elle est toujours un lieu isolé. L'île est donc l'endroit idéal pour que puisse s'épanouir l'utopie, laquelle suppose en effet l'isolement (voir le héros de Priest qui écrit seul dans sa chambre blanche ou Ulysse qui finit par revenir à peu près seul à Ithaque). Lieu clos, entouré d'enceintes (ou de la mer), l'utopie suppose par définition un repli sur soi et le retour à une pureté perdue.
L'amour n'est jamais loin, au pays d'utopie, mais paradoxalement la femme idéale qu'on y rencontre est aussi une mère (l'île est d'ailleurs entourée par la mer). Chez Priest c'est la femme aimée qui va permettre au héros (qui a perdu la mémoire en acquérant l'immortalité) de se reconstituer une personnalité, laquelle est assimilée à une nouvelle naissance. La famille, avec ce qu'elle comporte de rigide et de pesant, disparaît (le héros de Priest est divorcé), tandis que l'amour, même physique, devient possible avec une partenaire idéale.
L'utopie est souvent maritime (isolement, insularité). Désir de régression vers un lieu idéal entouré d'eau, elle est aussi un refus de grandir (ce que j'avais dit, finalement, dans la note de 2007 en me demandant si le fait d'écrire n'est pas non plus une manière de renoncer à affronter le monde en préférant créer des espaces imaginaires). Lieu en dehors du monde connu, l'utopie se situe aussi en dehors du temps. Rien d'étonnant, donc, à ce que le héros de Priest devienne immortel. Lieu où sont abolies les règles habituelles, l'image du père en est forcément absente (le père vient de mourir chez Priest). Tout repose sur l'affectif et donc la femme y tient le premier rôle. Comme tout est parfait, il n'y a rien à contester (dans « la fontaine pétrifiante », le héros qui avait hésité à accepter l'immortalité finit par se soumettre assez facilement à ce bonheur imposé).
Bon, j'ai longuement parlé de l'utopie et de l'insularité, mais Aristote, finalement, qu'est-ce qu'il en disait? Nous ne sommes pas plus avancés.

00:06 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, cercle, insularité, grèce antique
11/05/2009
Du cercle et du concept d'insularité dans la Grèce antique
Je voudrais revenir un instant encore sur la notion d'île, évoquée dans la note précédente. L'artiste en général et l'écrivain en particulier sont souvent « en marge » par rapport à la communauté des hommes, non pas qu'ils vivent forcément en ermites (encore que le travail de création suppose bien souvent une certaine solitude), mais disons que le regard critique qu'ils portent sur la société, et le monde imaginaire qu'ils élaborent dans leur œuvre, impliquent en soi un certain recul, une certaine distance.
On connaît les idées de Platon sur l'art. Pour lui, l'artiste représente un danger pour l'équilibre de la République dans la mesure où il crée un monde fictif, qui ne correspond pas à la réalité. En d'autres mots, c'est un illusionniste qui présente comme vrai ce qui est faux. A ce titre, il est condamnable.
Aristote, quant à lui, a tenu un discours diamétralement opposé à celui de Platon. Loin d'exclure les artistes de la cité, il les trouve au contraire nécessaires. L'art est avant tout une imitation. Le plaisir esthétique viendrait donc de l'émotion que provoque l'œuvre, cette copie de la réalité, qui d'une part touche nos passions et qui d'autre part permet une sorte d'exutoire. Voir une scène horrible sur scène, par exemple, permettrait d'évacuer en nous toutes les tensions et loin de nous inciter à mal agir, nous permettrait plutôt de condamner ce type d'action.
C'est que l'objet représenté n'est pas la réalité mais sa représentation. Il est le fruit du travail de l'artiste et c'est en cela qu'il est beau. Un objet qui serait laid en soi peut devenir beau par la manière dont l'artiste l'a représenté. L'émotion et la passion du spectateur peuvent donc s'exprimer en dehors de la réalité. Ce qu'on ne pourrait tolérer dans cette même réalité (crimes, incestes, etc.) est au contraire accepté sur scène. Cela produit une sorte de "catharsis" qui ferait sortir du cœur des hommes tout ce qu'ils ont de mauvais (et qui aurait finalement pu se traduire par des actes répréhensibles dans la réalité concrète). A ce titre, pour Aristote, l'art est bénéfique pour l'ordre de la cité.
Ceci étant posé, j'ai beau parcourir la « Poétique », je ne retrouve pas cette notion d'île qui a été évoquée dans les commentaires de la note précédente. Platon, lui, parle du concept d'insularité avec le mythe de l'Atlantide et Aristote en parle aussi, mais dans le « Politique » (la cité située au centre de son territoire et à égale distance de toutes ses frontières pour mieux en assurer la défense et pour mieux assurer son propre ravitaillement. En outre, entourée et protégée par ses remparts, la cité parfaite vit en autarcie et se suffit à elle-même).
Ceci dit, cela nous amène à réfléchir sur la notion de cercle et donc sur la perfection de celui-ci. Et de l'image du cercle à celle de l'île, il n'y a qu'un pas, que je vous propose donc de franchir.
L'image du cercle, sa représentation artistique, on la retrouve chez les Grecs au chant XVIII de l'Iliade, avec la description du bouclier d'Achille :
" Et (Ephaistos) jeta dans le feu le dur airain et l'étain, et l'or précieux et l'argent. Il posa sur un tronc une vaste enclume, et il saisit d'une main le lourd marteau et de l'autre la tenaille. Et il fit d'abord un bouclier grand et solide, aux ornements variés, avec un contour triple et resplendissant et une attache d'argent. Et il mit cinq bandes au bouclier, et il y traça, dans son intelligence, une multitude d'images. Il y représenta la terre et l'Ouranos, et la mer, et l'infatigable Hélios, et l'orbe entier de Séléné, et tous les astres dont l'Ouranos est couronné : les Pléiades, les Hyades, la force d'Orion, et l'Ourse, qu'on nomme aussi le Chariot, qui se tourne sans cesse vers Orion, et qui, seule, ne tombe point dans les eaux de l'Okéanos.
Et il fit deux belles cités des hommes. Dans l'une on voyait des noces et des festins solennels. Et les épouses, hors des chambres nuptiales, étaient conduites par la ville, et de toutes parts montait le chant d'hyménée, et les jeunes hommes dansaient en rond, et les flûtes et les cithares résonnaient, et les femmes, debout sous les portiques, admiraient ces choses.
Ensuite, le forgeron représente deux armées, deux sentinelles, un « champ de hauts épis que des moissonneurs coupaient avec des faux tranchantes », « une belle vigne d'or chargée de raisins, avec des rameaux d'or sombre et des pieds d'argent », « un troupeau de bœufs aux grandes cornes », « un grand pacage de brebis blanches, dans une grande vallée », un chœur de danses où « les adolescents et les belles vierges dansaient avec ardeur en se tenant par la main. Et celles-ci portaient des robes légères, et ceux-là des tuniques finement tissées qui brillaient comme de l'huile. Elles portaient de belles couronnes, et ils avaient des épées d'or suspendues à des baudriers d'argent. Et, habilement, ils dansaient en rond avec rapidité, comme la roue que le potier, assis au travail, sent courir sous sa main. Et ils tournaient ainsi en s'enlaçant par dessins variés ; et la foule charmée se pressait autour »
Véritable œuvre d'art, ce bouclier est d'ailleurs réalisé par un dieu et non un homme. Circulaire, il est symbole de perfection et en tant qu'arme, il permet de défendre la cité, à laquelle il renvoie donc par sa forme ronde (la cité entourée de remparts, close sur elle-même). Cité qui est elle-même un tout, une somme d'éléments divers rassemblés en une unité politique. Métaphore de la cité, le bouclier circulaire décrit lui aussi toute une série de scènes (les armées, les danses, les moissons, etc.), qu'il globalise en un tout. Perfection esthétique, il est à la fois la cité parfaite et le monde, qu'il tente de figurer par l'énumération de toutes ses caractéristiques (du moins celles qui ont un rapport avec les hommes).
Mais ce n'est pas le bouclier lui-même, qu'Homère nous met sous les yeux, mais sa description littéraire, son évocation poétique. Nous avons donc un texte écrit (enfin, récité, car les chants homériques relèvent de la poésie orale, comme les chansons de geste) qui renvoie à une oeuvre d'art, laquelle est un bouclier imaginaire supposé représenter lui-même la perfection de la cité. Belle mise en abyme donc, où tout renvoie à tout et où tout inclut tout.
Par sa dimension et son côté circulaire, le bouclier évoque le concept de l'île. En résumant une multitude de scènes dans un espace réduit (un peu comme tous les animaux qui rentraient dans l'arche de Noé), l'artiste donne donc un sens à ce qui était infini et donc peu compréhensible. En peignant et en gravant toutes ces scènes sur le bouclier, l'artiste divin leur donne un sens. De plus, par leur côté artistique, il nous les fait aimer. Véritable résumé du grand Tout, le bouclier, de taille réduite et d'aspect circulaire, renvoie au monde comme à la cité. Comme on ne sait pas dire le monde en le décrivant entièrement, on se contente d'en faire un résumé sur une surface réduite, mais cette surface réduite est supposée renvoyer au tout.
Or, pour les Grecs, l'île est bien elle aussi un tout. Véritable résumé du monde (elle est à elle seule un monde en petit), elle renvoie par son côté circulaire et par l'autarcie qu'elle suppose, à la cité (qui, elle aussi, est circulaire et qui vit en autarcie à l'intérieur de ses remparts). Entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, la cité résume le monde (comme le faisait le bouclier) et elle en représente la perfection (cf. l'image du cercle).
(à suivre)

00:58 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, cercle, insularité, grèce antique
07/05/2009
"La fontaine pétrifiante" de Christopher Priest
Nous avions parlé, il y a bien longtemps (le 26.10.07), de la lecture et de l’écriture considérées comme un refuge intérieur et j’avais posé cette question : « Cette activité intellectuelle qui nous apparaît à nous comme une échappatoire, une percée décisive contre la bêtise ambiante, ne peut-elle être qualifiée de fuite en avant, de refuge, voire de régression ? »
En effet, alors que les hommes, habituellement, agissent pour s’imposer dans le monde, le lecteur (ou celui qui écrit), en se complaisant dans l’imaginaire, semble rester en retrait et donc demeurer fondamentalement passif. A moins qu’on ne considère qu’il agite des idées subversives, allant à l’encontre de la société de ses semblables et de leurs pensées communes…
J’avais alors avancé la notion « d’île » pour illustrer l’isolement bien réel de cet écrivain/lecteur, que celui-ci soit passif ou subversif, finalement, car dans tous les cas il vit dans un autre monde.
Visiblement, c'est cette idée d’île qui avait amené Ellisa (une commentatrice aussi discrète que fidèle) à me conseiller par la suite le livre de Christopher Priest, « La fontaine pétrifiante » (voir les commentaires de la note en question). Pris par mes autres lectures, il me fallut encore six mois pour aborder ce volume, mais je dois dire que je ne regrette pas de l’avoir enfin ouvert.
Le héros, en plein divorce, se réfugie à la campagne et il cherche dans l’écriture un moyen de retrouver son équilibre. Il s’enferme dans une pièce toute blanche (blanche comme les pages qu’il va remplir) et décide de raconter sa vie pour comprendre qui il est vraiment. Mais, assez vite, il se rend compte qu’il ne peut pas citer les personnages réels qu’il a connus, par discrétion principalement. Il prend donc l’initiative de modifier leurs noms. Mais il se sent encore limité. En effet, ce qu’il dévoile de ces personnages, c’est son point de vue à lui et par forcément ce qu’ils sont vraiment. Du coup, il décide de passer par l’intermédiaire d’une fiction pour mieux raconter ce qu’il a vraiment vécu (belle réflexion sur l’écriture, donc et sur la nécessité de recourir à l’imaginaire pour atteindre la vérité).
Il imagine donc un monde irréel, composé essentiellement d’îles enchantées, où les protagonistes ont envie d’oublier le continent où ils vivent habituellement (et on devine que pour cet auteur anglais, ce continent, c’est l’Angleterre, en fait). L’écrivain narrateur (pas Priest, mais le héros qui divorce et qui écrit pour survivre) se retrouve dans cette histoire et il rencontre une jeune femme à laquelle il donne les qualités qu’il aurait voulu trouver chez son ex-épouse. Mais, petit à petit, on ne sait plus si on est dans la réalité ou dans l’histoire inventée. Les faits se croisent, s’interpénètrent, etc. Lui-même finit tellement par croire à l’histoire de son roman qu’il ne sait plus trop qui, de son épouse réelle ou de l’héroïne imaginée, est la femme dont il est amoureux.
Le lecteur s’y perd aussi car dans l’histoire écrite par le héros, on ne retrouve pas seulement les personnages de sa vie sous un autre nom et vus sous une autre optique, mais le héros lui-même avec son manuscrit (celui qu’il est en train d’écrire dans sa maison isolée à la campagne, donc).
Finalement, il y a Priest qui nous raconte l’histoire de quelqu’un (lequel parle à la première personne) et qui écrit un livre pour survivre (premier niveau), il y a ce même personnage qui nous donne de larges extraits de son roman en chantier (deuxième niveau) et dans cette histoire racontée (avec le cheminement entre les îles) on retrouve le manuscrit en question et cela constitue donc un peu comme un troisième niveau (puisque le manuscrit dont il est question au premier niveau se retrouve dans le deuxième). Vous suivez ? Rassurez-vous, chez Priest, c’est plus limpide qu’ici.
Au premier niveau, le héros-narrateur est donc divorcé tandis que dans son manuscrit, comme je l’ai déjà dit, il est amoureux d’une femme qui a les qualités qu’il aurait voulu que sa vraie femme possède. Le problème devient complexe quand sa vraie femme revient et qu’il ne sait plus qui il préfère, du personnage réel ou du personnage inventé. Car finalement les qualités rêvées chez son héroïne, son ex-épouse les possède aussi mais il semblerait qu’il ne les avait pas suffisamment remarquées.
Ce livre est donc une véritable mise en abyme. Centré sur l’écriture, il parle aussi, comme tous les grands livres, de l’existence et de la mort. Ainsi, dans les îles, le héros du manuscrit a la possibilité de suivre un traitement médical qui le rendra immortel. Ces îles entre lesquelles sa compagne (la fictive, celle du manuscrit) désire voyager éternellement vers des ailleurs enchanteurs (on retrouve le thème de bateau cher à Rimbaud) symbolisent les rêves et donc l’imaginaire. Ecrire est donc bien une fuite vers un monde meilleur, un monde où tout serait possible (l’immortalité, une femme adorable à aimer, des paysages enchanteurs).
Le problème (car il y en a un), c’est que pour devenir immortel, le héros doit perdre la mémoire de son passé et donc de lui-même. Pour ne pas oublier son identité, on lui demande donc de raconter préalablement sa vie afin qu’il puisse se reconstituer une personnalité à partir du récit de son passé. Mais ce récit, notre héros l’a déjà fait, c’est le fameux manuscrit dont nous parlons. Malheureusement, on se souvient que ce n’est pas une autobiographie au sens strict, mais avant tout une fiction. C’est donc à partir de cette fiction qu’il va se reconstruire. A la fin, il finit par croire qu’il est le personnage inventé dans son manuscrit et plus celui qui a divorcé. C’est la réalité qui fait alors figure de fiction (manière de dire que les réalités inventées par l’écriture ont une existence propre et qu’elles sont finalement plus réelles que notre morne existence).
« Mon imagination m’avait installé dans l’existence. J’écrivais sous l’empire d’une nécessité intérieure, et cette nécessité me commandait de créer une vision plus claire de moi-même. Ecrire, c’était devenir ce que j’écrivais », explique le héros au début. Il ne croyait pas si bien dire. L’imaginaire a si bien remplacé la réalité qu’il en arrive à noter : « Je fis comme si elle était Gracia, même si elle l’était en réalité. »
A la fin, on se demande si le héros n’a pas perdu l’esprit puisque dans la vraie vie du premier niveau (à Londres et non dans les îles imaginaires) il finit par rechercher la femme qu’il a créée dans son roman. Il croit la voir, lui parle, tandis que les gens se retournent sur lui, intrigués par son délire. Pourtant il décide de la quitter et de tenter de revenir vers son ex-femme (laquelle le prend pour un fou car elle a remarqué que le fameux manuscrit qu’il transporte toujours avec lui ne contient que des pages blanches). Dramatiquement, le livre s’achève sur une phrase inachevée, phrase inachevée que nous avions déjà rencontrée dans le premier niveau, ce qui fait que tout se rejoint et que le lecteur ne sait plus du tout où il se trouve et qu’il finit par douter de tout.
Si la réalité inventée par mon imaginaire est préférable à la vraie réalité, on peut dire qu’écrire est fabuleux mais aussi que c’est une sorte de fuite en avant pour ne pas accepter cette réalité. Cela s’apparente donc à un refuge sur une île, comme je disais au début et comme veut le signifier Priest lui-même avec ses îles où on vit éternellement. Mais si ce monde que j’ai imaginé finit par devenir réel pour moi, c’est alors la réalité qui est imaginaire (et du coup elle devient digne de mes aspirations). « La vie est un songe » (la vida es sueño) disait Calderone de la Barca. Il ne croyait pas si bien dire.
Fabuleux livre, que nous a conseillé là Ellisa. Qu’elle en soit remerciée !

00:26 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : littérature, priest, la fontaine pétrifiante
04/05/2009
La femme et la louve
Toi, la louve aux yeux en amandes
où se réfléchissent tous les lointains,
tu désires un ailleurs où tu n’iras jamais :
l’étendue de la plaine éclairée par la lune,
le firmament des étoiles, les rumeurs de la forêt
et les steppes infinies de toute l’Eurasie.
La vie sauvage est là et la proie qui palpite
entre tes blanches canines
agonise sans comprendre le pourquoi de sa mort.
Hurlement de la meute au cœur de la nuit sacrée,
cauchemar qui devient rêve, puis songe…
La louve est là, sa toison, son regard.
L’amande de tes yeux
et ta tresse que tu défais d’un geste ample et souple
au cœur de la nuit ténébreuse.
Dans le rayon de la grande lune, dévêtue,
tu t’offres comme une proie
et ton cœur sauvage palpite
comme si c’était la mort qui s’avançait dans la profondeur de la forêt,
tandis que les loups n’en finissent plus de hurler.
Par la fenêtre ouverte tu contemples le firmament étoilé
Tu cherches un ailleurs,
un au-delà de toi-même.
Etendue dans la nuit sacrée,
Tu attends dans ta nudité, dans l’aura de ta chevelure d’or
et ton désir n’a d’égal que la peur de la mort qui approche
à pas de loups.
Tu as des yeux en amandes,
de beaux yeux qui pleurent, parfois,
quand l’aube pointe derrière la vitre
et que toute la meute a disparu
dans l’immense plaine de la vie.
Et tu restes là, seule,
à contempler les lointains inaccessibles
comme une louve
qui n’aurait pas trouvé sa raison d’être.
Tu es une louve, perdue dans le firmament des étoiles.
00:22 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature, poésie
29/04/2009
Des romans de Mac Carthy
D’un livre à l’autre, on retrouve toujours les mêmes thèmes chez Mac Carthy. Dans « La trilogie des confins », le héros est jeune : ce n’est même pas un adulte, plutôt un grand adolescent (16-17 ans), mais son comportement dénote une grande maturité. A chaque fois, il quitte le milieu familial, moins à la suite d’un conflit que par une décision bien réfléchie, celle de prendre sa vie en main. Ainsi, dans « Le grand passage », après avoir aidé son père à poser des pièges, afin de capturer le loup qui s’en prend au bétail, il finit par reconduire la louve prise au piège dans son pays d’origine (le Mexique) plutôt que de la tuer. Il part donc seul (sans avertir ses parents) avec cette louve, véritable fauve dont il s’agit de se protéger mais avec lequel un certain respect mutuel s’établit.
Dans « De si jolis chevaux », c’est vers le même Mexique que deux adolescents chevauchent, dans une sorte de fugue à caractère initiatique. Ces « marginaux » ne sont pas des bandits, bien au contraire. On est même étonné de la politesse qui les caractérise quand ils s’adressent à des adultes (« Oui Monsieur, bien sûr Madame », etc.), ce qui ne les empêche pas de se retrouver en prison (pour s’être promené avec une louve ou pour avoir soi-disant volé un cheval alors qu’en réalité ils n’ont fait que tenter de récupérer celui qu’on leur avait pris). Innocents par nature, ils paient ainsi le prix de leur désir de liberté et de leur transgression des règles sociales (la soumission au groupe dans une vie bien réglée).
On notera l’ambiguïté que représente le Mexique. D’un côté, c’est un pays tout différent : on y parle l’espagnol et non l’anglais, les gens y sont plus pauvres, on y fait souvent la révolution (ce qui ne doit pas déplaire au héros, avide de liberté), la nature y est plus sauvage encore et une frontière bien réelle en marque la limite (c’est soit une clôture pour le bétail qu’il faut franchir, soit un fleuve qu’il faut traverser). Cependant, il est clair que de chaque côté de cette frontière on retrouve de grands espaces ou le bétail vit en semi-liberté et la situation n’est donc pas fondamentalement différente, finalement.
Il en va de même pour la langue. Né à la frontière, le héros anglophone s’exprime parfaitement en espagnol (ne pas oublier que ces régions du Sud des Etats-Unis ont été conquises sur le Mexique au milieu du XIX° siècle). Ce bilinguisme fait donc de lui un individu privilégié et le rend capable de s’adapter au-delà de cette frontière qu’il vient de franchir. Une fois de l’autre côté, ce pays qui est un peu le même est pourtant plus beau, plus grand, plus vaste. Il représente surtout l’inconnu et à ce titre il fascine le héros qui va pouvoir y exercer ses talents d’aventurier et y affirmer sa personnalité. Cette marche (ou cette chevauchée) le long du chemin renvoie évidemment à une démarche existentielle (voir aussi le dernier roman de Mac Carthy, qui s’intitule précisément « La Route » et où un homme d’âge mûr et son fils tentent de survivre et de conserver leur humanité dans le monde en ruine qui a succédé à l’Apocalypse).
Le lecteur est surpris par la description qui est donnée de ces régions du Nord du Mexique. On s’attend à y trouver une chaleur écrasante mais même si celle-ci existe durant la journée, on parle beaucoup de la froideur de la nuit dans les montagnes, des cols enneigés qu’il faut franchir ou des éclairs qui illuminent l’horizon (et cela dans les trois recueils de la trilogie).
En effet, il y a toujours un orage qui menace quelque part, comme si l’imminence d’un danger donnait une dimension supplémentaire aux actions du héros.
La solitude est l’essence même de ce dernier et ce n’est pas un hasard s’il évite les villes (qu’il ne fait souvent que traverser) et préfère chevaucher au milieu d’une nature restée sauvage. Il campe à l’extérieur, auprès d’un feu de bivouac qu’il a allumé et contemple dans le lointain de la plaine les lumières des villes qui sont là sans faire partie de son univers.
Cette errance, véritable quête existentielle, lui permet d’aller jusqu’au bout de lui-même. Dépassant sa peur, misant sur son courage, (ici : côtoyer un loup), il se distingue des autres hommes par cette errance perpétuelle. Pourtant, par ses actions (ne pas tuer le loup qu’il a capturé, aider un jeune adolescent, tenter de délivrer une jeune fille innocente, devenue prostituée bien malgré elle, de l’emprise de son souteneur) il fait preuve d’une culture humaniste. Car s’il vit dans la nature, ce n’est pas pour redevenir sauvage. D’ailleurs il impose sa loi humaine à cette nature (dompter un cheval, obliger un loup à le suivre), ce qui le classe bien du côté de la culture (au sens large que donne Lévi-Strauss à ce terme). Il s’agit surtout d’imposer sa volonté personnelle au monde extérieur et là on retrouve, me semble-t-il, une des grandes caractéristiques des romanciers nord-américains. Alors que la littérature française a pu parfois sombrer dans un nombrilisme regrettable ou des considérations théoriques et un peu stériles sur l’écriture, Mac Carthy oppose bien les aspirations intérieures et le monde extérieur, étant entendu qu’il s’agit toujours pour l’individu, autant que faire se peut, de tenter d’imposer sa volonté au monde dans lequel il vit. Il n’y arrive jamais tout à fait, bien entendu et il lui faut faire des concessions.
Ainsi de la jeune fille riche dont il tombe éperdument amoureux dans « De si jolis chevaux ». Mexicaine (pour le héros, elle est donc déjà revêtue de l’aura mystérieuse qu’il prête à ce pays mythique qu’est pour lui le Mexique), elle est inaccessible à la fois géographiquement (elle réside souvent loin de l’exploitation où il travaille) et socialement (il est pauvre et elle est riche et en plus c’est la fille de son patron). Arrêté sur les conseils de ce dernier pour un acte qu’il n’a pas commis (dans le but d’éviter le mariage), il ne devra sa sortie de prison qu’à l’intervention d’une tante de la jeune fille. Malheureusement, si la tante a accordé son aide, c’est contre la promesse qu’a faite la jeune fille de se séparer de son amoureux. Devant respecter tous les deux la parole donnée, les deux amants doivent se séparer la mort dans l’âme (et leur dernière rencontre est d’une force rarement atteinte dans la littérature amoureuse). Dans ce cas, le milieu extérieur (et ici le monde social de l’argent et de la famille) l’a donc emporté sur le désir amoureux de l’individu.
Cette manière de tenter de s’imposer au monde, tout en essuyant des revers qui font grandir et qui font mûrir, me semble être un des traits caractéristiques des romans de Mac Carthy. Livres initiatiques, ses héros aux idées généreuses nous attirent et nous émeuvent. N’est-ce pas le but ultime de la littérature ? Nous faire vivre par procuration en mettant le doigt sur ce qui, dans notre propre existence, compte vraiment ?

Désert du Mexique, image Internet
16:46 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, mac carthy
27/04/2009
La louve
En arrivant à l’eau elle la flaira d’un air méfiant et leva la tête pour le regarder. Elle observa à nouveau les flammes et la silhouette du cheval au-delà du feu. Ses yeux luisaient dans la lumière. Elle baissa le nez pour flairer l’eau. Ses yeux restaient fixés sur lui et ne cessaient pas de brûler et quand elle baissa la tête pour boire, le reflet de ses yeux apparut dans l’eau sombre comme un double de loup qui aurait eu son gîte à l’intérieur de la terre ou attendu en secret jusqu’en d’aussi artificiels trous d’eau pour que la louve puisse toujours y trouver confirmation de son existence et ne soit jamais tout à fait abandonnée dans l’univers.
Cormac Mac Carthy, « Le grand passage », page 92

16:49 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, mac carthy
22/04/2009
Les écrivains (encore!)
On a souvent réfléchi ici sur la définition de l’écrivain, réflexion un peu vaine et théorique, j’en conviens, mais qui indirectement nous oblige à méditer sur l’essence de la littérature. L’autre jour, Jean-Louis Kuffer avait abordé le même sujet et avait ajouté un élément intéressant à ce débat. Il reprenait en fait la distinction de Jacques Audiberti, lequel distinguait
- l’ écriveur (qui utilise la langue comme un simple outil pour pouvoir communiquer).
- l’écrivant (qui, habituellement cultivé, entretient un rapport privilégié avec la langue, qu’il maîtrise parfaitement. Il n’a pas, cependant, de prétention littéraire particulière. Cela signifie qu’il s’exprime clairement, dans un style limpide, agréable même et donc que le message qu’il veut communiquer passe facilement, la langue ne faisant certainement pas obstacle à une bonne compréhension du contenu. A la limite, il parviendrait même à mieux se faire comprendre que certains auteurs qui restent quelque peu obscurs, que ce soit volontairement ou non.
- l’écrivain qui se donne le droit de transformer le langage (ce bien pourtant commun à tous) à sa guise pour en faire une sorte de propriété personnelle, ce qui fait que sa « griffe » se reconnaît parfaitement. C’est probablement ce que l’on veut dire quand on parle de « style ». Pas le « beau style » au sens académique, comme le fait remarquer JL Kuffer, (car ce style-là, c’est plutôt l’écrivant qui le maîtrise à la perfection), mais le style « organiquement accordé à un souffle et un rythme qu’on retrouve de Rabelais à Céline et de Proust à Thomas Bernhard entre mille autres… »
Grâce à cette définition, on comprend mieux ce qui se tramait dans la fameuse querelle sur les «fautes» de Flaubert. On sait que celui-ci avait une manière bien à lui d’employer les imparfaits de l’indicatif. Au début du XX° siècle, on le lui a reproché, allant jusqu’à dire qu’il maîtrisait mal la langue (il était donc un mauvais « écrivant »). Mais enfin, c’était Flaubert, tout de même, un des plus grands classiques. Pouvait-on dire que s’il était un bon narrateur, il écrivait cependant fort mal ? C’est Marcel Proust qui est venu prendre la défense du maître et expliquer que pour lui il n’y avait pas de fautes chez Flaubert dans la mesure où elles étaient voulues. C’est justement parce que Flaubert était un grand écrivain (ce que personne ne contestait) qu’il s’était permis de « jouer » avec la langue, de la pousser dans ses derniers retranchements pour mieux exprimer ce qu’il ressentait.
Etre écrivain consisterait donc, non pas à être édité, mais à savoir tordre la langue jusque dans ses derniers retranchements pour lui faire dire tout ce qu’on a envie de dire. Personnellement, avec mon style relativement classique, il me semble que je me situe surtout du côté des «écrivants». A chacun de réfléchir maintenant sur son cas personnel. Bon, que cela ne vous gâche pas la journée quand même, hein !
23:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (35) | Tags : littérature, écrivains
19/04/2009
L'antivoyage
Les gares, ces lieux où l’on n’existe pas
au milieu d’une foule qui ne fait que passer.
Endroits de transit pour des départs vers d’autres possibles.
Rêves de voyages, retours désespérés.
Dans la salle d’attente, mes pas se sont perdus.
Je regarde ces rails qui ne mèneront nulle part.
Je suis un voyageur en attente, qui sait qu’aucun train ne passera plus.
Déambulent des gens en ce lieu qui semble à peine exister.
Impossibilité d’une rencontre dans cette foule en transit.
Dans mon désespoir, je rêve encore de voyages
et passe devant un train en attente sans pourtant monter dedans.
Je suis en partance vers d’autres possibles
et voyage en rêve sur des rails d’éternités.
Tout cela ne mène nulle part
et je perds mon temps à attendre une voyageuse qui ne viendra plus.
Dans la gare, la foule n’existe pas
et moi, je ne fais que passer,
voyageur éphémère
qui n’a nulle part où aller.

01:44 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : littérature, poésie
17/04/2009
Des auteurs connus et de leurs manuscrits
Nous avons déjà parlé ici des auteurs et des éditeurs. Quiconque éprouve le besoin d’écrire se retrouve être un «écrivant», puis, le temps passant, il espère souvent devenir un écrivain, ce qui demande une reconnaissance publique qu’il ne peut obtenir sans être publié, autrement dit sans avoir été accepté par un éditeur.
Évidemment, quand on raisonne de la sorte, on pense de prime abord aux « écrivants » inconnus ou aux auteurs méconnus, étant entendu que tout écrivain reconnu (vous me suivez ?) ne doit avoir, lui, aucune difficulté pour continuer à se faire éditer (parce que son écriture est excellente et qu’il a atteint sa maturité disent certains ; parce que l’édition est d’abord un système commercial qui mise sur les célébrités du moment, disent d’autres, plus méchantes langues).
Une chose qui étonne, cependant, c’est qu’il est rare qu’un même auteur fasse toute sa carrière chez le même éditeur. Il y en a même qui changent de maison à chaque fois qu’ils sortent un livre. Inconstance des auteurs, gémissent les éditeurs (qui voient s’envoler la poule aux œufs d’or) ou même désir sordide et mesquin de vouloir gagner plus d’argent ailleurs avec un contrat mieux ficelé. Il y a du vrai dans tout cela, sans aucun doute, mais ne pourrait-on pas imaginer qu’un auteur déjà reconnu puisse voir son manuscrit refusé par son éditeur habituel ? Dans ce cas, il faudrait supposer, soit que ce manuscrit est de moins bonne qualité que la production antérieure et que l’éditeur, qui fait consciencieusement son travail, ne veut pas voir son nom associé à un pareil navet, soit que l’auteur a pris un cheminement différent dans sa manière d’écrire (dans le style ou dans les sujets traités) et que dès lors sa production ne correspond plus à la ligne éditoriale en vigueur chez son éditeur.
Dès lors, le voilà contraint d’aller sonner à d’autres portes, où généralement on lui ouvrira sans trop de problème, vu sa notoriété antérieure. Encore faut-il frapper à la porte qui soit la bonne et trouver une maison dont la philosophie corresponde à celle qui sous-tend ce dernier manuscrit et là, cela ne semble pas gagné d’avance.
Voici un exemple réel, trouvé sur le site d’Alina Reyes. (je ne sais par quel hasard je m'y suis retrouvé, les voies de Dieu sont vraiment impénétrables). J'’ai déjà parlé plusieurs fois de cette auteure, lui ayant même consacré un article dans la Presse littéraire autrefois et on connaît par ailleurs mes réserves face à ses récentes orientations mystiques, je n’y reviens pas. Après avoir joué sur la ligne d’un certain érotisme, elle écrit maintenant sur des sujets religieux (ceci dit, ces deux domaines ne sont pas incompatibles à mes yeux) et après avoir publié un livre sur Lourdes et Bernadette Soubirous, elle vient d’en écrire un autre sur Marie-Madeleine (belle manière d’associer la chair et la foi). Il lui fallait donc trouver un éditeur et là, voilà que cela se complique. Les trois éditeurs contactés se sont montrés enthousiastes sur son texte, mais tous ont déclaré qu’ils n’éditeraient pas ce livre.
L’un, qui est avant tout un éditeur purement commercial, spécule déjà sur le nombre limité de lecteurs qu’un tel ouvrage pourrait avoir et, vu paraît-il la qualité du texte, renvoie l’auteur vers des collègues spécialisés dans le domaine littéraire.
L’autre, parce que chrétien, trouve cette Marie-Madeleine un peu trop sensuelle.
Le troisième, quant à lui, très orienté vers des ouvrages littéraires, apprécie l'écriture « éblouissante », mais trouve que le contenu est « trop chrétien pour lui ».
En résumé, le manuscrit serait bon (mais auraient-ils dit la même chose, ces hypocrites, à un écrivain débutant ?), mais il ne correspondrait jamais avec la ligne éditoriale des maisons contactées. Celle-ci, c’est à craindre, vise surtout à caresser le lecteur dans le sens du poil et donc à lui proposer les livres qu’il a envie de lire. Cela signifie que si un auteur sort des sentiers battus, comme c’est le cas ici avec ce livre qui traite d’un sujet religieux, il aura les pires difficultés à trouver un éditeur.
On connaît mes sentiments face à la religion, dont je ne suis certes pas en train de faire l’apologie dans ce blogue. Je donne simplement cet exemple du manuscrit de « Marie-Madeleine » pour illustrer la politique éditoriale. Il faut rentrer dans un moule, en fait. Si l’auteure avait fait dans le style bigot, elle aurait trouvé preneur sans difficulté dans les milieux catholiques. Si elle s’était écartée du personnage biblique et s’était contentée de s’en inspirer pour dessiner les contours d’un héros littéraire, il n’y aurait pas eu de problème non plus. Si elle avait résolument choisi de choquer en faisant de Marie-Madeleine une héroïne purement érotique, on se serait bousculé pour vendre ce livre à succès. Non, ce qui ne va pas ici, c’est que le sujet est hybride : d’une dimension à la foi religieuse et humaine, il est trop profond et trop complexe (trop sincère aussi, à mon avis, l’auteure devant certainement y exprimer toutes ces convictions) pour les maisons d’édition, qui veulent finalement des produits formatés sur mesure.
Enfin, ne nous tracassons pas trop pour Alina Reyes, ses succès antérieurs vont certainement finir par lui ouvrir quelques portes. Mais que se passerait-il s’il s’agissait d’un premier manuscrit ? La réponse n’est pas difficile à trouver.

Marie-Madeleine, par Léonard de Vinci
00:01 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (33) | Tags : littérature, édition, alina reyes
14/04/2009
Eloge du temps
Eloge du temps qui passe et qui grignote un peu plus notre vie, saison après saison ? Non, bien sûr, ce n’est pas de ce temps-là que je veux parler ici. Celui-là est mortifère et nous savons tous, en effet, qu’un certain nombre d’années nous est imparti et qu’il s’agit d’exploiter au mieux le peu qui nous est donné si nous voulons simplement « être » et avoir le temps d’affirmer ce que nous sommes (ou du moins tenter de le faire).
Ceci dit, nous ne connaissons pas le nombre exact de ces années, lequel varie d’un individu à l’autre, ce qui, finalement, fait ressembler notre existence à une loterie de mauvais goût et nous rend tous terriblement inégaux (les uns mourant à vingt ans quand d’autres finissent centenaires).
Mais laissons-là pour aujourd’hui ces considérations un peu morbides, j’aurai bien l’occasion d’y revenir une autre fois.
Non, le temps dont je voulais parler ici est un temps positif, celui que l’on se donne pour découvrir toute chose. Dans notre vie moderne et citadine, tout se fait en vitesse, depuis le petit déjeuner qu’on prend sur le pouce avant de s’engouffrer en courant dans un métro jusqu’au travail toujours plus performant que l’on accomplit sous l’œil inquisiteur d’un manager qui cherche à rentabiliser au maximum son personnel. La rapidité semble être devenue la qualité essentielle de notre société post-moderne.
Je suis toujours étonné (les rares fois où j’ai le temps de me promener à l’extérieur pendant mon temps de midi), de voir toutes ces personnes qui grignotent un sandwich en pleine rue, ne prenant même plus le temps de s’asseoir pour manger (ce qui arrange bien par ailleurs le vendeur de sandwiches, qui ne doit plus mettre une salle à la disposition de sa clientèle et qui se contente de vendre à même le trottoir un produit par ailleurs de mauvaise qualité).
Ce qui m’étonne aussi, c’est la solitude de ces gens pressés, qui ne regardent même plus les personnes qu’elles croisent et qui, forcément, ne parlent pas et ne dialoguent pas davantage. Quand je voulais faire l’éloge du temps, c’est de ce temps-là que je voulais parler. Celui que l’on se donne pour découvrir (l’autre, la nature, un sujet d’étude, etc.)
Je me souviens, enfant, de ces longues promenades dans les bois où il fallait attendre sous un arbre que cesse l’averse qui nous avait pris au dépourvu. J’entends encore le bruit des gouttes de pluie sur les feuilles et le grand silence qui nous entourait, impressionnant. Il n’y avait rien d’autre à faire qu’attendre que cesse la pluie, ce qui donnait le temps d’observer les alentours, où il ne se passait évidemment rien d’exceptionnel. Pourtant, petit à petit, mille choses venaient frapper mon esprit en éveil : le cri d’un oiseau indigné d’avoir été mouillé, le lent cheminement d’un escargot sur l’herbe humide, la senteur de la résine du pin contre lequel je m’appuyais, le cheminement d’une chenille en dessous d’une feuille, un craquement insolite dans le lointain, le bruit soudain et étonnant d’une tronçonneuse à l’autre bout de la forêt, signe que là-bas l’averse avait déjà cessé, le brouillard qui s’élevait des arbres mouillés, dans la chaleur du mois d’août, etc. Tout cela apprend à être patient et vous donne une philosophie de vie fondée sur l’observation.
Il en va de même dans les relations humaines. Je suis quelqu’un de lent, il me faut du temps, beaucoup de temps, pour accorder ma confiance à quelqu’un. Mais ce temps, précisément, il faut savoir se le donner, pour écouter l’autre, lire ses lettres, l’observer dans ses actions. Je ne suis pas de la génération SMS et m’étonne toujours de ces jeunes qui envoient message sur message (à qui ? Pour dire quoi ?) à des correspondants qui semblent aussi nombreux que superficiels. Nous vivons, paraît-il, dans une société de communication. Mais je crois que les lettres de madame de Sévigné permettaient une approche plus riche, plus exhaustive entre les deux protagonistes qui s’écrivaient que ces messages instantanés qui ne véhiculent aucun contenu. Certes, ces lettres classiques avaient le « défaut » d’être décalées par rapport à l’actualité et on n’apprenait un événement que trois ou quatre semaines après qu’il se fut produit, mais justement cela permettait de focaliser son attention sur la personne qui écrivait et non sur l’événement en lui-même, souvent futile par ailleurs. Ce n’est donc pas sur ce qui s’était passé que ces lettres donnaient des indications en premier, mais sur la manière dont le correspondant l’avait vécu et ressenti. Dès lors, son interlocuteur pouvait mieux percevoir sa personnalité et sa sensibilité, ses peurs et ses craintes aussi. Il se faisait donc de la personne une certaine idée qui collait au plus juste avec la réalité et ni la distance qui les séparait, ni le décalage temporel n’étaient finalement une entrave à une bonne compréhension de la personne.
L’avantage de nos sites et blogues respectifs, c’est qu’ils demandent justement du temps : du temps pour rédiger un billet, du temps pour commenter et du temps pour répondre. Rien de tout cela ne se fait en direct, dans la précipitation. Il en va de même pour les éventuels messages que nous nous envoyons les uns les autres. On espère toujours recevoir une réponse, mais on n’exige pas qu’elle soit rapide, car toujours il faut se donner le temps de la réflexion, la richesse même de la réponse en dépend.
16:31 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : temps qui passe
09/04/2009
Jean-Louis Kuffer, "Le Sablier des Etoiles".
Dans ce livre, qui se lit comme on écoute un morceau de musique, JL Kuffer nous donne à voir quelques tranches de sa vie passée dans un style croustillant assez inimitable. Il n’y a pas ici d’histoire à raconter au sens strict, mais par petites touches l’auteur nous fait remonter dans ses souvenirs, nous livrant des morceaux d’enfance, des impressions fugaces, des bouts de sa vie d’étudiant ou bien il dépeint la bohème de ses premières années, sans oublier les livres, bien entendu, qui ne sont jamais bien loin.
Se promenant au hasard dans les quartiers qu’il a connus, le narrateur capte les changements subtils qui se sont opérés, puis il part dans la chasse aux souvenirs, se demandant ce que sont devenues les personnes qu’il a connues autrefois. Il nous en brosse à chaque fois des portraits truculents et pleins d’humour, dans un style souvent baroque. Mais la tendresse et la nostalgie sont souvent bien présentes et c’est finalement tout émus que narrateur et lecteur quittent ces personnages du passé qui, entre-temps et par la force de l’écriture, ont acquis un statut de héros légendaires.
Chaque chapitre commence par un résumé de quelques lignes qui est à chaque fois un véritable morceau de style. En voici deux exemples pris au hasard :
Chapitre "Dernières nouvelles du siècle".
Où il est question de la dérive d’un jeune drogué et d’une barre de chocolat. Que la révolte gronde derrière les portes de la pauvreté. De l’étrange damnation frappant un innocent.
Chapitre « Dans les nuées.»
Où apparaît le personnage emblématique de la mère en ses œuvres. Des vicissitudes ménagères et des litanies qui en découlent. Des appareils symbolisant les avancées du Progrès. De la machine à tout oublier.
Quant au style du livre proprement dit, il est imagé et original. On se laisse entraîner par lui et à travers la grande balade des mots on suit le narrateur dans les circonvolutions de sa pensée, pensée qui se détourne facilement du récit raconté pour prendre des chemins de traverse où la poésie et un certain fantastique sont souvent au rendez-vous. Mais plutôt que de longs discours, voici un court extrait :
Description de La Désirade, la maison habitée par l’auteur au sommet des montagnes avec une vue plongeante sur le lac Leman :
« On est ici comme au bord du ciel, le dos à la forêt suspendue, à rêver à tous les bleus de là-bas.
Là-bas, pour peu qu’on oublie notre espèce désenchantée, c’est le règne encore d’avant le Déluge et, sur les rivages noirs aux murailles d’orchidées, c’est le jardin d’avant la Faute ; là-bas, tous les bleus vivent encore en liberté dans l’imagination du ciel aux trente-six mille lubies par jour, et tous ces bleus nous rappellent l’Afrique de nos enfances et l’Amérique, l’Asie extrême, l’Océanie cannibale de nos enfances aux visages ornés de peinturlure et aux noms libérant leur magie rien qu’à se trouver prononcés : rien que le nom de Pernambouc et ressuscite le tamanoir de Cendrars à la longue liche fourmivore et au petit œil élégiaque, rien que le nom d’Irkoutsk et se ressoulèvent, du néant de poussière, les hordes de cavaliers asiates à la pourchasse de Michel Strogoff, rien que le nom de la Désirade et voici qu’émerge, de tous les bleus étales de la mer des Caraïbes, cette affreuse souche de rocher plus vieil et plus dur que l’os, mais comment ne pas rêver à ce nom ?"
On notera les références bibliques (le Déluge, la Faute), qui donnent une dimension eschatologique et mythologique à cette description du paysage. On n’est plus seulement dans un jardin, mais dans Le jardin d’avant la Faute, celui d’Adam et de la création du monde, bref, en d’autres mots, nous sommes aux origines de toute chose.
Il y a des aspects inquiétants dans ce jardin primitif (« les rivages noirs aux murailles d’orchidées »), mais aussi beaucoup de poésie (« là-bas, tous les bleus vivent encore en liberté »). De la description physique du ciel, on remonte aux souvenirs de l’enfance dans l’Afrique profonde, Afrique qui renvoie à son tour à d’autres contrées (l’Amérique, l’Asie, l’Océanie). Mais comme les mots sont au centre du livre, on joue bien évidemment avec eux et l’Extrême-Orient devient « l’Asie extrême » tandis que l’Océanie est qualifiée de « cannibale ». Du coup les jeux de l’enfance remontent à la surface et voici que le petit Jean-Louis apparaît « orné de peinturlure » (le terme « peinture » eût été trop simpliste pour renvoyer à la magie de cet âge et aux mille couleurs dont les visages sont maquillés, tels les Indiens du Bateau ivre avec leurs « poteaux de couleurs »). Les livres d’aventures, lus à cet âge, ne sont pas oubliés non plus (L’île au trésor ? Robinson Crusoë ?) et s’ils ne sont pas cités, on les devine en arrière fond de ces jeux enfantins. Puis ce sont les villes lointaines qu’on n’a jamais visitées mais qui sont demeurées dans la mémoire rien que par la beauté de leur nom étrange qui fait rêver : Pernambouc et Irkoutsk. Du coup, à partir de là, ce sont d’autres lectures qui refont surface et voici Cendrars puis Jules Verne (cité non pas directement, mais par l’intermédiaire de son héros Michel Strogoff, lequel, dans notre imaginaire, fait défiler devant nos yeux ébahis les grandes steppes de la Russie centrale).
On notera l’utilisation de néologismes (« fourmivore ») et surtout la référence aux grands faits historiques (les hordes de cavaliers asiates qui n’en finissent plus de soulever la poussière des siècles), lesquels donnent une dimension extraordinaire à cette maison qu’est la Désirade, qui semble soudain se situer au carrefour du temps et de l’espace. Avant elle, l’époque d’Adam ou les hordes asiatiques, plus loin qu’elle, ces villes aux consonances étranges que sont Pernambouc et Irkoutsk, quand ce n’est pas la mer des Caraïbes elle-même, avec son bleu incomparable, qui vient nous rappeler que la maison de l’écrivain est un lieu où on peut rêver.
JL Kuffer, "Le Sablier des Etoiles", Bernard Campiche Editeur, 1999, 200 pages.
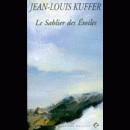
07:59 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, jl kuffer, le sablier des etoiles
07/04/2009
Correspondance troublante
Suite au poème « Comparaison » (axé sur la répétition à l’infini des « comme si »), qui avait fait l’objet de la note précédente, je vous invite à aller lire un texte similaire proposé par Bertrand Redonnet sur son site l’Exil des mots.
Ce qui est fascinant, c’est que je ne connaissais absolument pas sa « Ballade pour un pendu » et que pourtant on retrouve des ressemblances avec mon texte, non seulement dans la forme (la répétition des « comme si »), mais aussi dans les thèmes traités, preuve que le « souffle poétique » est universel et l’esprit humain constant dans ses démarches. C’est ce que disait déjà Lévi-Strauss pour expliquer les similitudes entre tous les mythes des peuples primitifs, alors qu’aucune rencontre géographique n’avait pu avoir lieu. Il semble qu’il en aille de même dans la création littéraire, les sujets traités n’étant finalement pas infinis. Il est certain, en effet, que nous parlons tous de la même chose depuis que l’humanité existe (amour, mort, sens de la vie, souffrance, solitude, etc.) et que pour exprimer cette pensée nous avons recourt à une série d’images, de métaphores, qui elles aussi semblent constantes.
Ainsi, dans les deux poèmes évoqués ici, on commence par le thème de l’oiseau : Comme l’oiseau qui prend son envol / Comme ce passereau minuscule soudain surgi des nues. La différence, c’est que le mien est majestueux et part à la conquête du ciel, tandis que le sien est minuscule et vient du ciel se réfugier sur un toit (image inversée, donc).
Bertrand parle d’équinoxe et moi de solstice (même fascination pour les moments charnières des saisons)
Il évoque les « vagues toutes blanches, qui viennent et qui reviennent sur le sable des plages et qui grondent » et moi je parle de la marée qui détruit les châteaux de sable de l’enfant. Enfant que l’on retrouve dans son poème en train de jeter des pierres dans une rivière, cette fois.
La « brume lascive des frais matins de mars » devient chez moi « la rosée dans l’herbe fraîche du matin ».
On retrouve le thème du « cœur qui s'égare sur une erreur sublime » dans « cette jeune fille aimée autrefois et qui a disparu dans les tourments de la vie. »
Notons que des deux côtés on a le thème
- de la neige abondante qui vient tout recouvrir
- de la fuite du temps (ténèbres promises / notre vie s’écoule)
- de la guerre (comme ces soldats tombés, pitoyables, dans les flaques toutes rouges / comme ces guerres qui par le monde massacrent de parfaits innocents)
- de la souffrance animale (l'animal blessé dans une cour obscure et qui pleure et gémit / la biche atteinte par une balle)
- des saisons (l'automne invitant le poète à écrire / l’été dans les collines andalouses)
- des étoiles (cette voie lactée sur ma tête allumée / un poème écrit sous la voûte étoilée de nos rêves)
Que conclure de tout cela ? Qu’il nous faut rester très modestes, car finalement nous n’inventons absolument rien et nous ne faisons que répéter sempiternellement les mêmes thèmes et cela depuis des générations. La seule variable, dans ce phénomène, c’est la « griffe » personnelle de chacun, la manière de dire et d’écrire, en un mot le style, lequel reflète le caractère et les préoccupations intimes de celui qui tient la plume. En dehors de cela, nous sommes tous hommes (et femmes) et donc hanté(e)s par une même réalité. A la limite et même si cela ne saute pas aux yeux, c’est le même discours que l’humanité véhicule depuis l’âge préhistorique et les dessins rupestres des grottes de Lascaux ne sont pas aussi éloignés qu’on ne pourrait le croire des poèmes de Rimbaud. Déjà à cette époque il s’agissait de créer un monde imaginaire (voir la dimension des animaux, qui varie selon la conception qu’on en a et non selon leur taille réelle), calqué sur la réalité et dans lequel l’artiste exprimait toute son admiration ou toute sa peur. Un monde parallèle en quelque sorte, fait de dessins sur un rocher, pour dire qu’on est homme et qu’on se demande bien ce que l’on fait sur cette terre. Rimbaud affirma-t-il autre chose quand il s’écria : « Et j’ai vu quelquefois ce que l’homme a cru voir » ?
13:46 Publié dans Blogue | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, correspondance entre poèmes
06/04/2009
Comparaison
Comme l’oiseau qui prend son envol et qui plane tout la-haut dans son éternité,
Comme les bateaux qui quittent le port et prennent le large pour des voyages dont ils ne reviendront pas,
Comme la fontaine qui n’en finit pas de chanter par les beaux jours d’été et dont le murmure se termine en sanglots une fois la nuit venue,
Comme les oliviers qui chuchotent dans les collines andalouses quand le solstice est au rendez-vous,
Comme le duvet de pêche de ta joue quand je la caresse d’un doigt tremblant,
Comme la rosée dans l’herbe fraîche du matin avant qu’elle ne s’évanouisse dans la chaleur du jour,
Comme cette jeune fille aimée autrefois et qui a disparu dans les tourments de la vie,
Comme la neige qui se met à recouvrir la campagne, lentement, lentement, mais aussi sûrement, très sûrement,
Comme la marée qui vient détruire encore une fois le château de sable construit patiemment par l’enfant,
Comme le soleil qui disparaît à l’horizon et qui entraîne le monde entier dans sa mort,
Comme ce chant d’opéra écouté en plein milieu de la nuit alors que la lune s’avance dans sa plénitude,
Comme ces chevaux qui galopent dans la plaine et qui sont encore un peu sauvages,
Comme l’oiseau qui chante au matin, étonné d’être toujours parmi les vivants
Comme la biche atteinte par une balle et qui sait qu’elle va mourir dans un instant,
Comme ces guerres qui par le monde massacrent de parfaits innocents,
Comme tout cela, notre vie s’écoule, heure après heure et nous n’en conservons qu’un poème écrit sous la voûte étoilée de nos rêves. Ce ne sont que quelques vers à lire debout devant le grand espace vide de la nuit.
09:49 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature, poésie
04/04/2009
Anniversaire
Tiens, le quatre avril. Cela fait deux ans que ce blogue est ouvert. On dit souvent que tout s’arrête après un an, donc c’est déjà bien, non ? Il est vrai qu’on a changé un peu d’orientation en cours de route, délaissant la critique sarkozienne, amusante mais finalement stérile, pour des réflexions plus littéraires et même quelques petits textes personnels de temps à autre. Je crois que c’est dans cette direction que cela va continuer. Le site devient alors un moyen de toucher un public, une sorte d’auto-édition électronique en quelque sorte. Le revers de la médaille, c’est qu’on finit par n’écrire que pour le blogue et donc qu’on s’oriente vers des textes très courts ou des poèmes. Tout cela se fait au détriment d’une écriture plus vaste, plus ambitieuse. Mais quand on s’adonne à celle-là, tout reste dans les tiroirs et donc cela ne sert à rien.
Maintenant, un texte comme « La cabane dans les bois » qui a bien été écrit pour ce site (il ne devait faire qu’une page au départ mais le thème du voyage et une histoire d’amour sont venus s’ajouter par la suite) est la preuve qu’on peut écrire des textes plus longs et les faire lire ici.
Je remarque que généralement les articles sur la langue française suscitent beaucoup d’intérêt. Je ne parle pas du nombre de commentaires, mais des réactions que j’en ai par ailleurs.
Je constate aussi que le nombre de visiteurs a toujours été en progression depuis le début. Je me moque des statistiques (clin d’œil à ceux et celles avec qui j’en ai parlé) mais j’avoue que si le nombre diminuait chaque jour, cela serait sans doute le signe que quelque chose ne fonctionne pas bien. Autant écrire pour soi dans un cahier alors.
Car un site permet aussi des rencontres, virtuelles certes, mais souvent intéressantes et certaines même très fortes. C’est aussi très important. On trouve des affinités avec certaines personnes et il se crée des amitiés et ma foi cela vaut bien les relations qu’on a dans sa vie habituelle. La différence, c’est d’une part qu’on rencontre ici des personnes ayant les mêmes centres d’intérêt (essayer de parler de Nietzsche avec votre voisin ou de Rimbaud avec votre banquier, pour ceux qui en ont un) et d’autre part qu’on se livre plus, les uns et les autres. Par livrer, je ne parle ni de la vie quotidienne ou familiale (sur laquelle je suis toujours resté très discret) ni des données d’état civil (âge, profession, etc.), qui n’apprennent finalement pas grand chose sur quelqu’un, mais du fait de livrer le fond de sa pensée, d’exprimer ses convictions, ses doutes, ses errements, sa philosophie de vie, etc. Bref, on va à l’essentiel, alors que dans la vie dite réelle (mais ce site aussi fait partie de ma vie réelle, il me semble) tout reste souvent au stade des convenances sociales. A l’artificialité, on tente de substituer une certaine vérité. Tout est relatif, évidemment et on pourrait dire exactement le contraire et que tout ceci n’est qu’un jeu de rôle dans lequel chacun essaie de briller et donc qu’on reste très loin aussi de la vérité. Je ne sais pas, il faut voir. Il me semble que je suis sincère dans ce que je dis. En tout cas c’est ce que je voudrais, sinon à quoi bon ?
10:23 Publié dans Blogue | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : blogue
03/04/2009
Mes aïeux!
Quelques lecteurs hier se sont mis à rêver sur le mot espagnol «abuela», la grand-mère et c’est vrai que ce terme a quelque chose de calme et de doux qui enchante l’âme. Du coup, intrigué, je me suis demandé quel en était l’étymon et après quelques recherches googelesques (ou googeliennes si vous préférez) j’ai trouvé, à ma grande surprise, que ce mot est apparenté à notre terme français «aïeul», ce qui ne saute pas aux yeux.
Abuelo (le grand-père) vient du latin «avus » (l’adjectif «avitus» existe aussi). A ce mot, on a joint un diminutif, sans doute pour exprimer l’affectivité et «avus» est devenu «aviolus». Le mot a ensuite évolué différemment selon les langues romanes et est devenu dans le Berry, aïol, en provençal aviol, en espagnol abuelo et en italien avolo.
En français, c’est l’accusatif d’aviolus, autrement dit aviolum qui a donné aviol puis aiol (plus facile à prononcer) au XIII° siècle et puis finalement aïeul au XVI° siècle.
En outre, il y aurait eu un étymon indo-européen antérieur à cet «avus».
Le Robert historique nous enseigne que le mot originel latin, «avus» ne désignait pas un terme de parenté mais qu’il était plutôt une appellation familière à l’égard d’un ancien du groupe, ce qu’on retrouve peut-être encore dans notre terme «aïeux» qui désigne les ancêtres en général, par opposition à «aïeuls», qui désigne directement les grands-parents (comme nous le rappelle Grevisse cette fois, dans son incontournable «Bon usage»).
Le vrai pluriel, le pluriel étymologique, est «aïeux» (d’après l’accusatif pluriel devenu le cas régime en ancien français). Ce n’est qu’au XVII° siècle qu’on aurait reformé le pluriel «aïeuls» d’après la forme du singulier. Ce qui est amusant, c’est de voir l’alternance du sens au cours des âges. Alors que le «avus» latin désignait plutôt l’ancien du groupe, «aviolus», avec son diminutif affectif, faisait bien, lui, allusion au grand-père. Pourtant, au XIII° siècle, c’est de nouveaux le sens d’ancêtres qui prédomine. Ce n’est finalement qu’au XVIII° siècle que la distinction actuelle (aïeux = ancêtres/aïeuls = grands-parents) s’est établie. Elle est finalement logique : le mot au pluriel désignant un grand nombre de personnes, c’est évidemment à l’ensemble des ascendants, autrement dit les aïeux, que l’on pense. Le singulier aïeul, quant à lui, ne pouvait que désigner le grand-père tout proche. Puis, comme on a en principe deux grands-pères et deux grands-mères (mais ce ne fut pas mon cas), on a dit « les aieuls » pour les désigner.
Notons encore, pour être complet, que le dérivé «avunculus» a donné le mot français «oncle».
Mais revenons à notre «abuela» initiale. Le mot castillan désigne la grand-mère, mais aussi une vieille femme en général. L’expression «cuentaselo a la abuela», familière, signifie « à d’autres ! ». «Habersele muerto a uno su abuela» signifie «être vantard», de même que «no tener uno abuela», un peu sans doute comme si l’absence de la grand-mère, qui symbolise la raison et la mémoire de la famille, permettait de divaguer et d’inventer n’importe quoi.
A côté de «abuela» existe le terme «abuelita», encore plus mignon avec son diminutif affectif. Le dictionnaire ne le traduit pas par grand-mère, mais par bonne-maman, ce qui est en effet plus intime. Ce qui est amusant, c’est qu’en Amérique (du Sud, évidemment car notre monde roman s’étend jusque là, devant le grand Pacifique) où on sait que les mots espagnols prennent parfois un autre sens, éloignement oblige, cette «abuelita» peut désigner un berceau ou un bonnet d ‘enfant. De l’aïeule, on passe à la toute dernière génération, peut-être parce que ce sont souvent les grands-mères qui s’occupent des petits-enfants.
Enfin, nous sommes partis de l’Etat du Texas, aux Etats-Unis, avec Mac Carthy et ses si jolis chevaux et nous revoilà en Amérique du Sud après avoir traversé l’Espagne et avoir parlé du Moyen-Age français et du latin de Rome. Comme quoi le temps et l’espace sont devant nous dès qu’on ouvre un livre.

Source
00:07 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : langue française, abuela
01/04/2009
Recueillement
"Il se leva et traversa la route et entra dans le cimetière… (…) Il s’arrêta son chapeau à la main sur la terre qui ne portait aucune marque. Cette femme qui avait travaillé pour sa famille pendant cinquante ans. Elle avait gardé sa mère au berceau et elle avait travaillé pour sa famille bien avant que sa mère ne vînt au monde et elle avait connu et gardé les oncles de sa mère les fils Grady qui étaient de vrais sauvages et qui étaient tous morts depuis si longtemps et il restait là avec son chapeau à la main et il l’appela son Abuela et il lui dit adieu en espagnol puis il fit demi-tour et remit son chapeau et tourna son visage humide vers le vent et resta un moment les bras tendus devant lui comme pour reprendre l’équilibre ou bénir la terre là où il était ou peut-être pour ralentir le monde qui fuyait dans sa course folle et semblait n’avoir nul soucis ni des vieux ni des jeunes ni des riches ni des pauvres ni des basanés ni des visages pâles ni de lui ni d’elle. Nul souci de leurs luttes, nul souci de leurs noms. Nul souci des vivants ni des morts."
Cormac Mac Carthy, « De si jolis chevaux »

Source
00:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, mac carthy
30/03/2009
De l'altérité
Le langage poétique, on le sait, a tendance à inverser les valeurs. Soit il prend des termes et en modifie ou en inverse le sens, soit il prend le terme opposé à celui qu’on attendrait habituellement (exemple : le fameux « soleil noir de la mélancolie » de Nerval dans El Desdichado). Par cette technique, la poésie nous parle donc d’un monde autre, différent, une sorte d’univers parallèle qui n’est pas sans rappeler celui de la magie, tel que décrit par les chamans.
Alors que la prose privilégie le signifié (le contenu), la poésie se concentre surtout sur le signifiant (la forme). La meilleure illustration en est la versification, qui est comme une sorte de retour en arrière (on reproduit un son qu’on vient déjà d’entendre). Il s’agit donc moins d’aller de l’avant vers un sens à découvrir que de regarder en arrière sur ce qui vient d’être dit, tout en prêtant moins d’attention au sens qu’à la musicalité de la langue. Les mots eux-mêmes sont d’ailleurs choisis avec discernement car par leur longueur et leur sonorité ils doivent former un tout harmonieux. Ainsi, le vers de Mallarmé « le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui » commence par deux groupes de trois syllabes (le/vier/ge, le/vi/vace) pour se poursuivre par une groupe de six (et/le/bel/au/jour/d’hui). Il existe donc une progression harmonieuse, que n’aurait pas rendu « le vivace, le bel aujourd’hui et le vierge. »
A côté du nombre de pieds, la césure et l’enjambement assurent des pauses respiratoires qui contribuent à l’harmonie de l’ensemble. Il arrive aussi que certains vers soient repris comme dans une sorte de refrain, ce qui renforce encore le caractère musical du poème (comme le vers «Vienne la nuit sonne l'heure » dans « Le pont Mirabeau » d’Apollinaire). Ou bien le poète a recours à l’allitération (répétition de plusieurs consonnes identiques à l’intérieur d’un même vers) comme le célèbre « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? » dans l’Andromaque de Racine. Parfois, c’est un même son qui est reproduit dans le vers (on parle alors d’assonance) comme dans «Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire » (toujours Racine, mais dans Phèdre), où le son « i » est répété plusieurs fois.
Bon, on pourrait comme cela poursuivre encre longtemps et détailler tous les moyens techniques utilisés en poésie, mais ce n’était pas le but de mon propos. Tout ce que je voulais montrer, c’est qu’il existe un monde poétique, différent de la vie quotidienne ou du regard habituel que nous portons sur ce qui nous entoure. Ce monde parallèle, ce regard particulier, existe en soi, je veux dire en dehors du poème. C’est un état d’esprit ou une particularité de l’individu d’aborder l’univers autrement. Que cette vision soit finalement traduite ou non dans un poème (ou un poème en prose ou une prose poétique) importe peu par ailleurs.
Ce qu’il faut donc souligner, c’est cette notion de décalage entre le monde tel qu’on le regarde avec des yeux objectifs et le monde imaginé par le poète à partir de cette même réalité.
Maintenant, si un des moyens de rendre ce monde imaginaire un instant entrevu est d’inverser les valeurs habituelles ou le sens des mots, il se pourrait aussi que la recherche d’un ailleurs participe de la même démarche. L’étranger, les pays d’au-delà des mers, l’Orient mythique, sont autant de destinations réelles qui devraient permettre un dépaysement suffisant pour sentir ce décalage. C’est sans doute ce qu’allaient chercher les grands littérateurs du XIX° siècle en Egypte ou ailleurs. Là bas, tout était différent, les paysages, les coutumes, les lois, le climat, etc. Visiter ces pays étrangers aurait donc dû permettre de toucher du doigt ce monde « autre », ce monde décalé dont nous parlons ici. Cela voudrait donc dire que d’une manière générale, aller vers l’autre, vers l’étranger, participerait de ce mouvement poétique de la recherche d’un ailleurs. Loin du choc des civilisations, le regard curieux et humaniste porté sur l’altérité serait une manière d’atteindre cet autre univers. Cela reviendrait à dire que c’est par la culture en général et par la poésie en particulier qu’on peut espérer trouver une entente entre les peuples. Le poète, cherchant par nature ce qui est rupture par rapport au monde dans lequel il vit, aura tendance à regarder avec intérêt la culture de l’autre. Cette altérité fondamentale ne l’effraiera pas, au contraire il cherchera à l’explorer pour en saisir l’essence. Et puis dans cette culture autre, il découvrira aussi des poètes, s’exprimant dans une autre langue, véhiculant d’autres images, d’autres concepts. Derrière ces différences, cependant, il retrouvera un terrain qui lui est familier, celui de la littérature. Car les hommes sont partout les mêmes dans tous les endroits de la planète et ils sont confrontés aux mêmes problèmes : la vie, la souffrance, l’amour, la recherche du bonheur, la difficulté voire l’impossibilité de réaliser ses rêves et bien sûr la mort qu est tout au bout. Quel que soit le climat, quel que soit le pays, ces réalités sont partout présentes et si les diverses cultures ont proposé des solutions différentes, les poètes, partout dans le monde, parlent le même langage.
Le problème, malheureusement, c’est que les poètes ne sont pas légion et qu’ils semblent bien fragiles pour faire entendre leur voix aux marchands de canon qui, eux, savent exploiter habilement les différences entre les hommes. Et puis il y a les puristes, les intégristes (les Frères musulmans d’un côté de la Méditerranée, l’extrême-droite de l’autre), qui diront toujours qu’apprendre la culture de l’autre c’est perdre la sienne ou en tout cas courir le risque de la voir se métisser suffisamment pour devenir une culture autre. Ce risque de perte d’identité est un problème crucial. Personne n’a envie de renier ce qui le constitue et d’en programmer la perte en introduisant le ver dans le fruit, en ouvrant les portes à une autre culture. Et pourtant… Et pourtant il en a toujours été ainsi dans l’histoire il ne faudrait pas oublier que les cultures latine est grecque de l’Antiquité que nous admirons tant n’ont pu nous parvenir qu’en supplantant la culture celte de nos ancêtres laquelle s’est effacée pour ne subsister qu’à l’état de substrat. Et si beaucoup s’inquiètent de la forte présence arabe sur le sol européen (et dont les enfants de la troisième génération sortent de nos universités et commencent à occuper des postes clefs), que doit dire le Maghreb qui a été colonisé par la France durant une longue période ? Il semblerait donc que les interpénétrations culturelles soient déjà à l’œuvre de part et d’autre de l’ancienne « mare nostrum ». Bien sûr, nous n‘avons pas du tout envie que l’islamisme radical soit enseigné à nos enfants dans les écoles de la République, pas plus que les gens du Maghreb ne se réjouissent de notre civilisation marchande et matérialiste. Mais au-delà de ces deux points extrêmes, de ces deux antagonismes, n’y aurait-il pas moyen de trouver par la culture un langage je ne dirai pas commun, mais en tout cas un langage qui serait ouvert aux richesses de l’autre ?
Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore et qui souhaiteraient approfondir ce genre de réflexions, je les invite à aller se promener de temps à autre (mais tous les jours c’est mieux) sur le site de Jalel el Gharbi (voir par ailleurs le lien ici à droite) qui tente de concilier l’Orient et l’Occident et leurs cultures respectives. Personne ne s’étonnera du fait qu’il est précisément professeur de littérature, critique littéraire et poète. C’est donc bien par les livres qu’un dialogue interculturel semble possible. D’ailleurs ne lisons-nous pas les livres étrangers en traduction ? La littérature est universelle et on devrait, je trouve, proposer des cours de littérature comparée dans les lycées, cela aiderait peut-être à comprendre le fait que quel que soit l’endroit où il vit l’homme reste un homme avec ses espoirs et ses angoisses.
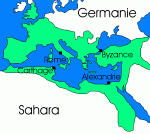
Empire romain et "Mare nostrum"
23:16 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, autres cultures
28/03/2009
De Mac Carthy et de son style
J’ai cité ici plusieurs extraits de romans de Cormac Mac Carthy et quelques commentateurs se sont étonnés à juste titre de l’accumulation de la conjonction de coordination « et », qui rend souvent la phrase un peu lourde, voire disgracieuse. Généralement, le nouveau lecteur est étonné devant ce procédé inhabituel, qui ne correspond pas à l’idée qu’on se fait d’un style d’écrivain, qu’on imagine forcément limpide. Au vu de la réputation de l’auteur, on en arrive vite à la conclusion qu’il ne peut s’agir d’une faiblesse mais bien plutôt d’un moyen stylistique original et peu commun. Encore faudrait-il comprendre quel est le but recherché par ce procédé.
La conjonction « et » n’est d’ailleurs pas le seul terme qui revient périodiquement chez Mac Carthy. En fait, il emploie souvent les mêmes mots, comme ces « d’accord » qui ponctuent souvent les dialogues. On en trouve déjà dans la « Trilogie des confins », mais surtout dans « la Route », où ce mot renforce encore le style dépouillé. Le fait de se dire d’accord avec quelqu’un exclut toute discussion. Même quand le fils n’obtient pas la réponse qu’il souhaitait ou quand la réponse du père ne le satisfait pas, il finit toujours par dire « d’accord » C’est à mon avis une manière de souligner l’affection qui les lie. Il fait confiance à son père, alors même que le monde qui l’entoure, plein de dangers, suscite surtout des questions. Il y a donc une dimension affective dans l’emploi de ce mot, mais aussi une démarche existentielle. Le fils ne comprend pas, mais il s’en remet à celui qui a de l’expérience. Le père agit de même avec son fils et à chaque fois que le petit lui demande quelque chose qui est en son pouvoir (ne pas l’abandonner par exemple), il dira lui aussi « d’accord ». Il s’ensuit donc une complicité certaine entre les deux protagonistes, qui illustre bien leur union face aux dangers traversés ensemble.
Dans ce roman « La Route », l’auteur ne désigne pas les deux héros par leurs prénoms, mais il utilise les termes «L'homme » et «le petit » pour bien exprimer le rapport adulte/enfant qui les lie, ce qui permet aussi de généraliser leur expérience à toute l’humanité et donc d’impliquer le lecteur (on est tous le père ou l’enfant de quelqu’un).
Je ne connais malheureusement pas la version originale en anglais, il serait intéressant, cependant, d’aller vérifier quels sont exactement les mots employés.
Mais revenons à notre conjonction « et » et à l'absence de virgules qui, comme je l’ai dit moi-même, gênent beaucoup au début. Dès qu’on accepte le fait qu’il ne peut s’agir d’une maladresse mais que c’est voulu, alors, insensiblement, non seulement on s’y fait, mais on finit par attendre ces longues énumérations. A quoi peuvent-elles bien servir ?
A créer une atmosphère, je suppose. Les faits et les actions s’enchaînent un peu comme on verrait un film au ralenti. Sans que je ne m’explique bien pourquoi, il me semble que cela donne une dimension tragique au récit (l’enchaînement inéluctable des événements comme dans la tragédie grecque). Remarquons que souvent il s’agit pourtant d’actions voulues par le héros (il se leva et pris sa couverture et monta sur son cheval et…) Dans ce cas, il y aurait une volonté délibérée d’agir, même contre le destin. Le héros tente de s’affirmer en faisant ce qu’il a décidé qu’il ferait. Mais en même temps on sent à chaque fois comme quelque chose d’inéluctable, comme si, par son geste déterminé, le héros s’en allait au devant d’un danger. Je crois que ce qui est mis en scène avec cette conjonction, c’est le rapport de l’homme au monde, le conflit entre les aspirations intérieures et l’univers extérieur.
Parfois, ces énumérations concernent des descriptions de paysages. Est-ce une manière de nous faire voir par les yeux des protagonistes, comme si on détaillait le décor de gauche à droite ? C’est du genre « Il y avait une rivière et une montagne et plus loin une autre plaine et dans le fond le soleil se couchait… » Là aussi il y a quelque chose d’inéluctable. Mais aussi une dimension poétique. On passe ce paysage en revue, détail après détail, mais en agglutinant nos impressions, jusqu’à en faire une totalité qui forme un tout et qui, peut-être, se donne comme une approche exhaustive de la réalité. L’auteur veut tout décrire, donner du monde une vision globale. Comme il ne peint pas un tableau et ne peut être synthétique, il est obligé, dans une démarche analytique, d’accumuler les détails pour définir le tout. D’où l’importance de la conjonction qui non seulement ajoute chaque fois un élément au précédent mais relie véritablement les éléments entre eux, les soudant en une entité indestructible.
Quelque part, Mac Carthy me fait penser à l’Anabase de Xénophon. Mes souvenirs scolaires sont un peu loin, mais il y avait aussi chez cet auteur une grande utilisation du « et » » :
"Cyrus ensuite fit vingt parasanges en quatre marches et vint sur les bords du fleuve Chalus, dont la largeur est d'un plèthre. Ce fleuve était plein de grands poissons apprivoisés, que les Syriens regardaient comme des dieux, ne souffrant pas qu'on leur fît aucun mal, non plus qu'aux colombes. Les villages près desquels on campait appartenaient à Parysatis et lui avaient été donnés pour son entretien. On fit ensuite trente parasanges en cinq marches, et l'on arriva aux sources du fleuve Daradax, large d'un plèthre. Là était le palais de Bélesis, gouverneur de la Syrie, et un parc très vaste, très beau, et fécond en fruits de toutes les saisons. Cyrus rasa le parc et brûla le palais. » (Livre I)
Ici, cependant, le procédé me semble être différent. C’est plutôt le déroulement de l’action qui est ainsi mis en évidence, leur succession chronologique. Chez Mac Carthy, c’est plus que cela. Certes les actions s’enchaînent aussi, comme dans un film, mais elles sont moins vues dans leur détail singulier que dans leur union finale. Chez Xénophon on cherche à nous faire voir ces actions individuellement, une après l‘autre, ici, on vise surtout un tableau d’ensemble (dont il a bien fallu au préalable dessiner les différents contours).

01:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, mac carthy
25/03/2009
Peu importe
Peu importent les jours et les nuits, les saisons qui défilent et l’équinoxe qui revient s’abattre sur nous en tempête de pluie battante et froide.
Peu importent la mer qui mugit et ses vagues en colère qui déferlent contre les falaises de la mort.
Peu importent ces navires au large qui tanguent dans la tourmente et pour qui tous les ports sont désormais hors d’atteinte.
Peu importent les heures qui passent et qui repassent au cadran de l’espoir.
Peu importent, vous dis-je, les départs sans cesse différés, les voyages toujours reportés et ces mille pas inutiles qui ne nous conduisent nulle part.
Parfois, une corne de brune hurle dans le noir et annonce des dangers imminents, tandis qu’un phare, au bout du monde, tente de trouer l’obscurité.
Peu importe, ils ne reviendront plus les exilés, ils auront péri en mer avant d’atteindre le port. Le poème sera leur tombeau et s’ils survivent, ce sera dans une chanson de marins, un de ces refrains qu’on reprend en pleine mer pour se donner un peu d’espoir, quand l’attente est trop longue et que la cause est perdue.
Peu importe la nuit au cœur de mon texte, peu importent cette page et ces mots qui s’envolent.
Peu importent ton cœur et ton sexe et tous tes mots qui m’ont fait rêver.
Peu importent les jours et les nuits.
Peu importe.
Reste le poème.
Je te le dédie.

16:03 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, poésie
24/03/2009
Dialogue (3)
Ils contemplaient le soleil qui se levait au-dessous d’eux. Les chevaux qui broutaient un peu plus loin sur un redan dressèrent la tête et le regardèrent. Rawlins but la dernière gorgée de son café et égoutta sa tasse et plongea sa main dans sa poche de chemise pour chercher son tabac.
Crois-tu qu’il y aura un jour où le soleil va pas se lever ?
Sûr, dit John Grady. Le jour du Jugement dernier.
Quand crois-tu que ce sera ?
N’importe quel jour qu’Il aura choisi.
Le jour du Jugement dernier, dit Rawlins. Tu crois à tout ça ?
J’sais pas. Oui. Sans doute. Et toi ?
Rawlins mit sa cigarette au coin de sa bouche et l’alluma et d’une chiquenaude il jeta l’allumette. J’sais pas, dit-il. Ca se peut.
J’savais bien que t’étais un mécréant, dit Blévins.
Toi tu sais foutrement rien, dit Rawlins. Ferme-la sans en rajouter à ta connerie.
John Grady se leva et traversa le bivouac et souleva sa selle par le pommeau et jeta sa couverture sur son épaule et les regarda. Allons-y, dit-il
Cormac Mac Carthy, « De si jolis chevaux »
14:23 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : littérature, mac carthy, de si jolis chevaux
22/03/2009
Mauriac
J’apprends qu’une nouvelle biographie de François Mauriac vient de voir le jour (mais je ne l’ai pas lue). L’auteur, Jean-Luc Barré, tente de comprendre la complexité du célèbre écrivain catholique et il a, paraît-il des révélations inédites à faire : François Mauriac. Biographie intime. Tome I de Jean-Luc Barré Fayard, 675 pages (je m’inspire pour cette note d’un article de jean d’Ormesson – écrivain que j’ai lu mais que je n’aime pas – paru dans Le Figaro –journal que je ne lis en principe jamais et sur lequel je suis tombé par je ne sais quel hasard lors de recherches sur Internet ).
On connaît en effet la complexité des personnages des romans de Mauriac, et nul peut-être mieux que lui n’a su rendre la lourdeur de cette atmosphère provinciale, faite de secrets inavouables, de tension entre les protagonistes, de haine assassine, de révolte larvée, d’apparences qu’il convient de sauvegarder et finalement de solitude désespérée. Dans cette bonne société bourgeoise bordelaise, l’argent ne manque pas, mais l’amour fait souvent défaut («Le Désert de l’amour ») ou s’il existe, il a souvent des effets pervers, comme dans « Thérèse Desqueyroux », où une femme étouffe son fils de son amour maternel. Une fois devenu veuf, celui-ci se détachera (enfin) d’elle pour s’enfermer dans le souvenir de son épouse décédée, ce qui nous fera finalement trois victimes : l’épouse qui est décédée au milieu de l’indifférence générale, le héros qui ne vit plus que de souvenirs et la mère qui voit son fils lui échapper. Tout cela sur fond de tradition familiale où le poids des ancêtres est encore bien présent.
Pour inventer des romans de cette trempe, il fallait bien que Mauriac ait eu lui-même une personnalité assez complexe. Orphelin de père, il est élevé par sa mère et sa grand-mère, toutes deux dévotes et puritaines. Le petit François apprend donc à vivre avec le regard d’un Dieu vengeur au-dessus de sa tête, ce qui, on s’en doute, le rendra obsédé par les notions de péché et de mal. A côté de cela, sa sensibilité exacerbée lui fait cruellement ressentir le manque d’amour apparent de sa mère, trop rigide et tout occupée à respecter les conventions.
Tout n’est pas négatif, pourtant, et dans son milieu aisé, on suit les cours de bons professeurs, notamment ceux du beau-frère de Gide et qui sera un des fondateurs de la NRF (Mauriac n’aura donc pas à chercher bien loin un éditeur quand il voudra être édité). Et puis il grandit dans un monde de livres et dévore Pascal, Racine, Baudelaire, Rimbaud, Gide, Régnier, Claudel, Francis Jammes et bien d’autres.
Le paradoxe de Mauriac, soutient son biographe, c’est d’un côté son humilité imposée par sa foi chrétienne et de l’autre son grand désir de gloire littéraire. Il est remarqué par Maurice Barrès, qui apprécie son recueil de poèmes « Les Mains jointes ». Il lui consacre un article élogieux dans la presse ce qui le range d’emblée dans le cercle des écrivains. Sans vouloir me montrer suspicieux, je me demande quand même si c’est la qualité littéraire de ce texte (que j’avoue n’avoir pas lu et sur lequel je ne me prononcerai donc pas) qui a propulsé Mauriac en avant ou si c’est le côté disons … catholique (avec un tel titre !) qui a ému Barrès.
Peu après, Mauriac connaît Cocteau, Radiguet, Proust et surtout André Gide, lequel règne sur la NRF. Et c’est là que notre biographe abat sa carte d’atout. Notant l’homosexualité manifeste d’au moins trois de ces écrivains, il en déduit que Mauriac n’aurait peut-être pas été insensible à cet aspect des choses. Etonnant, je n’avais jamais pensé à une chose pareille. Et le biographe de citer une phrase du propre fils de François, Jean, qui est troublante, il faut le reconnaître : «Homosexuel, mon père ? Non, certainement pas au sens où l'on entend ce terme quand on l'applique à Gide, Cocteau, Jouhandeau ou Montherlant. Mais de tendance homosexuelle, oui, bien sûr. »
Et le biographe d’insister sur les amitiés essentiellement masculines que Mauriac aurait entretenues à côté de son couple légal. D’ailleurs le romancier aurait affirmé un jour : «Il existe des affections légitimes : la famille, les amis, j'entends bien. Mais ces affections ne sont pas l'amour ; et, dès qu'elles tournent à l'amour, les voilà, plus qu'aucune autre, criminelles.»
Si cette hypothèse est vraie, on comprend d’autant mieux l’aspect torturé de Mauriac : «Je suis romancier, je suis catholique : c'est là qu'est le conflit ! Je crois qu'il est heureux pour un romancier d'être catholique, mais je suis sûr aussi qu'il est très dangereux pour un catholique d'être romancier…» Car si l’homme Mauriac recherche la grâce et la paix intérieure, le romancier donne libre cours à ses fantasmes, sans toutefois pouvoir les exprimer clairement, ce qui expliquerait le caractère torturé de tous ses personnages et le côté pesant des traditions et du silence. Maintenant, je ne sais pas s’il faut vraiment supposer une homosexualité refoulée pour comprendre tout cela. La lutte entre la chair et la grâce a souvent tracassé les bons catholiques et à mon avis une hétérosexualité classique suffit déjà amplement à expliquer cette angoisse. Ceci dit, cela m’a toujours un peu dépassé, je dois dire, ces tourments, et je ne comprends pas bien comment on peut voir le mal dans des choses finalement naturelles (le désir et les rapports sexuels) et que Dieu lui-même, si tant est qu’il existe, a voulues.
Mais bon, Mauriac, lui, semble rempli de remords, de repentirs et du coup il remplit ses romans de monstres amers et finalement pervers. Certains lui ont reproché de se complaire dans un «nouveau sensualisme trempé d'eau bénite» et Martin du Gard lui aurait dit : «Je rigole, mon cher Mauriac, je rigole quand on fait de vous un écrivain du catholicisme. Il n'y a pas d'œuvre d'incrédule ou d'athée où le péché soit plus exalté. Ce sont des livres à damner les saints (…) Il crève les yeux, que vos tableaux sont peints avec une frénésie, une complaisance, une évidente et charmante tendresse. »
Voilà, c’était le compte rendu d’un livre que je n’ai pas lu, d’après un auteur que j’ai peu lu, publié dans un journal que je ne lis pas et au sujet d’un écrivain que j’ai lu. Vous me suivez ? Comme quoi, ce n’et pas bien compliqué de parler de ce qu’on ne connaît pas, finalement.

11:16 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature, mauriac
19/03/2009
Fnac
Nous parlions l’autre jour de la Fnac et de sa politique culturelle. Aujourd’hui il convient de parler de sa politique sociale. Trouvant sans doute qu’elle ne faisait pas assez de bénéfices (j’avais cru comprendre pourtant qu’elle avait parfaitement intériorisé le concept de «consommation culturelle») ou constatant que lesdits bénéfices ne suffisaient pas à contenter la boulimie des actionnaires, il a été décidé de supprimer 400 emplois en France (150 en province, 50 au siège central et 200 dans les magasins parisiens proprement dits)
Que dire d’autre ? Je ne peux que renvoyer à l’appel à l’aide repris sur le site « Turbulence » d’Alain Freixe.
23:01 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : fnac
18/03/2009
Printemps, le retour
J’avais, au cours de ce long hiver, passé mes nuits à écrire. Que faire d’autre, en écoutant siffler le vent ? Rien, si ce n’est raconter ce que l’on a vécu ou imaginer ce que l’on pourrait vivre.
Un à un, les mots sont tombés dans mon cahier comme les flocons dans le jardin. Encre noire, tapis blanc, de longues phrases ont rempli les pages tandis que dehors s’épaississait la couche de neige.
Puis, un soir, le temps s’est soudain arrêté. Nature figée, immobile, au cœur du solstice.
Dans le petit matin gelé, un oiseau s’est envolé, effrayé de sa propre fragilité. Cri éphémère dans la pureté de l’azur. Blancheur et éternité.
De mon petit cahier, mes pensées frileuses se sont éparpillées, disant la beauté du monde, mais aussi ma peur et mon angoisse.
Ainsi donc, dans le grand silence de l’hiver, j’écrivais.
J’écrivais et décrivais ce que j’aurais voulu que fût le monde : un endroit où nul oiseau, le matin, ne serait effrayé par la blancheur éternelle de la mort. Un endroit où nul cri, jamais, ne devrait retentir si ce n’est pour dire la beauté fragile de l’azur.
Puis les jours, les semaines et les mois passèrent et un grand matin, ce fut le printemps. C’est l’oiseau qui me l’a dit avec ses mots à lui, qu’il inscrivait dans le grand cahier du monde. Alors j’ai déposé mon stylo, je suis sorti dans la douceur nouvelle et j’ai observé : le vol du premier bourdon, la beauté de la première fleur, la senteur du premier bourgeon. Tout était là, offert, donné, sans raison aucune.
Quand la nuit est tombée et que je suis rentré, toutes mes phrases, soudain, m’ont semblé bien vaines. Etalées là, noires sur le papier blanc, elles n’avaient ni la présence imposante du bourdon, ni l’éclat de la fleur, ni le parfum du bourgeon. Elles n’étaient finalement que des mots, des mots insignifiants et un peu tristes, qui cherchaient sans y parvenir à dire le manque, le vide et l’absence. Toute cette masse de papier inerte n’avait pas un grand intérêt et elle m’apparut pour ce qu’elle était dans toute sa futilité : un grand bavardage inutile, une logorrhée sans fin, un discours interminable.
Alors, tandis que la blanche lune se levait dans la nuit bleue, j’ai jeté dans les flammes de la cheminée le petit cahier avec toutes ses pages et toutes ses phrases devenues inutiles. Il s’ensuivit une grande chaleur qui pendant un instant m’a réchauffé le cœur.

16:45 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature, poésie, printemps
16/03/2009
Marc Villemain, "Et que morts s'ensuivent"
Onze petites nouvelles, voilà ce que nous propose Marc Villemain dans son livre « Et que morts s’ensuivent » (Seuil, février 2009, 165 pages, 17 euros).
Beaucoup de lecteurs se méfient des nouvelles car ils y voient des histoires trop courtes, pas suffisamment développées et sans liens aucuns entre elles. Le moins que l’on puisse dire c’est que ce recueil-ci va les réconcilier avec le genre car l’auteur est parvenu à ce tour de force qui consiste à rendre homogène un recueil composé pourtant de onze histoires différentes. C’est qu’elles ont toutes un point commun : comme dans la vie, la mort (réelle ou symbolique) est à chaque fois au rendez-vous à la fin de l’histoire. Comme par ailleurs les personnages mis en scène sont tous plus ou moins ordinaires, le lecteur ne peut s’empêcher de faire un rapprochement entre leur existence et la sienne propre, ce qui jette tout de même un froid, il faut bien le reconnaître.
A chaque fois Marc Villemain nous décrit des situations relativement banales (des jeunes femmes qui passent une charmante après-midi dans un institut de beauté, un noble qui surveille ses terres, une critique littéraire qui trempe sa plume dans l’acide, un père de famille qui revient avec sa fille sur le lieu de villégiature de son enfance, un employé fatigué de la monotonie de son existence), ou plus dramatiques mais pourtant ô combien familières (un jeune atteint d’un cancer, une amatrice d’art qui se fait enlever, un père incestueux, etc.). Ces situations, il les décrit très bien, dans un style pur et fluide. Nous nous prenons au jeu et quand nous sommes bien entrés dans le quotidien des personnages, le charme se rompt par un drame aussi brutal qu’inattendu. Pour être tout à fait honnête (ce que l’on peut faire plus facilement dans un blogue que dans un article, finalement), j’avoue que j’ai été un peu surpris par cette fin tragique dans les deux premières nouvelles. C’était tellement inattendu et surtout cela survenait de manière tellement étrange (aveugler son amie avec une fourchette, verser de l’acide dans un bain) que cela m’a semblé un peu forcé, comme si l’auteur voulait absolument s’assurer lé bénéfice d’une chute surprenante pour respecter le genre de la nouvelle, qui, si elle est courte, vaut surtout par sa fin. Mais cette impression un peu négative s’est vite dissipée à la lecture des autres textes, dont la fin, si elle reste surprenante, semble mieux s’accorder avec les faits racontés.
Mais reprenons note vue d’ensemble. Je disais que ce qui unissait tous ces textes, c’était leur fin morbide, mais il n’y a pas que cela. Un personnage, une certaine Géraldine Bouvier, se retrouve dans chaque histoire, créant ainsi une sorte de fil d’Ariane qui permet de guider le lecteur. Il faut dire que cette Mme Bouvier est chaque fois différente (par son âge, sa fonction, son statut social, son rapport au héros) et que ce n’est que par son nom, finalement, qu’elle parvient à assurer la cohésion du texte. Que faut-il comprendre par là ? Est-ce un clin d’œil pour signifier qu’il s’agit ici de personnages de papier, d’êtres inventés, qui n’existent que par leurs noms ? Est-ce une sorte de réflexion sur le langage, afin de montrer que les mêmes mots (y compris des noms propres) peuvent désigner une réalité différente ? Est-ce une manière de dire que nous sommes tous interchangeables, tous autant que nous sommes, n’occupant finalement que des fonctions (et pas vraiment des personnalités) dans la vaste comédie humaine ? Incarne-t-elle la Parque antique, cette Géraldine Bouvier et est-ce elle qui vient couper le fil de la vie dès qu’elle apparaît ? Il y a un peu de tout cela, à mon avis. En tout cas la trouvaille est intéressante et on se surprend à attendre son apparition, laquelle nous étonne à chaque fois, évidemment, car elle occupe les fonctions les plus insolites. Il y a là une sorte de dialogue entre l’auteur et son lecteur qui n’est pas déplaisant, une sorte d’humour et de connivence qui nous fait un peu oublier la mort qui rode sans cesse.
Le livre est intéressant aussi par ce qu’il nous dit sur notre société. C’est un véritable portrait de mœurs, mœurs qui sont décrites avec un côté pince-sans rire qui n’est pas déplaisant. Et puis il y a de vraies questions qui sont soulevées, comme celui de l’inceste et cette réponse originale : ce sont les enfants (les copains et copines du cours de catéchisme) qui jugent le père coupable et qui lui infligent un châtiment finalement fort logique, puisqu’ils l’émasculent sur le champ. Il y a aussi l’histoire de cette grande amatrice d’arts qui se fait enlever par un révolutionnaire idéaliste et qui finit par prendre la défense de son ravisseur, au point d’être la première à être tuée lorsque les forces spéciales de la gendarmerie interviennent.
Bon, je ne vais pas raconter les nouvelles les unes après les autres, ce serait déflorer le sujet, comme on dit pudiquement. Notons encore pour terminer une grande présence des enfants, qui contemplent le monde avec des yeux qui sont loin d’êtres naïfs, même s’ils conservent en eux cette part de rêve qui caractérise leur âge (et on sent bien que l’auteur, lui aussi, reste de plein pied dans le rêve) Mais cette présence enfantine contraste avec la fin chaque fois cruelle, établissant un raccourci saisissant entre les premières années de la vie, toutes de tendresse, et cette fin inéluctable qui arrive quand on s’y attend le moins. Le récit en devient cinglant, évidemment, grinçant, même, tout en procurant au lecteur une sorte d’étrange plaisir, mélange de sadisme, d’effroi et de peur. Le fait d’annoncer la mort finale comme une simple anecdote, sans la détailler outre mesure, en renforce encore l’aspect tragique car nous comprenons alors que cette mort appartient à notre quotidien et qu’elle est finalement banale. Affreusement banale, devrais-je dire et superbement mise en scène dans un livre qui lui ne l’est pas.

00:16 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, villemain, et que morts s'ensuivent
13/03/2009
Des consommateurs
Je tombe l’autre jour dans la presse sur l’expression «consommateur culturel», laquelle m’a laissé quelque peu rêveur, je l’avoue. Si l’idée est d’exprimer que la personne concernée est un grand amateur de culture, un boulimique de lecture, un passionné de musique ou de films de qualité, ma foi, je veux bien l’accepter. Ce qui me dérange, cependant, c’est cette notion de consommateur. Consomme-t-on de la culture ?
- Oui, dit le directeur de la Fnac, je peux vous dire que tel client, qui a sa carte de fidélité (payante) en ordre, a acheté l’année dernière pour xxx euros dans notre magasin, c’est donc un grand consommateur culturel.
- Non, dis-je, on ne consomme pas dans une librairie comme on consomme dans une brasserie.
- Mais la Fnac n’est pas qu’une librairie, pourrait me répondre le susdit directeur, elle est aussi un lieu de vente de disques et d’appareils électroniques, photographiques ou informatiques. Et en plus c’est aussi une brasserie puisque vous pouvez boire un café ou un coca après avoir fait vos achats.
- Sachez tout d’abord, cher Monsieur, que je ne m’assois jamais dans votre cafétéria. Comment voulez-vous qu’en un lieu aussi bruyant je puisse feuilleter à loisir les livres que je viens d’acheter ? Il me faut pour cela un endroit plus calme et je préfère de loin un banc public (en souvenir de Brassens peut-être) pour parcourir quelques instants ces fameux livres avant de regagner mon domicile ou mon bureau. Ensuite, est-ce qu’acheter un lecteur DVD est un acte culturel en soi? Ce n’est qu’un appareil, une vulgaire machine. Où est la culture là-dedans ? Disons que par cet achat je me donne le moyen de pouvoir regarder des films qui eux sont en effet de la culture, si je les choisis bien. Mais ne mélangeons pas tout, s’il vous plaît. Tenons-nous en aux livres, pour ne parler que de ce que je connais. Est-ce que lire beaucoup de livres fait de moi un consommateur ? Culturel, qui plus est. Non, si je lis, je me cultive, d’accord, mais je ne consomme pas. S’exprimer de la sorte serait ramener le livre à un vulgaire objet de vente et j’imagine que ce ne peut être votre propos, Monsieur le Directeur de la Fnac.
- C’est à dire que…
- De plus, il faudrait encore voir de quels livres nous parlons, bien entendu, car les livres à succès qui s’étalent bien en vue sur vos présentoirs ne relèvent pas tous pour moi du domaine culturel, loin s’en faut. Mais vous proposez aussi des poètes, je le sais. Leurs oeuvres se trouvent au niveau du tapis, obligeant le lecteur potentiel à des acrobaties pas possibles. Vous avez une conception fort terre à terre de la culture, il me semble.
- C’est que l’on manque de place et…
- Je comprends, les locations en ville sont chères et le moindre mètre carré se paie comptant. Il faut d’abord penser aux intérêts des actionnaires avant de réfléchir au confort des lecteurs.
- Des lecteurs ? Mais à quelle époque croyez-vous vivre ? On ne vient pas à la Fnac pour lire, cher Monsieur, ni même pour feuilleter, on vient pour acheter. Et là, croyez que tout est mis en œuvre pour assurer le confort des clients, enfin, je veux dire des consommateurs, vous m’avez compris. Vous avez déjà vu le nombre de caisses qui sont ouvertes aux heures de pointe ?
- Vous avez raison et d’ailleurs il est l’heure que je m’en aille et que je passe par vos caisses. Avec mes trois livres, là, vous croyez que je suis un bon consommateur culturel ?
- Avec trois livres de poche à 6 euros le livre, ce qui ne fait que 18 euros, non, il ne faut pas rêver, vous n’êtes pas pour moi un grand consommateur culturel, désolé de vous le dire. J’ai de bien meilleurs clients que vous. Il y a en a qui dépensent dans les 400 euros en une fois. Cela va vite. Le matériel informatique est cher. Voilà des gens cultivés.
- Vous voulez dire : voilà de gros consommateurs.
- Si vous voulez. De gros consommateurs culturels. Je vois que vous m'avez enfin compris!
15:40 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : consommateurs culturels







