02/10/2009
Ecriture
Combien de monstres l’homme d’à présent expédie-t-il dans son écrire ? Combien délègue-t-il de peurs et d’envies dans le maquis de ses romans ? Comment organise-t-il sa survie dans ces personnages qu’il dépêche au traitement de ses propres préoccupations et par la mise en mots desquelles il parvient parfois à se connaître un peu ?
Toute écriture est nécessité presque organique de clarifier en lui un indicible chaos, un mal-être qui réclame une voie d’équilibre et que lui tente d’inventer dans quelques pages organisées, toujours nécessaires, toujours ratées, et qui toujours l’apaisent faussement.
Patrick Chamoiseau, A bout d’enfance (Une enfance créole III), Folio, page 79.
09:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, chamoiseau
30/09/2009
Regrets
L’homme, qui se croit intelligent (et qui l’est peut-être, par ailleurs, je ne dis pas le contraire), oublie trop souvent qu’il n’est finalement qu’un animal. Ainsi, bien des émotions de notre vie sont à relier non pas à notre aptitude à résoudre des problèmes, mais tout simplement à nos cinq sens. Tout ce que nous percevons de la réalité extérieure, nous nous imaginons que c’est grâce aux capacités de notre cerveau, mais celui-ci, en fait, ne fait que centraliser toutes les impressions qu’il a reçues. Or, les indications que nous donnent les sens s’imprègnent en nous de manière beaucoup plus profondes que les raisonnements intellectuels. Si on y regarde d’un peu plus près, on s’apercevra que la mémoire vivace que nous avons de certains événements précis est en fait reliée directement à notre perception physique des événements. Marcel Proust le savait bien quand il a raconté la saveur de sa petite madeleine et comment cette saveur lui permettait de retourner dans son passé et de revivre un moment privilégié enfoui au plus profond de sa mémoire.
Je crois qu’on peut affirmer sans trop se tromper qu’une bonne part de ce qui nous constitue est fait ainsi d’impressions passées qui nous ont bouleversés à un moment donné de notre vie. La chaleur d’un rayon de soleil sur notre peau, la saveur de tel plat, l’harmonie enivrante et transcendante d’un morceau de musique, le bruit de la mer sur les galets, un jour, quelque part en Bretagne, l’odeur des pins dans la forêt des Landes, le chant des cigales dans la plaine languedocienne, les exemples ne manquent pas. Chacun a ainsi en lui une réserve d’émotions qui peuvent resurgir à n’importe quel moment. Il suffit d’un élément déclencheur pour que des souvenirs très précis, qui évoquent tout un pan de notre vie, refassent surface.
Evidemment, la période la plus propice pour engranger toutes ces émotions, c’est l’enfance puisqu’à cet âge le petit homme se comporte comme l’animal qu’il est vraiment et qu’il n’a pas encore subi le dressage ultérieur qui lui imposera de tenir un rôle dans la société et de ne rien exprimer de ce qu’il ressent. Petit à petit, il se fermera comme malgré lui aux impressions directes du monde extérieur, qu’il captait pourtant si bien et qui le rendaient si heureux, pour rationaliser tout et refuser d’écouter le langage si direct de ses sens. Du coup, tout ce qui est plaisir immédiat lié à ce contact du corps avec le monde sera définitivement banni.
Heureusement, les impressions premières sont restées bien gravées en nous et, comme je l’ai dit, il n’est pas rare qu’un rayon de soleil, une odeur, la subtilité d’un parfum ou une note de musique éveillent en nous des sensations oubliées et avec elles c’est toute l’époque où nous les avons connues qui refait surface, nous bouleversant d’autant plus.
Et quand on parle des sens, on pense immédiatement à la vue et à l’ouïe, mais l’odorat peut lui aussi jouer un rôle essentiel. Ainsi, quand je suis rentré en première primaire pour apprendre à lire, nous occupions des bâtiments en bois qui venaient d’être construits à la sortie de la ville et qui étaient situés au milieu des champs. Ces bâtiments avaient été traités à la lasure (ou au carbonil, je ne sais pas trop) et les jours de forte chaleur l’odeur acre qui s’en dégageait m’enivrait complètement au point que j’ai fini par associer cette école avec cette odeur. Plus tard, je suis parti, j’ai quitté ma campagne pour la grande ville et j’ai connu pas mal de lieux d’enseignement, si bien que petit à petit le souvenir de cette première école s’est estompé. Pourtant, il suffit qu’au hasard d’une promenade je repasse devant un bâtiment fraîchement repeint ou dont les volets, tout simplement, ont été repassés à la lasure, pour qu’immédiatement cette première école refasse surface et avec elle toutes les impressions que j’ai connues ces années-là, comme le plaisir de la lecture, l’odeur de l’encre dans les encriers, le touché doux des feuilles de buvard, la beauté mystérieuse des grandes cartes géographiques qui ornaient le mur ou la chaleur de juin, quand nous attendions en rang dans la cour pour rentrer en classe.
Le jour où j’ai quitté cette école, deux ans plus tard, je l’ai englobée d’un seul regard, sachant que je la quittais pour toujours et qu’un pan entier de ma vie s’arrêtait là. En juillet de cette année, je suis repassé dans cette région pour la première fois depuis toutes ces années. J’ai voulu aller revoir l’école au milieu des champs et la montrer aux personnes qui m’accompagnaient. J’ai retrouvé le chemin, j’ai reconnu les maisons qui bordaient la route, la grande prairie qui servait d’espace de jeux lors des beaux jours était toujours là, mais l’école avait disparu ! Rasée, anéantie, volatilisée, il n’en restait plus rien, comme si elle n’avait jamais existé. Elle demeurera donc à jamais dans mes souvenirs, il n’y a plus que là qu’elle subsiste ou dans la mémoire de quelque condisciple de l’époque, mais que sont-ils tous devenus ? Et les années passeront et chaque fois que me pénétrera l’odeur de lasure, la petite école en bois survivra encore un peu, du moins pour moi. Jusqu’au jour où, évidemment, elle disparaîtra vraiment à jamais.
Je voudrais citer un autre exemple de l’importance de l’odorat dans la structuration de nos impressions et de nos souvenirs. Il m’est déjà arrivé de croiser une inconnue qui portait un parfum que je suis capable de reconnaître entre tous et qui me renvoie aussitôt à une histoire d’amour vécue lorsque j’avais vingt ans. Alors, tous ces souvenirs que je croyais oubliés et auxquels je ne pensais plus se mettent à resurgir en vagues successives et avec une précision dans les détails que je n’aurais pas crue possible. Des scènes de ma vie d’alors refont surface et je me revois en train d’attendre une certaine jeune fille sur la place de la cathédrale ou bien en train de discuter avec elle dans un café, à quatre heures du matin ; je revois sa main posée sur la mienne ou les larmes qui un soir coulaient sur son visage… Je revois même l’impasse où elle habitait, étudiante ou, plus tard, cette rue en pente, à flanc de colline, que je gravissais, alerte, heureux parce que j’allais la retrouver. Et tout cela parce que j’ai croisé une inconnue que je n’ai même pas regardée et qui avait le même parfum que le sien. Alors, quand j’arrive à mon bureau, je suis tout étonné de me retrouver là car il me semble être encore des années en arrière. Il faut pourtant se mettre à travailler, malgré les regrets qui commencent à m’envahir et malgré la nostalgie que je peux avoir de ces temps irrémédiablement perdus.

Photo Internet
00:36 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : littérature
27/09/2009
Tempête dans un encrier
Aujourd’hui, comme c’est dimanche, j’invite tous les lecteurs à faire une petite balade. En effet, « Marche romane » est l’invitée du site « « Tempête dans un encrier », qui poursuit l’expérience commencée par les « Sept mains ». Le principe en est simple : six écrivains se relaient pour proposer chaque jour un texte (le lundi Emmanuelle Urien, le mardi Bertrand Redonnet, le mercredi Aglaé Vadet, le jeudi Stéphane Beau, le vendredi Manu Causse, le samedi Thomas Vinau). Et le dimanche, me direz-vous ? Et bien, ce jour-là, c’est à un invité surprise que l’on donne la plume. Il vous faudra donc vous déplacer pour lire mon texte du jour, texte qui est à la fois une balade dans le temps puisque je vous propose une relecture d’un conte que vous lisiez quand vous étiez enfant, mais aussi une balade dans l’espace puisque les protagonistes se promènent le long d’un chemin.
Notez aussi que nous avions déjà abordé ce thème autrefois ici, mais d’une manière disons plus sérieuse.
10:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, tempête dans un encrier
25/09/2009
La remise
J’ouvre la porte de la remise, tout au fond du jardin et je suis immédiatement envahi par l’odeur du bois de chauffage, qu’on a entreposé là, en belles piles régulières. C’est pour cette odeur, que je suis venu jusqu’ici. Je ferme les yeux et je respire, sans plus penser à rien. L’odeur chaude et tendre m’envahit complètement et des images de forêts profondes s’imposent à mon esprit. Puis je revois les stères de bois, tels qu’ils étaient alignés le long du petit chemin forestier, les myrtilliers épars, l’étendue des fougères… Il me semble presque percevoir sur mon visage la chaude brise du dernier mois d’août et entendre les feuillages qui s’agitent légèrement. Leur bruit me parvient par vagues successives, comme la houle d’une mer intérieure. Un geai a crié, cri d’alarme dans la quiétude du lieu. Un promeneur se serait-il aventuré jusqu’ici ? Non, dans la clairière, c’est un renard qui s’avance, l’œil aux aguets, concentré sur sa tâche de chasseur. Il s’arrête et renifle un petit tas de sciure fraîche au pied d’une souche. On le voit bien, dans cette mise à blanc : son pelage roux, ses yeux vifs… Puis il s’en va, trottinant, et disparaît dans le sous-bois.
Dans la remise, j’ouvre un instant les yeux, puis je les referme et respire de nouveau la bonne odeur du bois. Cette fois, c’est le bruit de la circulaire hurlante qui s’impose à moi. Il me semble voir les grosses bûches que l’on coupe une à une et les rondins plus petits qui s’amoncellent à terre, en un tas irrégulier. L’homme, devant la machine, est méconnaissable, car il porte un foulard sur le visage et de grosses lunettes protectrices. Mon rôle consiste à ramasser les rondins et à les empiler sur la brouette. Puis il y aura le rangement proprement dit. Les rondins que je prends un à un et que j’empile comme je peux, en tentant de ne pas perdre de place, de ne pas laisser le moindre espace vide. Parfois il faut tout recommencer, enlever deux trois morceaux de bois et les agencer autrement. Le tout doit former un mur bien droit, bien stable. Sur ma peau nue, sans gants, je sens la rugosité de l’écorce, les petites échancrures pointues laissées par la lame sur les bords de la bûche, les nœuds du bois, ces protubérances aux formes variées. Parfois, il me semble reconnaître un des rondins que je viens de charger sur la brouette. Puissance de la mémoire affective, puissance des choses, qui s’imposent à nous, malgré nous.
Plus tard, ce sera l’hiver et il aura neigé. Il faut mettre de grosses bottines pour traverser le potager et atteindre la remise. Je revois le grand panier d’osier, tressé à la main à partir d’écorce de noisetier. On le remplit de rondins, comme on peut. Ce n’est pas facile à cause de l’anse qui gêne les mouvements. Il fait froid, très froid et par la petite fenêtre un timide rayon de soleil donne un peu de clarté, juste ce qu’il faut pour que l’enfant puisse voir les volutes de vapeur qui s’échappent de sa bouche. L’odeur du bois a disparu, figée par la froidure, sans doute. Il faudra déposer le panier dans la cuisine près du gros poële pour qu’elle réapparaisse, plus discrète qu’à l’origine, mais bien présente quand même. Avec elle, c’est un peu de nature sauvage qui est entrée dans la maison. Le feu crépite doucement dans le foyer et il fait bon, tandis que dehors, la neige n’en finit plus de tomber. Déjà, dans le sentier, les traces de mes pas sont en train de disparaître.
Photo personnelle
00:02 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature
23/09/2009
De l'automne
On nous l’avait bien dit dès les premiers bourgeons en avril, que cela ne durerait pas et que l’automne, inexorablement, finirait par arriver. Je le savais pertinemment aussi et pourtant j’avoue que c’est d’une oreille distraite que j’ai écouté tous ces annonciateurs de mauvaises nouvelles, tous ces prophètes de mauvais augure, moi pourtant si vigilant et si peu porté aux extases injustifiées. Certes, je savais que le ver était dans le fruit depuis le premier jour de l’été, à savoir le vingt et un juin, mais je me suis dit qu’il fallait tout de même profiter un peu de ce qui nous était donné, même si c’était pour une durée fort limitée. Et il faut reconnaître que la période estivale fut belle et largement ensoleillée et que cela aurait été dommage de ne pas se comporter en épicurien, fut-ce temporairement.
Mais voila qu’hier le calendrier nous a asséné la vérité inexorable : l’automne est là et bien là. Ce n’est plus qu’une question de jours avant de renouer avec le vent et la pluie et même si le soleil nous gratifie encore de quelques rayons, les arbres vont prendre inexorablement cette couleur jaune et or si caractéristique avant de se replier sur eux-mêmes et de camoufler dans leurs racines tous les rêves dont ils sont capables.
Ceci dit, fin août déjà, alors que la température atteignait encore les trente degrés, quelques petites feuilles jaunes provenant d’un bouleau du voisinage étaient venues se regrouper sur ma terrasse, annonçant discrètement mais inéluctablement le désastre qui se préparait. Depuis, cela ne s’est pas amélioré. Il y a eu quelques nuits fraîches, un peu de pluie, rien de bien sérieux en fait, mais juste ce qu’il fallait pour nous avertir que les beaux jours étaient désormais derrière nous.
Ainsi en va-t-il dans la vie, bien entendu. Adolescents, nous savions déjà que l’histoire se terminerait mal et c’est avec délectation que nous lisions Nizan et d’ailleurs nous approuvions fort sa phrase : «J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie. »
Lucides, nous l’étions donc tous, enfin la plupart ou du moins quelques-uns. Dans des cafés enfumés, nous discutions jusqu’à l’aube et refaisions le monde, lequel pourtant ne s’est guère amélioré depuis lors, au contraire (il faut croire que nous n’avons pas assez discuté…)
Mais à côté de cet échec sur l’organisation de la société idéale (il faut bien parler d’échec puisque le monde actuel ne correspond en rien à celui que nous avions rêvé et que nous conservons toujours enfoui au plus profond de notre cœur) il faut ajouter notre absence de clairvoyance sur notre devenir. Certes nous nous savions mortels et nous invectivions les dieux de nous avoir joué un aussi mauvais tour, mais quelque part nous parlions de ces réalités d’une manière par trop détachée car nous savions au fond de nous que l’échéance n’était pas pour demain. Nous discourions, en quelque sorte et nous discourions bien, il faut en convenir, mais cette angoisse existentielle qui nous nouait tout de même les tripes trouvait une certaine consolation quand nous pensions qu’un bon demi-siècle au moins s’ouvrait devant nous.
Or le temps a passé et de même que quelques feuilles mortes nous annoncent l’automne, de petits signes physiques encore discrets nous font comprendre qu’une bonne partie du chemin est maintenant derrière nous. Nous voilà donc à un tournant, à l’équinoxe de notre vie, en quelque sorte. Le bel automne s’installe lentement en nous et c’est même avec un certain émerveillement que nous en admirons les splendeurs. Maturité, tempérance, raisonnement bien assuré, tout ce que nous avons patiemment acquis au cours de notre existence rayonne maintenant de mille feux.
Mais que se passera-t-il demain ? Demain ce sera l’hiver pour de bon, un hiver éternel qui ne sera suivi par aucun printemps. Alors, dans la lucidité qui nous restera, nous nous demanderons le pourquoi de tout cela. Quel aura été, en effet, le sens de ce parcours ? L’enfant de deux ans dont je parlais hier et qui se dressait dans son lit dès les premiers rayons du soleil afin de conquérir le monde et de ne pas perdre une minute de cette vie qu’on venait de lui offrir sur un plateau, cet enfant, dis-je, qu’a-t-il réalisé, dans le fond, qui en valait vraiment la peine ? Et s’il peut aujourd’hui, dans le panache de l’automne qui s’annonce pour lui, admirer une dernière fois les beautés de l’existence, que lui restera-t-il demain quand l’hiver sera venu ? Il lui restera la honte de n’avoir pas été assez lucide.
Avec le temps qu'arbre défeuille
Quand il ne reste en branche feuille
Qui n'aille à terre
Avec pauvreté qui m'atterre
Qui de partout me fait la guerre
Au temps d'hiver
Ne convient pas que vous raconte
Comment je me suis mis à honte
En quelle manière …
01:09 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : automne
22/09/2009
La chambre
Maison-poème (fin)
De la chambre, il n’y a pas grand chose à dire, si ce n’est que c’était un endroit où on s’ennuyait profondément. L’enfant se souvient de ces réveils de grand matin (lui qu’on avait couché tôt au lit) où il se retrouvait dans un lit cage qui ressemblait à une prison. Du haut de ses deux ans, il se dressait comme il pouvait pour contempler le monde qui s’étendait au-delà de ces barreaux que les adultes lui avaient imposés avec un sens inné de l’autorité qui le laissait complètement pantois. Ainsi donc, à peine né, il se retrouvait incarcéré, entravé dans ses mouvements et cela sans avoir commis le moindre délit. Dans sa petite tête où les idées commençaient à se mettre en place, les concepts de liberté, de libre-arbitre et d’injustice se faisaient tout doucement un chemin. Pourquoi, en effet les parents, ces dieux omniscients au pouvoir absolu, pouvaient-ils aller dormir quand ils en avaient envie alors que lui devait aller au lit quand il n’avait pas sommeil ? Et pourquoi ces mêmes parents pouvaient-ils maintenant paresser dans leur chambre alors qu’il faisait déjà presque clair ? Soupir.
Il n’y avait donc rien d’autre à faire qu’à contempler pendant un temps indéfini qui semblait une éternité le petit canard en relief qui ornait la tête du lit et dont l’enfant suivait les contours avec ses doigts fragiles. Il regardait donc ce canard, le caressait, lui parlait, lui racontait des histoires et allait même parfois jusqu’à se disputer avec lui quand le stupide volatile semblait ne rien comprendre à ce qu’on lui disait.
Il fallait alors se tourner vers une autre activité et à vrai dire, dans cette prison, il n’y en avait qu’une. Elle consistait à regarder attentivement la tenture sur laquelle le soleil donnait déjà et à essayer d’imaginer ce que représentaient les formes géométriques qui y étaient dessinées. Objectivement, ces formes n’avaient rien d’extraordinaires en elles-mêmes et il suffisait de la présence d’un adulte dans la pièce pour qu’elles ne sortent pas de leur rôle. Mais là, quand l’enfant était seul, elles prenaient subitement des contours étranges, en partie probablement à cause des rayons du soleil qui traversaient le tissu. Alors, ce qui n’était pourtant la veille qu’un carré ou un losange devenait subitement une tête de lion rugissant ou quelque horrible monstre baveux et à la langue fourchue. Certes, on pouvait se raisonner et le petit homme ne s’en privait pas. Il savait pertinemment que tout cela n’était que le fruit de son imagination, il n’empêche qu’à un certain moment la peur l’emportait sur la raison et c’est véritablement pris de panique qu’il se réfugiait au fond du lit, sous les couches de couvertures.

Il faut dire qu’il faisait froid, dans la chambre. A cette époque, le chauffage central n’existait pas ou alors seulement chez les riches (lesquels, vous l’aurez remarqué aussi, possèdent toujours tout avant tout le monde). La maison n’était chauffée que par le gros poële de la cuisine et évidemment, la nuit, en hiver, quand le gel sévissait et que la neige avait imposé sa loi implacable, il ne faisait pas bon rester dans la chambre. Plonger sous la couette était donc une nécessité qui relevait du simple bon sens de survie. L’enfant, effrayé par les monstres qui s’agitaient sur la tenture, retrouvait donc une certaine quiétude une fois réfugié sous l’amas de couvertures et de coussins qui lui sauvaient ainsi deux fois la vie. Là, dans la douce tiédeur du lit, il retrouvait peu à peu ses esprits et sentait les palpitations de son cœur se calmer. Alors, timidement d’abord, puis avec de plus en plus d’audace, il repartait affronter les fameux monstres. Souvent, ceux-ci avaient disparu entre-temps et leurs gueules grimaçantes n’ornaient plus le haut de la tenture. Le soleil avait sans doute été caché par un nuage et la lumière s’étant affaiblie, elle n’avait plus la force suffisante pour animer ce bestiaire infernal qui semblait rappeler à l’enfant l’époque où il n’était pas encore né. Car il lui semblait avoir connu dans un autre monde ces créatures diaboliques et pour lui il ne faisait pas de doute qu’il existait quelque part un pays étrange où il avait séjourné avant de naître. Car peut-on concevoir qu’on soit ici aujourd’hui et qu’hier on n’ait pas été ? Non, cela ne se pouvait et l’enfant tentait désespérément de se souvenir de cet univers d’avant la vie, univers qui était encore bien proche, pour lui qui n’avait que deux ans.
Mais la mère arrivait, interrompant ces réflexions angoissantes sur l’origine de l’être et l’existence des présences infernales. D’un geste sûr, elle ouvrait les tentures et, si on était en été, le bon soleil entrait dans la pièce, reléguant définitivement les monstres aux oubliettes. Par contre, si on était en hiver, c’est une autre découverte qui attendait l’enfant. Ce n’était pas la rue et ses maisons familières qui apparaissaient à travers le rideau, mais une vitre opaque, aux mille dessins géométriques stylisés. Dans le froid matinal, l’enfant qu’on avait enfin fait sortir de son lit courait vers la fenêtre et de son petit doigt il suivait les contours de ces roses de glace que le froid avait dessinées dans le givre.
Mais il fallait vite descendre en bas, et s’habiller près du gros poële de fonte, qui déjà ronronnait en emplissant la maison d’une bonne chaleur douillette, tandis que dehors il neigeait sans arrêt.
00:17 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature
15/09/2009
Le promeneur solitaire
Le promeneur solitaire parcourt la dune, perdu dans ses pensées, entre la rumeur de la mer et les montagnes empourprées du couchant.
Il marche, rêveur, dans l’infini des sables, et songe à ces cités englouties dont parlait le poète.
Vivent-elles encore au fond de l’eau, les belles sirènes d’autrefois ou ne sont-elles plus qu’un souvenir dans la mémoire des hommes ?
Il marche le promeneur, dans le bleu du soir et pense à tous ces peuples qui ont foulé le même sable, depuis la nuit des temps, depuis que le monde est monde. Que reste-t-il aujourd’hui de leurs conquêtes, de leurs rêves, de leurs aspirations ? Il n’en reste rien et tout cela ne fut qu’un reflet éphémère, comme ce scintillement passager au crépuscule, sur la mer.
Il fait noir maintenant et le mendiant s’est arrêté sur le sommet de la dune. Il a tout perdu, même son ombre, qui s’en est allée rejoindre les flots verts qui s’agitent dans l’obscurité.
Le voilà perdu, le promeneur solitaire, en ce désert de sable. Sur les rivages de la nuit, il cherche son chemin, n’ayant pour se guider que l’éternel grondement de la mer et la rumeur des vagues.
D’autres sont passés avant lui, qui ont disparu. D’autres passeront après lui, qui découvriront peut-être dans le sable les os blancs anonymes d’un promeneur éphémère. C’est sa mémoire, sans doute, qu’honore le vent, quand il siffle en gémissant, les soirs de tempête et qu’il emporte le sable en tourbillons fantastiques.

00:03 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : poésie
13/09/2009
Intermède musical: Léo Ferré et l'Italie
On ne le sait pas toujours, mais Léo Ferré, qui a tout de même conduit la chanson française à des sommets rarement atteints, a aussi chanté en italien. Si son père était directeur du personnel du Casino de Monte-Carlo, sa mère, Marie Scotto, était une couturière d'origine italienne. D’ailleurs, à neuf ans, il se retrouvera chez les Frères des Ecoles chrétiennes au collège St Charles de Bordighera, en Italie, où il sera en pension pendant huit ans (cf. son livre Benoît Misère).
Attention tout de même qu’il s’agit ici d’une école française des Frères de l’instruction chrétienne (le collège St Charles de Marseille, en fait), exilée en Italie, suite la suppression légale de l'ordre en France le 7 juillet 1904. Si les Frères avaient été appuyés du temps de Napoléon III, ils avaient commencé à perdre de leur influence sous Jules Ferry (lois laïques) avant de se voir interdits d'enseignement en 1904. Du coup, beaucoup d’écoles passèrent la frontière et s’établirent dans le Nord-Ouest de l’Italie, à une distance encore raisonnable du lieu de domicile des élèves.
Mais revenons à Ferré. Si celui-ci a toujours aimé l’Italie, c’est surtout après son mariage avec Marie-Christine Diaz qu’il s’installe près de Florence. En 1972, il enregistre d’ailleurs son premier disque en italien, ce qui n’est pas courant pour un poète français. Notons encore que c’est à Castelina qu’il se réfugiera quand il sera malade et que c’est là qu’il décédera en 1993, ce qui en dit long sur son amour pour la Toscane, où il se sentait chez lui.
Il n’est jamais facile de traduire un texte, surtout si ce texte est un poème. Il semblerait que Ferré, lorsqu’il chantait en italien, ait usé de sa voix pour faire passer tous les sentiments qu’il avait mis dans le texte initial en français, comme s’il voulait par-là compenser une éventuelle perte de sens. C’est ainsi que ce très beau texte qu’était « Tu ne dis jamais rien» est à mon avis chanté avec encore plus de force quand il devient «Tu non dici mai niente ». Le poète y exprime à vif tous ses regrets et sa sensibilité y est à fleur de peau.
Jugez vous-même :

http://www.youtube.com/watch?v=nLd1c7FTrEY
02:02 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : léo ferré
07/09/2009
Le propriétaire
Préambule :
Puisque nous avons parlé, dans un texte précédent, de ce propriétaire qui ne déliait pas facilement le cordon de sa bourse, même pour des travaux de première nécessité, il serait intéressant d’en donner une description plus détaillée, tant il ressemblait, comme je l’ai dit, au Père Grandet de Balzac. On sait que le héros de ce livre est devenu (avec l’avare de Molière, bien entendu), le prototype de l’homme avare, radin et près de ses sous, mais le mien n’avait rien à lui envier. Evidemment j’étais très jeune quand je l’ai croisé et forcément les faits que je raconte ici sont déformés par mes yeux d’enfant. Je ne dis pas que c’est la réalité, mais plutôt la réalité telle que j’ai pu la percevoir à cet âge. De plus, une partie de la description provient de ce que la rumeur publique pouvait colporter sur le personnage et on sait ce qu’il en est de la rumeur publique. Enfin, c’est bien connu, l’acte d’écriture transforme inévitablement ce que l‘on a vécu, en l’amplifiant, en le déformant, en le faisant rentrer dans la grille de lecture de notre subjectivité, ce qui fait qu’entre la situation de départ et ce que l’on retrouve couché sur le papier il y souvent un abîme. Mais cet abîme est aussi la trace du regard spécifique qui est le nôtre et je crois que c’est finalement ce que l’on cherche dans la littérature. Ni des faits réels, ni des histoires destinées à nous amuser, mais plutôt la manière unique dont un de nos semblables peut voir le monde. Parfois il le voit comme nous (et nous nous sentons confortés dans la pertinence de notre être), mais souvent il le voit différemment (ce qui nous ouvre alors d’autres horizons et nous fait percevoir ce que nous n’avions jamais perçu). Et comme la littérature n’est pas un jeu (comme les surréalistes ont pu parfois le croire) mais une réponse à nos angoisses existentielles (ou plus exactement une tentative de réponse car la littérature ne résout rien et ne fait que poser encore plus de questions), elle participe pleinement à nous rendre plus humains, par le fait qu’elle provoque en nous une prise de conscience de notre destinée.
= = = = = = = = = = = = = = =
Ce vieux monsieur, qui dépassait les quatre-vingts ans, tenait à avec sa fille (une demoiselle restée célibataire qui flirtait avec la soixantaine), une petite épicerie dans le haut de la ville. Il avait économisé toute sa vie, ce qui fait qu’il possédait au moins une vingtaine de maisons, peut-être une trentaine, je ne sais pas exactement. Son avarice était légendaire. On disait qu’en hiver, par exemple, il ne chauffait pas sa maison, à part le magasin qui accueillait ses clients, sinon évidemment tout le monde aurait déserté son établissement et son chiffre d‘affaire s’en serait ressenti. Alors, quand la froidure se faisait par trop sentir et que ses mains commençaient à s’engourdir, il venait se réchauffer dans la boutique. Je le revois encore, pendant que sa fille servait derrière le comptoir, assis sur une vielle chaise pliante récupérée je ne sais où, tendant ses doigts transis devant le petit poële de fer blanc qui diffusait une chaleur timide. Il était enveloppé dans une couverture rapiécée et contemplait la petite casserole de soupe qu’on avait mise à réchauffer là, afin sans doute d’épargner la cuisinière à gaz qui devait se trouver quelque part dans le logement.
Il restait là sans rien dire, répondant d’un simple signe de tête aux nouveaux arrivants qui le saluaient et s’enquéraient de sa santé. Il semblait éteint, moribond et avait des gestes d’une lenteur de tortue. Pourtant, quand la caisse enregistreuse faisait son déclic caractéristique et qu’elle s’ouvrait pour engloutir les petits sous, il fallait voir alors comme son œil pétillait. On aurait dit que toute la vie qui lui restait s’était concentrée dans ce regard, dont la vivacité offrait alors un contraste étonnant avec sa vieille carcasse décatie. En attendant, les hivers passaient les uns après les autres et il était toujours là, tandis que certains clients avaient déjà rejoint l’autre rive, terrassés par l’une ou l’autre de ces maladies étranges et terribles qui faisaient chuchoter les ménagères à mi-voix quand elles attendaient dans la boutique leur tour pour être servies.
- Et vous savez Un Tel, il est mort en trois jours sans que le médecin ait pu faire quoi que ce soit. Pourtant il fallait voir la force qu’il avait !
- Non ? C’est pas vrai ! Remarquez qu’au moins il n’aura pas souffert longtemps. Ce n’est pas comme le grand Joseph de ma rue, qui est resté alité pendant cinq longues années et qui ne se souvenait même plus qui il était. Même que sa femme n’en pouvait plus de toujours le soigner au point qu’elle est partie avant lui, d’épuisement probablement .
Le gamin que j’étais écoutait tous ces malheurs dont se délectaient littéralement les commères, lesquelles, leur cabas à la main, semblaient intarissables. On aurait dit qu’elles se complaisaient dans ces drames et plus c’était horrible, plus elles semblaient contentes. Je jetais un œil discret vers le vieillard en me disant que tout de même elles auraient pu lui épargner la description de toutes ces agonies, lui qui avait déjà un pied dans la tombe… Mais il ne semblait rien entendre, comme si tout cela ne devait jamais le concerner et il se contentait de tourner de temps à autre dans son potage avec une vieille cuillère en bois, sans jamais perdre de vue ce qui se passait au comptoir. Pendant que cela discutait ferme des malheurs du monde, lui il calculait mentalement le bénéfice que lui rapportait chaque salade que sa fille sortait d’un cageot ou chaque paquet de café qu’elle allait chercher en haut d’un rayonnage, montée sur une échelle branlante à laquelle il manquait un échelon.
Evidemment, les temps étaient durs, même pour lui, car il devait avoir en tête d’acheter d’autres maisons et on sait bien que pour cela il faut de l’argent, beaucoup d’argent. Alors, comme il n’avait que son petit magasin pour vivre (en plus de tous ses loyers, évidemment), il avait trouvé un moyen très simple pour faire fructifier ses affaires. L’art du commerce, c’est bien connu, consiste à vendre très cher au détail ce que l’on a acheté bon marché en gros, cela il l’avait toujours su. Mais là où il dépassait tous ses collègues et concurrents en ingéniosité, c’est qu’il avait imaginé de rogner sur les quantités des produits qu’il vendait. Ainsi, tous les paquets d’une demi-livre de beurre étaient délicatement ouverts et il en retirait une fine lamelle avant de refermer le tout. Après avoir répété la même opération une bonne dizaine de fois, il parvenait ainsi à vendre un onzième paquet qu’il n’avait pas dû acheter. Il procédait de même avec les paquets de café en grains ou encore avec le sucre fin.
Cette pratique un peu scandaleuse, il faut l’avouer, était connue de tous, mais en ces temps où les voitures étaient encore rares et où il n’était pas facile de se déplacer, chacun trouvait son compte dans ce petit magasin de proximité. Si on désapprouvait cette manière de faire, on le chuchotait en rue, mais jamais dans la boutique, par une sorte d’accord tacite entre tous. Pourtant, certaines clientes étaient plus difficiles et il y en avait parfois une qui se montrait récalcitrante au point de rompre le pacte. Je me souviens ainsi d’avoir vu une brave dame refuser une bouteille de limonade qui avait été ouverte et dans laquelle il manquait manifestement un peu trop de liquide. Mais bon, ces incidents regrettables étaient rares et d’une manière générale le vieux monsieur parvenait tout de même à arrondir subtilement ses fins de mois.
L’argent qu’il gagnait, on s’en doute, ne servait pas à améliorer son existence quotidienne, mais prenait tout droit le chemin de la banque. On avait l’impression qu’il craignait pour ses vieux jours et qu’il se constituait pour plus tard un petit magot rassurant, à l’abri des regards. Le problème, c’est qu’il avait déjà plus de quatre-vingt ans, ce qui fait que tout le monde se demandait à quel âge il envisageait de mourir. A ceux qui lui disaient qu’il serait temps qu’il profitât un peu de la vie, il répondait par le silence, se contentant de lever une main dans un geste dubitatif, comme pour signifier qu’on ne savait jamais ce que le hasard pouvait bien réserver et qu’il valait mieux être prudent. On ne pouvait pas dire qu’il travaillait pour ses petits-enfants, puisqu’il n’en avait pas, sa fille unique ne s’étant jamais mariée, par crainte sans doute des maris dilapidateurs de fortune. Quant à elle, seule héritière du patrimoine immobilier que constituaient les trente maisons, elle semblait à l’abri du besoin, d’autant plus qu’elle n’était déjà plus si jeune.
Pourtant, la rumeur disait que dans cette maison on ne mangeait pas à sa faim. Les visites chez le boucher étaient rares et se limitaient aux grandes fêtes du calendrier, encore parvenait-on à se contenter de bien peu, comme cent grammes de saucisses ou quelques pieds de porc (lesquels allaient cuire interminablement dans une marmite sur le poële de la boutique, ce qui, ces jours-là, écourtait considérablement la conversation des ménagères, avides pourtant de mille ragots à colporter). Parfois, on voyait le vieux monsieur se lever de sa chaise comme à contrecœur et d’un pas lent et résigné aller prendre une boîte de petits pois sur un rayonnage avant de disparaître dans sa cuisine. Manifestement, cette boîte constituait tout le repas de cet étrange couple, le père et la fille, si bien assortis qu’on finissait par les confondre. Il était même à craindre que ce ne fût là le seul repas de la journée car on n’avait jamais vu le moindre boulanger s’arrêter devant la boutique et quant à aller chercher eux-même leur pain, ils n’en avaient pas le temps, évidemment. Quand on tient soi-même un commerce, il faut savoir se consacrer aux clients, c’est bien connu, n’est-ce pas ?
Bon, j’arrête là la description de mon père Grandet local, n’ayant pas beaucoup d’autres éléments à rapporter. Quand il eut repris la maison que nous occupions (avec la nouvelle serre), j’ai déménagé puis un peu après j’ai changé de région, ce qui fait que j’ai perdu de vue tout ce petit monde. J’ai appris plus tard que le vieux monsieur était mort à cent trois ans, fort étonné, probablement, que la vie ne lui ait pas laissé le temps de profiter de son petit capital.

Le Père Grandet (dessin de Henri Monnier)
23:03 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature
03/09/2009
Les cercles magiques.
Sur la plage, l’enfant trace un cercle avec un bâton, puis un autre et encore un autre. Trois cercles concentriques qui délimitent un disque d’un mètre de diamètre environ, dont il aplanit maintenant délicatement la surface avec les mains. Puis il va chercher quelques branches de pins odorants qu’il dispose religieusement le long du premier cercle. Ensuite, il parcourt le rivage et revient avec des galets blancs, qu’il place uns à uns sur le périmètre du deuxième cercle. Le voilà maintenant parti tout la-bas, à la limite de plage et des grandes dunes qui circonscrivent l’espace marin. Je le distingue à peine, silhouette minuscule au pied d’un grand arbre. Puis le voilà qui revient en courant, rayonnant, car il a trouvé ce qu’il cherchait. Tout autour du troisième cercle il dispose alors des feuilles d’eucalyptus, dont l’odeur entêtante envahit tout l’espace. Ensuite, très sérieusement, l’enfant se tient debout devant son chef d’œuvre et marmonne quelque chose, cela pourrait être une chanson ou une prière, on ne sait pas bien, mais ce sont des paroles qui pour lui prennent la tournure d’une formule magique, c’est évident. Puis, d’un bond, il saute à pieds joints au centre du cercle et reste là, tout penaud, étonné qu’il ne se passe rien.
Je souris de sa naïveté et replonge dans mon livre. Quelques instants plus tard, intrigué par le grand silence qui règne autour de moi, je lève les yeux et à ma grande surprise je constate que l’enfant a bel et bien disparu.
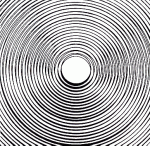
00:37 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature
02/09/2009
La mer (suite)
Derrière la dune que je gravis pieds nus, des cris se font entendre, sorte de gémissements plaintifs tels ceux d’une fille en pleurs. Mais je suis loin, si loin.
Derrière la dune que je gravis aussi vite que je peux, je perçois la plainte du vent et le claquement des câbles contre le mat des navires. C’est du moins ce qu’il me semble.
Derrière la dune, tandis que mes pieds n’en finissent plus de s’enfoncer dans le sable, j’imagine des départs vers des ailleurs ultramarins, des tropiques incroyables, des caps Horn mystiques. Trois grands bateaux prennent le large, tandis qu’une femme, sur la plage, pleure l’absence de son capitaine, seule, irrémédiablement seule. C’est que c’est un voyage sans retour et elle le sait.
Quand j’arrive au sommet, quand je franchis la ligne, quand je laisse enfin derrière moi la dune et son sable, je découvre la mer et la plage immense, déserte comme au premier jour. Il n’y a personne ici. Dans le ciel, seule plane une mouette, dont le cri strident, tel un long sanglot, se répercute à l’infini dans ce lieu solitaire.
A l’horizon, trois petits points, comme trois voiles mystérieuses, semblent voguer de concert avant de disparaître dans l’immensité bleue.
C’est du moins ce qu’il m’a semblé.

Photo Internet : Bruno Monginoux /
Photo-Paysage.com (cc-by-nc-nd)
00:56 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature
26/08/2009
La serre
Maison poème
J'intitule ce texte « la serre » car je ne trouve pas d'autre mot pour désigner cette espèce de verrière qui prolongeait la cave, par une sorte d'aberration architecturale à laquelle personne n'avait jamais pu trouver le moindre sens. En effet, en principe, une serre renvoie aux concepts de clarté, de chaleur et de plantes quasi tropicales. Rien de semblable ici, évidemment. Les vieux carreaux consolidés avec du papier goudronné ne laissaient passer qu'une lumière diffuse, ce qui donnait à la cave adjacente des airs d'aquarium et pour un peu on se serait cru au fond de la mer. Sans compter que ladite verrière laissait abondamment passer l'eau les jours de pluie, ce qui renforçait encore la certitude que ce lieu entretenait avec l'élément aquatique des liens aussi profonds que secrets.
Pour mieux comprendre la topographie des lieux, il faut imaginer que l'excavation qui avait été faite pour construire la maison était exagérée par rapports à la surface de celle-ci. Les ouvriers s'étaient visiblement retrouvés avec un trou à devoir combler une fois l'habitation terminée et il me plait de penser que c'est par paresse qu'ils ont imaginé cette sorte de verrière qui venait donc prolonger la cave dans le sous-sol, mais qui en surface offrait l'énorme inconvénient de se situer au même niveau que la cour. Point de jeux de ballons pour l'enfant que j'étais, évidemment, car les carreaux auraient été immédiatement cassés. Je peux avouer aujourd'hui que cette situation m'arrangeait bien, car j'ai toujours eu pour les ballons une aversion viscérale et à vrai dire si profonde qu'elle doit être d'origine génétique, il n'y a pas d'autre explication. Il n'en restait pas moins que cette serre qui, à l'extérieur, se retrouvait de plain-pied avec le sol, constituait un véritable danger car quelqu'un d'un peu distrait ou qui aurait été victime d'un soudain étourdissement, se serait immédiatement retrouvé dans la cave après avoir été déchiqueté par la verrière.
Celle-ci représentait donc un danger potentiel et tout le monde s'en méfiait. Il nous fallait pourtant bien vivre avec elle, ce qui revenait à se comporter comme on le fait avec un animal qu'on nous dit être gentil mais dont on sait qu'il appartient à une race agressive. Bref, la serre, par son emplacement, constituait une menace permanente pour notre intégrité physique, ce qui n'était pas rien. Malheureusement, c'était loin d'être tout. Son état de vétusté était tel qu'on se demandait bien comment la vieille structure métallique toute rouillée parvenait encore à supporter le poids des carreaux, alourdis encore par le papier goudronné dont j'ai déjà parlé. A l'extérieur, on avait donc peur de passer par inadvertance à travers la verrière, de par sa position au niveau du sol, et à l'intérieur on redoutait de tout recevoir sur la tête, ce qui semblait de plus en plus probable au fur et à mesure que les années s'écoulaient. Ajoutez à cela le manque de clarté et les infiltrations de pluie et vous aurez compris que cette serre était devenue pour tous un véritable cauchemar et qu'elle alimentait souvent les conversations.
En tout cas, je lui dois mon premier cours d'économie domestique et la conscience que la lutte des classes n'est pas un vain mot. Je m'explique.
Chaque fois qu'il avait l'occasion de croiser le propriétaire (c'est-à-dire au moins une fois par mois), le père ne manquait pas de souligner la dangerosité de la situation. A chaque fois, évidemment, on lui répondait que ce n'était pas la saison, que les moyens manquaient, qu'il faisait trop chaud ou trop froid, bref, que cela pouvait bien attendre encore un peu, par exemple jusqu'à l'année prochaine. Allons, disons même jusqu'à la fin de l'année prochaine, ce sera plus sûr. Mais une fois la période prévue arrivée, le terme reculait aussitôt du même nombre de mois que l'année en comportait, ce qui fait que les travaux étaient reportés de douze mois et en réalité ne se faisaient jamais. Pourtant, sur le terrain, la situation empirait, ce qui fait que le père en vint à proposer un compromis. Pour autant qu'on lui payât les matériaux, il s'engageait à construire lui-même une nouvelle serre, ce qui en outre donnerait une plus value à cette maison qui ne lui appartenait pas. Le propriétaire écouta un peu plus attentivement ses propos, mais finalement il dit que non, que ce n'était pas possible dans l'immédiat : il ne disposait pas des liquidités suffisantes pour acheter les trois cornières de métal et la grande plaque de plastique ondulé qui seraient nécessaires. C'est qu'il avait à entretenir une bonne vingtaine de maisons et on n'imaginait pas tous les frais que cela occasionnait et qu'il devait assumer. Bref, au mieux, on verrait l'année prochaine, mais il ne promettait rien. Tenace, le père renouvela pourtant son offre plusieurs fois si bien qu'un jour, à la surprise générale, l'accord oral fut donné. Ce fut une surprise, assurément et on mit sur les qualités de persuasion du paternel d'avoir remporté la bataille. Certes, il fallut encore attendre quelques mois avant que Crésus ne se décidât à ouvrir son portefeuille, mais après tout, on pouvait comprendre, ce n'était pas la saison, n'est-ce pas ?
Puis vint enfin le jour où les travaux débutèrent. Le père acheta donc lui-même ce dont il avait besoin et transporta comme il put tout ce matériel dans sa petite voiture (une quatre chevaux Renault), ce qui en soi constituait déjà un exploit. A la réflexion, ce fut même un miracle s'il y parvint et il faut croire que les dieux, touchés par notre obstination, avaient décidé de prendre notre parti.
C'est comme cela que la famille se retrouva avec une serre convenable, sur laquelle on avait moins peur de faire une chute fatale (puisque le panneau de plastique était solidement fixé à des chevrons de qualité), qui ne risquait plus de s'effondrer à la cave et qui, ô merveille, non seulement ne laissait plus passer l'eau mais qui en plus diffusait une lumière douce et agréable.
Nous en profitâmes pleinement deux mois entiers, jusqu'au moment où le propriétaire signifia qu'il rompait le bail pour occuper lui-même la maison. Le vieux grigou, âgé de près de quatre-vingt ans, venait de décider de prendre sa pension et de ne plus s'occuper de l'épicerie qu'il tenait dans le haut de la ville. Il loua donc son commerce au plus offrant et vint occuper notre maison, qui était la plus petite de toutes celles qu'il possédait et donc celle qui lui rapportait le moins. Mais vous comprenez, pour une personne seule, c'était bien suffisant, n'est-ce pas ?
Epilogue :
Avec le recul, je me dis que ce vieux monsieur, qui avait tout du père Grandet de Balzac, m'a donné une bonne leçon de vie. Malgré mes six ans, j'avais en effet compris qu'il existe des possédants et des possédés et que le sens moral qu'on essayait de m'inculquer ne concernait évidemment pas certaines catégories de la population. Leur argent les mettait au-dessus de tout cela puisque, de toute façon, il leur permettait d'obtenir le respect des autres.
15:34 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, la serre
12/08/2009
La mer
Je marche pieds nus sur le chemin sablonneux. Devant, ce seront bientôt les dunes et leurs herbes folles, indomptées, un peu coupantes aussi (il va falloir faire attention). Et puis ce sera la mer, celle qu'on ne voit jamais, celle dont on ne fait que rêver. Enfin, d'habitude. Derrière, se dressent les montagnes, je le sais, inutile de me retourner. Hier encore je gravissais leurs pentes, avec de solides bottines et un sac à dos. C'est de là-haut, tout là haut, que j'avais vu la mer, véritable toile de fond dans un tableau de la Renaissance. Malgré la chaleur, elle était d'un bleu intense et semblait éternelle. Les Grecs déjà, l'avaient parcourue, puis les Romains et tous ces autres venus du Nord, issus de ces pays sans soleil où la neige et le froid tiennent lieu de paysage.
La mer était donc là, comme dans le poème de Valéry, sorte de « toit tranquille où marchent des colombes », et soudain l'envie m'était venue d'aller la voir de plus près, de sentir son odeur, de la toucher du bout des doigts et de goûter la saveur du sel sur ma peau.
Je suis redescendu des sommets dans la nuit qui tombait déjà et qui n'en finissait plus d'effacer les contours et les distances. Ce n'est qu'en franchissant le pont de la petite rivière que j'ai su que j'étais tout en bas. La chaleur était intense, obsédante, enveloppante aussi, comme dans ces rêves qu'on fait parfois et dont on sort au réveil trempé de sueur. Dans le lointain des forêts, un hibou solitaire hululait.
Aujourd'hui, je marche pieds nus sur le chemin sablonneux.
Au-dessus de moi le ciel est bleu, immense, d'encre profonde et de désir.
La lumière est aveuglante.
Je marche et dans ma tête défilent toutes les attentes et tous les espoirs. Une légère brise, déjà, se fait sentir. Voici les dunes et leurs herbes coupantes. Qu'y aura-t-il derrière ?

15:41 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, poésie, la mer
09/08/2009
Partir, revenir...
Partir, revenir...
Des blogues s'éveillent lentement, après quelques semaines d'assoupissement, tandis que d'autres ferment seulement maintenant, leur auteur préférant le mois d'août pour prendre quelque repos. Les plus courageux continuent même comme si de rien n'était, sans interruption, imperturbables.
C'est comme dans la vie, finalement, certains sont toujours là quand d'autres sont sur le point de partir ou sont déjà partis.
Sauf que dans la vie, c'est l'âge, le hasard ou la malchance qui détermine le départ.
Sauf que dans la vie on ne revient jamais pour recommencer ce qu'on a interrompu. Mais ce n'est pas grave, la machine tourne quand même et on s'aperçoit à peine de l'absence de ces personnes qui ont pourtant compté. Terrible vérité qui nous oblige à rester modestes, toujours, et à prendre conscience que tout est éphémère.
Mais puisque Internet est différent et qu'on a la chance de revenir et de recommencer, il faudrait en profiter et écrire de belles pages pour nos lecteurs impatients. Mais l'écriture ne se commande pas, elle est par définition personnelle et c'est assurément pour soi qu'on écrit. Alors, gagné par la torpeur estivale, on se dit que rien ne presse, qu'il est bon de continuer à vivre au ralenti, sans trop d'efforts, et que goûter les choses est aussi bien que de les (d)écrire.
Paresse ou art de vivre ? Qui sait ? Bien malin celui qui pourra répondre à cette question. Cela revient à se demander si l'écriture est la quintessence de la vie. Certes, on ne peut pas vraiment vivre sans écrire, mais est-ce qu'écrire c'est vraiment vivre ? Qu'est-ce qui est mieux, se laisser guider par l'existence sans trop réfléchir ou au contraire montrer beaucoup de lucidité tout en se réfugiant dans l'imaginaire ? Dans le premier cas, on subit, on est passif, dans l'autre on est actif, on crée un monde, un monde à soi, avec des personnages de papiers qui évoluent dans des paysages inventés (ou du moins déformés par rapport à la stricte réalité). Alors, vaut-il mieux être passif dans la réalité ou actif dans un songe ?
La question, donc, est insoluble mais en fait elle n'a pas de sens puisque lorsque j'imagine une histoire et que je la raconte, c'est encore moi qui m'exprime. Pour le dire autrement, c'est le génie humain de la pensée et des sentiments qui se manifeste ainsi, dans ces écrits pourtant inventés (comme il pourrait se manifester dans n'importe quelle autre activité). Le paradoxe, c'est que je ne serais donc vraiment moi-même que lorsque je quitte la stricte réalité pour aborder un monde créé par moi, un monde de rêves et de douleurs dans lequel je parviens à exprimer si pas tout mon être, du moins une partie de celui-ci.
Que voilà de graves réflexions, qui ne conviennent guères à cette période estivale. Aussi est-il préférable d'attendre encore un peu pour reprendre la plume et rouvrir ce site. Il convient de savourer le temps retrouvé de la lecture et de poursuivre ma rêverie intérieure. Internet est un outil magnifique, mais il est chronophage. A parler, écrire et dialoguer sans cesse on en oublierait les livres et le grand silence qui les entoure, quand on est seul à tourner les pages. J'ai besoin de ce silence et de cette rencontre avec moi-même. Après, seulement, peuvent venir l'écriture et les conversations à son sujet. Il ne faut pas brusquer les choses, jamais, mais se laisser porter par sa vérité intérieure.

Photo Internet
01:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (5)
13/07/2009
Absence
Le stylo est soigneusement refermé afin que l'encre ne sèche point.
Dans le tiroir du bureau, je l'ai bien rangé, entre un crayon taillé avec soin et une gomme désuète.
Ensuite, j'ai fermé tous les programmes de l'ordinateur, un à un, puis j'ai tout éteint. J'ai même débranché la prise, car les orages de juillet peuvent être terribles, parfois, quand les vents venus de grand Sud viennent affronter ceux du Nord. Mille zébrures meurtrières raient alors la nuit noire, éclairant un instant nos songes et semblant nous montrer le sens caché des choses.
J'ai regardé les livres, soigneusement rangés sur leurs rayonnages, les poètes avec les poètes, les romanciers avec les romanciers. Puis la couverture jaune de Rimbaud, dans son édition des Classiques Garnier, qui tranche sur tous les autres. Je n'ai point besoin de me lever et de le prendre pour savoir que les pages en sont usées d'avoir si souvent été lues et que la reliure en est un peu fatiguée, d'avoir si souvent été ouverte. Ensuite il y a ceux qui n'arrêtent pas de nous habiter depuis qu'on les a lus, les Malcolm Lowry, les Dostoïevski, les Styron, les Garcia Marquez. Et puis Montaigne, bien sûr et Baudelaire et tous les autres. Ils sont tous là, bien présents au cœur de la nuit. Je souris en les regardant, car leur présence est rassurante. Lentement, je me lève et m'achemine vers la porte, puis j'actionne l'interrupteur. La grande nuit reprend aussitôt ses droits. Pourtant, en me retournant, il me semble encore sentir la présence des livres, comme s'ils avaient une âme qui eût flotté dans la pièce. Il suffirait d'allumer de nouveau la lampe pour qu'ils réapparaissent. Mais non. Il est tard, il faut partir. Je referme la porte sans faire de bruit et m'éloigne à pas feutrés.
A l'adresse de mon site, j'ai laissé un message pour les lecteurs et les lectrices qui viendraient flâner par ici. Ils et elles le découvriront demain :
« Blogue en pause estivale ».
Alors eux aussi s'en iront, n'ayant plus à revenir en ce lieu maintenant désert. Mais on ne peut pas toujours écrire. Il faut vivre aussi, s'imprégner de nouvelles impressions, les intégrer, les faire siennes. Plus tard, alors, on pourra écrire sur ce que l'on a vécu, le transformer, le modifier, l'amplifier, lui donner un sens. Plus tard.
Mais si toi, lectrice, tu ne pars pas ou si toi lecteur, tu restes dans tes foyers, cela n'empêche pas le voyage intérieur. Recherche ta vérité au plus profond de toi-même et tu n'auras pas perdu ton temps.
Photo personnelle
01:11 Publié dans Blogue | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : blogue
07/07/2009
La cave
La cave... Impossible de descendre dans une cave sans avoir l'impression de transgresser une limite et de pénétrer dans un autre monde. La cave est un lieu souterrain, un lieu de mystère, plongé dans le noir, dans la grande nuit de la mort.
C'était, je m'en souviens bien, un endroit interdit, probablement à cause de la présence d'un escalier assez dangereux, mais pour moi cette interdiction était la preuve que la cave recelait des mystères inquiétants. Et en effet, à peine avait-on descendu les marches qu'on se retrouvait devant la porte toujours close de ce qu'on appelait « la petite cave ». Je ne passais devant cette porte qu'avec la plus grande vigilance et ce n'est que de loin que j'osais l'observer. Je savais, pour l'avoir vue un jour entrouverte, ce qui se cachait derrière : une sorte de boyau étroit, mais long, si long qu'on en devinait à peine le bout dans la quasi-obscurité que ne parvenait pas à vaincre une ampoule rachitique. Ce qui m'avait frappé, c'était l'absence totale de fenêtre. Pas le moindre soupirail, pas le plus petit interstice par lequel la lumière du jour aurait pu pénétrer. Un endroit de cauchemar, assurément. Et comme il n'y avait rien dans cette cave, j'en déduisais qu'elle était en fait un corridor souterrain qui devait mener Dieu seul savait où, quelque part dans les entrailles de la terre. Plus loin, incontestablement, devait se trouver une prison moyenâgeuse, une sorte d'oubliette où on jetait les enfants dont on avait pu se saisir.
Le fait que même mes parents ne pénétraient jamais dans ce lieu renforçait mes craintes tout en les confirmant. C'était un lieu maudit, vous dis-je, et pour rien au monde je n'aurais franchi le seuil de cette tombe, où j'aurais été contraint d'errer dans le noir absolu, tâtonnant maladroitement le long des murs humides, m'écorchant les doigts à leurs pierres rugueuses. Tout au bout, des soldats en armures m'auraient saisi et emporté plus loin encore, dans un endroit de terreur dont je ne serais jamais revenu. Rien qu'à regarder la porte pourtant soigneusement close de cette « petite cave », il me semblait entendre dans le lointain le cliquetis de leurs épées et le bruit métallique de leurs armures. Après m'être raconté deux ou trois histoires absolument terrifiantes, je remontais l'escalier en courant, affolé pour de bon et c'est le cœur battant que j'arrivais à la lumière du jour, en plein solstice d'été, dans la chaleur de midi. On me regardait avec étonnement, mais mes yeux exorbités disaient assez d'où je venais et on ne me posait donc aucune question. Je vivais ce silence comme une preuve supplémentaire de la réalité des horreurs qui se déroulaient immanquablement dans cette cave et qui étaient si terribles que personne n'osait même en parler.
Mais reprenons notre visite. Sous l'escalier, se trouvait un renfoncement où on mettait au frais la réserve de pommes de terre, en provenance directe du potager. Au printemps, l'appel de la belle saison était tel qu'elles se mettaient toutes à faire des germes incroyables, sortes d'excroissances blanches ou bleutées qui témoignaient que la vie, toujours, était là, palpitante, au cœur de la nuit souterraine. Mais je m'attardais peu à contempler ces tubercules et leurs mystères, à cause de la proximité de la « petite cave ». Je préférais passer en courant et aller directement dans la « grande cave », qui était le règne de ma mère. A l'entrée se trouvait le garde-manger (j'ai parlé, déjà, de l'absence de frigo), où on tentait de conserver tant bien que mal les restes de repas en profitant de la fraîcheur du lieu. C'était souvent peine perdue, surtout lorsque le temps était à l'orage et il fallait alors jeter cette nourriture pourtant si précieuse. Comme le rayonnage de la cuisine, ce garde-manger était une fabrication artisanale du père, faite de bois et de treillis métallique, lequel avait pour fonction de protéger des insectes et de laisser passer l'air. J'avoue que c'est le seul garde-manger que j'ai vu dans ma vie, aussi quand à l'école, beaucoup plus tard, j'ai étudié le pluriel des noms composés, ce n'est pas sans fierté que j'ai retrouvé ce mot dans la liste des substantifs comportant le mot « garde » (garde-chasse, garde-meuble, etc.). Tandis que me petits condisciples se demandaient à voix basse ce que pouvait bien être un garde-manger, moi je souriais intérieurement et il me semblait que l'instituteur ne l'avait glissé là qu'à mon intention.
Un peu plus loin dans la cave se trouvait la machine à laver. Progrès technologique incroyable que cette machine, surtout pour ma mère qui avait encore connu le lavoir public dans son village et la glace qu'il fallait casser en hiver pour rincer le linge. Pourtant cette machine était constituée d'une simple cuve avec une hélice. Cela veut dire qu'il fallait préalablement chauffer de l'eau dans une lessiveuse aussi grande que l'enfant que j'étais. Je revois encore les flammes bleues du brûleur à gaz qui léchaient le fond de cette lessiveuse et qui constituaient, pour peu qu'on éteignît la lumière, autant feux follets bleutés qui dansaient dans l'obscurité. Une fois l'eau bien chaude, il fallait la transvaser dans la machine à laver, opération délicate et dangereuse à laquelle je n'ai jamais été autorisé à participer, ce qui fait que j'ignore toujours comment on s'y prenait pour mener cette opération à bien. Ensuite, il fallait actionner l'interrupteur de la machine et faire tourner le linge un temps qui me semblait une éternité.
C'est que j'avais hâte d'arriver à l'étape suivante, qui m'était confiée. Une fois le linge ressorti de la cuve, il fallait l'essorer en le faisant passer entre deux rouleaux fixés à la machine et qu'on actionnait à l'aide d'une manivelle. C'était un plaisir que de voir les linges gorgés d'eau se faire happer par ces rouleaux, s'aplatir autant qu'il était possible et rendre, dans un bruit de cascade, toute l'eau dont ils étaient gorgés. Ils ressortaient à l'autre bout complètement aplatis, complètement ridicules aussi, pauvres petites choses insignifiantes et plates dans lesquelles il était bien difficile de reconnaître une taie d'oreiller ou un pyjama. Quand tout cela était terminé, comme si leur sort n'était pas encore assez cruel, ils passaient à l'essoreuse, machine incroyable qui à l'époque représentait la pointe de la technologie (surtout si on la comparait à la machine à laver) et qui à ce titre faisait la fierté de toute la famille. Pourtant, quand je voyais ma mère la maintenir tant bien que mal quand elle prenait de la vitesse dans un bruit de sirène, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui arriverait si jamais elle la lâchait. Emportée dans sa course tourbillonnante, l'essoreuse aurait fait toute seule le tour de la cave avant d'aller s'encastrer contre un mur dans un grand bruit de ferraille, ce qui, heureusement, n'arriva jamais.
00:01 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature
05/07/2009
Pierre Leroux, questions à Bruno Viard
Je reviens encore une fois à Pierre Leroux. On aura compris, par les quatre notes qui lui ont été consacrées, que ce philosophe m'intrigue. On a rarement vu, en effet, un penseur aussi perspicace, car il a été capable de deviner ce qu'allait devenir le capitalisme (une recherche exclusive de la fortune personnelle, au détriment de l'épanouissement de la société) et ce qu'allait devenir le socialisme (la dictature stalinienne). Evidemment, de son vivant, personne ne savait encore qu'il allait avoir raison dans ses prédictions. Plus tard, les défenseurs des doctrines concernées se sont bien gardés de le lire, puisqu'il faisait leur critique. Aujourd'hui, par contre, nous nous retrouvons déçus par le socialisme d'état, mais écrasés par le capitalisme et son économie mondiale. Il semblerait donc que le moment soit bien choisi pour s'intéresser (enfin) à Pierre Leroux.
Intrigué donc par ce philosophe, je suis rentré en contact avec l'auteur du livre dont j'ai fait le compte-rendu (« Pierre Leroux, penseur de l'humanité"), via son éditeur. Je vous donne ici, afin d'en faire profiter le plus de personnes possible, les réponses qu'il a bien voulu donner à mes questions,
Je rappelle que Bruno Viard est professeur de littérature à l'Université de Provence (Aix-en-Provence) et qu'il est spécialiste du XIX°siècle.
Voici donc mes questions et ses réponses.
Cher Monsieur,
j'ai apprécié votre compte-rendu de mon livre qui me paraît sonner juste. J'ai aussi découvert votre blog et les intéressantes discussions qu'il contient. Je réponds donc avec plaisir aux questions que me transmettent (les éditions Sulliver).
Première question :
A la page 58 du livre, on trouve une citation de Leroux, qui tente de définir la notion de « ciel » et qui explique que tout vient d'une erreur d'interprétation du texte biblique et notamment de la phrase « Mon royaume n'est pas encore de ce temps.» Leroux veut montrer par-là que le Christ imaginait son royaume sur terre, parmi les hommes, dans un futur encore à venir et non dans l'espace (interprétation fausse qui elle aurait servi de base pour justifier tout le courant mystique). Ce qui m'ennuie, c'est que si on se reporte à la Bible et notamment à Jean, 18- 36, on trouve « Mon royaume n'appartient pas à ce monde ; si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Les autres évangélistes ne reprennent pas cette phrase (uniquement celle sur le « roi des Juifs »)
Je précise d'emblée que je suis athée et que ma question est d'ordre philologique et non religieux. Leroux s'appuyait-il sur un autre passage que celui que j'ai cité ou bien déforme-t-il le texte biblique ? A moins que ce ne soit la traduction française du texte grec initial qui ne soit erronée ? Leroux reprend-il à d'autres endroits dans son œuvre cette interprétation ? Celle-ci est fondamentale puisqu'elle définit une anthropologie de l'action : c'est sur terre qu'il faut faire le paradis de l'homme plutôt que de contempler un Dieu inaccessible.
Réponse :
La question est capitale. Il y a d'abord une querelle philologique: Leroux conteste les traductions habituelles de l'Evangile et affirme que le mot grec ouranos qu'on traduit par ciel, signifie aussi monde, univers, ce qui entraîne l'immense conséquence de faire Dieu immanent et non transcendant. De même, l'adverbe entautha qu'on traduit par là, ici-bas signifie aussi alors, en ce moment-là: le royaume du Dieu immanent ne serait donc pas perché dans le ciel, mais à contruire pour l'avenir (sens temporel et non spatial), puisqu'il n'est pas de maintenant, ce qui crève les yeux. Je ne peux entrer dans cette discussion savante. Le plus intéressant me semble être la volonté politique de Leroux sur ce problème. Lui aussi était athée à 16 ans, mais il fut très impressionné par le livre de Saint-Simon paru en 1925, Nouveau Christianisme où Saint-Simon réclamait que le magnifique message de fraternité de Jésus trouve son application sur notre terre et le plus vite possible. Le saint-simonisme est né de là, c'est-à-dire la première forme de socialisme avant même que le mot existe, Marx étant âgé de 7 ans à peine. Loin que cet aspect du saint-simonisme soit utopique, il est réaliste puisqu'il réclame que l'idéal évangélique d'amour soit appliqué au sein de la vie sociale et économique.
Leroux parle tout le temps de Dieu et de religion, mais ça n'a rien à voir avec la religion des curés de l'époque. C'est juste le contraire ! Il faut absolument désambiguïser ! Pour lui, Dieu, c'est la Vie universelle. En ce sens, ce n'est plus une question de croyance, mais une constatation. Leroux qui pressentait l'évolution sans connaître les théories de Darwin, et pour cause dans les années 1830, voulait dire que la vie et la conscience humaines constituaient l'extrême pointe du vivant dans ses formes multiples. Dieu, c'est la vie universelle dans son évidence et son mystère. Cette conception du divin permettait à Leroux d'exprimer une "solidarité" de tous les êtres vivants qui se nourrissent les uns les autres biologiquement et spirituellement, préfiguration de la conscience écologique actuelle.
Deuxième question :
Quand on parcourt un peu le site des « amis de Pierre Leroux » et qu'on lit ce que Georges Sand a pu dire de lui, on s'aperçoit que l'opinion de cette dernière a fort varié avec le temps. L'engouement initial finit par se transformer en lassitude. Le problème est donc, pour nous qui vivons au XXI° siècle, de savoir comment interpréter la personnalité de Leroux. C'est le problème de tout historien confronté aux sources. D'une part nous avons les écrits de notre philosophe et de l'autre les commentaires que des contemporains ont pu laisser sur lui. Par définition, cependant, ces témoignages sont subjectifs (on le voit bien avec G. Sand). Au début du livre vous citez d'ailleurs Henri Heine, Jacques Reynaud, Marie d'Agoult et Alexandre Erdan, donnant du coup une image positive de Leroux (ce n'est pas un reproche). Mais comment avez-vous procédé ?
Par recoupement de tous les témoignages des contemporains ? En se focalisant essentiellement sur les textes de Leroux ? En consultant tous les documents d'archives (procès verbaux etc.) afin de tenter de cerner comment Leroux était vu par les autorités (un doux illuminé ou un homme dangereux...) ?
En fait, ce que dit Leroux me séduit et si j'avais dû écrire un livre sur lui, je me rends compte que j'aurais eu tendance à le présenter sous son meilleur jour. Mais quand on le voit quémander sans cesse de l'argent, on finit quand même par se demander si c'était un idéaliste qui mettait tout en œuvre pour réaliser ses projets ou si au contraire c'était un opportuniste qui se servait de ses idées pour vivre au crochet des autres (ou du moins qui se servait habilement de ces autres pour avoir les moyens matériels d'imposer ses idées).
Réponse :
Mon livre succède à la publication d'une Anthologie de l'oeuvre de Leroux (Le Bord de l'Eau, 2007). Je crois avoir dépouillé la quasi totalité de cette oeuvre immense que j'évalue à 12. 000 pages. Si je pense assez bien connaître les textes, il n'en va pas de même, bien sûr, de la vie de Leroux.
J'ai été très frappé par la convergence des 4 portraits que j'ai reproduits, tracés par des auteurs qui ne se sont pas donné le mot. C'est vraiment concordant. Et c'est la générosité du personage qui frappe le plus, en accord avec toute son oeuvre. Avait-il des défauts de carctère ? Qui n'en a pas ? Et nous n'y étions pas. Mais il est sûr qu'une oeuvre comme la sienne heurtait violemment l'opinion catholique, et l'opinion bourgeoise. On devine que la calomnie était, dans un climat de passion extrême, surtout en 48, une arme dont on usa et abusa. Aujourd'hui, c'est plutôt ceux qui croient encore à un socialisme scientifique, et qui sont à mes yeux les véritables utopistes, qui gardent rancune à Leroux d'avoir montré du doigt ce qu'on n'appelait pas encore le totalitarisme.
Leroux vécut en bohème, c'est sûr, toujours dans sa philosophie et sa politique. Marié deux fois, il eut neuf enfants et connut les misères de l'exil et même la faim, en famille ! à Jersey après le 2 décembre 1851. Que les fourmis lui reprochent d'avoir sollicité des bienfaiteurs plus fortunés ! George Sand fut généreuse. Il est vrai qu'elle s'éloigna de lui. Leroux se brouilla gravement avec Hugo, son riche voisin. Et alors ? Qui dira où furent les bons et les méchants ? Quelle vie est sans conflit ?
Troisième question :
Vu le tempérament bien trempé de Leroux (voir discours à l'Assemblée nationale, etc.) et vu sa volonté de parvenir à tout prix à imposer ses idées, comment expliquer qu'il soit finalement aussi méconnu ? Pourquoi sa synthèse dialectique du capitalisme et du socialisme ne s'est-elle pas imposée ? Hegel, qui venait de mourir en 1831, avait pourtant montré, dans sa « Phénoménologie de l'esprit » l'importance de cette dialectique dans les courants de pensée.
Réponse :
Je trouve comme vous que la pensée de Leroux est mal reconnue alors même qu'elle serait très vivifiante pour le XXI° siècle, d'où mes efforts pour la faire connaître. Pour tout dire, je ne connais pas de penseur de cette envergure et qui balayent autant de questions avec autant d'ouverture et de profondeur, de simplicité et de sens de la synthèse Je pense que c'est parce qu'il transcende tous les dualismes et les manichéismes qu'il se fit des ennemis à chaque fois des deux côtés, chez les catholiques, comme chez les athées, à droite comme à gauche à l'époque du stalinisme. Il faut dire que l'étiquette utopiste appliquée par Engels à tous les penseurs français antérieurs à Marx fut extrêmement efficace. Fourier, certes fut un authentique utopiste, comme Cabet. Leroux est au contraire un réaliste et un terrien, même si certains côtés de son oeuvre sont aujourd'hui dépassés. Nous savons maintenant que l'impasse faite par Marx sur le droit constitutionnel, sur les droits de l'homme, sur les formes juridiques du pouvoir était en réalité un boulevard ouvert au despotisme et à la dictature. En même temps qu'il déclarait à l'ordre du jour "la grande question du prolétariat", Leroux n'a cessé de faire des mises en garde dès 1832 contre les révolutionnaires trop pressés et trop violents. Il fut Cassandre ! Le mur de Berlin est tombé, mais les esprits sont parfois plus lents à changer leurs habitudes. Tocqueville a pourtant refait surface. Parions que le XXI° siècle verra le retour de Pierre Leroux.
03:35 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : leroux, bruno viard
01/07/2009
La cuisine
Maison poème
Chez nous, en ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Chez les autres non plus, à vrai dire, mais chez nous il y en avait encore moins que chez les autres. Alors, si je devais vous décrire les meubles de la cuisine, je serais bien embêté parce qu'il n'y en avait pas.
Heureusement, la pièce était très petite, comme toute la maison d'ailleurs, ce qui fait que le visiteur qui entrait n'était pas frappé par cette absence de meubles, pourtant bien réelle. Dans le prolongement de la porte, contre le mur de gauche, trônait une desserte à roulettes. On n'a jamais su pourquoi ma mère l'avait achetée car elle n'a jamais servi à rien, si ce n'est à déposer la cage du canari. Celui-ci, par contre, on savait bien à quoi il servait : son rôle était d'égayer la maison et de faire oublier sans doute que nous étions un peu démunis. Alors, éternel prisonnier dans sa cage, le pauvre s'acquittait du rôle qui lui avait été assigné en chantant du matin au soir. Il chantait bien en plus et très juste. Je l'écoutais pendant des heures, étonné quand même qu'il prît tant à cœur son travail de forçat. Je me disais en le contemplant qu'il y avait plus mal loti que nous. Condamné à la prison à vie, il chantait quand même et exultait sa joie de vivre en petit philosophe qu'il était. Parfois je me demande s'il ne m'a pas appris davantage de choses sur la vie que les frères des écoles chrétiennes, mais bon, ce n'est pas là notre sujet et nous en parlerons une autre fois.
A part la desserte et son canari, donc, il n'y avait rien contre le mur de gauche. Au bout, dans le coin, on trouvait l'évier (d'origine). Un rideau à fleurs habilement passé dans une tringle cachait les ustensiles qu'on déposait en dessous, comme le savon et les éponges.
Le mur du fond, en prolongement de l'évier, ne comportait qu'une fenêtre ainsi que la porte donnant sur le jardin. Au printemps on enlevait les grands rideaux blancs supposés nous protéger du froid hivernal (ce qu'ils faisaient bien mal, à vrai dire) et on les remplaçait par de petits rideaux avec des motifs représentant des cerises rouges. Cette couleur égayait aussitôt la pièce, que la lumière envahissait soudainement grâce à la partie de la vitre désormais laissée libre. C'était une joie, quand je revenais de l'école, de découvrir que les petits rideaux à cerises rouges avaient refait leur apparition. Ils annonçaient déjà l'été et le retour des grandes vacances.
Durant ces étés caniculaires (avez-vous remarqué comme les étés étaient toujours beaux et chauds dans nos enfances ?), la porte restait grande ouverte et un rideau en plastique composé de lanières de différentes couleurs retenait la chaleur à l'extérieur tout en empêchant les insectes d'entrer. C'était un plaisir délicieux, avec ma petite voisine, de passer et de repasser sans arrêt entre ces rubans qui sentaient bons la matière synthétique, jusqu'au moment évidemment où un adulte s'apercevait de notre manège. On se faisait alors réprimander vertement sous prétexte que nous allions abîmer le précieux rideau, qui n'était pas un jouet. Pourtant, étant donné la chaleur étouffante qui régnait à l'intérieur de la cuisine, complètement privée d'air, et le nombre de mouches qui volaient dans tous les sens, je me disais que ce rideau si inefficace n'avait d'autre but que d'agrémenter mes journées, notamment en me permettant de frôler délicieusement les membres ou le dos dénudés de ma compagne de jeu, qui, si elle avait déjà franchi les rubans multicolores et était ainsi devenue invisible à mes yeux, ne semblait jamais assez rapide pour s'esquiver, sans qu'on sût jamais si elle le faisait exprès ou pas.
Mais je m'égare, revenons à notre description. Au milieu du troisième mur de la cuisine, trônait le grand poêle de fonte, sorte de gros crapaud énorme qui occupait un cinquième de la pièce à lui tout seul et qui, en hiver, était capable d'ingurgiter une quantité astronomique de bois de chauffage. Ce bois que mon père allait couper lui-même en pleine en forêt durant les mois d'été, ce bois qu'il avait dû transporter jusqu'à la maison, puis qu'il avait dû refendre, scier et finalement empiler dans la remise du jardin, ce bois, dis-je, voilà que ce gros bêta de poêle l'avalait sans aucune retenue, en demandant et en redemandant sans cesse. Il était semi-circulaire, avec une taque noire où s'engouffraient les bûches et, sur les côtés, des garnitures chromées qui déformaient le visage de l'imprudent qui osait se regarder dedans. Je me souviens des matins d'hiver, avant l'école, quand je grignotais une gaufre (ces grosses gaufres nourrissantes faites dans un moule en fonte qu'on disposait directement au-dessus de la flamme), les pieds dans le four latéral du poêle qu'on venait juste d'allumer. C'est qu'il avait bien du mal à combattre la froidure de la nuit qui continuait à s'éterniser dans la pièce et qui avait laissé aux vitres ces roses magnifiques que je contemplais avec émerveillement dans mon demi-sommeil, quand je ne me mirais pas dans les garnitures en chrome qui me renvoyaient l'image d'un bien étrange personnage qui n'était autre que moi-même.
Quant au quatrième et dernier mur, il était un peu la honte de la maison, aussi s'arrangeait-on souvent pour que les visiteurs, si d'aventure il s'en trouvait, lui tournassent d'office le dos. C'est que contre ce mur, là où aurait dû se dresser un beau meuble en chêne, un vaisselier de style ou un de ces mastodontes tout d'une pièce qui font l'orgueil des familles de génération en génération, se cachait, derrière son rideau, une ridicule petite étagère. Et encore, quelle étagère ! Elle n'était même pas faite de ce bois stratifié et lisse qu'on trouve dans les magasins et qui, s'il n'est d'aucune beauté, offre au moins l'avantage d'être facile à nettoyer. Non, ce qui misérablement était adossé au mur, c'était un simple rayonnage de bois brut à peine raboté, dont beaucoup n'auraient même peut-être pas voulu pour leur cave. On y rangeait toute la vaisselle et surtout ces casseroles émaillées pleines de coups dont je me demandais toujours de quelle guerre elles étaient les rescapées. Pour cacher tout cela (quand même!), un rideau monté sur sa tringle, le même rideau, ô luxe inouï, que celui qui dissimulait le dessous de l'évier, preuve que la maîtresse de maison avait du goût et qu'elle aurait accompli des merveilles si les moyens lui avaient été donnés. Comme ce n'était pas le cas, elle se rabattait, avec cette dignité qu'ont les gens démunis, sur ces petites coquetteries qui rendent agréables des maisons qui sans cela ne le seraient vraiment pas.
Car en ce lieu, même si c'était une cuisine, il ne fallait pas chercher de frigo, sans qu'on sache bien si c'était le manque de liquidités du ménage ou l'exiguïté de la pièce qui en avait rendu la présence impensable. Il ne fallait pas chercher non plus de poste de télévision, ni dans cette pièce-ci ni dans aucune autre d'ailleurs. Le luxe et la modernité, ce n'était pas pour nous et ma foi c'était peut-être mieux ainsi. Pour l'enfant solitaire que j'étais (quand la petite voisine n'était pas là, ce qui arrivait souvent, soit qu'elle eût trouvé des filles de son âge pour s'amuser, soit que, déjà, elle me fût infidèle) il ne me restait plus qu'à apprivoiser mes rêves et à contempler les formes étranges que prenaient les nuages quand le vent les poussait en troupeaux indisciplinés vers l'horizon inconnu.
09:45 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : littérature, la cuisine
28/06/2009
Cercles concentriques
L'homme, de par son regard, a une vision circulaire du monde, contrairement à ce que pourraient nous faire croire les rues bien rectilignes de nos villes.
La terre est ronde et ce que je peux observer du paysage quand je me place sur une hauteur, c'est un grand cercle dont j'occupe le centre. Du coup, dans la préhistoire déjà, l'homme s'est cru le centre de tout. Il l'a dit dans ses mythes et la religion l'a conforté dans ses convictions.
Pourtant, cet homme, qui par ailleurs est intelligent, s'est vite rendu compte que ce centre changeait d'endroit en même temps que lui lorsqu'il se déplaçait. Lui-même restait au milieu de tout, mais ce milieu pouvait se trouver n'importe où. C'est pourquoi le fait de se sédentariser le rassura. Non seulement il trouvait là un genre de vie plus commode et moins tributaire du hasard, mais aussi il se redonnait du même coup une place précise et unique dans l'univers : il était et pour toujours au centre de son monde à lui.
Il lui fallut alors, comme un animal, marquer son territoire. Faute de pouvoir dire qui il était, il pouvait au moins dire ce qui était à lui. Les premiers fossés furent creusés (qu'on se souvienne du sillon sacré que Romulus aurait tracé lors de la fondation de Rome, ce qui l'amènera aussitôt à tuer son frère Remus qui avait osé franchir cette limite symbolique) et les premières palissades dressées afin de se protéger des ennemis mais aussi afin de clôturer l'espace et de définir un cercle plus restreint qui ne serait qu'à soi. En effet, si le grand cercle de l'horizon englobe tous les hommes et tous les animaux, la clôture de mon jardin permet de distinguer le tien du mien.
L'homme imagina donc toute une série de cercles concentriques qui, dans l'immensité du monde, allaient délimiter son intimité.
Imaginez la scène. Elle est là, sous vos yeux.
Partout c'est la forêt, immense, infinie, primitive. Elle est le règne des animaux sauvages et symbolise tous les dangers.
Puis, à un endroit, la forêt laisse la place à une clairière. Ce sera d'abord un emplacement où la foudre a frappé. Les arbres calcinés n'ont pas repoussé et l'herbe a envahi le terrain. Plus tard, ce seront les moines qui auront, par petits morceaux, défriché cette forêt primitive, tentant d'imposer la loi des hommes (de Dieu ?) à la nature.
On a donc un premier cercle, constitué par la ligne des arbres à l'orée du bois.
Il y en aura bientôt un deuxième, car l'homme a décidé de vivre dans cette prairie riante, en retrait de la forêt sauvage, dont il dépend encore en grande partie pour se nourrir et se chauffer.
Il labourera la prairie ou une partie d'icelle et cultivera de l'orge et du froment, ce blé des terres pauvres et encore un peu sauvages. La nuit, quand tout est aboli, que plus rien n'existe et que le monde a cessé d'être, les animaux sauvages viendront piétiner les jeunes pousses de leurs sabots fendus ou même fouiner à même le sol de leur groin redoutable.
Au petit jour, l'homme contemplera, consterné, le massacre du blé tendre. Il lui faudra bien dresser une palissade pour protéger les semis futurs. Car aussi tenace qu'un insecte, il recommencera à ensemencer son champ, non sans l'avoir cette fois clôturé au préalable d'une ligne de pieux pointus. Ce sera le deuxième cercle dont je parlais plus haut.
Voilà donc le champ protégé, mais aussi définitivement délimité. La frontière est là, entre la nature et la culture, entre ce qui est public et ce qui est privé.
L'orée de la forêt, la palissade. Un premier cercle, puis un autre. La nature s'arrête au premier, le règne de l'homme commence en deçà du deuxième. Entre les deux, la clairière, la prairie, qui n'appartient à aucun des deux mondes et qui du coup appartient à tous.
Si le blé, maintenant bien protégé, se met à pousser à la chaleur de l'été, en hiver il faut se chauffer. La forêt n'est pas loin, on y fait des incursions, on abat quelques arbres, qu'on découpe et qu'on ramène chez soi, c'est-à-dire derrière la palissade. Car au centre du champ de céréales se dresse le repère de l'homme, son antre, sa tanière, autrement dit, sa maison. C'est là qu'il se réfugiera à la mauvaise saison, c'est là, déjà, qu'il se cache, une fois la nuit venue. Bien protégé des bêtes sauvages, il peut s'assoupir et écouter ses rêves.
Le matin, dans l'air frisquet du petit jour, il coupera le bois ramené la veille et en fera un tas bien ordonné. Une sorte de mur d'un mètre de haut qui va aller en s'allongeant (car l'hiver est rude dans ces contrées et il faut se montrer prévoyant cette fois, plus prévoyant qu'il ne l'avait été quand il avait ensemencé une première fois son champ). Bientôt, c'est un rempart de trente stères de bois qui entourera la maison.
Voilà le troisième cercle.
C'est un cercle plus fragile celui-là : un monceau de bois de chauffage, qui délimite la propriété. C'est toujours du bois, mais il est le fruit du travail de l'homme. Coupé, scié, mis en tas bien ordonné, il devient à son tour palissade, marquant une autre limite, celle entre l'intimité domestique et la sphère agricole, entre l'endroit où on vit et l'endroit qui permet de vivre.
Dans cette « clairière » privée, en son centre, la maison. C'est une cabane en bois, évidemment. Autre cercle (même s'il est carré), qui cette fois offre un abri, un espace fermé et couvert, où s'abriter des intempéries et des froidures de l'hiver.
A l'intérieur de tout cela, il y a l'homme. Il vit là avec sa famille.
Le temps a passé depuis le début de cette histoire, les générations aussi. Ce n'est pas lui qui a trouvé le premier cercle, l'orée autour de la clairière. Ce n'est pas lui non plus qui a défiché puis créé le deuxième cercle, la palissade protectrice. Ce sont ses ancêtres et les ancêtres de ses ancêtres. Et même ceux encore avant tous ceux-là. Bref, entre le néolithique et notre homme, beaucoup de blé a été fauché et beaucoup de bois a été coupé.
Et lui, il est là, l'héritier de tous, le garant de leur mémoire, en quelque sorte. Il ne se souvient pas vraiment, mais c'est inscrit dans ses gènes, c'est le principal.
Il y a plusieurs pièces, dans la maison, mais celle qu'il préfère, c'est ce petit coin qui n'est qu'à lui, un bureau et tout autour, le long des murs, couvrant ces murs, des livres et encore des livres. Une muraille de livres, en réalité.
Et dans sa tête à lui, on trouve toutes sortes d'idées, qui grouillent dans tous les sens et qu'il met par écrit, parfois, quand il y en a trop, afin de les ordonner. Les ordonner comme il a fait du tas de bois à l'extérieur et tenter par-là de donner un sens à l'incohérence du monde.
Et quand finalement arrive l'hiver, rigoureux, quand la neige vient de la forêt et recouvre tout, il faut chauffer la maison. Alors l'homme prend du bois de chauffage, fragilisant du même coup la palissade extérieure. Plus l'hiver dure et plus la pile de bois diminue. A la fin elle disparaît presque, abolissant les limites entre le troisième et le deuxième cercle. Entre les pourtours de la cabane et ce qui était le champ de blé, mais qui n'est plus qu'un champ de neige, comme la clairière, comme la forêt, comme le monde entier. La neige recouvre tout, abolissant les limites.
C'est alors que du bois sortent les premiers loups, tenaillés par la faim.
Post scriptum : pour ceux qui voudraient contempler cette cabane et ses cercles concentriques, c'est par ici.

00:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (22) | Tags : littérature, cercles concentriques
24/06/2009
Le grenier
Maison poème...
Dans le grenier des rêves j'ai retrouvé mon enfance.
Dans une grande malle, sont rangés les jouets et des puzzles incomplets. Sous la tabatière, le cheval à bascule contemple les étoiles.
En hiver, on faisait sécher en ce lieu la lessive des lundis et c'était comme de grands fantômes blancs immobiles qui semblaient dormir là, énigmatiques et muets. Je me faufilais entre eux, respirant à pleins poumons, les yeux fermés, la bonne odeur du large que le savon avait laissée. Dans mon cœur, des tempêtes faisaient rage et les vagues de l'Atlantique déferlaient sous le vent des équinoxes. Contre ma joue, les draps humides et froids mouillaient ma peau. Frisson délicieux. Envoûtement...
Du bout des doigts je touchais ces êtres mouvants, mais ceux-ci, rebelles, se dérobaient sans fin.
Dans les coins reculés trottinaient les souris. Leurs yeux interrogateurs parfois luisaient dans l'ombre et c'était ensuite des courses éperdues dans l'épaisseur du plancher. Monde mystérieux, inaccessible. Quelle vie palpitait là, sous mes pieds ?
Sur une boîte en carton, une trappe tendue attendait, inutile, son fromage ayant été dévoré au siècle passé.
Dans une housse transparente pendaient des vêtements d'un autre âge. Portés par qui ? Mystère.
Sur un journal de l'année passée sèchent des oignons. Le bruit de papier quand on effrite la pelure dans les mains... Elle retombe en poussière d'or emportée au moindre courant d'air.
Près de la cheminée (celle du père Noël ?) un vieux lustre gît à terre. Quelles fêtes d'un autre âge a-t-il dû éclairer ? Quelles jeunes filles en fleur ont dansé dans sa clarté ? Elles doivent être mortes, maintenant. Qui étaient-elles ? Une de ces mères-grands entr'aperçues un jour sur de vieilles photos en noir et blanc ? Bien droites, raides et dignes dans leurs habits du dimanche, figées pour l'éternité, avec sur les lèvres un sourire si las... Suis-je leur descendant, moi qui suis maintenant à genoux, cherchant entre les lattes du plancher une épingle à cheveux inaccessible ?
Dans la vielle armoire dont la porte grince, il y a, je le sais, des lettres du temps jadis, venues tout droit des tropiques. Zanzibar, Tananarive et les îles sous le vent surgissent dans le grenier. Sur les timbres dentelés, des négresses aux dents blanches sourient devant les mers du Sud. Qui a envoyé ces lettres ? Quel oncle disparu, jamais croisé ? A-t-il acheté des esclaves le long du fleuve Zaïre ou vendu des armes à Tombouctou ? De quel désert du Hogar a-t-il écrit ? De quel village abyssin ? Je ne le saurai jamais, un cadenas maintenant condamne la porte. Il me reste à rêver et à imaginer des voiliers remplis de pirates ou des îles enchantées.
Craquement dans l'escalier. On vient me chercher car on sait que c'est ici que je me réfugie souvent, pour contempler dans la lumière de la tabatière les mille grains de poussière d'or qui volent au moindre souffle, formant comme des nuages énigmatiques dont nul n'a le secret.
12:13 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, poésie, le grenier
21/06/2009
Le blogue : une logorrhée verbale ?
Pour ceux que cela intéresse, Marche romane vient de franchir le cap de son quatre centième article. Ce n’est pas rien, évidemment. Ce n’est pas rien mais cela nous amène, une fois de plus, à nous poser des questions sur la pertinence de tout cela. Qu’est-ce finalement qu’un blogue ? Que cherche-t-on en écrivant ici et que conviendrait-il d’y écrire ? Au-delà de la réflexion sur le phénomène blogue en lui-même, il importerait aussi de réfléchir sur le rapport entre l’écriture et le blogue. En d’autres termes, le fait d’avoir des lecteurs, de les sentir présents, conditionne-t-il le contenu et la manière d’écrire ?
Ce qui est amusant, c’est qu’alors que je me faisais ces réflexions et que j’en discutais même en privé, via la messagerie, avec une connaissance, voilà que Bertrand Redonnet, de son côté, nous propose justement sur son site un billet qui traite de ce thème. Je vous invite à le lire car il reprend exactement, en les développant subtilement, les réflexions que j’étais en train de me faire.
L’avantage, en tenant un blogue, c’est qu’on s’oblige à écrire car on sent inconsciemment que si on ne l’alimente pas régulièrement, il sera bientôt déserté par le public habituel, qui trouvera ailleurs une nourriture plus abondante. Et écrirais-je aussi ponctuellement si je n’avais pas l’opportunité de le faire ici ? Probablement pas, les occupations et les soucis de la vie quotidienne étant souvent un frein au travail d’écriture, lequel demande disponibilité et sérénité. Mais d’un autre côté, il ne faudrait pas que le public devienne un tyran qui conditionnerait mon acte d’écriture, soit en m’imposant indirectement un rythme à tenir, soit même en influençant la nature des billets présentés. J’ai su, il me semble, me préserver jusqu’à présent de ce travers.
Maintenant, le fait de pouvoir être lu est assurément un avantage dont on finirait par oublier qu’il constitue un privilège. Pour autant qu’on ne laisse pas au public le choix des thèmes traités mais qu’on continue à écouter sa petite musique intérieure, tout est parfait.
Le problème, c’est plutôt le temps. Or le temps, quand on est dans la vie active, est le bien le plus rare et le plus précieux. Et il n’y a pas que les articles à rédiger et les commentaires à surveiller, il y a aussi tous les autres sites à aller lire. Ce serait un peu égoïste de se réjouir de la présence des lecteurs et de ne pas leur rendre leur politesse en allant lire leur propre site s’ils en ont un. Des liens se créent souvent ainsi, par affinité et c’est très intéressant.
.
C’est intéressant sauf que quelquefois on a un peu l’impression d’être sur la place publique. On écrit à la craie sur un trottoir devant les badauds médusés, au milieu d’un brouhaha indescriptible, celui de la foule et de ses bavardages. Alors il y a inévitablement des jours où on se retrouve fatigué de tout ce vacarme, ce qui fait qu’on aspire à un peu de silence. Ces jours-là, la petite voix intérieure ne parvient plus à trouver son chemin dans la cacophonie générale. L’intelligence ne commande-t-elle pas une position de retrait qui n’est pas seulement protectrice mais aussi désir de se retrouver avec soi-même dans le silence ?
Quel est l’intérêt, finalement, d’écrire par exemple sur les livres qu’on a lus ? N’est-ce pas aussi participer au grand bavardage ambiant ? Certes, cela oblige à un esprit de synthèse et même, en écrivant ainsi un article, on approfondit le sujet traité et on découvre soi-même des choses qu’on n’avait pas vues, mais bon, au-delà de cela, quel avantage y trouve-t-on vraiment ? Est-ce un vain étalage de culture, un désir de partager ses connaissances ou une tentative de communiquer avec autrui ? Un peu des trois sans doute, mais n’est-ce pas là une démarche vaine ? N’est-ce pas contribuer à son tour au grand bavardage ambiant que je dénonçais plus haut ?
Ne ferait-on pas mieux, plutôt que de s’égarer dans cette voie, de se concentrer sur sa propre écriture, la vraie ? Car dans ces quatre cents articles, combien de textes littéraires, en fait ? Bien peu, vraiment bien peu. Déjà j’avais renoncé par le passé à toute une série d’articles disons d’actualité et je m’étais alors concentré sur des sujets plus littéraires. Mais parler de la littérature, ce n’est pas encore écrire (encore faudrait-il qu’on en soit capable, mais cela c’est une autre question dont nous ne débattrons pas ici).
Bien entendu, pour celui qui écrit et qui est publié (ce qu’on appelle donc classiquement un écrivain), le blogue devient une vitrine. Pour peu qu’il ne lui consacre pas trop de temps, c’est pour lui un moyen habile de faire connaître sa production et même, pourquoi pas, de lever pour le public un coin du voile sur l’art de la création, en proposant de temps à autre un extrait en cours de rédaction.
Vu l’évolution des techniques, il est clair qu’un homme de lettre se doit, de nos jours, de tenir un site ou un blogue, simplement pour favoriser sa visibilité dans cette jungle commerciale qu’est devenu le monde de l’édition.
Mais nous, hommes ordinaires qui n’avons rien écrit, pourquoi perdre notre temps à nous donner l’illusion d’avoir un public avant même que d’avoir écrit quoi que ce soit ? C’est un peu mettre la charrue avant les bœufs, non ? Ecrire suppose le recueillement et la solitude. On n’écrit pas dans l’immédiateté. Je ne pense pas, en disant cela, à l’inévitable travail de correction qui chez moi est souvent fort limité (preuve qu’il y a des choses à améliorer dans mon travail d’écriture lui-même) mais plutôt au recul nécessaire à toute activité de création. Avant de prendre la plume, il faut cerner son sujet, l’apprivoiser, ce qui peut demander quelques jours. Puis il faut laisser faire l’imagination, qui va, dans votre tête, échafauder un semblant d’histoire. Ce n’est qu’alors qu’on prend sa plume ou qu’on s’installe devant son ordinateur. Les mots alors viennent en principe relativement aisément, mais c’est parce qu’ils sont le fruit de tout ce qui précède.
Or, cette démarche qui prend du temps, ne trouve pas dans le blogue le terrain qui lui convient. Ici, tout doit aller vite et on finirait par préférer de simples billets sur des sujets divers, relativement faciles à rédiger, plutôt que de se pencher sur un réel travail de création.
En conclusion, j’ai bien peur que je n’aie fait que contribuer à amplifier la rumeur ambiante d’Internet par mes différentes notes. J’aspire à un peu de silence, de discrétion, de recueillement. Je reviens donc à l’idée que j’ai déjà exprimée autrefois ( à savoir laisser de côté tous les thèmes d’actualité et se concentrer exclusivement sur les sujets littéraires) mais pour la radicaliser. Autrement dit, ne plus déposer ici que des textes personnels, soit de fiction, soit de poésie, soit encore des considérations personnelles ou philosophiques, voire des souvenirs ou des rêveries, un peu comme on le ferait dans un journal intime (se posera alors le problème du rapport entre la sphère privée et la sphère publique, mais s’il s’agit de textes littéraires, ce qui est trop personnel sera de toute façon transformé par le processus de création et sera donc devenu complètement méconnaissable. En plus personne ne connaît ma vie, donc personne ne parviendra à distinguer ce qui est réel et ce qui est inventé)
Cela n’empêche pas de traiter de sujets existentiels ou même de réfléchir sur des phénomènes de société, mais plutôt que de le faire de manière disons intellectuelle, en développant point par point un raisonnement, on pourrait imaginer que cette réflexion s’inscrive dans un texte de fiction ou prenne la forme d’un journal personnel, ce qui, dans les deux cas, supposerait une approche plus littéraire.
Pour me résumer et exprimer tout cela plus simplement, je dirai que la tenue de ce blogue m’a apporté beaucoup, mais qu’il me semble maintenant que cela constitue une entrave à la rédaction de textes plus littéraires, que je n’ai que trop négligés (essentiellement par manque de temps).
L’avenir nous dira si je parviens à me tenir à ces nouvelles règles.
23:06 Publié dans Blogue | Lien permanent | Commentaires (26) | Tags : blogue, internet
16/06/2009
Patrick Chamoiseau
On se dit que le roman français qui s'était un peu assoupi pendant quelques décennies pourrait peut-être retrouver une certaine vigueur dans le cadre plus large de la francophonie. Ainsi il est indéniable que les départements d'Outre-mer possèdent leur propre spécificité, spécificité qui cherche à s'exprimer dans une langue pour le moins originale. Je termine le livre de Chamoiseau, « Autan d'enfance » (qui est le tome I d'une « Enfance créole ») et il me semble y trouver plusieurs éléments intéressants.
Certes, il s'agit finalement d'une autobiographie et on me dira qu'il n'y a rien de plus narcissique, justement, qu'une autobiographie. Bien sûr, mais au-delà des souvenirs personnels, l'auteur nous fait découvrir tout un monde haut en couleur, celui de la vie quotidienne à Fort-de-France, ce qui pour nous, qui habitons le vieux continent, comporte tout de même pas mal d'éléments exotiques assez dépaysants. Donc, de même que l'Europe a pu s'extasier devant les romans Sud américains (Garcia Marquez, etc.) en grande partie à cause de leur touche exotique et de leur part d'étrangeté, de même ici nous découvrons des réalités qui ne nous sont pas forcément familières, ce qui nous oblige, précisément, à sortir de notre coquille et de notre ronron quotidien.
A côté de cela, Chamoiseau raconte la pauvreté et la débrouillardise de sa mère pour parvenir à élever sa famille, ce qui peut aussi renvoyer beaucoup d'entre nous à leur propre enfance. Je veux dire par-là que la réalité qu'il décrit nous est aussi très familière, en dehors de son caractère exotique et antillais et que c'est donc un discours très humain qu'il nous tient en fait. Par-là, il nous touche directement, car il sait sortir de la relation de sa propre enfance pour généraliser son propos et décrire l'âme humaine.
Quoi de plus émouvant, en effet, que de découvrir le monde par les yeux de cet enfant qui est le narrateur. Son regard innocent, parfois naïf, mais toujours intelligent, nous charme. Quant au portrait qu'il dresse de sa mère, cette maîtresse femme qui ne possédait rien mais qui par son bagout et sa ténacité parvenait toujours à ce que sa famille ne manque de rien, il restera gravé dans la mémoire du lecteur une fois qu'il aura refermé le livre.
Pas de réflexions philosophiques profondes ici, par d'interrogations sur la nécessité d'écrire ou le but de l'existence, mais une description de la vie des gens simples, qui tentent simplement de survivre et de s'en sortir.
Donc, en résumé, on trouve chez Chamoiseau un côté exotique et dépaysant mais aussi une peinture de l'universel humain. A cela il faut ajouter tous les mots créoles dont il parsème son ouvrage, juste assez pour nous faire sentir une réalité autre, mais tout en sachant rester modéré, afin de ne pas entraver la bonne compréhension du discours. Et à côté de cela, il y a sa manière imagée de s'exprimer, cette petite touche qui fait qu'on sait qu'on a à faire à un écrivain (et pas à un écrivant ?)
« Le dimanche après-midi, Fort-de-France devenait un silence. On ne voyait passer qu'un vent marin, dénoncé par les poussières, et les miettes de la vie. »
Ce silence du dimanche après-midi, lorsque toute activité est interrompue, est rendu en deux petites phrases, avec notamment ce vent qui « passe », invisible et à peine dénoncé par les poussières qu'il transporte (ce qui renvoie à la pauvreté et à la saleté ambiante, à la chaleur et à la sécheresse aussi). Quant aux « miettes de vie » elles rappellent que les hommes sont bien là, ancrés dans ce paysage, même si on ne les voit pas et que leur existence s'écoule irrémédiablement, avec ses petits bonheurs et ses grands malheurs.
Ou bien, on trouve des phrases comme la suivante :
« La messe du soir aimantait l'existant. Des négresses à chapelets, porteuses d'âges sous des voiles noirs et des bijoux d'or massif, clopinaient sur le trottoir en une lente transhumance. »
Au calme de l'après-midi, succède donc la messe du soir, qui vient redonner un peu d'animation à la ville assoupie dans la chaleur de l'été des tropiques. On notera le terme « l'existant » qui est pour le moins inhabituel. Quant à ces négresses (mot que Chamoiseau peut employer en tant que mulâtre, ce qui est pour lui une manière de revendiquer une sorte de négritude à la Senghor), leur description est assurément comique. Les mots « négresses à chapelets » les figent dans leur rôle religieux, les désignant déjà comme bigotes respectueuses des règles extérieures de la religion, s'enfermant dans des litanies de prières aussi stériles que ridicules. « Porteuses d'âges » (notez le pluriel, qui renvoie les négresses dans une éternelle vieillesse), elles sont forcément veuves. Mais l'auteur juxtapose les « voiles noirs » et les « bijoux d'or », dans une sorte d'oxymore redoutable qui finalement nie l'authenticité de leur veuvage. Certes, elles portent un deuil éternel, mais en même temps elles s'affichent avec des bijoux luxueux et voyants, ce qui ne cadre pas avec leur condition première. Et ne parlons pas de l'adjectif « massif », qui insiste sur le prix exorbitant de ces bijoux (ce qui est contradictoire avec le statut de veuves pieuses qu'elles veulent se donner), et en même temps constitue une touche ironique à l'encontre de leur désir de paraître et de se faire voir. Le fait qu'elles « clopinent » n'est certes pas valorisant à leur égard, mais le mot « lente transhumance » l'est encore moins. Assimilées à des brebis idiotes qu'en emmène où on veut, elles semblent réduites à un troupeau stupide, mot qui donne à son tour une idée sur leur nombre qui doit être important. Voilà donc comment en deux petites phrases on peut faire passer toute une réalité sociale et présenter avec humour ce qui est en fait une critique virulente.
Rien que pour des phrases comme celles-là, le livre de Chamoiseau vaut le détour et comme je le disais au début, il se pourrait bien que ces territoires d'Outre-mer aient quelque chose à nous apporter en littérature. Un peu de sang neuf ne ferait pas de tort, non ?

00:54 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : littérature, patrick chamoiseau, fort-de-france
14/06/2009
Pierre Leroux (4 et fin)
Discours de Pierre Leroux devant l'Assemblée nationale constituante le 30 août 1848. Où l'on verra que ce discours, sur le fond, pourrait être tenu de nos jours. Où l'on se dira cependant qu'il n'y a plus personne pour oser parler de la sorte.
"Citoyens représentants [...] vous êtes ici de par les besoins de l'humanité, de par la volonté du peuple, pour garantir à tous la liberté, non pas la liberté tendant à l'anarchie et au néant, mais la liberté tendant à la reconstitution de l'humanité, à l'association. De là il suit que votre devoir, ainsi déterminé, est en même temps nettement tracé. D'un côté, défendre et protéger la vieille société en faisant des lois qui, sans blesser la liberté, aussi nécessaire à elle qu'à la société nouvelle qui aspire à sortir de son sein, l'empêchent pourtant d'arriver à cet excès de mal et de souffrance au-delà duquel il n'y a plus que ce dernier combat de la mort qu'on appelle l'agonie. De l'autre, par ces lois mêmes, préparer avec un esprit de tolérance ou plutôt d'amour, semblable à cet amour paternel qui s'étend de nous sur nos descendants, l'avènement de la société nouvelle, de la société où seront véritablement réalisés les augustes termes de l'immortelle devise de nos pères : Liberté, fraternité, égalité. Voilà notre devoir, à nous tous élus du peuple, après dix-huit siècles et demi de christianisme, après la révolution de 1789, après celle de 1830, après celle de 1848. Il ne s'agit donc pas de faire intervenir l'État dans les relations sociales ; mais entre l'intervention de l'État dans les relations sociales et la négation de toute médiation et de tout droit tutélaire de sa part, il y a un vaste champ où l'État peut marcher et doit marcher, sans quoi il n'y a plus d'État, il n'y a plus de société collective et nous retombons dans le chaos. L'État doit intervenir pour protéger ce qu'on appelle la liberté des contrats, la liberté des transactions ; mais il doit intervenir aussi pour empêcher le despotisme et la licence, qui, sous prétexte de liberté des contrats, détruirait toute liberté et la société tout entière. [...]
Si, en essence, l'État ne peut pas être autre chose qu'un juge du camp et un gendarme, il faut au moins qu'il soit un juge du camp équitable et un gendarme intelligent (Rires.)
(...)
La seule question que l'on puisse faire, c'est de demander si l'État a le devoir et le droit de veiller sur la santé des travailleurs et d'empêcher que l'on porte atteinte en leur personne à la dignité humaine. Je réponds à cela que l'État a assurément ce droit, et que même les lois, en général, n'ont pas d'autre but que de veiller sur la conservation de la vie des hommes et d'empêcher que l'on porte atteinte à leur dignité d'hommes. La liberté de faire le mal, en effet, n'est pas liberté, mais crime et licence ; et comme le mal que nous faisons à nos semblables se résume toujours dans une atteinte portée directement ou indirectement à leur existence, il s'ensuit que l'État n'est véritablement institué que pour veiller sur la conservation de la vie des citoyens.
(...)
Forcer des hommes à travailler quatorze heures par jour est un délit, un crime ; c'est un homicide. Il est évident que la nature humaine, ne peut, sans se détériorer, sans s'abrutir, et sans se détruire rapidement, endurer quatorze heures d'un travail malsain dans un air souvent vicié. Ignore-t-on que les probabilités de vie, qui sont pour les enfants du riche de vingt-neuf ans environ, au moment de la naissance, ne sont que de deux ans pour les enfants de l'industrie cotonnière ? Mais, l'homicide étant constaté, où sont les délinquants, demandent les adversaires du décret. Je réponds : ils sont partout où des hommes prêtent assistance au délit. Partout où des chefs d'industrie encouragent ou tolèrent un travail évidemment homicide, il y a des délinquants.
(...)
Et vous auriez le droit de livrer des hommes à un travail mortel sans aucune intervention de l'État, abusant ainsi de l'ignorance et du malheur des hommes ! Non, mille fois non, à moins que vous ne fassiez déclarer par cette Assemblée, nommée par le peuple tout entier, et chargée de ses destinées et de son bonheur, que les travailleurs dont il s'agit ne sont pas des hommes, ou du moins ne sont pas des citoyens, qu'ils sont encore exclus de la cité et que l'État abdique à leur égard son droit tutélaire. (Très bien !)
(...)
La loi actuelle de la production est telle, qu'un certain nombre de capitalistes actifs jouissent d'un moyen assuré d'attirer à eux toute la fortune publique ; d'où résulte en même temps la baisse continuelle des salaires pour la multitude des travailleurs, condamnés à vivre du moindre salaire possible, et à mourir lorsque ce salaire vient à leur manquer. Citoyens, vous le voyez, la cause que je défends, la cause des pauvres ouvriers, est la cause de tous ; elle est la vôtre, propriétaires fonciers qui empruntez de l'argent à gros intérêts, tandis que vos domaines cultivés si péniblement par vos métayers et vos fermiers, vous rendent si peu ; elle est la vôtre aussi, chefs d'industrie et négociants, qui voyez continuellement la faillite planer sur vos têtes.
Moniteur Universel,
n° 244 du 31 août 1848, pages 2232-2236.
Source : Assemblée nationale

00:57 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, pierre leroux
12/06/2009
Pierre Leroux (3)
En 1843, Leroux crée une imprimerie à Boussac, dans la Creuse. Il n'est pas très éloigné de son amie Georges Sand, qui elle vit principalement à Nohant, dans l'Indre (entre Châteauroux et La Châtre). Leroux fait d'abord venir sa famille (notamment son frère) et quelques proches. Il veut instaurer un phalanstère sur le modèle conçu par Fourier. Le phalanstère idéal est une sorte d'hôtel coopératif situé au milieu de 400 hectares de terrain agricole et où vivraient plus ou moins deux mille personnes. Il comporterait des couloirs chauffés et de grands réfectoires. Le but est de faire vivre et de faire travailler les hommes en communauté, un peu sur le modèle qui sera réalisé dans les kibboutz.
Le projet de Leroux est plus modeste et se développe, lui, autour d'une imprimerie (ce qui lui permet par ailleurs de publier ses écrits et de les répandre, notamment via les revues L'Eclaireur et La Revue sociale ). Petit à petit, des disciples séduits par ses idées vont venir se joindre à la communauté initiale, qui comportera en tout plus ou moins 80 personnes. Devenu franc-maçon, Leroux essaie de trouver de nouveaux adeptes. Comme il s'agit d'auto financer son institution, on dit qu'il recrute surtout ceux qui ont de la fortune. On sait par ailleurs que Georges Sand l'aida beaucoup financièrement et qu'à la fin elle fut lassée de le voir toujours tenter de soutirer de l'argent à ses amis aisés. Certains verront Leroux comme un idéaliste qui tente désespérément de réaliser ses idées par tous les moyens. D'autres diront au contraire que c'est un opportuniste qui ne pense qu'à quémander de l'argent pour des projets farfelus. Question de point de vue, évidemment, qui ouvre cependant un vaste débat. Quelle perception avons-nous des grands hommes du passé ? Nous ne les connaissons que par leurs écrits ou par les témoignages de leurs contemporains. L'Histoire officielle, souvent, s'est emparée de leur légende, les glorifiant sans cesse et déformant finalement leur vraie personnalité. Il nous aurait fallu les connaître personnellement pour nous faire une idée, mais là aussi notre point de vue n'aurait pu être que subjectif. Difficile donc, d'atteindre la « vérité » des êtres, surtout s'ils appartiennent au passé.
00:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, pierre leroux
11/06/2009
Pierre Leroux (2)
Puisque nous parlions de Pierre Leroux (1797- 1871), voici quelques citations de ce philosophe qui semble injustement méconnu. Même s'il est un peu utopique dans ses désirs les plus fous (notamment en rêvant d'une justice sociale), la passion qui l'anime mérite le respect, d'autant plus qu'elle ne vise jamais ses intérêts personnels, mais la collectivité tout entière.
Si ses contemporains l'avaient un peu plus écouté, le système capitaliste tel que nous le connaissons aujourd'hui (avec ses crises financières à répétition, son désir de production aveugle, son mépris des classes laborieuses qu'on licencie pour des raisons douteuses) n'existerait peut-être pas. Pas plus que n'aurait existé la dictature stalinienne de sinistre mémoire, laquelle a clairement corrompu l'idée généreuse initiale du communisme.
Vivre, ce n'est pas seulement changer, c'est continuer
La vie est une aspiration vers l'avenir
Les vrais poètes sont toujours prophètes
L'homme ne supportera donc jamais deux vérités à la fois ?
Serai-je sur a terre quand la justice et l'égalité régneront parmi les hommes ?
L'art, c'est l'artiste. L'artiste, c'est Dieu
Vous voulez vous aimer. Aimez-vous donc dans les autres car votre vie est dans les autres et sans les autres votre vie n'est rien.
Mais que faire de cette force permanente en nous, de cette force qui aspire et qui aspire toujours ?

00:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, pierre leroux
08/06/2009
Pierre Leroux
Je termine le livre que Bruno Viard, professeur de littérature à l’Université d’Aix en Provence, a consacré à Pierre Leroux. (« Pierre Leroux, penseur de l’humanité", éditions Sulliver, février 2009).
Leroux est un penseur et un philosophe du XIX° siècle qui aura eu l’originalité de percevoir avant tout le monde le danger des systèmes de pensée. Adepte dans un premier temps du libéralisme, il aura vite compris comment cette doctrine, qui voulait faire progresser la société en développant les initiatives personnelles et en réduisant le rôle de l’Etat, pouvait déboucher sur un égoïsme effréné et ne viser qu’à l’enrichissement personnel. Après avoir fréquenté un temps St Simon, il s’en écarte quand il pressent que pour imposer la fraternité, il faut réduite la liberté. En d’autres mots il devine qu’un régime socialiste fort sera par définition obligé de lutter contre l’individualisme, ce qui l’amènera à limiter la liberté individuelle au profit d’une fraternité collective imposée. En bon dialecticien, il tentera donc une synthèse de ces deux courants de pensée que sont le capitalisme et le socialisme et cela avant même que chacune de ces doctrine ne fasse les ravages que l’on connaît (crise de 1929, dictature stalinienne).
Toute la vie de Pierre Leroux est dans cette synthèse. C’est lui qui a créé le mot « socialisme» et lui encore qui a œuvré pour imposer la devise "Liberté, égalité, fraternité". On peut dire qu’il a pressenti avant d’autres les grands dangers des deux courants de pensée politiques qui sont les nôtres depuis 1789. Il est assez rare de rencontrer un penseur qui ne s’enferme pas dans un système de réflexion mais qui au contraire ose un regard critique sur ses propres conceptions. C’est à son refus des idéologies préétablies que Pierre Leroux doit manifestement sa capacité à percevoir les limites des mouvements de pensée auxquels il adhère. Saluons un homme qui à chaque étape de sa vie a su se remettre en question et qui a toujours tenu compte de son expérience antérieure pour tenter une nouvelle synthèse. Saluons ce penseur qui a consacré son existence à réfléchir à la meilleure manière d’organiser la société des hommes.

10:02 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, philosophie, pierre leroux, editions sulliver
04/06/2009
Elections européennes (suite)
J'apprends que Le Mouvement Républicain et Citoyen de Jean-Pierre Chevènement ne prend pas part à la campagne des élections européennes et qu'il préconise au contraire un vote blanc ou nul.
On me dira que ce n'est pas étonnant, de la part d'un petit parti qui n'a pas grand chose à espérer de ce scrutin. C'est vrai, bien entendu, mais je retiens tout de même que dans sa déclaration il reprend un peu ce que j'ai dit de mon côté dans la note précédente :
" Cette élection à un Parlement-fantôme est un trompe l'œil. Dans cette enceinte où 770 soi-disant députés inconnus de leurs électeurs peuvent s'exprimer trois minutes chacun, en usant de l'une des vingt-deux langues officielles reconnues, aucune volonté générale ne peut bien évidemment s'exprimer.
M. Sarkozy, à Nîmes, a parlé de politique de change volontariste, de protection communautaire et de politique industrielle commune, mais il sait très bien que le texte du traité de Lisbonne qu'il a fait adopter, l'en empêchera. La même schizophrénie - pour ne pas dire hypocrisie - frappe le Parti socialiste qui a approuvé lui aussi le traité de Lisbonne. D'ores et déjà MM. Brown et Zapatero ont fait savoir que les députés travaillistes anglais et ceux du PSOE espagnol soutiendraient le candidat libéral à la présidence de la Commission européenne, M. José Manuel Barroso. Cette élection est vide de contenu.
(...)
Le Mouvement républicain et citoyen appelle au vote blanc ou nul de préférence à l'abstention : le peuple français, en effet, ne doit pas laisser bafouer la volonté qu'il a démocratiquement exprimée le 29 mai 2005. »
Et c'est vrai que lorsque tous les partis, de gauche comme de droite, suivent finalement la même politique et acceptent sans broncher les décisions d'une Commission européenne qui est non seulement influencée mais même carrément dirigée par la haute finance et le grand capital, on peut se poser des questions sur le sens du mot démocratie. Pris en otages, les citoyens, par leur vote, ne font que participer à l'enlisement général. Ne pas voter, c'est s'abstenir de donner son avis. Voter blanc, c'est au moins montrer qu'on n'est pas d'accord, même si cela ne change rien au résultat final du scrutin, puisque les postes seront répartis entre les partis selon le souhait exprimé par ceux qui auront voté, même s'ils ne sont que quelques-uns.
Ce vote est donc complètement faussé puisque l'électeur n'a pas une vision d'ensemble sur le parti auquel il va donner sa voix. Imaginons un citoyen français qui vote socialiste, par exemple, il ne pourra pas se faire une idée générale de la politique qui sera menée par l'ensemble des socialistes européens. Il n'a, lui, pour justifier son choix, que le programme du PS français. Rien ne dit que le PS espagnol ou le PS danois ont la même vison des problèmes que le PS français. C'est même d'autant moins probable que chaque parti, quelle que soit finalement sa couleur, a tendance à réagir en fonction des problèmes spécifiques du pays qu'il représente. Inversement, s'il y a une ligne directrice de tous les PS des vingt-sept états membres, on aimerait bien la connaître car cela n'apparaît absolument pas dans les programmes exposés lors de la campagne. Et même si c'était le cas, ce qui serait quand même plus logique, on tomberait alors dans une autre ineptie, à savoir que les décisions et les lignes de conduite d'un parti seraient prises lors de gigantesques assemblées internationales et donc que les partis nationaux seraient parfois amenés à devoir voter des mesures contre l'intérêt même des électeurs qu'ils représentent sur le plan national. Si la production d'huile d'olive concerne certainement les électeurs grecs, il n'est pas certain que cet aspect des choses serait envisagé par un congrès international socialiste qui se tiendrait par exemple à Berlin et où donneraient leur avis des politiciens danois, finlandais et lituaniens.
Tout cela pour dire que l'Union européenne devient un énorme mammouth ingouvernable, ce qui ne serait pas encore trop grave en soi si les états membres n'avaient pas entre temps perdu une grande partie de leurs prérogatives. Nous nous retrouvons donc devoir confier la direction d'un bateau à un équipage dont on sait déjà qu'il s'acquittera mal de sa tâche. C'est d'autant plus inquiétant quand on sait que le bateau en question effectue une traversée qui va contre nos intérêts de citoyens ordinaires.
18:37 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : elections européennes
02/06/2009
De l'élection européenne
Laissons pour une fois de côté la littérature pour nous pencher sur l'utilité ou l'inutilité de l'élection européenne du 07.06.09. Voilà une question qui mérite en effet d'être posée.
Nous vivons, nous dit-on, en démocratie. Nous devrions en être fiers. Pourquoi, dès lors, le taux d'abstention à l'élection européenne est-il passé de 37% à 54% ces dernières années ? Il y a à cela pas mal d'explications.
Tout d'abord, dans chaque pays, on retrouve comme candidats des politiciens bien connus qui ont souvent déjà fait preuve de leur incompétence ou qui en tout cas ont fini par lasser.
Ensuite, le résultat de ces élections est connu à l'avance puisque le citoyen moyen a peu de chance de voir sa vie quotidienne s'améliorer d'une manière ou d'une autre suite à son vote. Quand il s'agit d'un scrutin local (communal) ou national, les enjeux sont plus directs et l'électeur veut bien se déplacer pour que sa tendance politique soit représentée (ou pour que la tendance qu'il déteste ne le soit pas, comme on a pu le voir lors de l'élection présidentielle qui, au second tour, opposait Chirac et Le Penn). Mais ici, vu la grandeur du territoire occupé par l'Union, il est clair que les quelques députés que chaque pays va élire vont être noyés dans la masse. Dès lors, la voix d'un citoyen ne représente quasi-rien et il préfère donc s'abstenir. Ceci est encore plus vrai si le pays est petit (Lituanie, Slovénie, Luxembourg).
De toute façon, qu'on vote à droite ou à gauche, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, il semble bien que rien ne change dans la politique de l'Union, laquelle poursuit la même ligne de conduite depuis ses origines : favoriser les échanges commerciaux et donc permettre à quelques-uns de s'enrichir plus facilement. L'Europe sociale ou l'Europe des citoyens, c'est toujours pour demain. Tout le monde la souhaite mais on ne la voit pas arriver. En attendant, chaque état a perdu une grande partie de ses compétences au profit de l'Union. Ce que le citoyen moyen retient c'est que l'entreprise dans laquelle il travaille peut maintenant faire venir légalement de la main d'œuvre polonaise (par exemple) et même la payer au prix qu'on paie en Pologne les travailleurs polonais (comme un récent arrêt de la Cour de Justice de Luxembourg vient de l'établir). Pour le travailleur français qui recherche un emploi, cela signifie qu'il va bientôt devoir accepter un emploi moins bien rémunéré, sinon on lui préférera un autre travailleur de l'Union. Quand les syndicats se mettent en grève contre ce genre de pratique comme cela a été le cas récemment en Angleterre, on leur reproche une attitude raciste, ce qui fragilise déjà beaucoup le bien fondé de leurs revendications. Le procédé est habile. Ce sont donc maintenant les petits qui se disputent entre eux, pour le plus grand plaisir du patronat qui lui, magnanime et pas raciste pour un sou, n'hésite pas à embaucher de la main d'œuvre roumaine ou bulgare, surtout si elle coûte moins cher. Il est même tellement magnanime, ce patronat, qu'il est même prêt à délocaliser une partie de ses centres de production vers ces pays pauvres dans le seul but de relancer leur économie moribonde, mise à mal par cinquante années de régime communiste. On reste confondu devant autant de philanthropie.
Une autre cause du désintérêt du citoyen pour cette Europe qui se construit sans son accord (et même malgré son désaccord puisque personne n'a tenu compte des « non » français, hollandais et irlandais au projet de constitution néo-libéral qui nous propose les échanges commerciaux comme principe idéologique et comme seule valeur de la personne humaine) c'est que du point de vue politique l'élection se fait sur le plan national. Je veux dire par-là qu'il n'existe pas par exemple un parti socialiste européen (mais on aurait bien peur de voir naître un jour un tel mammouth). Les socialistes français votent pour des socialistes français et les Espagnols ou les Allemands font la même chose. Entre eux, aucun accord. Ils n'est même pas sûr qu'ils envisagent de suivre la même politique. Autrement dit, nous sommes en présence de vingt-sept petits scrutins nationaux avec des enjeux internes et aucun parti ne propose une vue d'ensemble sur ce que devrait être l'Europe.
Il serait grand temps pourtant de voir les syndicats défendre nos intérêts sur le plan européen. Aujourd'hui, se mettre en grève quand on licencie du personnel en France (parce que des managers ont hypothéqué la survie d'une entreprise en jouant en bourse ou parce qu'ils ont voulu racheter un concurrent alors qu'ils n'en avaient pas les moyens) est suicidaire car on prend prétexte de ce mécontentement social pour tout fermer et délocaliser sous d'autres cieux. Il faudrait donc que la défense des travailleurs se fasse sur le plan européen, ce qui est loin d'être le cas. C'est pourtant bien ce qui se passe pour le patronat, puisque les frontières sont ouvertes à tous les mouvements de capitaux. Encore qu'il convienne de nuancer cette dernière affirmation. Tant qu'il s'agit de s'étendre, les firmes semblent avoir une vocation européenne bien ancrée, mais quand les choses tournent mal, on les voit se replier sur leur pays d'origine. Ainsi en va-t-il de ces firmes allemandes qui ferment d'abord leurs succursales françaises afin de préserver la maison mère allemande. On ne va pas le leur reprocher, Renault avait fait la même chose il y a quelques années en fermant d'abord son site de la banlieue de Bruxelles avant de restructurer en France même (mais tout en ayant déjà un regard pointé sur les anciens pays de l'Est).
L'Union est tellement grande qu'aucun citoyen ne sait ce qui se passe dans les pays voisins. Si un Français a une vague connaissance de la politique allemande ou espagnole, qui peut se targuer de connaître les enjeux en Slovénie ou en Bulgarie ? Personne, évidemment. Du coup, au lendemain du vote, on découvrira peut-être avec étonnement que ces pays ont pris une position qui va à l'encontre de celle que nous aurons prise nous, court-circuitant dès lors notre propre choix. Pourquoi, dès lors, se déplacer encore pour aller voter ?
A côté de cela, vous avez les calculs électoraux des partis, qui décident de parachuter tel candidat du Nord dans le Sud-Ouest ou le contraire (j'invente) afin d'attirer des voix. Ces politiciens-là sont certains d'être élus, ce qui fait que l'électeur a perdu en fait son pouvoir de sanctionner les erreurs commises dans le passé par ledit politicien.
De plus, pour couronner le tout, si le clivage gauche-droite a souvent un sens dans la vie politique nationale, il ne semble pas en aller de même à Strasbourg. A-t-on jamais entendu que des débats houleux s'étaient poursuivis plusieurs jours dans l'hémicycle des députés ? Non, car en fait ils semblent tous d'accord entre eux, même s'ils ne sont pas de la même tendance politique. Cette apathie bien réelle s'explique par le fait que le Parlement ne décide à peu près rien, contrairement à ce qu'on nous dit et que c'est la Commission qui tient les rênes du pouvoir. Dans cette Commission, où sont présents des observateurs des Etats-Unis et même d'Israël (grâce à l'intervention récente de MM Sarkozy et Kouchner), on règle surtout les grands problèmes économiques et on ne se penche pas vraiment sur les problèmes sociaux des citoyens. Faut-il s'étonner, dès lors, que ceux-ci marquent un tel désintérêt pour ces élections ? La solution, certains pays l'ont trouvée, comme la Belgique, qui rend le vote obligatoire (pour les élections communales, régionales, nationales ou européennes). Là, en quelque sorte, on est obligé d'être libre et de manifester son choix. Que voilà une manière habile d'avoir des citoyens motivés puisqu'on aura cent pour cent de participation ! Il est vrai que le siège de la Commission est à Bruxelles et que la petite Belgique ne pouvait pas faire moins.
19:30 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : election européenne
31/05/2009
Maurice Grevisse
L'autre jour, Solko avait consacré une note à Maurice Grevisse, le trouvant trop laxiste. Il n'a pas tort, mais j'ai envie de lui faire remarquer que les grammairiens font de la linguistique synchronique, ce qui signifie qu'ils donnent un état de la langue à un certain moment (en l'occurrence le français qui se parle de leur vivant). Ils sont donc « coincés » entre des règles et une tradition d'un côté et une langue qu'ils voient évoluer sous leurs yeux de l'autre.
Tant que ce n'est que le peuple qui commet une faute en ne respectant pas les règles, le grammairien peut sanctionner. Le problème de Grevisse, c'est qu'il s'est appuyé sur les « bons auteurs » pour trouver une légitimité à ce qu'il disait. Ceci traduit d'ailleurs une certaine admiration pour les écrivains et relève encore d'une conception proche de celle du XIX° siècle où on attendait encore de quelqu'un comme Hugo qu'il puisse, mieux que le commun des mortels, s'exprimer correctement.
Mais à partir du moment où Grevisse s'appuie sur le corpus littéraire pour légitimer ses règles grammaticales, il doit lire les auteurs qui lui sont contemporains. Forcément. Son but n'est pas de donner un aperçu de la langue de Molière mais de celle qu'on parle de son temps à lui. Et voilà qu'il découvre qu'une série non négligeable d'auteurs célèbres et reconnus font des fautes. Il ne peut donc que rappeler la règle première et constater que celle-ci perd de son autorité puisque même de « bons auteurs » ne la respectent plus ou ne la connaissent plus.
Quelque part donc, Grevisse tente encore d'imposer une règle ancienne tout en signalant qu'il ne faut plus trop se faire d'illusion et que la langue évoluant naturellement, il suffira d'une génération encore pour que cette règle apparaisse comme désuète.
Que devait-il faire ? Dans la note qu'il lui consacre, Solko lui jetait la pierre. Je le comprends quelque part. Mais d'un autre côté, je me dis que si Grevisse avait refusé cette ouverture vers une évolution inéluctable de la langue et s'était contenté d'affirmer des règles avec autorité, il aurait peut-être commis une faute, professionnellement parlant. En effet, en agissant de la sorte, il aurait fait comme si la langue ne devait plus évoluer. Or, malheureusement (ou heureusement), elle évolue.
On sent bien, quand on étudie un peu l'ancien et le moyen français, qu'une langue n'a pas toujours atteint son point d'équilibre. Alors que le latin classique permettait d'exprimer des idées complexes avec aisance, on remarque chez les écrivains de ces périodes intermédiaires une sorte de flou donc ils sont eux-mêmes conscients. Ils disent souvent qu'ils essaient d'exprimer au mieux ce qu'ils ont à dire avec la langue imparfaite dont ils disposent, langue qui n'est encore régie par aucune règle. C'est qu'il a fallu un certain temps pour passer des déclinaisons à six cas du latin (nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif) à une déclinaison à deux cas en ancien français (cas sujet et cas régime-complément) :
Singulier :
li murs (cas sujet), d'après murus, muri, le mur. On remarquera la chute de la voyelle
le mur (cas régime), d'après l'accusatif murum
Pluriel :
li mur (cas sujet), d'après muri
les murs (cas régime) d'après muros
C'est donc à partir du cas régime que le français s'est formé puisqu c'est là qu'on trouve la distinction entre le singulier sans « s » et le pluriel avec « s ».
Mais à peine un équilibre était-il trouvé avec l'utilisation de ces deux cas que la langue a continué d'évoluer naturellement vers plus de simplification encore pour arriver à ne plus posséder qu'un seul cas. Il fallut alors remédier à cette lacune par l'utilisation généralisée des prépositions (afin d'indiquer tout de même la fonction des noms : il parle « à » son ami, il vient « de » Paris, il va « à » Paris, etc.), ce qui demanda de nouveau un certain temps.
Il faut attendre le XVI° siècle pour que la langue trouve enfin son vrai souffle. Polie ensuite par les grammairiens du XVII° siècle (qui reprenaient, eux, l'usage de la Cour), elle atteint alors sa plénitude. Depuis, malheureusement, elle a quitté ce fragile point d'équilibre pour se simplifier. Les subjonctifs imparfait et plus que parfait sont complètement sortis du langage parlé, ainsi que le passé simple. On pourrait donner des dizaines d'exemples où ce qui se disait avec nuance s'exprime maintenant plus pauvrement. Je suis le premier à le regretter car il y a là une perte. Mais je me dis aussi que si mes ancêtres avaient raisonné comme moi, on parlerait encore latin.
Avec la mondialisation galopante que nous connaissons, il est à craindre que l'anglais ne devienne la seule langue véhiculaire (et il prendra ainsi la place qu'occupait le latin autrefois). Mais quel anglais ? Pas celui de Shakespeare, évidemment, mais un sabir commercial fort approximatif. Cela me fait de la peine. Et d'un autre côté je me dis que notre belle langue française est issue du bas latin de la fin de l'Empire, une langue de marchands et de soldats, d'immigrés et de barbares. Alors tous les espoirs me semblent permis. Sauf qu'il faudra de nouveau mille ou deux mille ans pour retrouver une belle langue classique toute en finesse. N'est-ce pas le temps qu'il a fallu pour passer de Cicéron à Corneille et Racine ? C'est sans doute pour cela que Solko en veut à Grevisse. Mais le pauvre homme pouvait-il faire autre chose que ce qu'il a fait ? Pouvait-il, à lui tout seul, arrêter l'évolution du monde ?

00:19 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : langue française, grevisse
28/05/2009
"Zozo, chômeur éperdu" de Bertrand Redonnet
C'est un conte drôle que nous offre Bertrand Redonnet avec son « Zozo, chômeur éperdu ». Drôle parce que tout est dit avec humour et même parfois avec une verve rabelaisienne. Son héros, « gros mangeur, grand buveur et paresseux par nature » comme dit l'éditeur en quatrième de couverture, est un chômeur professionnel. L'action se passe dans les années soixante, autrement dit à une époque où il allait de soi de trouver du travail. C'est donc bien par pur goût de l'oisiveté que Zozo se complait dans sa condition et qu'il met tout en œuvre pour que celle-ci perdure. Pourtant, derrière cet humour qui sous-tend tout le livre, on perçoit une contestation sociale et politique manifeste. Zozo vit comme bon lui semble, à contre-courant de ses contemporains, ce qui n'est peut-être pas aussi facile qu'on le croit et qui dénote finalement d'une certaine force de caractère. Et puis cette critique du monde du travail, par définition humiliant et aliénant, nous parle à tous, nous qui vivons en pleine ère de néo-libéralisme triomphant. Certes Zozo fait rire quand on le voit se battre avec les autorités pour tenter de refuser les emplois qu'on lui propose. Certes, c'est plus par maladresse que par intelligence qu'il parvient à ses fins (par exemple il se blesse en tombant d'un échafaudage et est donc dispensé de travail). Mais dans le fond, on finirait par l'envier et on voudrait l'accompagner quand il passe ses journées à flâner dans la campagne, son fusil sous le bras (il ne fait pas grand mal au gibier car il rate toujours sa cible). Cette vie n'est-elle pas plus agréable que celle que nous menons tous, soumis aux horaires et aux obligations de résultat imposées par l'OMC et la mondialisation de l'économie ?
Derrière la farce drôle se dessine donc une contestation manifeste et Bertrand Redonnet semble bien revendiquer le droit de l'individu à disposer de lui-même et de son emploi du temps.
Le style, quant à lui est truculent puisque les dialogues sont rapportés tels quels, en langage populaire :
« C'était le garde-champêtre qu'était venu. Le garde-champêtre ? Nom de dieu d'bon dieu, et qu'est-ce qu'il voulait de feignant, plus feignant encore que l'curé, à venir faire chier les autres avec son vélomoteur que c'était nous qu'on payait l'essence, les pneus et les réparations ? Hein, qu'est-ce qu'il voulait ce gros crétin ? »
Remarquons qu'il s'agit ici d'un discours indirect libre plutôt que d'un simple dialogue. Ce procédé est courant dans le livre et permet de raconter rapidement ce qui s'est dit sans couper le récit par des dialogues intempestifs, mais tout en conservant la verdeur du langage.
Les termes du patois local sont à l'honneur : « I m'auront la peau » pour « ils auront ma peau », « I sais pas » pour « je ne sais pas ». On rencontra aussi des mots inhabituels en français comme « lumas » (« fouiner dans toutes les vieilles murailles à la recherche de lumas ») ou « métive » (« les autres louaient la limpidité des cieux pour la métive, la fenaison ou l'arrachage des pommes de terre »). Je note qu'en dehors même des dialogues, des termes sont employés qui doivent eux aussi relever de la langue régionale, comme « carnassier » pour «carnassière ».
S'il n'aime ni le garde-champêtre ni le curé, Zozo, en marge de la société des hommes, ne manque pas d'ironie pour ridiculiser toutes les conventions. C'est ainsi que c'est toujours le deux novembre, jour des morts, qu'il tue son cochon pour en faire du boudin ou de la saucisse. Chasseur par vocation, il rate toujours sa cible, tant il semble incompétent en tout, sauf dans l'art de la flânerie. Ne lisant pas et sachant d'ailleurs à peine lire, il sera bien étonné le jour où son ancien instituteur lui offrira trois livres (Raboliot, La Dernière Harde et les Contes de la Bécasse). Ce seront les seuls qu'il possédera jamais dans sa vie, encore ne les parcourt-il qu'en hiver « car enfin on ne lit pas à moins d'être malade ou blessé ou quand il fait bon à courir les chemins ». Mais s'il ne lit pas, Zozo est un conteur né et il sait inventer des histoires truculentes à partir de ses expéditions de chasse manquées, en les déformant à son avantage bien entendu, comme celle de ce héron qu'il a tiré par inadvertance et qu'il finira par empailler et par surnommer De Gaulle.
Par son côté truculent, Zozo aurait pu figurer dans une chanson de Brassens et ce n'est pas étonnant que ce soit notre ami Bertrand qui l'ait inventé, lui qui justement consacra autrefois un livre à ce chanteur-poète (Brassens, poète érudit). Je retrouve aussi dans « Zozo » des caractéristiques déjà rencontrées dans Chez Bonclou et autres toponymes (édité chez Publie.net) comme par exemple les diverses interprétations données d'un même fait par différents protagonistes. Ainsi, pour tenter de comprendre le décès d'un menuisier qui s'est pendu, certains avancent l'hypothèse d'une infidélité conjugale, d'autres disent que le pauvre homme était endetté jusqu'au cou à cause de toutes les machines qu'il avait dû acheter (on retrouve ici la critique acerbe du monde du travail et du système capitaliste), d'autres encore affirment qu'il avait perdu la raison tellement il avait bu. Par cette manière de raconter les faits, l'auteur laisse au lecteur le soin de choisir la version qui lui convient, tout en décortiquant l'art de raconter, démontrant par-là que tout est possible à celui qui écrit un livre. Miroir braqué sur le monde, la littérature se donne comme le reflet de tout ce qui se dit dans les villes et les villages. Elle n'est qu'un amplificateur de l'immense brouhaha de la société des hommes.
On ne racontera pas ici la fin de l'histoire de Zozo, disons seulement qu'il est la victime de plus rusé que lui. Alors qu'il ne voulait qu'un peu de tranquillité, la fourberie des hommes le rattrape. Conte « sans morale apparente » disait l'éditeur. Pas sûr. Zozo est puni non pas de sa fainéantise mais de sa naïveté. C'est ce que je disais en commençant : derrière l'humour de ce livre, se dessine le drame de tout individu qui doit vivre au milieu de ses semblables.

16:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, "zozo, chômeur éperdu", bertrand redonnet











