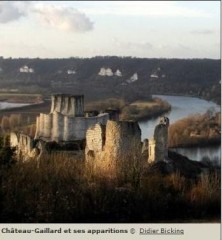21/03/2011
Nuit blanche
La nuit, parfois ils descendaient jusque dans le village, du moins c’est ce que l’on disait. Personne ne les voyait jamais, mais on les devinait, on sentait leur présence. On entendait ou on croyait entendre des grognements, des frôlements, et de temps en temps le bruit insolite d’un objet qui tombait dans l’obscurité. Personne n’osait sortir, évidemment. S’il n’y en avait eu qu’un, cela aurait pu aller, on se serait bien risqué à aller jeter un coup d’œil, quitte à rentrer précipitamment si cela tournait mal. Mais là, on ignorait tout de leur nombre. Combien étaient-ils ? Cinq, dix ? Douze peut-être ? C’était trop risqué. Alors, derrière les volets clos, on se contentait de tendre l’oreille. Le moindre feulement nous faisait sursauter, mais souvent ce n’était que le vent qui agitait les arbres, le grand vent de la nuit qui venait de la mer et qui chassait les nuages.
On finissait par retourner se coucher, mais le sommeil était lent à venir. On se tournait et retournait et tout le temps on les imaginait, là, dehors, occupés à faire Dieu sait quoi. On se demandait subitement si on avait bien fermé la porte de la remise du jardin. Il n’aurait plus manqué que d’en retrouver un là-dedans au petit matin ! Mais non, la porte était bien fermée, on s’en souvenait maintenant. Mais c’était pour penser aussitôt au potager. On revoyait les pommes de terre en fleurs ainsi que les courgettes, si fragiles encore avec leurs deux petites feuilles tendres qui sortaient timidement du sol. S’ils s’aventuraient de ce côté, ils allaient tout saccager et il n’allait rien rester. Il aurait fallu se lever, prendre le fusil et sortir. Et pour faire quoi ensuite ? C’est qu’on ne voyait rien là dehors. C’était le noir absolu et même si la lune dépassait le sommet des montagnes, ici, dans le fond, c’était l’obscurité totale. S’aventurer d’une dizaine de mètres, c’était courir le risque de se faire renverser par un de ces monstres. Car ils voyaient, eux, dans le noir. En tout cas cela ne les empêchait pas de se déplacer. Au moindre bruit, on aurait tiré, c’est sûr. Au hasard, comme cela, sans viser, avec le risque de toucher quelqu’un qui se serait aventuré sur le chemin, quelqu’un qui comme soi serait sorti avec son fusil tellement il en aurait eu assez de ruminer toute la nuit et de se demander ce qu’ils faisaient. C’était un risque qu’on ne pouvait pas prendre. C’est du moins ce qu’on se disait en se retournant encore une fois sur le vieux sommier qui grinçait, mais dans le fond on savait que ce n’était là qu’un beau prétexte. La vérité, c’est qu’on préférait encore rester là pendant des heures, à tendre l’oreille, plutôt que de se lever d’un bond, d’ouvrir la porte et d’en avoir le cœur net une fois pour toutes. La vérité c’est qu’on mourait de peur, au fond de nos lits, et que pour rien au monde on n’aurait voulu se retrouver parmi eux en plein cœur de la nuit.
Alors on se contentait d’écouter et d’écouter encore. Quand, pour la troisième fois, un objet tombait sur le sol, on savait que ce ne pouvait plus être le vent, même s’il soufflait maintenant en rafale. Alors, pour oublier, comme on était éveillé, on se mettait à penser à sa vie. On se revoyait enfant, là-bas, à l’autre bout du pays, dans la grande forêt qui n’avait ni commencement ni fin. Ou plus tard, adolescent, dans de grandes villes dont on avait presqu’oublié le nom. On se souvenait d’amphithéâtres, de salles de cours, de bibliothèques, et puis surtout d’une étudiante au sourire énigmatique, qu’on suivait de loin en loin, en contemplant sa démarche souple et en admirant le balancement de ses hanches. Puis on revoyait des guerres, des voyages, des mariages, des révoltes, des déménagements, des fuites en avant, des retours en arrière, bref tout ce qui fait habituellement la vie d’un homme. Tout cela pour se retrouver ici, dans l’obscurité d’une chambre, à les écouter aller et venir. Car c’était bien ce qu’ils faisaient, non ? Ils allaient où ils voulaient, eux, arpentant nos terres, foulant nos gazons, renversant nos outils. Parfois ils se frottaient à l’écorce des chênes lièges et pendant des jours on croyait percevoir leur odeur de bêtes sauvages, cette odeur d’animal non dompté, qui vit selon son bon vouloir. Alors, sans le dire vraiment et surtout sans jamais l’avouer, nous nous mettions à les admirer secrètement. Peut-être, finalement, aurions-nous voulu jouir de la même force et de la même liberté qu’eux ?
Mais pendant que nous réfléchissions ainsi, la nuit avançait. Déjà il était déjà six heures du matin et l’aube commençait à poindre à travers les fentes des volets. C’est le moment où nous finissions enfin par nous assoupir, exténués par toutes ces émotions.
Au matin, nous retrouvions le ciel tout dégagé et le soleil brillait sur les montagnes. Nous prenions le petit déjeuner sur la terrasse, admirant le paysage. Pendant que les premières cigales commençaient leur obsédant refrain, on sentait comme une odeur de thym sauvage qui venait des sommets. Alors l‘un d’entre nous se levait et allait inspecter le potager. Il se penchait vers la terre meuble et là, incrédule, il regardait les traces qu’ils avaient laissées. Des traces de pas, mais aussi comme des traces de lutte. Ils avaient tout retourné en cherchant des racines avec leur groin. C’est à peine si on voyait encore une dernière courgette et seule l’étendue de la surface ravagée et piétinée donnait une idée de leur nombre. Alors, tout en savourant un croissant, on se disait qu’on avait drôlement bien fait de ne pas sortir cette nuit et de faire semblant de dormir.

Photo personnelle
07:00 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (2)
16/03/2011
Au pays du soleil levant.

Photo de presse
Que dire encore après tout cela ? Quel sens pourrait bien avoir l’écriture devant de telles catastrophes ?
Se souvenir qu’on était tous méfiants devant cette technologie nucléaire, très méfiants. Comme devant toute technologie d’ailleurs.
J’avais dix-sept ans et j’étais au lycée. Dans les couloirs, après le cours, nous discutions avec le professeur de mathématique de la pertinence des centrales nucléaires. Nous étions jeunes, nous avions en nous le goût de l’opposition, nous avions également une fibre vaguement écologique (c’était l’époque du Larzac, du camp militaire qu’on devait construire là-bas, des Parisiens qui quittaient leurs bureaux pour aller élever des moutons sur le Causse). Lui, il nous vantait la puissance de la technique, l’indépendance énergétique enfin trouvée, ainsi que les possibilités immenses et infinies de l’atome. Nous, plus terre à terre, nous demandions : « Et s’il se produit un accident ? » « C’est impossible », répondait-il péremptoire. « Même s’il y a un accident, il y a tellement de moyens de sécurité qui sont mis en place, qu’il est impossible que quelque chose tourne mal. »
« Oui, mais si tous ces moyens de sécurité tombent en panne les uns après les autres ? » argumentions-nous, plus pour le plaisir de la discussion d’ailleurs que par conviction, car nous nous rendions bien compte que ce que nous disions là n’avait pas beaucoup de sens. Alors le vieux professeur, qui ressemblait un peu à Einstein, nous donnait sa réponse et cette réponse, nous la connaissions à l’avance. Il était impossible, statistiquement parlant, que dix moyens de prévention tombent en panne en cascade.
« Et en cas de tremblement de terre ? » avais-je demandé. « Impossible qu’il y ait des dégâts, les constructions sont faites pour résister à tout ». « Et si on bombarde la centrale en cas de guerre ? », avait demandé un autre élève, plus pessimiste encore que moi. « Alors, si c’est la guerre, il y aura déjà tellement de morts que ce n’est pas une petite catastrophe de plus qui va changer grand-chose » lui avait répondu le professeur, avant de remonter ses lunettes et de s’acheminer vers une autre salle de cours.
Je l’ai regardé s’éloigner. Ce jour-là, moi qui étais dans une section littéraire et qui, la tête pleine d’Homère et de Virgile, ne raisonnais pas comme lui, je me suis dis que malgré toutes ses certitudes, il ne devait pas avoir raison.
Aujourd’hui, devant l’ampleur du désastre qui peut-être se prépare, je ne suis pas spécialement fier d’avoir eu finalement raison. Pour une fois, je voudrais au contraire m’être lourdement trompé.
00:49 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : japon, centrales nucléaires
13/03/2011
Stupeur et tremblements
Le premier novembre 1755, un tremblement de terre suivi d’un raz-de-marée ravagea Lisbonne. Il y eut entre 50.000 et 100.000 victimes. Les personnes qui n’avaient pas péri sous les décombres des maisons, se ruèrent sur les quais, croyant être à l’abri des chutes de pierres. Là, elles découvrirent avec stupéfaction que le fond de l’océan était visible. La mer s’était retirée. Évidemment, peu de temps après, un tsunami ravagea la partie basse de la ville. Le peu qui avait été épargné fut ensuite la proie des incendies, les cheminées ayant été endommagées lors du séisme.
On connaît la réaction de Voltaire, qui pour la circonstance composa le Poème sur le désastre de Lisbonne. Pourquoi, en effet, Dieu, s’il existait (et pour Voltaire, déiste et non athée, Dieu existait, même si dans son imaginaire il était plus proche des forces de la nature que du vieillard barbu de l’Ancien Testament) avait-il voulu tuer ainsi des innocents, qui plus est le jour d’une fête chrétienne, la Toussaint ? En remettant ainsi en cause la sagesse divine, notre philosophe s’opposait directement aux thèses optimistes de Leibniz et Pope. Ceux-ci soutenaient que la Providence gouvernait le monde et que si parfois il arrivait quelques événements regrettables, ceux-ci restaient minimes par rapport au Bien absolu, qui progressait toujours. Le bouillant Voltaire ne pouvait tolérer cette sorte de fatalisme béat et il s’en moquera dans Candide avec sa fameuse formule « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. »
Rousseau répondra au poème sur le désastre de Lisbonne par la Lettre sur la Providence.
Et nous, que dirons-nous, devant ce malheur qui frappe le Japon ? Un tremblement de terre, un raz-de-marée, un incident nucléaire majeur… Cela fait beaucoup en un jour, pour un seul pays. Pays qui nous est proche, même s’il est loin géographiquement, puisque nous avons le même stade de développement technologique, le même genre de vie, etc. Je veux dire par-là que ce n’est pas le tiers-monde. Car quand un cataclysme frappe le tiers-monde, nous ne nous sentons guères concernés. Nous nous disons que nous n’avons pas le même climat extrême et que nous sommes de toute façon bien mieux préparés pour y faire face. Mais ici ? Tout avait été prévu. Les bâtiments avaient été construits en respectant les normes antisismiques (heureusement !) même la centrale nucléaire, qui pouvait résister à un tremblement de terre de force 7. Mais là on était à 8,9 ! On appréciera l’optimisme des spécialistes, qui ont toujours raison, sauf quand les faits leur donnent tort.
Les croyants fondamentalistes diront que Dieu a puni les hommes de leurs péchés (ah bon ?). Les croyants se refuseront à prendre position et soutiendront que les voies de Dieu sont impénétrables. Les fatalistes diront qu’on n’y peut rien, que cela devait arriver et voilà... Les athées comme moi seront impressionnés par cette force aveugle de la nature, qui nous oblige de temps à autre à nous souvenir que nous ne sommes pas grand-chose, malgré notre culture, notre science et notre savoir-faire. L’homme, finalement, reste un animal bien démuni.
La presse, évidemment, toujours friande de catastrophes, surtout si le nombre des victimes est élevé, s’est emparée de l’événement. On en a oublié la Lybie. Ca tombe bien, car l’ami Sarkozy voulait justement partir en guerre contre celui qu’il accueillait en grande pompe en 2007 encore, mais il a été désavoué par ses alliés européens. La France n’ira donc pas bombarder la Lybie, seul état arabe dont le dirigeant osait tenir tête à l’Occident. Tant mieux, cela aurait fait un peu expédition coloniale, surtout qu’il y a du pétrole à voler. Et puis débarquer là-bas juste au moment où Kadhafi est en train de reprendre la situation en main, cela allait être compliqué. Cela nous aurait encore fait pas mal de victimes en plus et dans les deux camps encore bien.
Vous me direz qu’on n’est plus à quelques victimes de plus ou de moins, surtout quand il s’agit d’aller imposer la démocratie et la libre circulation des biens et des richesses. Les Afghans le savent bien qui ont l’habitude de voir leur population civile bombardée par l’Otan, par erreur sans doute mais pour la bonne cause toujours.
Tout cela pour dire que les hommes sont fous. Comme si on n’avait pas déjà assez des tremblements de terre et des tsunamis ! Il faut encore qu’ils se tuent entre eux. La vie est pourtant si courte ! C’est ce que doivent se dire cette nuit les Japonais qui ont survécu. Ils ont perdu des proches, toute leur famille peut-être, leur maison est détruite et ils sont là dans le noir (plus d’électricité), devant la mer qui s'est retirée, à se poser les mêmes questions que Voltaire quelques siècles plus tôt : « Pourquoi ? »
Et il n’y aura évidemment personne pour leur répondre.

00:29 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (10)
11/03/2011
Une affaire de plagiat ?
Mauvaise surprise l’autre jour. En ouvrant ma page d’accueil Hautetfort, je trouve le message suivant :
Votre blog a fait l'objet d'une plainte de l'AFP concernant des articles que vous avez publiés sans en avoir l'autorisation et listés ci-dessous. Ces articles ont été retirés de la publication et sont à présent en mode brouillon. Vous ne devez pas remettre en ligne ces contenus faute de quoi nous serons amenés à fermer l'accès à votre blog, conformément aux CGU. Articles retirés : http://feuilly.hautetfort.com/archive/2008/07/05/des-langues-regionales.html
Et effectivement, l’article a été retiré du site et se retrouve dans les brouillons. Fort étonné, je le relis plusieurs fois et ne trouve décidément rien qui viendrait justifier ces avertissements peu amènes (fermer l’accès au site, quand même !). En gros, j’avais parlé des langues régionales, que j’aime beaucoup par ailleurs, mais je mettais en garde contre la politique actuelle de l’Union européenne, qui, en valorisant les régions et leurs langues, risquait de contribuer un jour à l’éclatement des grands états nationaux. Ce sont là des idées strictement personnelles, qu’on peut approuver ou désapprouver, certes, mais qui en tout cas ne devaient rien à un quelconque article de l’AFP. Je m’étonne donc toujours de cette censure à retardement (un article de 2008 !).
Peut-être est-ce la carte illustrative, qui présentait les différents patois de France et dont je n’avais pas cité la source (en 2008 j’étais encore un peu novice ou un peu inconscient) qui serait la cause de toute cette affaire. Je l’ignore. Dans ce cas, ne suffisait-il pas de demander à ce que cette source soit citée ou bien, à la imite, à ce que la carte soit retirée ?
Le plus curieux c’est que d’autres sites ont connu la même mésaventure et eux aussi pour des articles publiés en 2008. Un comité de censure s’est-il donc mis en place ? Sont-ce là les premières manifestations de la loi Hadopi ? Sarkozy craint-il de perdre son pouvoir via une révolution organisée sur Internet, comme ce fut un peu le cas en Tunisie ? L’Union européenne a-t-elle des espions qui surveillent ceux qui osent la critiquer ? Ce serait me faire beaucoup d’honneur…
Si l’incident reste isolé, ce n’est pas trop grave, mais si un comité de « sages » commence à éplucher tout ce qui se dit sur Internet, cela va être dur d’émettre la moindre idée, car on retrouvera toujours bien un article de presse quelque part qui développe le même thème.
Quant à Hautetfort, je leur ai demandé de m’expliquer de quoi il s’agissait exactement, mais je n’ai pas reçu de réponse.
07:00 Publié dans Blogue | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : blogues, internet, censure
08/03/2011
Forêt
Ce n’étaient que feuilles, branches et futaies,
Troncs lisses, nuages et pluie.
Ce n’étaient que forêts, toujours, et horizons bleus,
Bêtes dissimulées,
Sangliers farouches, cerfs aux aguets, brames et amour.
Ce n’étaient que bruissements et rumeurs
Regards et fuites.
Ce n’était que lune, la nuit, en la clairière offerte
Ce n’était que bleu, partout, au profond du silence.
Puis mort jaune et or, automne, en novembre de brume.
Et encore flocons, quand tombe l’hiver, empreinte du loup,
Tache de sang.
C’était renard au printemps, amour et rage.
C’était bave sur la pierre, dans le village, en plein midi.
Et enfant mort, mordu, perdu,
Enfant d’ici, de la forêt, dedans sa tombe.
Tombe la pluie, sur la lune bleue, en son printemps.
Et les flocons, dedans l’hiver, sur le loup gris.
Regard perdu, mort à l’affut, sang répandu.
Oiseau de nuit, oiseau tout noir, dans la forêt.
Cri éperdu, peur du midi, enfant perdu.
Village de pierres, forêt des morts, cimetière tout gris.
Horizons bleus, sangliers noirs, hordes de nuages.
Ce n’étaient que forêts, toujours, branches et futaies
Ce n’étaient que regards, village perdu, renard d’ici
Puis l’enfant mort, dans la pluie bleue, sous sa pierre grise.
Puis l’enfant mort, forêt profonde, oiseau de nuit.
00:01 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature
04/03/2011
Là-bas (fin)
Mais l’horizon, déjà, rougeoyait, et le soleil, fatigué, quittait la scène du grand théâtre du monde. Si nous ne voulions pas nous faire surprendre par l’obscurité, il fallait regagner bien vite la voiture. Tant pis pour le cadran solaire en marbre blanc, de dix mètres de diamètre, qui devait se trouver quelque part dans les fourrés et que nous n’avions jamais vu. Tant pis pour la tour lunaire, qui servait à observer les éclipses et que nous n’avions jamais vue non plus. Ce n’était pas encore aujourd’hui que nous allions découvrir ces merveilles et il nous faudrait revenir une fois encore.
Nous rentrions au plus vite. Nous repassions devant le lavoir, dont les tuiles rouges avaient maintenant une couleur ocre, nous longions les ruines du palais-bibliothèque, dont les contours commençaient à s’estomper dans l’obscurité naissante, nous laissions à notre gauche les ruines du théâtre antique et nous abordions enfin le chemin qui devait nous ramener à la voiture.
Mais, une fois de plus, nous avions trop tardé à partir et en traversant le bois de pins il faisait si sombre qu’une peur ancestrale et atavique nous saisissait aussitôt. C’était la peur du noir et de la nuit, la peur des bêtes sauvages et de la mort, cette même peur que les hommes préhistoriques avaient dû connaître et qui les avaient poussés à trouver refuge à l’intérieur des grottes. Ensuite, ils avaient donné une forme à leurs angoisses en tentant de dessiner sur les parois ce qui allait devenir la première forme de l’art humain. Car l’art n’était pas autre chose que l’affirmation de l’homme devant la mort, nous le savions bien et c’est pour cela que nous revenions sans cesse contempler les ruines de ce lieu insolite, perdu au milieu des bois. Depuis le théâtre antique jusqu’au palais princier, nos ancêtres avaient tenté désespérément de marquer leur passage sur terre. Ce n’était évidemment qu’une illusion et il suffisait de regarder l’état de délabrement de tous ces bâtiments pour se rendre compte de la vanité de leur démarche, mais peut-être qu’en multipliant nos visites nous voulions inconsciemment honorer leur travail et tenter de nous souvenir qu’ils avaient existé.
Derrière tout cela, c’était évidemment notre propre vie qui était en jeu et en contemplant les ruines des siècles passés nous n’étions pas sans nous demander ce que nous allions laisser, nous, comme traces de notre passage. Certes nous étions bien jeunes encore, à cette époque, mais l’adolescence n’est-elle pas propice à ce genre de réflexion ? Après, nous allions devenir tellement occupés à lutter pour vivre et pour survivre, que nous en oublierions de nous poser la question du « pourquoi » de l’existence.
C’est donc inquiets et l’âme angoissée que nous traversions le bois de pins, finalement plongé dans l’obscurité totale. Puis nous longions une nouvelle fois les pâtures où les vaches, bovines à souhait, n’en finissaient plus de ruminer l’herbe tendre sans s’interroger le moins du monde sur leur état. Quand nous arrivions enfin à la voiture, il faisait nuit noire. Derrière nous, l’ancien hôtel dressait sa masse sombre. Il nous semblait alors entendre les pas feutrés d’amants imaginaires qui glissaient sur les vieux parquets cirés. Dans le silence de la nuit, ils se dirigeaient vers des lits d’un autre âge pour aimer à leur façon des dames souvent plus jeunes qu’eux et qui leur offraient sans retenue leur corps presque parfait. En cet instant, nous croyions subitement percevoir le côté illusoire de tous ces jeux érotiques. Car nous qui venions de contempler des monuments en ruine, nous qui venions de voir la vanité de l’Histoire, de l’art et des princes, nous ne pouvions qu’émettre des doutes sur la pérennité de ces corps enlacés dans un éphémère bonheur. Tant de couples avaient dû passer par ici… Et que restait-il de leurs étreintes ?
Nous poussions un soupir en remontant dans la voiture. Dans une heure, nous serions dans la grande ville et respirerions ses fumées nauséabondes. Ce qui nous consolait, c’est que nous savions déjà que nous reviendrions bientôt afin de tenter de percer le mystère de ces ruines qui, décidément, n’en finissaient plus de nous intriguer.
07:00 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature
02/03/2011
La-bas (suite de la suite)
Plus loin, une petite rivière alimente toujours un lavoir étonnant, dont les poutres impressionnantes ont résisté aux siècles. On ne sait quelles jeunes filles venaient ici se pencher sur l’onde, rêvant à des amours impossibles tout en regardant les fils du seigneur qui, sur leurs montures, partaient pour des guerres dont ils n’allaient pas revenir. On imagine leur désarroi à l’annonce de la mort de ces princes et bien des larmes durent tomber dans l’onde du lavoir, des larmes aussi secrètes qu’inavouables. Quant à celles qui avaient eu plus de « chance » et qui, malgré leur servile condition, avaient été remarquées un instant, elles avaient perdu leur honneur dans des amours ancillaires. On les retrouvait bientôt courbées sur le linge à laver, le frottant avec désespoir, puis, subitement, on les voyait se tordre de douleur et s’affaler sur la pierre froide et mouillée, tentant désespérément de cacher leur ventre proéminant, fruit douloureux de ces amours diaboliques.
Elles étaient alors impitoyablement chassées et quand elles s’enfonçaient seules dans la grande forêt où gémissaient les loups, le rire cruel et ironique des seigneurs ressemblait à la lame qui allait tuer ces pauvrettes. Car une fois arrivées dans les clairières profondes, elles tentaient toutes de faire partir par le fer ce fruit du démon qui arrondissait leur ventre. Certaines y arrivaient, mais la plupart y perdaient la vie et après l’hiver on retrouvait près d’un arbre des restes décharnés dont les loups n’avaient pas voulu. Mais il y avait longtemps qu’on ne doutait plus de leur mort car chaque fois que l’eau du lavoir rougissait, on savait que l’une d’entre elles était morte dans son sang, transpercée par le fer de la honte, celui qui, par vengeance divine, met un terme à la vie des filles impudiques.
Ces histoires des temps anciens nous bouleversaient et c’est le cœur meurtri pour ces pauvres lavandières que nous continuions notre promenade. A quelques mètres du lavoir, nous apercevions bientôt les arcades d’un promenoir. Il ne restait que deux pans de mur avec des colonnes et la voûte qui soutenait le toit de tuiles, lequel était resté miraculeusement intact. La présence isolée de ce déambulatoire au milieu d’une clairière nous surprenait toujours. Les bâtiments dont il dépendait avaient été détruits et nous n’avons jamais su s’il avait appartenu à un couvent ou à un château. Des moines y méditaient-ils leur bréviaire ou de belles princesses y lisaient-elles des lettres d’amour, écrites par quelque chevalier parti bien loin pour une vague croisade ?
Plus loin, un muret de pierres sèches empêchait les passants de tomber dans une fosse. Celle-ci avait dû servir de cage pour les ours et nous supposions qu’une espèce de jardin zoologique avait été aménagé en ce lieu, peut-être au XVIIIe siècle. Rien n’était moins sûr, mais comment expliquer autrement l’existence de ces paons, redevenus sauvages, qui hantaient les alentours ? Leurs cris parfois nous glaçaient d’effroi, quand ils nous surprenaient au milieu du silence. Par contre nous admirions leurs parades amoureuses et quand les mâles faisaient la roue, il nous semblait voir dans leur plumage chatoyant comme le souvenir des vitraux d’une cathédrale à jamais disparue.
Près de la cage aux ours, à l’entrée du chemin qui s’avançait vers la forêt, deux lions de pierre évoquaient des continents lointains et inconnus, tandis que quelques arbres aux essences inconnues de nous avouaient une origine manifestement africaine. D’où venaient-ils, comment étaient-ils arrivés là ? C’était un mystère. Cette partie de la propriété avait-elle été consacrée à la botanique ? Nous imaginions alors quelque adepte de Linné ou de Jussieu occupé à cultiver ici des plantes rares et des espèces vénéneuses. Le « Genera Plantorum secundum ordines naturales disposita » aurait-il été écrit ici même que nous n’en aurions pas été autrement surpris.
00:37 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature
28/02/2011
Là-bas (suite)
Mais il fallait partir et poursuivre notre route. Après avoir traversé un autre petit bois, nous parvenions enfin au but de notre voyage. A un détour du chemin, les bâtiments surgissaient soudain devant nous, impressionnants, dans ce lieu où on n’entendait aucun bruit. Le théâtre était quasi en ruine et seules trois colonnes tenaient encore debout. Les herbes avaient envahi les gradins de pierre, mais on devinait encore facilement la forme de l’hémicycle.
A l’entrée, deux statues de marbre blanc nous regardaient de leurs yeux fixes. La première, un homme, tenait dans ses mains un rouleau déplié pour que nous pussions y lire notre destinée. Mais les inscriptions, s’il y en avait eu, étaient inexorablement effacées et le sens de ce message nous restait à chaque fois inconnu. L’autre statue représentait une femme. De la main gauche, elle soutenait une sorte de petite harpe dont elle pinçait les cordes avec la main droite. Mais une nouvelle fois nous avions beau prêter l’oreille, aucun son ne s’échappait de l’instrument et le silence profond qui régnait parmi les ruines accentuait encore la perte irrémédiable de cette musique qui n’avait pu être que divine. Seul le vent, parfois, gémissait sourdement et il nous semblait alors entendre comme le murmure évanoui d’un chœur antique. Mais ce n’était qu’une illusion de plus, comme ce théâtre dont il ne restait presque rien. Quant aux tragédies qu’on avait jouées ici autrefois, elles avaient relaté l’histoire de héros malheureux à jamais disparus et dont malheureusement nos mémoires fatiguées n’avaient conservé aucun souvenir.
Plus loin, se dressait un bâtiment de style classique et qui devait dater probablement du XVIIe siècle. Il semblait avoir été conçu pour être le palais d’un prince, du moins si l’on en croyait les armoiries ouvragées, taillées dans le trumeau de la porte principale. Plus tard, quand les révolutions avaient fait basculer le cours de l’histoire et que les têtes couronnées étaient tombées les unes après les autres, ce palais privé était devenu une bibliothèque publique. Les milliers de volumes qui y avaient été rassemblés aux cours des siècles appartenaient maintenant à la nation, dont ils constituaient le patrimoine culturel. Les livres les plus anciens, à ce qu’on disait, remontaient à ces fameux moines du Moyen Age dont il nous semblait encore parfois entendre les chants étranges et les voix mystiques. Ce n’était pourtant déjà plus qu’un souvenir qui s’évanouissait chaque jour inexorablement dans nos mémoires.
Nous imaginions des Bibles enluminées aux dorures raffinées et des hagiographies relatant la vie fantastique ou la mort plus étrange encore de saints aux noms improbables. Tout en haut des rayons, sur des étagères inaccessibles, s’alignaient les romans de chevalerie, où tout était conté des aventures des quatre fils Aymon, de Lancelot du lac ou de guillaume d’Orange. Là, entre ces pages, Merlin l’enchanteur n’en finissait plus de hanter la forêt de Brocéliande et Tristan murmurait à l’oreille d’Yseut des choses qu’elle n’aurait jamais dû entendre. Dans un coffre fermé à clef, on avait caché à la vue de tous les poèmes d’amour que des troubadours en plein délires avaient composés pour des princesses à jamais inaccessibles.
Voilà donc ce que la bibliothèque avait pu sauver, disait-on, de ce lointain Moyen Age. Mais il n’y avait pas que cela. Au XVIe siècle, des érudits au nom désormais oublié avaient ramené de Grèce ou de Rome des manuscrits antiques à la valeur inestimable. La vie des douze Césars côtoyait là l’Art d’aimer et les Tacites et les Tites-Lives rivalisaient en sagesse avec les écrits des Epicuriens ou des Stoïciens. Dans ces pages, Rome n’en finissait plus de brûler sous l’œil indifférent de quelques Nérons pendant que des Barbares aux noms imprononçables déferlaient en bandes enragées sur la Gaule transalpine.
On racontait que le dernier prince à avoir occupé ces lieux, et qui avait un sens du tragique assez prononcé, avait conservé là un exemplaire de toutes les pièces jouées devant le Roy durant le Siècle d’Or et que sur les rayons les œuvres originales et manuscrites du grand Corneille y avaient côtoyé celles de l’entêté Racine. Puis vint la Révolution et les privilèges des temps anciens tombèrent, par une logique implacable du grand balancier de l’Histoire. Nous qui n’étions rien et qui n’avions jamais rien été, nous nous réjouissions en secret de ces revirements inespérés et pour un peu nous aurions remercié les dieux, auxquels pourtant nous ne croyions guère, d’avoir ainsi renversé l’équilibre social.
Malheureusement, ces révolutions amenèrent également leur lot de malheur et l’incendie qui ravagea un beau soir la bibliothèque ne fut pas le moindre. On se sut jamais s’il fut allumé volontairement par quelque rebelle qui voyait dans ces livres l’esprit de l’Ancien Régime ou si au contraire une maladresse seule en fut la cause, mais le résultat fut épouvantable : des milliers d’ouvrages disparurent dans un brasier incroyable et pendant quatre semaines on put pu voir le ciel nocturne ensanglanté par les lueurs d’un gigantesque brasier. Les étincelles montaient jusqu’aux étoiles et l’on retrouva à des kilomètres des pages calcinées et noircies sur lesquelles tout message avait été effacé. Adieu donc la sagesse antique et l’amour courtois. Adieu la quête du Graal et les lettres d’Abélard. Quant à celui qui fut peut-être pendu à Montfaucon, il mourut ainsi une deuxième fois, quand ses poèmes disparurent dans les flammes de l’enfer.
Après cette catastrophe, la palais-bibliothèque servit d’écurie pour les chevaux de l’empereur puis de caserne pour la soldatesque. Aujourd’hui, ce n’est plus qu’une ruine et seuls des pans de murs noircis rappellent encore aux visiteurs que se trouvait ici la plus grande bibliothèque d’Occident.
07:00 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature
23/02/2011
Là-bas
Il fallait marcher longtemps, pour parvenir à ces bâtiments, car aucune voie carrossable n’y donnait accès. On se levait de bon matin, ces jours-là. En voiture, on quittait la grande ville, sa circulation et ses fumées, puis, après une bonne heure de route, on se garait sur un parking, près d’une maison en ruine qui avait dû être un restaurant. Les volets en étaient clos depuis des années et nul ne se souvenait y avoir jamais vu la moindre activité. Le patron devait être parti sous d’autres cieux ou peut-être même était-il mort. Personne n’en savait rien. En tout cas, il y a avait des décennies qu’aucun voyageur ne s’était arrêté là. Des herbes folles avaient envahi les parterres et de petits bouleaux poussaient même sur la façade, entre les pierres de taille. Près de la porte, une vieille enseigne pendait toujours au bout de sa chaîne, ballottée au gré du vent : « Aux délices de… » Le reste avait été effacé et nous ne saurions jamais à quels délices il était fait allusion.
En fait, rien ne prouvait que cette maison isolée, en pleine campagne, fût bien un restaurant. C’était peut-être un lieu de rendez-vous secret pour des amoureux illégitimes. Il me plaisait d’imaginer un couple arrivant là, discrètement, et montant, main dans la main, les marches du perron. Dans la grande chambre, surpris, ils apercevaient soudain leur image dans le miroir d’une antique garde-robe. Ils étaient d’abord un peu impressionnés, un peu intimidés, par l’atmosphère désuète qui régnait là. On sentait que des générations entières avaient dû défiler en ce lieu, et les meubles semblaient en avoir conservé le souvenir. Mais bientôt chacun ne voyait plus que l’être aimé à côté de lui. Subitement, une robe glissait à terre et c’est le souvenir d’Eve en son paradis que le miroir réfléchissait alors. Le reste appartient à ces amoureux, le secret de leurs gestes comme le secret de leurs cœurs.
Nous, une fois la voiture garée, comme abandonnée, nous empruntions le petit chemin de terre qui prenait naissance près de l’hôtel et qui se dirigeait ensuite vers la forêt. Il fallait compter une bonne heure de marche avant d’arriver à destination. Nous devions d’abord longer des champs, où invariablement des vaches placides nous regardaient passer, puis ensuite il nous fallait traverser à gué le petit ruisseau. On abordait enfin la grande forêt de pins où l’odeur suave de la résine nous enveloppait aussitôt. C’était un parfum « étrange et pénétrant » qui évoquait en moi le Sud profond. Il suffisait de fermer les yeux pour se croire aussitôt en Provence, au cœur du massif des Maures, et il ne manquait que le chant des cigales pour que l’illusion fût parfaite. Le silence qui régnait là était impressionnant. Nous cheminions sur un tapis d’aiguilles qui amortissait nos pas et personne n’aurait osé proférer la moindre parole, par respect pour l’aspect sacré de ce lieu. Parfois, s’il y avait un peu de vent, on entendait juste comme un murmure dans les frondaisons. Ce devait être le souffle des dieux qui vivaient là, des dieux oubliés par la civilisation et qui avaient dû trouver refuge dans ces solitudes.
Un bon quart d’heure était nécessaire pour traverser la forêt, peut-être même davantage. Cela dépendait du nombre de haltes que nous faisions, car parfois l’envie nous prenait d’écouter le silence. Alors on s’asseyait sur le tapis d’épines et on tendait l’oreille. Rien, il n’y avait rien à entendre. Rien qu’un vide comparable à celui de l’espace infini. Il nous semblait alors être non seulement à mille années lumière, mais même hors du temps. En été, au moment des fortes chaleurs, on percevait pourtant comme un murmure lointain. C’était celui de milliers de mouches qui bourdonnaient dans les sous-bois et qui faisaient comme un écho à nos rêves éveillés. Invisible, la vie était pourtant là, présente et obsédante. Inquiétante aussi. Car quels êtres étranges étaient ces insectes qu’on ne voyait jamais ? De quel monde venaient-ils ? Dans quelles frondaisons se tenaient-ils cachés ? Toujours, le mystère restait entier et quand nous nous relevions, des fourmis dans les jambes, rien n’avait été élucidé.
Il nous restait alors à parcourir deux petits kilomètres, à travers un paysage sauvage de landes et de prairies à l’abandon. A une époque très lointaine, ces terres avaient dû être entretenues par la main de l’homme, puisque la forêt y avait été défrichée. Nous imaginions alors des moines bénédictins occupés à sarcler les champs, dans un Moyen Age quasi mythique. Si nous tendions bien l’oreille, il nous semblait presque entendre des chants grégoriens issus d’une abbaye aussi improbable qu’inconnue. Était-ce le fruit de notre imagination ou bien cette abbaye avait-elle vraiment existé ? Et se pouvait-il que ces chants mystiques eussent continué à glorifier la création à travers les siècles malgré la disparition des moines ? Si nous voulions nous montrer rationnels, nous devions reconnaître qu’un tel raisonnement ne tenait pas la route. Pourtant, les lieux que nous traversions étaient si mystérieux que nous n’étions pas loin de croire à ces histoires que nous venions d’inventer.
10:45 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature
18/02/2011
De la "littérature" en ligne
Je n'aime pas trop parler de statistiques, mais il faut bien passer par-là si on veut se rendre compte de la diffusion d'un texte en ligne.
Je me demandais l'autre jour quel avait été l'impact d'« Obscurité », qui nous a tous occupés pendant quasi une année. Ce texte a été lu sur Marche romane bien entendu (entre 120 et 150 lectures par jour en moyenne) mais pas uniquement. Mon site était également répertorié sur le site « Paperblog » et, si l’on en croit leurs statistiques, il y aurait eu là une centaine de lecteurs par jours ( ???).
|
|
Article |
Lectures via le blog |
Lectures via Paperblog |
Total |
Voir l'article |
|
|
? |
108 |
108 |
||
|
|
? |
177 |
177 |
||
|
|
? |
280 |
280 |
||
|
|
? |
163 |
163 |
||
|
|
? |
134 |
134 |
||
|
|
? |
97 |
97 |
||
|
|
? |
100 |
100 |
||
|
|
? |
36 |
36 |
||
|
|
? |
98 |
98 |
||
|
|
? |
124 |
124 |
On pourrait juste regretter que ce roman ait été classé dans la rubrique « Humeur », là où j’aurais évidemment préféré qu'il soit répertorié dans « talents » ou dans « littérature », mais on ne peut pas tout avoir, n’est-ce pas ? Et puis cela oblige à rester modeste...
http://www.paperblog.fr/3839120/obscurite-61/
Par ailleurs, j’avais été contacté par le blogue "Ideoz". Je n’avais tout d’abord pas bien compris ce que je serais allé faire sur un site, certes fort intéressant, mais qui traitait essentiellement de voyages (conseils pratiques, expériences des personnes qui se sont rendues dans des pays proches ou lointains, comptes-rendus, impressions, journaux de route, etc). En fait, il existait une rubrique consacrée aux voyages imaginaires, ceux qu’on ne fait qu’en rêve, en tenant une plume à la main. Là, cela rentrait plus dans mes cordes, évidemment, mais j’avais répondu que je n’avais pas trop de temps pour m’investir dans un site qui n’était pas le mien (ce qui n'est pas très courtois, je l'avoue). Bref, il ne fallait pas compter sur moi pour écrire des articles sur "Ideoz"…
On m'a alors proposé de venir copier les articles de Marche romane qui sembleraient intéressants, ce que j'ai accepté. C’est comme cela qu’Obscurité s’est retrouvé sur Ideoz où il a forcément été lu également.
Heureusement, on se déplaçait beaucoup dans cette histoire de l’enfant, de sa mère et de Pauline et notre trio a finalement traversé tout le pays. De plus, les paysages étaient à l'honneur (ce qui n'était pas prémédité) et du coup mon texte n'a pas trop déparé dans ce site consacré aux voyages.
Si on regarde les chiffres, on a entre 50 et 80 lecteurs pour les premiers chapitres et plus de 150 pour les derniers. On peut donc estimer, qu'en moyenne, une centaine de personnes ont lu le texte.
Je découvre aujourd’hui avec surprise que les notes sur l’origine des mots se trouvent également sur Ideoz.. Nous voilà pourtant loin des voyages, même imaginaires, mais il est vrai qu’il s’agit ici d’un voyage dans la langue dont on tente de retracer l’évolution. Un voyage dans le temps, en quelque sorte.
Merci en tout cas à Ideoz d’avoir accueilli Obscurité et de s’être montré particulièrement persévérant malgré mes refus successifs.
http://voyages.ideoz.fr/author/feuilly/
http://voyages.ideoz.fr/de-lorigine-des-mots-suite/
Conclusion : si on en croit les chiffres, Obscurité aurait donc été lu par environ 300 personnes, ce qui est tout de même inespéré pour un roman en ligne. Il n’est pas du tout certain qu’une édition « papier » aurait rencontré un tel succès.

07:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, roman en ligne
14/02/2011
De l'origine des mots (suite et fin)
Nagier : n’a pas le sens de « nager » comme on pourrait le croire naïvement. En effet, jusqu’au XVIe siècle ce verbe, qui vient du latin « navigare »signifiait « aller en bateau ».
Il nagierent tant qu’il ariverent desox le cite de Cartage, et quand Nicolete vit les murs del castel et le païs, ele se reconut, qu’ele y avoit esté norie et pree petis enfes ,mais ele ne fu mie si petis enfes que ne seust bien qu’ele avoit este fille au roi de Cartage et qu’ele avoit este norie en le cite. (« Aucassin et Nicolette, ch XXXVI »)
Ceci dit, je ne suis pas trop d’accord avec cette date du XVIe siècle que donne Dufournet car en cherchant chez Montaigne, je retrouve bien notre sens actuel de nager :
Il avoyt cette mesme opinion que la science de nager estoit tresutile à la guerre et en tira plusieurs commoditez : s’il avoyt à faire diligence, il franchissoit ordinairement à la nage les rivières qu’il rencontroit. (Livre II, chapitre XXXIV)
Le Robert historique, quant à lui, donne la date du XIIe pour la première apparition du sens moderne. Nager se met alors à concurrencer « noer » (nager) qui s’emploie, lui, effectivement jusqu’au XVIe siècle. Ce « noer » était issu du latin « notare », lui-même provenant du latin classique « natare » (cf. « natation » aujourd’hui). La proximité formelle avec « noyer » explique sans doute la disparition de ce verbe « noer » au profit de « nager ». Mais il y avait aussi une collision homonymique avec un autre verbe « noer », qui lui signifiait « nouer, faire un noeud » « Noer » ne pouvait donc survivre et « nagier » s’est imposé.
Mais du coup, cette nouvelle signification de nagier (se déplacer dans l’eau sans couler) a rendu difficile son emploi dans le sens premier (naviguer, voyager sur la mer). Pour ce faire, on a donc recréé un mot à partir de « navigare » et c’est notre « naviguer » (écrit « naviger » dans un premier temps).
Notons que « nager » au sens de naviguer demeure dans l’expression « nager entre deux eaux » qui signifiait en fait « refuser de s’engager ».
Notons aussi que Nagier (naviguer) a pu prendre, assez logiquement, le sens de « ramer », ce que l’on retrouve aujourd’hui dans l’expression « nager sec ».
Ce qui est sûr (et la Dufournet et el Robert historique tombent d’accord), c’est qu’au XVIe, en effet, « nager » s’est définitivement imposé définitivement dans son sens actuel. Petit à, petit, des expressions vont en élargir le sens, comme « nager dans son sang » (XVIIe) ou « nager dans un vêtement » (XVIIIe).
Travailler : ce verbe avait le sens de « torturer, tourmenter », sens qu’il a conservé jusqu’au XVIe siècle. Il a alors remplacé « ouvrer », que nous avons encore dans des expressions comme « du fer ouvré », « un jour ouvrable » (jour où l’on travaille) et bien entendu dans notre substantif « ouvrier ». Le vieux verbe « ouvrer » venait lui du latin « operare » qui avait donné dans un premier temps « obrer » après la chute de la voyelle avant de devenir « ovrer » (cf. œuvre, œuvrer, etc.), puis ouvrer. Mais une confusion était possible avec le verbe « ouvrir » et c’est pour cela qu’il a été remplacé par «travailler ».
Remarquons qu’une composition savante, à partir du latin « operare », a donné « opérer ».
Mais revenons à notre verbe « travailler. Il provient du latin populaire « tripaliare » autrement dit torturer avec un trepalium (instrument qui servait à ferrer les bœufs). L’idée était bien celle de souffrance infligée et on l’employait pour parler des condamnés qu’on torturait mais aussi pour les douleurs ressenties par une femme qui accouche (dont on dit aujourd’hui qu’elle est en plein travail). Mais dès l’ancien français le verbe travailler a pris la signification d’une transformation acquise par un effort. En moyen français, l’idée de transformation efficace l’emporte sur celle de fatigue ou de peine et petit à petit le sens actuel s’impose (accomplir une action, réaliser quelque chose pour gagner sa vie).
Ce qu’il y a de remarquable, dans tous les exemples que nous avons vus dans cette rubrique, c’est cette disparition des verbes qui possédaient une forme trop proche de verbes ayant un sens complètement différent. Petit à petit, la langue s’est adaptée en éliminant les « doublons » et les formes trop rapprochées qui prêtaient à confusion. Personnellement, j’en retiens la leçon suivante : la langue que nous connaissons aujourd’hui et qui, depuis le XVIIe siècle est bien équilibrée, n’a pas toujours été ainsi. Il est des époques beaucoup plus troubles. Certains auteurs hésitent sur les termes à employer et ils le disent parfois. La clarté et la précision que nous connaissons aujourd’hui signifie que la langue a atteint un équilibre. Mais tout équilibre est précaire et provisoire. L’ancien français avait mis du temps pour passer des déclinaisons latines au système à deux cas puis finalement au système prépositionnel. Cet équilibre était à peine atteint que l’évolution rapide de la langue orale a débouché sur le moyen français, lequel s’est encore transformé jusqu’à notre français d’aujourd’hui. Respectons donc notre langue, ne la maltraitons pas. Les périodes d’équilibre sont souvent le fruit de plusieurs siècles d’effort.
Crédit photo : Azurs point net http://www.azurs.net/
00:52 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (6)
11/02/2011
De l'origine des mots (encore et toujours)
Avaler : ce verbe désigne tout d’abord l’idée de descendre, d’aller vers le « val » (cf. l’expression « aller par monts et par vaux », donc des sommets vers la vallée, autrement dit un peu partout). De l’idée de « descendre », avaler est passé à celle de « faire descendre », puis, par restriction sémantique, on en est arrivé à notre sens actuel : « faire descendre un aliment dans le gosier ».
Par le cuerbé : ce juron n’a rien à voir avec le corbeau (latin « corvus »), comme on pourrait le croire. Le « bé » qui termine le mot est une déformation de « Dé » autrement dit de Dieu. Par le cuerbé, c’est donc « par le cœur de Dieu ». De la même manière nous avons « corbleu » (par le corps de Dieu), morbleu (par la mort de Dieu), palsambleu (par le sang de Dieu). Pour ceux qui aiment les gros mots, je les renvoie à la chanson de Brassens « La Ronde des jurons », où en en trouve de toutes les sortes :
Tous les morbleus, tous les ventrebleus,
Les sacrebleus et les cornegidouilles,
Ainsi, parbleu, que les jarnibleus
Et les palsambleus,
Tous les cristis, les ventres saint-gris,
Les par ma barbe et les noms d'une pipe,
Ainsi, pardi, que les sapristis
Et les sacristis,
Sans oublier les jarnicotons,
Les scrogneugneus et les bigree et les bougree,
Les saperlottes, les cré nom de nom,
Les peste, et pouah, diantre, fichtre et foutre,
Tous les Bon Dieu,
Tous les vertudieux,
Tonnerre de Brest et saperlipopette,
Ainsi, pardieu, que les jarnidieux
Et les pasquedieu
Ah Brassens… J’en profite pour signaler que chaque semaine, sur le site de Bertrand Redonnet, on peut lire des extraits du livre qu’il avait consacré autrefois à ce poète-troubadour. Mais qu’on ne vienne pas m’accuser ici de plagier son blogue, comme je l’ai ouï dire. Cornegidouille (juron inventé par Jary dans Ubu Roi), on ne pourrait donc plus parler d’étymologie sans se retrouver avec un procès d’intention sur le dos sous prétexte qu’ailleurs, autrement dit en Pologne (« La scène est en Pologne, c’est-à-dire nulle part » comme disait le même Jary), une connaissance s’amuse également à jouer avec les mots ? « Honni soit qui mal y pense » (comme disait un roi angloy, en parlant, lui, de la jarretière de la mariée).
Puisque nous évoquions plus haut le corbeau, parlons-en. Le mot vient de « corbiaus » et est issu du latin populaire corbellus. Celui-ci est un diminutif de corbus, lequel avait donné de son côté « corp » au singulier et cors au pluriel, mais ce terme a finalement disparu au profit de notre corbeau, sans doute pour éviter la confusion avec « corps » ou « cor ».
Corbus lui-même était issu du latin classique corvus.
Le sens a évolué. Ainsi, par analogie avec le bec de l’oiseau, le mot corbeau a désigné en architecture une grosse pierre en saillie et qui sert à soutenir une partie qui dépasse (« encorbellement»). Il faut attendre la XIXe siècle pour voir le mot corbeau prendre différents sens négatifs (liés à la couleur noire de l’oiseau) et désigner tantôt un prêtre, tantôt un croque-mort, tantôt un homme sans scrupule et finalement un auteur de lettres anonymes.
Gésir : en ancien français, ce verbe signifiait aussi bien « être couché » que « être en couches, accoucher ». On fait là plutôt allusion à la position couchée de la jeune mère, après ses couches, plutôt qu’à la position adoptée pendant l’accouchement proprement dit. En effet, si je me souviens bien de mes lectures, au Moyen Age les femmes accouchaient plutôt debout ou accroupies.
Es canbres la roine : dans la chambre de la reine. On remarquera la construction du complément du nom (ancien génitif) qui pouvait encore se faire sans préposition au début du XIIIe siècle. On disait donc « le cor le conte » et « le fix le conte ».
Oïl : adverbe d’affirmation qui provient de « o » et il (pronom personnel de la troisième personne du singulier). Mais on avait aussi oie (o + ie, c’est-à-dire « je »). En Occitanie, on avait évidemment la forme « oc » (du latin « hoc », cela. Le sens était donc « oui, c’est cela »).

07:00 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (14)
07/02/2011
De l'origine des mots (suite de la suite)
Errer : il existe deux verbes « errer » en ancien français. Un qui vient du latin « iterare » et qui signifie, aller, cheminer, marcher et un autre qui provient de « errare », se tromper, s’égarer (voir « erreur » et « erroné » en français moderne). De la famille du premier, il ne subsiste que des expressions souvent mal comprises comme « chevalier errant » (qui s’en va à l’aventure) ou Juif errant (condamné à marcher sans fin).
Cière ou chière : ce mot désignait le visage (latin « cara »). « Faire bonne chère », c’était donc accueillir les gens avec un visage souriant. De là, forcément, le mot a été employé pour désigner un accueil chaleureux, puis le bon repas que cela impliquait souvent.
La prime était une subdivision temporelle de la journée. Cette division, qui est restée dans le langage ecclésiastique, remonte en fait aux Romains, qui avaient divisé en 12 heures la durée qui va du lever au coucher du soleil. « Prime » est donc la première heure du jour (6 heures du matin). La haute prime, c’est quand l’aube est déjà bien passée, soit à 8 heures. La « tierce » ou troisième heure correspond donc à 9 heures du matin. La « none » ou neuvième heures correspond à 15 heures (6 + 9 = 15). Quant à la « sieste », ou 6° heures, elle désigne donc midi (6 + 6 =12). Le terme est resté pour désigner le petit somme que l’on fait à midi après le déjeuner.
Se partir : toujours utilisé à la forme réfléchie dans Aucassin et Nicolette, ce verbe signifiait « séparer, diviser, partager ». Il nous reste l’expression « avoir maille à partir », la « maille » étant une petite monnaie sans grande valeur. Il s’agissait donc de diviser entre plusieurs personnes une piécette qui ne valait déjà pas grand-chose en elle-même, ce qui ne manquait pas de provoquer des querelles. A la fin du Moyen Age, « se partir » a signifié « s’en aller, se séparer de quelqu’un » (le sens n’est donc plus un objet que l’on divise, mais une personne dont on se sépare), de là notre « partir » qui signifie s’en aller. On retrouve donc des mots comme « départ » et « en partance » qui véhiculent l’idée de départ et des mots comme « partage », « part », « partie », qui conserve l’idée de partager.
Souple (du latin supplex, supplicis, qui plie les genoux en suppliant les dieux) désignait au Moyen Age une personne humble puis finalement une personne triste, abattue. A partir de « humble », le sens à glisser à « qui se plie facilement », car celui qui demande et implore n’est pas en position de force et doit forcément faire des concessions. Aujourd’hui, souple désigne des objets qui plient avec facilité.
Notons que le terme « supplice » vient lui aussi de « supplex », ce qui peut se comprendre car celui qu’on torturait avait tendance à implorer sa grâce à genoux .
08:12 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (8)
05/02/2011
De l'origine des mots (suite)
Uis (ou huis), que l’on retrouve dans « huissier » et « juger à huis clos », désignait la porte de la demeure, tandis que le mot « porte » était réservé aux grandes portes des villes, qui s’ouvraient dans les remparts.
Noise : bruit, querelle. Du latin « nausea » (mal de mer, d’où « nausée »), le mot prend le sens de situation désagréable et pénible. De là, il dérive vers le sens de « querelle », celle-ci étant par définition bien peu agréable. En français moderne, on trouve l’expression « chercher noise à quelqu’un ».
Traire : le sens premier était « tirer, tirer vers, se diriger ». Le mot a connu une restriction sémantique évidente puisqu’il ne signifie plus que « tirer le lait d’une vache, d’une brebis ou d’une chèvre. Les linguistes expliquent cela par une collision homonymique entre « moudre » le grain (du latin molere) et un autre « moudre », qui signifiait traire (du latin mulgere). Pour éviter la confusion entre les deux « moudre » on a employé de préférence le verbe « traire » quand il s’agissait de tirer le lait des vaches et « tirer » a donc pris la place de ce dernier verbe dans le sens général qui était le sien initialement.
Destrier (cheval de combat). Le terme vient du mot « dextre » car l’écuyer le tenait à droite quand il n’était pas monté. N’oublions pas que le contraire de dextre était « senestre », (gauche – latin sinister-) qui a donné sinistre.
Sengler : sanglier. En fait, c’est le porc solitaire, le « porcum singularem »). Ici, c’est l’adjectif « singularem » qui a prit la place du substantif pour désigner l’animal, puis le suffixe en « er » a été remplacé par un autre en « ier ». Notons qu’en patois on retrouve « sainguié » (Meurthe-et-Moselle), « sanler » (Morvan), singlé (wallon) sanglire (Languedoc), singlar (Midi), singuié (Vosges), etc. Le féminin « sanglière » a existé en ancien et moyen français puis a disparu au profit de « laie ». C’était pourtant joli, la sanglière, non ? Personnellement, j’ai toujours un peu de nostalgie pour tous ces mots qui ont existé et qui n’existent plus, même si je ne les ai pas connus. On touche là du doigt la potentialité extraordinaire de la langue, qui, devant le foisonnement qui s’offrait à elle, a finalement taillé, découpé et réduit. La belle forêt vierge est devenue un parc policé.

01:42 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : ancien français
03/02/2011
De l'origine des mots
Parmi les lectures de ces dernières semaines, citons « Aucassin et Nicolette » , célèbre chantefable du Moyen Age. Voilà un livre qui ne relève pas vraiment de l’actualité éditoriale, me direz-vous, mais qui traite gentiment de la passion amoureuse, de manière guillerette et sans jamais être lourd ni pesant. La langue, celle du début du XIII° siècle, se comprend relativement facilement, en tout cas j’ai connu des textes plus ardus. Mais si je parle de tout ceci ici, c’est pour les notes de Jean Fourniret, qui complètent le livre dans la collection Garnier-Flammarion. Des notes axées sur la langue, évidemment, et qui nous font mieux comprendre le sens caché des mots que nous employons quotidiennement. Car la langue vient de loin, de très loin, même, et nous avons trop souvent perdu de vue le sens premier, que nous ne percevons plus que de manière intuitive ou inconsciente. Voici quelques exemples.
Valet : c’est un adolescent de famille noble qui sert à la cour d’un grand pour apprendre les armes. Il portera les armes du seigneur, l’aidera à revêtir sa cuirasse, se verra chargé d’un message important à aller transmettre, etc. C’est l’idée de jeunesse qui prime. Dès lors, le terme a pu s’employer pour désigner un adolescent non noble, puis, finalement, c’est le sens « d’être au service de » qui a prévalu. Notons qu’en patois wallon, valet désigne le fils (l’idée de jeunesse est donc restée par archaïsme). Dans le Poitou, on dit « drôle » et « drôlesse »… Comme quoi il n’y a rien de plus amusant que d’étudier la langue.
Caitive : autrement dit, captive, prisonnière. De là, le terme a pris le sens de « malheureuse, misérable », ce qui se comprend aisément. Ensuite, par restriction sémantique, la langue en a limité l’emploi à « de faible constitution », autrement dit chétive. Captif et chétif ont donc le même étymon.
Estrange : pouvait signifier en ancien français à la fois « étranger » et « étrange », (comme messager pouvait désigner le message ou la personne qui portait le message). Cette confusion n’était pas fort pratique, c’est pourquoi on a utilisé le suffixe « er » pour différencier les termes : étrange/étranger et message/messager.
France (= franche) : au départ le terme désigne l’ethnie des Francs, puis il a pris le sens de « libre » en désignant les nobles, puisque c’était l’aristocratie franque qui dirigeait le peuple gallo-romain (d’où des expressions comme « avoir les coudées franches » ou le « franc arbitre », le « franc parler », etc.). Ensuite, au sens social s’est ajoutée l’idée de noblesse morale.
Maleoite ou maldite (maudite) est l’antonyme de benoite (bénie ou bénite), lequel survit dans le prénom Benoît et dans les adjectifs benoît (bon, doux voire même doucereux) et benêt. Aujourd’hui, il n’est pas si évident que cela de se rendre compte que béni (idée de bien) est l’opposé de maudit (idée de mal), tant le sens religieux a prévalu dans le premier terme.
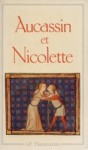
07:00 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (2)
02/02/2011
Réveil
Pour le lent réveil de Marche romane, une petite touche d’humour. Je ne parle jamais ici des statistiques du blogue, cependant quelque chose m’a interpellé dans les chiffres de janvier. Alors que le site était à l’arrêt complet et qu’il n’y avait rien à lire, il n’y a jamais eu autant de visiteurs, ce qui est un comble. On peut interpréter la situation de deux manières. Soit certains attendaient la reprise avec impatience et venaient régulièrement voir s’il y avait du nouveau, soit au contraire mon silence était plus apprécié que mes écrits, ce qui laisse tout de même rêveur…
Pour le reste, l’hiver est toujours là (moins sept degrés hier matin et verglas généralisé le soir) mais la planète se réchauffe, dit-on. En tout cas cela chauffe beaucoup en Tunisie et en Egypte où les peuples se soulèvent. On ne comprend d’ailleurs pas pourquoi ils ne se sont pas soulevés plus tôt, écrasés qu’ils étaient par des dirigeants plus soucieux de plaire à l’Occident que de s’occuper du bien-être de la population. Reste à savoir à qui ces révolutions vont profiter. Il ne faudrait pas que la chute de ces régimes forts ouvre la voie à un libéralisme économique aveugle qui plongerait pas mal de personnes dans une misère noire tandis que quelques-uns tireraient avantageusement leur épingle du jeu.
En attenant cela fera réfléchir les dirigeants du monde entiers, qui se rendront compte que leur pouvoir peut être précaire et que la base qu’ils méprisaient allégrement peut se révolter. Certes la situation est meilleure chez nous ou en tout cas moins explosive (car les caisses de chômage, de maladie-invalidité et les retraites permettent de ne pas mourir de faim), mais l’écart se creuse tout de même tous les jours entre une bourgeoisie d’argent qui tire les ficelles et le reste de la population qui s’appauvrit de manière irréversible. Entre une droite sarkozienne autoritaire et fière d’elle-même et une opposition de gauche bientôt représentée par le financier du FMI, DSK, l’avenir me paraît assez sombre.
Quand l’élastique sera trop tendu, il se pourrait bien que peuples d’Occident descendent eux aussi dans la rue. Malheureusement, faire tomber un dirigeant ou un gouvernement ne sert plus à grand chose puisque l’économie restera mondiale et qu’il faudra bien se plier au dictat de la haute finance et des spéculateurs. A moins que la révolte ne se transforme en révolution et qu’elle devienne mondiale elle aussi … Mais ce n’est pas demain la veille.

09:58 Publié dans Actualité et société, Blogue | Lien permanent | Commentaires (7)
18/12/2010
Pause
Après une année de bons et loyaux services, Marche romane prend ses quartiers d’hiver, ce qui signifie que ce site entre en hibernation pour quelque temps. J’ai envie de me plonger tout entier dans le silence des livres. Mon texte « Obscurité » a été écrit pour ainsi dire en direct et sous le regard de tous, aussi ai-je besoin maintenant d’un peu de recul. Internet est un outil fantastique, pour autant qu’on vienne y exprimer ce qui émane du plus profond de soi, sinon on risque de tomber dans un inutile bavardage, ce que je ne voudrais pas. Il est donc nécessaire de se ressourcer de temps à autre et telle est bien mon intention. Lorsque dehors tombe la neige, on n’a point trop envie de parcourir les routes, fussent-elles virtuelles, mais plutôt de rester bien au chaud et d’ouvrir un livre. Il suffit alors de tourner les pages pour retrouver aussitôt un autre voyage, celui où nous emmènent les écrivains. Rêver et plonger dans l’imaginaire peut être vu comme une philosophie de vie, une manière comme une autre d’échapper à ce monde agressif dans lequel il nous fait pourtant bien vivre.
A bientôt donc. Dans une autre année, probablement.

07:00 Publié dans Blogue | Lien permanent | Commentaires (5)
13/12/2010
Dernière rose
Je me souviens d’un monde où les roses fleurissaient en novembre. C’étaient des fleurs étranges qui gardaient la mémoire de nos amours. Elles étaient belles dans leur ardente robe rouge et avaient en elles-mêmes une grâce et une splendeur incomparables.
Quand il avait plu, elles semblaient fort fragiles, avec une goutte d’eau qui parfois glissait le long de leurs pétales avant d’aller s’écraser dans la boue du chemin. Mais elles, sur leur branche, paraissaient attendre les jours d’un printemps improbable qu’elles ne verraient jamais.
Parfois, j’effeuillais d’un doigt délicat leurs pétales tendres, qui s’ouvraient sans résistance, laissant voir un instant les souvenirs enfermés là, au cœur des ténèbres.
Puis, quand venait décembre, un manteau de neige recouvrait soudain les roses. Immobiles, figées dans l’instant, elles semblaient n’exister qu’en rêve, comme si elles nous avaient déjà quittés.
De temps en temps, une mésange venait se poser sur une branche et, sous l’offense, celle-ci ployait légèrement. D’un bec rageur, l’oiseau effronté picorait alors le givre qui recouvrait la rose, la meurtrissant dans son rêve éternel.
Plus tard, bien plus tard, quand venait le printemps, la reine des fleurs, desséchée et flétrie, pendait lamentablement. Ballotée au gré des vents de mars, elle finissait par tomber sur le sol humide, où elle disparaissait bientôt sous des pas anonymes.
Il ne restait plus rien alors de la rose, rien qu’un parfum évanoui au plus profond de notre mémoire, rien qu’un souvenir oublié de nos amours adolescentes.
12:30 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature
08/12/2010
Le vent de l'Histoire
Le monde est à genoux
Terrassé par le vent de l’Histoire.
Dans les livres des Dieux,
Un poème s’est écrit
Avec des lettres de feu.
Quelque part tombe la foudre
Et dans les jardins d’Orient
Une jeune fille rédige des lettres d’amour.
Plus loin, le long des fleuves,
Courent des enfants nus,
Tandis que sur les plages de l’océan
Quelqu’un a tracé ton nom sur le sable infini.
Regarde les nuages dans le ciel,
Cet alphabet mystérieux…
On dirait un rêve qui se dessine
Puis qui se transforme en un tableau changeant
Jusqu’à figurer la carte de mondes inconnus.
Dans le lointain, les forêts du Sud n’en finissent plus de brûler
Et un épais nuage de fumée occulte tous les soleils.
Maintenant c’est la nuit
La nuit profonde des origines
Et le souvenir revient de guerriers incroyables
Qui pillaient les villages et emportaient nos femmes.
Plus loin encore, sur les plages de l’océan,
Des vagues s’inversent et s’échouent
Dans le bruit des tempêtes et du vent,
Gerbes d’écume qui gémissent en glissant,
Grondement rocailleux des rochers déchirés.
Ici finit l’Histoire, ses batailles et ses défaites
Ici finit le monde, dans l’éternité d’outre-mer.
07:00 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature
06/12/2010
Vases communicants, bilan.
Le principe des échanges, tels que je l’ai pratiqué vendredi dernier, semble prendre de l’ampleur. Je ne sais si c’est un bien ou un mal, car si chacun bouge d’une case et va écrire chez son voisin, les lecteurs vont finir par s’y perdre. Mais quelque part, cela me semble renouveler le processus de création et tous ces textes qui s’échangent sans qu’on sache trop finalement qui les a écrits, me fait penser à la littérature orale primitive, celle des aèdes grecs ou celles de nos chansons de gestes moyenâgeuses. Internet devient dès lors un immense réservoir de paroles.
Le problème sera de discerner là-dedans les textes forts. Certains diront que tout le monde peut désormais écrire et y aller de son petit texte et donc que le tri que faisaient les éditeurs ne se fait plus. D’autres diront au contraire que beaucoup de ces fameux éditeurs ont failli à leur tâche en publiant tout et n’importe quoi et donc que les textes de qualité qu’ils ont écartés peuvent s’exprimer ici.
Au-delà de cette polémique, je dirai surtout que derrière tout cela il y a le plaisir d’écrire et que cette écriture qu’on croyait morte et qu’on nous annonçait comme telle (civilisation de l’image, de la télévision et du téléphone, primauté de l’oral sur l’écrit, etc.) renait à une vitesse incroyable. Écrire et être lu, que demander de plus, finalement. ?.
En attendant, on en parle des échanges de vendredi ici : http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article2366
Et encore là : http://brigetoun.blogspot.com/2010/12/comme-presque-nombreux-etaient-les.html
Barrage de Serre-Ponçon, sur la Durance
15:46 Publié dans Blogue | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
05/12/2010
Vacances de rêve
Il y a quelque temps, les éditions Antidata recherchaient des textes pour réaliser un petit recueil de nouvelles sur le thème de la musique. Il s’agissait donc d’un recueil collectif. Malheureusement, j’étais fort occupé par la rédaction d’Obscurité et je n’avais pas trop le temps d’imaginer une histoire originale. De plus, il m’aurait été très difficile de « sortir » de mon texte (Obscurité) tant j’étais en phase avec les personnages de mon récit. Par contre, je venais d’écrire un chapitre où je parlais justement de musique. Les lecteurs fidèles s’en souviennent forcément, c’est l’épisode au cours duquel l’enfant rencontre dans une clairière une jeune fille inconnue qui joue du violoncelle. Pour les lecteurs moins fidèles (honte à eux) c’est ici.
Pris par le temps, j’ai donc repris cette histoire de la musicienne et l’ai intégrée dans un autre contexte. Cela a donné le texte qui suit, dans lequel j’ai mis en gras les passages modifiés (pour les lecteurs pressés). Comme il fallait s’y attendre, cette histoire n’a pas été retenue par les éditeurs, qui sortent maintenant leur livre (dans lequel nous retrouvons une connaissance, le désormais "célèbre » Bertand Redonnet).
Si je remets cette nouvelle ici, c’est pour montrer comment un même texte peut prendre des connotations différentes selon le contexte dans lequel on l’insère. Nous retrouvons donc indirectement notre débat sur les étapes successives par lesquelles passe un manuscrit (corrections importantes ou pas de corrections, etc.)
............................................................................

Vacances de rêve.
Il pleuvait ce jour-là et ses parents l’avaient amené au musée. Lui, avec ses douze ans, cela ne l’intéressait pas trop d’arpenter des kilomètres de galeries pendant des heures, aussi s’ennuya-t-il beaucoup. Un tableau, cependant, retint son attention. C’était une peinture du XVI° siècle qui représentait une jeune femme en train de jouer de la musique. Il n’aurait pu dire quel instrument elle tenait en main, mais il fut frappé par l’expression de son regard, qui semblait en extase. En plus, il y avait un tel recueillement dans son attitude, une telle concentration, qu’il sentit qu’il se passait là quelque chose. Cette jeune fille, il aurait bien aimé la rencontrer en vrai et l’écouter, pour percer le mystère qui semblait émaner de la musique elle-même, domaine qui lui était complètement étranger. En plus elle était belle, délicieusement belle, avec une mèche de cheveux noirs qui retombait sur son front et elle avait de longs doigts fins et délicats. Quelque part dans son subconscient, il assimila donc la beauté féminine et l’art musical. Puis il oublia le tout.
Quelques mois plus tard, cependant, alors qu’il était en vacances dans la Creuse et qu’il s’était enfoncé dans une forêt particulièrement profonde, il crut entendre de la musique. Cela paraissait tout à fait incroyable en cet endroit ! Pourtant, plus il avançait en direction d’une clairière qu’il devinait à travers le feuillage, plus il lui semblait percevoir des notes. Était-ce son imagination qui lui jouait des tours ? Non, ce n’était pas possible… Il s’approcha donc lentement de la fameuse clairière et là, dissimulé dans les fourrés, il vit la plus belle chose qu’il lui eût jamais été donné de voir.
(...) Tout en continuant à écouter cette musique envoûtante, il se dit que c’était quand même bien étrange d’assister à un tel spectacle au milieu des bois. Il y avait là quelque chose d’absolument insolite, c’était le moins que l’on pût dire. Et que faisait cette adolescente, seule, en cet endroit ? D’où venait-elle ? Et puis, surtout, quel âge pouvait-elle bien avoir ? Quinze ans, seize ans ? Il n’avait aucune réponse à ses questions, ce qui le désespérait.
A la fin, la jeune musicienne arrêta de jouer. Elle regarda autour d’elle et soupira. Ensuite, elle rangea son instrument dans une housse protectrice et l’emporta tant bien que mal à travers la clairière, puis disparut. Aussitôt, un grand vide et un grand silence se firent dans le cœur de l’enfant et c’est à contrecœur qu’il rentra chez lui. Q’aurait-il encore pu faire, tout seul là au milieu des bois ? (...)
Cependant, il voulait la revoir ! Il ne pensait même qu’à cela … C’est pourquoi, le lendemain, à peine avait-il avalé la dernière miette du déjeuner, qu’il s’enfuyait déjà vers la forêt. (...) Quand il arriva à la clairière, De son observatoire, il put enfin voir son visage. Il en resta figé sur place, tant celui-ci lui parut charmant. (...) Il grava dans sa mémoire ses traits réguliers et se promit de les comparer avec ceux du fameux tableau, qui le hantaient toujours. Il nota également qu’elle avait un air pensif, un peu triste, un peu rêveur, qui correspondait bien avec la mélodie qu’elle jouait et cela l’émut fortement. A la fin, comme la veille, la jeune musicienne rangea son instrument et s’achemina vers l’extrémité de la clairière. L’instant d’après, comme un fantôme, elle s’était volatilisée. Il rebroussa donc chemin, mais se promit de revenir encore.
Le jour qui suivit, comme il était en avance, il se mit à attendre patiemment à son poste. Une heure passa, puis deux, puis trois. Malheureusement, la clairière resta désespérément vide. (...) A la fin, le soleil rougeoyait déjà à l’horizon quand il se décida à quitter les lieux, la mort dans l’âme. La belle inconnue n’était pas venue… Existait-elle, seulement ou n’était-elle que le fruit de son imagination ? Allait-il revenir encore une fois ? Bien sûr qu’il allait revenir ! Qu’aurait-il pu faire d’autre ? (...) (...) (...)
Le lendemain, il s’achemina donc une nouvelle fois vers la clairière enchantée. Il approchait de l’endroit fatidique, le cœur un peu serré, quand il entendit dans le lointain la musique plaintive de l’instrument. Elle était donc là ! Une vague de bonheur le submergea aussitôt. A pas de loups, il se glissa derrière les troncs pour parvenir à son lieu d’observation habituel. La jeune fille était bien là, en effet, mais elle avait changé de place ! Elle se trouvait aujourd’hui beaucoup plus près de la lisière de la forêt. Autrement dit, elle n’était qu’à une dizaine de mètres de lui, ce qui, à la fois le combla de bonheur et le paralysa complètement. Qu’est-ce qu’elle était belle ! Cette fois il la voyait bien (...) et il remarqua ses seins qui pointaient à travers le tee-shirt. (...) Il en avala sa salive et resta comme paralysé. (...) C’est qu’en plus elle semblait vivre dans un univers tellement différent du sien ! Jouer de la musique comme elle le faisait, c’était fabuleux. Elle devait sûrement être riche et vivre dans un château, ce n’était pas possible autrement. Il imaginait des pièces immenses, avec des lustres de cristal pendus au plafond, des cheminées monumentales en marbre rose, des escaliers en pierre blanche qui semblaient monter directement vers le ciel, des tables de bois noir bien ciré, avec des corbeilles qui débordaient de fruits exotiques, et en plus de tout cela, une armée de domestiques qui s’empressaient de tous côtés. Dans une pièce merveilleuse aux fenêtres ogivales et aux vitraux colorés, elle devait apprendre la musique avec des professeurs de renom, descendus de Paris ou de Vienne tout exprès pour elle. Ou bien elle jouait seule, cherchant l’inspiration, et relevait parfois la tête en contemplant, rêveuse, le jeu de la lumière sur les vitraux. (...)
Il la regarda encore, la contempla, plutôt. Elle tenait son instrument avec une aisance déconcertante. (...) Elle venait de terminer un morceau et en entamait un autre, encore plus beau, encore plus aérien. Il lui semblait voir les notes s’envoler comme des oiseaux et aller se perdre la-bas dans les feuillages. La mélodie était prenante, attendrissante même et n’était pas dépourvue d’une certaine tristesse. (...) C’était véritablement l’âme de la jeune fille qui s’exprimait là et plus il écoutait cette musique et plus il avait l’impression de la connaître et même de la comprendre, elle. Car ce qu’elle disait, là, avec ses notes, c’est qu’elle était seule, un peu trop seule pour être heureuse. Elle disait aussi que le monde était beau, qu’elle appartenait à ce monde, mais qu’il lui manquait un petit quelque chose pour que tout fût parfait. Le fait d’exprimer ainsi cette mélancolie finissait par rendre celle-ci presque attendrissante. Au lieu de pleurer sur son sort, la musicienne disait simplement ce qu’elle ressentait au plus profond d’elle-même et du coup, parce qu’elle était parvenue à dire cela, sa propre tristesse se changeait en beauté. L’enfant venait de découvrir le langage musical et il sut là, au bord de cette clairière, qu’il n’oublierait jamais cette leçon. (...)
Mais soudain, après un dernier accord plus long et plus langoureux encore que les autres, la mélodie prit fin. Le silence qui suivit fut impressionnant, tout rempli encore des timbres musicaux qu’on venait d’entendre. La jeune fille alors se redressa et tourna la tête dans sa direction. Bien qu’il fût en partie dissimulé dans les branchages, leur regard se croisèrent. Il resta paralysé. Trop tard pour se sauver ou même pour faire un pas en arrière ! Elle lui sourit « Tu as aimé ce morceau ? » demanda-t-elle comme s’ils s’étaient toujours connus. Il ne sut que répondre et ne répondit donc rien, restant planté là comme un nigaud alors qu’il avait envie de dire et même de crier que c’était là une musique magnifique et qu’il n’avait jamais rien entendu de plus beau. Un peu décontenancée par son mutisme, elle n’en continua pas moins à lui sourire. « Allez, viens, ne reste pas caché là, tu peux venir près de moi pour écouter, si tu veux. »
Alors il sortit de sa cachette car il n’y avait plus d’autre solution. Il se sentait pris en faute comme un voleur. (...) Il aurait dû reculer et s’enfuir, mais il n’en avait plus ni la force ni le courage. Cette voix féminine l’avait complètement paralysé. Il fallait dire qu’elle était douce, incroyablement douce, comme celle d’une mélodie. Elle le regarda. « Ce n’est pas la première fois que tu viens, hein ? Tu aimes la musique ? Tu joues d’un instrument, toi aussi ? » (...) Bien sûr que non, qu’il ne jouait pas d’un instrument ! Il se sentait vraiment idiot, là à côté d’elle. Si au moins il avait pu l’impressionner et lui annoncer qu’il maîtrisait le piano ou la flûte traversière, il aurait eu une chance de se faire remarquer et d’être accepté, mais non, il n’avait rien à dire, il ne jouait d’aucun instrument, pas même du tambour ou de l’harmonica. (...)
Son interlocutrice, pourtant, continuait à se montrer bienveillante avec lui. Il se dit qu’elle devait avoir le fond gentil pour manifester autant de patience avec un idiot tel que lui, qui ne savait répondre que par oui ou par non. Alors, pour rompre cette situation embarrassante et sortir de son malaise, il se lança en avant et parvint à formuler une phrase entière : « Qu’est-ce que c’est pour un instrument que vous avez là ? » Évidemment, il avait à peine posé cette question qu’il en perçut toute l’incongruité et tout le ridicule. S’enquérir de l’instrument lui-même, c’était avouer son ignorance totale dans le domaine de la culture en général et dans celui de la musique en particulier. (...)
Il resta donc là à attendre que le ciel lui tombât sur la tête, tout en avalant une nouvelle fois sa salive. Allait-elle éclater de rire ? Allait-elle le congédier d’un geste brusque ? Allait-elle se fâcher devant autant d’ignorance ? Et bien non. De sa voix douce, elle répondit calmement que cet instrument était un violoncelle et elle se mit patiemment à lui en montrer les différentes parties. Elle lui montra la pique, qui permettait de fixer l’appareil au sol, tandis qu’autrefois on le coinçait entre ses jambes. Elle parla de l’archet, elle lui expliqua la technique des cordes frottées et celle du « démanché », qui n’était autre qu’un déplacement de la main gauche le long du manche afin d’obtenir des notes plus aigües. Il en resta saisi d’admiration.
Son étonnement redoubla quand la jeune fille lui proposa de jouer lui-même. Il se mit donc devant l’instrument et elle se mit derrière lui. Elle avait un parfum envoûtant qui le fit chavirer aussitôt. Ensuite, elle prit sa main pour la positionner correctement sur le manche. Ah ! Comme le contact de cette main était agréable ! La belle inconnue avait la peau douce et sa main était toute chaude… Il en fut complètement troublé. Cependant, il n’eut pas le temps d’analyser les sentiments qui l’agitaient car déjà elle lui confiait l’archet. Son corps était tout contre le sien et c’était délicieux. Elle se pencha davantage encore pour tenir sa main droite et guider le mouvement. Le violoncelle émit un cri aigu, suivi d’un grognement rauque. Ils se mirent à rire tout les deux, trouvant là une première complicité. On recommença et ce fut bien meilleur. Quelques notes plus ou moins correctes s’envolèrent dans les airs. C’est elle qui faisait tout, bien entendu, mais cela n’avait aucune importance. L’instant était délicieux. (...)
A un moment donné, elle changea de position et vint se placer à sa droite. Pour tenir l’archet, elle se pencha donc devant lui et là il crut complètement défaillir. Ses beaux cheveux noirs venaient toucher sa figure et dans l’échancrure du tee-shirt un peu entrebâillé de par sa position, il entrevit ce qu’il n’aurait jamais cru voir, la naissance de ses deux seins. Sans cesse, ses yeux revenaient s’attarder à cet endroit, pendant qu’elle guidait sa main et que le violoncelle se mettait à gémir de plus en plus fort.
Mais déjà l’obscurité tombait et il fallait partir. Reviendrait-elle le lendemain ? Non, malheureusement, car c’était son dernier jour de vacances et elle rentrait à Paris… Il crut que l’univers allait s’effondrer autour de lui. Il la regarda, consterné. Elle lui sourit. « Allons, ne fais pas cette tête-là, tu auras encore bien d’autres occasions d’apprendre à jouer du violoncelle ! » Il n’y avait plus qu’à se dire au revoir. Il la fixa longuement, de la même manière dont, autrefois au musée, il avait regardé la musicienne du tableau. La jeune fille, un peu intimidée quand même, s’approcha pour lui faire la bise, mais sa lèvre vint effleurer le coin de la bouche du garçon. Quelle intensité il y avait dans ses yeux quand elle s’écarta ! Quel trouble il y avait dans les siens ! Sans plus la regarder, il se précipita en courant vers la forêt et c’est à peine s’il l’entendit qui criait « Bonnes fins de vacances »
Il s’arrêta dans la partie la plus sombre du bois. Son cœur battait à tout rompre. Etait-ce seulement d’avoir couru ? Il écouta le grand silence qui l’entourait et ferma les yeux. L’image de la musicienne peinte sur le tableau surgit devant lui avec une netteté incroyable. Avait-elle vraiment existé ou était-elle sortie de l’imagination de l’artiste ?
01:39 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature
03/12/2010
Bertrand Redonnet, "Le bourgeois, la mort et le manant"
Vous connaissez le principe des vases communicants ? C’est tout simple : l’auteur d’un blogue invite une connaissance à venir discourir sur son site tandis que lui-même va prendre possession du site laissé libre. Alors voilà, aujourd’hui, j’ai remis les clefs de Marche romane à Bertrand Redonnet, qui doit être tout heureux de quitter un instant sa Pologne enneigée et ses moins vingt-cinq degrés pour venir se réchauffer un peu plus à l’Ouest. Pas de chance, il y a aussi de la neige ici, mais il ne fait que moins huit et il appréciera, j’en suis certain.
Il est inutile de vous présenter Bertrand. Si vous ne l’avez pas lu ici, en commentaire, vous l’aurez entendu tempêter depuis son blogue d’exilé qu’il a consacré aux mots. Et ses mots, justement, sonnent généralement fort car il a su garder en lui, malgré les années qui défilent et qui lui ont quelque peu blanchi les cheveux, il a su garder, dis-je, cet esprit de révolte (contre toutes les tromperies de la société) qu’on possède généralement quand on a dix-sept ans. Et ses propos, contrairement à ce qu’affirmait Rimbaud, sont toujours très sérieux…
Je vous laisse en sa compagnie. Quant à moi, je me sauve…
-----------------------------------------------------------------------------------------
C’est la fête aujourd’hui aux vases communicants : Je vais passer chez un ami…Le saluer. Nous nous connaissons depuis plus de trois ans. Je pousse la porte de Marche Romane…J’appelle. Personne….La maison est vide mais le feu crépite et la table est servie. Que faire ? Attendre là ? Mais il est où, l’ami Feuilly ? Et tout à coup j’y repense : Il est chez moi…Je l’avais invité. Merde ! Quel âne bâté je fais ! Bon…Il est tard…J’étais venu pour laisser un mot…Un texte que j’avais écrit il y a quelques années et puis que j’avais abandonné. Je le lui laisse sur la table. J’espère qu’il me laissera aussi un mot. Chez moi. Comme ça, nous ne nous serons croisés qu’à demi. De toute façon entre nous, c’est toujours une histoire de mots. Bertrand

Le bourgeois, la mort et le manant
Quentin vit le soleil se lever par-dessus la forêt. Trois chevreuils au détour d’une allée détalèrent devant lui et, d’un bond, sautèrent sous le couvert des taillis. L’herbe des allées était blanche d’une moindre gelée et craquait sous la chaussure.
On était le matin du 28 décembre.
Quentin marchait d’un pas désordonné, pressé de constater l’état dans lequel la tempête de la nuit aurait laissé son chantier.
Ses coupes se situaient au cœur d’une vaste propriété de plus de quatre cent hectares, entièrement ceinte d’une clôture grillagée. Aussi l’hiver, par respect pour les allées détrempées, laissait-il sa camionnette au portail d’entrée et se rendait-il à pied à travers la forêt jusqu’à sa coupe du moment, le plus souvent à deux ou trois kilomètres de distance.
Chemin faisant, il furetait les sous-bois, tâchait de surprendre les animaux sauvages et prenait le temps d’examiner les empreintes de chevreuils ou les dévastations des sangliers de la migration d’automne.
A la saison, il musardait aussi pour repérer le passage des lièvres et des lapins. Si les indices lui paraissaient probants, une vieille corde de guitare était alors disposée en collet. Dès potron-minet et très discrètement, il faisait alors de longs détours dans les sous-bois pour aller lever ses pièges.
Car il y avait danger. Le propriétaire des lieux, hobereau de village, bourgeois fesse-mathieu, ladre obsédé par la propriété, s’il l’eût surpris, aurait assurément voulut dénoncer la convention d’exploitation qui le liait à Quentin.
A grand regret sans doute car le bonhomme, âpre aux gains, recevait pour les replantations une subvention substantielle et la récolte annuelle de Quentin lui procurait, en plus, un joli petit dividende.
N’empêche qu’un article du contrat, peut-être par intimidation, stipulait bien que toute action de chasse, à plus forte raison de braconnage, était absolument prohibée et même, idiotie suprême de l’hystérie accaparatrice, la cueillette des champignons, le ramassage des escargots, des fraises des bois, des noisettes, des fleurs sauvages, dont en premier lieu les orchidées.
La transgression systématique de ces interdictions - sauf celle s’appliquant aux orchidées - constituait pour Quentin un double plaisir : Il mettait un point d’honneur à « voler le voleur ».
Une fois même, il s’était emparé d’un chevreuil.
C’était peu avant Noël. La journée avait été sombre et le brouillard flottait maintenant autour des arbres, enveloppant aussi les allées d’une humidité tremblante. Quentin avait mis la dernière main au chargement de son camion. Il se préparait à partir et se lavait les mains à l’eau rougeâtre d’une ornière. Dans le lointain depuis longtemps il entendait la chasse, les cris gutturaux des hommes, les aboiements rauques des chiens de meute, comme ceux de fauves mis en appétit et qui se racleraient la gorge et, de temps à autre, appel navrant de la mort aux abois, une corne.
Un frisson remua les broussailles alentour et les genêts s’écartèrent, sans bruit, avec douceur presque. Quelqu’un claudiquait là, tout près.
Quentin tressaillit et se retourna vivement. Une sombre silhouette s’était arrêtée aux abords de l’allée, qui respirait bruyamment.
Grelottant sur ses pattes écartées pour garder l’équilibre, le bas côté ensanglanté et l’œil qui dégoulinait de stupeur et d’effroi, un chevreuil fixait Quentin. Se voyant là perdue, la retraite coupée par cet homme immobile et qui le regardait en silence, avec la meute qui rugissait là-bas et la corne lancinante derrière les brouillards et les chasseurs hurlant, la bête ne bougea plus, regarda l’homme en pleurant de grosses larmes, pencha doucement la tête de côté comme si elle voulait d’un œil voir une dernière fois la couleur des nuages et du ciel, meurtrie autant par la fatigue de ses blessures que par le désespoir du combat perdu, plia les pattes, se mit lentement à genoux, éternua dans un soubresaut et se laissa choir enfin sur la boue du chemin.
Déjà la petite langue pendait des babines entrouvertes.
Quentin s’était précipité et avait jeté l’animal sur son chargement, entre les deux rangées de bois. Dans ses larges rétroviseurs il avait vu, tandis qu’il cahotait lentement sur l’allée, la meute écumante tourner en rond et rugir, là où était tombé le chevreuil.
Mathilde, sa compagne, avait préparé des civets et des sauces aux airelles et on avait festoyé entre amis pour Noël.
Mais Quentin n’avait goûté que du bout des lèvres et avait déclaré que c’était dégueulasse, trop fort, trop saveur de sauvage.
Peut-être revoyait-il, parmi les sauces, les morceaux de viande et les champignons, flotter les deux yeux du désespoir et de la mort.
07:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature
02/12/2010
Lecture du jour
Quand l'art atteint une plus grande perfection que la nature...
On trouve par escrit que Zeuxis, cet excellent peintre, ayant esté prié par quelques honnestes dames et filles de sa connoissance de leur donner le pourtrait de la belle Helaine et la leur representer si belle comme on disoit qu’elle avoit esté, il ne leur en voulut point refuser ; mais qu’avant d’en faire le pourtrait , il les contempla toutes fixement et, en prenant de l’une et de l’autre ce qu’il y put trouver de plus beau, il en fit le tableau comme de belles pièces rapportées, et en representa par icelles Helaine si belle qu’il n’y avoit rien à dire, et qu’il fut tant admirable à toutes, mais Dieu mercy à elles, qui y avoyent bien tant aydé par leurs beautez et parcelles comme Zeuxis avoit fait par son pinceau. Cela vouloit dire que de trouver sur Helaine toutes les perfections de beauté il n’estoit pas possible, encor qu’elle ait esté en extremité très-belle.
Brantôme, "les Dames galantes"
 Château de Richemont, demeure de Pierre de Bourdeille, dit Brantôme, dans le Périgord.
Château de Richemont, demeure de Pierre de Bourdeille, dit Brantôme, dans le Périgord.
15:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature
25/11/2010
Ecrire, dit-il. Oui, mais comment?
J’ai beaucoup réfléchi au dernier commentaire de notre ami Halagu sur l’écriture naïve, telle que Flaubert la définissait.
Dans les naïfs, Flaubert plaçait Homère et Montaigne, par exemple. Des gens qui exprimaient ce qu’ils avaient à dire, sans trop se soucier de ce qu’on avait écrit autour d’eux ou avant eux et qui, avec un langage simple, non étudié, parvenaient à exprimer leurs idées. Leur force est là. Ils disent ce qu’ils ont à dire et du coup ils atteignent leur but.
A côté des naïfs, Flaubert admirait aussi les classiques, qui eux parvenaient à une sorte de concision et à un équilibre certain. Quant aux contemporains (en gros les romantiques), Flaubert les rejette car ils s’épanchent sans arrêt et tournent au sentimentalisme.
En tant qu’auteur, Flaubert essaie donc de concilier la force du message des naïfs avec la force du style des classiques. Et ce n’est pas facile, assurément. D’autant qu’il se rend compte que sa chronologie des écrivains n’est pas cohérente et que quelqu’un comme Hugo, bien qu’il soit romantique et contemporain, est aussi un naïf. Pris par l'urgence de son message, Hugo n'a pas le temps de s’interroger sur son style. Il écrit.
Néanmoins il y a une chose triste, c'est de voir combien les grands hommes arrivent aisément à l'effet en dehors de l'Art même. Quoi de plus mal bâti que bien des choses de Rabelais, Cervantès, Molière et d'Hugo ? Mais quels coups de poings subits ! Quelle puissance dans un seul mot ! Nous, il faut entasser l'un sur l'autre un tas de petits cailloux pour faire nos pyramides qui ne vont pas à la centième partie des leurs, lesquelles sont d'un seul bloc (correspondance à Louise Colet).
Dès lors, le naïf travaillerait « en dehors de l'Art même » tandis que l'artiste (Flaubert) se bornerait à « faire du style ». Voilà de quoi décourager notre bon Normand qui passe des heures à modifier une phrase et à trouver le mot juste. Le génie, lui, se contenterait de suivre son tempérament sans penser à rien d’autre qu’à son message. En un mot, il n’a pas de style, mais n’en a pas besoin.
Flaubert classe donc dans ces génies Rabelais, Cervantès, Molière (bien que classique) et Hugo (bien que contemporain) Du côté des artistes (qui donc ne sont ni naïfs, ni classiques), il place par exemple Horace, La Bruyère et lui-même. Ceux-là recherchent la perfection du langage, mais atteignent bien difficilement la vérité.
D’où sa fameuse phrase : « Quel homme eût été Balzac, s'il eût su écrire ! »
Qu’en penser ? A trop travailler une œuvre, on risque de la rendre artificielle et de s’éloigner de ce que l’on voulait signifier au départ. Inversement, on dit à juste titre que le génie n’existe pas et que tout est dans le travail. Quant à Céline, il s’exprimait ainsi :
Des écrivains, ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas. Les histoires, y’en a plein la rue des histoires. J'en vois partout n'est-ce pas des histoires, plein les commissariats, plein les correctionnelles, plein votre vie, tout le monde a une histoire et mille histoires...
Des écrivains comme René Char ou Francis Ponge ont assurément porté leur attention sur le style. Tout est dans le jeu sur la langue et les mots. Ils peuvent même être parfois obscurs ou en tout cas difficiles à comprendre. Personnellement, je les trouve un peu froid, mais cette opinion n’engage que moi.
Par contre, quelqu’un comme Philippe Jaccottet me semble concilier à la fois la recherche sur la langue (trouver le mot juste) et l’expression du sens et de la sensibilité. Ce qu’il dit m’émeut et en même temps j’ai conscience que les termes qu’il emploie sont exactement ceux qu’il fallait employer.
On dit aussi que tant qu’on veut faire de la littérature, on n’en fait pas. C’est quand on croit ne plus en faire qu’on en fait. Cela se comprend. Si je m’efforce d’employer des subjonctifs imparfaits ou si je ne m’exprime qu’au passé simple, pour faire bien, je suis surtout scolaire et ennuyeux. Quand j’oublie tout cela et que je parle simplement, pour atteindre ce que j’ai à dire (avec, pourquoi pas, des dialogues, des interjections, du langage parlé etc.), mon texte devient plus fort, je captive et on m’écoute.
Quelqu’un comme Giono conciliait les deux. Il y a des passages avec un vocabulaire fort riche, des phrases très recherchées et puis subitement on tombe dans des dialogues en langage parlé, qui font « vrai ».
Prenons maintenant quelqu'un comme Daudet et sa chèvre de Monsieur Seguin. Il aurait pu être ennuyeux à mourir en nous contant cette histoire d’une chèvre échappée de son enclos (c’est que le sujet est mince en soi). Mais, non, il parvient à nous captiver par la manière dont il rend la situation :
Ah ! qu'elle était jolie la petite chèvre de M. Seguin ! Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande ! Et puis, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle. Un amour de petite chèvre !
Le tout est de savoir si Daudet s’exprime ainsi naturellement (s’il est un naïf) ou si son texte est le fruit d’un long travail de correction. Le principal, pour nous lecteurs, c’est que cela semble naturel et aller de soi.
07:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (52) | Tags : littérature
22/11/2010
Avenir
« Obscurité », ce long récit, est terminé. Ce fut un beau voyage. Aujourd’hui, c’est Marche romane qui est en voyage, et c’est ici : http://nondenon-webzine.blogspot.com/
07:00 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (3)
20/11/2010
Bilan sur l'écriture d'Obscurité
Quel bilan convient-il de dresser après cette expérience originale que fut la rédaction d’Obscurité ?
Tout d’abord, rappeler qu’au départ il ne s’agissait que d’une nouvelle, l’actuel chapitre un, avec l’enfant apeuré dans la cave. On se souvient que ce sont les lecteurs qui ont insisté pour que je poursuive, alors que de mon côté tout ce que j’avais à dire était déjà exprimé.
J’ai donc relevé le défi, un peu par jeu, un peu pour leur faire plaisir, mais surtout pour satisfaire mon propre plaisir d’écrire. Au départ, je n’imaginais évidemment pas que mon texte prendrait une telle ampleur. Je pensais à cinq ou six chapitres, sans plus. Et puis voilà. J’ai eu la chance de trouver un fil conducteur (le voyage), qui me permettait à la fois de parler des paysages traversés et d’ajouter une petite intrigue à chaque épisode. Je veux dire par-là qu’il n’y avait pas de plan d’ensemble, je ne savais absolument pas où j’allais aller.
Chaque chapitre était donc plus ou moins fermé sur lui-même. J’inventais un incident que je développais et généralement la fin du chapitre restait ouverte, suscitant la curiosité des lecteurs. Souvent, je me suis trouvé entraîné beaucoup plus loin que prévu. Par exemple, quand nos héros partent à Limoges pour trouver une clef, je croyais traiter cela en un chapitre. Mais voilà, un incident en a amené d’autres. Pauline a failli se faire écraser en rue, puis il y a eu l’accident du sanglier (une route peu fréquentée, le soir…). Comme l’enfant était à l’écart, en train de regarder la pauvre bête qui agonisait, la mère se retrouvait seule sur la route et dans le noir. D’où l’idée de l’agression, ce qui a amené la fuite précipitée en voiture et la nuit passée dans les bois, etc.
Au début, les chapitres étaient de plus ou moins 8.000 signes (bonne longueur pour lire un texte sur écran), mais petit à petite et malgré moi ils se sont allongés (plus de 10.000 signes, parfois 12.000). Heureusement, il y avait les photos pour aérer un peu le texte.
La seule chose dont j’ai assez vite été certain, c’est que l’histoire finirait mal et qu’elle finirait par un accident de voiture dans le Verdon. Mais moi, à ce moment-là, j’étais dans la Creuse. En dehors de cet accident du Verdon, tout a été laissé au hasard. Bien souvent ce sont les personnages eux-mêmes qui m’ont guidé (les souvenirs de la mère à Bergerac ou à Beynac par exemple). J’espère que l’ensemble ne donne pas une impression de décousu, c’est le risque. Evidemment, on est pris par l’action et on a envie de connaître la suite, ce qui fait un peu oublier le manque de structure de l’ensemble.
Les lieux géographiques cités sont généralement connus de moi, ce qui était une force pour en rendre l’atmosphère. A part Limoges, où je ne suis jamais allé et la plage des Landes sous la tempête, j’ai visité et même logé à Beynac, Hendaye, St Julien d’Arpaon, etc. C’était aussi pour moi l’occasion de renouer avec mes souvenirs, certains fort éloignés et remontant à l’adolescence. Les chouettes de La Courtine sont réelles. Je n’ai jamais entendu autant d’oiseaux de nuit que dans cet endroit. Evidemment, ici, le cri de ces chouettes dépasse l’anecdotique pour prendre une autre dimension (la chouette voit dans l’Obscurité à la différence de l’enfant ; son cri est inquiétant, etc.)
Qu’en est-il des commentaires ? Le texte a bien pour origine la volonté des lecteurs d’avoir une suite au chapitre un (qui ne s’appelait pas encore le chapitre un). Très vite le dialogue s’est installé en cours de rédaction. Cela a cependant coincé à un certain moment, quand des désaccords sont apparus (l’incident du bain de la mère : on quittait une histoire innocente pour entrer dans autre chose. On ne se concentrait plus sur l’enfant mais sur tous les personnages). J’ai tenu bon car je sentais que mon texte serait plus volumineux que prévu et que j’avais la possibilité de mettre tout les personnages en scène. Vers la fin de l’histoire, je me suis aussi fait plus discret dans mes réponses aux commentaires car chacun voulait me proposer sa propre manière d’envisager la suite et je ne voulais ni me laisser influencer, ni dévoiler ce que j’avais en tête. Le plus dur, c’est quand dans un commentaire je trouvais exactement ce que j’allais dire le lendemain (partir à l’étranger par exemple). J’avais un peu peur qu’on ne m’accusât de plagiat ou que mon roman ne devînt celui de tous. Car si j’ai innové en écrivant en direct, sans relecture de l’ensemble et sans possibilité d’aller rectifier des détails (je devais me contenter des situations dans lesquelles j’avais mis mes personnages et bien souvent je me suis demandé ce que j’allais faire pour les sortir du pétrin où ils étaient allés se fourrer), si j’ai innové, dis-je, en écrivant en direct, ce « roman » ne fut pas non plus une écriture collective et j’ai très vide mis des barrières. J’aurais été incapable de suivre les suggestions des lecteurs, qui m’auraient envoyé l’un à droite, l’autre à gauche au point que j’en aurais perdu le Nord.
Pour ma méthode de travail, elle est chaque fois la même et il en a toujours été ainsi. L’histoire (le thème plutôt) me trotte en tête pendant un ou deux jours. Je n’y pense pas volontairement ni systématiquement, mais à certains moments (en attendant un métro, en se brossant les dents) des idées viennent. Puis elles s’agencent petit à petit. A ce moment, j’ai donc mon plan pour l’épisode suivant. Je sais ce qui va se passer, mais cela tient en quatre mots. Quand je me mets à écrire, je développe ces quatre mots, c’est tout. Cela se fait alors facilement, mais il me faut donc en amont ces deux ou trois jours durant lesquels les idées, encore embryonnaires, germent, sans cela je ne suis incapable d’écrire. Une fois que tout est rédigé, il faut relire, mais je me contente souvent de corriger les fautes de langue, d’améliorer, de modifier, pour rendre une phrase plus harmonieuse, plus musicale. C’est là sans doute ma faiblesse, je ne corrige pas assez. Mais l’avantage, c’est que le texte, malgré ses imperfections, conserve sans doute une certaine fraîcheur.
Ce fut parfois un peu stressant de savoir que les lecteurs attendaient la suite, alors que le dernier épisode avait été posté un lundi par exemple, qu’on était déjà le vendredi et que je n’avais encore rien imaginé dans ma tête. D’un autre côté, je reconnais que sans cette pression derrière moi, j’aurais sans doute trouvé mille prétextes pour faire des choses plus urgentes et soi-disant plus importantes (la gestion des tâches quotidiennes). Merci donc à tous.
Pour votre information, Obscurité fait finalement 116 pages Word, des pages pleines évidemment. Il comporte 589.889 signes (espaces compris), ce qui n’est tout de même pas rien.
16:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature
15/11/2010
Obscurité (61)
07:00 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : littérature
12/11/2010
Obscurité (60)
00:28 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature
08/11/2010
Obscurité (59)
07:00 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature
04/11/2010
Obscurité (58)
« Comment çà, plus d’argent ? » demanda Pauline qui avait tout entendu. « Vous savez bien que j’ai dû payer la réparation de la voiture et qu’à la banque il m’a été impossible de retirer quoi que ce soit. Et si je me rends dans une autre banque, il y a de fortes chances pour que la police débarque à nouveau. J’ai donc de l’argent sur mon compte d’épargne, mais c’est comme si je n’en avais pas puisque je n’y ai pas accès. » « Qu’est-ce qu’on va faire alors ? » « En réalité, il me reste soixante-dix euros. Mais le réservoir de la voiture est presque vide et si on veut arriver jusqu’en Italie, il faudra bien garder cet argent pour faire le plein. Sinon, tout est fini.» « Mais comment est-ce qu’on va pouvoir rester sans manger ? » s’inquiéta encore la petite. « On va essayer de dormir quelques heures. Ce sera l’occasion de vérifier la véracité du proverbe « qui dort dîne ». Après on repartira en pleine nuit, pour ne pas attirer l’attention des patrouilles de gendarmerie. Car cette fois, l’alerte générale doit être donnée et à l’heure qu’il est ils sont sûrement tous à nos trousses. Le plus dur, cela va être de passer la vallée du Rhône. Ils vont surveiller les ponts sur le fleuve. » « Comment est-ce qu’on va faire alors ? » demandèrent les deux enfants en même temps. « Je ne sais pas encore très bien. Mais il faut absolument qu’on passe le Rhône. Après, on sera en montagne, on prendra les petites routes et on se dirigera vers l’Italie. »
(...)
07:00 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature