04/07/2013
Moby Dick (lecture)
Curieux que ce roman ait souvent été présenté comme un livre d’aventures, dont la version courte a été lue par beaucoup d’adolescents. Tout le monde connaît l’histoire de ce capitaine qui tente d’attraper une baleine. Le thème dépasse pourtant de loin ce simple fait. Tout ici, est symbolique et l’histoire racontée a quelque chose d’épique. On peut y voir la lutte du bien contre le mal, le cétacé sortant des abimes ayant tout d’un monstre inquiétant. L’approche de Melville est quasi mystique et la baleine tueuse incarne aussi le destin qui nous frappe, nous pauvres humains. Dès lors, la chasse que lui donne le capitaine n’est pas une simple chasse, mais une manière pour l’homme d’affronter son destin mortel et de le dépasser.
Les premiers mots du livre sont déjà révélateurs : « Appelez-moi Ismaël » dit celui qui va devenir le narrateur. Notons que ce « Call me Ishmael » a bien ennuyé les traducteurs, chacun se demandant comment il fallait interpréter ces trois mots.
-
Mon vrai nom n’est pas Ismaël, mais vous m’appellerez ainsi tout au long de ce récit (et le fait que dans le Bible ce soit le nom du fils d’Abraham, donne déjà un éclairage sur tout le roman. En effet, il s’agit de l’enfant qui a failli être sacrifié par son père pour obéir aux ordres de Dieu, mais qui fut finalement sauvé quand le père était à deux doigts d’exécuter l’ordre divin. Dans le roman, le futur narrateur sera le seul à échapper au naufrage du navire et à la mort)
- Peu importe mon nom, je suis avant tout un narrateur (manière de dire qu’on est ici dans une œuvre de fiction pure et que tout est inventé, même les prénoms)
- Appelez-moi familièrement par mon prénom, je vous y autorise. Après tout, nous sommes tous des humains, poursuivis par le même destin qui s’achèvera dans la mort
Un autre problème de traduction est celui de l’animal poursuivi. On parle souvent de baleine, de baleine blanche et même de poisson. Or la bête que le capitaine Achab poursuit est un cachalot et non une baleine au sens strict. En effet, la baleine (la baleine franche) possède des fanons qui lui permettent de filtrer le plancton dont elle se nourrit. Le cachalot, au contraire, est un prédateur muni de dents, qui plonge dans le fond des abysses pour capturer des calmars (y compris des calmars géants dont on ne connaît finalement l’existence que par les tentacules retrouvés dans l’estomac des cachalots capturés). La traduction « baleine blanche » est donc assez mauvaise car en français, la véritable baleine blanche, c’est le bélouga, qui est plutôt une sorte de dauphin et dont la taille modeste n’a rien à voir avec les grands cétacés. Oui, mais me direz-vous, le cachalot n’est pas blanc, il est noir. Certes, mais il faut donc comprendre qu’il s’agit d’un cachalot albinos, autrement dit d’un animal plus que rare, ce qui renforce encore le caractère exceptionnel et singulier de Moby Dick. Notons en passant le fait que ce monstre marin qui personnifie le mal est blanc, couleur traditionnellement associée à la pureté.
En anglais, le terme est « whale ». Dans le roman, il désigne parfois l’ensemble des grands mammifères marins, autrement dit les cétacés. A d’autres endroits, il désigne plutôt l’animal qui était capturé par les baleiniers (la baleine, mais aussi le cachalot). Enfin, quand Melville emploie le terme « whale », il pense en fait à « sperm whale », qui est le cachalot. Or la pêche au cachalot est évidemment beaucoup plus dangereuse que la pêche à la baleine, d’abord parce que cet animal peut atteindre vingt mètres de longueur mais surtout parce que, comme je l’ai déjà dit, il possède des dents (famille des odontocètes) et est agressif. En effet, il n’était pas rare de voir un cachalot briser les petites baleinières qu’on avait mises à l’eau pour le capturer.
Pourquoi, me direz-vous, les anglophones emploient-ils le terme « sperm whale » pour désigner le cachalot ? En effet, il existe des cachalots femelles ainsi que des baleines mâles. En, réalité, le nom « sperm whale » a son origine dans la substance laiteuse qui se trouve dans la tête impressionnante de l’animal (laquelle représente un tiers de son corps). Cette substance, appelée en français spermaceti ou blanc de baleines, fournissait un excellent combustible (meilleur que l’huile de baleine). Le terme vient du grec sperma, graine, et du latin cetus, baleine car on croyait autrefois qu'il s'agissait du liquide séminal de l'animal. En réalité, les scientifiques restent partagés sur l’utilité de cette substance. Certains pensent qu’elle pourrait assurer la flottabilité (en diminuant la température lors des plongées profondes, l’animal modifierait la densité du spermaceti, qui servirait alors de stabilisateur, ses cristaux étant devenus plus denses). D’autres pensent que ce spermaceti servirait plutôt à capter les ondes sonores, le son étant sans doute le seul moyen de se déplacer dans les abysses sous-marins plongés dans l’obscurité.
Il n’empêche, qu’en employant le mot baleine blanche, Giono a, à mon avis, commis une erreur lourde de conséquences. En effet, dans cet univers de marins, on ne rencontre que des hommes (la vie sur le bateau constitue d’ailleurs un microcosme exemplaire car le bateau de pêche reste coupé du monde de longs mois, parfois plusieurs années. Melville insiste d’ailleurs sur ce point. Alors que les bateaux de commerce font des escales pour charger ou décharger leurs marchandises ou pour se ravitailler en nourriture, les baleinières, dont l’activité consiste à sillonner sans arrêt les mers, sont équipées de tout le nécessaire pour ne pas devoir perdre leur temps à mouiller dans un port). Donc, les hommes restent entre eux sur le bateau pendant un ou deux ans sans accoster et leur univers est uniquement masculin. A partir du moment où le monstre surgi des profondeurs est du genre féminin, certains lecteurs francophones pourraient en tirer des conclusions erronées sur le message transmis par Melville. Cette erreur n’existe plus à partir du moment où on dit clairement que Moby Dick est un cachalot et qui plus est un cachalot mâle, ce que révèle sa taille et le fait qu’il vive seul et pas en bande.
Notons en passant que le lecteur du XXI° siècle a un peu de mal à accepter cette chasse à la baleine (ou au cachalot). Pour nous, il s’agit là d’une espèce sympathique en voie de disparition et qu’il convient de protéger. Pour Melville, au XIX° siècle, il n’en allait pas de même et la taille de ces cétacés comme le fait qu’ils plongent à des profondeurs incroyables en faisait de véritables monstres incarnant l’esprit du mal.
Maintenant, j’ai peut-être un peu vite accusé Giono de mauvaise traduction car quelque part le mot baleine est une sorte de générique qui englobe tous les cétacés et qui renvoie à des histoires mythiques comme l’histoire de Jonas, avalé précisément par une baleine. Melville fait d’ailleurs allusion à ce récit biblique, qu’il explique. Jonas ayant refusé d’accomplir les volontés de Dieu (aller prévenir les habitants de Ninive que leur fin est proche s’ils ne se repentent pas et ne se tournent pas vers Dieu), s’enfuit sur un bateau qui se rend à Jaffa. Survient alors une tempête. Les marins estiment que Dieu veut punir Jonas et le jettent à la mer. En effet, la tempête se calme aussitôt. Quant au pauvre Jonas, il est avalé par la baleine, où il reste trois jours (chiffre symbolique) durant lesquels il a le temps de se repentir. La baleine recrache alors Jonas sur le rivage. Le thème est donc celui de la soumission à Dieu et au destin que celui-ci impose, ainsi que le pardon final.
Dans le roman de Melville, ce thème est pour ainsi dire inversé, puisque le capitaine Achab, qui a perdu précédemment une jambe à cause de Moby Dick, veut se venger (et non pardonner). Au lieu d’accepter sa destinée, il veut lutter contre elle et anéantir ce qui pour lui représente la force du mal. Il y a quelque chose de prométhéen en lui puisqu’il va à l’encontre des vérités établies (la force et la férocité naturelles du cachalot). Quelque part, il lutte donc contre les puissances de la mort. Mais pour tuer le cétacé, il est prêt à tout. Les matelots sentent bien qu’ils vont à leur perte s’ils suivent leur capitaine. Ils lui suggèrent plusieurs fois de tout abandonner et de rentrer au pays auprès de sa femme et de son fils. Il refusera systématiquement tout compromis et affrontera Moby Dick durant trois jours (encore ce chiffre symbolique). Il échouera dans sa tentative et sera puni de son orgueil puisque le cachalot, en fonçant sur le navire, fera couler ce dernier. Le seul survivant sera le narrateur de l’histoire, qui s’accrochera à un cercueil transformé en bouée de sauvetage (tout un symbole).
Il y a quelque chose de biblique dans ce roman. Les références à Noé et à son arche y sont nombreuses. On sait que Noé avait embarqué un couple de tous les animaux pour les sauver du déluge. Seuls les poissons n’avaient pas eu besoin de ses services. Ici, le bateau du capitaine Achab est en permanence sur l’océan, loin de toute côte et peut symboliquement être assimilé au bateau de Noé. Mais au lieu d’abriter des animaux, il emplit ses cales de l’huile des baleines (ces monstres marins) qu’il a tuées.
La scène finale du bateau qui sombre dans les flots (à l’inverse de celui de Noé) et dont les trois mâts restent un instant visibles, est impressionnante. Un aigle (qui vit haut dans le ciel, près du soleil et qui symbolise le bien, par opposition à l’obscurité des gouffres sous-marins) est cloué sur le plus haut de ces mâts. A la différence de la colombe de Noé, qui annonçait le pardon de Dieu et l’émergence d’une terre nouvelle, l’aigle va sombrer irrémédiablement dans les abysses sans fond où règne le mal.
L’orgueil et la révolte du capitaine Achab n’auront servi qu’à faire périr son équipage.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, melville, moby dick
29/06/2013
Moby Dick
Or, quand ces pauvres marins hâlés, pieds nus, les pantalons roulés hauts sur leurs mollets d’anguilles, eurent péniblement tiré au sec leur gras poisson, se promettant un rapport de cent cinquante livres d’argent sonnant pour son huile précieuse et ses fanons, alors qu’en imagination ils sirotaient déjà un thé de choix avec leurs épouses, et une bonne bière avec les amis sur la foi de la part qui devait leur échoir à chacun, alors s’avança un gentilhomme très savant, très chrétien et très charitable, portant sous le bras un exemplaire de Blackstone et qui, l’ouvrant sur la tête de la baleine, leur dit: «Bas les pattes ! les patrons, ce poisson est un poisson amarré. Je le saisis au nom du Gardien. » À ces mots, les pauvres marins, dans un atterrement respectueux, si spécifiquement anglais, ne sachant que répondre, se mirent à se gratter vigoureusement la tête à la ronde, leurs regards allant lugubrement de la baleine à l’étranger. Cela n’arrangea pas l’affaire pas plus que cela n’attendrit le cœur de pierre du savant gentilhomme -à-l’exemplaire-de-Blackstone. Enfin l’un d’eux, après un long grattage en quête d’idées, s’enhardit à parler :
–S’il vous plaît, sir, qui est le Gardien ?
–Le Duc.
– Mais le Duc n’a rien à voir avec la capture de cette baleine ?
–Elle est sienne.
–Elle nous a donné beaucoup de tracas, nous avons couru des dangers et dépensé de l’argent, tout cela doit-il être versé au bénéfice du Duc ? N’aurons-nous rien d’autre pour notre peine que des ampoules ?
–Elle est sienne.
–Le Duc est-il si affreusement pauvre qu’il en soit réduit à ces extrémités pour gagner sa vie ?
–Elle est sienne.
–Je pensais venir en aide à ma vieille mère infirme sur ma part de ce poisson.
–Il est sien.
–Le Duc ne se contenterait-il pas d’un quart ou d’une moitié ?
–Il est sien.
En un mot, la baleine fut saisie, vendue et M. le duc de Wellington encaissa l’argent. Pensant que, vu sous certains angles, le cas aurait une petite chance d’être un tantinet revu, étant donné les circonstances et à cause de sa rigueur, un honnête pasteur de la ville adressa une pétition au Duc, le priant respectueusement de prendre en considération le sort de ces pauvres marins. À quoi Monseigneur le Duc répondit en substance (les deux lettres furent publiées) que c’était déjà fait, qu’il avait reçu l’argent, et qu’il serait très reconnaissant au révérend de bien vouloir désormais se mêler de ses affaires (à lui, révérend). N’est-ce pas là le vieillard toujours militant, debout au carrefour des trois royaumes pour arracher de toutes parts l’aumône aux mendiants ?
On aura tôt fait de comprendre qu’en ce cas le prétendu droit du duc sur la baleine lui était délégué par le souverain. Il faut nous demander, dès lors, au nom de quel principe le souverain détient lui-même ce droit. Nous avons déjà parlé de la loi, Plowden nous donne la raison de principe. Selon lui, la baleine ainsi capturée appartient au Roi et à la Reine « à cause de son excellence ». D’après les plus sains commentateurs, c’est là un argument convaincant.
(Herman Melville)
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature
24/06/2013
Le retour des dictatures ?
On connaissait le pouvoir des banques et de la haute finance et on savait que les gens qui sont derrière ces institutions s’enrichissent toujours, ce qui n’est pas forcément le cas des citoyens ordinaires. On savait aussi que les banques étaient prêtes à tout pour accroitre leurs bénéfices, mais ce qu’on ne savait pas, c’est que cela se ferait à notre détriment et d’une manière organisée et planifiée.
Je vous propose donc de lire l’article ci-dessous attentivement, il vaut assurément le détour. En gros, on y explique que pour que les banques continuent à faire du profit, il faudrait un peu restreindre les acquis sociaux des citoyens, mais comme ces derniers (ou du moins certains de ceux-ci) ne semblent pas d’accord, il faudrait songer à saper les bases de la démocratie et à mettre en place des régimes beaucoup plus durs, quasi dictatoriaux, pour empêcher toute tentative de révolte.
http://www.comite-valmy.org/spip.php?article3616
Bon, on va me dire que c’est là un article tendancieux, issu des mouvements d’extrême-gauche. Certes, mais qui peut être certain qu’il ne dit pas la vérité ? Ce qui est sûr, par contre, c’est que notre presse classique (qui est aux mains, justement, de la haute finance) ment sans arrêt. Il suffit de voir les sornettes qu’on nous a livrées sur l’Irak (armes de destructions massives), sur la Libye (6.000 civils tués par l’aviation de Kadhafi) et aujourd’hui sur la Syrie (utilisation de gaz sarin par l’armée régulière) pour se rendre compte que cette presse officielle ment tout le temps. Depuis les USA ont reconnu s’être trompés en Irak (la version des armes de destructions massives provenait d’un opposant et non de l’ONU, opposant qui a ensuite été récompensé pour ses mensonges en devenant vice-premier-ministre d’Irak). Quant à la Libye, on sait que le vote à l’ONU a été obtenu sur base des déclarations d’un médecin libyen en exil à Genève, lequel se basait sur les dires de ses amis restés en Libye, amis qui depuis, sont évidemment devenus ministres dans le nouveau régime. Bref, ils ont menti pour faire tomber Kadhafi et ont été les premiers bénéficiaires du changement. Pour ce qui est de la Syrie, Carla del Ponte elle-même avait dit que le seul gaz sarin qui avait été utilisé l’avait été par les rebelles eux-mêmes. Malgré cela, des journalistes du Monde tentent de faire croire qu’ils ont ramené des échantillons de sang qui prouvent l’utilisation de ce gaz par l’armée régulière. Mais les conditions d’acheminement de ces échantillons sont si rocambolesques qu’on a du mal à les croire fiables (n’importe qui ayant pu ajouter n’importe quoi à ces échantillons). De plus les articles de presse relatant les faits sont ridicules : aucune convulsion chez les personnes soi-disant atteintes, mais une irritation des yeux qu’on soigne par de simples gouttes ophtalmiques. Sans parler des absurdités médicales qui sont écrites, comme ces quinze doses d’atropine administrées au même patient, alors qu’il aurait dû succomber à la troisième dose.
Bref, tout cela pour dire que si mon article du Comité Valmy est tendancieux, il ne l’est certes pas plus que les articles de la presse officielle. Il le serait plutôt moins, car il n’a à défendre que la vérité et des idées, tandis que la presse classique défend les intérêts économiques de certains.
Oui, mais me direz-vous, le Comité Valmy reprend de nombreux articles du Réseau Voltaire, or le Réseau Voltaire, c’est Thierry Meyssan et Thierry Meyssan c’est celui qui soutient que les attentats du 11 septembre 2001 à New-York ont été commandités par ceux qui voulaient justifier l’invasion de l’Irak (invasion qui était par ailleurs programmée bien avant ces attentats). C’est donc là une hérésie, me direz-vous et cela discrédite le travail de ce journaliste. C’est en tout cas ce que j’entends autour de moi quand je parle du Réseau Voltaire.
Mais si Thierry Meyssan avait raison ? Après tout sa version n’est pas plus farfelue que la thèse officielle, qui soutient que l’avion qui a percuté le Pentagone s’est « dématérialisé » (puisqu’on n’en a retrouvé aucune trace), ce qui est quand même difficile à croire. Sans compter que cela n’explique pas comment cet avion a pu traverser un mur de béton armé en ne laissant qu’un trou de quelques mètres carrés (ce qui ferait plutôt penser à un tir de missile). Mais passons, ce n’est pas le lieu de débattre de ce problème.
J’ajouterai cependant que si les thèses de Meyssan restent des hypothèses (mais plus que crédibles), il est d’autres faits, historiques ceux-là, qui démontrent que ce ne serait pas la première fois qu’un pays tue des innocents dans son propre camp pour soulever l’opinion mondiale en sa faveur. Ainsi, le 08.06.1967, deux jours avant la fin de la guerre des Six Jours, Des Mirage et des torpilleurs israéliens attaquent le navire américain « USS Liberty ». Ce bateau n’était pas armé et se trouvait dans les eaux internationales. On a même tiré sur les canots de sauvetage, afin de ne laisser personne en vie. En effet, le but était d’accuser l’Egypte de Nasser afin que les Etats-Unis soutiennent Israël dans sa guerre contre le monde arabe. Malheureusement (ou plutôt heureusement), un bateau soviétique croisait dans les parages et a pu relater les faits. Israël a alors évoqué une erreur de tir et les choses en restèrent là (enfin, pas vraiment car l’absence de réaction des Etats-Unis fit comprendre à Israël qu’il avait le soutien inconditionnel de la plus grande puissance du monde).
Ce fait semble incroyable, mais il est pourtant historique et authentique. Dès lors, tous les articles « incroyables » que l’on lit sur les sites du Réseau Voltaire ou du Comité Valmy pourraient bien être vrais eux aussi. En tout cas ils semblent bien plus crédibles que ceux que l’on lit dans la presse officielle. Et dès lors, ce qui est dit plus haut du désir de JP Morgan d’imposer des dictatures en Europe ne devrait peut-être pas être pris à la légère.
1967, Grèce, mise en place de la dictature des Colonels

00:05 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (13)
17/06/2013
Village natal (suite et fin)
Elle roula droit devant elle, dans la grande forêt, sans penser à rien. Elle prit des routes au hasard, puis encore d’autres routes, et finalement se retrouva sur une autoroute sans trop savoir comment. Elle roula comme cela une partie de la nuit puis, à un moment donné, exténuée, elle s’arrêta sur un parking. Elle prit une chambre d’hôtel et s’endormit sans faire le moindre rêve. Vers midi, la femme de chambre la tira de son sommeil, lui faisant comprendre poliment mais fermement qu’il était temps de quitter les lieux. Elle mangea un sandwich insipide, but un café qui lui brûla l’estomac, puis elle reprit la route. Elle ne voyait devant elle qu’un long ruban de bitume qui n’avait pas de fin et qui ne menait nulle part. Au soir, elle était à Montpellier, tout étonnée d’être là.
Elle entra de nouveau dans un hôtel et se retrouva dans une chambre absolument identique à celle qu’elle avait quittée le matin. Là, elle s’endormit et fit un rêve étrange. Elle marchait dans une forêt et à un moment donné le chemin qu’elle suivait se divisa en deux. Par habitude, elle prit celui de droite, mais un peu plus loin celui-ci se divisa encore en deux et ainsi plusieurs fois de suite. A la fin, elle marchait dans un sentier tellement étroit qu’elle avait du mal à se faufiler entre les arbres. Bientôt celui-ci disparut dans la végétation et elle ne savait plus où aller. Elle prit conscience qu’elle était complètement perdue. C’est alors qu’elle le vit, Lui, à une centaine de mètres. Il était donc vivant ! Elle essaya de l’appeler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Lui, de son côté, s’éloignait déjà et bientôt il disparut. Elle tenta de le rejoindre, mais elle se prenait les pieds dans des ronces et ne parvenait pas à avancer. A un moment donné, elle entendit des voix et se dirigea de ce côté. A la sortie du bois, dans une clairière, des paysans étaient occupés à fumer. Elle leur demanda s’ils n’avaient pas aperçu son ami, mais ils n’avaient rien vu. Elle insista, expliquant qu’il ne s’agissait pas seulement de son ami, mais de son amoureux. Ils la regardèrent, un peu embarrassés, puis expliquèrent que de toute façon, s’il s’était engagé seul dans le bois, il était forcément mort à l’heure qu’il était, à cause des loups qui rodaient sans arrêt dans le coin. A ces mots, elle se sentit vaciller et se laissa tomber sur le sol. Elle se réveilla dans la chambre de l’hôtel, au pied de son lit. Il était neuf heures du matin.
Là, elle se dit qu’il était temps de se ressaisir. Elle se rendit à la cafétéria et mangea deux croissants. Ils étaient excellents et bien croustillants. Elle sentit que la vie reprenait le dessus. Ensuite, elle roula jusqu’à Béziers et là prit l’autoroute qui remonte vers Paris en passant par le Massif central. Elle s’arrêta plusieurs fois pour admirer les paysages, surtout ceux des Causses, avec leurs grands plateaux désertiques et leurs falaises à pic.
Le soir tombait quand elle arriva chez elle. Après avoir garé la voiture le long de la pelouse, elle prit ses clefs et, machinalement, fit un détour par la boîte aux lettres. Et là, sous quelques publicités, il y avait une lettre. Elle n’y fit d’abord pas plus attention que cela, mais tout en marchant vers la porte d’entrée, elle la regarda distraitement et là elle eut un choc. Elle venait de reconnaître l’écriture. Son écriture ! Ainsi donc elle avait assisté à son enterrement ou plus exactement elle était allée se recueillir sur sa tombe, puis avait roulé au hasard pendant deux jours, et voilà que pendant ce temps il lui avait écrit ! La main qui tenait la lettre se mit à trembler. Elle ne comprenait plus rien. Il lui fallut plusieurs secondes pour se calmer et réaliser, le cachet de la poste faisant foi, que cette lettre avait été écrite et envoyée avant son décès.
Toujours tremblante, elle ouvrit la porte, alluma la lampe et s’effondra dans un fauteuil. La lettre était devant elle et elle n’osait l’ouvrir car elle savait que c’était la dernière et qu’elle n’en recevrait plus jamais de Lui. C’était un peu comme s’il lui avait écrit de l’au-delà, pour lui faire un dernier petit signe. Après plusieurs minutes, elle se décida à déchirer l’enveloppe et les premiers mots la laissèrent complètement anéantie : « Mon amour, toi pour qui je donnerais ma vie, si tu savais à quel point je t’aime… »
Elle resta là, la lettre dans la main, n’ayant plus le courage d’en continuer la lecture. Une fois de plus, désespérément seule.

17:49 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature
09/06/2013
village natal
Elle avait garé la voiture à la sortie du petit bois, et avait attendu là patiemment. Devant elle, la route descendait en pente raide vers le village, longeait le cimetière, puis se perdait près des premières maisons. L’esprit vide, elle ne pensait à rien. Elle attendait, c’était tout. Elle attendait quoi au juste ? Cela avait-il un sens d’être là ? Oui, bien sûr ! C’est ne pas y être qui aurait été incompréhensible. Dans son esprit, les idées se mélangeaient. Elle regarda les grands bois qui couvraient l’horizon, de l’autre côté du village. Voilà donc la région qu’il aimait tant et dont il lui avait si souvent parlé. Elle n’y était jamais venue. Ni seule ni avec lui. Forcément. On le connaissait ici et même s’il n’y vivait plus depuis longtemps, cela restait son village natal. Qu’est-ce que cela aurait été bon, pourtant, de se promener à deux dans ces forêts sauvages. Quand elle aurait eu peur d’un bruit étrange, il lui aurait pris la main et ne l’aurait plus lâchée. Elle n’aurait rien dit, mais qu’est-ce qu’elle aurait été heureuse, comme cela ! Le soir, ils seraient rentrés à l’hôtel et il aurait expliqué que ce bâtiment était en fait la vieille ferme de son grand-père, laquelle avait été vendue et transformée pour les touristes. La charrue que l’on voyait au milieu de la pelouse avait été tirée par un cheval qu’il avait encore connu, lorsqu’il était enfant. Il aurait parlé pendant des heures de son passé et elle l’aurait écouté, heureuse de découvrir ce qui avait fait ce qu’il était devenu, cet homme à la fois renfermé et généreux, persévérant et pourtant si fragile à ses heures. Puis ils seraient allés dormir dans une chambre aux murs de schistes gris et avant de sombrer dans le sommeil, ils se seraient aimés comme jamais. Au milieu de la nuit, elle se serait réveillée en entendant le hululement d’un hibou, si près qu’on aurait dit que l’oiseau était à l’intérieur de la chambre. Elle aurait souri de sa naïveté et se serait blottie contre lui pour le reste de la nuit. Alors, heureuse, elle aurait rêvé de l’océan et de son enfance à elle.
Elle en était là de ses pensées quand elle les vit arriver. Ils venaient à pied, suivant la voiture noire. Il n’y avait pas beaucoup de monde, une vingtaine de personnes au maximum. Ils marchaient lentement à cause de la pente qui était raide et quand ils furent devant le cimetière, elle vit bien qu’ils étaient tous contents d’être à destination. Alors on sortit le cercueil du corbillard et ils franchirent la petite grille. Ils restèrent là devant le trou qui était creusé. Elle les voyait bien, d’où elle était. Celle qui se tenait à peine debout, c’était sa femme, manifestement. Ses deux filles la soutenaient, toutes fières au fond d’elles-mêmes d’être pour une fois les adultes que leur mère les avait toujours empêchées d’être. Une voiture arriva à vive allure et se gara sur le parking. C’était le curé. Un curé, il ne manquait plus que cela ! Qu’est-ce qu’il aurait dit s’il avait su cela ! Une fois de plus il devrait faire semblant et subir ce qu’on lui imposait. Elle en eut mal pour lui. Il n’y avait pas à dire, ces gens n’avaient vraiment rien compris à ce qu’il était. Un curé !
Elle vit l’homme de Dieu traverser le cimetière au pas de course, tout en passant son étole autour du cou. Puis il dut faire un discours car tout le monde sembla se recueillir un instant. Ce fut bref car déjà il bénissait la fosse et faisait signe aux hommes des pompes funèbres qu’ils pouvaient continuer leur travail. Elle vit le cercueil descendre au fond du trou et quand il se fut immobilisé, il lui sembla entendre le bruit mat de la caisse contre la terre, ce qui était complètement impossible vu la distance. Pourtant, au fond d’elle-même, elle ressentit un choc et elle sut que sa vie venait de s’arrêter.
Après elle ne sait plus. Ils durent tous faire un dernier signe d’amitié envers le défunt et venir présenter leurs condoléances à la veuve et à ses filles. Mais elle ne vit rien de tout cela, son esprit vacillait et était ailleurs. Elle pensait à ces deux jours merveilleux où il avait pu se dérober à la vigilance des siens et où ils étaient allés visiter quelques églises romanes en Auvergne, du côté d’Orcival ou de Saint-Nectaire, elle ne savait plus trop. Qu’est-ce qu’ils avaient été heureux, là-bas !
Quand elle retrouva ses esprits, la foule quittait le cimetière et les fossoyeurs étaient déjà à pied d’œuvre. Quant au curé, il était parti depuis longtemps ! Visiblement, il n’avait même pas proposé à la veuve de la raccompagner jusqu’au village. Bien fait pour elle, elle n’avait pas besoin de l’inviter !
Elle attendit encore deux bonnes heures et quand elle vit le soleil qui se couchait à l’horizon, elle lâcha le frein à main et laissa la voiture descendre sans bruit. Le silence était impressionnant. On se serait cru au fond de la mer et elle entendait les battements de son cœur qui frappaient ses tympans, comme si elle avait été à cent mètres de profondeur. Arrivée devant la grille, elle stoppa et attendit encore un peu. Il n’y avait plus personne et à cette heure crépusculaire aucun villageois ne viendrait jusqu’ici. Alors elle ouvrit la portière qui grinça un peu (en fait elle fermait mal. Combien de fois ne lui avait-il pas dit de la réparer !). Elle la referma lentement. La petite grille avait été laissée ouverte. Décidément, ils avaient tous été pressés de partir ! Elle parcourut l’allée principale et très vite se retrouva devant le petit monticule de terre. Alors là, subitement, toutes les vannes s’ouvrirent en même temps et elle pleura comme elle n’avait jamais pleuré. Elle resta là une bonne heure, assise dans l’herbe, suffoquée par les sanglots. Puis elle se releva et regagna sa voiture. Il faisait complètement noir. Dans le lointain un hibou poussa un cri et elle frémit. C’est à ce moment qu’elle comprit qu’elle était vraiment seule.
Photo personnelle

00:26 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
28/05/2013
Rencontre
J’ai marché des jours et des jours, toujours vers l’ouest.
J’ai marché sans m’arrêter, sur des chemins qui fuyaient sans fin vers l’horizon de mes rêves.
Il y eut des soirs, il y eut des matins.
Il y eut des aubes tristes et des crépuscules flamboyants.
Parfois, j’avançais courbé sous la force du vent et sur mon visage ruisselait la pluie, comme des larmes d’un autre temps.
Parfois il faisait chaud, étouffant, et dans les lointains s‘élevait sans fin la fumée des pinèdes calcinées.
J’ai marché depuis les commencements du monde, sans m’arrêter.
Je n’avais qu’une idée en tête, celle de te retrouver, mon amour.
Et toi, toi, tu t’es mise à marcher vers l’est.
Tu as traversé des rivières et des fleuves, des plaines fertiles et des villes gigantesques.
Tu as contemplé des cathédrales plus hautes que le ciel dont les vitraux ensanglantés disaient la souffrance de tous les peuples.
Sous les voûtes ogivées ou dans l’obscurité des criques, tu as prié à genoux un dieu étranger.
Etendue nue sur les dalles bleues et glacées, le froid déjà gagnait ton cœur quand tout là-haut les grandes orgues se mirent à jouer seules au milieu de la nuit.
Alors tu t‘es levée et tu t’es remise en route.
Tu as marché en aveugle dans les ténèbres et quand soudain la lune est apparue, c’est mon reflet que tu as cru voir dans l’onde d’un étang bleu.
Alors tu as souri et tu m’as attendu, assise au bord du monde.
00:05 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : littérature
24/05/2013
Océan mer
« - Quelquefois je me demande ce que nous sommes en train d’attendre
- Qu’il soit trop tard, madame. »
Alessandro Baricco, « Océan mer »
Joli roman que celui-là, plein d’images saisissantes, comme ce peintre qui passe ses journées devant la mer avec son chevalet, et qu’il faut aller récupérer le soir dans une barque, au moment de la marée montante, alors que sa toile est restée désespérément blanche. Il est vrai qu’au lieu de peinture, il n’emploie généralement que de l’eau de mer ! Il y a aussi des enfants qui savent lire dans les rêves des grandes personnes ou un célibataire qui écrit chaque jour une lettre à la femme qu’il espère rencontrer un jour. Le jour où il la trouvera, il a l’intention de lui montrer ces centaines de lettres, empilées dans une boîte, et il ne doute pas qu’elle tombera amoureuse à l’instant-même.
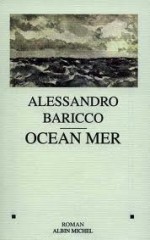
15:36 | Lien permanent | Commentaires (9)
21/05/2013
De l'édition (suite et fin)
Une fois ce deuxième manuscrit envoyé, je me suis mis à attendre patiemment. En effet, je savais maintenant qu’il ne fallait pas espérer obtenir une réponse avant une bonne année. Mais au moins, s’agissant d’un roman, cette fois, j’étais sûr qu’on ouvrirait le manuscrit (ce qu’on n’avait évidemment pas fait dans le cas des nouvelles) et même s’il n’était pas retenu, on me dirait ce que l’on en pensait. Pour moi, c’était ce qui comptait.
Les mois se mirent donc à défiler les uns après les autres : huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze… J’en avais presqu’oublié que j’attendais une réponse ! C’est alors qu’eut lieu un salon du livre, que dans ma petite région on rebaptisa « Foire du livre », ce qui était assez honnête. En effet, l’ambiance qui régnait là n’avait rien à voir avec le calme feutré des librairies, où l’on entend juste le bruit les pages feuilletées par quelques amateurs de littérature. Non, ici, c’était la grosse foire commerciale, avec des micros qui hurlaient sans arrêt, indiquant aux badauds qu’il y avait des débats qu’ils ne devaient surtout pas manquer et des séances de dédicaces incontournables, qu’il aurait été malvenu de négliger. Il régnait là-dedans un bruit extraordinaire et une chaleur étouffante. A certains endroits, on voyait une foule compacte se presser devant un stand dans l’espoir d’avoir un autographe. En se hissant sur la pointe des pieds, on pouvait apercevoir le chapeau moyenâgeux d’Amélie Nothomb… Plus loin, c’était tout le contraire : deux auteurs parfaitement inconnus attendaient patiemment qu’un lecteur éventuel vînt leur prouver qu’ils ne s’étaient pas déplacés pour rien. Mais personne ne venait, manifestement, et pour se donner une contenance ils buvaient une gorgée au verre d’eau qu’on avait déposé devant eux (au cas fort improbable où ils auraient dû parler beaucoup).
Bref, je déambulais dans ce capharnaüm quand, par le plus grand des hasards, je me suis retrouvé devant le stand de mon éditrice. Bon, elle n’était pas là en personne (en tout cas pas ce jour-là), mais son acolyte était là. Je me suis avancé pour demander s’il était normal de ne pas avoir de réponse après quatorze mois (pas dans le but de faire des reproches, mais simplement afin d’être rassuré. On ne sait jamais. On manuscrit se perd si vite !). C’est alors que quelqu’un de plus pressé que moi me brûla la politesse et vint s’enquérir de son propre manuscrit.
« Et vous vous appelez comment ? »
« XX »
« Oui… et le titre de votre manuscrit ? »
« ZZ »
« Oui, parfaitement, je m’en souviens très bien. Il est arrivé il y a une bonne année, c’est bien cela ? »
« Seize mois exactement… »
« Oui, mais c’est normal, nous recevons tellement de textes. Mais rassurez-vous, je me souviens parfaitement de ce titre. Je me demande même si je ne l’ai pas revu récemment dans la pile que nous lisons en ce moment. »
Et voilà mon auteur en herbe qui s’en va tout content, certain de recevoir une réponse positive dans quelques jours.
Je me suis alors avancé, j’ai posé la même question et j’ai reçu la même réponse. La différence, c’est que je suis reparti beaucoup moins confiant que mon prédécesseur. Il est vrai que je commençais à avoir un peu d’expérience dans le monde mensonger de l’édition.
Quelques mois se sont encore écoulés et j’ai reçu une réponse : « …n’entre pas dans le cadre de nos collections ». C’était la première fois que je lisais cela. Ce ne serait pas la dernière, malheureusement.
Cependant, cette phrase assassine qui venait de briser tous mes espoirs était suivie d’une autre, beaucoup plus optimiste (ou beaucoup plus perfide, c’est selon) : « … néanmoins, devant la qualité de certains textes, nous suggérons l’auto-édition. Vous trouverez ci-dessous la maison avec laquelle nous travaillons habituellement ». Suivait alors le nom d’une société parfaitement inconnue de moi, logée à la même adresse que ma chère éditrice.
Bon, j’avais compris. On ne m’éditait pas car mon texte ne serait pas rentable. Cependant, si je le trouvais bon, je pouvais prendre le risque de l’éditer à mes frais.
Aucun commentaire sur les « qualités » supposées du manuscrit, ni d’ailleurs sur ses éventuels défauts. N’étant pas encore complètement déniaisé, j’ai donc écrit un petit mail, où je remerciais pour le temps qu’on avait consacré à me lire et demandais d’avoir un compte-rendu de quelques lignes. La réponse fut rapide cette fois (elle vint dans les cinq minutes), mais plutôt sèche. En gros, elle disait : « Nous ne sommes pas des conseillers littéraires et n’avons pas pour habitude de donner un avis détaillé sur les manuscrits. Vu le nombre que nous recevons chaque jour, vous comprendrez aisément, bla bla, bla… ». Dont acte.
Quelques mois passèrent encore et je suis retourné une dernière fois à cette « Foire du livre » (depuis je n’y vais plus, dégoûté par son côté commercial et vente forcée). Et voilà que je retrouve l’acolyte de mon éditrice (elle, toujours absente et lui toujours aussi dynamique). Il expliquait justement à un petit jeune qu’il se souvenait parfaitement avoir vu son manuscrit dans une des nombreuses piles qui s’entassaient dans son bureau. Je n’ai pu m’empêcher de sourire. Comme je restais là, sans rien demander, c’est lui, je crois qui est venu vers moi. J’ai expliqué que non, que je n’attendais plus rien, que j’avais déjà reçu ma réponse et qu’elle était négative. Négative mais ambiguë quand même puisqu’elle disait qu’on n’éditait pas mon texte tout en reconnaissant que le manuscrit n’était pas mauvais (manière assassine de laisser un certain espoir aux pauvres « écrivants »).
« Et on vous a proposé quoi ? De l’auto-édition ?»
« Ben oui… »
« Et vous avez fait quoi ? »
« Rien, je n’ai pas accepté. »
« Vous avez drôlement bien fait, cela ne sert strictement à rien. »
« … »
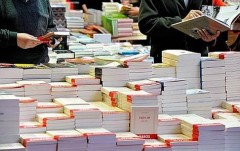
15:42 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature
13/05/2013
De l'édition
Quand j’ai envoyé mon premier manuscrit (il s’agissait d’un recueil de nouvelles) à un éditeur, j’étais encore bien naïf, m’imaginant qu’avec un peu de chance il pourrait déboucher sur une publication. L’éditeur en question (en l’occurrence, c’était une éditrice) mit un an et demi pour me répondre … qu’elle ne publiait jamais de nouvelles d’un inconnu.
Un peu furieux, je lui fis aussitôt la remarque par courriel que ce n’était pas la peine d’attendre un an et demi pour me dire ce qu’elle aurait tout aussi bien pu me dire le premier jour.
Curieusement, elle me répondit, m’expliquant que les nouvelles ne se vendaient pas, qu’elle ne consentait à en publier que si elles avaient été écrites par ses auteurs « maison » et encore, bien à regret et en trichant (en donnant comme titre général au livre le titre de la première nouvelle, mais en se gardant bien de dire qu’il s’agissait d’un recueil de plusieurs récits. Bref, elle essayait tant bien que mal de faire passer pour un roman ce qui n’en était pas un).
Perfide, elle m’expliqua que pour les nouvelles, il fallait mieux d’abord passer par des publications en revue, pour se faire connaître. Et comme par hasard, elle s’occupait justement d’une revue… J’ai vite compris qu’il fallait être abonné si on espérait voir un jour son texte accepté. Je me suis donc abonné (je vous ai dit qu’à l’époque j’étais encore complètement naïf, à la limite de la sottise). Pendant un an j’ai donc reçu cette revue où je retrouvais les noms de tous les écrivains connus de ma région (je devrais dire « connus régionalement », pour mieux me faire comprendre). Vous voyez, il s’agissait de ces personnes invitées à toutes les réceptions locales, tous les vernissages de peinture, toutes les soirées culturelles organisées par quelque politicien en mal d’être élu, etc. Bref, des gens fort connus par leur nom (dans ma région toujours), mais dont j’aurais été bien incapable de citer le titre d’un livre.
Néanmoins, un an passa et, après avoir renouvelé mon abonnement, le temps me sembla venu de proposer l’un ou l’autre texte. Inutile de dire que je ne reçus jamais aucune réponse, pas même un petit accusé de réception. Manifestement, pour entrer dans la revue qui permettrait de me faire connaître, il fallait d’abord être connu… Passons. Pourtant, lorsque je lisais les textes de certains heureux élus (textes très courts qu’ils avaient dû composer entre deux cocktails et trois réceptions mondaines), ceux-ci ne me semblaient pas si extraordinaires que cela. Comme un thème était imposé pour chaque numéro de la revue, il m’est même arrivé de retrouver des textes qui ressemblaient étrangement aux miens. Non pas qu’il y ait eu plagiat, non, du tout, mais inévitablement, quand on écrit tous sur le même sujet, il arrive qu’on dise à peu près la même chose et dans les mêmes termes.
Je n’oserais dire que mes textes étaient meilleurs que les leurs (ce serait afficher une terrible vanité qui heureusement n’est pas dans ma nature), mais honnêtement je dirai quand même que je ne voyais pas en quoi les écrits de ces célébrités locales surpassaient les miens au point qu’on les préférât pour les insérer dans la fameuse revue. Bon, vous me direz que je suis mal placé pour juger et que ma réaction est celle d’un débutant jaloux du talent des autres. C’est possible et je n’insisterai donc pas sur ce point.
En attendant, le temps passait et j’avais déjà envoyé un deuxième manuscrit à l’éditrice qui tenait la revue. C’était un roman, cette fois. Puisqu’elle aimait cela, elle allait être servie !
(à suivre).

16:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : littérature
10/05/2013
Syrie, la destruction programmée d'un peuple.
Il n'y a rien à dire. Il suffit de regarder ces images pour comprendre. Et n'oubliez pas que nos gouvernements soutiennent et arment les rebelles avec notre argent. Faire semblant de ne pas le savoir, c'est se rendre coupable d'un génocide.
00:22 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (5)
22/04/2013
Anniversaire
En avril, Marche romane fête ses six ans d’existence, ce qui mérite bien quelques jours de pause. Il me semble d’ailleurs avoir tout dit et je risque finalement de me répéter. Quant au sens de tout ceci, il n'y en a pas, probablement.
Pas de panique. Il y a surtout que l'hiver fut long, très long et qu'en ces premiers beaux jours on préfère jardiner à l'extérieur plutôt que de rester penché sur son clavier. Quand la pluie reviendra, je reviendrai aussi, sans doute.
22:17 Publié dans Blogue | Lien permanent | Commentaires (6)
16/04/2013
L'ancêtre
C’était une petite vieille. Le soir, vers vingt-trois heures, quand je promenais mon chien, elle était souvent sur le seuil de sa porte. Ca ne se fait pas trop, dans le quartier, mais elle, qui était d’une autre époque, le faisait. Elle prenait le frais et regardait dieu seul savait quoi, car il n’y avait rien à voir. Sans doute rêvait-elle à toutes les personnes qu’elle av ait connues et qui étaient toutes disparues. En hiver, comme il faisait froid, je ne la voyais pas pendant des mois, mais dès que revenait le printemps, elle était là. En été, lors des fortes chaleurs, il lui arrivait même de sortir sur le pas de sa porte en robe de nuit. On se disait bonjour (on aurait mieux fait de se dire bonsoir), sans plus, mais il passait entre nous comme un courant de sympathie.
Je ne sais pas pourquoi, mais elle me faisait penser à ma grand-mère, disparue depuis près de vingt ans. Non pas qu’elle lui ressemblât vraiment, mais sa taille, son attitude, la manière dont elle se tenait, la coupe de ses cheveux, son tablier à fleurs, tout cela évoquait pour moi cette personne née avec le siècle, qui avait connu deux guerres, avait eu sept enfants, en avait perdu deux, et dont j’étais un des descendants.
Je passais donc, après avoir salué la petite vieille, et je poursuivais ma promenade accompagné de mon chien. Un chien fidèle, un véritable ami. Un golden retriever doux comme un agneau et qui semblait deviner tous mes états d’âme. Parfois, j’avais même l’impression d’avoir avec lui de véritables conversations.
Mais revenons à la petite vieille. Les saisons passaient, les années aussi, et je voyais bien qu’elle se voûtait insensiblement, qu’elle était moins rapide à répondre à mon bonjour, que son regard était plus vague. C’est sûr, elle ne rajeunissait pas. Puis il se passait parfois plusieurs semaines sans que je ne la rencontrasse, même en été. Sans doute était-elle malade ou hospitalisée. Puis un soir elle réapparaissait et on se disait bonjour, comme s’il ne s’était rien passé.
Un samedi, je l’ai croisée en journée qui traversait la rue pour aller saluer une voisine en face. Là, elle ne me salua pas. Forcément, on n’était pas le soir. Pourtant, son air plus qu’absent et son pas chancelant m’alertèrent. Je me suis retourné et je l’ai aperçue qui gisait à terre. Elle venait de tomber. Je l’ai relevée délicatement. Elle n’a rien dit, pas un mot. J’ai demandé s’il fallait la raccompagner jusque devant sa porte, mais non, d’un geste elle manifesta son intention de poursuivre sa route. Elle traversa donc la chaussée et alla sonner chez sa voisine. Quand je vis qu’elle était entrée sans encombre, j’ai poursuivi mon chemin. Le lendemain soir, elle était de nouveau sur le pas de sa porte, vers les vingt-trois heures, et on se salua comme d’habitude, comme s’il ne s’était rien passé. Avait-elle seulement conscience qu’il se fût passé quelque chose ou une sorte de pudeur l’obligeait-elle au contraire à faire comme si de rien n’était ?
Je ne sais pas et je n’ai jamais eu la réponse à ma question. Je la voyais de moins en moins souvent, puis un autre hiver est arrivé et elle a disparu come d’habitude. Au printemps suivant, cependant, elle n’est pas réapparue. Par contre, un jour, son trottoir s’est retrouvé rempli de vieux meubles empilés et de boites en carton. Voilà tout ce qui restait d’elle. Ces quelques babioles accumulées au cours de toute une vie et qui pour elle, sans doute, avaient l’importance que donnent les souvenirs. Elle si discrète, qu’aurait-elle pensé en voyant tout son intérieur étalé là au grand jour, sans pudeur aucune, avec même une sorte de mépris pour tous ces meubles d’un autre âge ? Pourtant je suis certain que ces meubles, elle les avait frottés, polis, lustrés pendant plus de soixante ans.
J’ai continué ma promenade, car mon chien s’impatientait et me tirait en avant. Tout en marchant, je me disais que c’était bien peu de choses, une vie. Cela se résume à quelques meubles démodés sur un trottoir.
Quelques semaines se sont encore passées et la maison a été à vendre. Puis quelqu’un a entamé des travaux de rénovation. On a mis de nouveaux châssis avec des vitres noires teintées, comme dans les grandes tours qui abritent le siège des banques, dans toutes les capitales européennes. Ce côté moderne et occulte m’a un peu agacé, mais qu'y faire ? Il faut bien vivre avec son époque. Après tout nous sommes dans une société du mensonge et ces vitres opaques, destinées à cacher ce qui se passait désormais à l’intérieur de la maison, étaient en harmonie avec le siècle.
Il s’est encore passé un an ou deux depuis que la petite vieille avait disparu. Je marchais moins vite, à cause de mon chien qui commençait à traîner la patte et que je devais maintenant tirer doucement pour qu’il me suive. Puis un jour il n’est plus parvenu à marcher du tout et il s’est même mis à vaciller dans la maison. Alors il a fallu se résigner à le conduire chez le vétérinaire, qui lui a fait sa dernière piqûre. Pour ne pas remuer inutilement des souvenirs trop durs à gérer, je suis allé porter à la déchèterie son vieux panier (qu’il avait mordillé allègrement quand il était jeune et dont les bords portaient encore des traces de dents.) et quelques ustensiles désormais inutiles. Dans le coffre de ma voiture, cela faisait un tas insignifiant, comme les meubles de la petite vieille. Qu’on soit homme ou chien, voilà finalement à quoi se résume toute une vie.
00:05 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature
11/04/2013
Aube
Sur la plage déserte, en ce matin du monde, nous cheminions.
La mer s’était retirée très loin, vaincue après ses assauts de la nuit.
Tandis que sur le sable nos pas laissaient des empreintes improbables,
Dans le ciel pur, un oiseau blanc passa,
Lançant un cri unique.
Puis ce fut le silence.
Le grand silence des origines,
Celui qui régnait avant l’apparition de l’homme.
Nous poursuivîmes notre route, savourant secrètement le monde et son premier matin.
19:33 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature
05/04/2013
Tempus fugit
Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges
Jeter l'ancre un seul jour ?
Ces vers bien connus de Lamartine, souvent découverts à l’adolescence, me semblent petit à petit prendre un sens bien concret. Les saisons défilent, les années passent, et nous emportent avec elles. C’est là, certes, un lieu commun. Il n’empêche que la vérité est là. A peine le sapin de Noël a-t-il été rangé que Pâques est déjà derrière nous. On attend l’été, qui passera comme un éclair et déjà les frimas de novembre seront là, avec leurs brouillards glacés.., Une année sera passée sans que nous ayons pu jeter l’ancre et nous arrêter un instant. Notre navire file tout droit vers l’horizon, vers le grand mystère des limites du monde.
00:05 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (8)
29/03/2013
La lettre
Je t’ai écrit trois mots, rien que trois mots.
Je les ai écrits à la main, lentement, au stylo, avec une belle encre bleue, puis j’ai signé de mon prénom.
Ils n’occupaient pas beaucoup de place, mes trois petits mots, au milieu de la page blanche.
Ils semblaient même un peu ridicules, alignés comme cela, avec tout ce vide autour d’eux.
Pourtant, en les relisant, il m’a semblé qu’ils disaient tout, tout ce que j’avais à te dire.
Alors j’ai plié la feuille en quatre et je l’ai glissée dans une enveloppe.
Ensuite, cette enveloppe, je l’ai collée avec ma langue, lentement, et c’était comme un baiser qui n’aurait pas eu de fin.
Un baiser humide, volé à la saveur salée de tes lèvres.
J’ai écrit ton nom, celui qui hante mes songes, ainsi que ton adresse, que je connais par cœur.
Puis j’ai mis un timbre, un beau timbre avec l’océan, une plage immense, et tout le ciel bleu de mes rêves.
Il ne restait plus qu’à poster ma lettre.
Je suis sorti au milieu de la nuit, la neige tombait et il faisait froid.
En me retournant j’ai vu les traces de mes pas sur la terrasse : trois petits points noirs au milieu du grand tapis blanc.

00:05 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
26/03/2013
De la publicité
Quand on y réfléchit bien, ce ne sont plus des produits que le discours publicitaire nous vend. En effet, j’ai déjà chez moi tous ceux dont j’ai besoin, donc pourquoi irais-je en acheter d’autres ? Parce qu’ils seraient meilleurs ? Mais ils ne le sont pas et je le sais. Donc il a fallu miser sur autre chose, pour tenter de me convaincre. Et cette autre chose, c’est l’ambiance et le rêve. Nivea n’est pas seulement une crème, c’est d’abord un moment de douceur partagé entre une mère et son enfant, dans une ambiance familiale pleine de tendresse. Tel shampoing n’est ni meilleur ni plus mauvais qu’un autre, mais il renforce l’éclat de vos cheveux, Mesdames et donc vous rend irrésistibles. Comme le déodorant Axe vous rend plus virils et plus attractifs, Messieurs. La publicité fait donc appel à ce que nous voudrions être, des espèces de surhumains qui auraient toutes les qualités pour séduire et donc pour plaire. Car derrière tout cela, il y a l’amour et la tendresse, que chacun espère et qu’il n’a pas toujours, dans ce monde égoïste réglé par le rendement, la performance et la compétition.
Le produit qu’on veut me vendre serait donc un moyen que je n’aurais qu’à saisir pour atteindre ce rêve qu’est l’amour ou du moins l’amitié (ah, ces fromages de chèvre qu’on déguste entre amis sur la terrasse d’une vieille ferme provençale un peu rustique !). On me vend donc de l’immatériel et on fait appel à mon besoin d’affection et de partage pour me le vendre. Le paradoxe, c’est que cette société marchande, basée uniquement sur l’argent, fait justement bien peu de cas de l’amour et des relations humaines en général puisqu’elle nous demande avant tout d’être performants dans notre travail et d’être de bons consommateurs à titre privé. Ces relations humaines qu’elle détruit sans état d’âme, elle les emploie dans la publicité pour nous faire acheter ces satanés produits dans le seul but est d’enrichir encore plus quelques privilégiés avides d’argent. Mais comme elle sait que nous souffrons de carences affectives dans cet environnement uniquement composé d’objets commerciaux sans intérêt (environnement qu’elle a créé elle-même et qu’elle nous a imposé), elle en profite pour nous faire rêver à ce que nous avons perdu à cause d’elle et cela dans le seul but de vendre encore et encore.
Triste époque.
00:05 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (7)
21/03/2013
Devinette
Je suis à la fois un militaire et un écrivain. J’ai écrit de nombreux livres dont un au moins est mondialement connu, ce qui ne veut pas dire que les gens l’ont lu. J’ai rédigé également un petit traité où j’expliquais que l’Etat devrait se procurer les moyens de venir en aide aux pauvres. Pour ce faire, je suggérais de favoriser le commerce, mais aussi de permettre à l’Etat de s’enrichir en s’adonnant lui-même à des activités commerciales, comme le secteur privé le fait. Par exemple, il suffirait de créer une flotte nationale qui acheminerait les denrées des pays étrangers pour les revendre aux citoyens. Les bénéfices ainsi obtenus rempliraient les caisses publiques. Une autre solution serait de ne pas laisser l’exploitation des mines au seul secteur privé. L’Etat pourrait très bien exploiter lui-même les gisements et l’argent ainsi gagné permettrait de réaliser de grandes choses. Je trouve qu’en ce début de XXI° siècle où le libéralisme sauvage fait des ravages, les dirigeants européens feraient bien de s’inspirer de mon ouvrage.
Qui suis-je ?
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (24) | Tags : littérature
19/03/2013
Promenade hivernale

Photo personnelle 12.03.13
Il avait beaucoup neigé, ce jour-là et j’en avais profité pour aller me balader. Tant qu’on est en ville, ce n’est pas très gai, la neige. A cause des camions de sel qui étaient passés sur la chaussée, tout était déjà en train de fondre sur les trottoirs et le beau tapis blanc s’était transformé en une sorte de boue infâme dans laquelle il n’était pas facile de marcher. Dans d’autres rues, là où les camions n’étaient pas passés, c’était le contraire : la neige s’était tassée sous les milliers de pas qui l’avaient foulée et elle n’était plus qu’une plaque de glace inégale, où le passant cheminait comme il pouvait, craignant à chaque instant de glisser et de tomber. Bref, il me fallut atteindre les champs pour pouvoir enfin progresser dans une belle poudreuse immaculée.
Et là, ô joie ! J’étais le premier à emprunter ce chemin campagnard, bien qu’il fût déjà plus de midi. J’adore marcher dans la neige vierge. J’ai l’impression, alors, d’être seul au monde, comme si l’humanité entière avait disparu. Je suis un peu sauvage de nature, c’est mon tempérament, on n’y peut rien. Je crois que cela ne m’aurait pas déplu d’être comme Robinson, perdu sur une île déserte (pour autant, bien entendu, que j’aie pu récupérer quelques livres dans l’épave de mon bateau). Alors, ici, le fait d’être le premier à fouler cette neige encore intacte m’enthousiasmait au plus au point. Il me semblait habiter une contrée sauvage, à mille kilomètres de toute habitation. Pour un peu, je me serais cru dans le grand nord canadien et si un loup avait surgi devant moi je n’aurais pas été plus surpris que cela. Je me suis peut-être trompé de siècle et de race et j’aurais dû naître algonquin ou iroquois (et cela avant que les hommes blancs ne viennent les massacrer, bien entendu). Cette existence primitive dans des paysages immenses et désertiques m’aurait assez bien convenu, je crois.
Tout en marchant, je me disais que nous restions tous des enfants, finalement, quel que soit notre âge. Il suffit d’un peu de neige pour que tout notre sérieux s’envole et que toutes les conventions sociales soient mises de côté. Je me retrouvais là, sur ce chemin tout blanc, comme si j’avais eu six ou sept ans, et j’étais tout simplement heureux. Je m’étonnais de voir que la neige était plus haute que mes chaussures de marche, je m’extasiais en contemplant l’empreinte de mes pas, j’admirais les congères qui s’avançaient au milieu du chemin, hautes de plus d’un mètre.
Dans une prairie, des chevaux étaient là, immobiles, tournant stoïquement le dos aux bourrasques de neige. Je les ai regardés un moment. Les pauvres semblaient avoir bien froid et dans leurs yeux j’ai cru lire une sorte de résignation, comme s’ils s’étaient fait à l’idée que le printemps n’arriverait plus jamais.
A un certain moment, j’ai obliqué vers le bois, d’abord parce que j’adore la forêt et puis aussi pour me mettre à l’abri de ce fichu vent d’est, qui soufflait en rafales de plus en plus fort et qui commençait à devenir franchement désagréable. Là, la neige était plus abondante que sur le plateau, parce que le vent, justement, ne l’avait pas emportée et elle était restée là où elle était tombée. C’est donc un beau tapis immaculé de plus de vingt centimètres que je foulais, tout en épiant les traces éventuelles d’un chevreuil ou d’un sanglier. Mais non, le bois semblait inhabité et un silence impressionnant m’entourait. A part quelques empreintes discrètes laissées par un merle au pied d’un arbre, on ne voyait rien d’autre que cette étendue blanche qui recouvrait tout, aussi loin que le regard pouvait porter. Quant à l’emplacement du chemin, il était de plus en plus difficile de le distinguer. Une ou deux fois, j’ai dû m’en écarter, mais comme je connais bien le coin, je parvenais quand même à m’orienter grâce aux arbres et aux rochers et j’arrivais finalement où je voulais arriver : au croisement près du bois de mélèzes, au petit pont sur la rivière, aux gros rochers de schiste échoués là comme de grosses baleines noires en perdition.
J’ai marché comme cela une bonne heure, heureux comme je n’avais plus été depuis longtemps. A un moment donné, je suis arrivé à un endroit où le sentier rejoignait une piste forestière. Faite pour laisser passer les véhicules, celle-ci était relativement large, suffisamment en tout cas pour que le vent ait pu emporter la neige, dont l’épaisseur était ici bien moins importante que dans le bois. Du coup, à droite et à gauche de la piste, on distinguait une couche de glace. Celle-ci devait correspondre aux ornières que les camions de débardage avaient laissées et qui étaient habituellement remplies d’eau. Par prudence, je me suis mis à marcher au milieu du chemin. Je n’avais pas envie, en effet, que la glace cédât sous mon poids. Me retrouver en train de patauger dans une flaque d’eau par ce temps glacial n’était pas trop conseillé. Je faisais donc bien attention où je mettais les pieds quand j’ai remarqué des traces de pas qui provenaient d’un sentier latéral et qui se concentraient elles aussi au milieu de la piste. J’avais d’abord été contrarié en découvrant la présence d’un humain dans cet endroit désert, mais en observant ces empreintes, qui étaient étroites et menues, j’en déduisis aussitôt qu’il s’agissait d’une femme. Je me demandais à quoi celle-ci pouvait bien ressembler. En attendant, je m’amusais à observer les endroits où elle était passée. Quand la glace sur les bords était étroite ou inexistante, les pas avaient tendance à emprunter le côté droit de la piste, mais ils revenaient vite au centre dès que la glace s’élargissait et qu’au milieu l’espace correspondant au sol dur se rétrécissait d’autant. A certains endroits, il ne restait plus que vingt centimètres pour se faufiler entre ces flaques d’eau traitresses, méchamment dissimulées sous leur fine pellicule de glace. Cela m’amusait de mettre mes pas dans ceux de l’inconnue et de savoir qu’elle avait raisonné comme moi quant aux endroits où il convenait de poser le pied.
Parfois je me retournais et je trouvais mignons nos deux pas confondus, tandis que devant, ses traces solitaires me montraient le chemin à suivre. Je me demandais comment tout cela allait finir et si j’allais avoir la chance de rencontrer mon inconnue. J’en étais déjà à imaginer un début de conversation quand je suis resté stupéfait. J’étais arrivé à un endroit où la glace occupait l’entièreté du chemin. Et les pas s’étaient arrêtés là. Ils n’allaient pas plus loin. A gauche et à droite du sentier, la neige était immaculée et vierge. Qu’était devenue la promeneuse solitaire ? Où avait-elle disparu ? Je me mis à écouter le silence de la forêt. Il était impressionnant ! Sans le vouloir, je me suis mis à trembler et inconsciemment mes yeux restaient fixés sur une ouverture dans la glace, au milieu du chemin, une ouverture à travers laquelle on apercevait une eau noire et glacée, immobile et inquiétante.

Photo personnelle, 12.03.13
00:05 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
15/03/2013
Solitude

Photo personnelle, 12 mars 2013
00:05 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (2)
13/03/2013
Réflexion...
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : declaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793
12/03/2013
Expression "à fond de cale" (sept centième note de Marche romane)
Au début de cette année, on avait pu lire ici une petite nouvelle que j’avais intitulée « A fond de cale ». Un lecteur attentif m’avait fait remarquer que cette expression, qui au départ désignait bien la punition d’un marin (lequel restait au secret, enfermé dans la cale), pouvait également signifier pour une voiture le fait d’aller très vite : « Il roulait à fond de cale » Il ne voyait pas bien et moi non plus, à vrai dire, comment on avait bien pu passer d’un sens à l’autre. Depuis, j’ai entrepris quelques recherches et j’ai trouvé ce qui suit.
« Fond » est issu du latin classique « fundus-i » (le fond d’un objet), qui a donné « fundus-oris » en latin populaire, puis « funz » (1080) et « fonz » ou « fons ». Ensuite, on a accolé à ce mot un « d » étymologique, histoire de rappeler d’où venait le mot (et peut-être aussi, me dis-je, pour le distinguer de « fons », fontaine).
Désignant le fond d’un objet, notre substantif signifiait donc aussi la limite, le point extrême de cet objet, d’où des expressions comme « le fond de la misère », « le fond des choses »
Le « fond » est donc l’élément véritable d‘un objet, celui qui est caché à la vue mais qui en constitue la réalité essentielle (voir « le fond des choses », révéler « le fond de sa pensée »).
De cet emploi, viendraient les expressions « au fond » (en réalité) et « dans le fond »
« A fond » reprendrait quant à lui l’idée d’extrémité, mais on serait passé de l’idée de profondeur maximale à celle de grande intensité. D’où « à fond de train » (à toute vitesse).
D’où l’expression récente « à fond la caisse » pour parler d’une voiture (une « caisse ») qui roule non seulement à vive allure, mais même au maximum de sa vitesse.
Notez qu’il ne faut pas confondre « fond » et « fonds ». Ce dernier terme correspond à un emploi particulier de « fond », à savoir la terre cultivée ou sur laquelle on bâtit. De Là, il a désigné les immeubles ou les meubles incorporels (« fonds de commerce ») et par extension le capital dont on dispose (« être en fonds », « à fonds perdus », « fonds publics », etc.)
Mais revenons à notre « fond ». Si on comprend l’expression « à fond la caisse », on comprend moins d’où peut venir « à fond de cale ».
Penchons-nous un peu sur ce mot.
Il faut savoir tout d’abord qu’au même mot « cale » en français, correspondent des étymons différents :
Un étymon germanique
- « Cale » viendrait du germanique « keil ». L’idée serait de germer, de pousser et donc de fendre (comme la graine qui fend la terre). Le mot désigne un morceau de bois (préalablement fendu) qu’on place sous un objet pour le mettre d’aplomb.
- Par extension, on a l’idée d’être installé confortablement (« se caler les joues», « avoir l’estomac bien calé »)
- L’idée de rendre fixe est réalisée dans le domaine technique avec un objet désignant une pièce ou une machine. (« caler le moteur »)
- Quand on parle d’une personne, le sens renvoie plutôt à une défaillance (« elle a calé sur ses maths »).
Un étymon grec
- Le verbe « caler » viendrait du grec khalan (détendre, se relâcher et plus spécifiquement abaisser le mât d’un navire), via l’ancien provençal « calar » (tendre les filets de pêche). Appliqué à la langue nautique, il désignait bien le fait d’abaisser la voile d’une embarcation.
- Le verbe a désigné aussi en moyen français le fait pour un bateau de couler (mais ce sens a été perdu)
- Dès le XIII° siècle, on trouve le mot « cale », formé sur « caler » (descendre, abaisser). Il désigne l’endroit où les marchandises sont descendues. Le syntagme « à fond de cale » renvoie donc à la partie la plus basse de la partie immergée d’un navire.
- Le supplice de la cale consistait à suspendre un marin à bout de vergue et de le plonger (caler, descendre) plusieurs fois dans l’eau, où il se retrouvait immergé.
- Le mot « cale » a désigné aussi la partie en pente d’un quai (qui permettait de descendre le navire dans la mer). D’où l’expression figée « en cale sèche».
- Le « calage », quant à lui, a d’abord désigné le fait de baisser les voiles d’un navire, puis, assez logiquement, le fait pour ce navire de rester immobile. On retrouve ce sens dans « caler le moteur d’une voiture », mais dans ce cas il y a confusion avec le premier étymon de cale (enfoncer, ficher une cale comme un coin).
Le participe passé « calé » qui avait le sens de « dans une bonne position » a fini par prendre le sens de doué (« il est calé en histoire »). « Recalé », par contre, désigne le fait d’avoir échoué à un examen.
Bref, tout cela, c’est très bien, mais nous ne savons toujours pas d’où vient l’expression « à fond de cale » pour désigner la vitesse excessive d’une voiture.
« A fond », on l’a compris, désigne l’intensité, en l’occurrence ici la vitesse maximale que peut atteindre la voiture (de l’endroit le plus profond, on est passé à l’idée d’intensité). Mais pourquoi « cale » ? Je me demande si l’idée ne serait pas que le moteur serait « calé » à fond, au maximum de son régime, le pied restant en permanence sur l’accélérateur enfoncé au maximum. A moins qu’il ne faille passer par les cale-pieds des vélos de course, le pied étant solidement rivé (et pour ainsi dire attaché) sur les pédales afin que toute la force du cycliste puisse être utilisée pour donner de la vitesse au vélo.
Si quelqu’un a une autre idée, elle est la bienvenue.
00:05 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : a fond de cale
08/03/2013
Pluie nocturne
Toute une nuit durant, la pluie est tombée drue,
Drainant des pierres vers la rivière en crue.
Sur le petit sentier qui monte à la maison,
Elle a effacé toutes les traces,
Même celles de tes pas…
Ces traces que je contemplais depuis des jours,
Depuis que tu n’es plus venue me voir.
20:07 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature
04/03/2013
Se mettre sur son trente et un
Voilà une expression qui semble toute simple et dont je ne parviens pourtant pas à trouver l’origine.
Que ce soit dans le dictionnaire des expressions et locutions de Rey et Chantreau ou bien dans le Dictionnaire historique du Robert (toujours par Alain Rey), on ne découvre rien de satisfaisant. On nous dit que le plus logique aurait été le chiffre 9 (= neuf). Puis on aurait multiplié ce chiffre pas deux par une sorte de calembour (se mettre sur son dix-huit, autrement dit mettre des habits deux fois neufs, vraiment neufs) ou par quatre (se mettre sur son trente-six). On trouve effectivement trente-six dans quelques textes, mais on peut lire aussi « se mettre sur son trente-deux » dans le journal des Goncourt et « se mettre sur ses cinquante et un » chez Balzac. Curieux. De là, on aurait ramené le chiffre à trente et un, soit parce que c’est le nombre de jours maximum que comporte un mois, soit parce que le nombre normal des jours serait trente et donc trente et un marquerait un jour un peu exceptionnel.
Honnêtement, toutes ces explications me semblent assez farfelues.
L’explication pour trente-six (« ils se voyaient tous les trente-six du mois », autrement dit pas souvent et même jamais) est plus convaincante. Au départ, trente-six, qui est un multiple de douze, avait la valeur d’un intensif (« voir trente-six chandelles », c’est en voir beaucoup, faire trente-six métiers, etc.). Evidemment, associée aux mois, l’expression a pris un sens opposé : comme il n’y a pas trente-six jours dans un mois, elle a signifié jamais (un peu comme les calendes grecques, qui n’existent pas, ou la semaine des quatre jeudis, qui n’existe pas davantage).
Remarquez qu’être « dans le trente-sixième dessous » (dans une mauvaise situation) indique également une idée d’intensité. La référence serait pourtant le chiffre trois si on en croit Alain Rey.
Trente, quant à lui, vient du latin « triginta » (trois fois dix) formé sur « tres » (trois). Ce « triginta » a donné « trinta » en latin populaire, par contraction et finalement « trenta » vers l’an mil.

00:05 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (10)
01/03/2013
Hiver
On est bien peu de chose
Et les fleurs déjà sont fanées dans le jardin des rêves.
Coupés par l’hiver, les chemins ne mènent plus nulle part
Et la neige a recouvert les tombes de ceux qui se sont tus.
Dans le froid et le silence gelé, un oiseau quelque part a crié.
Reste la forêt, immobile et nue,
Seul espoir d’un printemps qui tarde à venir.
00:05 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
25/02/2013
Patrimoine historique en danger
On se souvient de ce qui s’était passé en Irak, lorsque les troupes américaines avaient pénétré dans Bagdad. Certains avaient profité du chaos qui régnait dans la ville pour piller les musées et faire sortir du pays une série de pièces antiques de haute valeur, afin de les revendre au marché noir. Les Irakiens avaient autre chose à faire, j’imagine, que de surveiller leurs musées et les troupes d’occupation aussi. Ceci dit, il aurait suffit de placer quelques « Marines » devant l’entrée du musée, mais bon, peut-être a-t-on laissé faire volontairement.
Ce qui s’est passé en Irak s’est évidemment reproduit en Libye et se passe actuellement sous nos yeux en Syrie. D’un côté il y a des pilleurs et des voleurs qui profitent du chaos pour s’emparer de tout ce qu’ils peuvent et de l’autre il y a les tirs aveugles, de l’un ou l’autre camp, qui détruisent irrémédiablement un patrimoine inestimable. Sans compter que les musulmans salafistes ne doivent pas avoir un respect très marqué pour les églises chrétiennes du début du christianisme.
La situation est si grave, qu’une réunion s’est tenue à Amman, en Jordanie à l’initiative de l’Unesco afin que les états voisins ne se rendent pas complices malgré eux d’un trafic illégitime.
Quant à ce qui se passe réellement sur le terrain, il est difficile d’en avoir une idée. On sait qu’en février 2012, la ministre syrienne de la Culture, Loubana Mouchaweh, a révélé qu'au moins 18 mosaïques représentant l'Odyssée ont été volées dans le nord-est du pays. Une statue araméenne de bronze plaqué or a également été volée au musée de Hama (centre) Elle a jouté que les possessions des musées syriens ont été placées en lieu sûr. Si c’est vrai, tant mieux. Elle soutient que les musées sont "bien gardés" et que "leurs possessions précieuses pour toute l'humanité ont été archivées et placées dans des lieux très sûrs."
Par contre, pour ce qui est des sites historiques (plus de 10.000 en Syrie !), elle reconnait qu’il est impossible d’en assurer la protection.
La responsable des musées de Syrie, Hiba al-Sakhel, avait quant à elle affirmé que « depuis trois ou quatre mois, les pillages se sont multipliés. Nous avons reçu une vidéo qui montre des gens arrachant des mosaïques au marteau-piqueur à Apamée ».
En faisant quelques recherches sur Internet, j’ai trouvé un texte en français, d’origine iranienne (donc peut-être mensonger, car il visera à discréditer les djihadistes, mais sans doute pas plus mensonger que notre presse occidentale, qui elle, essaie de faire porter le chapeau à Bachar el Assad à tous les coups, même pour ce que son armée n’a pas commis) :
« L'opération de l'armée syrienne lancée dans la ville historique de Tadmar a laissé, au moins, 100 morts chez les terroristes. L'armée nationale visait à protéger les monuments antiques de la ville. 180 miliciens (= djihadistes), bien occupés à détruire et à piller les oeuvres historiques de la localité Tadmar, à Homs, ont été liquidés. Les miliciens trafiquent des objets de valeurs et des oeuvres antiques de la ville vers l'Irak. Les soldats syriens ont, également, empêché les Qaïdistes (= membres d’Al Quaïda) de voler les camions de transport d'essence, à Hassiya, et ont tué, au moins, 7 d'entre eux. L'armée se concentre, davantage, désormais, sur la sauvegarde du patrimoine culturel de la Syrie, depuis que les terroristes ont décapité la statue de l'une des plus célèbres figures de la littérature syrienne, le poète Abou Alla Moari.
Une autre presse, pro-occidentale et donc anti-Assad, celle-là, dit exactement l’inverse :
« Les militaires en opération ne sont pas réputés pour faire dans le détail. S’ils n’hésitent pas à bombarder un immeuble habité par des civils, à plus forte raison rien ne les arrête s’il s’agit de monuments historiques stratégiquement situés dont ils connaissent rarement la valeur ».
Notons toutefois que l’armée américaine n’a pas fait beaucoup mieux en Irak, mais passons. La seule chose à retenir, c’est que le patrimoine architectural antique subit de lourds dommages et peu importe finalement quel camp en est à l’origine.
Or, on ne peut oublier que la civilisation est née dans cette région du monde (croissant fertile) et que différentes cultures se sont succédé sur ces terres d’Orient, chacune laissant une trace de son passage (Assyriens, babyloniens, Grecs, Romains, premiers Chrétiens, etc.). Ce sont tous ces témoignages qui risquent aujourd’hui d’être partiellement détruits par ce conflit.
Ceux qui me lisent régulièrement savent ce que j’en pense. Pour moi c’est l’Occident qui a armé des djihadistes enragés venus des quatre coins du monde pour renverser le régime d’Assad. Celui-ci soutenait le Hezbollah, présentait une menace militaire pour Israël et surtout il « empêchait de faire des affaires » puisque l’économie était en gros aux mains de l’Etat. Donc, pour plaire à Israël et pour que nos entrepreneurs et nos financiers puissent avoir de nouveaux marchés, on n’a pas hésité à créer un conflit, lequel a déjà fait 70.000 morts et qui en plus (même si cela peut sembler accessoire à côté du drame humain) est en train de dévaster des sites historiques de premier plan.
On trouve en Syrie des palais, des monuments, des forteresses, des églises, des mosquées, des villages anciens et des œuvres d’art. Toutes ces richesses sont de diverses origines puisqu’elles remontent aux Babyloniens, aux Assyriens, aux Hittites, aux Phéniciens aux Grecs, aux Romains, aux Byzantins, aux Sassanides (qui représentent l’apogée de la civilisation perse avant l’arrivée des Arabes et de l’Islam), aux Perses, aux Arabes, aux Omeyyades, sans oublier nos croisés et l’empire ottoman.
Mais les nouvelles venant de Syrie sont alarmantes. Malgré un appel solennel de l’Unesco, on apprend que trois des six sites syriens classés au patrimoine mondial par l’Unesco ont été atteints par des bombardements:
-
les cités mortes du massif calcaire à l’ouest d’Alep, où se trouvent de nombreuses églises délaissées vers le VIIIe siècle
-
Bosra, dans le djébel druze, ancienne ville romaine qui possède un vaste théâtre de 15.000 places, parfaitement conservé
-
Le Krak des chevaliers (construit par nos croisés), qui domine la trouée de Homs et est apparemment occupé par des opposants au régime syrien.
Des tirs ont également été signalés à Palmyre. On les attribue à l’armée, laquelle aurait tiré sur des personnes traversant les ruines (peut-être des djihadistes armés…). On dit aussi que des fouilles clandestines ont lieu dans ces ruines.
 On sait aussi que le vieux quartier d’Alep a été détruit par les flammes. Apamée (qui fut construite sur un promontoire en bordure de l’Oronte par Seleucos, l’un des généraux qui recueillirent l’héritage d’Alexandre le Grand) serait intacte, mais le site de la citadelle voisine, Qalaat el Mudiq, habité depuis le néolithique (il y a dix mille ans), a été frappé par des tirs d’artillerie, selon l’Institut français du Proche-Orient, qui y effectuait des travaux de restauration depuis 2004. Selon l’IFPO, « une partie des fortifications médiévales a été atteinte et une voie a été creusée au bulldozer sur les flancs de la colline, dans les niveaux archéologiques ».
On sait aussi que le vieux quartier d’Alep a été détruit par les flammes. Apamée (qui fut construite sur un promontoire en bordure de l’Oronte par Seleucos, l’un des généraux qui recueillirent l’héritage d’Alexandre le Grand) serait intacte, mais le site de la citadelle voisine, Qalaat el Mudiq, habité depuis le néolithique (il y a dix mille ans), a été frappé par des tirs d’artillerie, selon l’Institut français du Proche-Orient, qui y effectuait des travaux de restauration depuis 2004. Selon l’IFPO, « une partie des fortifications médiévales a été atteinte et une voie a été creusée au bulldozer sur les flancs de la colline, dans les niveaux archéologiques ».
A Ebla (Tell Mardikh), dans la région d’Alep, cité-Etat qui rivalisait avec l’Egypte et la Mésopotamie, on avait découvert un palais datant de 4.500 ans, ainsi que 17.000 tablettes cunéiformes révélant une langue sémitique inconnue. Toutes ces œuvres avaient été transportées aux musées d’Idlib et d’Alep. Mais on sait que c’est à Alep qu’ont lieu les affrontements les plus durs, ce qui ne présage rien de bon. De plus, des combats auraient eu lieu sur le site même d’Ebla.
Je ne parle ici que des sites connus, mais il existe une multitude de sites plus modestes, non encore explorés par les archéologues. Ceux-ci sont également au cœur des combats et les pillards s’en donnent à cœur-joie pour emporter tout ce qu’ils peuvent. Ces pillards ne sont généralement pas des amateurs. Ce sont des groupes criminels organisés, qui bénéficient de relais internationaux. On peut donc s’attendre à retrouver chez quelques riches industriels occidentaux une partie de ces vestiges antiques inestimables. Ceux qui auront déclenché la guerre seront encore ceux qui en tireront tous les profits.
A côté des bandes organisées, quelques habitants auront sûrement profité des troubles pour s’emparer de tout ce qu’ils auront pu afin d’arrondir leurs fins de mois particulièrement difficiles ces derniers temps.
Adel Safar, lorsqu’il était Premier ministre de Bachar el Assad, a averti que « des groupes organisés sont prêts à entrer en Syrie, où ils ont déjà introduit des équipements technologiques perfectionnés et des moyens de communication satellite afin de dérober notamment des manuscrits et des antiquités et de s’attaquer aux musées ». Propagande ? J’en doute, car d’autres sources font état de ces pillages. De plus, on sait que le patrimoine syrien n’est pas le seul de la région à avoir souffert des révoltes arabes. En janvier 2011, des pillards se sont introduits dans le Musée du Caire, ont fracturé une dizaine de vitrines qu’ils ont vidées et ont brisé soixante-dix objets. Heureusement, la population s’est interposée et a réussi à attraper quelques pillards.
 Le site bien connu de Saqqarah, près du Caire (célèbre pour ses pyramides à degrés et ses mastabas) a été victime de fouilles sauvages. Et le 17 décembre 2011, l’Institut d’Egypte, fondé en 1798 lors de l’expédition de Bonaparte, a brûlé, avec ses inestimables archives comprenant 200.000 ouvrages. Parmi les pièces les plus précieuses, se trouvait une édition originale de la monumentale Description de l’Egypte. Une véritable catastrophe culturelle, qui n’est pas sans nous rappeler l’incendie de la bibliothèque d’Alexandrie, dans l’Antiquité.
Le site bien connu de Saqqarah, près du Caire (célèbre pour ses pyramides à degrés et ses mastabas) a été victime de fouilles sauvages. Et le 17 décembre 2011, l’Institut d’Egypte, fondé en 1798 lors de l’expédition de Bonaparte, a brûlé, avec ses inestimables archives comprenant 200.000 ouvrages. Parmi les pièces les plus précieuses, se trouvait une édition originale de la monumentale Description de l’Egypte. Une véritable catastrophe culturelle, qui n’est pas sans nous rappeler l’incendie de la bibliothèque d’Alexandrie, dans l’Antiquité.
En Irak, Donald Rumsfeld, avait défendu le ministère du Pétrole, mais pas le musée archéologique de Bagdad. Celui-ci avait immédiatement été pillé (15.400 objets avaient été volés)
A Babylone, cité d’Hammourabi et de Nabuchodonosor, les troupes américaines et polonaises avaient creusé des tranchées en pleine zone archéologique et y avaient installé un héliport. Depuis, dans l’Irak « libéré », c’est un oléoduc qu’ont a construit à travers le site archéologique. On ne s’y prendrait pas mieux pour effacer la culture et les racines d’une nation. Il faut dire que les Américains ont l’habitude. Ils ont déjà pu s’exercer aux Etats-Unis-mêmes sur les Indiens, dont ils avaient volé les terres et massacrer la population.
Et que dire d’Ur, en Chaldée (où selon la Bible Abraham serait né), où des bulldozers ont nivelé des terrains et où des tranchées ont été creusées dans la zone archéologique pour la protection des troupes américaines ?
Si on ajoute à ces destructions liées aux conflits guerriers toutes celles qui ont été faites systématiquement et de volonté délibérée, cela commence à faire beaucoup de pertes.
Je pense aux bouddhas géants détruits par les Talibans en Afghanistan alors qu’ils avaient plus de mille cinq cents ans. Je pense aussi aux mausolées de Tombouctou.
A ce sujet, je voudrais faire deux remarques.
D’abord je me demande jusqu’à quel point notre bonne presse occidentale (qui est aux mains de la classe sociale dominante, celle qui veut aller faire des affaires dans ces pays arabes) ne met pas en évidence ces destructions systématiques (par ailleurs scandaleuses et c’est bien ce que je dénonce ici) pour nous émouvoir et justifier ainsi l’intervention de nos troupes. C’est quand même curieux qu’on ait beaucoup parlé des bouddhas juste avant l’intervention américaine en Afghanistan. Même chose pour Tombouctou. Nul n’ignorait la destruction des mausolées quand la France a envoyé son armée au Mali. Curieusement, on a moins parlé des autres destructions comme les musées pillés en Irak, l’incendie de l’Institut d’Egypte, etc. C’était comme si on mettait en avant certaines destructions et pas d’autres, pour cautionner l’invasion américaine en Afghanistan ou justifier l’envoi des troupes françaises au Mali.
En détruisant ces œuvres d’art, les musulmans intégristes savent ce qu’ils font : ils effacent la mémoire d’un peuple et tentent d’éradiquer ce qui à leurs yeux est une hérésie. On pourrait donc se demander si les bonnes troupes d’occupation des armées occidentales ne pratiquent pas la même politique : en ne protégeant pas les musées des pays conquis, en autorisant les pillages par laxisme, en participant elles-mêmes à la destruction partielle de certains sites sous couvert de motifs militaires (construction d’un héliport, etc.) ne visent-elles pas elles aussi à effacer les origines historiques du pays conquis et donc à détruire sa mémoire ? Le but ultime n’est-il pas de faire de ses habitants de futurs clients de McDonald, des futurs adeptes de la société de consommation et de « l’american way of live » ?
Qui sait ?
En attendant, pour revenir en Syrie, je voudrais terminer cet article en parlant du Krak des chevaliers, situé près de la frontière du Nord-Liban (la frontière est perméable puisqu’elle laisse passer dans uns sens des combattants armés qui entrent en Syrie et dans l’autre des oeuvres d’art qui en sortent). Ce patrimoine n’appartient pas au gouvernement de Bachar el Assad, il appartient à tous les Syriens. Que dis-je ? Il appartient à l’humanité entière car il est un symbole par excellence des rapports historiques (à vrai dire assez belliqueux) entre l’Orient et l’Occident. Or les opposants au régime de Damas (ASL) se sont emparés de ce Krak des chevaliers et ils en interdisent l’accès. Le Figaro se réjouissait cet été de cette occupation par l’ASL, regrettant juste que l’armée régulière tirât sur la citadelle. On aurait pu tenir le raisonnement inverse et dire que les djihadistes feraient mieux de trouver d’autres cachettes que des monuments historiques, mais bon, s’emparer d’une citadelle réputée inexpugnable, c’est toujours tentant lorsqu’on est en guerre. Reste à savoir dans quel état on retrouvera le Krak des chevaliers quand tout sera terminé.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : patrimoine historique en danger, syrie
17/02/2013
Cheval
On parle beaucoup du cheval ces derniers jours.
Cela me semble un juste retour des choses. L'histoire n'est-elle pas cyclique ?


00:21 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (18)
14/02/2013
Afghanistan, Syrie, Mali : partout les mêmes bombardements.
« Dix civils, en grande partie des femmes et des enfants, ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi lors d'un bombardement de l'Otan dans la province du Kunar, un bastion taliban de l'est de l'Afghanistan » peut-on lire dans la presse. Concrètement, cela signifie que rien ne distingue les actions de l’Otan (qui s’était aussi distingué en Libye par ses bombardements intensifs de certaines villes) de celles menées par l’aviation syrienne de Bachar el Assad. Dans les deux cas, le nombre de victimes civiles innocentes est élevé.
La différence, cependant, c’est que l’armée syrienne tente comme elle peut de stopper l’avancée de djihadistes étrangers qui se sont infiltrés sur son territoire et qui déstabilisent le pays. On sait que ces djihadistes n’hésitent pas à tuer, torturer et violer tous ceux qui ne partagent pas leurs convictions religieuses rétrogrades. Que peut donc faire l’armée syrienne ? Si elle laisse ces bandes de rebelles financés et armés par l’Arabie et le Qatar massacrer sa population, on lui reprochera son absence de réaction et on dira qu’elle n’est plus maître du pays. Si elle s’emploie à les attaquer, on lui reproche non seulement les victimes civiles collatérales, mais même la mort des djihadistes. En effet, ceux-ci n’étant pas des soldats au sens strict, ils sont généralement comptés parmi les victimes civiles.
Il y a donc deux poids deux mesures. Il y a les bons bombardements de l’Otan qui luttent contre des terroristes (en fait, généralement des hommes qui s’opposent à l’invasion de leur pays et qu’on avait par ailleurs armés autrefois contre les Russes) et les mauvais bombardements d’Assad, lequel s’en prendrait à de braves opposants épris de démocratie.
Passons. Le parti-pris de notre presse est tellement scandaleux que cela ne vaut même plus la peine de relever ses aberrations.
Par contre, j’entends tous les jours que l’armée française, qui combat aussi de méchants terroristes au Mali (en partie les mêmes qui étaient soutenus, financés et armés par Sarkozy quand ils combattaient Kadhafi pour le plus grand bonheur du groupe pétrolier Total, qui a maintenant la mainmise sur les puits de pétrole libyens) j’entends dire, donc, que l’armée française n’arrête pas de bombarder les quartiers où se sont retranchés les rebelles. Ce qui m‘étonne grandement, c’est l’habileté de nos pilotes, qui, si on en croit la presse toujours, parviennent à tuer les djihadistes (lesquels se sont honteusement dissimulés parmi la population) sans faire de victimes civiles. Curieux. Car avouez que s’il y avait jamais des victimes innocentes, on pourrait reprocher à l’armée française ce que Fabius et Hollande reprochent à Bachar el Assad. Sauf qu’il est chez lui en Syrie et que nous ne sommes pas chez nous au Mali.
Le problème, c’est qu’une certaine presse indépendante commence à donner des exemples de familles décimées par notre aviation. C’est embêtant.
http://www.youtube.com/watch?v=pg4bXBJOHlM
Ce qui est embêtant aussi, c’est que les djihadistes, qui avaient battu en retraite les premiers jours, semblent avoir décidé de passer à la contre-offensive en appliquant la bonne vieille tactique de la guérilla. Cette tactique, on la connaît bien, cela fait des années qu’on essaie de l’éradiquer en Afghanistan et on n’y est jamais arrivé. La preuve, on finit par quitter ce pays en claironnant bien haut notre victoire pour mieux cacher notre défaite. Si les djihadistes au Mali commencent eux aussi avec des attentats suicides et s’ils commencent à miner le terrain, nous sommes partis pour des années de présence militaire et forcément il y aura des victimes dans nos forces armées. Ce n’est pourtant pas ce qu’on nous avait promis lorsque nous sommes partis en guerre. On nous avait promis que cela serait court. Il est vrai que le lendemain on nous a dit que cela durerait le temps qu’il faudrait. Bref, cela signifie que cela peut durer encore longtemps.
Le problème c’est qu’une armée qui combat à l’étranger, cela coûte cher. En cette période de restriction budgétaire où on demande à tous les citoyens de se serrer la ceinture, c’est tout de même un peu dérangeant. Je n’ai personnellement aucune sympathie pour ces djihadistes fous de Dieu, mais au lieu d’aller les combattre au Mali, n’aurait-il pas été plus simple de ne pas les financer autrefois en Libye ? Et ne pourrait-on pas demander à nos amis d’Arabie et du Qatar (pays où la condition de la femme mériterait quand même qu’on pose quelques questions aux dirigeants de ces pays) d’arrêter de financer ces Salafistes qui sont en train de semer la terreur dans tout le monde arabe ?
Non, on ne dira rien, car les actions de ces Salafistes nous arrangent bien. Nous qui nous félicitons de la laïcité de nos institutions, nous sommes en train de faire tomber les uns après les autres les régimes arabes laïcs. La Libye est sous la coupe des anciens d’Al Quaïda et on y remet la Charia au goût du jour, l’Egypte est au bord de la guerre civile, la Tunisie est en proie à une grave crise politique qui risque de se terminer par la prise du pouvoir par des religieux intégristes. Quant à la Syrie, elle pourrait bien éclater demain en une série de petits états confessionnels (un pour les druzes, un pour les Chrétiens, un pour les Alaouites, un pour les Sunnites, sans parler des Kurdes et des Maronites).
Bref, les pays arabes seront exsangues, divisés, en proie à un fanatisme religieux d’un autre âge, et des attentats suicides s’y produiront tous les jours (voyez l’Irak « pacifié » par les troupes américaines). L’avantage, cependant, c’est que nous n’aurons même pas eu à intervenir, puisque les Salafistes auront fait le travail à notre place. Le principal, c’est que les nouveaux dirigeants acceptent d’emprunter auprès du FMI (ce qu’ont déjà fait les Frères musulmans égyptiens). En attendant, le grand gagnant, c’est Israël, qui ne verra plus de nations arabes militairement puissantes à ses frontières. De plus, une fois le fameux printemps arabe terminé, tous ces états seront avant tout confessionnels. On ne sera plus syrien, on sera d’abord Sunnite, comme on ne sera plus tunisien, mais Salafiste de tendance wahhabiste. Voilà qui devrait réjouir les conservateurs israéliens, qui pourront voir dans la religion une justification de leur état. Malraux n’avait-il pas dit que le XXI° siècle serait religieux ou ne serait pas ?
Remarque : en fait, cette phrase de Malraux n’est pas certaine. Il aurait plutôt dit « le XXI° siècle sera mystique ou ne sera pas », ce qui n’est pas tout à fait la même chose. Comme il est possible aussi qu’il n’ait rien dit du tout car personne n’a jamais retrouvé de trace écrite de cette fameuse phrase, l’intéressé lui-même ayant nié l’avoir prononcée. Mais bon, cela sonnait bien à la fin de mon article et après tout on n’est plus à un mensonge près…
00:05 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : syrie, mali
09/02/2013
In memoriam
Toujours, il y aura des personnes pour crier la vérité.
Pas beaucoup, mais il y en aura.
Il y en aura au moins un.
Alors, comme souvent, le croyant seul, d’autres viendront pour le faire taire.
D’où sortent-ils ?
Nul ne le sait, on ne les avait jamais vus, ni ici ni ailleurs.
Peut-être, après tout, étaient-ils bien cachés ?
Mais aujourd’hui, ils sont là, loups hurlant avec la meute, trottant en bande dans nos avenues, piétinant nos rêves.
Et voilà que quatre coups de feu ont retenti, quatre coups de feu qui marquent la fin d’un monde.
Un homme s‘écroule devant chez lui, assassiné au nom d’un livre sacré.
L’ont-ils bien lu, ce livre, ceux qui viennent de tirer, tuant du même coup la liberté, la justice et la vérité ?
Un grand silence s’est fait dans toute la ville, un silence terrible, plus profond que celui du désert.
Les loups s’en donnent à cœur joie. Ils sont maîtres des avenues, ils sont maîtres de nos rêves.
Déjà, ils gravissent les marches du Palais, où leurs pattes laissent des empreintes de sang.
Mais voilà qu’un homme sort de sa maison, puis un autre et encore un autre.
On entend le claquement sec des portes qui se referment derrière eux.
Ils marchent au milieu de l’avenue, ensemble, bientôt rejoints par d’autres encore.
Ils sont maintenant des dizaines, des centaines, des milliers.
Dans leurs yeux, il y a toute l’étendue du désert, toute sa beauté et son grand silence.
Dans leurs yeux il y a l’image de ces arbres qui poussent au milieu des sables et qui ne meurent jamais.
Ils marchent au milieu de l’avenue, ils ne disent rien.
Ils marchent.
Ces lignes sont dédiées à Chokri Belaïd, assassiné cette semaine en Tunisie pour ses idées de gauche.

00:27 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature
03/02/2013
Citation
"L'intelligence, c'est le seul outil qui permet à l'homme de mesurer l'étendue de son malheur."
Pierre Desproges
00:05 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (9)
30/01/2013
La neige
La neige, infiniment blanche, avait tout recouvert.
Elle avait recouvert les routes et les chemins, les plaines et les collines, les villes et les villages.
Fascinés par cette blancheur étincelante qui couvrait le monde, nous en avions oublié nos peines, celles qui se cachent au plus profond de l’être.
Comme des enfants, nous avions marché et joué dans cette neige, image du paradis perdu, jardin de l’insouciance, désert aux congères changeantes comme des dunes de sable blanc.
Puis la pluie est revenue. La pluie et ses tempêtes qui te font si peur, mon amour.
Et avec la pluie, nos peines ensevelies sont réapparues, plus fortes que jamais. Comme si nos routes ne devaient plus jamais se croiser.
21:47 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
















