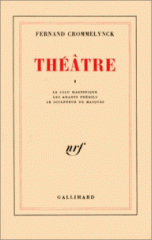14/08/2018
Le faucheur et sa faux
Il faisait chaud, terriblement chaud. Ils avaient travaillé toute la journée dans les champs, à couper le blé blond et à le lier en gerbes plus ou moins égales. Puis le soleil, enfin, s’était couché derrière l’horizon, ensanglantant la campagne et jetant sur les meules une couleur rouge sang. Alors, ils avaient repris leurs outils tranchants à la lame maintenant un peu élimée, et s’étaient dirigés vers le village, par groupes de quatre ou cinq. Ils devisaient en chemin et parlaient de la cambrure de reins des juments et de la beauté des femmes. Ils disaient la soif qu’ils avaient et à quel point leur gosier était sec, après ce dur labeur. Ils racontaient des blagues un peu salaces, par lesquelles ils exprimaient leur envie de finir le nuit près d’une fille brune au regard de feu, une belle fille qui les aurait attendus depuis toujours, et dont la langueur lascive ne pouvait laisser personne indifférent. Ils imaginaient sa peau douce et la manière dont elle gémirait quand ils l’embrasseraient dans le cou. Alors, doucement, ils déboutonneraient son chemisier et moissonneraient à pleines mains les tendres fruits de la passion.
Devisant de la sorte, ils étaient arrivés devant le premier cabaret, où ils firent une halte bien méritée. Le vin rosé coula à flot, ainsi que la bière blonde aux saveurs de houblon. Ils burent plus que de raison, mais on pouvait les comprendre. La journée avait été rude, sous la canicule, et là-bas, les gerbes bien alignées témoignaient de leur dur labeur. Ils parlèrent de nouveau de la qualité des juments et de la courbure des reins des femmes, puis s’en allèrent dans un autre établissement, manger une omelette au lard copieusement arrosée de vin.
Il faisait chaud, très chaud. La nuit était parfois déchirée par un éclair lointain. Un orage était possible et on l’espérait presque, tant la chaleur était étouffante et pour ainsi dire accablante. Après le repas, quelques-uns s’endormirent dans un coin de l’établissement, tandis que la plupart sortirent pour aller s’étendre dans le fenil, où ils s’assoupirent bientôt, écrasés de fatigue. Trois rudes gaillards, cependant, restèrent encore un moment à fumer et à deviser de tout et de rien. Ils commandèrent une nouvelle cruche de vin, tant leur soif semblait inextinguible. Ils parlèrent, comme c’est normal, de leur paie, qui était bien maigre, et de la radinerie des patrons. De fil en aiguille, ils se mirent à comparer les différentes fermes où ils avaient travaillé. Hector, le plus âgé, avait roulé sa bosse aux quatre coins du pays et il avait de l’expérience, aussi l’écoutait-on avec attention. Chaque année, après la moisson dans le Nord, il descendait faire les vendanges dans les Pyrénées Orientales, puis quand l’hiver arrivait, il remontait en Provence pour la cueillette des olives. Il se déplaçait à pied, mais trouvait souvent un attelage charitable qui lui permettait d’épargner ses vieilles chaussures. Une fois, il s’était même aventuré jusqu’en Espagne, où on disait qu’il y avait beaucoup de travail. Il s’était ainsi retrouvé dans les grandes haciendas au fin fond de l’Andalousie. Ah du travail, il y en avait, ça c’était sûr ! Et de la chaleur aussi ! Mais pour ce qui était de la paie, c’était encore pire que partout ailleurs. Là-bas, les patrons, qui possédaient des centaines d’hectares, embauchaient à la journée. Chaque matin il fallait faire la file et c’était le contremaître qui choisissait qui il voulait parmi la centaine de pauvres villageois qui attendaient là, certains presque en guenilles. Chacun espérait être pris, mais il y avait forcément des déçus. Et si on avait la chance d’être accepté, il y avait intérêt à se montrer plein d’ardeur au travail si on voulait avoir la possibilité de travailler de nouveau le lendemain. Bref, c’était de l’exploitation pure et simple et le salaire était une vraie misère. Face à cette injustice, Hector n’avait pas réagi. Qu’aurait-il pu faire face à ces puissants propriétaires ? Rien du tout. Mais il en avait gardé un sentiment de haine et une volonté farouche de vengeance. Il s’était mis à fréquenter des gens proches des syndicats et finalement il était devenu une sorte d’anarchiste. Quand il parlait, tout le monde l’écoutait, tant il s’exprimait avec fougue, mais il fallait bien reconnaître que ses interlocuteurs avaient toujours un petit sourire aux lèvres. Sans doute ne comprenaient-ils pas vraiment le sens profond de ses propos et n’étaient-ils frappés que par sa véhémence outrancière, qui en effet avait un côté comique. Plus il parlait en essayant de convaincre son auditoire, plus celui-ci se montrait ironique à son égard, ce qui avait le don de l’exaspérer.
Ce soir-là, cependant, il ne parla pas de politique ni de lutte des classes. Non, il raconta une belle histoire d’amour. Il expliqua comment lui, l’éternel voyageur sans attaches, l’anarchiste contestataire de l’ordre établi, avait finalement craqué pour une fille qui l’avait ensorcelé au point qu’il avait voulu se marier avec elle. Oui, il aurait été prêt à mener une existence des plus rangées et même à passer devant le curé pour faire bénir les anneaux, c’était tout dire. Elle était belle, délicieusement belle, avec une longue chevelure noire qui descendait en cascades jusqu’au milieu du dos. Elle avait des yeux de braise et quand elle vous regardait, on se sentait transpercé jusqu’au plus profond de son être. N’allez pas croire pour autant qu’elle était provocante. Non, au contraire, elle avait un petit côté timide et réservé qui était tout à fait charmant et qui faisait qu’on avait envie de la protéger.
Il l’avait connue l’année dernière, au moment de la fenaison. C’était la fille du fermier pour lequel il travaillait et c’était elle qui venait vers midi apporter le déjeuner, généralement de grandes tartines de pain gris avec une omelette et du vin rosé qui vous chatouillait la gorge quand vous le buviez. Peut-être d’ailleurs était-ce ce vin qui lui avait tourné la tête et qui lui avait donné le courage de parler à la belle. Oh, avec les autres femmes, il n’avait jamais eu peur, et il n’était pas le dernier à leur faire des sourires ou à leur pincer la taille derrière une meule de foin, mais avec celle-là, c’était différent. Il la trouvait tellement belle et tellement « comme il faut » qu’il n’aurait jamais rien entrepris sans la douce ivresse du vin. Certes, il avait bien remarqué qu’elle le regardait à la dérobée quand elle arrivait avec ses paniers chargés de victuailles, mais il l’idéalisait tellement qu’il la considérait comme inaccessible. Pourtant, un jour de grande chaleur, après avoir mangé, pendant que les autres ouvriers faisaient une sieste à l’ombre des haies, il l’aida à tout remettre en place dans ses paniers et là, par hasard, leurs mains se frôlèrent. Ce simple geste suffit et le regard qu’ils échangèrent alors contenait en germe tout ce qui allait suivre. Le lendemain, ils eurent une longue conversation, ponctuée de sourires complices, et le surlendemain fut le jour du premier baiser. La suite, il n’est pas besoin de la raconter. Pendant que tout le monde faisait la sieste, eux deux allaient s’isoler dans un champ voisin, où une petite cabane servant à ranger les outils leur offrait un lieu idéal pour s’aimer tout à loisir. Il se souviendrait toute sa vie du trouble qui fut le sien en déboutonnant pour la première fois le beau chemisier bleu qu’elle portait avec élégance et qui l’avait tant fait rêver. Il se perdit dans la douceur de ses bras et en ressortit tout hébété, amoureux comme il ne l’avait jamais été.
Les jours passèrent les uns après les autres, et arriva le moment fatal de la fin de la moisson. Il allait falloir partir, trouver un autre travail, et abandonner ce paradis terrestre, où l’Eve éternelle s’était donnée sans retenue. L’idée d’une séparation était intolérable, aussi décidèrent-ils de se voir durant les trois nuits qui restaient à leur disposition. Pour elle, ce n’était pas là une chose facile, car elle devait quitter discrètement le logis paternel sans se faire remarquer et le réintégrer à l’aube, ce qui était encore plus compliqué. Elle le fit pourtant sans hésiter, tant sa passion était forte. Ils dormirent dans les meules de foin ou plutôt dormirent bien peu, car chacun voulait faire le plein d’émotions et conserver de l’autre le plus de souvenirs possible. Ils n’en finirent plus de s’aimer, alliant caresses tendres et fougue érotique.
Mais vint le moment, après la troisième nuit, où le soleil pointa irrémédiablement derrière l’horizon, illuminant de ses rayons les champs remplis de gerbes fraîchement fauchées. L’heure du départ avait sonné et elle fut douloureuse. Ils n’en finissaient plus de se dire adieu, de se quitter pour aussitôt revenir s’embrasser dans des étreintes qu’ils auraient voulu voir durer toujours. Mais c’était la dure réalité, il fallait partir, abandonner ces lieux enchanteurs et cet être fragile qui vous regardait avec désespoir, des larmes plein les yeux.
Il fut le plus fort et finit par s’en aller, non sans avoir assuré qu’il reviendrait dès qu’il le pourrait. Oui, mais quand ? Cela, c’était impossible à dire. Il avait beau promettre, il ne pouvait fixer aucune date avec certitude et quand il se retourna une dernière fois, il vit que les larmes coulaient sur le beau visage de celle qu’il aimait. Alors, pour ne pas pleurer à son tour (ce qui assurément ne lui était jamais arrivé), il fonça vers la forêt, où il disparut bientôt. Une page de sa vie venait de se tourner, mais il ne le savait pas encore.
Le lendemain, il était déjà loin, ayant marché toute la journée et toute la nuit pour tenter d’oublier son chagrin. Il marcha ainsi une semaine entière et finit par trouver du travail dans une petite exploitation assez pauvre dont les champs remplis de pierres ne semblaient pas fort propices à la culture du blé. Il y resta dix jours, le temps de faucher le peu qu’il y avait à récolter, puis il revint d’où il était parti, afin de faire une surprise à sa bienaimée (et surtout afin de pouvoir la tenir une nouvelle fois dans ses bras). C’est en arrivant au village qu’il apprit la nouvelle. De désespoir, la jeune fille s’était jetée dans un étang et on venait de l’enterrer la veille. On disait (mais les gens sont tellement médisants…) on disait que la pauvrette était enceinte et qu’elle avait commis cet acte de désespoir après avoir été chassée du domicile familial par ses parents.
De tels propos étaient évidemment une pure calomnie. Si elle était morte, c’était de désespoir parce qu’elle s’était imaginé ne jamais revoir celui qu’elle aimait. Il le savait bien, lui. Sans rien dire, il se dirigea vers la maison des parents. Il frappa à la porte, mais il n’y avait personne. Alors, il entra discrètement et déposa sur la table de la cuisine l’argent de ses deux dernières paies. Sur l’enveloppe froissée, il écrivit ces simples mots : « Pour Marie », puis il s’en alla.
Quand il eut terminé son histoire, les deux autres se turent, ne sachant que dire. Lui se leva sans un mot et décida d’aller dormir, mais avant de disparaître dans la nuit, il ajouta encore ceci : « Ca s’est passé ici et elle repose au cimetière du village. Si vous allez voir, vous reconnaîtrez sa tombe, j’y ai dessiné un champ de blé avec un faucheur tenant sa faux. Tout le monde croit que ça représente la mort, mais non. C’est une allusion à notre amour au milieu des moissons.»
12:59 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (0)
04/08/2018
Souvenirs
De l’enfance lointaine, au fond des forêts, subsistent des souvenirs de feuilles mortes, d’écorce chaude et d’odeurs sauvages et pénétrantes.
Le village, blotti au creux de la rivière, en épousait toutes les courbes. Les saules pleuraient éternellement et du haut des falaises, des oiseaux fantastiques planaient dans le ciel d’un éternel été.
Sur les routes écolières, par les ponts de bois ou de pierre, nous marchions vers notre devenir.
Sur l’estrade haute, le maître épelait des savoirs antiques et nous l’écoutions, rêveurs, en songeant à toutes ces vies éteintes qui avaient cessé d’être.
Les dimanches étaient désespérants et notre ennui se blottissait au cœur des églises, parmi les chants et les encens mystiques.
Les repas, interminables, prenaient fin avec la nuit, quand les hiboux énigmatiques lançaient des cris incompréhensibles.
Puis l’obscurité nous enveloppait, nous plongeant dans des terreurs primitives. Au milieu de nos rêves, surgissaient des ancêtres inconnus, qui dessinaient d’une main hésitante des animaux étranges sur les parois des grottes.
Ces grottes, nous partions à leur recherche dans l’aube blafarde, quand la terre s’éveillait lentement et que dans les grands chênes le premier oiseau du monde nous saluait.
Il nous fallut toute une vie pour comprendre qu’il n’y avait d’autre trésor que notre enfance, maintenant à jamais perdue.

20:53 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature
01/07/2018
Lune
La forêt a disparu dans la nuit et les ténèbres ont envahi l’espace. C’est alors que la lune mystérieuse s’est levée, d’abord lentement, puis avec plus de franchise. Elle vient d’ailleurs, d’au-delà de nos rêves, et nous réconforte dans notre solitude.
Le paysage nocturne s’est figé dans le grand silence de la mort. Tout ici dort. La vie est abolie, oubliée, inversée.
Dans le ciel noir brillent des feux éteints depuis dix mille ans et leur lumière menteuse n’est qu’une illusion.
En contrebas, s’écoule le grand fleuve, éternel et obstiné. Inéluctable, il dit le temps qui passe et les espoirs des embouchures magiques. Dans le delta sacré, il disparaîtra au milieu d’un océan magnifique. Majestueux, il se dirige vers les lendemains, porteur de nos rêves nocturnes et de nos désespoirs d’enfants.
Solitude. Recevras-tu un jour cette lettre que je te destinais et que je ne t’ai d’ailleurs pas écrite ? A quoi bon ? Quels mots aurais-je pu aligner pour dire les amours passées et évanouies ? Ce qui fut n’est plus et le fleuve d’hier n’est pas celui d’aujourd’hui. Seul son flot obstiné demeure, éternellement, comme le souvenir que j’ai de toi, ancré à jamais en moi. Sur ma table, brille une étoile arrachée au ciel. J’écris un poème qui parle de toi, mais qui ne t’est plus dédié. Comme les étoiles, tu as disparu du ciel nocturne. Quant à la lune, elle a dépassé l’horizon de tous les possibles. La forêt s’est évanouie dans le silence. Il n’y a plus rien qu’un léger souffle de vent, semblable à un soupir de femme. Là-bas, le fleuve s’écoule lentement vers son embouchure, vers ce delta de tous nos désirs.

01:25 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : lune
15/06/2018
Des îles
Il est des îles, là-bas, où des femmes mauresques racontent aux enfants des histoires de marins et de voiliers fantastiques.
Il est une ville, là-bas, où le vent apporte des senteurs marines chaque fois que le soir tombe.
Un grand fleuve fait de souvenirs coule lentement jusqu’à sa bouche océane.
Du haut des falaises du temps, on peut contempler les récifs où se sont brisés tous les rêves.
Dans les cafés enfumés aux vitraux mystiques, des hommes boivent de la bière amère et du vin doux. Ils devisent entre eux sur les femmes inconnues qu’ils ont croisées dans la nuit des cathédrales. Ils se souviennent de leurs regards de feu et du désir qui les a alors consumés. Ils se souviennent de leurs cheveux fauves, de leurs lèvres troublantes, et de leur sourire énigmatique. Ils se racontent les corsages entrouverts et les jupes flottant le long des cuisses nues, comme de grandes voiles invitant aux voyages. Ils parlent et ils boivent, puis s’en vont dans la nuit oublier les fantômes de ces sirènes qui hantent leur mémoire.
Il est des îles, là-bas, où les enfants dorment et où les femmes mauresques rêvent d’un ailleurs étrange. Elles laissent tomber leur robe et contemplent en silence le grand fleuve qui coule dans la nuit jusqu’à l’océan infini.
Il est des îles.
Là-bas.

00:25 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (4)
07/05/2018
Une librairie fantastique (fin)
Le temps passait et il était déjà deux heures du matin. Il devenait urgent d’aller explorer la deuxième salle, celle que les cartons non déballés avaient transformée en un véritable labyrinthe. Il n’y avait plus de bandes dessinées, ici, mais plutôt des livres étranges, sur la magie noire, la sorcellerie, les mondes disparus comme l’Atlantide, les forêts ténébreuses remplies d’esprits, ou encore le monde légendaire du Moyen-Age (la quête du Graal, le château des quatre fils Aymon, le cycle de Charlemagne ou celui de Bretagne). J’ai retrouvé là le « Lancelot du Lac » de Chrétien de Troyes et j’en ai relu quelques pages avec plaisir. Sur le radiateur, traînait une édition bilingue (ancien français–français contemporain) de la « Chanson de Roland », que j’avais étudiée dans ses moindres détails lors de mes lointaines études :
CARLES li reis, nostre emperere magnes,
Set anz tuz pleins ad estet en Espaigne :
Tresqu’en la mer cunquist la tere altaigne.
N’i ad castel ki devant lui remaigne ;
Mur ne citet n’i est remés a fraindre,
Fors Sarraguce, ki est en une muntaigne.
Il me semblait, en lisant ces lignes, que les mots venaient à moi, comme si je les connaissais de toute éternité. J’ai reposé le livre et en ai choisi un autre, consacré à la forêt de Brocéliande. Cette fois, la magie n’opéra pas. J’étais fatigué et mes yeux commençaient à se fermer bien malgré moi. Il était temps de songer à me reposer quelques instants sur le fameux lit de camp dont m’avait parlé le libraire. C’est à ce moment précis que j’ai entendu un bruit dans le fond de la pièce. Une image me traversa soudain l’esprit : la femme que j’avais saluée juste avant la fermeture, où était-elle passée ? Elle n’avait pas pu aller rejoindre le libraire dans son appartement, puisque je m’étais précipité le premier, en entendant le volet de l’entrée qui se fermait. Se pourrait-il qu’elle fût encore là ? Peut-être était-elle, elle aussi, une cliente, fascinée par le monde des livres ? Lisait-elle les aventures de Tristan et Iseult ou bien s’était-elle endormie sur le fameux lit de camp que je convoitais maintenant ? Sans que je sache pourquoi, l’image de la jeune fille dénudée de Thorgal refit subitement surface dans mon esprit, et c’est avec un trouble certain que je me suis avancé vers l’extrémité de la salle. Arrivé contre le mur du fond, je vis dans un coin une espèce de matelas posé sur une structure métallique sommaire. Il n’y avait personne d’autre que moi dans cette salle. Visiblement, mon imagination avait dû me jouer un tour. On ne côtoie pas le monde de l’imaginaire impunément ! Je me couchai sur le matelas et fermai les yeux. Immédiatement, le sommeil s’empara de moi et m’emporta vers les contrées, plus étranges encore, des rêves.
J’étais sur un grand voilier, une sorte de caravelle de l’ancien temps, et je voguais sur une mer d’un bleu intense. Des requins suivaient le navire, menace évidente pour qui serait tombé à l’eau. Pourtant, c’était plus fort que moi, je me penchais très fort, désirant contempler une sirène qui nageait entre deux eaux. Parfois elle folâtrait à ras des flots et je pouvais voir sa longue chevelure ondoyante, ainsi que ses épaules et son dos nus. Parfois, au contraire, elle plongeait plus profondément, semblant m’inviter à la suivre. Alors, attiré comme par une force irrésistible, je me penchais plus fort encore, presque dangereusement, pour tenter de l’apercevoir. Je repensais à Ulysse, qui avait été confronté au chant des sirènes du côté de la Sicile. La mienne ne chantait pas, mais elle me fascinait par son beau corps, qu’elle ne montrait en partie que pour mieux le cacher ensuite. J’étais devenu l’esclave de ce jeu de cache-cache et le dessinateur de Thorgal aurait souri s’il avait dû croquer cette scène en quelques coups de crayon.
A ma grande déconvenue, la sirène disparut soudain, ayant sans doute plongé définitivement dans les eaux bleues de l’océan. J’en étais tout dépité, quand j’entendis un chant qui semblait sortir tout droit de l’abîme. Je me suis réveillé et, ô stupeur, le même chant mélodieux continuait, comme s’il émanait de l’autre extrémité de la pièce. Je me suis levé précautionneusement, le cœur battant, et me suis approché des caisses de livres. Le chant s’arrêta aussitôt, comme celui des cigales quand on passe sous le pin où elles ont élu domicile. De quel sortilège étais-je la victime ? Tout se mélangeait dans ma tête, la sirène, l’esclave nue de la bande dessinée, la jeune femme entrevue ici même hier au soir… Se pourrait-il que celle-ci fût cachée quelque part entre ces caisses ? Je le redoutais et le désirais à la fois. Qui était-elle ? Un être fabuleux, sorti tout droit du monde imaginaire évoqué dans les milliers de livres qui m’entouraient, ou bien un être de chair, désirable comme la sirène de mon rêve ? Finalement, n’étais-je pas moi-même l’esclave de cette attirance pour le corps féminin, qui, par sa différence avec le mien, n’en finissait plus de me fasciner ? Je contournai les boîtes de carton, longeai le radiateur, revint sur mes pas. Personne ! C’est alors qu’il me sembla entendre les ressorts du lit de camp grincer et percevoir comme un petit rire étouffé. J’allais faire un pas dans cette direction, le cœur battant à tout rompre, la peau frémissante de désir, quand une voix virile retentit à l’autre extrémité du magasin.
— Alors, vous avez passé une bonne nuit ? Il est sept heures du matin et je vous apporte le petit déjeuner, vous l’avez bien mérité.
C’était le libraire qui venait de se lever. Il tenait d’une main une assiette remplie de croissants et de l’autre une cafetière fumante.
— Avez-vous pu dormir un peu ? J’espère que le bruit des souris, qui trottinent toute la nuit entre les caisses ne vous a pas trop dérangé ? Certains des visiteurs qui vous ont précédé m’ont dit avoir été importunés par leurs cris et leur sarabande. Il faudrait quand même bien qu’un de ces jours je me décide à poser quelques trappes.
Je le regardai, incrédule.
— Ben oui, poursuivit-il, en versant le café bouillant dans les tasses, il ne faudrait quand même pas qu’elles se mettent à grignoter les livres. Notez que je pourrais acheter un chat, comme on faisait autrefois sur les vieilles caravelles. J’aime les chats et j’adore par-dessus tout caresser leur fourrure soyeuse. Mais ce sont des animaux capricieux, comme les femmes, finalement.
— Comment cela ? Vous n’aimez pas les femmes ?
— Si, bien sûr. Elles sont fascinantes comme des sirènes, mais elles savent aussi nous rendre esclaves de leur beauté. Souvenez-vous d’Ulysse, qui est ainsi resté sept longues années dans l’île de la princesse Calypso, dont il ne parvenait plus à se séparer parce qu’il aimait un peu trop l’éclat de ses yeux et sa nudité de déesse.
— Oui, c’est vrai, vous avez raison. Au fait, croyez-vous qu’il y avait des chats, sur son bateau, pour combattre les souris ?
— Ca se pourrait, en effet. D’ailleurs j’adore l’expression « jouer au chat et à la souris », n’est-ce pas ce que nous faisons, nous les hommes, dans nos rapports avec les femmes ? On ne sait jamais qui attire l’autre, ni surtout qui va gagner à ce jeu de dupes.
Que répondre à cette vérité ? J’ai mangé mon croissant en silence, tout en méditant sur la capacité de la littérature à exprimer toutes ces relations complexes, qui sont au centre de notre vie. Vers huit heures, j’ai pris congé de mon hôte, tout en le remerciant avec un petit sourire pour son hospitalité. Je me suis retrouvé dans la rue et le temps était doux et ensoleillé. Il me fallait maintenant regagner ma voiture, qui devait toujours se trouver dans ce quartier éloigné et délabré où je l’avais laissée. Devant moi, sur la place de la mairie, une jeune femme se dirigeait vers les bâtiments administratifs. Elle portait une jupe courte, qui s’agitait dans la brise matinale, et qui laissait voir ses jambes nues. Je la suivis du regard, incapable de détacher les yeux du mouvement souple de ses hanches. Bientôt elle disparut derrière la porte d’entrée, me renvoyant inexorablement à ma solitude et à mon désir inassouvi.
Je me perdis un peu en recherchant mon véhicule. Quand je le retrouvai enfin, un PV pour stationnement interdit était apposé sur le pare-brise. Voilà une journée qui commençait bien mal !
Otto Greiner - Ulysse et les sirènes

23:38 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (4)
02/05/2018
Une librairie fantastique (2)
Je commençais à me demander pour de bon où je me trouvais, quand j’entendis le volet de l’entrée qui se fermait. Un coup d’œil à ma montre m’indiqua qu’il était dix-neuf heures. Il était plus que temps de sortir de ma rêverie et de m’en retourner chez moi. Mais une fois dans la première pièce, je m’aperçus qu’il n’y avait plus personne ! Des bruits de pas dans un escalier dissimulé derrière une porte attirèrent mon attention.
— Holà ! Monsieur le libraire ? Je suis un client et je voudrais sortir. Comment fait-on ?
Il se pencha par-dessus la rampe et me dit en riant :
— Mais à cette heure on ne sort plus, voyons. Je ferme tous les jours à dix-neuf heures, ce qui est beaucoup plus tard que mes confrères. Alors, tant pis pour les clients qui se font prendre au piège. Ils passent la nuit dans la librairie ! S’ils se sont attardés si tard et se sont laissé surprendre par la fermeture du volet, c’est qu’ils aiment les livres, non ? Alors ils peuvent bien passer une nuit en leur compagnie. Rassurez-vous, vous n’êtes ni le premier ni le dernier à qui cela est arrivé et personne ne s’est encore plaint.
– Quoi ? vous voulez dire que je vais passer la nuit ici ?
— Ben oui, une fois le volet fermé, il n’y a plus d’autre issue vers la rue. Est-ce que par hasard vous n‘aimeriez pas les livres ?
— Si, absolument, mais enfin…
— Eh bien alors, tout est pour le mieux ! Vous verrez, vous ne le regretterez pas. La lampe reste allumée toute la nuit et dans le pire des cas, il y a dans la salle du fond un lit de camp destiné aux visiteurs attardés. Si vous vous trouvez trop fatigué à un certain moment et que vous désirez faire un petit somme, ne vous gênez pas. Faites comme chez vous. Là-dessus, je vous laisse et à demain. Je vous souhaite une joyeuse nuit au milieu de tous les héros des bandes dessinées.
Le libraire se remit à gravir les marches et j’entendis bientôt la porte de son appartement qui se refermait derrière lui. Quelle affaire ! Je n’avais jamais vécu une telle aventure ! Mais après tout, pourquoi pas ? J’aimais les livres, je les adorais, et je n’arrêtais pas de le répéter. Je n’allais quand même pas rechigner devant le fait de passer une nuit en leur compagnie ! Certes, il s’agissait ici essentiellement de bandes dessinées, et le moins que l’on puisse dire c’est que je ne maitrisais pas la matière, mais pourquoi ne pas relever le défi ? Ce serait l’occasion de découvrir un monde pour moi quasi inconnu.
Je me mis donc à parcourir les rayonnages et à prendre une BD de temps à autre. J’ai commencé par celles que je connaissais, comme Tintin ou les Schtroumpfs. Assis par terre, j’ai relu intégralement « Tintin au Tibet » et j’ai retrouvé le sens de l’amitié en partant à la recherche de Tchang dans les neiges himalayennes. Puis ce fut « l’Etoile mystérieuse », avec ses savants fous et ses araignées géantes. Littéralement captivé, j’ai choisi ensuite « Le Trésor de Rackham le Rouge » et c’est avec la même émotion que lorsque j’avais dix ans que j’ai plongé au milieu des requins, revêtu d’un scaphandre, à la recherche du fameux trésor du chevalier de Haddock. Oui, à travers ces bandes dessinées, je retrouvais ma capacité enfantine à m’émerveiller. Car c’était bien grâce aux livres, qu’à peine âgé de six ans, j’avais quitté le monde réel pour celui de l’imagination. J’en avais vaguement conscience, mais là, en relisant tous ces récits, je me rendais bien compte que tout avait débuté à leur contact, un demi-siècle plus tôt.
Il était déjà presque minuit quand je me suis décidé à quitter l’univers de Tintin pour poursuivre mes découvertes. Mais ce fut d’abord pour rechercher une nouvelle fois les autres ouvrages qui avaient accompagné mon enfance : les Schtroumpfs, Michel Vaillant, Tanguy et Laverdure… Deux bonnes heures se passèrent encore en leur compagnie. Comment avais-je pu les oublier, eux qui m’avaient fait tellement rêver ? En parcourant les rayonnages, j’ai même retrouvé Alix, cet esclave gaulois qui vivait dans la Rome antique. Je ne possédais chez moi aucun livre d’Alix, mais je lisais ses aventures à la dérobée, de manière illicite, dans les rayons des grandes surfaces. J’étais fasciné, à l’époque, je m’en souviens très bien, par la semi-nudité des personnages. J’allais bientôt terminer mes primaires, et la pré-adolescence n’était pas loin, qui allait bientôt me laisser pantois devant le corps des filles. Un souvenir me revint. J’avais lu à l’époque dans Thorgal (toujours dans une grande surface) une scène qui m’avait à la fois bouleversé et indiscutablement attiré. Il s’agissait d’une vente aux esclaves et une jeune fille resplendissante était amenée sur une estrade pour être achetée. Pour faire monter le prix, le vendeur n’hésitait pas à la dévêtir complètement d’un geste autoritaire, la laissant complètement nue devant les regards du public. Je me souviens parfaitement d’avoir compati à sa gêne, qu’on devine terrible, mais je sais aussi qu’au même instant je n’en finissais pas d’être fasciné par son corps de déesse, et notamment par sa poitrine, qu’elle tentait de dissimuler d’une main, tandis que de l’autre elle essayait de cacher son sexe. Cette scène avait marqué assurément ma sortie de l’enfance et mon entrée dans l’arène sexuelle de l’adolescence. Il fallait absolument que je retrouve le volume concerné. Je passai une bonne heure à le chercher, mais quand je l’eus enfin en main, c’est avec une émotion indescriptible que je me suis mis à lire l’histoire. Arrivé à la scène décrite plus haut, la même émotion emplit tout mon être. Cette femme, j’avais d’abord envie de la revêtir de sa tunique, pour qu’elle oublie sa nudité forcée, puis de me jeter à ses genoux, pour lui demander pardon de la bestialité des hommes. Pourtant, en même temps, je n’arrêtais pas, malgré moi, d’admirer ses formes parfaites, qui me fascinaient. Rien n’avait donc changé depuis l’époque lointaine où j’avais fait sa « connaissance », car en l’occurrence, on peut bien parler de rencontre, les personnages de papier étant parfois plus présents dans notre imaginaire que les êtres que nous côtoyons tous les jours.

16:01 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (8)
30/04/2018
Une librairie fantastique
Je cherchais, depuis quelque temps déjà, une édition originale de Julien Gracq. Comme mes démarches n’aboutissaient à rien, une connaissance m’avait donné l’adresse d’un bouquiniste obscur qui passait pour collectionner quelques raretés.
— Va donc y jeter un coup d’œil, m’avait-il dit, si tu ne trouves pas là ce que tu recherches, tu ne le trouveras nulle part ailleurs.
Je n’avais rien à perdre, aussi avais-je donc décidé de suivre son conseil. La fameuse boutique se situait, paraît-il, près de la place de la mairie à La Louverie. Comme ce n’était pas trop loin de chez moi, je me suis donc mis en route. Trouver la mairie ne fut pas un problème, par contre trouver un emplacement de parking le fut bien davantage. Après avoir tourné pendant une bonne demi-heure, il fallut bien me résoudre à garer ma voiture dans un quartier passablement éloigné du centre névralgique et politique de cette cité au lourd passé industriel. Après avoir longé à pied quelques rues aux maisons basses et avoir traversé des friches et des terrains vagues où, je suppose, devaient être implantées autrefois les usines qui avaient fait la prospérité de la région, je me suis enfin retrouvé sur la place de la mairie. C’était une espèce de grand espace désert, entouré de bâtiments administratifs et d’une banque. En tout cas, rien dans ce paysage qui ressemblât à une échoppe de bouquiniste. J’ai fait deux fois le tour de la place, puis j’ai parcouru dans les rues adjacentes, rien. Je commençais sérieusement à me demander si mon ami ne m’avait pas fait une méchante blague aussi, pour en avoir le cœur net, ai-je abordé le premier passant rencontré. C’était un adolescent, plongé comme de bien entendu dans la lecture de son portable. Il parut passablement étonné que je lui adresse la parole et j’ai débord cru qu’il allait s’enfuir. Mais non, poliment, il a ôté le casque qui recouvrait ses oreilles et m’a écouté attentivement.
Une librairie dans le quartier de la mairie ? Non, ça ne lui disait pas grand-chose. Il faut dire qu’il n’était pas grand amateur de livres, mais quand même, il aurait dû la connaître, il était du coin. Non, franchement il ne voyait pas. Il interpella alors un de ses copains, qui lui aussi semblait plongé dans la lecture attentive de son Iphone. Celui-là ne lisait pas non plus et honnêtement, les librairies, ce n’était pas son truc, mais il croyait savoir que dans une des rues adjacentes, il y avait du côté droit une petite ruelle où pourrait bien se trouver ce que je cherchais. En tout cas, lui qui traînait sur la place à longueur de journée, il avait déjà vu des passants sortir de cette ruelle en tenant des bouquins sous le bras. Après avoir remercié les deux jeunes, je pris donc la direction indiquée et en effet, je trouvai la ruelle en question et tout au bout la librairie tant recherchée. J’en poussai la porte avec une joie non dissimulée, persuadé que j’allais enfin mettre la main sur le fameux original de Gracq que j’espérais trouver depuis si longtemps.
Une fois à l’intérieur, je compris immédiatement que je m’étais trompé d’enseigne, car on ne vendait ici que des bandes dessinées. Pourtant, loin d’être déçu, je suis immédiatement resté en admiration devant ce qui s’offrait à moi. J’étais entré dans une véritable caverne d’Alli Baba. Les étagères couvraient les murs jusqu’au plafond et il n’y avait pas un rayonnage qui ne fût entièrement rempli. Je ne sais pas combien de bandes dessinées devaient se trouver là, mais assurément je n’en avais jamais vu autant.
— Bonjour, me dit le libraire.
— Heu… Bonjour.
Je ne l’avais pas vu, celui-là ! A moitié caché derrière son comptoir sur lequel s’empilait un amoncellement de boîtes et de livres, je n’avais même pas remarqué sa présence, tout occupé que j’étais à admirer la somme prodigieuse de bouquins que renfermait cette boutique. Car c’était bien d’une boutique qu’il s’agissait. Rien de pompeux, ici, pas d’étagères en chêne ou de comptoir vernissé. Non, mais de vieux rayonnages qui ployaient sous le poids des volumes. Le tout avait une vague ressemblance avec les vieilles épiceries de village, que nous avons tous connues dans notre prime enfance. Aucun luxe en ces lieux, mais on y trouvait de tout.
— Vous cherchez quelque chose de précis ?
— Heu non, ou plutôt oui, mais je crois que je me suis trompé de librairie. Cependant, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, je vais quand même jeter un coup d’œil.
— Faites seulement, faites, les livres sont là pour être admirés et consultés.
Cette réponse me plut. J’avais affaire à un passionné, cela se sentait, et d’ailleurs l’atmosphère qui se dégageait de toute la boutique le prouvait à suffisance. Je m’avançai sur un vieux tapis tout usé, qui laissait voir par intermittence le carrelage qu’il avait dû recouvrir un siècle plus tôt, mais qu’il était bien incapable de dissimuler aujourd‘hui, tant il était troué. Curieusement, ce détail me plut au plus haut point. Manifestement le tenancier n’était pas là pour faire fortune ni pour épater le client. Non, s’il se tenait derrière son comptoir, ce n’était pas pour compter les billets de banque gagnés au cours de la journée, mais parce qu’il aimait les bandes dessinées et qu’il voulait faire partager sa passion. C’était son métier, cependant, et on se demandait bien comment il parvenait à boucler les fins de mois, car j’étais manifestement le seul curieux à flâner entre les rayonnages. Pourtant, la quantité de livres présents prouvait qu’on n’était pas à la fin d’une époque plus glorieuse ou à la veille d’une faillite. Il fallait croire que le bonhomme parvenait à s’y retrouver tout de même, même s’il ne devait pas rouler sur l’or.
Je continuai ma visite et passai dans la seconde salle. C’était un capharnaüm incroyable ! Non seulement les mêmes rayonnages continuaient à couvrir les murs jusqu’au plafond, mais en plus il fallait cheminer entre des caisses non déballées qui constituaient une sorte de labyrinthe au milieu de la pièce. Ajoutez à cela un radiateur volumineux et décentré qu’il fallait contourner, et une ou deux tables où s’amoncelaient pêle-mêle des jeux vidéo et des livres sur la forêt de Brocéliande ou les légendes galloises et irlandaises. Au sol, le même tapis miteux continuait d’avouer son âge et montrait à travers ses nombreux trous un carrelage d’une époque elle aussi révolue. Tout au bout, derrière une pile de bouquins, une jeune femme se tenait debout. Elle me sourit et me fit un petit signe de la main. Ce devait être l’épouse du libraire et je lui rendis son sourire.
(à suivre)

01:14 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (3)
27/02/2018
Le canal
Les mouettes blanches se reflètent dans le miroir du canal noir.
Elles proviennent de la mer lointaine
Et tournent dans le ciel gris des hivers du Nord
Fantômes évanescents
Qui disent nos peurs devant la mort qui s’avance
Derrière les peupliers de la rive
Dans la brume matinale
Se dresse un clocher solitaire
Dont l’horloge égrène le temps
Au pied de la petite église je sais qu’il est un cimetière
Aux tombes oubliées
Où reposent ceux qui n’étaient que de passage
Eux aussi autrefois ont contemplé les mouettes aux grandes ailes
Et tout en marchant le long du canal
Ils ont compté les coups du clocher
Avant que de devenir fantômes
Dans la brume de notre mémoire
William Degouve de Nuncques Brume sur le canal (1908)

00:46 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (6)
17/02/2018
Aube marine
Là-bas il y aura la mer derrière la dernière dune
La mer la plage et le sable
Et puis l’infini du monde
Dans le vent planeront des oiseaux aux cris de tempête
A l’horizon disparaîtra un dernier navire en partance pour les îles
La nuit le vent soufflera sur la lande et quand l’aube se lèvera sur les champs de la mémoire
Nous raconterons nos batailles, nos peines et nos peurs
Nous raconterons nos espoirs nos amours et nos morts
Et puis tout ce qu’il a fallu oublier pour continuer à vivre

00:10 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (4)
11/02/2018
Paysage
J’ai vogué sur l’océan et me suis laissé emporter par les vagues de ton corps
J’ai aimé ce rivage humide et ta peau brûlée de soleil que caressaient mes doigts
Je t’ai aimée, toi, ta source, et les collines qui surplombaient la mer
Un petit chemin en descend qui serpente vers le rivage et la grotte des sirènes
C’est là que jaillit la fontaine au pied des falaises entre des pierres moussues
C’est là que je reviens sans cesse en répétant ton nom
Plus loin gronde l’océan et ses tempêtes meurtrières
11:44 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (3)
18/01/2018
Emile Verhaeren
08:43 | Lien permanent | Commentaires (0)
12/01/2018
Les espaces infinis
Tout qui regarde les étoiles ne peut qu’être fasciné par l’étendue du cosmos. Déjà on ne comprend pas bien comment la terre a pu se constituer et nous offrir un endroit où vivre, mais on comprend encore moins quand on contemple le firmament et qu’on se dit qu’il y a là des milliards et des milliards d’étoiles, autrement dit et pour faire simple, des milliards de soleils semblables au nôtre, et autour desquels doivent certainement graviter des planètes.
Pourquoi tout cela ? Pourquoi autant de matière en mouvement et pourquoi cette énergie dépensée ? Cela laisse rêveur. Certains y voient la toute-puissance d’un dieu, d’autres plus sceptiques, tentent d’expliquer ce phénomène par le hasard. « Le hasard fait bien les choses » dit le proverbe, mais quand même… Certes, vu ces milliards d’étoiles, on se dit que la probabilité que la vie existe ailleurs dans l’univers est réelle. Il suffit d’un peu de chance et de la combinaison de certains éléments. Oui, sauf que pour expliquer l’apparition de la vie sur terre, il en a déjà fallu beaucoup, de conditions. Et on ne voit toujours pas très bien comment en mélangeant de la matière inerte on est parvenu à créer la vie. Les scientifiques, sur ce point-là, sont assez décevants, puisqu’ils nous disent que la vie viendrait de l’espace. Ce serait des comètes, des météorites ou que sais-je qui en s’écrasant sur notre bonne vieille planète, auraient apporté les éléments nécessaires à la vie. Bref, ils ne valent pas mieux que les religieux qui expliquent le monde par l’existence d’une divinité mais qui ne nous disent jamais pourquoi cette divinité existait préalablement. On tourne donc en rond, ce qui est logique me direz-vous, quand on parle de planètes et de corps célestes.
Ceci dit, ces corps célestes ne tournent pas tous en rond. Non, l’univers est en expansion constante et toute la matière du cosmos progresse à une vitesse vertigineuse en ligne droite dans toutes les directions. Tout cela à cause du big-bang, l’explosion primitive. Très bien. Mais si on comprend en effet qu’une explosion a pu donner cet éparpillement de matière, cela ne nous dit pas encore ce qu’il y avait avant cette explosion, quelle planète primitive aurait ainsi explosé. Une nouvelle fois, on est incapable d’expliquer quoi que ce soit.
Mais il y a plus fort encore. Ces galaxies, formées de milliers d’étoiles (toutes à des stades différents de leur combustion), que l’on peut observer avec des télescopes de plus en plus puissants (ce qui ne résout rien mais ne fait que nous faire prendre conscience du gigantisme de l’univers), ces galaxies, dis-je, que nous voyons aujourd’hui, n’existent peut-être plus. Malgré la vitesse de la lumière, il a fallu des milliers d’années pour que leur rayonnement nous parvienne et les conclusions que nous tirons sur leur masse, leur forme et leur agencement, reflètent une situation antérieure qui n’est plus celle d’aujourd’hui. Pour le dire autrement, nous voyons ce qui a existé il y a mille, dix mille ou cent mille ans. Bref, les étoiles qui parsèment notre ciel sont un leurre. Si ça se trouve, elles sont déjà toutes mortes et nous n’en savons rien. C’est effrayant. Nous revoilà, pauvres humains, seuls dans l’univers, sur une planète qui tourne autour d’un soleil qui bientôt va s’éteindre, à contempler des étoiles qui n’existent peut-être plus. Une telle idée donne le vertige et nous fait comprendre que nous ne sommes pas grand-chose. L’homme (pardon, je veux dire l’être humain, sinon les femmes partisanes de l’orthographe inclusive vont me tomber dessus à la vitesse d’une comète enflammée) ne serait donc pas le centre de l’univers, comme on le dit dans la bible, mais perdu dans la nuit et fruit du hasard dans un univers en expansion.
De plus, il semblerait que cette fameuse expansion doive un jour s’arrêter. Les scientifiques pensent qu’il il y a de moins en moins d’étoiles plus on avance dans le temps. C’est assez logique, finalement. Après l’explosion primitive, l’énergie était considérable et les étoiles incandescentes se sont ruées vers les limites de l’infini. Mais les milliards d’années passant, elles ont perdu de leur force. Beaucoup déjà se sont éteintes (comme notre soleil le fera un jour) et on peut supposer qu’un jour viendra où il n’y aura plus rien de lumineux. Le ciel alors sera noir et la vie aura disparu. Voilà qui n’est certes pas réjouissant. Reste la question initiale : pourquoi tout cela ? Quel a été le but de ce gigantesque embrasement ?
Bon, vous me direz qu’on a le temps de voir venir et qu’en ce qui concerne notre petite terre, le soleil la réchauffera encore longtemps. Hélas, ce n’est pas si sûr ou plus exactement nous pourrions tous mourir à cause précisément du rayonnement de ce soleil. Tout le monde connaît le problème de la couche d’ozone, mais il y en a d’autres. Je veux parler du magnétisme (ce qui fait que l’aiguille d’une boussole marque le Nord ou presque). Ce magnétisme nous protège du vent solaire, ces particules de notre étoile dont nous sommes bombardés sans arrêt et qui sont déjouées justement grâce au magnétisme terrestre. Mais il apparaît que celui-ci s’inverse périodiquement (tous les 780.000 ans environ). A ce moment, l’aiguille de notre boussole se tourne vers le pôle Sud. En soi ce n’est pas grave, sauf que pendant une courte période (entre 1.000 et 10.000 ans) les pôles magnétiques se déplacent n’importe où sur la surface du globe ou même disparaissent provisoirement, ce qui laissera suffisamment de temps au vent solaire pour anéantir toute vie.
Bref, nous vivons dangereusement, je trouve, et ne savons toujours pas pourquoi nous sommes là

00:05 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (8)
08/01/2018
Epiphanie
(Reprise de l’article paru le 04.01.16)
Épiphanie : du grec « τ α ̀ Ε π ι φ α ́ ν ι α » neutre pluriel substantivé de l’adjectif « ε ̓ π ι φ α ́ ν ι ο ς », « qui apparaît ». Le verbe « ε ̓ π ι φ α ι ́ ν ω » signifie par ailleurs « faire voir, montrer » (l’idée première est celle de la lumière du soleil qui éclaire).
Dans l’Eglise catholique, L’Epiphanie désigne donc la manière dont le Christ se manifeste auprès des hommes (baptême dans le Jourdain, transformation de l'eau en vin aux noces de Cana, etc.)
Ensuite, la tradition a restreint l'usage du mot Épiphanie à la visite des mages, qui étaient sans doute des prêtres zoroastriens.
Zoroastre, aussi appelé Zarathoustra, est un prophète perse (plus ou moins contemporain de Périclès en Grèce) qui eut une révélation du dieu Mazda. Il s’ensuivit une religion qui est une des premières à être monothéiste et qui parlait déjà de l’immortalité de l’âme et du jugement dernier. Elle a donc directement influencé le christianisme, qui est loin d’avoir tout inventé.
Mais revenons à nos mages. Selon saint Matthieu, ceux-ci furent guidés jusqu’à la crèche par une étoile (sans doute notre évangéliste voulait-il signifier par-là que le vieux monothéisme zoroastrien se soumettait au nouveau Messie qu’était le Christ). Ce récit, qui n’a évidemment aucun fondement historique, a pris beaucoup d’importance au Moyen Âge, où les mages sont même devenus des rois (prénommés par ailleurs Gaspard, Melchior et Balthazar). Notons parmi eux la présence d’un Africain noir (sans doute pour indiquer que la venue du Christ concernait tous les hommes)
L'Épiphanie se célèbre le 6 janvier, mais ces derniers temps l'Église catholique a préféré la fixer au premier dimanche qui suit le 1er janvier.
Quant à la galette des Rois (une réminiscence des Saturnales romaines et de la fête païenne du Soleil, lequel était représenté par une galette ronde), si l’on en croit les historiens, la fameuse fève cachée dans le gâteau rappellerait l'Enfant Jésus que les mages, les yeux fixés sur leur étoile, avaient mis pas mal de temps à découvrir. Vous n’oublierez pas ce détail, j’en suis sûr, lorsque vous dégusterez votre galette.
Notons encore que si en France les enfants reçoivent des cadeaux à Noël (les adultes aussi, d’ailleurs, sans doute parce qu’ils sont restés de grands enfants), en Belgique c’est Saint Nicolas (le six décembre) qui leur apporte des jouets. En Espagne, par contre, ces sont bien les rois mages qui remplissent cette fonction le six janvier.
Lorenzo Monaco, l'Adoration des mages (vers 1422), Florence, Gallerie des Offices

08:25 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (9)
25/12/2017
Charles De Coster
22:40 | Lien permanent | Commentaires (2)
06/12/2017
Des signes symboliques
On savait que des personnes bien intentionnées ont attaqué les livres de Tintin car ils véhiculaient des thèmes coloniaux et que certains personnages de cette bande dessinée tenaient des propos condescendants envers la race noire. C’est vrai que lorsqu’il lit « Tintin au Congo », le lecteur contemporain sent tout le décalage qui existe entre notre époque et celle où Hergé a écrit ce livre. Le constater et en prendre conscience est peut-être plus important que de faire interdire la vente du livre.
Mais nous sommes dans une société où il est de bon ton de tout contester. On a vu ainsi que le personnage du père fouettard, qui accompagne traditionnellement le bon Saint Nicolas, a été vivement critiqué aux Pays-Bas. Faire tenir le rôle du domestique subalterne à un Noir a paru choquant et en faire un méchant qui punit les enfants (et les effraie par la couleur de sa peau) en a ému plus d’un. Certes, tout ce que disent ces braves gens est cohérent et ils n’ont pas tort, mais ne risque-t-on pas, en les écoutant, de bannir de notre culture les éléments traditionnels qui en font la base ? Car on ne s’arrête plus. Après avoir contesté l’existence même du père fouettard, on a retiré la croix de la mitre de Saint Nicolas, qui était pourtant évêque de Myre (ville antique de Lycie, au sud-ouest de l'Anatolie, sur le fleuve Myros) entre 250 et 270. Certains y ont vu la main du mouvement de la laïcité, d’autres ont imaginé qu’il s’agissait là d’une sorte de complaisance à l’égard du monde musulman. Dans tous les cas, les esprits ont commencé à s’échauffer, de la gauche laïque à l’extrême-droite raciste. Ceci dit, cela semble devenir une habitude de supprimer les croix partout où elles se trouvent. On se souvient de la publicité récente d’une chaîne de grande surface qui avait effacé les croix sur les dômes des églises grecques pour mieux vendre du yoghourt ou du fromage. Là encore il s’agissait de ne pas heurter le client potentiel, qu’il soit indifférent à la religion ou au contraire musulman irascible.
Moi qui ne suis pas croyant du tout (et c’est un euphémisme), je regrette pourtant cette manière sournoise de venir effacer des symboles culturels traditionnels. Saint Nicolas est la fête des enfants et à ce titre fait partie de notre patrimoine depuis des siècles. Pour la petite histoire, au dixième siècle une relique du saint (une phalange) a été transférée depuis Bari vers le Duché de Lorraine. Une basilique a ensuite été dédiée au saint, qui très rapidement est devenu le saint-patron de la Lorraine. La région étant un centre commercial avec les grandes foires qui y étaient organisées, le culte de Saint-Nicolas se répandit très rapidement, notamment en Belgique et en Allemagne. Voilà pourquoi cette fête est toujours célébrée aujourd’hui dans ces régions. Alors je trouve regrettable de commencer à édulcorer l’image traditionnelle pour la faire correspondre à une vision contemporaine neutre et insipide.
Où s’arrêtera-t-on ? Après Tintin et Saint Nicolas, c’est maintenant au conte de la Belle au bois dormant d’être la cible de féministes intransigeantes. On se souvient de cette histoire : la belle princesse est victime d’un sortilège et s’endort pour l’éternité jusqu’au moment où un prince vient la sortir de sa torpeur en lui donnant un baiser. J’avais toujours trouvé tout cela merveilleux et poétique. Un bel hommage à l’amour en quelque sorte. Mais non, on voit maintenant dans le geste salvateur du prince un comportement machiste dominateur. Embrasser une femme de force, sans son consentement ! Scandale ! Et on demande à l’école de ne plus donner à lire un tel livre de contes, qui risquerait de pervertir la jeunesse ou en tout cas les petits garçons, lesquels en effet, en lisant de telles histoires pernicieuses, risqueraient bien de devenir des violeurs potentiels à l’âge adulte.

19:45 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (19)
26/11/2017
Sans nouvelles d'elle
Cette nouvelle était parue ici même, sur Marche romane, il y a très longtemps. L'idée m'en était venue après des échanges par mails que j'avais eus à l'époque avec une interlocutrice. Nous avions beaucoup parlé de la littérature et du poète Jaccottet notamment. J'étais donc parti de cet échange fructueux avec une inconnue pour écrire cette nouvelle, totalement imaginaire.
L'opportunité m'a été donnée de la reprendre et de la publier dans la revue en ligne "ONUPHRIUS".
Sur le plan du style, des détails ont été corrigés, suite aux conseils judicieux de Jean-David Herschel, que je remercie au passage pour sa perspicacité.
11:27 | Lien permanent | Commentaires (10)
21/11/2017
Victor Serge
00:46 | Lien permanent | Commentaires (0)
27/10/2017
"La pomme ne tombe pas loin du pommier" de Bertrand Redonnet, Cédalion, août 2017
Voilà assurément un livre que je vous recommande. Une belle histoire, sensible et émouvante, où la destinée individuelle est mise en parallèle avec la destinée de l’humanité toute entière. La scène se passe toujours, dans les livres de l’ami Redonnet, ou bien sur les terres de l’Ouest, battues par les vents de l’Atlantique (les Charentes, le marais Poitevin, la Vienne) ou bien dans l’Est de la Pologne. Pas étonnant puisque cet auteur est originaire de la Vienne et qu’il vit aujourd’hui en Pologne. Dans son dernier roman, c’est encore plus simple, puisque les héros passent alternativement d’une région à l’autre. Mais s’il y a évidemment une part d’autobiographie derrière tout cela, ce n’est pas le but recherché. Les thèmes traités, ce sont plutôt les paysages et l’Histoire. On y parle de ces résistants polonais qui se sont battus contre les Nazis avant de retourner leurs armes contre le « libérateur » russe, qui se montrait tout aussi envahissant que son prédécesseur. Après quelques années de combat utopique, un jeune couple, traqué par les autorités, prend le chemin de l’exil et se retrouve sur les rivages de l’Atlantique, où il s’établit.
Soixante ans plus tard, leur fils veut partir à la découverte du pays de ses parents, cette Pologne mythique où il sait qu’ils ont été des héros. Il refait donc le chemin à l’envers. Non seulement celui de ses géniteurs, mais aussi celui des grandes migrations du temps du néolithique. Car dans son verger charentais, on vient de découvrir une nécropole préhistorique. Le lecteur est donc invité à réfléchir sur le sentiment d’appartenance. Sommes-nous de la terre qui nous a vus naître ? Oui et non car nos ancêtres lointains, finalement, venaient d’ailleurs. Nous sommes donc tous des migrants ou si l’on veut des exilés (et là on voit poindre la réflexion existentielle fondamentale : qui sommes-nous ?)
Mais une fois parvenu en Pologne, le héros découvre un autre aspect de ses parents qu’il n’avait pas imaginé. La guerre est cruelle et est faite de sang et de barbarie. L’image idéalisée du père en prend un coup ! Le fils a-t-il bien fait de venir, finalement ? D’autant plus qu’il a laissé en France une sympathique archéologue qui ne lui voulait que du bien et avec qui il aurait mieux fait de faire sa vie plutôt que de courir après des fantômes.
Ce voyage initiatique, à la recherche des siens et surtout de lui-même, l’amène devant cette forêt primitive qui existe vraiment en Pologne, à la frontière biélorusse : la forêt de Białowieża, qui est un reste de l’immense sylve qui recouvrait autrefois le contient jusqu’à l’Atlantique. On y trouve des loups, des lynx et les derniers bisons d’Europe. C’est donc là qu’est le pays de son père, mais c’est aussi un peu le berceau de l’humanité car c’est dans un environnement semblable qu’ont vécu les hommes de la préhistoire, comme ceux dont on a retrouvé les squelettes en Charente.
Le livre est donc un va-et-vient perpétuel entre le passé et le présent, entre ici et ailleurs, entre l historie individuelle et celle de toute l’humanité.
Tout est décrit avec nuance (le père héroïque n'est-il pas finalement un vulgaire assassin ? Et les Russes libérateurs des nazis ne sont finalement que d'affreux occupants).Il y a des scènes tendres et pudiques (la rencontre avec Maryse, l’archéologue ou avec la tenancière d’un hôtel en Pologne). Il y a des personnages hauts en couleur (le vieux Jozef, qui a vécu toutes les guerres et qui connaît bien la forêt et les hommes, ou Nestor Augérant, ce Charentais qui avait accueilli à bras ouverts le jeune couple de migrants en fuite).
J’ai adoré ce livre et si on est captivé par l'histoire, derrière celle-ci il y a surtout de la réflexion (sur le temps, l'Histoire des hommes, le destin, le hasard, etc.). Et puis cette question : qui sommes-nous si nous dépendons des événements ? Le vieux Jozef donne la réponse : il ne faut pas juger de nos actes anciens selon notre point de vue d'aujourd'hui. Ce chemin à rebours du fils vers la Pologne de ses parents (qui n'avaient fait que reproduire les migrations néolithiques) et vers cette forêt primitive, nous renvoie à nos propres origines et à celles de toute l'humanité..
Un beau livre, vraiment. !

00:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (16)
23/10/2017
L'esprit de la forêt
Prends le chemin et marche jusqu’au bois. Passe le petit pont de pierre et pénètre dans la forêt profonde. Tu n’as qu’à suivre le sentier, c’est facile et même si personne ne l’emprunte jamais, il est bien tracé. Laisse à ta droite la grande sapinière. Tu entendras peut-être ce qui pourrait ressembler à un soupir. Ne t’arrête pas et surtout ne regarde pas ! Il ne s’agit pas du bruit du vent dans les branches, comme tu pourrais le croire, mais des esprits des bêtes sauvages. Il ne faut pas les déranger, ils ne te connaissent pas. Ils pourraient s’effrayer ou se courroucer.
Continue ta promenade. Si tu vois des champignons le long du chemin, salue-les, car ils sont en communication permanente avec les royaumes souterrains, là où règnent les âmes qui se sont tues, celles que tu as aimées.
A ta gauche, si tu marches d’un bon pas, tu verras bientôt de grands chênes qui montent vers le ciel. Ils sont immenses et ont plus de trois cents ans. La, tu t’arrêteras et t’assoiras sur la mousse. Ne dis rien, écoute. Cela peut prendre un certain temps, ne te décourage pas. Ferme les yeux, concentre-toi. Oublie tous tes soucis du jour, tous tes cauchemars de la nuit, et toutes les blessures que les hommes t’ont infligées. Ne pense plus à rien, chasse toutes les idées qui envahissent ton esprit, surtout les mauvaises. S’il ne se passe toujours rien, souviens-toi d’un lieu agréable, où tu as éprouvé de la joie. Penses-y très fort et essaie de te remettre dans le contexte de l’époque. Descends en toi, au plus profond. Bientôt, une sorte de joie va t’envahir. Tu seras redevenu celui que tu étais ce jour-là, dans ce lieu-là. Que tu le veuilles ou non, tu vas te mettre à sourire. Tes muscles vont se détendre et ton esprit va s’apaiser. C’est alors que tu vas les entendre. Cela ressemblera à des notes de musique, d’abord dispersées, puis qui finiront par se transformer en une sorte de mélodie. Ouvre alors les yeux et contemple les grands chênes. Tu les verras beaucoup plus beaux et beaucoup plus grands que précédemment. Et tu entendras leur musique. Ce sera comme un murmure doux et continu, qui viendra des arbres eux-mêmes. Alors tu sauras que tu es entré en communication avec les esprits de la forêt. Plus jamais tu n’oublieras cet instant.
Plus tard, bien plus tard, quand ton cœur sera rempli de cette mélodie, tu pourras repartir, enfin apaisé. Mais avant de t’en aller, remercie la grande forêt, comme c’est la coutume. Agenouille-toi, écarte les bras et dis tout simplement merci. Merci à la vie et à l’univers, dont tu fais partie.
Photo personnelle
17:31 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (4)
07/10/2017
Un article sur Marie Gevers
01:29 | Lien permanent | Commentaires (2)
30/09/2017
Une Catalogne indépendante ?
Il y a quelques années de cela, j'avais rédigé un article sur mon blogue dans lequel je mettais en garde contre la politique européenne de défense des langues régionales. Non pas que je n'aime pas ces langues régionales, loin de là (j'ai d'ailleurs une formation de linguiste) mais j'y voyais un danger pour l'intégrité et l'unité des Etats. Eh bien, que vous le croyez ou non, mon article a été censuré par mon hébergeur Hautetfort (et ce fut bien le seul article qui l'a jamais été) avec menace de fermeture du blogue si je le remettais en ligne.
Je vois aujourd'hui que j'avais raison puisqu'il suffit de tourner les yeux vers la Catalogne pour se rendre compte de ce qui se passe. L'UE privilégie les Régions aux Etats (qui risqueraient de s'opposer à sa politique libérale de type anglo-saxon en maintenant par exemple une législation sociale). Elle pousse donc les différentes communautés à s'insurger et à rejeter le centralisme étatique. Or que pourra faire une petite région contre les grands marchés transatlantiques ? Rien du tout. On est donc en train de nous diviser pour mieux régner sur nous. Et cela au nom de la liberté. On a fait éclater la Yougoslavie et on fait maintenant éclater l'Irak et la Syrie en propulsant les Kurdes sur le devant de la scène. Finalement, il me semble qu'on pratique la même politique en Europe. On remet en cause 2.000 ans d'histoire car il a fallu toutes ces années pour arriver à la situation actuelle avec les pays que nous connaissons. Qui nous dit que demain on n'aura pas un nouveau duché de Bretagne, une Alsace autonome ou une république languedocienne ? Qui nous dit que tout cela n'est pas dirigé par des puissances occultes qui nous dépassent ? Ces révoltes au nom de la liberté, on les a déjà vues dans les pays arabes (les fameux printemps arabe, qui ont finalement abouti à la destruction de la Libye et de la Syrie) et en Ukraine. Alors méfions-nous
01:17 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (14)
28/09/2017
Un article sur Fernand Crommelynck
08:11 | Lien permanent | Commentaires (2)
21/09/2017
"Ici et ailleurs" (nouvel extrait de mon dernier livre)
EXTRAIT DE LA NOUVELLE « LE TEMPLE DU SOLEIL »
Le camion aborde le premier virage en lacet. Le moteur cogne, le changement de vitesses grince. Derrière, une épaisse fumée noire jaillit du pot d’échappement. Il n’y a rien à faire : la pente est trop forte. Il va falloir qu’il se déporte à l’extrême gauche ou il ne passera pas! Instinctivement, le chauffeur a réagi : il braque le volant autant qu’il peut. Le bahut se déplace, le voilà de l’autre côté de la route. Le pneu avant mord même la poussière du fossé ! Cela fait un de ces nuages ! Les branchages griffent la carrosserie. Pourvu qu’il ne vienne rien en face. Non, ouf, c’est fini ! Le premier virage est passé. Il n’y en a plus que deux mille cinq cents quatre-vingt-quatre.
C’est qu’elle les connaît, Isabel les virages qui mènent à l’Altiplano. Cela fait cinq ans, maintenant, qu’elle fait la route, toujours la même. Elle charge des marchandises en bas, dans la forêt, et elle les achemine là-haut, dans la capitale. Cela peut paraître simple, mais ce ne l’est pas. En bas, c’est l’équateur, la forêt vierge, la chaleur, les moustiques, la malaria. En haut, ce sont les montagnes et les deuxièmes du monde encore bien. La Paz culmine à 3.658 mètres d’altitude et le lac Titicaca n’est pas loin. D’un côté, c’est l‘été, de l’autre l’hiver. Et puis il y a les habitants. Tous des Indiens, certes, mais tellement différents. Les gens de la plaine ont une certaine mentalité, ceux des sommets une autre. Leur seul point commun, c’est d’être tous des Indiens. C’est déjà ça. Et elle, Isabel, elle est comme un trait d’union entre ces deux mondes. Indienne aussi, forcément, comme tout le monde en Bolivie. N’empêche que le fait d’être une femme a quelque chose de singulier. Tous les autres chauffeurs sont des hommes, elle doit être la seule femme de la profession et elle en est fière. Comme elle est fière d’amener dans la capitale andine toutes ces nourritures exotiques de la plaine. Originaire de la zone intermédiaire des collines, elle se sent partout chez elle. Ce qui signifie aussi qu’elle est étrangère des deux côtés. Elle n’est pas de l’Amazonie, mais elle n’est pas non plus des sommets andins. Qui est-elle finalement ? Elle serait bien en peine de le dire. Alors elle voyage et essaie de trouver son identité sur les routes, entre les chaleurs étouffantes de la forêt et les crêtes brumeuses des montagnes.
Mais voilà le deuxième virage. Il tourne dans l’autre sens, celui-là, de la gauche vers la droite. Ce sera donc plus facile, elle ne sera plus du côté du précipice et bénéficiera de la pente la moins raide. C’est déjà ça. Il faut dire que la route est à peine asphaltée. Pourtant elle l’a été autrefois, à certains endroits en tout cas... Mais il y a longtemps de cela et la nature a repris ses droits. Le macadam, petit à petit, s’est effrité et il ne faut pas croire que le gouvernement l’a remplacé. Non. D’ailleurs il ne faut jamais compter sur le gouvernement ! Les politiciens, là-haut, à La Paz, ont autre chose à faire. La révolution pour commencer ! Et puis, une fois qu’ils sont au pouvoir ils pensent un petit peu à eux. C’est normal après tout, ils ont tout de même risqué leur vie dans ces coups d’état. Alors, dès qu’ils sont installés derrière leur beau bureau de président ou de ministre, ils essaient de compenser, c’est-à-dire de s’enrichir par tous les moyens. Qui pourrait le leur reprocher ? S’ils sont d’origine modeste, on ne les pendra pas au sérieux tant qu’ils ne seront pas riches. Et s’ils proviennent d’une famille de notables, on ne trouverait pas normal qu’ils baissent de statut et qu’ils s’appauvrissent. Un député, un sénateur, un ministre, cela doit être riche pour être respectable, un point c’est tout. Ici, en Bolivie, vous ne rencontrerez jamais un être humain qui pensera le contraire.

16:13 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature
12/09/2017
Ici et ailleurs (extrait)
"Ici et ailleurs" est un recueil de nouvelles. Pour les lecteurs fidèles de Marche romane, voici le début de la première de ces nouvelles.
LA LETTRE
Il n’y avait pas dix minutes que monsieur Habary était dans son jardin quand on sonna à la porte. Il déposa à terre les grands ciseaux avec lesquels il s’apprêtait à tailler la haie et se dirigea vers la maison. C’était le facteur, qui tenait à la main une lettre postée de Paris. Elle attendrait !
— Un petit verre ?
Comme chaque fois, la conversation s’engagea aussitôt. Depuis qu’il était à la retraite, monsieur Habary ne voyait plus grand monde et la venue du facteur était toujours la bienvenue, d’autant plus que celui-ci passait rarement. En effet, à part quelques factures, il n’y avait plus beaucoup de courrier pour le 14 de l’allée des moineaux. Quand on est veuf depuis vingt ans et que votre fille préfère le téléphone, qui pourrait bien vous écrire ? Autrefois, quand il habitait Paris, il rencontrait de nombreuses personnes, surtout issues des cercles scientifiques. C’était l’époque où il s’était fait remarquer par la publication de quelques articles dans le domaine de la botanique et il avait aussi collaboré, comme bénévole, à quelques projets menés par le F.N.R.S. Bref, il connaissait des gens et il n’était pas rare, au sortir d’une conférence, de le voir revenir à la maison à dix heures du soir, accompagné de quelques amis. Sa femme aimait ces réunions improvisées et elle se mêlait souvent à la conversation. Parfois, leur petite fille se réveillait et elle descendait en pyjama pour voir qui étaient tous ces messieurs qui parlaient si fort.
C’était une époque merveilleuse, mais elle avait été trop courte. En effet, sa femme était morte subitement, comme cela, sans crier gare, d’un cancer qui l’avait mangée tout en dedans en quelques mois. Quelle étrange chose que la vie ! Il était resté seul pour élever la petite, alors, pour lui consacrer le plus de temps possible, progressivement, il avait abandonné toutes ses réunions, tous ses colloques, et il n’avait plus rien publié. Mais il ne le regrettait pas, car Fabienne était une enfant merveilleuse. En grandissant, elle s’était mise à ressembler à sa mère, avec sa queue de cheval, son large sourire et ses grands yeux au regard brillant et malicieux. Monsieur Habary en avait presque oublié qu’il vieillissait, tant il lui semblait revivre les premières années de son mariage. Ils ne se quittaient pas. Le samedi, ils traînaient ensemble dans les magasins, ou bien ils allaient au cinéma. Le dimanche, ils partaient pour la Normandie et ils marchaient des heures le long des rivages de sable fin, au pied des grandes falaises de calcaire blanc. Pendant les grandes vacances, ils louaient une petite maison en Provence, dans les contreforts du Lubéron. Ils avaient passé là des moments merveilleux, dans une nature sauvage, écrasée de soleil et remplie du chant lancinant des cigales. C’était à un point tel que ce matin encore, quand il avait entendu dans son jardin de Seine et Marne un timide grillon émettre un petit cricri, sa mémoire s’était immédiatement envolée vers ces moments enchantés passés ensemble autrefois.
Puis Fabienne avait grandi. Elle avait réussi son baccalauréat, était entrée à la faculté et en était ressortie avec un diplôme de spécialiste en médecine tropicale. Alors, elle était partie, partie pour ces pays lointains aux noms étranges : N’Djaména, Khartoum, Bangui, Yaoundé.
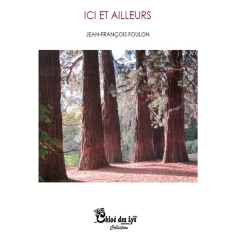
10:34 | Lien permanent | Commentaires (5)
24/08/2017
Marie
Les années avaient passé, beaucoup d’années même, et voilà qu’il était revenu au village. Pourquoi ? Nul ne le savait et lui encore moins qu’un autre. Le hasard sans doute. Il ne passait pas loin de là et l’idée lui était venue de faire un détour. Pourtant chacun sait qu’il n’y a jamais vraiment de hasard.
Il était revenu et la première chose qu’il avait vue, c’était la fontaine sur la place. Elle n’avait pas changé et le doux murmure de l’eau qui s’écoulait lui sembla aussitôt familier. Son cœur à lui non plus, n’avait pas changé, car il se mit à battre plus vite. C’est que c’était là, assis sur le rebord de pierre, qu’il avait dit à Marie qu’il l’aimait. Quarante années s’était écoulées et il se rendait compte qu’il n’avait rien oublié et qu’il conservait en lui cette blessure.
Il se mit à parcourir le village, mais cette visite se transforma rapidement en pèlerinage. Était-ce encore le hasard qui lui avait fait prendre la petite ruelle sur la gauche, celle qui conduisait au fenil du père Mathieu ? Non, on aurait dit que quelqu’un guidait ses pas, c’était troublant. Il regarda attentivement le bâtiment, un peu délabré aujourd’hui. Qu’est-ce qu’il avait été heureux, ce jour-là, allongé dans le foin, quand Marie était venue s’allonger près de lui…
Plus loin, de l’autre côté de la rivière, il revit la maison de son amoureuse ou plutôt celle de ses parents. Il n’y était jamais entré car on le trouvait trop pauvre sans doute, pas assez bien pour fréquenter la fille du plus gros fermier de la région. Qu’est-ce qu’il y pouvait, lui, si on était pauvre chez lui et si son père était communiste et ne fréquentait pas l’église ? Il n’y pouvait rien du tout et d’ailleurs on n’entre jamais dans de telles considérations quand on aime. Non, l’amour vient comme cela, comme une grâce, sans qu’on sache pourquoi. Subitement, deux êtres se croisent et ils comprennent au premier regard qu’ils sont faits l’un pour l’autre, c’est tout.
Cela avait été difficile, cette période, il ne s’en souvient que trop bien. Il fallait se cacher, ne rien dire, conserver le secret. C’était l’époque des rendez-vous clandestins à l’orée de la forêt ou dans les carrières de schiste à la sortie du village, jusqu’au jour où on les avait vus. C’était inévitable, finalement, ils se rencontraient trop souvent, ne pouvant se passer l’un de l’autre.
Alors il avait fallu tout arrêter, ne plus se voir, ne plus se parler. Même s’écrire était impossible ! C’était à ce moment-là qu’il avait dû partir pour le service militaire et c’était là-bas, bien loin, dans les Aurès algériens, qu’il avait appris que Marie allait se marier. Telle était paraît-il la volonté de son père. Que devait-il faire ? Déserter ? Ce n’était pas l’envie qui lui en avait manqué, mais que faire quand on est perdu dans des montagnes, à l’entrée du grand désert de sable et que des rebelles vous attendent embusqués à chaque tournant du chemin ? Il fallait mieux attendre la première permission, dans un mois, en espérant que le mariage n’aurait pas lieu avant. Evidemment il avait écrit à Marie, pour lui dire de refuser ce qu’on lui imposait et lui demander de l’attendre lui, qui l’aimait plus que tout. Il évoquait aussi le fenil du père Mathieu, pour lui rappeler qu’en fait elle était déjà sa femme depuis longtemps. Il découvrirait plus tard qu’elle n’avait jamais reçu cette lettre ou en tout cas que son père ne la lui remit jamais.
Et c’est comme cela que le drame est arrivé. Marie n’a pas supporté d’être mariée de force à un homme qu’elle n’aimait pas. C’est le matin des noces qu’on l’a retrouvée, pendue dans sa chambre.
Il lui semble que tout cela vient d’arriver hier. Il marche et se retrouve devant l’église, celle-là où il n’a jamais mis les pieds. Le petit cimetière est juste à côté. Il ouvre la vieille grille de fer qui grince un peu et la première chose qu’il voit c’est la tombe toute blanche de Marie. Non, vraiment, il n’y a jamais de hasard.

01:08 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (11)
10/08/2017
Le moulin
13:12 | Lien permanent | Commentaires (5)
01/08/2017
Michel de Ghelderode
13:08 | Lien permanent | Commentaires (5)
06/07/2017
Vacance(s)
Les chemins s’ouvrent devant nous comme les pages d’un livre. Il suffit de les suivre et une histoire prend soudain sens. Certains sont ardus et caillouteux, mais ce sont ceux que je préfère. En effet, ils conduisent généralement vers des sommets peu fréquentés et là, dans la solitude, on peut enfin contempler et comprendre le monde.
Partons donc, un livre sous le bras, et parcourons ces chemins. Ils finiront bien par nous ramener à nous-même et nous permettront de découvrir l’essentiel, l’essentiel qui était déjà en nous avant que ne commence le voyage.

00:35 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (3)
19/06/2017
Rodenbach
12:21 | Lien permanent | Commentaires (2)
10/06/2017
Du regard que l'on peut porter sur la nature.
Quand, à la fin du Moyen-Age, les érudits florentins redécouvrirent l’Antiquité et la langue latine, ils redécouvrirent en même temps la distinction que leurs ancêtres romains avaient faite entre la « vita activa » (celle des citadins banquiers, commerçants, hommes politiques) et la « vita contemplativa » (quand on se retire à la campagne pour méditer et se consacrer aux Arts).
Il faut dire que la situation en Italie était différente de celle de la Gaule. Alors que les seigneurs du nord des Alpes, repliés dans leurs châteaux-forts isolés, passaient leur temps à guerroyer entre eux, ceux de Toscane quittaient la campagne pour bâtir en ville de somptueux palais, après avoir mis en fermage toutes les terres qu’ils possédaient. Du coup, le fossé qui existait chez nous entre la ville et la campagne n’existait pas en Italie. Ces mêmes seigneurs, devenus citadins, revenaient avec plaisir en été dans leur « villa » campagnarde. La conséquence, c’est que la nature ne fut pas perçue comme sauvage ou menaçante, comme elle l’était en France à la même époque. Quant aux villes libres, celles où les bourgeois avaient supplanté les nobles, elles s’étendent elles aussi vers les campagnes, les habitants plaçant leur argent dans des revenus fonciers. Dans les deux cas, la distance entre la ville et la campagne est plus que ténue et cette dernière est perçue comme endroit privilégié pour le repos estival (« otium »). Boccace ne situe-t-il pas l’action de son Decameron à la campagne, loin de la peste qui sévit à Florence ?

00:26 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (7)