27/10/2017
"La pomme ne tombe pas loin du pommier" de Bertrand Redonnet, Cédalion, août 2017
Voilà assurément un livre que je vous recommande. Une belle histoire, sensible et émouvante, où la destinée individuelle est mise en parallèle avec la destinée de l’humanité toute entière. La scène se passe toujours, dans les livres de l’ami Redonnet, ou bien sur les terres de l’Ouest, battues par les vents de l’Atlantique (les Charentes, le marais Poitevin, la Vienne) ou bien dans l’Est de la Pologne. Pas étonnant puisque cet auteur est originaire de la Vienne et qu’il vit aujourd’hui en Pologne. Dans son dernier roman, c’est encore plus simple, puisque les héros passent alternativement d’une région à l’autre. Mais s’il y a évidemment une part d’autobiographie derrière tout cela, ce n’est pas le but recherché. Les thèmes traités, ce sont plutôt les paysages et l’Histoire. On y parle de ces résistants polonais qui se sont battus contre les Nazis avant de retourner leurs armes contre le « libérateur » russe, qui se montrait tout aussi envahissant que son prédécesseur. Après quelques années de combat utopique, un jeune couple, traqué par les autorités, prend le chemin de l’exil et se retrouve sur les rivages de l’Atlantique, où il s’établit.
Soixante ans plus tard, leur fils veut partir à la découverte du pays de ses parents, cette Pologne mythique où il sait qu’ils ont été des héros. Il refait donc le chemin à l’envers. Non seulement celui de ses géniteurs, mais aussi celui des grandes migrations du temps du néolithique. Car dans son verger charentais, on vient de découvrir une nécropole préhistorique. Le lecteur est donc invité à réfléchir sur le sentiment d’appartenance. Sommes-nous de la terre qui nous a vus naître ? Oui et non car nos ancêtres lointains, finalement, venaient d’ailleurs. Nous sommes donc tous des migrants ou si l’on veut des exilés (et là on voit poindre la réflexion existentielle fondamentale : qui sommes-nous ?)
Mais une fois parvenu en Pologne, le héros découvre un autre aspect de ses parents qu’il n’avait pas imaginé. La guerre est cruelle et est faite de sang et de barbarie. L’image idéalisée du père en prend un coup ! Le fils a-t-il bien fait de venir, finalement ? D’autant plus qu’il a laissé en France une sympathique archéologue qui ne lui voulait que du bien et avec qui il aurait mieux fait de faire sa vie plutôt que de courir après des fantômes.
Ce voyage initiatique, à la recherche des siens et surtout de lui-même, l’amène devant cette forêt primitive qui existe vraiment en Pologne, à la frontière biélorusse : la forêt de Białowieża, qui est un reste de l’immense sylve qui recouvrait autrefois le contient jusqu’à l’Atlantique. On y trouve des loups, des lynx et les derniers bisons d’Europe. C’est donc là qu’est le pays de son père, mais c’est aussi un peu le berceau de l’humanité car c’est dans un environnement semblable qu’ont vécu les hommes de la préhistoire, comme ceux dont on a retrouvé les squelettes en Charente.
Le livre est donc un va-et-vient perpétuel entre le passé et le présent, entre ici et ailleurs, entre l historie individuelle et celle de toute l’humanité.
Tout est décrit avec nuance (le père héroïque n'est-il pas finalement un vulgaire assassin ? Et les Russes libérateurs des nazis ne sont finalement que d'affreux occupants).Il y a des scènes tendres et pudiques (la rencontre avec Maryse, l’archéologue ou avec la tenancière d’un hôtel en Pologne). Il y a des personnages hauts en couleur (le vieux Jozef, qui a vécu toutes les guerres et qui connaît bien la forêt et les hommes, ou Nestor Augérant, ce Charentais qui avait accueilli à bras ouverts le jeune couple de migrants en fuite).
J’ai adoré ce livre et si on est captivé par l'histoire, derrière celle-ci il y a surtout de la réflexion (sur le temps, l'Histoire des hommes, le destin, le hasard, etc.). Et puis cette question : qui sommes-nous si nous dépendons des événements ? Le vieux Jozef donne la réponse : il ne faut pas juger de nos actes anciens selon notre point de vue d'aujourd'hui. Ce chemin à rebours du fils vers la Pologne de ses parents (qui n'avaient fait que reproduire les migrations néolithiques) et vers cette forêt primitive, nous renvoie à nos propres origines et à celles de toute l'humanité..
Un beau livre, vraiment. !
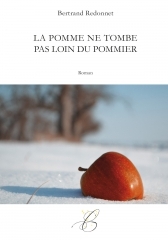
00:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (16)


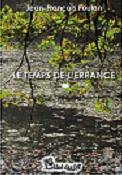



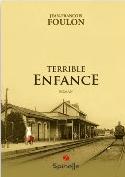
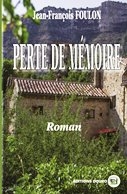
Commentaires
Mais au commencement, un vieux village…
« Juché sur une sorte de ligne de crête, que les géographes appellent parfois ligne de partage des eaux, le village surplombait un mince ruisseau d’eau claire.
Une soixantaine de maisons environ, toutes bâties de pierres jaunes scellées par un grossier mortier de terre glaise, en constituaient l’ossature. Certaines étaient habitées par des agriculteurs encore actifs, une dizaine tout au plus, d’autres par de vieux paysans qui avaient passé le flambeau à la descendance, ou loué, ou vendu leurs terres. Ceux-là vivaient en taiseux, le plus souvent assis devant leur porte à regarder couler un temps auquel ils ne trouvaient plus d’utilité. (…) »
Ainsi commence le roman de Bertrand...
Écrit par : Michèle | 27/10/2017
Écrit par : Feuilly | 27/10/2017
Je trouve, depuis longtemps déjà, que vous devriez également ouvrir un blog qui serait un bel écho à celui de Feuilly.
Écrit par : cleanthe | 27/10/2017
Écrit par : Michèle | 27/10/2017
¸¸.•*¨*• ☆
Écrit par : celestine | 28/10/2017
Simplement, tout roman, toute fiction, est historique en ce que ses personnages, ses décors et ses émotions s'inscrivent dans le cercle particulier d'une époque, dans un temps défini par les rapports sociaux et les comportements.
Bien à Vous.
http://lexildesmots.hautetfort.com/
Écrit par : Bertrand | 28/10/2017
Écrit par : Feuilly | 28/10/2017
Écrit par : Feuilly | 28/10/2017
Célestine, pour avoir réfléchi à la question, m'apercevant qu'en bibliothèque les gens qui demandent des livres historiques attendent plutôt un Christian Jaq ou une Juliette Benzoni que François Taillandier (L'écriture du monde/ La croix et le croissant / Solstice) par exemple, -et je crois que Feuilly a lu "L'écriture du monde" -.
Je dirais que le roman historique est un roman qui est très insoucieux de l'Histoire ; il ne s'y inscrit même pas, il la prend seulement comme "thème" littéraire. Ce sont des textes de facture très traditionnelle, avec une forme linéaire et une intrigue historique traitée sur le mode romanesque. (Jeanne Bourin, La Chambre des dames 1979, Françoise Chandernagor, L'Allée du roi, 1981). Je n'ai pas en tête de titre récent, je ne lis pas ces romans.
Autre chose est l'écriture contemporaine (ou si vous préférez, l'écrivain du 21e siècle) qui INTERROGE l'Histoire. Il n'y a pas là de forme préconçue mais autant de formes que d'écrivains.
Et c'est peut-être parce qu'on a perdu beaucoup d'illusions que la littérature s'interroge sur les causes de ce délitement.
Quand on regarde de près (ce que des théoriciens comme Viart et Vercier ont fait), on s'aperçoit que c'est à partir des deux guerres mondiales que l'espérance en l'humanisme commence à sombrer. Mais la littérature qui interroge l'Histoire n'apparaît sur la scène littéraire qu'à la fin des années 80 (coïncidant avec la chute du Mur de Berlin, la disparition de l'URSS...)
Les écrivains concernés sont nés entre 1949 et 1954 Jean Rouaud, Jean Echenoz, Philippe Claudel, Gérard Mordillat, Sébastien Japrisot... C'est-à-dire que ce sont des "fils sans guerre", ils n'ont connu aucune des deux guerres et ils écrivent alors que les derniers survivants de la Grande Guerre sont en fin de vie.
Bertrand Redonnet appartient à cette génération d'écrivains. Il ne fait pas de roman historique. Il écrit l'Histoire. Il écrit le Monde.
Il participe de cette révolution culturelle qui fait passer du côté du sujet le "dit" de l'Histoire.
Car l'Histoire sans la littérature reste une "donnée" extérieure, elle n'est pas vécue. Chiffrer les millions de morts d'une guerre mondiale ne dit paradoxalement rien de son horreur absolue...
Écrit par : Michèle | 28/10/2017
Pour moi, un roman historique est une aventure qui se passe dans un environnement d'autrefois (les croisades, le MA, la Renaissance etc.). L'auteur y développe une intrigue classique mais la plonge dans un environnement qui n'est pas nôtre (on y trouvera des armures, des chevaliers, des tournois)
Ici, chez Bertrand, il n'y a rien de tel. Le héros est né vers 1950 et par nostalgie personnelle, il va découvrir la terre de ses parents (lesquels il est vrai ont participé à la Résistance pendant la guerre). On se questionne sur le rôle de l'individu dans ce grand mouvement des choses qui nous entourent. Et on se rend compte que finalement rien ne change depuis la préhistoire.
Écrit par : Feuilly | 28/10/2017
C'est ce regard qui fait littéraure ou pas....
Écrit par : Bertrand | 28/10/2017
Écrit par : Bertrand | 28/10/2017
Je voulais simplement dire que je n'aimais pas les romans qui interrogent l'histoire, les guerres, les événements tragiques de l'histoire de l'humanité.
Je n'aime que les romans intimistes, psychologiques, et qui parlent des sentiments, des luttes, des joies, des turpitudes l'histoire personnelle d'hommes et de femmes comme vous et moi, histoire qui cependant parle à notre humanité et à notre intériorité.
Mais cela n'enlève rien à la qualité du roman cité ici.
Bien à vous
¸¸.•*¨*• ☆
Écrit par : celestine | 02/11/2017
Écrit par : Feuilly | 02/11/2017
Écrit par : Michèle | 03/11/2017
¸¸.•*¨*• ☆
Écrit par : celestine | 05/11/2017
Les commentaires sont fermés.