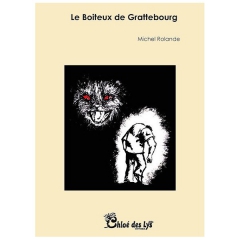29/05/2017
Ici et ailleurs
Cette fois, il est bien sorti officiellement :
Mon troisième livre, au prix démocratique de 13 euros en librairie.

22:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature
25/05/2017
Le silence
Ecoute le silence.
Ecoute-le bien et tu entendras la face cachée du monde.
Ecoute.
Est-ce le vent qui mugit là-bas dans la forêt ? Et ce bruissement ? Est-ce le doux frottement des épis de blé dans la brise matinale ?
Ecoute encore.
Quelque part, un chien aboie, loin, très loin, dans un village que tu ne connais pas.
Puis un oiseau lance un cri. Le danger est imminent.
En effet, dans les herbes rousses, voilà que surgit le renard.
D’un pas silencieux il débouche sur le chemin et t’aperçoit.
Immobiles, vous vous regardez.
Puis il s’en va en trottinant, indifférent à ta présence, superbe de mépris.
Tu restes seul dans le silence et déjà tu ne sais plus si tu as rêvé ou non.
Emu, tu entends les grands battements sourds de ton cœur.
La vie est si simple, parfois.

01:31 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature
11/05/2017
"Auprès de ma blonde" de Thierry-Marie Delaunois, Editions Chloé des Lys, 2016
Je viens de terminer le livre de Th-M Delaunois, « Auprès de ma blonde », qui ma foi ne manque pas d’intérêt. Le titre, à vrai dire, ne me plaisait pas trop (il est vrai que je préfère les filles brunes aux filles blondes, ceci expliquant peut-être cela, car finalement, qu’on le veuille ou non, le lecteur n’est jamais neutre quand il aborde un ouvrage et il vient avec tous ses préjugés et sa propre grille de lecture).
Au fil de la lecture, j’ai découvert une histoire bien ficelée, aux multiples rebondissements. Au début, tout semble normal et anodin : une rencontre dans un parc public entre un homme et une femme. Une histoire se noue lentement et on devine la suite. Rien de plus banal, en quelque sorte. Mais les protagonistes sortent pourtant de l’ordinaire. Lui est écrivain (tiens donc !) et elle, manifestement, n’a rien de la blonde classique. Grande, baraquée, elle exerce la profession de sorteuse dans un bar. Etrange. Mais derrière ce côté un peu bourru on devine une faille. Et c’est là que le roman devient intéressant. Il ne faut pas se fier aux apparences. Petit à petit le lecteur est intrigué et veut en savoir plus sur cette femme dont insensiblement le héros tombe amoureux.
Il y d’autres protagonistes autour de ce couple qui se forme. Il y a Hélène (la belle Hélène, comme dans l’Iliade d’Homère), qui vit seule avec ses trois enfants et tombe sous le charme d’André, notre héros qui lui est déjà sous le charme de la belle blonde. Une rivalité s’installe entre les deux femmes, comme on pouvait s’y attendre.
Il y a les trois enfants d’Hélène, qui par leur naïveté (ou leurs propos mûrement réfléchis et qui font mouche) disent des vérités qu’il n’est pas bon de dire.
Il y a une gitane aussi, qui erre dans le parc et qui dit la bonne aventure à qui veut bien l’écouter. Comme le devin Calchas dans l’Iliade, elle ne se trompe jamais et prédit l’avenir avec clairvoyance, mais personne ne l’écoute.
Il y a le lac, au milieu du parc. Véritable protagoniste de l’histoire, il semble immense. En tout cas on s’y noie fréquemment.
Il y a enfin les affaires de famille, qu’on devine petit à petit au cours de la lecture, comme cette sœur jumelle de l’héroïne qui est morte autrefois, laissant un vide qu’on ne peut combler. Et puis il y a le questionnement sur les origines : qui est la père de la blonde ? Petit à petit tout cela se met en place et plus on avance dans le livre plus on a envie de découvrir la suite, suite que je ne vous raconterai évidemment pas !
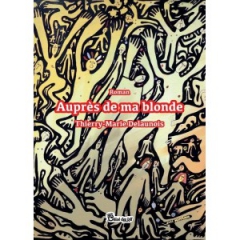
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature
21/04/2017
Une note de lecture de mon livre "Le temps de l'errance"
LE TEMPS DE L'ERRANCE de Jean-François FOULON
J'ai lu et relu à plusieurs reprises cet ouvrage, avec un plaisir sans cesse renouvelé.
Je me suis longtemps demandé comment trouver des mots dignes de qualifier une oeuvre d'une intensité poétique aussi exceptionnelle, à la fois pleine de tendresse et empreinte d'un romantisme teinté d'angoisse, d'incertitude et de questionnement.
Pour Jean-François Foulon, la rime est accessoire, même s'il se plaît à la taquiner avec une facilité déconcertante.
Quel que soit le mode d'expression choisi, l'auteur laisse errer sa plume, au hasard de ses états d'âme, de ses souvenirs, de ses angoisses.
Certains thèmes essentiels, que je me bornerai à évoquer, sont récurrents.
Rêver ! C'est bien là le propre de l'Homme, ce qui le différencie de l'animal depuis la nuit des temps.
Jean -François Foulon évoque, non sans nostalgie, son enfance, les endroits familiers, leur odeur aussi. Associés à la musique, ses souvenirs lui ont permis de fuir un présent sur lequel il jette un regard attristé. Grâce à eux, il a pu s'évader dans ses rêves, à la recherche d'une étoile, et exprimer, à travers l'écriture, son espoir d'un monde meilleur.
Comme il le dit si bien : "Heureux ceux qui partent sur des navires affrétés pour nulle part, sans savoir s'ils reviendront."
La mer symbolise l'infini, l'éternité.
L'Homme hésite à se mettre en route, diffère son départ et se décide enfin à prendre la mer, à embarquer sur ses rêves, des "navires dont les nuages sont les voiles". A quel prix ? Vers quelle destination ? Peu importe. Il marche.
Il arrive que ses pas se perdent dans les gares, le temps d'une halte, en attente du "train de la vie". L'emprunter le condamne à la solitude. Très vite, les traces de ses pas s'effacent cependant, comme il en va de celles qu'il laisse quand il marche sur des routes enneigées. Existons-nous vraiment ? Se pourrait-il que nous rêvions notre vie ?
Durant son périple, l'Homme assiste, impuissant, à la destruction de la nature, à la victoire du matérialisme, du sexe, de la drogue.
Le temps fuit inexorablement, un peu comme si la mort et son silence étaient le but de toute existence. Mais le temps a-t-il jamais existé ou l'avons-nous créé ?
Après des années d'errance, l'Homme arrive au bout de son chemin. A l'automne de sa vie, il a le sentiment d'avoir tourné en rond. Confronté à la réalité, il en arrive à la conclusion que fuir, en quête d'un ailleurs illusoire, ne servait à rien. Il se demande alors si ce voyage qui le ramène à son point de départ en valait la peine.
Pourtant, en cours de route, il a connu l'amour qui embellit la vie et fait souffrir aussi. Mais, comme toute chose, l'amour est éphémère. Le poète a rêvé d'une femme inconnue qu'il aurait voulue parfaite et unique. De ses amours imaginaires ou perdues, seuls restent les regrets et la solitude.
Cette quête d'amour idéal, si chère aux romantiques, l'auteur l'exprime avec infiniment de douceur et de délicatesse.
Et il y a aussi cette déclaration d'amour sublime que toute femme rêverait d'entendre, et que j'aimerais vous inciter à méditer avant d'en terminer :
" Je ne me souviens plus où nous nous sommes rencontrés,
Ni de quel pays tu venais.
Je n'ai jamais rien su ni de ton enfance ni de ta famille.
J'ai même oublié ton nom.
Mais j'ai gardé au fond de moi la tendresse de tes caresses,
L'odeur de ta peau et la douceur de ton regard.
Je te reconnaîtrais entre toutes. "
Rolande Michèle

09:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature
20/04/2017
Art pariétal
Je me demande pourquoi nos ancêtres préhistoriques se sont réfugiés au fond des grottes pour aller peindre. Tout simplement pour avoir une paroi rocheuse sur laquelle dessiner me direz-vous. Certes, certes, mais des parois rocheuses, il y en a à l’air libre. Il existe des falaises le long des rivières et des fleuves, par exemple. Souvent, le bas de celles-ci (la zone la plus facilement accessible) est même protégé des intempéries par la partie haute, qui la surplombe. Ainsi, on rencontre souvent de telles falaises le long de la Dordogne, dans la région précisément où on a retrouvé un certain nombre de grottes avec des dessins rupestres.
Alors pourquoi aller dessiner au fond d’une grotte obscure quand la nature offrait un support naturel accessible et bien éclairé ?
On pourrait penser que cela s’est peut-être fait et que seuls les dessins intérieurs, protégés de la pluie et du vent, ont survécu. Mais un tel raisonnement ne tient pas la route. En effet, suite à des éboulements, des glissements de terrain ou que sais-je, une partie au moins de ces falaises aurait dû se retrouver protégée des intempéries et on n’aurait pas manqué de découvrir là des vestiges de peintures rupestres.
Mais non, généralement les dessins répertoriés se situent dans des grottes. Il y a des exceptions, je le sais, mais majoritairement c’est au plus profond des grottes qu’on a retrouvé des dessins (mains pleines ou mains creuses, représentations d’hommes, de femmes, d’animaux, etc.). Alors je me dis qu’il doit bien y avoir une raison à cet état de fait.
La grotte, c’est l’obscurité, la nuit. Peindre dans la nuit, c’est se cacher et ne pas vouloir que son dessin apparaisse au grand jour. Le but de celui-ci est donc bien religieux. Seuls quelques privilégiés devaient avoir accès à l’art pariétal. Il fallait sans doute être initié, être chamane ou que sais-je ? Le dessin touche au sacré.
La grotte, c’est aussi le ventre de la terre, une sorte d’utérus qui renvoie à nos propres origines. Rentrer dans la grotte pour y peindre ce que l’on voit dans la vie de tous les jours (les animaux chassés) n’est –ce pas revenir à ses propres origines, rentrer dans le ventre de sa mère et là, dans cet endroit où nous avons été conçus, toucher du doigt le mystère de la création ? Peindre dans le silence et l’obscurité de l’intérieur ce qui se passe au-dehors, c’est remonter le temps et immortaliser dans le silence souterrain tout ce qui existe, existera et a existé. C’est dire que là, dans ce noir absolu, la vie va soudain surgir. Il n’y avait qu’une paroi rocheuse et voilà que des troupeaux de bisons galopent. L’homme est venu ici pour dire le mystère de la vie, la vie qui est apparue on ne sait comment, mais qui était déjà là, en gestation, au cœur même de la terre, notre mère à tous.

00:05 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : art pariétal
14/04/2017
Un conte japonais
On se souvient de Pénélope, qui défaisait la nuit le voile qu’elle confectionnait pendant la journée (lequel devait servir à envelopper le corps de son beau-père Laërte, lorsque celui- mourrait). Cette ruse habile lui permit de repousser les prétendants qui accouraient nombreux et qui souhaitaient l’épouser. Plus tard, elle eut une autre idée : celui qui arriverait à bander l’arc de son mari Ulysse pourrait prétendre à sa main. On connaît la suite : seul Ulysse, qui revenait enfin de son interminable périple, parvint à tendre l’arc et à décocher des flèches contre ses rivaux.
On trouve dans les contes d’autres stratagèmes du même genre. Souvent, la fille d’un roi sera donnée en récompense au héro valeureux. Dans quelques cas, la situation est inversée, comme dans Cendrillon, où ce sont les jeunes filles qui se précipitent en espérant que leur joli pied rentrera dans la fameuse pantoufle. Dans ce cas, c’est le roi qu’elles désirent épouser. Alors que dans l’Odyssée on avait une femme qui se refusait à de nombreux prétendants, on a ici de nombreuses femmes qui voudraient à tout prix épouser un homme remarquable.
Parfois, la situation est encore différente. On a une femme seule qui cherche l’amour mais qui ne consentira à se donner qu’à celui qui réalisera un exploit extraordinaire (Pénélope, elle, espérait bien que personne ne parviendrait à tendre l’arc).
Il en va ainsi dans un conte japonais. Une princesse avait fait confectionner un tambour dont la peau était faite d’une toile de soie. Autant dire qu’il était impossible d’émettre le moindre son avec un tel instrument. Tous les jeunes gens s’y essayèrent pourtant, mais ils avaient beau frapper le tambour, seul le silence répondait à leurs efforts. Pendant ce temps, la princesse se désespérait de rencontrer un jour le prince charmant.
Une nuit pourtant arriva de loin un jeune homme qu’on n’avait jamais vu. Il venait d’un pays lointain et s’il avait traversé de nombreux fleuves et de nombreuses montagnes, c’était dans le but d’essayer le fameux tambour dont il avait entendu parler. Dès qu’il fut arrivé au pied du château de la princesse, il s’enquit donc de l’endroit où se trouvait l’étrange instrument de musique. Un serviteur le lui montra : il était accroché à la branche d’un arbre surplombant un lac. Le jeune homme, éperdu d’amour, tenta sa chance, mais comme il fallait s’y attendre, aucun son ne sortit du tambour. Alors, de désespoir, il se jeta dans la lac où son corps disparut au milieu de cercles concentriques. Il venait à peine d’être englouti quand le tambour se mit à émettre un son doux et agréable. En l’entendant, la princesse quitta son château et se précipita. Folle d’amour, elle qui attendait depuis tant d’années, elle arracha ses vêtements tout en courant le long du chemin en pente qui menait au lac. Quand elle comprit ce qui s’était passé, elle resta là, nue et désespérée, à contempler l’onde noire dans la nuit. Elle eut beau geindre et pleurer, seul le silence répondit à ses cris.
On dit que depuis, tous les soirs, elle descend au bord du lac. Ensuite, elle fait vibrer le tambour dans l’espoir de faire revenir celui qu’elle n’a jamais vu, mais qui est mort d’amour pour elle.

00:05 Publié dans Littérature, Prose | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature
13/04/2017
Jardinage
Il faisait beau dimanche et un grand soleil nous faisait oublier les jours gris des longs mois qui venaient de s’écouler.
L’équinoxe de printemps était dernière nous. Je le savais, la roue avait tourné, irrémédiablement, comme chaque année, comme toujours.
Emporté dans l’immensité de l’espace sur ma petite planète, je méditais sur la notion de l’éternel retour si chère aux hommes de l’Antiquité.
A vrai dire, je ne méditais pas vraiment, car profitant de la bonne chaleur ambiante, je jardinais.
Jardiner est pour moi un plaisir. C’est un plaisir simple, certes, mais qui me procure des joies profondes. Surtout s’il fait beau et que tout autour de moi est calme et silencieux.
Après avoir retourné la terre, il faut la sarcler pour casser les mottes, puis ratisser lentement, pour égaliser. C’est tout un travail, déjà, mais un travail plaisant, qui prend tout son sens puisqu’il a une finalité immédiate. Et cette finalité, c’est de semer et de faire naître la vie.
On se penche sur cette terre que l’on vient de retourner, cette terre qui doucement se réchauffe sous l’action bénéfique du soleil. C’est le printemps mais déjà c’est un peu l’été, tant il fait chaud.
On se penche et on trace un sillon avec le manche du râteau. Rayure qui délimite à jamais l’endroit où pousseront les plantes. Instant fatal, arbitraire (pourquoi ici et pas là ?) mais irrémédiable.
On ouvre délicatement le paquet de graines et on verse dans la paume de sa main les précieuses semences. La vie est là, simple et tranquille, comme disait le poète. Ensuite, du bout des doigts on laisse tomber les graines une à une dans le sillon. Que voilà un geste simple, mais beau. Deux mille ans avant moi, mes ancêtres accomplissaient déjà le même rite, conférant au mouvement de ma main une sorte d’éternité intemporelle.
Là où le sillon a été mal tracé, il faut le refaire avec le doigt et insister délicatement, comme si on caressait le sexe d’une femme.
Ces graines que l’on vient de déposer lentement et avec amour dans la grande chaleur de ce dimanche, germeront demain. C’est l’avenir qu’elles portent en elles.
Il y aura toujours des graines pour tomber dans la terre après le grand équinoxe de printemps, même quand je ne serai plus là. Mais aujourd’hui cette terre sur laquelle je me penche n’est pas celle de la tombe, mais celle de l’espoir. Dans le silence de l’après-midi, je suis seul et heureux, parfaitement heureux.
00:05 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (2)
08/04/2017
Le silence
Ce site est un peu à l’arrêt.
Tout est silence.
Mais à l’origine, le silence n’était-il pas tout ? Ne dit-on pas d’ailleurs que Dieu était le Verbe ? Avant Dieu, avant le monde, c’était le règne du silence.
Puis le serpent susurra quelques mots à l’oreille d’Eve et tout s’écroula.
Depuis, nous vivons dans le bruit, chassés du paradis.
Avant notre conception était le silence. Encore que pendant la gestation le fœtus doit entendre le bruit du cœur de sa mère. Puis il vient au monde dans un grand cri.
Ensuite ce sont des guerres et encore du bruit jusqu’à la mort, qui est un autre silence.
Entre les deux il y a l’amour. L’amour et le silence des amants, qui se contemplent sans un mot, fascinés l’un par l’autre. Nudité d’avant le temps, d’avant la parole et le bruit. Nudité de l’origine, silence des corps qui s’attirent.
Le silence est-il amour ?

02:04 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (9)
16/03/2017
La lectrice et son livre
Elle se livre parfois
Quand commence un nouveau chapitre
Et que l’écriture lui plaît
Elle se livre à livre ouvert
Tandis que lui, il tourne les pages
De son passé, de son présent
Elle lui raconte son enfance
Toutes ses turbulences
Et parfois lui lit un conte d’autrefois
Il l’écoute en feuilletant
Ce livre ouvert
A la page de l’amour
Il l’effeuille page à page
Caresse son visage
Contemple sa nudité
Son doigt glisse sur les pages
Le dos, la tranche
Et s’attarde en un point précis
Elle gémit lentement
Quand il pénètre au cœur de l’histoire
Et qu’il lui murmure son amour
Elle gémit dans le grand lit
Tandis qu’il tourne les pages
Et lui lit la suite de l’histoire
Puis arrive le mot « fin »
Le livre est refermé
La page est tournée
Il s’en est allé
Dans la bibliothèque
Le livre est rangé
Le conte est terminé
Elle rêve à cette histoire
A cet amour perdu
A ce livre merveilleux
Elle rêve à la manière dont il racontait l’histoire
Elle revoit sa main
Qui parcourait les pages
Sa main qui caressait son dos
Sa tranche, son ventre
Mais qui a fini par tourner la page

00:49 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature
07/03/2017
Nicolae Labis (mort à 21 ans)
On connaît peu la Roumanie, pour ne pas dire pas du tout. Pourtant le roumain est une langue romane, une langue soeur du français, au même titre que l'italien ou l'espagnol. Une langue bien douce à écouter en tout cas.
Nicolae Labis (1935- 1956), la mort de la biche (la traduction proposée ici n'est pas excellente, mais cela donne une bonne idée du contenu)
La sécheresse a tué tout vent.
L'ardent soleil coula du firmament.
Le ciel demeure un torride trou.
Du fond des puits remonte de la boue.
Et sur les bois, de plus en plus s'élancent
De sataniques feux qui dansent, dansent.
Je monte à coté de papa vers les cimes,
Blessé par les branches des rudes sapins.
On va à la chasse, la chasse aux chevrettes,
Au coeur des Carpathes accablés par la faim.
La soif me tourmente. Je vois que les gouttes
Qui choient sur la pierre vont s'évaporant.
Mes tempes paraissent gêner mes épaules.
Devant, une étrange planète s'étend.
On va aguetter dans un site où les sources
Gargouillent et frémissent encore dans leur lit.
C'est là le lieu où s'abreuvent les biches
Quand couche soleil et sa soeur resurgit.
Je souffre de soif, mais papa me fait taire.
Oh sources limpides, comme vous palpitez!
La soif me conjoint désormais à cet être
Que, contre les règles, on va supprimer.
La combe resouffle d'un air agonique.
Affreux crépuscule, celui qui descend!
Le rouge horizon dans des vagues déborde,
Couvrant ma poitrine de taches de sang.
Aux cieux les étoiles clignotent et scintillent,
Tandis que fougères s'enflamment aux autels.
Je prie qu'elle ne vienne, je veux qu'elle ne vienne,
L'offrande si triste d'un songe mortel!
Elle vînt en sautant et pausa près des sources,
Sondant le terrain d'un regard apeuré.
Et l'eau qu'elle éffleure de frêles narines
S'émeut dans des cercles glissant argentés.
Du fond de ses yeux se projette un mystère.
Je sais qu'elle approche la fin de sa vie.
Je crois reconnaître aux portes du mythe
La noble pucelle en biche convertie.
La lune baignait de jolies lumières
Sa face aux pétales de cerisier.
Combien je voulais que pour fois première
Le tir d'escopette se voie échoué!
Mais vînt le tonnerre. Fauchée et mourante,
Sa tête elle haussa vers le ciel un moment,
Et chut tout d'un coup, ébauchant sur la source
De rouges joyaux qu'emporta le courant.
Un cri déchirant transperça la ravine.
Un sombre oiseau d'entre branches bondit
Portant sur ses ailes l'esprit de la biche,
Comme emple d'absence l'automne leurs nids.
J'allai lui fermer les ombrées paupières
D'un pas vacillant quand j'ouïs mon papa
Joyeux et ravi s'exclamer derrière:
'On a de la viande, on en mangera! '
J'ai soif. Mon papa me fait signe de boire.
Oh sources obscures, comme vous soupirez!
La soif me conjoint désormais à cet être
Que, contre les règles, on vient de tuer.
Mais que fait-on des règles et des lois
Quand on ne peut survivre presque pas?
Et à quoi bon coutumes et compassion
Quand j'ai ma soeur mourante à la maison?
De l'escopette sort de la fumée.
Sans vent les feuilles commencent à tournoyer!
Mon père fit un feu éblouissant.
Oh plus jamais le bois n'est comme avant!
Ma main saisit de l'herbe à mon insu
Une clochette au timbre soutenu.
Papa extrait des braises, à la main,
Le coeur de la chevrette et ses reins.
Le coeur? Quel coeur? J'ai faim, moi! Je veux rester en vie!
Pardonne-moi, pucelle, bichette, ma chérie!
Le feu grandit, s'élève... Je veux dormir... Etrange...
Que pense-t-il, mon père? Je pleure. Et je mange!
(1954)
(Traduit par Paul Abucean)

23:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, nicolae labis
03/03/2017
Joël Godart, "A la fin de ces longues années" (Editions Chloé des lys)
Une nouvelle fois, je suis sous le charme après la lecture du dernier livre de Joël Godart (« A la fin de ces longues années »), un livre de poèmes, bien entendu :
Dans son recueil précédent, il était question du rêve, de la mer, des nuages, de la femme et aussi de la mort.
Ces thèmes, on les retrouve dans ce second livre, mais il me semble que la conscience de la mort qui rode a pris plus d’emprise sur le poète :
A la fin de ces longues années
Quand nous devrons quitter cette terre
Nous déposerons sur le fleuve nos deux cœurs
C’est que le temps continue à avancer et que les années qui restent devant l’écrivain s’amenuisent petit à petit :
Les années ont passé comme feu de paille
déposant sur nos vies des brassées de feuilles
L’hiver s’avance et sur toutes choses
étend ses longs doigts blancs de givre
Cette prise de conscience n’est pas morbide, elle est simplement lucide. L’auteur a conscience qu’une grande partie du chemin est derrière lui et il décide, puisqu’i n’y a plus rien devant lui, de s’arrêter et de regarder la beauté du monde.
On sait que le poète habite maintenant en Bretagne, devant l’océan. Cette région devait forcément devenir un thème de prédilection :
Sur mes domaines les routes sont rares. Beaucoup de végétations battues par les vents, de chemins tracés en toute hâte (…) La nuit nulle lumière sur la lande mais des cris d’oiseaux.
Outre la description de la lande bretonne, un tel texte porte en lui une réflexion existentielle. Les routes qui se font rares sont celles de l’existence, le vent symbolise les difficultés de la vie et ces cris d’oiseaux dans la nuit noire ont quelque chose d’effrayant. On devine la mort tout au bout et le grand plongeon du haut de la falaise.
Pourtant, en ce lieu de repos et de recueillement, l’amour peut renaître :
J’avais oublié jusqu’à la blancheur de ta peau (…)
Tes yeux étaient deux promesses.
Parfois les vers de J Godart deviennent des jeux de mots tendrement érotiques aux consonances bibliques :
L’amour est olivier au jardin de mes caresses
Mais les saisons défilent et l’automne (ultime cycle de la vie) approche. Les arbres qui « bavardent dans la nuit mystique» vont perdre leurs feuilles :
Ainsi va comme une feuille
Le monde vers sa perte
Le poète (qui nous a parlé d’un autre livre qui devrait sortir bientôt et qui sera consacré au Père Lachaise) hante les cimetières et voit sur les tombes des noms de femmes. Il se demande si leurs amants se souviennent d’elles, de la douceur de leurs lèvres et de leurs mèches blondes. Mais
Seules les allées se souviennent et chuchotent sans fin vos noms dans les corridors du temps
Parfois, le poète par le de son « métier » d’écrivain :
Avec des mots j’ai fait une tresse
Descendant en guirlande jusqu’à mes pieds
A d’autres endroits, il parle de la musique comme d’une métaphore de ses poèmes :
Au son de ta mandoline
J’ai gravé ô Colombine
Mes accents sur le disque
D’amertume et de folie
Mais déjà le disque se raie
L’amour et l’érotisme sont bien présents (à quoi renvoie cette mandoline ? Au corps de la femme aimée peut-être…) mais la fin est bien là : le disque se raie.
Le recueil se termine sur neuf petits textes étranges et charmants où l’auteur met en scène des guerriers d’une peuplade primitive. Ceux-ci ont combattu vaillamment, mais ils attendent la mort.
Nous, les lecteurs, nous attendons plutôt les livres suivants de Joël Godard. Puissent-ils être nombreux !

00:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : joël godart, a la fin de ces longues années
02/03/2017
Mardi gras
Le Mardi gras était à l’origine une fête païenne, où on fêtait le retour du printemps et le renouveau de la nature. L’Eglise catholique, comme d’habitude, a incorporé cette fête dans son calendrier. Le mot « gras » indique qu’on peut manger copieusement une dernière fois (et même de la viande) avant que ne commence le carême, soir le Mercredi des cendres.
C’est l’époque des carnavals. Ce mot vient de l'italien carnevale ou carnevalo, altération du latin médiéval « carnelevare », lui-même issu de « carne » (la viande) et « levare » (enlever). Il s’agit donc bien de l’entrée en carême, cette époque durant laquelle la consommation de viande était interdite.
Pendant longtemps, le mot carnaval a eu le même sens que celui de « carême-prenant », autrement dit celui d’entrée en carême. Puis le terme a désigné la veille du carême et l’accent a été mis sur les réjouissances qui caractérisent ce jour-là.
Notons en passant que « carême » (d’abord orthographié « quaresme »), provient lui du latin populaire « quaresima », altération du latin classique « quadragesina » (quarantième jour avant Pâques).
Mais revenons au carnaval. Cette fête trouve son origine dans les Lupercales des Romains et les fêtes dionysiaques en Grèce.
L’historien des religions Mircea Eliade a écrit : « Toute nouvelle année est une reprise du temps à son commencement, c’est-à-dire une répétition de la cosmogonie. Les combats rituels entre deux groupes de figurants, la présence des morts, les saturnales et les orgies, sont autant d'éléments qui dénotent qu’à la fin de l’année et dans l’attente du Nouvel An se répètent les moments mythiques du passage du chaos à la cosmogonie »
Claude Levi-Strauss a étudié également ce besoin de se déguiser, d’inverser les valeurs (les pauvres devenant rois pour une journée) et de faire du bruit afin de marquer une rupture dans l’écoulement classique du temps. Le temps s’est arrêté et un nouveau cycle commence (le retour du printemps renvoie à la conception antique de l’éternel retour, de l’âge d’or qui immanquablement finira par revenir périodiquement).
Pour un jour, le vieux monde s’écroule. Le carnaval est en effet une sorte de « fin du monde », où les barrières sociales tombent ou s’inversent, où les licences érotiques sont permises. Bref, c’est un retour au chaos primitif avant la renaissance d’un temps nouveau.
Pour terminer, n’oublions pas la Laetare, qui a lieu le quatrième dimanche du carême (à la mi-carême donc) et qui marque une pause dans les privations. Le mot latin laetare est en fait l'impératif présent du verbe « laetari » et signifie donc « réjouis-toi ». C’est une époque où on retrouver également des fêtes carnavalesques.
Stavelot, Wallonie, dimanche de Laetare.
00:05 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Étymologie, carême, mardi gras
27/02/2017
Prise de conscience
Quand j’étais un cheval, je parcourais des plaines immenses, du matin au soir et du soir au matin. Je broutais l’herbe verte des hauts plateaux puis descendais me désaltérer dans les eaux limpides des rivières.
Quand j’étais un aigle, je planais des heures durant dans les hautes sphères, regardant en face le soleil et observant, en contrebas, la pauvre vie des êtres éphémères.
Quand j’étais un poisson, j’étais un grand requin bleu et je nageais en eaux troubles à l‘affût de la moindre proie. J’étais redouté partout et la faune marine craignait mes ondoiements languissants et sournois.
Quand j’étais une tortue, je prenais mon temps et méditais sur mon grand âge, bien à l’abri sous ma carapace.
Quand j’étais un écureuil, je gambadais dans la forêt et tel un éclair roux et imprévisible j’atteignais la cime des arbres avant d’en redescendre la tête en bas.
Quand j’étais un loup, je chassais en meute les élans magnifiques et les rennes rachitiques. Dans la neige je laissais l’empreinte de mes pas, terrifiant les enfants en chaperon rouge.
Quand j’étais un cerf, je portais sur ma tête l’emblème de la forêt et conscient de ma noblesse, je parcourais en bonds majestueux les clairières et les halliers.
Quand j’étais un sanglier, je parcourais l’Ardenne en fouinant de mon groin les faînes et les glands. Quand on lâchait sur moi des meutes de chiens, ceux-ci ne me rattrapaient jamais.
Aujourd’hui je suis un homme. Je ne peux ni voler dans les airs ni courir par les plaines. Je n’ai ni la force du loup ni l’agilité de l’écureuil. C’est à peine je parviens à suivre mon chien dans la forêt, quand celui-ci a senti la trace d’un sanglier.
Alors je reste là, méditant sur mon sort, et j’appelle réflexion ce qui n’est que rumination et attente de la mort.

00:17 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
21/02/2017
"ici et ailleurs"
Il est arrivé aujourd’hui !
Je veux parler de mon nouveau livre publié aux éditions Chloé des Lys…
Après un roman (« Obscurité ») et un recueil de poésie (« Le temps de l’errance »), c’est maintenant un recueil de nouvelles (ou plus exactement d’histoires courtes) que je vous propose. Celles-ci se déroulent en Afrique, en Amérique du sud ou en Europe. De quoi se dépayser.
Pour le commander, il faudra attendre quelques mois encore, le temps qu’il soit référencé et repris dans le catalogue de l’éditeur.
Le prix cette fois sera très démocratique : 13 euros en librairie pour 293 pages.
J’en reparlerai ultérieurement.
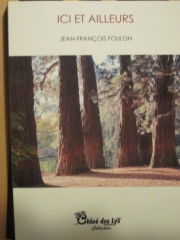
00:05 | Lien permanent | Commentaires (16)
20/02/2017
Renouveau
Seule et obstinée elle a trouvé son chemin…
Tandis que nous rêvions au coin du feu
Aux temps anciens
De notre jeunesse évanouie,
Elle, elle a percé la couche glacée
Et s’est épanouie, radieuse, dans la blancheur du paysage.
Le matin, à l’aube, on ne voyait qu’elle,
Verte tige obstinée et confiante,
Qui ne savait pas que l’hiver encore
Avait de beaux jours devant lui.
Insouciante et belle
Comme une fille au printemps,
Elle continua de croître malgré le vent du nord.
Bientôt, deux bourgeons troublants
Vinrent couronner sa silhouette svelte et fine.
Encore un jour et elle atteignit sa pleine maturité,
Incroyablement belle,
Attirante et attendrissante comme une femme.

00:05 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
29/01/2017
Page blanche
Quand la page est blanche
Et que la neige tombe,
Ecrire encore serait comme une rature
Sur la beauté du monde.
Dans le jardin, un chat a laissé l’empreinte de ses pas
Jusqu’au bout de la nuit.
La neige tombe toujours
Et bientôt l’univers aura disparu.
On devine dans la brume
Une lune blanche et blafarde.
Silence nocturne.
J’écoute le chant de mes rêves.
Dans la nuit gelée
Il n’y a plus rien.
Rien que ma page blanche
Et moi qui la contemple.
Pourquoi écrire d’autres histoires
Quand tout est là, dans cette blancheur éternelle ?
Que dire encore qui n’ait déjà été dit
Par tous ceux-là qui se sont perdus sur les chemins du temps ?
L’aube déjà se lève.
Un oiseau ose un cri,
Puis retourne à l’oubli qui n’a pas de nom,
Celui du grand hiver qui a tout englouti.
Dans le salon, la lampe est restée allumée
Au-dessus du petit cahier bleu.
Sur la page vierge, un seul mot est tracé.
C’est celui d’un prénom de femme.

00:05 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature
08/01/2017
Du lecteur et de la lecture
Vous tous, qui venez ici, devez être comme moi des passionnés de lecture. Pourtant, si on parle beaucoup des auteurs et des œuvres qu’ils ont écrites (que ce soit des romans, de la poésie, des essais ou des nouvelles), on ne dit jamais rien sur le personnage qu’est le lecteur ni sur l’acte de lecture en lui-même. Considéré comme passif, celui-ci ne mériterait pas notre attention.
Je termine à l’instant le livre « Le lecteur » de Pascal Quignard dont le thème est précisément la disparition du lecteur. En gros et pour faire simple, Quignard nous dit que lorsqu’un lecteur s’assoit et prend un livre, il oublie tout ce qu’il est pour se plonger dans l’histoire racontée. Reniant sa personnalité, il s’identifie (provisoirement) aux personnages de papier dont il suit les histoires. Dévoreur de livres, il finit dévoré par sa passion, devenant Jean Valjean avec Hugo, Phèdre avec Racine, Madame Bovary avec Flaubert ou Bardamu avec Céline.
Quignard ne manque pas d’ironie, car pour nous parler du lecteur il écrit lui-même un livre, laissant sous-entendre par-là que nous qui le lisons allons disparaître à notre tour. Le jeu est plaisant mais il me paraît limité. N’y aurait-il vraiment rien d’autre à dire sur ce lecteur ? N’y a-t-il que lui qui disparaît ? Et disparaît-il vraiment ?
Reprenons tout cela au début.
Quand il se passe un événement, celui-ci sera raconté de manière différente par toutes les personnes qui étaient présentes et cela tout simplement parce que chacun a sa propre sensibilité. Si une jeune dame trébuche sur le trottoir et se blesse, certains se mettront à sa place avec empathie, d’autres critiqueront l’incompétence des services communaux qui n’ont jamais réparé ce trottoir, d’autres encore se sentiront faibles à la vue du sang et certains ne penseront qu’à la manière de porter secours à la jeune victime (soit par compassion réelle, soit pour le plaisir d’entrer en contact avec elle.
Il en va de même sur le plan des émotions. Devant un paysage enneigé, on peut être émerveillé devant la beauté de la nature, se plaindre du froid ou tempêter parce que les routes ne sont pas dégagées. Mais même ceux qui s’émerveillent le font pour des motifs différents. Le premier admirera la blancheur, qui évoque pour lui la pureté, le deuxième sera sensible à l’uniformité du paysage, le troisième ne verra que les branches des arbres chargées de neige, tandis que pour le dernier cette neige évoquera le pays de son enfance.
On pourrait multiplier les exemples à l’infini. Il suffit de dire qu’il n’y a pas une réalité mais qu’il y en a autant que d’individus sur la terre. Donc, quand un écrivain décide de prendre la plume et de nous raconter une histoire (ou d’écrire un poème), c’est avant tout avec sa sensibilité qu’il va écrire. Un autre écrivain qui raconterait la même histoire la tournerait autrement et dirait finalement autre chose.
Même s’il est historien et qu’il veut s’approcher de la réalité des faits, cet homme qui écrit sera influencé, qu’il le veuille ou non, par ce qu’il est (ses opinions politiques, son goût ou son aversion des batailles, le fait de croire ou non que la personnalité d’un dirigeant peut changer le cours des choses, etc.). Michelet, qui est à la fois historien, poète, visionnaire, et qui possède une belle plume, est un bel exemple pour illustrer notre propos.
Mais nous ne parlons pas ici d’Histoire mais de littérature. Je veux dire par-là que dans un roman, l’histoire est inventée, même si elle s’inspire de faits réels. Ces faits, l’écrivain a dû les assimiler et après un certain temps, après les avoir passés au moule de sa sensibilité, il va les restituer en les transformant.
La littérature est donc deux fois mensongère. Une première fois parce que l’homme qui deviendra écrivain a déjà interprété les faits réels dont il s’inspirera plus tard pour raconter une histoire (la vision de Zola sur la société n’est pas celle de Barrès et celle de Chateaubriand n’est pas celle de Jules Vallès) et une deuxième fois parce que cette réalité est délibérément transformée pour en faire une œuvre de fiction.
Arrêtons-nous un instant sur ce point pour souligner qu’un écrivain s’inspire rarement d’un fait unique mais qu’il va puiser à différentes sources pour finalement les transformer, les amalgamer et en faire cette œuvre de fiction unique qui nous enchante. Il en va de même des personnages et des lieux. Il fut une époque où les historiens de la littérature voulaient absolument mettre un nom sur chaque protagoniste ou chaque endroit cité dans un roman. Prenez les œuvres complètes de Nerval, dans la mythique collection des Classiques Garnier (édition scientifique qui était un peu la Pléiade du pauvre puisque le prix en était plus abordable). Le critique veut mettre un visage réel sur chaque personnage et Sylvie ne peut être que telle cousine tandis que telle rivière est celle où le petit Gérard passait on enfance. D’abord ce genre de remarque n’a que fort peu d’intérêt pour le lecteur, qui n’a pas connu la cousine en question et qui n’a jamais vu la rivière maintenant mentionnée avec une érudition quelque peu fatigante. Mais en plus cette remarque est fausse dans la mesure où si Nerval s’est inévitablement inspiré de sa cousine ou de la rivière de son enfance (car c’est dans l’enfance que sont les racines de notre être), il s’est aussi inspiré de toute une série de personnages féminins rencontrés dans sa vie pour dessiner le portrait de son héroïne. L’acte créateur est avant tout synthèse et transformation. Il est donc foncièrement mensonger pour notre plus grand plaisir.
Revenons maintenant à Pascal Quignard et à son lecteur, qui délaisserait sa personnalité pour s’identifier aux héros des romans qu’il lit. Quignard aurait donc dû dénoncer aussi l’écrivain, puisque l’histoire que celui-ci nous propose est doublement fausse comme nous venons de le voir. Si le lecteur a le tort d’être passif, l’écrivain, lui, a le tort de n’être finalement qu’un menteur car il y a loin de la réalité à l’histoire qu’il nous raconte. Le lecteur est donc doublement abusé et il a bien tort de renier provisoirement sa personnalité pour des histoires inventées.
Mais ce lecteur est-il aussi passif que Pascal Quignard ne veut bien le dire ? Honnêtement, je ne le pense pas.
En effet, chaque personne qui ouvre un livre vient avec sa propre sensibilité et Madame Bovary sera reçue différemment par chaque lecteur. De plus, chacun a son passé et les événements vécus orientent la manière de voir et d’interpréter les faits (dans le roman lu, il s’agit de faits certes fictifs, mais présentés comme vrais). La culture de chacun a aussi une importance considérable, on le comprend facilement. Mais les lectures passées orientent aussi notre manière d’aborder un livre inconnu. Selon que je suis plus ou moins sensibilisé au réalisme magique, j’apprécierai différemment l’œuvre de Garcia Marquez. Si je n’ai lu que des bandes dessinées et que je n’ai jamais ouvert un roman classique du XIXème siècle, je risque de trouver « Les frères Karamazov » de Dostoïevski un peu longuet et je n’apprécierai pas ce livre à sa juste valeur. L’âge auquel j’aborderai cette œuvre va jouer également, d’où l’intérêt de relire parfois certains auteurs qu’on a cru comprendre à vingt ans et qu’on redécouvre littéralement à cinquante.
Bref, on l’aura compris, le lecteur vient avec son bagage personnel. Dès lors, son passé, sa personnalité, sa sensibilité et sa culture littéraire vont influencer fortement sa manière d’aborder le roman qu’il a entre les mains. Son attitude n’est donc pas aussi passive que Pascal Quignard ne veut bien le dire. Il est passif dans le sens où il n’est pas responsable de ce qu’il est devenu - ou du moins pas entièrement (c’est la vie qui s’est chargée de le rendre tel qu’il est ) mais il ne l’est pas quand il ouvre un livre. Chaque lecteur étant différent, on ne peut donc se contenter de parler « du lecteur » comme s’il s’agissait d’un terme générique général. La réalité est bien plus complexe. Il n’existe donc pas un lecteur, mais des lecteurs.
Poursuivons notre propos. Ce sera facile. Chacun étant différent, l’interprétation qui sera faite du texte lu sera elle aussi différente, qu’on le veuille ou non. Il y a donc d’un côté un auteur qui a voulu exprimer quelque chose (et nous avons vu que pour cela il a transformé deux fois la réalité) et de l’autre des lecteurs qui vont interpréter son texte. Evidemment, l’idéal serait qu’ils comprennent exactement ce que l’auteur a voulu dire. Ils doivent donc s’en tenir au texte proprement dit, le suivre mot à mot et ne pas extrapoler. Mais au-delà de cet exercice qui se veut fidèle à la pensée de l’auteur, il y aura inévitablement des interprétations personnelles. C’est pour cela qu’on dit qu’une fois qu’un livre est édité il n’appartient plus à l’auteur mais aux lecteurs. En effet, ceux-ci vont y trouver des vérités que l’auteur y a mises à son insu (et dont il n’a pas conscience) et aussi des vérités qu’il n’a pas mises mais qui peuvent cependant être extraites de son texte.
On le voit, le lecteur n’est donc pas aussi passif que Pascal Quignard ne veut nous le faire croire, lui qui voit dans l’acte de lecture la disparition pure et simple d’une personne, son anéantissement.
Bien au contraire, la littérature redit le monde et l’interprète. C’est le travail de l’auteur d’en extraire « la substantifique moelle » et de nous la présenter sous la forme d’un récit (ou d’un poème). Mais c’est le travail du lecteur de rentrer dans cette histoire (ou dans ce poème), de la comprendre, de se l’approprier, pour en retirer à son tour un plaisir esthétique mais aussi un enseignement qui lui sera profitable. Car la littérature n’est pas un jeu gratuit, elle est interprétation et contestation du monde et de la société. C’est à ce titre qu’elle nous enchante et c’est donc pour cela que tout lecteur reste fasciné par une grande œuvre. Mais loin d’être passif devant elle et de disparaître, ce lecteur s’enrichit à son contact et en ressort différent. Cette transformation est absolument extraordinaire si on réfléchit au fait que l’auteur n’a fait que mentir et que le lecteur n’a fait qu’interpréter.

01:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : littérature, lecteur
31/12/2016
Le boiteux de Grattebourg de Rolande Michel (Editions Chloé des Lys)
Je termine à l’instant le livre de Rolande Michel et je dois dire d’emblée qu’il m’a beaucoup plu. L’histoire se déroule dans un petit village un peu hors du temps, où des événements de plus en plus curieux se produisent, ce qui fait qu’insensiblement le lecteur se retrouve dans une ambiance fantastique. C’est que dans ce village à première vue ordinaire (on retrouve un maire, un curé, un médecin et la palette classique des habitants, du boucher au fermier et du garde-champêtre au cafetier, en passant par une ou deux grenouilles de bénitier quelque peu médisantes), il va se produire toute une série d’événements. Au début, ceux-ci n’ont rien d’anormal en soi et peuvent s’expliquer rationnellement (par exemple, un chat qui gratte à la fenêtre en pleine nuit et qui effraie un enfant endormi) mais petit à petit, par leur répétition et leur côté étrange, on bascule insensiblement dans un univers insolite et inquiétant : la fenêtre contre laquelle le chat vient gratter est tellement haute qu’elle est en principe inaccessible, même pour un félin, ce chat agressif effraie de nombreux enfants, les eaux paisibles du lac se mettent à faire des vagues, les poules des villageois sont égorgées les unes après les autres, etc. Le lecteur est pris dans cette tourmente et l’inquiétude des habitants devient peu à peu la sienne. A la fin (fin que je ne raconterai évidemment pas ici), tous ces événements étranges nous plongent dans une situation qui est clairement fantastique. Celle-ci, que l’auteur a subtilement amenée, progressivement et par paliers, est finalement acceptée sans problème par le lecteur et elle vient clôturer un livre à la lecture duquel il a pris beaucoup de plaisir.
Il faut dire que dès le début ce village est décrit comme atemporel. La vie que l’on y mène semble celle d’une autre époque : on y vit en autarcie, comme dans les années 1930 (des fermes, de petites boutiques, une église, etc. et il y a même un moulin à vent pour moudre le blé). Pourtant, la présence épisodique de la télévision vient démentir cette impression. On est donc bien dans le monde d’aujourd’hui, mais le temps semble s’être arrêté.
L’endroit où se situe le village est lui aussi ambigu. On a parfois l’impression d’être dans une campagne reculée, éloignée de tout. Pourtant, on apprend que certains habitants vont travailler comme ouvriers dans la ville voisine. Des « étrangers », venus on ne sait d’où, viennent aussi s’établir parmi les habitants (mais à ceux-là, on préfère ne pas parler). Le médecin regrette d’être venu s’installer dans cette localité arriérée, aux mentalités archaïques et il s’en ira d’ailleurs à la fin. Les jeunes eux aussi quittent le village.
Que ce soit sur le plan géographique ou temporel, Grattebourg est donc « en marge », sans qu’on puisse rien préciser de plus. Cette situation est voulue par l’auteur et elle lui permet d’introduire plus facilement le côté fantastique de l’histoire.
Il y aurait beaucoup à dire sur les thèmes développés dans cet ouvrage, où la mort est omniprésente. Le principal protagoniste, Anselme, a un don de voyance car chaque fois qu’une personne va mourir dans le village, il a la vision terrifiante d’une charrette qui s’approche à grand bruit, conduite par un cocher habillé de noir et qui fouette ses chevaux. C’est le char de la mort qui vient pour emporter sa future victime. Le livre commence d’ailleurs par le décès d’un des habitants, Jules, mais il y en aura d’autres, comme Joe, qui se noie dans les remous mystérieux du lac. Le meunier, lui, avait été retrouvé pendu aux ailes de son moulin. Il faut dire qu’il venait de perdre sa femme, laquelle s’était noyée de désespoir après la mort de son enfant. On le voit, le mort est donc ici un thème central, qui oblige le lecteur à réfléchir à sa propre destinée.
On notera que la religion est abordée avec un sourire amusé. Le curé est bien brave, certes, mais on le sait gourmand et il préfère laisser un homme mourir seul sous prétexte qu’il doit aller dire une messe ailleurs. On le sent peu humain. Les sœurs du couvent préfèrent aussi s’adonner à leurs prières et à leur contemplation plutôt que de s’intéresser au sort des villageois. Anselme l’orphelin a pourtant été recueilli par elles, mais il reste livré à lui-même et on ne s’occupe pas de lui. On ne trouve donc rien de très chaleureux du côté de ces religieuses non plus.
Venons-en maintenant aux personnages principaux. Ils sont tous « en marge » par rapport aux habitants. Anselme est orphelin et boiteux, ce qui lui vaut la méfiance des habitants et les railleries des écoliers (et du coup il ne fréquente pas l’école, ce qui ne l’empêche pas de savoir lire, autre singularité). Joseph, le rebouteux, vit à l’écart du village et est parfois accusé de sorcellerie. Maria, elle, tire les cartes de tarot et semble avoir des liens avec un monde parallèle. Ces trois personnages ne sont pas originaires du village, ils viennent d’ailleurs (mais on ne sait pas d’où), ce qui accentuent encore la méfiance à leur égard. Ils ont pourtant le fond gentil et aident tout le monde. Joseph soigne les gens gratuitement avec ses remèdes et Anselme fera de même une fois qu’il sera devenu son élève dans l’art de guérir par les plantes. Anselme qui à la différence du curé sera resté auprès de Jules au moment où celui-ci mourait.
Ces personnages sont donc différents (tant par leur physique que par leur générosité) et leur comportement, basé sur le don de soi, contraste fortement avec la mesquinerie des habitants de ce village. C’est là sans doute que réside la morale de cette belle histoire.
12:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature
23/12/2016
Plaisir de la lecture
J’ai tourné les pages de ce livre une à une, lentement,
Comme autrefois j’enlevais tes vêtements,
Sans hâte et méticuleusement.
Subtil effeuillement, plaisir suprême.
J’ai commencé à lire, une ligne, puis l’autre
Et les mots soudainement ont pris un sens
Comme mon doigt qui descendait le long de tes courbes,
Histoire sans fin d’un corps qui disait son bonheur.
Il est des chapitres sombres et des chapitres clairs,
Comme il est des jeux d’ombre et de lumière sur ta peau
Des monts éclairés, des gorges profondes,
Des clair-obscur à découvrir tendrement.
Il est des senteurs étranges de vieux parchemin,
Et celles du cuir doré des vieux livres.
Il est des senteurs sauvages dont je m’imprègne
En parcourant ta peau qui se lit comme un livre.
La fin de l’ouvrage est toujours un peu triste,
On voudrait rester encore avec les personnages,
Mais te quitter est plus triste encore
Et je voudrais demeurer infiniment en toi.

12:15 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
10/12/2016
La maison des souvenirs
Il suffit de caresser la mousse qui recouvre le vieux tronc pour entendre le murmure de la forêt. C’est une musique douce à mes oreilles, celle qui déjà emplissait le monde de mon enfance.
Cet arbre-ci, je l’ai toujours connu, lui dont les branches s’agitaient près de la fenêtre de ma chambre. Parfois, les nuits de grand vent, elles venaient se frotter contre les vitres en caresses étranges et troublantes. Alors je fermais les yeux et m’endormais rassuré, bercé par ce doux va-et-vient monotone et entêtant.
Aujourd’hui, la maison est en ruine, plus personne ne l’habite. Inutile d’entrer, je connais chaque recoin par cœur. Des marches glissantes de schiste bleu descendent vers la cave au sol de terre battue. Il règne là une odeur de mort que seuls supportent les rats, terribles mangeurs de récoltes. Dans la cuisine, la grande cheminée attend les brassées de bois pour des feux imaginaires que plus personne n’allumera. Autour de la table maintenant vermoulue, l’ombre de mes frères et sœurs doit continuer à hanter ces lieux, fantômes éternels qui errent au fond de ma mémoire. Le vieil escalier de bois grince-t-il encore quand on monte vers les chambres d’un pas hésitant, sachant qu’on va bientôt basculer dans le monde irrémédiable des rêves ? Le grenier est sans doute resté désert. Seul un grand drap blanc qu’on avait mis là à sécher se balance-t-il encore doucement, car la vitre de la tabatière est brisée. C’est par là que pénétraient les oiseaux de la nuit, dont on entendait les pas incertains sur le vieux plancher.
Cette maison est remplie de légendes, de souvenirs et d’histoires incroyables.
A l’extérieur, le long du mur, une plante étrange s’est mise à pousser. Ces fleurs sont rouges comme le sang. Ce sang qui coula ici, à la fin de la guerre, quand les ennemis qui se repliaient voulurent laisser une trace de leur passage.
Je descends vers la rivière, laissant à ma droite le cimetière aux souvenirs. Je ferme les yeux. Du fond de mes rêves perdus, j’entends le murmure de ceux qui se sont tus. Ce ne sont que les arbres de la forêt qui bruissent sous le vent du passé.
02:19 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature
22/11/2016
Cap breton
C’est un grand cap qui s’avance dans la mer, une étendue verdoyante où fleurissent les bruyères. Quand on emprunte le petit chemin qui mène à son extrémité, on finit par se retrouver seul devant l’immensité bleue de l’océan qui gronde en-dessous. Il faut alors prendre le sentier tortueux qui descend par palier à flanc de falaise, en veillant à ne pas regarder en bas, sous peine de se sentir irrésistiblement attiré par le vide qui vous entoure de toute part. Il faut continuer à marcher et ne pas se laisser distraire par le bruit sauvage et continu qui provient des profondeurs. Vous savez que là les vagues se fracassent contre les rochers noirs et qu’inlassablement les galets sont roulés dans un grondement de fin du monde.
Une fois arrivé tout en bas vous pourrez vous asseoir sur le sable fin d’une crique minuscule et contempler le spectacle grandiose et sauvage de la nature primitive. Eclaboussé d’écume, recouvert d’embruns, vous vous souviendrez être venu ici avec elle, autrefois, à une époque lointaine. De tout cela, il ne reste que la saveur de deux lèvres salées et la chaleur d’un corps qui se blottissait contre le vôtre. Et puis aussi des cheveux flottant au vent et cachant un visage souriant.
A vos pieds la mer continue de s’agiter, enragée comme jamais, en harmonie avec le trouble qui s’empare de votre cœur.
Après une heure passée à contempler les flots écumeux, vous finirez par remonter le sentier à flanc de falaise, puisqu’il le faut bien. Au sommet, vous contemplerez encore une fois l’immense océan et ses flots bleus et en vous éloignant vous vous demanderez pourquoi l’herbe de la lande est devenue si terne et pourquoi les fleurs des bruyères semblent si clairsemées.
C’est un grand cap qui s’avance dans la mer. En bas, il y a des vagues qui se fracassent contre des rochers noirs.

00:07 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature
10/11/2016
Anne-Marielle Wilwerth
Anne-Marielle Wilwerth est une poétesse du silence. Ses textes sont courts (trois ou quatre vers, pas davantage) mais denses car elle estime sans doute qu’il faut dire l’essentiel et puis se taire. « Quand on a entendu du Mozart, le silence qui suit est encore du Mozart » disait Sacha Guitry. Cette sentence pourrait s’appliquer aux textes du recueil d’Anne-Marielle, « L’île tutoyée » (Editions La Bruyère, Paris). Par petites touches brèves et incisives, elle s’inspire d’un paysage maritime (et qui est même encerclé par la mer, puisqu’il s’agit d’une île, autrement dit d’un lieu isolé dont on ne peut ni ne veut s’échapper) pour parler de ses sentiments intérieurs et de son moi profond. Les paysages ne sont pas simples descriptions, mais prétexte au cheminement intérieur.
J’ai le temps
J’attendrai
que la mer me transmette
ses secrets de sel
et que s’installe en moi
la sagesse insulaire
L’écrivain n’est jamais loin, qui, en surprenant la conversation du gardien et de son phare, apprend à « éclairer de l’intérieur l’ancre des mots » Ancre des bateaux amarrés dans la baie ou encre du texte qui s’écrit ? Au lecteur de choisir et s’il aime les jeux de mots, il sera servi. Ainsi, on parle de « la première page du paysage », « des jardiniers de l’âme », « des îles frangées de doute » ou du « poème échoué au fond de ma barque ».
Les animaux sont présents, pourtant, dans cette île des grandes solitudes. On y croise des chats
qui ont dans leurs yeux
la grande marée
-celle qui pousse les pensées
Vers le dedans
On observe des mouettes, à la pointe de l’île, « là où les rochers parlent peu » ou bien des goélands. On n’est pas loin de l’albatros baudelairien, mais point de bateau où l’animal peut venir s’échouer ici. On préfère plutôt « traverser à gué le long poème de la mer ». Un bateau, la poétesse en apercevra un pourtant, qui rentre au port, et c’est alors un peu comme si elle se réconciliait avec l’autre versant d’elle-même.
La présence d’une sirène et les « grottes du savoir où se parfument les fées » font penser à Nerval et à son «Desdichado ». Pourtant, point de vrai tristesse, ici, mais plutôt une quête de soi-même et on cherche son identité « dans les balcons éphémères des vagues ».
L’autre recueil que j’ai lu («Le coupeur de phrases est passé » publié chez L’horizon vertical) est plus difficile à expliquer car plus hermétique et il faut le lire pour s’en imprégner. Les mots sont judicieusement choisis et s’entrecroisent pour former des bouquets étranges et fascinants.
Je cherche les éclaireurs de miroir
La trame le plus profonde est en nous de toute façon Nous qui jardinons partout sauf dans nos jardins Les images que je récolte dans mes mains effacent ma voix qui voudrait briller dans la haute mer Qui a fermé mon grenier à sel J’ai besoin de chaque parcelle d’amour
La poétesse est devant son miroir sans doute et elle cherche qui éclairera et donnera un sens à l’image qu’elle voit. Mais la trame la plus profonde (ce qui est caché) est en elle, jardinière particulière qui jardine en elle-même. L’image qu’elle récolte (le sens de ce verbe renvoie à l’idée de jardin), elle la tient dans ses mains (belle métaphore) Mais cette image n’est sans doute pas satisfaisante puisqu’elle efface sa voix qui aurait voulu briller au milieu de la mer. Le « grenier à sel » renvoie à la fois à l’idée de mer, qui vient d’être évoquée (et du sel aux larmes il n’y a jamais loin) mais aussi au jardin (le grenier étant l’endroit on en conserve les produits de la terre). La dernière phrase dit le besoin d’amour, dont on ne gaspille aucune parcelle car il est rare. C’est donc une femme seule qui se contemplait dans le miroir et qui se demandait qui « éclairerait » sa vie.
Ce serait sans doute aller trop loin que de voir dans ce poème une connotation érotique (encore que des mots comme « profond » « mains », « jardiner » et « grenier à sel » pourraient aller dans ce sens. Mais d’autres textes s’y prêtent davantage :
Déchirement aux hanches du cri Muraille entrouverte sur un glaive éraillé
Cependant, ce serait réducteur comme interprétation. L’essentiel n’est pas là, mais dans des phrases comme « j’ai envie de voir les étoiles au fond de la mer » qui disent bien l’aspiration à un au-delà poétique. On notera au passage le choc des images (étoiles de mer ou les étoiles du ciel qui se retrouvent au fond de la mer). Derrière la réalité, le poème crée donc un monde à lui, où la vraie vie peut enfin trouver un sens. « Je veux respirer encore demain quand la marée se lèvera ».

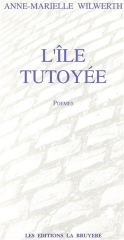

23:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, anne-marielle wilwerth
01/11/2016
Françoise Houdart, "L'amie slovène", Editions Luce Wilquin, 2011
Magnifique roman que celui de Françoise Houdart, « L’amie slovène » que je referme à l’instant. C’est un livre sur le temps qui passe et sur l’amitié, qui reste plus forte que ce temps qui cherche à séparer les êtres. Laura a fui la Belgique pour retrouver ses racines en Slovénie. Là, devenue Lara, elle apprendra le slovène, cette langue que sa mère a refusé de lui parler depuis qu’elle est petite. Ce retour aux sources est donc une manière de se reconstruire et de trouver une identité. Mariée et devenue mère, elle entretient une relation épistolière ou téléphonique avec Sarah, son amie belge. Les années défilent et les deux femmes sont tellement prises par leur propre vie (les enfants, la guerre, la maladie, la mort) qu’elles ne trouvent jamais le temps de se revoir. A moins qu’elles ne l’aient pas vraiment voulu. En effet, si leur correspondance ne s’est jamais interrompue, il est clair qu’elles ne se sont pas dit l’essentiel et qu’il reste des zones d’ombre, des non-dits, des silences.
Pourtant, après plus de trente ans de séparation, Sarah décide d’aller revoir son amie. Elle laisse là son mari et prend l’avion pour la première fois de sa vie, la peur au ventre. Peur de ce premier vol, sans doute, mais peur aussi de ce qu’elle va trouver à son arrivée. Laura/Lara sera-t-elle devenue une étrangère pour elle ? L’attendra-t-elle seulement à l’aéroport ? Mais oui, elle est là et durant trois jours les deux femmes vont se (re)découvrir. Lara va se mettre à parler. Elle racontera son arrivée en Slovénie pour fuir un amour impossible en Belgique, son mariage heureux avec Ivan, mais aussi la guerre d’indépendance et le conflit avec la Serbie. Elle dira aussi la mort d’Ivan, emporté par la maladie et la solitude qui est la sienne aujourd’hui.
Durant ces trois jours, Lara fera découvrir son pays à son amie, depuis la douceur de la côte adriatique jusqu’à l’hiver glacial et enneigé de Ljublana. Car tout se joue sur le thème de la dualité, dans ce roman. Il y a deux pays (la Belgique et la Slovénie), deux temps (un avant et un après), deux langues (le français et le slovène). Les mots ont une importance primordiale. Car si Sarah est écrivain (elle enregistre d’ailleurs la conversation de son amie pour en faire plus tard un roman, qui est finalement celui que le lecteur tient en main, dans une sorte de mise en abime), Lara est traductrice. Et si les mots ont permis aux deux amies de conserver le contact pendant plus de trente ans, c’est aussi par les mots qu’elles vont se redécouvrir. Car chacune a changé au cours de toutes ces années. La vie a laissé ses traces et de petites rides sont apparues sur leurs deux visages. Mais l’amitié est toujours là, même si bien des choses n’ont pas été dites et si bien des secrets sont restés cachés.
Car Sarah avait une amie qui s’appelait Laura et c’est Lara qu’elle découvre dans ce pays étranger pour elle. Pourquoi avoir amputé son prénom d’une lettre ? Pour devenir autre et être une vraie Slovène, en reniant sa jeunesse passée en Belgique. Mais cela veut dire aussi que Lara a fui ce qui avait constitué cette jeunesse et qu’elle a renié une part d’elle-même. Durant ces trois jours, grâce à Sarah, elle va renouer avec son passé et tenter de concilier ses deux identités.
En attendant, elle lui montre les endroits qui ont compté dans sa vie (paysages, villes, ponts, maisons, etc.), ce qui permet de montrer avant d’oser dire. Car il faut du temps pour que les mots reviennent, il faut du temps pour oser se dire et se raconter à l’amie. Parfois, Lara s’aide de vieilles photos conservée dans une boîte pour rafraîchir sa propre mémoire. Alors elle raconte sa vie, ses joies, ses souffrances. Sarah, qui n’avait jamais compris comment cette jeune fille libre et libérée qu’était Laura avait pu venir s’enfermer dans un pays austère comme la Yougoslavie, découvre que la réalité était tout autre. Lara était libre d’aller où elle voulait et elle a d’ailleurs beaucoup voyagé à l’étranger avec son mari. Elle est même revenue quelques jours en Belgique au moment de la guerre d’indépendance. Pourquoi alors ne l’a-t-elle pas dit ? Pourquoi n’a-t-elle pas cherché à la revoir alors qu’elle était si près ? Il était donc grand temps que les amies se retrouvent et se parlent. Et c’est là toute la beauté de ce livre : cette manière de se retrouver, de se réapproprier l’amitié, par petites touches discrètes et pudiques.

01:06 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, françoise houdart
27/10/2016
Automne sanglant
Il fut le seul à se lever.
Il fut le seul à dire tout ce que tout le monde savait et que personne n’osait dire.
Il y eut bien dans la foule quelques murmures d’approbation, puis ce fut tout.
Quand les forces de l’ordre vinrent pour l’arrêter, tous se turent et il ne se trouva personne pour le défendre.
Jamais il n’avait été seul à ce point.
Il tenta de se sauver mais un coup de feu eut raison de son courage.
Le lendemain, sur le trottoir, il ne restait de l’incident qu’une trace rouge sombre, une tache couleur de l’automne.
Les passants pressaient le pas, sans rien dire, mais songeaient en eux-mêmes qu’il avait bien cherché ce qui lui était arrivé.
Une bourrasque se leva emportant les feuilles des arbres, rouges et jaunes, qui s’éparpillèrent dans le vent.

00:25 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
20/10/2016
Réflexion
Le temps manque. Il a dû se perdre quelque part. La page reste blanche, les mots se sont enfuis. Ils ont été emportés par les bourrasques d’automne, comme les feuilles qui s’en vont dans le vent. Bientôt la neige recouvrira la page et nul ne se souviendra des mots qu’on aurait pu écrire et qu’on n’a pas écrits.
00:52 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature
06/10/2016
Fleur marine
Il est une fleur dans la nuit
Dans la nuit noire du temps.
Il est une fleur dans mes souvenirs
Qui s’étiole lentement et se fane.
Par-dessus les grandes falaises de la mer
Passe le vent fou qui vient du large.
Il vient de là-bas, de l’autre côté de l’horizon
D’où personne, jamais, n’est revenu.
Sur la plage où les enfants nagent
Git un vieux rafiot d’autrefois.
Point de marins à la barbe drue,
Mais quelques noms, sur la pierre froide,
En mémoire de ceux qui ont disparu.
L’océan est partout, qui s’agite et gronde,
Puis qui déferle sur les falaises du temps.
Il est une fleur dans ma mémoire
Que le vent emporte jusqu’à l’horizon.

16:52 | Lien permanent | Commentaires (5)
09/09/2016
Nocturne
Je voudrais dire le bruit de la pluie dans les petits matins,
Quand le café noir fume encore dans les tasses
Et que son goût âcre m’emporte bien loin.
Je voudrais dire les figures tristes croisées dans le métro
Quand les rêves se sont trompés d’aiguillages
Et que j’ai oublié le goût de tes baisers.
Je voudrais dire les grands bateaux blancs qui se perdent en mer
Quand le soleil se couche
Et engloutit tous nos espoirs.
Je voudrais dire.
Mais enfermé dans le silence immobile,
Je contemple les dernières étoiles mortes
Qui brillent au milieu de nulle part.
Là-bas, dans la brume nocturne,
On entend la rivière,
La belle rivière de nos enfances
Qui n’en finit plus de ronger les paysages.
Insomniaque à ma fenêtre
Je rêve du temps passé.
La nuit d’août s’achève.
Bientôt, les cerfs brameront dans les clairières de feu
Et l’automne venteux s’infiltrera sous les portes de ma mémoire.
Je voudrais dire, encore une fois,
L’immensité de la forêt,
Sa rumeur, ses soupirs et son éternel mystère.
Je voudrais dire les chemins parcourus par les aventuriers
Depuis les ruines de Carthage
Jusqu’aux steppes infinies de l’Asie centrale.
Je voudrais dire tant de choses…
Mais qui entendra ma voix ?
J’aurai beau crier du haut de la falaise,
Le bruit des vagues, toujours, l’emportera,
Monotone et éternelle clameur des mondes.
Demain est aussi loin qu’un pays étranger.
Seule existe la rumeur des feuillages dans la brise d’été,
Rumeur semblable au ressac de l’océan
Contre les murs du temps.
Tout près de moi, un oiseau de la nuit a frôlé les cimes
Puis s’est perdu dans l’immensité,
Emportant avec lui son cri mystérieux
Chargé de tous nos désespoirs.
Il faudrait dormir.
Minuit est passé depuis longtemps
Et la lune elle-même s’en est allée,
Poursuivant son éternelle course incompréhensible.
Le ciel, maintenant, est vide et noir.
Seule subsiste dans mon cœur une petite musique intérieure,
Sonate composée de quelques notes seulement,
Mais qui me dit de croire à la vie.
Alors je me souviens que les yeux des femmes brillent
Parfois, dans la pénombre des chambres.
Je voudrais dire leurs gestes tendres et gracieux,
Le son de leur voix,
Et le parfum qui imprègne leurs vêtements
Quand lentement elles se déshabillent
Et s’avancent nues dans l’immensité du monde.
Le vent se lève et il fait plus froid.
Bientôt le beau chêne près de la fenêtre perdra ses feuilles.
Celles-ci tomberont une à une, inexorablement,
Comme les minutes qui avancent au cadran de la vie.
Dans le ciel passeront des oiseaux en partance
Vers des cieux improbables.
Tout n’est que départ, mouvance et éternel recommencement.
Seul je demeure au milieu du silence.
Une ancienne blessure s’est rouverte,
Blessure d’amour qui saigne au milieu de la nuit
Et qui colore l’horizon d’une encre rouge.
Voilà le soleil qui se lève au-dessus des abîmes.

00:05 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature
31/08/2016
Le port
Il y avait là des voiliers, de grands voiliers revenant de nulle part.
Il y avait la mer, qui rongeait les pierres grises du port et puis surtout il y avait des dizaines de marins, attablés dans les petits cafés aux toits d’ardoise.
Et ça riait et ça criait fort, bien plus fort que le bruit des vagues qui tout à côté déferlaient sur la plage de galets.
Parfois une bagarre éclatait, pour quelques sous perdus au jeu, pour une femme éperdue, ou même pour rien, si ce n’était le plaisir de se battre.
Dans l’ombre du soir, on voyait briller la lame des couteaux et quand le sang coulait sur les pavés noirs, jamais personne ne serait allé dénoncer le coupable. C’est qu’ils étaient tous frères de la mer et du vent et qu’il y avait plus de vingt ans qu’ils voyageaient ensemble, de Dunkerque à Agadir et de Monrovia à Dar es Salam.
Ils étaient les enfants de la mer et si l’un d’entre eux disparaissait, jamais ils ne versaient une larme. Pourtant, quand un goéland venait se poser au bout du ponton, ils lui souriaient comme à un ami, saluant en lui son désir de voyage et de liberté.
Partir, voilà ce qui comptait, peu importe où et comment, finalement.
Partir, quitter le triste aujourd’hui et découvrir un ailleurs.
Dans le port, les attendaient les voiliers, les grands voiliers en partance pour nulle part.
10:05 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature
26/08/2016
François Bon, une vidéo...
00:23 | Lien permanent | Commentaires (4)
13/08/2016
Fin de partie
Je vous écris du bout du monde.
Je vous écris d’un pays qui n’existe pas, qui n’a jamais existé.
Ici, c’est la nature à l’état pur. Il n’y a pas de routes, à peine des sentiers, qui serpentent à travers la forêt profonde et que l’on suit comme on peut, malgré les moustiques et la chaleur accablante.
Quand on a bien marché, pendant six ou sept jours, on débouche au-dessus d’une grande falaise et alors devant vous s’étend la mer, la mer immense, à l’infini.
En contrebas, il y a des rochers qui s’avancent dans l’eau et qui finissent par disparaître au milieu de l’écume banche et rageuse.
Au-delà, il n’y a plus rien. Rien que l’océan, dont on entend la rumeur éternelle, seule musique de cette terre inhabitée.
Parfois, un goéland vient vous frôler, lançant un cri strident. On se souvient alors qu’on est seul, incroyablement seul. Personne autour de vous, rien que l’immense forêt dans votre dos et devant vous cette masse liquide qui s’agite et qui vous attend.
Je vous écris du bout du monde, d’un endroit au-delà duquel il n’y a plus rien. Rien que la falaise abrupte et le remous des vagues qui n’en finissent plus de se briser.

00:05 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature