28/06/2015
La France, le français et les langues régionales.
J’avais écrit autrefois un article sur les langues régionales et on avait pu le lire ici même sur Marche romane. En substance je disais toute l’affection que je pouvais avoir pour les langues régionales, tout en insistant sur le danger qu’il y avait à les reconnaître trop. En effet, sous prétexte de défendre les minorités culturelles, l’Europe visait surtout à affaiblir politiquement les Etats. Que serait la France si un Breton ne se sentait pas d’abord Français et s’il ne pouvait pas s’entretenir avec un Marseillais qui lui ne voudrait parler qu’en Occitan ? Car reconnaître les langues régionales peut aller loin (accès à l’administration, à la justice, etc.). Tout en reconnaissant que tous les patois méritaient certes le titre de langue à part entière, j’insistais sur le danger qu’il y avait à leur donner un statut officiel.
C’est le seul article qui a été censuré, Hautetfort me demandant de le retirer sous menace de fermeture de mon site. Le prétexte était que j’avais utilisé une carte géographique pour illustrer la répartition des langues régionales en France et que cette carte était propriété de l’agence France presse. Pour ne pas tout perdre, j’ai retiré l’article, mais je reste persuadé que ce qui était visé, ce n’était pas l’origine de la carte mais le contenu de mon article.
Bref, puisque je ne peux plus m’exprimer sur ce sujet, pourtant capital et qui me tient à coeur, je suppose que j’ai quand même le droit de citer les articles des autres. En voici un qui reprend en substance ce que j’avais dit, tout en insistant sur le rôle trouble de l’Allemagne dans ce jeu. J’ajouterai qu’il ne faut pas perdre de vue que l’Europe qui cherche à affaiblir les langues officielles de ses Etats membres (français, espagnol, italien) au profit de leurs différentes langues régionales, ne s’exprimera bientôt plus qu’en anglais. Curieux paradoxe, n’est –il pas vrai ?
Pour lire l'article, c'est ici.

01:03 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : langue française, patois, langues régionales
31/05/2009
Maurice Grevisse
L'autre jour, Solko avait consacré une note à Maurice Grevisse, le trouvant trop laxiste. Il n'a pas tort, mais j'ai envie de lui faire remarquer que les grammairiens font de la linguistique synchronique, ce qui signifie qu'ils donnent un état de la langue à un certain moment (en l'occurrence le français qui se parle de leur vivant). Ils sont donc « coincés » entre des règles et une tradition d'un côté et une langue qu'ils voient évoluer sous leurs yeux de l'autre.
Tant que ce n'est que le peuple qui commet une faute en ne respectant pas les règles, le grammairien peut sanctionner. Le problème de Grevisse, c'est qu'il s'est appuyé sur les « bons auteurs » pour trouver une légitimité à ce qu'il disait. Ceci traduit d'ailleurs une certaine admiration pour les écrivains et relève encore d'une conception proche de celle du XIX° siècle où on attendait encore de quelqu'un comme Hugo qu'il puisse, mieux que le commun des mortels, s'exprimer correctement.
Mais à partir du moment où Grevisse s'appuie sur le corpus littéraire pour légitimer ses règles grammaticales, il doit lire les auteurs qui lui sont contemporains. Forcément. Son but n'est pas de donner un aperçu de la langue de Molière mais de celle qu'on parle de son temps à lui. Et voilà qu'il découvre qu'une série non négligeable d'auteurs célèbres et reconnus font des fautes. Il ne peut donc que rappeler la règle première et constater que celle-ci perd de son autorité puisque même de « bons auteurs » ne la respectent plus ou ne la connaissent plus.
Quelque part donc, Grevisse tente encore d'imposer une règle ancienne tout en signalant qu'il ne faut plus trop se faire d'illusion et que la langue évoluant naturellement, il suffira d'une génération encore pour que cette règle apparaisse comme désuète.
Que devait-il faire ? Dans la note qu'il lui consacre, Solko lui jetait la pierre. Je le comprends quelque part. Mais d'un autre côté, je me dis que si Grevisse avait refusé cette ouverture vers une évolution inéluctable de la langue et s'était contenté d'affirmer des règles avec autorité, il aurait peut-être commis une faute, professionnellement parlant. En effet, en agissant de la sorte, il aurait fait comme si la langue ne devait plus évoluer. Or, malheureusement (ou heureusement), elle évolue.
On sent bien, quand on étudie un peu l'ancien et le moyen français, qu'une langue n'a pas toujours atteint son point d'équilibre. Alors que le latin classique permettait d'exprimer des idées complexes avec aisance, on remarque chez les écrivains de ces périodes intermédiaires une sorte de flou donc ils sont eux-mêmes conscients. Ils disent souvent qu'ils essaient d'exprimer au mieux ce qu'ils ont à dire avec la langue imparfaite dont ils disposent, langue qui n'est encore régie par aucune règle. C'est qu'il a fallu un certain temps pour passer des déclinaisons à six cas du latin (nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif) à une déclinaison à deux cas en ancien français (cas sujet et cas régime-complément) :
Singulier :
li murs (cas sujet), d'après murus, muri, le mur. On remarquera la chute de la voyelle
le mur (cas régime), d'après l'accusatif murum
Pluriel :
li mur (cas sujet), d'après muri
les murs (cas régime) d'après muros
C'est donc à partir du cas régime que le français s'est formé puisqu c'est là qu'on trouve la distinction entre le singulier sans « s » et le pluriel avec « s ».
Mais à peine un équilibre était-il trouvé avec l'utilisation de ces deux cas que la langue a continué d'évoluer naturellement vers plus de simplification encore pour arriver à ne plus posséder qu'un seul cas. Il fallut alors remédier à cette lacune par l'utilisation généralisée des prépositions (afin d'indiquer tout de même la fonction des noms : il parle « à » son ami, il vient « de » Paris, il va « à » Paris, etc.), ce qui demanda de nouveau un certain temps.
Il faut attendre le XVI° siècle pour que la langue trouve enfin son vrai souffle. Polie ensuite par les grammairiens du XVII° siècle (qui reprenaient, eux, l'usage de la Cour), elle atteint alors sa plénitude. Depuis, malheureusement, elle a quitté ce fragile point d'équilibre pour se simplifier. Les subjonctifs imparfait et plus que parfait sont complètement sortis du langage parlé, ainsi que le passé simple. On pourrait donner des dizaines d'exemples où ce qui se disait avec nuance s'exprime maintenant plus pauvrement. Je suis le premier à le regretter car il y a là une perte. Mais je me dis aussi que si mes ancêtres avaient raisonné comme moi, on parlerait encore latin.
Avec la mondialisation galopante que nous connaissons, il est à craindre que l'anglais ne devienne la seule langue véhiculaire (et il prendra ainsi la place qu'occupait le latin autrefois). Mais quel anglais ? Pas celui de Shakespeare, évidemment, mais un sabir commercial fort approximatif. Cela me fait de la peine. Et d'un autre côté je me dis que notre belle langue française est issue du bas latin de la fin de l'Empire, une langue de marchands et de soldats, d'immigrés et de barbares. Alors tous les espoirs me semblent permis. Sauf qu'il faudra de nouveau mille ou deux mille ans pour retrouver une belle langue classique toute en finesse. N'est-ce pas le temps qu'il a fallu pour passer de Cicéron à Corneille et Racine ? C'est sans doute pour cela que Solko en veut à Grevisse. Mais le pauvre homme pouvait-il faire autre chose que ce qu'il a fait ? Pouvait-il, à lui tout seul, arrêter l'évolution du monde ?

00:19 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : langue française, grevisse
03/04/2009
Mes aïeux!
Quelques lecteurs hier se sont mis à rêver sur le mot espagnol «abuela», la grand-mère et c’est vrai que ce terme a quelque chose de calme et de doux qui enchante l’âme. Du coup, intrigué, je me suis demandé quel en était l’étymon et après quelques recherches googelesques (ou googeliennes si vous préférez) j’ai trouvé, à ma grande surprise, que ce mot est apparenté à notre terme français «aïeul», ce qui ne saute pas aux yeux.
Abuelo (le grand-père) vient du latin «avus » (l’adjectif «avitus» existe aussi). A ce mot, on a joint un diminutif, sans doute pour exprimer l’affectivité et «avus» est devenu «aviolus». Le mot a ensuite évolué différemment selon les langues romanes et est devenu dans le Berry, aïol, en provençal aviol, en espagnol abuelo et en italien avolo.
En français, c’est l’accusatif d’aviolus, autrement dit aviolum qui a donné aviol puis aiol (plus facile à prononcer) au XIII° siècle et puis finalement aïeul au XVI° siècle.
En outre, il y aurait eu un étymon indo-européen antérieur à cet «avus».
Le Robert historique nous enseigne que le mot originel latin, «avus» ne désignait pas un terme de parenté mais qu’il était plutôt une appellation familière à l’égard d’un ancien du groupe, ce qu’on retrouve peut-être encore dans notre terme «aïeux» qui désigne les ancêtres en général, par opposition à «aïeuls», qui désigne directement les grands-parents (comme nous le rappelle Grevisse cette fois, dans son incontournable «Bon usage»).
Le vrai pluriel, le pluriel étymologique, est «aïeux» (d’après l’accusatif pluriel devenu le cas régime en ancien français). Ce n’est qu’au XVII° siècle qu’on aurait reformé le pluriel «aïeuls» d’après la forme du singulier. Ce qui est amusant, c’est de voir l’alternance du sens au cours des âges. Alors que le «avus» latin désignait plutôt l’ancien du groupe, «aviolus», avec son diminutif affectif, faisait bien, lui, allusion au grand-père. Pourtant, au XIII° siècle, c’est de nouveaux le sens d’ancêtres qui prédomine. Ce n’est finalement qu’au XVIII° siècle que la distinction actuelle (aïeux = ancêtres/aïeuls = grands-parents) s’est établie. Elle est finalement logique : le mot au pluriel désignant un grand nombre de personnes, c’est évidemment à l’ensemble des ascendants, autrement dit les aïeux, que l’on pense. Le singulier aïeul, quant à lui, ne pouvait que désigner le grand-père tout proche. Puis, comme on a en principe deux grands-pères et deux grands-mères (mais ce ne fut pas mon cas), on a dit « les aieuls » pour les désigner.
Notons encore, pour être complet, que le dérivé «avunculus» a donné le mot français «oncle».
Mais revenons à notre «abuela» initiale. Le mot castillan désigne la grand-mère, mais aussi une vieille femme en général. L’expression «cuentaselo a la abuela», familière, signifie « à d’autres ! ». «Habersele muerto a uno su abuela» signifie «être vantard», de même que «no tener uno abuela», un peu sans doute comme si l’absence de la grand-mère, qui symbolise la raison et la mémoire de la famille, permettait de divaguer et d’inventer n’importe quoi.
A côté de «abuela» existe le terme «abuelita», encore plus mignon avec son diminutif affectif. Le dictionnaire ne le traduit pas par grand-mère, mais par bonne-maman, ce qui est en effet plus intime. Ce qui est amusant, c’est qu’en Amérique (du Sud, évidemment car notre monde roman s’étend jusque là, devant le grand Pacifique) où on sait que les mots espagnols prennent parfois un autre sens, éloignement oblige, cette «abuelita» peut désigner un berceau ou un bonnet d ‘enfant. De l’aïeule, on passe à la toute dernière génération, peut-être parce que ce sont souvent les grands-mères qui s’occupent des petits-enfants.
Enfin, nous sommes partis de l’Etat du Texas, aux Etats-Unis, avec Mac Carthy et ses si jolis chevaux et nous revoilà en Amérique du Sud après avoir traversé l’Espagne et avoir parlé du Moyen-Age français et du latin de Rome. Comme quoi le temps et l’espace sont devant nous dès qu’on ouvre un livre.

Source
00:07 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : langue française, abuela
19/02/2009
L'école buissonnière
En cette période de vacances scolaires (pour certains) ou de presque vacances (pour d’autres), les salles de classe étant vides, il serait intéressant de se pencher sur l’expression «faire l’école buissonnière ». Celle-ci signifie, comme chacun sait, « ne pas aller au cours » mais quelle en est l’origine ?
L’explication la plus logique, c’est évidemment la référence au mot « buisson » : les élèves qui ne se rendent pas à l’école vont se promener dans les champs et se cacher dans les buissons, où leur présence passerait inaperçue. Selon certains, l’expression remonterait au XV° siècle, époque où on en aurait donné la définition suivante : « promenade dans les chemins creux ou parmi les buissons qui cachent les fuyards. »
Le problème, c’est que certains philologues proposent une autre explication.
L’expression trouverait son origine dans le fait que les prélats qui devaient se rendre au Concile de Pavie, en 1423, refusèrent de s’y rendre parce que la peste sévissait dans cette ville. Ils seraient donc restés dans la campagne environnante. Comme argument, ceux qui proposent cette interprétation avancent cette phrase de Clément Marot.
«Vray est qu'elle fust buissonnière, l'escolle de ceux de Pavie ».
D’autres pensent au contraire que l’expression daterait plutôt du XVI° siècle, époque où les protestants auraient créé des écoles secrètes (nommées buissonnières parce qu’elles se situaient dans les campagnes) afin d’éviter les écoles de la ville de Paris, qui étaient toutes entre les mains du clergé catholique. Si cette interprétation est la bonne, l’école buissonnière impliquait donc qu’on aille aux cours, mais le fait d’être absent des écoles officielles de Paris où les élèves auraient dû se trouver, permettrait de comprendre le glissement de sens.
Une petite recherche sur Google m’a permis de trouver deux expressions espagnoles pour désigner le même phénomène.
1. Hacer novillos (hacer = faire ; novillo = jeune taureau) : en Andalousie les élèves qui ne suivaient pas les cours préféraient aller dans les prés afin de toréer les jeunes taureaux et tenter ainsi d’accomplir leur rêve de devenir un jour des toréadors professionnels lesquels, soit dit en passant, sont souvent issus des classes sociales les plus pauvres car il faut être pauvre pour risquer ainsi sa vie à chaque combat dans l’espoir de conquérir la gloire et de devenir riche.
2. Hacer campana (en catalan Fer campana), autrement dit, « faire la campagne». On ne confondra pas ce mot « campaña » (avec une tilde sur le n) avec le même terme (sans tilde sur le n) qui signifie « cloche » en castillan (campanella en latin). Ici, c’est un mot issu directement du latin campus- campi (campagne cultivée, champ) ou de l’adjectif campañeus, ea, eum (de la campagne, champêtre). Cet adjectif au neutre pluriel (campanea) est devenu un substantif et a pris le sens de « champs ».
On ne confondra pas non plus ce « campaneus » avec le nom propre Campania, qui a désigné d’abord la Campanie, en Italie, puis une province gauloise, aujourd’hui la Champagne.
08:02 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : langue française, expression, école buissonnière
05/12/2008
Le calumet de la paix
Ne quittons pas encore l’Amérique. Une fois qu’ils eurent débarqué sur ce nouveau continent, les Européens se mirent à observer les mœurs des Indiens (avant de les massacrer). C’est ainsi qu’est passée en français l’expression bien connue « fumer le calumet de la paix ». Elle désignait donc la coutume des Indiens d’Amérique du Nord qui consistait à fumer avec ses ennemis pendant qu’on négociait la paix. Ce qu’on sait moins, c’est qu’il existait également un calumet de la guerre, qu’on allumait lors des négociations de la dernière chance. Ce qu’on ne sait pas du tout, c’est que ce calumet pouvait aussi avoir un usage thérapeutique, selon la sorte d’herbe qu’on y faisait brûler.
D’une manière générale, de toute façon, ce rituel relevait de l’art de l’hospitalité. Dans notre civilisation, boire un verre ou manger avec quelqu’un, lui faire partager sa table, est un signe de bienvenue, d’échange, d’acceptation. Refuser de se joindre au repas proposé fait office d’affront. Lévi-Strauss (fort à l’honneur ces derniers temps et fort justement d’ailleurs) a beaucoup parlé des manières de table dans ses «Mythologiques ». Préparer un repas, c’est introduire la culture (par la cuisson et tout le cérémonial qui tourne autour) dans la nature, autrement dit c’est affirmer la singularité de l’homme par rapport à l’animal.
Avant, c’était facile : Nul ne doutait que Dieu eût créé l’homme à son image. Ce dernier était donc un demi-dieu. D’ailleurs il occupait le centre de l’univers, à savoir la terre, autour de laquelle tournait le soleil. Une fois que cette vérité fut battue en brèche (après quelques difficultés d’ailleurs, voir par exemple la rétractation de Galilée ou la mort sur le bûcher de Giordano Bruno), l’homme n’était plus qu’un être parmi d’autres qui errait sur une planète emportée dans un cosmos infini. Bref, il devenait un animal comme les autres, ni plus ni moins et perdait toute spécificité. Et voilà qu’à ce moment on découvre là-bas, en Amérique, des sauvages dont le mode de vie se rapproche fort dangereusement de celui des animaux. Reflet d’une période historique révolue, ils offrent cependant à l’Européen le reflet de sa propre image à travers les siècles. Si certains s’extasient devant la pureté de ces sauvages innocents qui semblent vivre au paradis terrestre, d’autres comprennent l’importance de l’enjeu : à trop vouloir se rapprocher de la nature, on redevient animal. Et de brandir les deux grandes lois qui sont les fondements mêmes de l’humanité et de la culture : la cuisson des aliments et la prohibition de l’inceste.
Manger un aliment cuit, c’est donc se rattacher à la culture. Inviter quelqu’un à partager ce repas avec vous, c’est réaffirmer que l’on forme ainsi une petite société, où règne la sympathie et l’échange.
Ces sauvages qu’étaient les Indiens de l’Amérique du Nord le savaient aussi pourtant. Ils cuisaient leurs aliments et fumaient ce fameux calumet (de la paix ou de la guerre) qui symbolisait et résumait les intentions que les protagonistes avaient les uns envers les autres.
Objet de culture par excellence, le calumet, fait de bois décoré, de verroteries et de plumes, comportait un fourneau en pierre (rouge pour la paix, blanche pour la guerre).
Notons que ce mot « calumet »n’est pas d’origine indienne (comme « sachem » ou « tipi ») mais qu’il vient du mot français chalumeau via sa forme normande (ou picarde) « calumet », d’après le latin « calamus », roseau (voir « chaume »)
Comme toujours et comme nous l’enseigne la linguistique diachronique, le « ka » latin initial devient « ch » en français d’île de France (ex : capra donne chèvre) tandis qu’il reste « ka » en langue d’oc (capra donne cabra). Dès lors, « calamus » donne logiquement « chalumeau » en français tandis qu’on retrouve une forme « calumo » en Provence. Pour ce qui est du picard et du normand, c’est évidemment sous l’influence des parlers germaniques que le « ka » s’est maintenu. C’est que les mots eux aussi sont le fruit de bien des voyages. Il aura fallu les migrations et les invasions germaniques d’une part (avec leurs guerres et leurs massacres) et la découverte de l’Amérique d’autre part (avec là aussi des guerres et des massacres) pour que ce calumet arrive jusqu’à nous, symbole d’une paix sans cesse remise en question, comme nous le montre encore l’histoire contemporaine.

00:37 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (23) | Tags : langue française, calumet
27/11/2008
Origine du nom des pays d'Amérique latine
Nous avons longuement parlé de Vespucci, qui a donné son prénom à l’Amérique. Est-ce à dire que Colomb fut complètement oublié ? Pas vraiment, puisque son patronyme a été donné à la Colombie. C’est l’occasion de donner l’origine du nom de quelques pays d’Amérique latine.
Colombie :
Ce pays porta d’abord le nom de Nouvelle Grenade (Nueva Granada) étant donné que Grenade venait d’être reconquise sur les Arabes en 1492, l'année même de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb.
C’est Simón Bolívar qui lui donne le nom de Colombie en hommage au « grand amiral de la mer océane ».
Au départ, il s’agissait de la grande Colombie, qui englobait aussi le Vénézuéla et l'Équateur.
En Amérique du nord on retrouve la Colombie britannique (British Columbia), province canadienne, ainsi que le district de Colombie (District of Columbia) qui correspond en fait à, Washington, la capitale des Etats-Unis, laquelle ne fait pas partie d'un état.
Notons encore que l’origine du nom de Christophe Colomb (Cristobal el Colon) est le mot « columbus » en latin (pigeon)
Vénézuela :
Découvert le 2 août 1498 par Christophe Colomb, lors de son troisième voyage, à l'embouchure du río Orinoco, qui forme un delta. C'est la première fois qu'il met le pied sur le continent américain (lors de ses précédents voyages, il a découvert les îles des Antilles). Il nomme le pays Tierra de Gracia (Terre de Grâce). Ensuite, en 1499, Alonso de Ojeda découvre un golfe avec des maisons sur pilotis qui lui fait penser à Venise. Il nomme donc cette région « golfe de la petite Venise », autrement dit Venezuela. C’est sur le bateau de Ojeda que se trouvait, comme marchand, notre ami Vespucci.
Paraguay :
Le Paraguay est le nom d'une rivière. La capitale est Asunción, parce qu’elle aurait été fondée le jour de l'Assomption, le 15 août 1537, par Juan de Salazar, un des lieutenants de Pedro de Mendoza. Les Espagnols remontèrent le rio Parana puis le rio Paraguay, pour tenter de rejoindre le Pérou, où on croyait découvrir de l’or.
Uruguay :
L'Uruguay est le nom du fleuve frontalier qui sépare l'Argentine et l'Uruguay.
Bolivie :
La Bolivie doit son nom au vénézuélien Simon Bolivar (El Libertador – Le Libérateur), le héros de l’indépendance de l’Amérique latine. On sait qu’il souhaitait ne faire qu’un seul pays de tout ce continent. Notons que Bolivar est, à l’origine, le nom d’un village du pays basque (Bolibar en Biscaye). C’est de là que serait originaire l’ancêtre de Simon Bolivar. Le terme désignerait en basque la vallée du moulin (ibar/bolu).
Soulignons qu’en 1999, Hugo Chavez, le président du Venezuela, adopta une nouvelle constitution qui donna à son pays le nom de République bolivarienne du Venezuela.
Argentine :
Comme on s’en doute, le nom de ce pays vient du mot latin argentum signifiant « argent ». Ce sont les premiers explorateurs espagnols du Rio de la Plata qui lui donnèrent ce nom parce que les indigènes leur avaient offert des objets en argent. Ils furent bien mal avisés d’avoir ce geste de bienvenue…
Brésil :
Le brésil est un bois exotique qui, séché et pulvérisé, donne une matière tinctoriale rouge. A la fin du Moyen-Age, le « bois de braise » provenait des Indes via la Perse et c’étaient les Vénitiens qui en faisaient commerce. Au Brésil, les Portugais découvrirent des arbres « couleur de braise » (brasa en portugais) en si grande quantité qu’ils donnèrent ce nom au pays tout entier.
Chili :
L’origine du nom est incertaine :
Les conquistadors installés au Pérou auraient appelé le Chili « valle de Chile " probablement du nom d’une rivière.
Le nom pourrait aussi venir du nom d’un oiseau ayant des taches jaunes sur ses ailes (trih o chi)
Selon certains historiens, ce terme viendrait d’un groupe d’Amérindiens (les Mitimaes). Ceux-ci, capturés par les Incas, provenaient d’une région du Pérou où coulait un fleuve portant ce nom.
Equateur :
L’Équateur fut nommé ainsi à la suite d’une mission scientifique dirigée par Louis Godin (il s’agissait de mesurer un degré du méridien près de l’équateur).
Guyane :
Le Guyana signifierait « terre d'eaux abondantes » en langue indienne. Il est vrai que dans cette région, de nombreux fleuves coulent à travers la forêt tropicale.
D’autres spécialistes font remonter le terme au dialecte guanao (delta de l’Orénoque) où guai signifiait « nom », « dénomination », tandis que yana serait une négation. « Guyane » voudrait donc dire « sans nom », et désignerait une terre « qu'on n'ose nommer ». Pour nous tous qui sommes passionnés par les mots, cela semble assez incroyable et mystérieux. En quoi cette terre est-elle si mystérieuse pour qu’on n’ose pas la nommer ? Sans doute faut-il y voir une connotation religieuse : ce serait une terre sacrée, celle où séjourne les dieux. Il est vrai que l’épaisse forêt qui recouvre le territoire avait de quoi inquiéter les hommes vivant dans la région. De là à y voir le séjour des dieux, il n’y a qu’un pas.

13:48 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : langue française, amérique latine
16/11/2008
Devinette
Quel est l’auteur (il faut bien l’appeler ainsi, puisqu’il a écrit) qui a en tout et pour tout rédigé trente-deux pages dans sa vie, qui n’était ni romancier ni inventeur, mais employé de banque et qui, avec ces trente-deux pages (et surtout grâce au titre qui leur a été donné) est devenu mondialement célèbre, non seulement de son vivant, mais encore aujourd’hui. La preuve, c’est que nous prononçons son nom (ou du moins le nom qui a été formé à partir du sien) couramment.
Personne, dans l’histoire de l’humanité, n’a connu un tel succès avec une œuvre aussi mince. Pourtant, il faut reconnaître que ce qu’il a dit (car il a dit, il n’a rien fait) a bouleversé bien des croyances. A sa manière (et malgré lui), ce fut donc un révolutionnaire.

00:15 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (71) | Tags : langue française
15/10/2008
Quand les Normands encerclaient Paris

C’est le 14 octobre 1066 que le duc de Normandie Guillaume le Bâtard remporte la victoire d’ Hastings. C’est par cette bataille que la langue française va se répandre en Angleterre et va donc influencer la langue anglaise, comme on l’a déjà dit ici.
Il est intéressant de souligner que Guillaume, de par ses ancêtres, n’était pas français à proprement parler puisqu’il descendait en fait de Rollon, un chef viking qui s'était établi 150 ans plus tôt à l'embouchure de la Seine. Belle ironie de l’Histoire, donc, qui a fait que ce soit à un «étranger » qu’incomba la tâche d’aller diffuser notre langue outre-manche. Voilà une leçon que certains feraient bien de retenir.
L’origine de cet ancêtre, Rollon, n’est pas très claire. Certains le disent danois, d’autres norvégien. Ce qui semble plus sûr, c’est qu’il s’est attaqué aux côtes de la Mer du Nord et de la Manche. Il aurait ainsi ravagé la Frise ainsi que l’embouchure du Rhin et de l’Escaut. On situe son arrivée dans la « Francia » vers 876. Il s’installe à l’embouchure de la Seine qu’il remonte en organisant des pillages. Ainsi, il aurait participé au fameux siège de Paris de 885-886.

Statue de Rollon à Falaise
Cela faisait cinquante ans que la région comprise entre Paris et la mer connaissait ces attaques des hommes venus du Nord. Les faubourgs de Paris avaient d’ailleurs déjà été attaqués plusieurs fois, mais jamais l’île fortifiée de la cité. Cette fois-ci, cependant, les Vikings demandent l’autorisation de remonter la Seine plus en amont. Si cette faveur leur est accordée, la ville ne subira aucun dommage. Gauzlin, l’évêque de Paris, refuse et c’est le début des affrontements. Les remparts tiennent bon et les assaillants subissent de lourdes pertes. Pour se venger, ils pillent la région et décident de faire le siège de la capitale du royaume franc, lequel durera un an. A la fin, ayant reçu une importante somme d’argent de la part de l’évêque, Les vikings s’en vont conquérir la région de Bayeux.
La faiblesse des rois carolingiens à s’opposer efficacement aux Vikings leur sera fatale. En effet, le roi Charles III le Gros, qui revient de Germanie avec son armée (un peu tard), préfère à son tour payer une grosse somme d’argent plutôt que d’affronter militairement les envahisseurs. Il aurait même consenti à ce qu’ils remontent la Seine, contribuant ainsi à la mise à sac de la Bourgogne. Conséquence : il sera destitué peu après et les seigneurs français élisent comme roi le comte Eudes (le fils de Robert le Fort), qui lui s’était fait remarquer par ses prouesses pendant le siège de Paris.
Mais revenons à Rollon, qui semble donc bien avoir participé à ce fameux siège. Ce qui est sûr, c’est qu’il a conquis Bayeux et qu’il a pillé la Bourgogne. On sait qu’il a épousé (de force, ce qui nous fait réfléchir sur la triste destinée des femmes en temps de guerre) une certaine Poppa, fille du comte Béranger de Bayeux, que Rollon tua de ses propres mains. Il s’installe et commence à développer des alliances avec les autorités franques en place. On peut donc estimer que vers 910, il n’est plus le simple chef d’une bande de pillards, mais un seigneur établi sur ses terres.
Cela ne l’empêche pas de continuer de guerroyer, mais vers 910 il échoue à prendre Chartres. C’est à ce moment que Charles le Simple (roi carolingien de la Francie occidentale) négocie avec lui le traité de Saint-Clair-sur-Epte (911), qui permet à Rollon de s’installer définitivement dans une partie de la Neustrie (autour de Rouen). La condition de la cession de ces terres (le futur duché de Normandie) était que Rollon empêche l’arrivée d’autres envahisseurs nordiques. Le roi carolingien agit donc comme avaient agi avant lui les derniers empereurs romains. Eux aussi avaient dû accepter l’installation de barbares à leurs frontières et même sur leurs territoires et eux aussi avaient demandé en échange que les nouveaux venus garantissent les frontières de l’empire, que les légions romaines ou gallo-romaines ne parvenaient plus à défendre.

Pour bien montrer qu’il a changé de camp, Rollon se fait baptiser en 912. Il rétablit même la vie monastique et les moines qui avaient fui la contrée reviennent avec leurs reliques. Maintenant, sur le plan politique, la question est de savoir s’il se comporte en prince chrétien ou en chef barbare. On pourrait aussi se demander quelle langue on parlait à cette époque dans le duché de Normandie et qui la parlait. On peut supposer que la population locale (gallo-romaine) n’avait pas disparu (ou était revenue à la fin des conflits) et qu’elle continuait à s’exprimer dans son patois local qui commençait à se distinguer du latin. L’aristocratie elle, devait être d’origine viking et parlait probablement une langue nordique. Tout ce que l’on sait, c’est que Rollon partage les terres entre « ses chevaliers et des étrangers » (faut-il comprendre entre les chefs Vikings et d’anciens nobles gallo-romains ?) Par ailleurs, la toponymie actuelle de la Normandie prouve bien une présence importante des peuples nordiques dans cette région. Il est clair aussi que le patois roman qui était parlé en Normandie a subi directement l’influence de ces parlers germaniques (voir plus tard, le français parlé par un écrivain comme Wace, qui cumule tout de même un certain nombre de traits spécifiques à sa région, tout comme les textes picards d’ailleurs, qui auront eux aussi leurs particularités propres, qui les distinguent du parler d’Ile de France.)
C’est donc ce patois roman teinté de germanismes que Guillaume, ce descendant des Vikings, va exporter vers l’Angleterre. Ce « français », qui sera parlé pendant quelques siècles par l’aristocratie anglaise, va à son tour influencer la langue anglaise parlée elle par le peuple. Comme quoi l’histoire est un éternel recommencement.
On sait par ailleurs que de nombreux anglicismes actuels réintroduisent dans notre langue des mots dont l’origine remonte en fait à cet ancien patois roman de Normandie alors qu’ils avaient disparu entre-temps en français de France.
Exemples :
- budget de l'ancien français « bougette » (petite bourse portée à la ceinture)
- caddie (de l'ancien français « cadet », chariot tiré à bras utilisé pour transporter de menus objets.
· challenge, de l'ancien français « chalenge ou chalonge » : contestation en justice ou par les armes, dispute.
· gentleman, partiellement de l'ancien français « gentil », homme d'ascendance noble
· humour (ancien français: « humeur », substance aqueuse.
· marketing ancien français: marchié, marchiet (accord, marché, lieu de marché)
· record (de l'ancien français: « record », souvenir; recorder: se rappeler, réciter par cœur.
· Etc. etc

00:26 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : langue française, normands, siège de paris
14/06/2008
Nouveau petit dictionnaire de la France sarkozienne.
Suite à la sortie du nouveau Petit Robert (voir une note antérieure), plutôt que de vous donner la liste de tous les néologismes qui sont désormais acceptés, ce qui serait fastidieux et sans grand intérêt, je vous propose un petit exercice calqué sur le Dictionnaire des idées reçues de Flaubert. Il s’agit d’imaginer, dans la France sarkozienne d’aujourd’hui, ce que pourrait donner un dictionnaire qui serait à la solde du pouvoir (après tout les grands médias le sont bien, non ?). Voici ce que je propose, libres à vous de continuer le jeu.
Nouveau dictionnaire de la langue française, sous la direction d’un collèges de linguistes proches de l’UMP (et avec une introduction de Carla Bruni)
Introduction : notions de grammaire dégénérative :
• Tous les verbes doivent être transitifs afin de faciliter le passage des idées et des concepts libéraux.
• Les verbes copules sont réservés à l’usage exclusif du président et de son épouse.
• Les adjectifs ne peuvent être attributs que d’un seul sujet.
• L’épithète détachée sera désormais enchaînée.
• La conjonction de coordination « mais » est désormais interdite, car elle introduit un début de réfutation par rapport à l’idée qui précède, ce qu’on ne pourrait tolérer dans une France qui va de l’avant.
• Les conjonctions de subordination seront au nombre de 64,5 millions (une par citoyen)
• Les néologismes seront du seul ressort du président de la République.
• Les anglicismes seront noyés dans la Manche.
• Les adverbes en « ment » seront interdits sauf dans le monde politique
• Chaque phrase devra comporter au moins un complément circonstanciel de but.
• Les compléments circonstanciels de cause ne sont pas interdits mais ils sont à déconseiller (car il vaut mieux regarder devant soi que derrière soi)
• Les compléments d’opposition seront embastillés durant toute la présidence sarkozienne.
• Le groupe sujet s’appellera groupe du président.
• La proposition relative sera doublement relative, afin de lui enlever toute valeur intrinsèque.
• Le mode impératif sera réservé aux agents de la force publique, qui seront les seuls à pouvoir en faire usage.
• Les modes futur et conditionnel seront réservés aux citoyens, tandis que le gouvernement emploiera toujours le présent.
• Le passé composé sera décomposé.
• Le plus que parfait deviendra l’arrière-passé.
• L’imparfait sera purement et simplement aboli, tout étant devenu parfait (du moins convient-il de le faire croire).
• Les pronoms personnels réfléchis seront réservés aux ministres de la majorité.
• Le pronom sans fonction logique se fêtera le six décembre, jour de la Saint Nicolas, en l’honneur de notre bon président laïc.
• Les superlatifs absolus seront réservés au domaine de la finance.
• Les comparatifs d’infériorité seront de mise chez les seuls chômeurs.
• Les accords du pluriel sont abolis car il n’y a qu’un président et que ce n’est pas le nombre qui doit l’emporter.
• Les majuscules seront interdites lorsque le gouvernement est en vacances.
• Afin de résoudre les problèmes d’accord, les participes passés seront remplacés par des participes présents.
Dictionnaire de la langue (lettres A à V)
Remarque : Les lettres W, X , Y et Z sont supprimées, vu leur connotation étrange et même étrangère.
Nouveautés :
• Le verbe « libreéchanger » passe dans le dictionnaire.
• Le verbe « libéraliser » s’emploie de préférence après « il faut ».
• L’usage du mot « sécurité » est à éviter. Il est à proscrire dans l’expression « sécurité sociale ».
Définitions :
• Albeniz : musicien espagnol connu par sa petite fille.
• Alpes : montagnes remplies de vaches en été et de touristes en hiver.
• Banlieue : zone située en dehors des grandes villes où vivent principalement des immigrés. Il y fait très chaud en décembre.
• Bruni : famille d’immigrés italiens régularisée suite au mariage d’un de ses membres avec un Français.
• Capital : à faire fructifier (voir évangile selon saint Max) .
• Capitale : ville où vit le président.
• Carla : prénom féminin (se dit en chantant).
• Cecilia : il est interdit de donner ce prénom à un enfant, sauf en Bulgarie et en Lybie.
• Césaire (Aimé): noir que l’on n’aime pas mais à l’enterrement de qui il faut aller.
• Chine : pays qui tremble au moment des jeux olympiques.
• Chirac : ancien chef qui a été supplanté. Est maintenant corrompu.
• Clochard : chômeur qui a perdu son droit aux allocations.
• Chômage : aumône accordée à celui qui ne veut pas travailler
• Constitution européenne : l’adopter même si le peuple n’en veut pas/ ne se rejette qu’en Irlande.
• Corrèze : région reculée qui compte beaucoup de vaches et un ex-président.
• Douane : entrave au commerce mondial. A été supprimée.
• Education nationale : les compétences semblant innées chez les individus (puisque ce sont toujours les mêmes familles qui détiennent les richesses), l’Education nationale peut disparaître. En attendant, elle assumera un rôle de rééducation.
• Elysée : maison dans laquelle vit celui qui a été élu par le peuple
• Enseignants : corps professionnel acquis à la gauche. En réduire les effectifs au maximum.
• Etats-Unis : pays ami qui nous a annexés en 1945.
• Expulser : ne se dit qu’en parlant des immigrés.
• Facteur : seul homme de lettres.
• Fonctionnaire : personne qui coûte très cher à l’Etat. Supprimer un tiers de l’effectif et voir les conséquences.
• Hongrois : se dit des chevaux hongres.
• Immigré : résident expulsable.
• Irak : pays où on trouve du pétrole et des terroristes mais pas d’armes de destruction massive.
• Iran : a disparu ou va disparaître.
• Italie : pays ami où règne Berlusconi.
• Jet : s’emploie surtout dans l’expression « jet privé ».
• Justice : département indépendant tenu par une amie du président de la République.
• Libre-échange : politique qui vise à favoriser l’échange des femmes.
• Mai : se disait en 68.
• Manifestation : émeute à réprimer.
• Mariage : se rompt sur un air d’Albeniz et se célèbre avec une chanson de Carla.
• Marin pêcheur : breton irascible.
• Martin pêcheur : ours mal léché.
• Neuilly : centre du monde.
• Otan : club sportif auquel il est de bon ton d’appartenir.
• Peuple : est supposé soutenir le président, mais le fait rarement.
• Poitou-Charentes : région reculée encore royaliste.
• Police : sert à courir après les incendiaires et à arrêter les terroristes. Il convient de calculer ses effectifs de manière inversement proportionnelle à la côte de popularité présidentielle.
• Pouvoir d’achat : permet d’acheter le pouvoir quand on en dispose.
• Prix (de l’alimentation) : monte toujours.
• Prix (de l’essence) : monte toujours.
• Salaire : entrave au profit/ monte seulement s’il est présidentiel.
• Salon agricole : endroit où on peut dire des gros mots, même si on est président.
• Sarkozy : famille d’origine hongroise fuyant le communisme.
• Sondage : courbe descendante
• Sondé : citoyen souvent déçu.
• Suisse : gigantesque coffre-fort.
• Syndicat : groupe terroriste.
• Télévision : moyen technique qui permet de grandir l’image du président.
• TGV : train qui, quand il roule, permet d’aller plus vite pour arriver nulle part
• Tibet : région montagneuse de la Chine méridionale. Manifester pour son indépendance est la première discipline olympique, qui fait rire jaune les Chinois.
• Yacht : bateau qu’on prête à un ami.
.

02:10 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : langue française, dictionnaire
12/06/2008
Du français et de ceux qui le parlent.
Le Petit Robert 2009 vient de sortir. On sait que chaque année de nouveaux mots font ainsi une apparition officielle, leur présence soudaine dans ce dictionnaire de référence leur conférant une légitimité qu’ils n’avaient pas encore.
On pourrait épiloguer longuement sur ce qui préside au choix de certains termes, tandis que d’autres sont irrémédiablement refusés.
Nous, qui sommes les locuteurs du français, nous avons souvent l’idée fausse que les mots n’existent que parce qu’ils sont repris dans les dictionnaires. C’est évidemment l’inverse qui se passe, les dictionnaires ne faisant qu’admettre à un certain moment (après un laps de temps plus ou moins long) des termes déjà bien ancrés dans l’usage.
Le choix des rédacteurs du Robert n’est pas facile à faire. S’ils vont trop vite pour accepter un mot et que celui-ci disparaît de lui-même dans les années qui suivent, ils se couvrent de ridicule. Inversement, s’ils s’obstinent à refuser des termes qui manifestement sont passés dans l’usage, ils se montrent alors particulièrement réactionnaires.
De tout ceci il faut retenir que ce ne sont pas les grammairiens qui font la langue, mais bien nous, modestes locuteurs. Autrefois, le système scolaire et des ouvrages de référence comme le Bon usage de Grevisse (que j’adore par ailleurs et auquel je me réfère tout le temps) ont fait de la langue leur chasse gardée. Ils détenaient la vérité et nous, pauvres citoyens, nous tentions tant bien que mal de ne pas commettre trop de fautes. Maintenant, la tendance s’est inversée. Les linguistes ont pris le pouvoir face aux grammairiens et pour eux, tout se vaut. Une langue, par définition, évolue tout le temps et dès lors le fait d’employer une tournure plutôt qu’une autre témoigne d’une étape historique et non de la supériorité de cette tournure sur celles qui ont été évincées. Plus de bon usage donc. Au lieu d’imposer une norme, les linguistes se promènent avec leur micro pour tenter de capter la langue telle qu’elle se parle aujourd’hui. Plus de hiérarchie des valeurs non plus : l’argot ou le parler adolescent valent la langue de Proust ou de Mauriac. J’en ai même entendu un (de linguiste) qui disait que le parler des jeunes des banlieues était bien plus innovant et partant beaucoup plus riche et créatif que la langue littéraire, faite finalement de conventions (utilisation de l’acceptation ancienne de certains mots, tournures désuètes, langue figée, emploi du passé simple, du subjonctif imparfait, etc.). Bref, selon lui, la vraie littérature se fait dans la rue par des jeunes à peine scolarisés et pas par des académiciens qui ont un pied dans la tombe et qui écrivent comme au XIX° siècle.
Il y a du vrai dans tout cela, évidemment. Ceci dit, j’ai déjà entendu des discours similaires à propos de l’enseignement autrefois : le jeune était riche de toute la potentialité qui était en lui tandis que l’enseignant venait contrer son imagination par un savoir aussi figé que ridicule. Depuis, beaucoup d’eau est passée sous les ponts et on est revenu, par une sorte de logique dialectique propre semble-t-il à la pensée humaine (comme quoi Hegel n’avait rien inventé), à plus de modération. L’idéal est finalement de transmettre un savoir sans brimer la spontanéité propre à la jeunesse mais en lui permettant au contraire, par ce savoir, de faire fructifier au mieux ses possibilités innées.
Il en va donc de même en matière de langue française. Si le Bon usage a pu parfois nous paralyser par la crainte que nous avions de commettre des fautes, il est certain que le laisser-faire généralisé n’apporte rien non plus. Une langue n’est finalement qu’une norme. Celle-ci est certes arbitraire mais il importe que chaque locuteur la respecte au même moment, sinon, c‘est la compréhension même du message qui se trouve en danger.
Tout cela pour dire que nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes les utilisateurs de notre langue. Je ne peux pas faire avec elle tout ce que je veux (puisqu’elle appartient aux autres aussi) mais je ne dois pas non plus me laisser paralyser par ce qui n’est finalement qu’un outil. Le principal, c’est que je parvienne à m’exprimer et à me faire comprendre (sciemment, je n’emploie pas le terme à la mode « communiquer », qui ne veut plus rien dire) et si parfois je prends quelques libertés avec la langue, ce n’est tout de même pas si grave que cela.
Le danger, en fait, c’est de vouloir à tout prix s’exprimer dans une langue parfaite car à partir de ce moment-là celle-ci se sclérose et devient hermétique à toute innovation. L’emploi des anglicismes s’explique à mon avis en partie à cause de ce phénomène. D’abord il convient de les relativiser : ils n’affectent que le vocabulaire (et encore, dans des domaines bien spécifiques) et non la grammaire et ils sont dus en partie à la suprématie économique de l’Amérique et à son avance en matière en matière scientifique et technologique. Ensuite, leur introduction est facilitée par la peur des locuteurs francophones de créer des néologismes. Si nous étions moins timorés et si nous osions proposer des termes nouveaux au lieu d’attendre que l’Académie en suggère un avec vingt années de retard, il se pourrait bien que notre langue se montrerait beaucoup plus vivante.
Bref, en matière de langue, il faut se montrer exigeant (et refuser les facilités et les compromissions) mais ne pas fermer la porte aux innovations, lesquelles sont nécessaires pour que cette langue demeure dynamique.
15:50 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : langue française, le petit robert
19/02/2008
Expression (1)
Pousser des cris d'orfraie
- Hurler, pousser des cris stridents (souvent disproportionnés par rapport aux faits)
- protester violemment
L'orfraie est un rapace piscivore (aigle de mer) à queue blanche et qui peut atteindre 2,5 mètres d'envergure. Ses cris ne sont pas plus stridents que ceux des autres oiseaux.
Vraisemblablement, il y a eu confusion entre les mots « orfraie » et la chouette « effraie ». Ce rapace nocturne peut, lui, dans certaines conditions, pousser des hurlements qui, autrefois, ont dû effrayer les passants attardés. Il fut imaginer la scène en l’absence totale de lumière. Rien de plus effrayant, en effet, que d’entendre ce cri lorsque vous traversez un bois la nuit dans l’obscurité la plus totale.
Le sens initial de l'expression est bien la frayeur. Par dérivation, elle s’est appliquée à quelqu’un qui proteste violemment, soit à cause de l’intensité des cris émis, soit à cause de la réaction disproportionnée qui est observée. Les personnes qui protestent bruyamment contre une décision anodine et prévisible s’agitent finalement pour pas grand chose, comme le fait la chouette effraie quand elle crie.
On retrouve l'orfraie dans un poème de Verlaine, Cauchemar, dans les Poèmes saturniens.
J'ai vu passer dans mon rêve
—Tel l'ouragan sur la grève,
D'une main tenant un glaive
Et de l'autre un sablier,
Ce cavalier
Des ballades d'Allemagne
(...)
Un grand feutre à longue plume
Ombrait son oeil qui s'allume
Et s'éteint. Tel, dans la brume,
Éclate et meurt l'éclair bleu
D'une arme à feu.
Comme l'aile d'une orfraie
Qu'un subit orage effraie,
Par l'air que la neige raie,
Son manteau se soulevant
Claquait au vent,
(...)

09:32 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : langue française, Pousser des cris d'orfraie, Verlaine
15/02/2008
La faute à Jeanne d'Arc
Tout le monde connaît la Guerre de cent ans, cette longue suite de batailles qui opposa la France et l’Angleterre. On sait aussi que la partie du territoire dont le roi de France est resté maître était particulièrement exiguëe. A l’école, on met en évidence la reconquête à partir de ce petit noyau et les élèves conservent l’idée qu’il ne pouvait en être autrement, que les bons rois qui ont fait la France ne pouvaient perdre et que le territoire national actuel ne pouvait pas être ce qu’il est aujourd’hui.
Cette une illusion de croire cela, bien entendu. Tout aurait pu être différent à chaque étape de l’Histoire, quelle qu’elle soit. Les Anglais auraient pu remporter la victoire et annexer la France. Et quelles en auraient été alors les conséquences pour la langue française elle-même ?
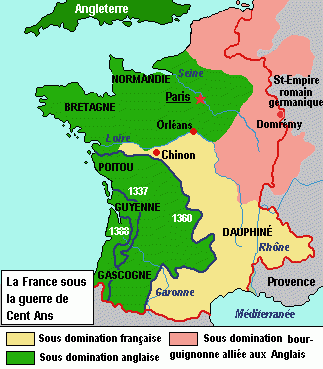
Pour mieux, comprendre, rappelons les faits.
- Défaite française de Poitiers en 1356. Le roi Jean II le Bon est capturé et il perd la Guyenne, la Gascogne et une grande partie du Poitou.
- Défaite française à Azincourt (1415), les Anglais, aidés des Bourguignons, priennent Paris et s'installent en Île-de-France, en Normandie et en Bretagne
- Du Guesclin (1320-1380) sous Charles V, et plus tard de Jeanne d'Arc (1412-1431) sous Charles VII redonnent l'avantage au roi de France. Il reprend Paris (1436), la Normandie (1450), la Guyenne (1453).
Le prix à payer aura été très cher : agriculture dévastée, famines, peste qui décima un tiers de la population. La noblesse elle-même perdit pas mal d’effectifs, se qui accéléra sans doute la prise de pouvoir de la bourgeoisie.
Mais revenons à la langue française. La guerre avait fait naître de part et d’autre un fort sentiment nationaliste. On a vu qu’en Angleterre c’est l’époque où l’anglais a supplanté le français dans les actes juridiques. Ceci dit, paradoxalement, c’est l’époque où les Anglais adoptèrent la fameuse devise Honi soit qui mal y pense (dans laquelle « honi » s’écrit avec un seul n) pour l'ordre de la Jarretière.
Mais que ce serait-il passé en France si l’Angleterre avait gagné ? Notre belle langue aurait-elle disparu ? Probablement pas. A mon avis, on aurait eu la même situation que venait de connaître l’Angleterre. La noblesse et les classes dirigeantes se seraient mises à l’anglais, tandis que le peuple aurait continué à employer son parler roman.
Encore faut-il savoir qu’à l’époque ce sont les patois qui l‘emportaient.

Il est donc fort possible que la prédominance du français d’Ile de France aurait été moins forte ou même que celui-ci serait devenu un patois comme les autres.
Si une autre région que l’Ile de France s’était alors imposée lors de la reconquête du territoire, on peut supposer que c’est ce patois-là qui aurait fait force de loi et qui aurait évincé les autres parlers locaux. Nous parlerions alors aujourd’hui gascon, provençal ou champenois. Comme quoi…
A l’inverse, certains linguistes (notamment une certaine Henriette Walter, que j’avoue ne pas connaître, affirme paraît-il dans son livre Honni soit qui mal y pense (avec 2 n, allez comprendre) que, sans l'intervention de Jeanne d'Arc, les Anglais restés en partie francophone auraient pu adopter définitivement le français et transporter plus tard cette langue dans les futurs États-Unis d'Amérique. Selon elle, les chances du français de s'implanter également en Angleterre auraient été incontournables. Les rois anglais parlant naturellement le français auraient continué à parler cette langue (alors qu’une fois « boutés hors de France », ils ont eu la réaction inverse). En d’autres mots, la fusion des deux royaumes se seraient faite à l’avantage du français.
Ce serait donc la faute à Jeanne d’Arc si aujourd’hui les Anglais parlent en anglais. Vu comme cela, évidemment, on se dit qu’elle méritait bien le bûcher.
16:00 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Langue française, Jeanne d'Arc, parlers d'oïl
12/02/2008
Français d'Angleterre

Meurtre de Thomas becket
Nous avions rappelé l’autre jour qu’il fut une époque où le français était parlé en Angleterre, en gros depuis 1066 et jusqu’au XIV° siècle au moins. Mais quel français était ainsi parlé et par qui ?
On a la preuve que le «françois de France» était employé dans les actes et les documents royaux
En 1174, Guernes de Pont Sainte Maxence rédige à Londres la « Vie de Saint Thomas Becket ». Ce texte, rédigé en alexandrins, est important pour l’histoire de la formation de la langue française. Guernes est un écrivain anglo-normand. Il avait vu Becket guerroyer en Normandie :
En Normandie r’out sun seigneur grant mestier ;
Et jo l’vi sur Franceis plusur feiz chevaucher
Aussi, après l’assassinat de ce dernier, alla-t-il enquêter en Angleterre afin d’interroger des témoins qui l’avaient connu.
A Chanterbire alai ; la verité oï ;
Des amis saint Thomas la verité cueilli
Et de cels ki l’aveient dès s’enfance servi
On appréciera au passage sa démarche, assez rare pour l’époque, qui consiste à remonter à des sources fiables. Cela lui permettra de dresser des différents protagonistes des portraits assez exacts.
Mais ce qui nous intéresse ici, c’est ce vers :
Mis langage est boens, car en France fui nez
Cela suppose donc que deux français se côtoyaient en Angleterre : le bon français, celui parlé en France et un français moins bon, appris sur place par les enfants de l’aristocratie anglaise et qui eux n’avaient jamais mis un pied sur le continent (qu’ils soient d’origine française ou anglaise, d’ailleurs)
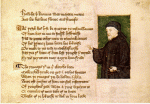
Dans ses célèbres Contes de Canterbury écrits eux en anglais vers 1380, Geoffrey Chaucer (v. 1343-1400) nous éclaire sur ce désir des nobles d’acquérir le bon français, lequel permettait de faire valoir ses bonnes manières. En voici une traduction :
Elle avait pour nom Dame Églantine,Chantait à merveille hymnes et matines Qu’elle entonnait savamment par le nez. Elle parlait un françois des plus raffinés,Le françois qu’on apprend à Stratford-atte-BowCar elle ignorait du françois de Paris le moindre mot.
La ville de Stratford-atte-Bow était située près de Londres et on y apprenait le «françois d'Angleterre».Il existait donc bien deux français distincts : l'un correspondait à « une langue vernaculaire parlée spontanément, sans égard à la langue écrite, alors que l'autre était une langue seconde qu’on allait apprendre en France ».
On peut donc supposer que même si le français avait continué à être parlé et écrit en Angleterre,il se serait tellement singularisé par rapport à celui de Paris, qu’il serait devenu une autre langue (un peu comme le latin parlé dans la Romania s’était très vite écarté du latin de Rome. Le résultat en a été la diversité des langues romanes.)
Notons encore que se développa en Angleterre une série de traductions françaises de traités spécialisés, que ce soit sur la médecine, les mathématiques ou la religion.
12:43 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : Langue française, Becket, Guernes de Pont Ste Maxence, Chaucer
11/02/2008
La transitivité dans tous ses états.
Il existe des termes que nous employons sans trop réfléchir à leur origine, c’est fréquent. Pourtant, quand il s’agit de notions grammaticales, on pourrait supposer que nous percevons bien toute la réalité qui se cachent derrière les mots. Il n’en est rien, cependant.
Prenons la notion de transitivité. Tout le monde sait qu’il y a des verbes transitifs (directs ou indirects) et des verbes intransitifs. Mais d’où vient ce mot « transitif » ? Des grammaires latines. Un verbe est transitif (trans + ire), s’il peut passer de la voie active à la voie passive. Dis comme cela, cela paraît simple et normal. Pourtant, si on y réfléchit bien, cela signifierait qu’un verbe comme avoir ne serait pas transitif car on ne voit pas bien comment ce verbe se mettrait au passif :
J’ai une pomme/ la pomme est eue par moi ( ??)
D’un autre côté, les grammaires scolaires disent plutôt qu’un verbe est transitif quand il est capable de « passer » son action à son complément.
J’achète une voiture. J’achète quoi ? Une voiture.
Très bien, sauf qu’avec des verbes comme « voir » ou « craindre », il n’y a aucune action au sens propre. Pourtant, ces verbes sont transitifs.
Hjelmslev, de son côté, définira la transitivité comme la capacité du verbe à régir son complément. A « acheter » correspondra des objets qui peuvent être achetés, etc. Sur le plan syntaxique, le verbe est l’élément régisseur, duquel dépendent les compléments subordonnés. Sur le plan sémantique, c’est l’inverse, c’est le verbe qui est déterminé (complété) par son complément.
Syntaxe : j’achète. Quoi ? Quelque chose qu’on peut acheter (une voiture, une maison, un fruit, etc.)
Sémantique : j’achète. Dis ainsi, sans complément, ce verbe ne veut rien dire. Il est incomplet. Il me faut donc un complément qui donnera tout son sens au verbe : c’est une voiture que j’ai achetée (ni une maison ni un fruit).
Dans ce contexte, le verbe transitif est celui qui a la capacité d’apparaître avec un complément direct, lequel est certes régi par le verbe mais c’est aussi un complément qui complète la signification de ce verbe.
Le verbe transitif est donc « modifié » par son accusatif, tandis que l’intransitif n’a pas d’accusatif.
Dans la grammaire générative, le complément direct se définit sur base de la position du syntagme nominal et de la relation qu’il entretient avec le verbe. Ainsi Chomsky définira le complément direct comme la relation entre le syntagme nominal et le verbe à l’intérieur du syntagme verbal, dans lequel le complément direct est le constituant dominé par le syntagme verbal.
Cela sera peut-être plus simple si on fait appel aux notions d’attribut ou de prédicat.
Isabelle est la mère de Pauline
Isabelle est contente.
La relation entre le verbe et son prédicat, dans ce cas, est égalitaire ou de nature identitaire (Isabelle = mère ; Isabelle = contente). On exprime donc la qualité du sujet. C’est la notion classique d’attribut du sujet.
Dans le cas des verbes transitifs, le prédicat exprime un phénomène ou une situation à laquelle participe le sujet :
Je lis une histoire
Quand le verbe exprime en lui-même tout ce que l’on veut dire du sujet, on aura un intransitif :
L’arbre fleurit.
Notons que le verbe copule se rapproche du premier cas :
Isabelle est la mère de Pauline
« Isabelle est » n’est pas suffisant pour qualifier Isabelle. Il faut ajouter un attribut tout comme dans « je lis », qui est complété par « un livre ».
Quelque part, donc, le verbe copule est plus proche du transitif direct que celui-ci ne l’est de l’intransitif. D’un côté il me faut un attribut ou un COD, de l’autre il ne me faut rien, le verbe se suffit à lui-même.
Comment, cependant, faire la distinction entre les verbes copules et les transitifs directs ? Par ce qu’ils ne supposent aucune action ? Sans doute, mais alors les verbes de possession (j’ai une voiture) ou de perception sensorielle (je vois un arbre, j’entends un bruit) ne pourraient pas être qualifiés de transitifs directs puisqu’ils ne supposent aucune action au sens propre.
Comme quoi, quand on se met à réfléchir un peu, on s’aperçoit que ce qui était évident ne l’est pas tant que cela.
On pourrait encore dire qu’avec le verbe être définit ce qu’est le sujet et non ce qu’il fait :
Isabelle EST la maman de Pauline.
Mais pourquoi, alors, si je peux dire « la fleur est un symbole de paix « , ne puis-je pas dire « la fleur est la maman de Pauline » ? Il s’agit pourtant du même verbe être ».
Cela signifie que le verbe « être » régit certes syntaxiquement l’attribut mais pas sémantiquement. Par contre, c’est l’attribut qui régit sémantiquement le sujet.
« la maman de Pauline » étant un attribut, cet attribut ne conviendra qu’à une personne (Isabelle) et non à une fleur. Cela revient à dire que le verbe « être » est simplement un lien entre le sujet et son attribut, ce que toutes les grammaires scolaires ont toujours dit.
Donc, le verbe « être » régit syntaxiquement son complément tandis que ce complément (ici l’attribut) régit sémantiquement le sujet (alors que dans le cas du transitif direct, le verbe régissait lui aussi syntaxiquement le complément, mais le complément régissait sémantiquement le verbe et non le sujet). C’est pour cela qu’on peut affirmer que le verbe être n’est pas un transitif direct.
12:16 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Langue française, transitivité, intransitivité, copule
08/02/2008
Premier recul de la langue française

On sait que depuis la bataille de Hastings (1066) et Guillaume le conquérant, le français était parlé en Angleterre, du moins par les classes nobles. Cette bataille aura pour conséquence que l’anglais est finalement la langue germanique la plus latinisée (alors qu’on pourrait dire que le français est la plus germanisée des langues romanes)
Comme toujours en Histoire, il aurait pu ne pas en être ainsi. Il fut une époque où Guillaume, qu’on n’appelait pas encore le « conquérant » mais le « bâtard » faillit perdre son duché de Normandie suite à une révolte des ducs. Il parvint à reprendre le pouvoir avec l’aide du roi de France, puis il étendra sa zone d’influence en épousant Mathilde de Flandre (celle de la tapisserie de Bayeux), fille du Comte de Flandre Baudouin V et nièce du roi de France.
« Par cunseil de sa barunie
Prist une fame de haut lin,
En Flandres fille Balduin,
Niece Robert li rei de France, »
(Wace, le roman de Rou)
Après avoir conquis le Maine, bien assuré sur ses territoires, il peut se lancer à la conquête de l’Angleterre. Toute la noblesse de cet état va donc parler français et cela jusqu’à la guerre de cent ans. A ce moment, en effet, les rivalités sont telles et le sentiment nationaliste est tellement aiguisé, que le Parlement anglais décide d’imposer l’anglais dans les tribunaux (1362)
Item, pur ce qe monstré est soventfois au Roi [...] les grantz meschiefs qe sont advenuz as plusours du realme de qe les leyes, custumes et estatuz du dit realme ne sont paa conuz comonement [...] par cause q'ils sont pledez, monstrez et juggez en la lange Franceis, q'est trop desconue en dit realme [...] les dites leyes et custumes seront le plus tost apris et conuz et mieultz entenduz en la lange usee en dit realme [...]. Le roi [...] ad [...] ordeigné et establi [...] qe toutes plees [...] soient pledez, monstrez, defenduz [...] et juggez en la lange engleise, et q'ils soient entrez et enroullez en latin.
Traduction en français moderne:
De même, parce qu'il a été souvent montré au roi les grands dommages qui sont arrivés à plusieurs personnes du royaume parce que les lois, coutumes et statuts dudit royaume ne sont pas communément connus, parce qu'ils sont plaidés, exposés et jugés en langue française, qui est très méconnue dans le royaume, lesdits lois et coutumes seront plus vite apprises et sues et mieux comprises dans la langue utilisée dans ledit royaume. Le roi a ordonné et établi que toute plaidoirie soit plaidée, exposée, défendue et jugée en langue anglaise, et qu'elle soit enregistrée et transcrite en latin.
On retient de ce texte que le peuple, lui, n’a jamais parlé français (comme chez nous après les invasions germaniques, nos ancêtres ont continué à s’exprimer dans leur patois roman) et que cette langue était réservée à l’élite, autrement dit à la noblesse. Il n'empêche que le français était là une langue de culture et respectée comme telle.
A partir de cette décision, la langue française reculera de jour en jour en Angleterre et finira par disparaître.
16:40 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : langue française, Guillaume le conquérant
05/01/2008
Mémoire
Toujours dans « Le Paradoxe sur le comédien », je trouve, sous la plume de Diderot, cette expression étrange, difficilement compréhensible : « une leçon recordée d’avance ». Il est des jours où le Dictionnaire historique d’Alain Rey est bien pratique, il n’y a pas à dire.
Le verbe « recorder » signifiait, en terme juridique « rapporter comme témoin ». Un « recordeur », c’est donc un témoin et l’adjectif « recort » signifiait « qui se souvient ». En ancien français, existait le substantif « record » (souvenir, mémoire), utilisé d’ailleurs jusqu’au XVI° siècle (chez Montesquieu encore), lequel provenait du verbe réfléchi « se recorder », se rappeler, apparenté au verbe « recorder », répéter plusieurs fois quelque chose pour le savoir par cœur.
Ce verbe provient du bas latin « recordare » (« recordari » en latin classique) et avait le sens de se rappeler. Il était lui-même composé à partir de « cor, cordis », l’esprit, le cœur, auquel on avait ajouté « re », un préfixe à valeur itérative.
Notre substantif « record », si cher aux sportifs est quant à lui emprunté à l’anglais « record » (témoignage enregistré) lui-même provenant de l’ancien français « recort » (témoignage) que nous venons de voir. Finalement, le mot a pris le sens d’exploit sportif puis celui d’un résultat supérieur à tous les autres résultats obtenus dans le même domaine.
La langue est donc un véritable roman, dont il est captivant de suivre les péripéties. De l’idée de mémoire on passe à celle de témoignage, puis, via la conquête normande (Hastings, 1066), le terme prend en anglais un sens précis (témoignage écrit dans le domaine du sport), avant d’agrandir le champ de son acceptation (exploit et finalement exploit supérieur à tous les autres) et de repasser dans le domaine français au XIX° siècle. Subjugué par la langue anglaise, le français acceptera les mots recordman et même recordwoman, oubliant sans doute que l’étymon primitif se trouvait déjà en ancien français et qu’il signifiait bel et bien « mémoire ».
00:56 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : langue française, recort
07/12/2007
Paresse linguistique
La paresse, de tout temps, a été à la base des actions humaines. En effet, pour arriver à leur fin, les hommes ont toujours emprunté la voie la plus facile. Pourquoi faire compliqué quand il y a moyen de faire simple ? Nicolas Sarkozy n’échappe pas à la règle. Il a beau demander aux Français de se lever tôt et de travailler davantage, de son côté il a adopté la solution de la facilité : faire augmenter son salaire sans modifier la nature et la durée des services qu’il rend à la collectivité.
Il en a toujours été de la sorte et on n’y changera rien. Ainsi en va-t-il en linguistique également. La langue, en évoluant, est toujours allée vers plus de facilité. On pourrait même dire que c’est ce désir de simplification qui est la base même de son évolution. En voici quelques exemples :
-Réduction des 5 déclinaisons latines à 3
-Réduction des six cas latins à deux (nominatif et accusatif : cas sujet et cas régime) en ancien français et emploi accru des prépositions.
-Disparition du neutre.
-Suppression des voyelles finales, sauf le « a » qui devient « e » (muri : mur, canto : chant, rosa : rose)
-Suppression définitive du système casuel et emploi systématique des prépositions.
-Facilité de prononciation, qui est à la base même de l’évolution phonétique : capra qui devient kiabra, kiaebre, tchaevre, chèvre.
-Seules les voyelles initiales, accentuées, se maintiennent (lucore : lueur), tandis que les atones disparaissent.
-Disparition des voyelles situées à l’avant-dernière syllabe (TAbula : table)
-Formaticus (mis en forme) qui devient formage avant de passer à fromage ou comme nous l’avons vu, corcodillus qui disparaît au profit de crocodile.
-De nos jours, disparition progressive de l’imparfait et du plus-que-parfait du subjonctif.
Ou nous arrêterons-nous ? Quand on voit la langue utilisée dans les SMS il y a de quoi se poser des questions. Sans doute tout cela fait-il partie d’une évolution inéluctable…
16:41 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : langue française
10/10/2007
Zeugma et autres anacoluthes
Un commentateur de l’article précédent a cité le zeugma ou zeugme (du grec ζεuγμα/ zeûgma, « joug, lien ») comme autre figure de style. Poursuivons notre parcours des figures de style et notons qu’il existe deux types de zeugma :
- Dans le premier cas, on ne répète pas un élément, par exemple le verbe, comme dans la phrase « L'un poussait des soupirs, l'autre des cris perçants ». Cette tournure apparente le zeugma a un raccourci. Ceci dit, on pourrait se demander dans notre exemple s’il s’agit bien d‘une figure de style au sens propre et si ce n’est pas la répétition du verbe qui en serait une, rendant la phrase plus poétique.
- Dans le deuxième cas, on met sur le même plan des éléments qui ne devraient pas s’y trouver. Ce parallélisme provoque la surprise. Il est parfois comique, parfois poétique.
o « Vêtu de probité candide et de lin blanc » (Victor Hugo)
o « Il parlait en anglais et en gesticulant. »
o « Les moutons suivaient le berger, et le berger le fil de ses pensées. »
o « Il prit son chapeau et la porte. »
o « Retenez cette date et une place dans le train. »
o « Il prit un café et un train. »
o « Il faisait nuit, et moi du vélo. »
Le zeugma poussé à l’extrême de ses limites (par exemple en associant un verbe transitif et un verbe intransitif) peut s’apparenter à l’anacoluthe. Par exemple : « J’ai vu et j’ai parlé à mes amis. »
L’anacoluthe (nom féminin, soit dit en passant) est une rupture de la construction syntaxique. Le mot anacoluthe vient du grec (aνακόλουθον/anakólouthon), « qui n’est pas à la suite de ». (préfixe privatif « an » et « aκόλουθος/akólouthos », « qui suit, qui s’accorde ». Notre mot acolyte a la même racine.
Il existe plusieurs types d’anacoluthes.
- Soit la phrase commence par un mot qui n’a pas de fonction grammaticale: « Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé »
- Soit le complément qui suit le verbe n’est pas celui qu’on attendrait : « J’ai vu et j’ai parlé à mes amis ». On parle alors de zeugma grammatical (preuve, une fois de plus, que toutes ces figures s’interpénètrent).
- Soit on a une ou plusieurs propositions subordonnées qui ne se rattachent à aucune proposition principale : « Quand tout dort, que la lune brille, mais il fait jour ».
L’anacoluthe est donc bien une « faute » de syntaxe. Elle est souvent liée à la langue parlée et est rarement volontaire, à la différence du zeugma. Cependant, on trouve des anacoluthes voulues chez des poètes connus, comme chez Baudelaire, dans ses vers célèbres :
« Exilé sur le sol au milieu des huées
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher »).
Pour terminer et revenir à notre zeugma initial, notons que ce terme est aussi le nom d'une cité antique située sur l’Euphrate (Turquie actuelle) près de la frontière syrienne, au Sud du pays (route de la soie). Elle fut fondée par un général d’Alexandre. Située de part et d’autre du fleuve, ce qui constitue une position stratégique importante, elle a pris logiquement le nom grec de Zeugma (« lien »). En 1995 on commença à construire un important barrage sur l'Euphrate, qui allait inonder toute la région. On entreprit des fouilles de toute urgence, lesquelles permirent de mettre au jour une organisation urbanistique très évoluée et de nombreux bâtiments importants. (grandes demeures patriciennes romaines, peintures murales et mosaïques d'un intérêt exceptionnel). Ces peintures et ces mosaïques sont rassemblées au musée de Gaziantep afin d’éviter leur immersion. Un examen du site proprement dit, mené après la première vidange du réservoir, a abouti à la conclusion que les bâtiments avaient grandement souffert de l'inondation et étaient quasiment détruits.
Ce thème de la destruction par les eaux d’un barrage me fait penser au livre de Penn Warren, « Les eaux montent », qui raconte comment un individu, revenu pour la circonstance dans le village de son enfance, vit l’ anéantissement programmé de ce qui fut le cadre de vie de son enfance. D’un côté il est obligé de replonger dans ses souvenirs et donc de faire le point sur sa vie, de l’autre il sait que ces souvenirs vont irrémédiablement appartenir au passé du fait de la destruction du village. Il se tourne donc vers son passé pour comprendre le présent au moment même où on lui retire ce passé sur lequel il pouvait enfin s’appuyer. Une belle réflexion sur l’homme et sa place dans le monde.
Comme quoi notre zeugma peut être fort utile. Il nous ouvre des portes insoupçonnées. Qui a dit que la rhétorique était dépassée ? Elle conduit à tout, à condition d’en sortir.

23:30 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : langue française, zeugma, anacoluthe
25/09/2007
La Defense et Illvstration de la langve francoise
Demain 26 septembre 2007, les députés français doivent ratifier le «protocole de Londres» sur les brevets. A ce jour, ce protocole a été ratifié par 11 États (Allemagne, Angleterre, Danemark, Islande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Slovénie, Suède), tandis que l'Italie, l'Espagne, la Finlande, la Grèce le refusent.
Jusqu’ici, la France avait également refusé ce protocole afin de défendre la position du français dans le monde. En effet, pour le moment, une société qui veut faire breveter une invention pouvait introduire se demande en anglais (66% des cas), en allemand (27%) ou en français (7%). Une fois le brevet délivré, elle doit le traduire dans toutes les langues des pays où elle souhaite une protection. Tout cela coûte cher et on sait que les firmes n’aiment pas dépenser leur argent. D’où l’idée de réduire les coûts des frais de traduction en limitant celle-ci aux « revendications » seulement (4 à 5 pages), en excluant donc toutes les descriptions techniques. Dès lors, les multinationales ne devront plus traduire en français les brevets des produits qu’elles veulent commercialiser en France (ni en grec pour la Grèce, en espagnol pour l’Espagne, etc.). Par contre, les firmes françaises, si elles veulent connaître la teneur des brevets que leurs concurrents ont déposés, devront les faire traduire à leurs frais (idem pour la Grèce, l’Espagne, etc.). Or, elles sont bien obligées de connaître le contenu des brevets déjà déposés avant de se lancer elles-mêmes dans la commercialisation d’un nouveau produit.
De son côté, Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la Francophonie, justifie la ratification du protocole de Londres en assurant que le français restera au même rang que l'anglais et l'allemand (puisque les brevets pourront toujours être déposés dans une de ces trois langues). Certes, ... à ce détail près qu'il ne concerne déjà plus que 7% des demandes de brevets.
Cent cinquante personnalités réunies autour du linguiste Claude Hagège (qui passe pour avoir des connaissances dans une cinquantaine de langues) et de l'académicien Erik Orsenna appellent les députés à bien réfléchir avant de ratifier ce protocole de Londres. Ils n’ont pas tort. On connaît l’engouement de notre ami Sarkozy pour l’Amérique. Il ne faut pas attendre de sa part une défense de la langue française (encore qu’on ait pu se rendre compte cet été que c’est en français et non en anglais que lui-même apostrophe les journalistes américains quand il monte à l’assaut de leur bateau). De plus, sur le plan européen, il veut sans doute se faire pardonner le non des Français au référendum de mai 2005. Comme il est visiblement pour la mondialisation de l’économie (et pour l’économie tout court, tant qu’on gagne de l’argent, c’est ce qui compte, non ?), il ne va certainement pas mettre en avant une spécificité française. Or cette société mondialisée, il se fait que personnellement, je ne l’apprécie pas beaucoup. Pas au nom d’un chauvinisme étroit, mais simplement pour deux raisons. D’abord parce qu’elle représente la suprématie de l’économie sur toutes les autres valeurs (y compris le droit des personnes et la culture en général) et ensuite parce qu’elle nous offre une vision du monde unipolaire (en l’occurrence exclusivement anglo-saxonne), au détriment de toutes les diversités que pouvaient offrir les peuples de la planète.
Car c’est bien là que se trouve le problème philosophique. D’un côté, on nous dit de ne pas nous refermer sur nous-mêmes, ce qui serait intellectuellement sclérosant et on a bien raison de le dire (on a vu où les nationalismes étroits ont pu nous conduire par le passé et aujourd’hui le régionalisme exacerbé de certains a de quoi inquiéter. Voir le Pays basque ou la Flandres). Mais d’un autre côté, une fois qu’on a abandonné les prérogatives de son propre pays et de sa propre culture, on se retrouve non pas devant une palette multiculturelle, ce qui serait enrichissant, mais devant un monde gris et monochrome.
Au-delà de cette réflexion, c’est le rôle du français lui-même qui est ici en question. On est loin de l’Edit de Villers-Cotterêts (1539) par lequel François premier en avait généraliser l’usage ( en réalité , il officialisait une situation de fait). Aujourd’hui, le français est en perte de vitesse de tous côtés. Vouloir le défendre, comme je le fais ici, c’est déjà avouer qu’on est sur la pente descendante. Alors, quelle attitude faut-il adopter ? Poursuivre la défense et refuser ce protocole de Londres, qui nous enterre un peu plus (et qui concerne non seulement notre langue, mais aussi les firmes françaises – ou francophones en général- unilingues qui ne sont pas des multinationales) ou accepter une fois pour toute la suprématie de l’Amérique sur l’Europe et la domination de la culture anglo-saxonne sur la nôtre ? Car s’il n’est plus une langue scientifique, le français devient une langue vernaculaire, une sorte de patois local qu’on n’utilisera plus que chez soi, au coin du feu.
De son côté, Sarkozy plaide pour une «France bilingue». Lui-même est fasciné par les Français qui vivent et parlent à l'américaine, comme Christine Lagarde, dont il a fait, en partie pour cette raison, son ministre de l'Économie. Il est clair que c’est bien d’être bilingue. C’est nécessaire aussi. Notre survie économique en dépend sans doute. Les Gaulois ne s’y étaient pas trompés quand ils avaient abandonné la langue celte au profit du latin (sur la manière dont s’est opérée cette transformation, nous ne sommes pas trop renseignés. Est-ce que cela s’est fait en douceur ou est-ce que cela a été imposé « militairement » par l’occupant romain ?). Le problème, c’est que le Gaulois a disparu. Cette culture n’était pourtant pas aussi barbare qu’on veut bien nous le faire croire (voir tous les mots français qui proviennent du gaulois, notamment dans le domaine agricole).
Alors, pour revenir au français, faut-il accepter l’inéluctable au point de favoriser l’usage généralisé de l’anglais dans nos propres entreprises ? On dit (mais je n’ai pas la preuve) que Sarkozy aurait échoué à une épreuve d’anglais en Sciences-Politiques. Cela ne l’a pas empêché de faire une belle carrière. Mitterrand, de son côté, se gardait de parler autrement qu'en français à l'étranger. Et puis, qui sait si demain ce n’est pas le chinois qui va l’emporter ? Alors, commençons d’abord par faire en sorte que nos élèves sortent de l’enseignement primaire en maîtrisant au moins leur langue maternelle, ce serait déjà un bon début.

11:07 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : Langue française, protocole de Londres
24/08/2007
Néologismes
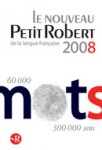
Le Robert 2008 vient de sortir. Pierre Assouline, sur son blogue (où je ne vais jamais), nous donne quelques-uns des néologismes acceptés par le dictionnaire. C’est ainsi qu’on apprend que quelques régionalismes feront désormais partie de la langue française :
« … en Belgique (carabistouille, brol, babelutte, jouer avec ses pieds…), au Luxembourg (auditoire pour salle de cours, et contournement pour périphérique), en Suisse (grimpion, se miner le plot, bringues…), en Afrique (ambianceur désignant le boute-en-train, deuxième bureau la maîtresse d’un homme marié, matabiche pour pot-de-vin, et faire couloir pour chercher à obtenir une faveur), au Québec (faire la baboune pour bouder, avoir de la façon pour être poli, chanter la pomme pour courtiser), aux Antilles (habitation pour exploitation agricole)… »
Il n’y a pas si longtemps, il me semble, que les dictionnaires se risquent en dehors de l’hexagone, ce qui nous amène à une réflexion sur la frilosité du français.
Le gros problème du français c’est en effet sa rigidité par rapport aux nouveautés.
Cela tient sans doute au poids du bon usage. Dans les autres langues, il me semble que les locuteurs s'expriment naturellement sans penser à mal. En français au contraire nous craignons toujours de commettre une faute, même les plus cultivés d'entre nous. Peut-être est-ce le regard de Richelieu, ce fondateur de l'Académie, qui continue à peser sur nous. On a l'impression que la moindre faute de langue est aussitôt sanctionnée par la société et passible de prison. Je dis cela, mais je suis le tout premier à essayer de respecter ce bon usage. Il y a même un certain plaisir à y parvenir. D'ailleurs nous tous sur nos blogues, ne faisons pas autre chose que de tenter de trouver le mot juste, la bonne définition, la nuance pertinente etc.
Malheureusement je crois que cette norme qui est imposée au français nous handicape dans l'apprentissage des autres langues. S'est-on déjà demandé pourquoi les Français semblent si peu doués pour les langues étrangères? Il y a à mon avis plusieurs raisons:
1) Le prestige passé du français continue à donner l'impression à ses locuteurs que cette langue se suffit à elle-même, y compris sur le plan international. Malheureusement c’est là une réalité dépassée, dont seuls les anglophones peuvent désormais se prévaloir pour leur propre langue.
2) Je me suis laissé dire que le nombre de sons (et leur complexité) était moins important en français par rapport à d’autres langues. Un Vietnamien aurait donc plus « facile » en apprenant le français (car il retrouverait des sons qu’il connaît déjà dans sa propre langue ou des sons moins complexes que ceux auxquels il est habitué) qu’un Français en apprenant le vietnamien.
3) Le poids du bon usage fait qu’un locuteur francophone a peur de « se lancer » dans l’élaboration d’une phrase dans une autre langue. A l’inverse les Allemands ou les Hollandais oseront davantage. Ils font des fautes ? Aucune importance, on les comprend tout de même. Et puis personne ne va se mettre à rire de leurs fautes. Du coup, petit à petit, ils progressent dans leur apprentissage. Nous, de peur de commettre le moindre impair, nous préférons nous taire. Et nous n’apprenons rien.
Pour revenir aux termes techniques (car c’est finalement là qu’on retrouve la plupart des nouveautés), il faudrait absolument créer rapidement des néologismes. L’Académie le tente bien, mais avec un tel retard que les mots qu’elle propose sont déjà passés dans l’usage (ex. : effeuillage pour streap-tease). L’initiative devrait donc venir des locuteurs eux-mêmes (ainsi j’utilise « courriel » de préférence à « mail », tentant ainsi d’imposer mon choix à d’autres. Cela donne parfois de bons résultats). Mais là on se retrouve confronté à un double problème :
1) De quel droit est-ce que moi, simple usager, je me permettrais d’innover et donc de modifier cette langue que j’ai reçue en héritage ? C’est de nouveau le poids du bon usage et de la norme.
2) Beaucoup de locuteurs francophones restent à ce point fascinés par la langue anglaise, qui leur semble symboliser la société idéale (et de fait, c’est bien ce type de société commerciale qu’on veut nous imposer. L’individu qui y souscrit est donc valorisé), qu’ils se croient obligés, par snobisme, d’employer systématiquement le terme anglais quand celui-ci existe. Or il existe souvent un mot français correspondant.
15:14 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : néologisme, langue française, dictionnaires
16/08/2007
palin
Nous parlions l’autre jour de palimpseste à propos d’une peinture de VanGogh.
A partir du même préfixe palin (à nouveau), on a formé les mots suivants, qui font rêver par leur sonorité ou leur côté mystérieux :
Palindrome(palin et dromos, la course) :
groupe de mots qui peut être lu de gauche à droite ou de droite à gauche en conservant le même sens (« Esope reste ici et se repose »)
Palingénésie :
1) retour cyclique des mêmes événements
2) retour à la vie, nouvelle vie
3) pour les anciens Chrétiens : régénération par le baptême.
Palingénésique (adj) :
Relatif à la palingénésie.
Palinodie (palin et odh, le chant) :
1) rétraction de ce que l’on a dit ou fait
2) dans l’Antiquité, pièce de vers dans laquelle l’auteur rétractait ce qu’il avait exprimé précédemment.
On notera au passage dans cette dernière phrase l’emploi transitif de « rétracter », d’après le latin retractare (retirer). On connaît mieux la forme pronominale « se rétracter» (revenir sur ce qu’on a dit). Par contre, on ne confondra pas avec l’autre verbe rétracter, également transitif, mais provenant du latin retrahere et qui signifie « faire se rétrécir, contracter » (l’escargot rétracte ses cornes). Lui aussi possède une forme pronominale : se rétracter, au sens de « se contracter, subir une contraction ». Existent aussi les adjectifs « rétractif » (qui produit une rétraction), « rétractiles » (qui a la possibilité de se rétracter) et les substantifs « rétractilité» (qualité de ce qui est rétractile) et « rétraction» (diminution du volume d’un matériau durant sa prise).
A vous de trouver le sens exact de rétractabilité, rétractable et rétractation...
15:23 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vocabulaire, langue française
01/06/2007
Vocabulaire
N’allez pas confondre une Nigériane avec une Nigérienne, les mots ayant leur importance Mais encore faudrait-il que vous sachiez où se trouvent ces deux pays et lequel se situe au Nord-Est de l’autre… Hé hé !
Comme il ne faut pas confondre un Hindou avec un Indien. Tous les Indiens ne sont pas hindous, mais est-ce qu’il y a des Hindous qui ne sont pas indiens ?
En tout cas il y a plusieurs Indiens, ceux d’Inde et ceux d’Amérique. Dans ce dernier cas on parle alors d’Amérindiens, par commodité. Encore faut-il distinguer ceux du Nord et ceux du Sud. Il est facile de les différencier. Ceux du Sud sont en voie de disparition tandis que ceux du Nord ont déjà disparu.
Une Indienne sera donc une femme vivant en Inde (qu’elle soit hindoue ou non) ou en Amérique (pour autant, bien entendu, qu’elle soit de race indienne. Georges Bush, par exemple et comme chacun sait, n’est pas un Indien même s’il joue souvent au cow boy). Mais une indienne (sans majuscule) est une toile de coton légère et colorée. Tout le monde peut s’habiller d’une simple indienne, les Indiennes hindoue d’Inde, mais aussi les Nigérianes du Nigeria.
Et les hommes dans tout cela ? N’allez pas confondre le substantif bonhomme avec l’adjectif homonyme. Un bonhomme (qui n’est pas forcément un homme bon) est une personne jugée sympathique ou au contraire qui inspire la réserve ou la méfiance. Ainsi, on dira : « Ce bonhomme me fait peur ». Le féminin est bonne femme (en deux mots). Par contre, pour un dessin représentant grossièrement l’être humain, on parlera toujours de bonhomme. L’adjectif bonhomme, quant à lui, signifie « qui exprime la franchise, la simplicité » (avoir un air bonhomme). Le substantif correspondant est évidemment bonhomie (avec un seul M), qui signifie « caractère d’une personne bonhomme » (et non bonne).
Bon, bon. Nous en aurons fini quand nous aurons parlé des bons-chrétiens, mot qui ne désigne pas les supporters de Benoît XVI mais une variété de poire.
On dit d’ailleurs « C’est une bonne poire » pour dire finalement qu’une personne a tellement l’air bonhomme qu’elle se fait toujours avoir. Etant trop bonne, elle en devient bonasse (le substantif correspondant est bonasserie, à ne pas confondre avec bonneterie, lequel soit-dit en passant s’écrit sans accent sur le « e »)
J’en ai fini et ne vais pas vous ennuyer avec la bonace, terme vieilli qui désignait le calme plat en mer (du latin malacia lequel a été contaminé par « bon »).
Il suffit maintenant de mettre tout cela en musique :
Une bonne femme nigériane se rendant au Niger vêtue d’une indienne rencontra un bonhomme bonasse. C’était un Indien hindou qui travaillait dans une bonneterie. « Que votre indienne est jolie », dit l’Indien à la Nigériane, « ne voudriez-vous pas me la céder pour mon épouse? ». « Merci pour le compliment, vous êtes trop bon », répondit la dame, mais ma religion m’interdit de parler aux hommes, qu’ils soient bons ou pas et encore moins de me dévêtir devant eux. ». « Je comprends », répond l’Indien, de mon côté je suis hindou et apprécie votre pudeur. Allons, n’en parlons plus. Comme je suis bonne-poire, je vous offre quelques bons-chrétiens pour la route. » « J’espère qu’ils sont bons », répond la bonne femme d’un air bonasse.
Ps. : je connais une ville qui possède une rue « de la bonne femme ». Ce terme n’est pas à opposer à "bonhomme » et pour en comprendre le sens il faut remonter à l’étymon latin : mala fama. Cette notion de « mauvaise réputation » fut ensuite transformée, par ironie ou par discrétion, en bonne réputation. On retrouve là l’hypocrisie habituelle de la bourgeoisie qui n’ose pas désigner les réalités par leur nom, ici en l’occurrence le monde de la prostitution.

13:52 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : langue française, vocabulaire







