27/04/2009
La louve
En arrivant à l’eau elle la flaira d’un air méfiant et leva la tête pour le regarder. Elle observa à nouveau les flammes et la silhouette du cheval au-delà du feu. Ses yeux luisaient dans la lumière. Elle baissa le nez pour flairer l’eau. Ses yeux restaient fixés sur lui et ne cessaient pas de brûler et quand elle baissa la tête pour boire, le reflet de ses yeux apparut dans l’eau sombre comme un double de loup qui aurait eu son gîte à l’intérieur de la terre ou attendu en secret jusqu’en d’aussi artificiels trous d’eau pour que la louve puisse toujours y trouver confirmation de son existence et ne soit jamais tout à fait abandonnée dans l’univers.
Cormac Mac Carthy, « Le grand passage », page 92

16:49 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, mac carthy


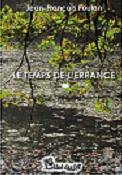



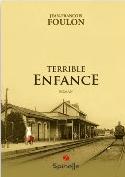
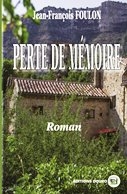
Commentaires
Ce passage illustre parfaitement le style et l’univers Mc Carthien. On retrouve la phrase typique qui s’envole dans un geste ample et vigoureux qui libère l’imaginaire, sans virgules, secouée par la répétition de la conjonction « et ». Cette dernière particularité a été bien décrite dans votre blog du 28 mars. Le style de McCarthy a fait aussi l’objet d’une excellente thèse de Doctorat de Mme Neila AMMAR KESKES soutenu à la Sorbonne en janvier 2007.
Écrit par : Halagu | 28/04/2009
L’errance qui est la leur, dans ces vastes paysages, devient souvent une quête existentielle. Ils vont au bout d’eux–mêmes, de leurs peurs, de leur courage (ici : côtoyer un loup), ce qui les singularise encore et les distingue d’autant plus des autres hommes.
Mais je ne vous suis pas quand vous dites qu’ils «s’installent dans la violence ». Je les trouve au contraire terriblement humains. S’ils se retrouvent en prison, c’est toujours pour des actions qu’ils n’ont pas commises. De plus, ils imposent leur volonté à la nature (dompter un cheval, obliger un loup à vous suivre), ce qui est quand même le signe d’une certaine humanité (si on oppose la culture à la nature, comme dans la conception anthropologique de Lévi-Strauss).
Je ne sais pas s’ils vivent en « eau trouble », je dirais plutôt qu’ils empruntent des chemins de traverse, ce qui n’est pas pareil. Mais c’est sûr que c’est par des actions insolites qu’ils essaient de se définir eux-mêmes et de se trouver.
Le loup symbolise la nature brute et sauvage. Mais qui est le plus cruel, du loup qui mange le bétail pour se nourrir ou de l’homme qui lui tend un piège aux dents acérées ? D’ailleurs une fois qu’il a capturé le loup, le héros ne le tue pas mais décide de le reconduire d’où il vient, ici de l’autre côté de la frontière mexicaine (passage de la ligne de démarcation, donc, du monde anglophone au monde hispanique, de la culture à la nature, de l’aisance à la pauvreté, etc.). Par un acte gratuit, il reconduit donc le loup dans la nature primitive (le paradis perdu ?) qu’il n’aurait pas dû quitter. Du coup, l’homme pénètre dans cet univers mythique (ce pays de révolutions où vivent des hommes différents). C’est au Mexique qu’il trouvera l’amour (cf. « De si jolis chevaux » mais aussi « Des villes dans la plaine »). A croire que l’amour ne peut se rencontrer qu’en un lieu éloigné. D’ailleurs la belle est toujours inaccessible (fille de riche propriétaire ou prostituée « protégée » par son proxénète).
Le Mexique est donc le pays du rêve. Y entrer en emmenant un loup est pour le moins singulier somme démarche.
Je ne connais pas la thèse de doctorat que vous évoquez. Cela se trouve sur Internet ?
Écrit par : Feuilly | 28/04/2009
La thèse se trouve à la bibliothèque de la Sorbonne et, peut-être, dans toutes les autres facs de lettres de France. Neila AMMAR KESKES semble professer à la fac de lettres de Sfax en Tunisie. Si vous arrivez à trouver son adresse (peut-être via Jalal El Gharbi), elle pourra, normalement, vous envoyer un exemplaire.
Écrit par : Halagu | 29/04/2009
Écrit par : Michèle | 29/04/2010
Les commentaires sont fermés.