22/04/2009
Les écrivains (encore!)
On a souvent réfléchi ici sur la définition de l’écrivain, réflexion un peu vaine et théorique, j’en conviens, mais qui indirectement nous oblige à méditer sur l’essence de la littérature. L’autre jour, Jean-Louis Kuffer avait abordé le même sujet et avait ajouté un élément intéressant à ce débat. Il reprenait en fait la distinction de Jacques Audiberti, lequel distinguait
- l’ écriveur (qui utilise la langue comme un simple outil pour pouvoir communiquer).
- l’écrivant (qui, habituellement cultivé, entretient un rapport privilégié avec la langue, qu’il maîtrise parfaitement. Il n’a pas, cependant, de prétention littéraire particulière. Cela signifie qu’il s’exprime clairement, dans un style limpide, agréable même et donc que le message qu’il veut communiquer passe facilement, la langue ne faisant certainement pas obstacle à une bonne compréhension du contenu. A la limite, il parviendrait même à mieux se faire comprendre que certains auteurs qui restent quelque peu obscurs, que ce soit volontairement ou non.
- l’écrivain qui se donne le droit de transformer le langage (ce bien pourtant commun à tous) à sa guise pour en faire une sorte de propriété personnelle, ce qui fait que sa « griffe » se reconnaît parfaitement. C’est probablement ce que l’on veut dire quand on parle de « style ». Pas le « beau style » au sens académique, comme le fait remarquer JL Kuffer, (car ce style-là, c’est plutôt l’écrivant qui le maîtrise à la perfection), mais le style « organiquement accordé à un souffle et un rythme qu’on retrouve de Rabelais à Céline et de Proust à Thomas Bernhard entre mille autres… »
Grâce à cette définition, on comprend mieux ce qui se tramait dans la fameuse querelle sur les «fautes» de Flaubert. On sait que celui-ci avait une manière bien à lui d’employer les imparfaits de l’indicatif. Au début du XX° siècle, on le lui a reproché, allant jusqu’à dire qu’il maîtrisait mal la langue (il était donc un mauvais « écrivant »). Mais enfin, c’était Flaubert, tout de même, un des plus grands classiques. Pouvait-on dire que s’il était un bon narrateur, il écrivait cependant fort mal ? C’est Marcel Proust qui est venu prendre la défense du maître et expliquer que pour lui il n’y avait pas de fautes chez Flaubert dans la mesure où elles étaient voulues. C’est justement parce que Flaubert était un grand écrivain (ce que personne ne contestait) qu’il s’était permis de « jouer » avec la langue, de la pousser dans ses derniers retranchements pour mieux exprimer ce qu’il ressentait.
Etre écrivain consisterait donc, non pas à être édité, mais à savoir tordre la langue jusque dans ses derniers retranchements pour lui faire dire tout ce qu’on a envie de dire. Personnellement, avec mon style relativement classique, il me semble que je me situe surtout du côté des «écrivants». A chacun de réfléchir maintenant sur son cas personnel. Bon, que cela ne vous gâche pas la journée quand même, hein !
23:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (35) | Tags : littérature, écrivains


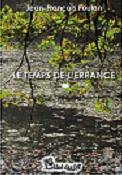



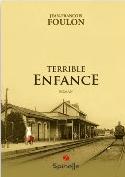
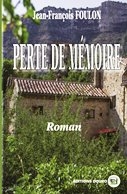
Commentaires
J'adhère complètement à ces concepts ainsi éclaircis.
Tu parles de Flaubert..Mais que dire alors de Céline ? Dans une écriture et une langue complètement chahutées du point de vue de l'académisme, que dire de ce souffle, de cette respiration, qu'on sent sur soi presque physique.
Merci d'avoir retransmis, par tes mots "d'écrivant" les précisions de Jean-Louis.
Écrit par : Bertrand | 23/04/2009
Écrit par : michèle pambrun | 23/04/2009
Écrit par : Natacha | 23/04/2009
Écrit par : Halagu | 23/04/2009
Dès lors, tout écrivain serait "écrivant" au moment où il rédige et écrivain quand il fait une séance de signatures.
@ Halagu: l'auteur étranger serait l'écrivain et le traducteur "l'écrivant". Encore que, car il doit bien souvent "tordre" sa propre langue pour parvenir à rendre les nuances de la langue étrangère.
Votre remarque ne rend pas les choses simples...
Par contre, je ne comprends pas bien ce statut du français qui serait une langue en chantier. Il me semble au contraire que tout a été fort codifié au XVII° siècle.
Et puis prenez l'anglais, il y a plein d'auteurs étrangers qui ont écrit en anglais, à commencer par le poète palestinien Darwich. Croyez-vous vraiment que la langue d'accueil doit avoir un statut particulier?
Écrit par : Feuilly | 23/04/2009
Vous avez abordé un sujet très, très vaste, et je vous livre l’ébauche d’un avis d’écriveur et non de littérateur.
Écrit par : Halagu | 24/04/2009
Comme s'est agréable de subir la pression exquise d'une belle langue.
Écrit par : Halagu | 24/04/2009
Pour la langue, oui, c'est sûr qu'elle évolue tout le temps et qu'elle va vers plus de simplification (abandon du passsé simple, des subjonctifs imparfaits et plus que parfaits, etc.).
Écrit par : Feuilly | 24/04/2009
Une grande part du boulot -peut-être la part essentielle, au moins pour moi- se fait à partir de l'expérience sans aucun parti-pris esthétique. C'est la vie qui va et décide, tranche à travers des formes disponibles. Je prends ce qui me convient, ce qui me fait aller dans la langue, rien de plus. Ensuite je peux tenter d'infléchir ces choix, mais ce n'est pas une nécessité ; je fais plutôt cet effort pour l'extérieur, pour ne pas toujours dire : je ne sais pas.
Au lieu de l'équation pongienne PPDC/PPDM, je préfère parti pris de l'émotion/parti pris des mots. Il est certain que le poème est un travail de la langue, mais le moteur de ce travail, c'est l'émotion. Elle accouche de sa forme, difficilement parfois, mais c'est bien ce processus qui aboutit chez moi au poème. Par exemple, la peur, c'est d'abord ce qui me tord le ventre, sans mots. Le poème ne va pas tenter de la réduire mais de la dire dans son mouvement.
Un poème c'est de la langue sur une émotion qui rend muet. Il va contre ce mutisme, il est donc bien un exercice de lucidité, d'élucidation. Par les mots, je retrouve un peu prise sur ce qui opresse. Par les mots, je me décale, je prends un peu de distance, je ne suis pas complètement dedans. On écrit sans doute moins pour ne plus avoir mal que pour comprendre de quoi on souffre exactement.
Ecrire comme personne d'autre ne l'a fait n'est pas une raison suffisante pour se croire génial. Beaucoup de poètes ont leur écriture propre sans arriver pour autant au génie. Mais il est certain que celui qui écrit "comme tout le monde" a moins de chance de dépasser le stade de l'anonymat.
La gloire... On écrit parce qu'on écrit, parce qu'il faut écrire sous peine d'étouffer, parce que l'air manque - " pas assez de ciel " (Reverdy) -. Ceci posé, un peu de reconnaissance ne fait pas de mal, ne serait-ce que pour compenser la solitude.
Écrit par : michèle pambrun | 25/04/2009
Écrit par : Feuilly | 25/04/2009
La francophonie propose une très grande diversité de langues françaises en constante évolution.
Le français venu, par exemple, par les chemins de la colonisation, a pris lui aussi, après la décolonisation, son indépendance.
Dans bien des pays africains, il y a deux modes d'existence du français : le mode officiel proche du français standard et le mode vernaculaire, français quotidien des échanges urbains ordinaires.
On s'éloigne de l'écriture et de la littérature, là, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'invente.
Au Cameroun par exemple, dont le français et l'anglais sont les langues officielles, s'est développé le camfranglais, langue branchée des lycéens et des étudiants qui développent entre eux un mixte remarquable :
"Je suis comot du wok" pour "je suis sorti (come out) du travail (work)".
Écrit par : michèle pambrun | 26/04/2009
Écrit par : Feuilly | 26/04/2009
Et tu saurais toi parler par aphérèses comme ils le font ?
Ils ne sauront pas que ce sont des aphérèses si personne ne le leur dit, mais ils sont virtuoses.
Écrit par : michèle pambrun | 26/04/2009
Écrit par : Feuilly | 26/04/2009
C'est dans ce coche d'apocalypse que la pauvre Emma arrive sur le lieu du supplice, Yonville-l'Abbaye. La littérature conduit le coche. Il y a dedans une jolie femme brune qu'on va faire souffrir jusqu'à la mort. Nous sommes tous à la sortie du coche, le souffle un peu court. Quand elle descend on voit sa cheville.
[...]
Il n'y aurait peut-être qu'une preuve possible de l'excellence de l'oeuvre, qu'un moyen de pulvériser une bonne fois le masque, qu'une ratification surnaturelle de la toute-puissance de l'écrit : ce serait de mourir de jouissance. L'artiste parfait meurt de la beauté de son chant. Cet artiste parfait, parfaitement justifié et ratifié, existe dans "Madame Bovary", dans la scène burlesque où Emma et Léon exaspérés, fous de leur corps, sont emportés dans une visite guidée de la cathédrale de Rouen, englués dans la parole du Suisse : "Voilà, fit-il majestueusement, la circonférence de la grande cloche d'Amboise. Elle pesait quarante mille livres. Il n'y avait pas sa pareille dans toute l'Europe. L'ouvrier qui l'a fondue en est mort de joie."
Cette cloche de vingt tonnes tombée du ciel que son auteur prend sur la gueule, c'est le texte qui tue.
Pierre Michon - " Corps du roi "
Écrit par : michèle pambrun | 26/04/2009
C'est Dominique Viart dans "La littérature française au présent, héritage, modernité, mutations" Bordas 2005 - qui dit ceci ( p. 213, 214) :
"En littérature, faire parler un exclu comme un exclu, c'est risquer de NE PAS le faire entendre : il ressemble à sa caricature, son discours ne produit que de l'attendu, son dire est toujours ramené à du déjà-dit : il est enfermé dans son accent, sa parlure, ses lieux communs. L'écriture de François Bon (Le Crime de Buzon, Décor ciment, Calvaire des chiens, Un fait divers, Parking, Impatience) produit au contraire un effet d'inouï et dispose à l'écoute d'une parole inédite. Cette stratégie de déplacement instaure un dialogue entre le dire et le dit, au point de corrompre la syntaxe et d'ouvrir d'autres espaces de signification ; le monologue s'ouvre ainsi à une dialogie du fond et de la forme, un entre-deux de la langue : ni mimétique, qui enfermerait le locuteur dans sa représentation figée, ni littéraire, qui l'abstrairait de sa réalité tangible au profit d'une esthétisation sans autre finalité qu'elle-même.
La parole que François Bon distribue à ses figures résonne de rythmes bibliques, d'élans prophétiques, de visions apocalyptiques, toujours tronquées, toujours reprises, dans une sorte de flot torrentueux.
Si factice qu'elle puisse paraître au lecteur, cette phrase n'est pas pure fabrication sans racine. Les brisures du monde contemporain, les rugosités régionales et les déformations patoisantes n'y sont pas les scories d'un mélange hétérogène mais portent une mémoire de la parole. Car la plus littéraire des langues n'est jamais que l'état plus ancien, plus enfoui, d'un parler plus juste : "Découvrir que cette phrase ancienne qui paraît si loin de nous n'était autre que le parler familial, le patois que j'entendais quotidiennement", dit François Bon de sa rencontre avec l'oeuvre rabelaisienne. Aussi n'y a-t-il pas de fossé entre deux états de la langue si éloignés l'un de l'autre : comme l'oeil soudain confronté à une autre lumière ou à une distance nouvelle, le lecteur doit "accommoder" son oreille intérieure."
Écrit par : michèle pambrun | 26/04/2009
Ces définitions, celles de la note, sont intéressantes.
Mais je crois qu'il y a aussi l'investissement dans l'écriture qui est importante.
J'ai toujours tendance à penser que l'écrivain est celui qui consacre tout son temps, toute son activité à l'écriture.
Écrit par : Rosa | 29/04/2009
Écrit par : Feuilly | 30/04/2009
Lectrice aussi, l'alter ego de l'écrivain en queque sorte.
Je lis Alina Reyès, "La jeune fille et la vierge".
solko avait raison : une écriture dégoulinante d'autocentrisme, échevelée et gênante par intimisme impudique.
En revanche un propos spirituel très décapant et fort intéressant.
Écrit par : Rosa | 30/04/2009
Vous plaisantez j'espère ? Sinon il faut revenir sur Terre au plus vite : je vous envoie un paquet de copies en guise de déplanneur ; c'est l'illétrisme quasi intégral qui règne en maitre, chez les jeunes des cités... je ne parle pas de maîtriser des conversations polies, mais la langue française elle-même...
Écrit par : solko | 01/05/2009
Écrit par : Feuilly | 01/05/2009
d'abord, la terre, à mes yeux, a un "t" minuscule.
Ensuite, oui, ce serait une bonne idée de publier, de façon anonyme, et de plusieurs lycées de France, disons les sujets des copies et puis les cours qui vont avec.
Ce que je veux dire c'est que le système scolaire passe son temps à évaluer ce qui s'apprend (ou ne s'apprend pas) ailleurs que dans les lieux censés donner des connaissances.
Les jeunes gens des cités, c'est vrai que je ne suis pas confrontée quotidiennement à leurs écrits.
Je parlais plutôt des compétences que je vois à l'oeuvre quand je les entends, mais ce n'est certainement pas à une déficience qui leur serait propre que j'imputerais leurs manquements à la langue écrite.
Si l'on prenait en considération ce qu'ils savent, sans doute acquerraient-ils plus vite ces biens symboliques que certains trouvent dans le lait de leur nourrice. Personne ne peut apprendre sans une attente positive.
Ne prenons pas d'exemples individuels (le self made man, l'enfant du lumpen prolétariat devenu savant biologiste ou chirurgien réputé ou), ayons la lucidité de regarder le grand nombre.
Écrit par : michèle pambrun | 01/05/2009
Mais ce dont il est question ici, c'est le niveau de langage atteint par les jeunes. Il est plus bas que jamais au départ et il me semble que l'école ne permet plus vraiment de changer cette situation. Elle n'enseigne plus une matière (qu'on pouvait maîtriser en faisant un effort autrefois), elle demande d'emblée des compétences. Or les enfants des milieux défavorisés sont d'office perdants dans ce système qui est plus inégalitaire que jamais.
Écrit par : Feuilly | 01/05/2009
Écrit par : solko | 01/05/2009
Écrit par : solko | 01/05/2009
L'égalité est formelle, l'universalisme républicain aveugle et abstrait.
Oui l'école reproduit l'ordre social et consacre les privilèges. Rien n'a bougé depuis ce constat déjà avec "Les Héritiers" de Bourdieu et Passeron.
Et l'école semble ne pouvoir faire autrement MAIS QU'ON LE DISE.
Écrit par : michèle pambrun | 01/05/2009
La gauche s'est rendue complice de cela (car elle a cru qu'en étant moins exigeante, l'école donnerait des diplômes à tout le monde, y compris donc aux milieux socialement et culturellement défavorisés).
Mais la droite a laissé faire, car ce qui l'intéresse, elle, ce n'est pas d'avoir 66 millions d'universitaires, mais des chauffeurs de camion et des manoeuvres qui ne réfléchissent pas trop. Et puis pourquoi dépenser l'argent des impôts pour éduquer les pauvres, n'est-ce pas? Mieux vaut taxer moins et les laisser où ils sont. Quant aux enfants de ces riches, ils s'en sortiront toujours de toute façon.
Écrit par : Feuilly | 01/05/2009
Écrit par : solko | 01/05/2009
Écrit par : solko | 01/05/2009
Quand je lis le petit bouquin de Pierre Bergounioux : "Aimer la grammaire " (et tout comprendre en 50 pages), je me dis "qu'apprendre l'usage soutenu, réfléchi de la langue française, ouvrir les élèves à la littérature, la nôtre et celle d'autres peuples, proches ou lointains, expliquer le merveilleux système des conjugaisons, les quatre-vingt-quinze variations que tout verbe est susceptible de présenter, qui épuisent toutes les situations, celles de la réalité et celles des rêves, où leur vie va se passer" serait le travail le plus enviable qui soit, si ceux auxquels il s'adresse, ne s'en retournaient pas, passé les cours, à une langue, un français, qui suffit aux exigences de la vie ordinaire (= une vie sans livres).
Combien retrouvent une "vie ouverte et savante" ?
Que pèsent les quatre heures et demie hebdomadaires de français et les trente passées au collège lorsque pendant les cent trente-huit restantes, ils retrouvent le parler plus ou moins sommaire et les tristes divertissements qui envahissent une cervelle qui n'est pas jalousement défendue, soigneusement cultivée?
Combien entendent encore que "rien n'est plus important que les choses qu'on apprend à l'école ?"
Écrit par : michèle pambrun | 01/05/2009
Qui fréquente les musées, les galeries, les concerts, les salles d'art et d'essai...
Les conditions matérielles dans lesquelles vit la majorité de la population sont incompatibles avec la culture générale, c'est-à-dire la familiarité avec les productions les plus élaborées de l'invention intellectuelle, artistique, nationale et internationale, présente et passée.
Écrit par : michèle pambrun | 01/05/2009
Sans parler des écrivains (des vrais ! ) qui n'ont pas passé le bac.
Je suis plutôt d'accord avec Solko : le laminage des plus faibles socialement et culturellement vient de la chute vertigineuse de notre langue. Les jeunes de famille aisées sont quasiment aussi incultes que ceux des banlieues mais ils ont plus facilement recours à ce vernis culturel qui leur permet de s'en sortir du point de vue social.
Je suis en revanche moins pessimiste que Solko, le "salut" viendra peut-être d'où on ne l'attend pas.
Écrit par : Rosa | 01/05/2009
Écrit par : Feuilly | 02/05/2009
Comme dit Pierre Autin-Grenier, écrivain édité mais peu connu, un écrivain, c'est rien.
Ce qui intéresse c'est la célébrité.
Un écrivain célèbre sera reconnu, non parce qu'il écrit, tout le monde s'en fout, mais parce qu'il est célèbre.
Écrit par : Rosa | 04/05/2009
Rien n'est moins sûr. Il ne cherche pas à être célèbre mais à être lu. Bien entendu, il souhaite avoir de nombreux lecteurs, le plus possible, même. Mais je ne pense pas que le côté "vedette" intéresse tous les écrivains. Beaucoup préfèrent la solitude de leur bibliothèque aux séances de signatures.
Le problème, c'est que pour avoir ces lecteurs tant désirés, il faut passer par la célébrité et donc se démener pour devenir un homme public. Et là, en effet, vous avez raison: il ne sera vraiment reconnu que lorsqu'il sera célèbre.
Il faut donc finalement distinguer l'acte d'écrire, qui est une passion, un besoin, du statut social de l'écrivain, qui est une reconnaissance par le public.
Il en va de même dans tous les domaines, finalement: Pavarotti adorait chanter, c'était sa passion (et il avait la chance de faire un métier qui correspondait à cette passion). Mais le public l'appréciait plus parce qu'il était Pavarotti que par la qualité de ses chants. J'exagère un peu, mais il y a de cela. Il devient célèbre par la qualité de son chant certes (mais sans doute pas uniquement) et une fois célèbre le public lui est acquis. A la limite, à ce stade, il chanterait même faux qu’on l’applaudirait encore. Comme par ailleurs il ne chantait pas faux…
Écrit par : Feuilly | 04/05/2009
Les commentaires sont fermés.