29/04/2009
Des romans de Mac Carthy
D’un livre à l’autre, on retrouve toujours les mêmes thèmes chez Mac Carthy. Dans « La trilogie des confins », le héros est jeune : ce n’est même pas un adulte, plutôt un grand adolescent (16-17 ans), mais son comportement dénote une grande maturité. A chaque fois, il quitte le milieu familial, moins à la suite d’un conflit que par une décision bien réfléchie, celle de prendre sa vie en main. Ainsi, dans « Le grand passage », après avoir aidé son père à poser des pièges, afin de capturer le loup qui s’en prend au bétail, il finit par reconduire la louve prise au piège dans son pays d’origine (le Mexique) plutôt que de la tuer. Il part donc seul (sans avertir ses parents) avec cette louve, véritable fauve dont il s’agit de se protéger mais avec lequel un certain respect mutuel s’établit.
Dans « De si jolis chevaux », c’est vers le même Mexique que deux adolescents chevauchent, dans une sorte de fugue à caractère initiatique. Ces « marginaux » ne sont pas des bandits, bien au contraire. On est même étonné de la politesse qui les caractérise quand ils s’adressent à des adultes (« Oui Monsieur, bien sûr Madame », etc.), ce qui ne les empêche pas de se retrouver en prison (pour s’être promené avec une louve ou pour avoir soi-disant volé un cheval alors qu’en réalité ils n’ont fait que tenter de récupérer celui qu’on leur avait pris). Innocents par nature, ils paient ainsi le prix de leur désir de liberté et de leur transgression des règles sociales (la soumission au groupe dans une vie bien réglée).
On notera l’ambiguïté que représente le Mexique. D’un côté, c’est un pays tout différent : on y parle l’espagnol et non l’anglais, les gens y sont plus pauvres, on y fait souvent la révolution (ce qui ne doit pas déplaire au héros, avide de liberté), la nature y est plus sauvage encore et une frontière bien réelle en marque la limite (c’est soit une clôture pour le bétail qu’il faut franchir, soit un fleuve qu’il faut traverser). Cependant, il est clair que de chaque côté de cette frontière on retrouve de grands espaces ou le bétail vit en semi-liberté et la situation n’est donc pas fondamentalement différente, finalement.
Il en va de même pour la langue. Né à la frontière, le héros anglophone s’exprime parfaitement en espagnol (ne pas oublier que ces régions du Sud des Etats-Unis ont été conquises sur le Mexique au milieu du XIX° siècle). Ce bilinguisme fait donc de lui un individu privilégié et le rend capable de s’adapter au-delà de cette frontière qu’il vient de franchir. Une fois de l’autre côté, ce pays qui est un peu le même est pourtant plus beau, plus grand, plus vaste. Il représente surtout l’inconnu et à ce titre il fascine le héros qui va pouvoir y exercer ses talents d’aventurier et y affirmer sa personnalité. Cette marche (ou cette chevauchée) le long du chemin renvoie évidemment à une démarche existentielle (voir aussi le dernier roman de Mac Carthy, qui s’intitule précisément « La Route » et où un homme d’âge mûr et son fils tentent de survivre et de conserver leur humanité dans le monde en ruine qui a succédé à l’Apocalypse).
Le lecteur est surpris par la description qui est donnée de ces régions du Nord du Mexique. On s’attend à y trouver une chaleur écrasante mais même si celle-ci existe durant la journée, on parle beaucoup de la froideur de la nuit dans les montagnes, des cols enneigés qu’il faut franchir ou des éclairs qui illuminent l’horizon (et cela dans les trois recueils de la trilogie).
En effet, il y a toujours un orage qui menace quelque part, comme si l’imminence d’un danger donnait une dimension supplémentaire aux actions du héros.
La solitude est l’essence même de ce dernier et ce n’est pas un hasard s’il évite les villes (qu’il ne fait souvent que traverser) et préfère chevaucher au milieu d’une nature restée sauvage. Il campe à l’extérieur, auprès d’un feu de bivouac qu’il a allumé et contemple dans le lointain de la plaine les lumières des villes qui sont là sans faire partie de son univers.
Cette errance, véritable quête existentielle, lui permet d’aller jusqu’au bout de lui-même. Dépassant sa peur, misant sur son courage, (ici : côtoyer un loup), il se distingue des autres hommes par cette errance perpétuelle. Pourtant, par ses actions (ne pas tuer le loup qu’il a capturé, aider un jeune adolescent, tenter de délivrer une jeune fille innocente, devenue prostituée bien malgré elle, de l’emprise de son souteneur) il fait preuve d’une culture humaniste. Car s’il vit dans la nature, ce n’est pas pour redevenir sauvage. D’ailleurs il impose sa loi humaine à cette nature (dompter un cheval, obliger un loup à le suivre), ce qui le classe bien du côté de la culture (au sens large que donne Lévi-Strauss à ce terme). Il s’agit surtout d’imposer sa volonté personnelle au monde extérieur et là on retrouve, me semble-t-il, une des grandes caractéristiques des romanciers nord-américains. Alors que la littérature française a pu parfois sombrer dans un nombrilisme regrettable ou des considérations théoriques et un peu stériles sur l’écriture, Mac Carthy oppose bien les aspirations intérieures et le monde extérieur, étant entendu qu’il s’agit toujours pour l’individu, autant que faire se peut, de tenter d’imposer sa volonté au monde dans lequel il vit. Il n’y arrive jamais tout à fait, bien entendu et il lui faut faire des concessions.
Ainsi de la jeune fille riche dont il tombe éperdument amoureux dans « De si jolis chevaux ». Mexicaine (pour le héros, elle est donc déjà revêtue de l’aura mystérieuse qu’il prête à ce pays mythique qu’est pour lui le Mexique), elle est inaccessible à la fois géographiquement (elle réside souvent loin de l’exploitation où il travaille) et socialement (il est pauvre et elle est riche et en plus c’est la fille de son patron). Arrêté sur les conseils de ce dernier pour un acte qu’il n’a pas commis (dans le but d’éviter le mariage), il ne devra sa sortie de prison qu’à l’intervention d’une tante de la jeune fille. Malheureusement, si la tante a accordé son aide, c’est contre la promesse qu’a faite la jeune fille de se séparer de son amoureux. Devant respecter tous les deux la parole donnée, les deux amants doivent se séparer la mort dans l’âme (et leur dernière rencontre est d’une force rarement atteinte dans la littérature amoureuse). Dans ce cas, le milieu extérieur (et ici le monde social de l’argent et de la famille) l’a donc emporté sur le désir amoureux de l’individu.
Cette manière de tenter de s’imposer au monde, tout en essuyant des revers qui font grandir et qui font mûrir, me semble être un des traits caractéristiques des romans de Mac Carthy. Livres initiatiques, ses héros aux idées généreuses nous attirent et nous émeuvent. N’est-ce pas le but ultime de la littérature ? Nous faire vivre par procuration en mettant le doigt sur ce qui, dans notre propre existence, compte vraiment ?

Désert du Mexique, image Internet
16:46 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, mac carthy
27/04/2009
La louve
En arrivant à l’eau elle la flaira d’un air méfiant et leva la tête pour le regarder. Elle observa à nouveau les flammes et la silhouette du cheval au-delà du feu. Ses yeux luisaient dans la lumière. Elle baissa le nez pour flairer l’eau. Ses yeux restaient fixés sur lui et ne cessaient pas de brûler et quand elle baissa la tête pour boire, le reflet de ses yeux apparut dans l’eau sombre comme un double de loup qui aurait eu son gîte à l’intérieur de la terre ou attendu en secret jusqu’en d’aussi artificiels trous d’eau pour que la louve puisse toujours y trouver confirmation de son existence et ne soit jamais tout à fait abandonnée dans l’univers.
Cormac Mac Carthy, « Le grand passage », page 92

16:49 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, mac carthy
01/04/2009
Recueillement
"Il se leva et traversa la route et entra dans le cimetière… (…) Il s’arrêta son chapeau à la main sur la terre qui ne portait aucune marque. Cette femme qui avait travaillé pour sa famille pendant cinquante ans. Elle avait gardé sa mère au berceau et elle avait travaillé pour sa famille bien avant que sa mère ne vînt au monde et elle avait connu et gardé les oncles de sa mère les fils Grady qui étaient de vrais sauvages et qui étaient tous morts depuis si longtemps et il restait là avec son chapeau à la main et il l’appela son Abuela et il lui dit adieu en espagnol puis il fit demi-tour et remit son chapeau et tourna son visage humide vers le vent et resta un moment les bras tendus devant lui comme pour reprendre l’équilibre ou bénir la terre là où il était ou peut-être pour ralentir le monde qui fuyait dans sa course folle et semblait n’avoir nul soucis ni des vieux ni des jeunes ni des riches ni des pauvres ni des basanés ni des visages pâles ni de lui ni d’elle. Nul souci de leurs luttes, nul souci de leurs noms. Nul souci des vivants ni des morts."
Cormac Mac Carthy, « De si jolis chevaux »

Source
00:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, mac carthy
28/03/2009
De Mac Carthy et de son style
J’ai cité ici plusieurs extraits de romans de Cormac Mac Carthy et quelques commentateurs se sont étonnés à juste titre de l’accumulation de la conjonction de coordination « et », qui rend souvent la phrase un peu lourde, voire disgracieuse. Généralement, le nouveau lecteur est étonné devant ce procédé inhabituel, qui ne correspond pas à l’idée qu’on se fait d’un style d’écrivain, qu’on imagine forcément limpide. Au vu de la réputation de l’auteur, on en arrive vite à la conclusion qu’il ne peut s’agir d’une faiblesse mais bien plutôt d’un moyen stylistique original et peu commun. Encore faudrait-il comprendre quel est le but recherché par ce procédé.
La conjonction « et » n’est d’ailleurs pas le seul terme qui revient périodiquement chez Mac Carthy. En fait, il emploie souvent les mêmes mots, comme ces « d’accord » qui ponctuent souvent les dialogues. On en trouve déjà dans la « Trilogie des confins », mais surtout dans « la Route », où ce mot renforce encore le style dépouillé. Le fait de se dire d’accord avec quelqu’un exclut toute discussion. Même quand le fils n’obtient pas la réponse qu’il souhaitait ou quand la réponse du père ne le satisfait pas, il finit toujours par dire « d’accord » C’est à mon avis une manière de souligner l’affection qui les lie. Il fait confiance à son père, alors même que le monde qui l’entoure, plein de dangers, suscite surtout des questions. Il y a donc une dimension affective dans l’emploi de ce mot, mais aussi une démarche existentielle. Le fils ne comprend pas, mais il s’en remet à celui qui a de l’expérience. Le père agit de même avec son fils et à chaque fois que le petit lui demande quelque chose qui est en son pouvoir (ne pas l’abandonner par exemple), il dira lui aussi « d’accord ». Il s’ensuit donc une complicité certaine entre les deux protagonistes, qui illustre bien leur union face aux dangers traversés ensemble.
Dans ce roman « La Route », l’auteur ne désigne pas les deux héros par leurs prénoms, mais il utilise les termes «L'homme » et «le petit » pour bien exprimer le rapport adulte/enfant qui les lie, ce qui permet aussi de généraliser leur expérience à toute l’humanité et donc d’impliquer le lecteur (on est tous le père ou l’enfant de quelqu’un).
Je ne connais malheureusement pas la version originale en anglais, il serait intéressant, cependant, d’aller vérifier quels sont exactement les mots employés.
Mais revenons à notre conjonction « et » et à l'absence de virgules qui, comme je l’ai dit moi-même, gênent beaucoup au début. Dès qu’on accepte le fait qu’il ne peut s’agir d’une maladresse mais que c’est voulu, alors, insensiblement, non seulement on s’y fait, mais on finit par attendre ces longues énumérations. A quoi peuvent-elles bien servir ?
A créer une atmosphère, je suppose. Les faits et les actions s’enchaînent un peu comme on verrait un film au ralenti. Sans que je ne m’explique bien pourquoi, il me semble que cela donne une dimension tragique au récit (l’enchaînement inéluctable des événements comme dans la tragédie grecque). Remarquons que souvent il s’agit pourtant d’actions voulues par le héros (il se leva et pris sa couverture et monta sur son cheval et…) Dans ce cas, il y aurait une volonté délibérée d’agir, même contre le destin. Le héros tente de s’affirmer en faisant ce qu’il a décidé qu’il ferait. Mais en même temps on sent à chaque fois comme quelque chose d’inéluctable, comme si, par son geste déterminé, le héros s’en allait au devant d’un danger. Je crois que ce qui est mis en scène avec cette conjonction, c’est le rapport de l’homme au monde, le conflit entre les aspirations intérieures et l’univers extérieur.
Parfois, ces énumérations concernent des descriptions de paysages. Est-ce une manière de nous faire voir par les yeux des protagonistes, comme si on détaillait le décor de gauche à droite ? C’est du genre « Il y avait une rivière et une montagne et plus loin une autre plaine et dans le fond le soleil se couchait… » Là aussi il y a quelque chose d’inéluctable. Mais aussi une dimension poétique. On passe ce paysage en revue, détail après détail, mais en agglutinant nos impressions, jusqu’à en faire une totalité qui forme un tout et qui, peut-être, se donne comme une approche exhaustive de la réalité. L’auteur veut tout décrire, donner du monde une vision globale. Comme il ne peint pas un tableau et ne peut être synthétique, il est obligé, dans une démarche analytique, d’accumuler les détails pour définir le tout. D’où l’importance de la conjonction qui non seulement ajoute chaque fois un élément au précédent mais relie véritablement les éléments entre eux, les soudant en une entité indestructible.
Quelque part, Mac Carthy me fait penser à l’Anabase de Xénophon. Mes souvenirs scolaires sont un peu loin, mais il y avait aussi chez cet auteur une grande utilisation du « et » » :
"Cyrus ensuite fit vingt parasanges en quatre marches et vint sur les bords du fleuve Chalus, dont la largeur est d'un plèthre. Ce fleuve était plein de grands poissons apprivoisés, que les Syriens regardaient comme des dieux, ne souffrant pas qu'on leur fît aucun mal, non plus qu'aux colombes. Les villages près desquels on campait appartenaient à Parysatis et lui avaient été donnés pour son entretien. On fit ensuite trente parasanges en cinq marches, et l'on arriva aux sources du fleuve Daradax, large d'un plèthre. Là était le palais de Bélesis, gouverneur de la Syrie, et un parc très vaste, très beau, et fécond en fruits de toutes les saisons. Cyrus rasa le parc et brûla le palais. » (Livre I)
Ici, cependant, le procédé me semble être différent. C’est plutôt le déroulement de l’action qui est ainsi mis en évidence, leur succession chronologique. Chez Mac Carthy, c’est plus que cela. Certes les actions s’enchaînent aussi, comme dans un film, mais elles sont moins vues dans leur détail singulier que dans leur union finale. Chez Xénophon on cherche à nous faire voir ces actions individuellement, une après l‘autre, ici, on vise surtout un tableau d’ensemble (dont il a bien fallu au préalable dessiner les différents contours).

01:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, mac carthy
24/03/2009
Dialogue (3)
Ils contemplaient le soleil qui se levait au-dessous d’eux. Les chevaux qui broutaient un peu plus loin sur un redan dressèrent la tête et le regardèrent. Rawlins but la dernière gorgée de son café et égoutta sa tasse et plongea sa main dans sa poche de chemise pour chercher son tabac.
Crois-tu qu’il y aura un jour où le soleil va pas se lever ?
Sûr, dit John Grady. Le jour du Jugement dernier.
Quand crois-tu que ce sera ?
N’importe quel jour qu’Il aura choisi.
Le jour du Jugement dernier, dit Rawlins. Tu crois à tout ça ?
J’sais pas. Oui. Sans doute. Et toi ?
Rawlins mit sa cigarette au coin de sa bouche et l’alluma et d’une chiquenaude il jeta l’allumette. J’sais pas, dit-il. Ca se peut.
J’savais bien que t’étais un mécréant, dit Blévins.
Toi tu sais foutrement rien, dit Rawlins. Ferme-la sans en rajouter à ta connerie.
John Grady se leva et traversa le bivouac et souleva sa selle par le pommeau et jeta sa couverture sur son épaule et les regarda. Allons-y, dit-il
Cormac Mac Carthy, « De si jolis chevaux »
14:23 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : littérature, mac carthy, de si jolis chevaux
03/03/2009
Dialogue (2)
Comment saurait-on qu’on est le dernier homme sur terre ? dit-il.
Je ne crois pas qu’on le saurait. On le serait, c’est tout.
Personne ne le saurait.
Ca ne ferait aucune différence. Quand on meurt, c’est comme si tout le monde mourait aussi.
Je suppose que Dieu le saurait. N’est-ce pas ?
Il n’y a pas de Dieu.
Non ?
Il n’y a pas de Dieu et nous sommes ses prophètes.
Cormac Mac carthy, La route
09:26 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature, mac carthy
02/03/2009
Dialogue (1)
Vous souhaitez mourir ?
Non. Mais je pourrais souhaiter être mort. Quand on est en vie on a toujours ça devant soi.
Ou vous pourriez souhaiter n’être jamais né.
Hé bien. Les mendiants ne peuvent pas faire les difficiles.
Vous pensez que ce serait trop demander.
Ce qui est fait est fait. De toute façon ça ne rime à rien de vouloir du luxe par les temps qui courent.
Sans doute que non.
Cormac Mac Carthy, La route
12:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, mac carthy
04/02/2009
Désabusement
- Quand je pense à ce que je voulais quand j’étais gamin et à ce que je veux maintenant, ça fait une fichue différence. Sans doute que ce que je voulais, ce n’était pas ce que je voulais. (…)
- Et qu’est-ce que tu veux maintenant ?
- Je ne sais pas ce que je veux. Je l’ai jamais su. (…) Quand t’es gamin t’as des idées sur ce que tu feras de ta vie, dit Billy. En vieillissant t’es forcé d’en rabattre un peu. A la fin tout ce que tu peux faire, c’est essayer de réduire la casse au minimum. De toute façon le pays n’est plus pareil. Rien de ce qu’il y a dedans non plus. La guerre a tout changé. Je ne crois pas que les gens s’en sont encore aperçus. (…)
- En quoi est-ce que la guerre a changé le pays ?
- Ca l’a changé. Le pays n’est plus pareil. Il ne le sera plus jamais.
Cormac Mac Carthy, Des villes dans la plaine, Seuil Points, pages 87-88
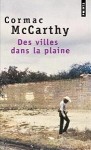
22:09 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, mac carthy







