20/02/2009
Réflexion
"Il regardait la lumière révéler les contours de l’eau stagnante dans les champs de l’autre côté de la route.
- Où on va quand on meurt ? dit-il
- J’en sais rien dit l’homme. On est où en ce moment ?
Le soleil apparut au-dessus de la plaine derrière eux.
(…)
- Je suis né au Mexique. Je n’y suis pas retourné depuis bien des années.
- T’y retournes maintenant ?
- Non.
Billy acquiesça.
L’homme contemplait le jour naissant.
- Au milieu de ma vie, dit-il, j’en ai tracé le parcours sur une carte que j’ai longuement étudiée. J’essayais de voir le dessin qu’elle faisait sur la terre parce que je croyais que si je pouvais voir ce dessin et en connaître la forme alors je saurais mieux comment continuer. Que je saurais mieux ce que devait être mon chemin. Que je pourrais lire dans l’avenir de ma vie.
- Qu’est-ce que cela a donné ?
- Autre chose que ce que j’attendais."
Cormac Mc Carthy, « Des villes dans la plaine ».
09:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature, cormac mc carthy
04/02/2009
Désabusement
- Quand je pense à ce que je voulais quand j’étais gamin et à ce que je veux maintenant, ça fait une fichue différence. Sans doute que ce que je voulais, ce n’était pas ce que je voulais. (…)
- Et qu’est-ce que tu veux maintenant ?
- Je ne sais pas ce que je veux. Je l’ai jamais su. (…) Quand t’es gamin t’as des idées sur ce que tu feras de ta vie, dit Billy. En vieillissant t’es forcé d’en rabattre un peu. A la fin tout ce que tu peux faire, c’est essayer de réduire la casse au minimum. De toute façon le pays n’est plus pareil. Rien de ce qu’il y a dedans non plus. La guerre a tout changé. Je ne crois pas que les gens s’en sont encore aperçus. (…)
- En quoi est-ce que la guerre a changé le pays ?
- Ca l’a changé. Le pays n’est plus pareil. Il ne le sera plus jamais.
Cormac Mac Carthy, Des villes dans la plaine, Seuil Points, pages 87-88
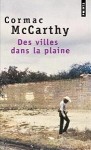
22:09 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, mac carthy
03/02/2009
Camus dans le Magazine des livres
Mon article «Camus ou l’ambiguïté d’une révolte» qui était paru autrefois dans la Presse littéraire est republié dans le dernier numéro du Magazine des livres. Il s’agissait de savoir si Camus n’était pas malgré lui le fruit du colonialisme. Certes il défend les Algériens contre les exactions commises par les Français, mais malgré ce discours très humain il ne remet jamais en question le fait que l’Algérie soit française et il n’envisage même pas son indépendance.
On a l’impression que pour lui il suffirait de prendre quelques mesures de surface (un peu de respect envers les Algériens) pour que l’ère coloniale puisse être justifiable.

16:52 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, camus, colonialisme, alégérie
30/01/2009
Pierre Reverdy (2)
Je reviens encore une fois à Reverdy dans une approche cette fois plus biographique. Il est né à Narbonne en 1889 et a fait ses études à Toulouse. De là il « monte » à Paris avec la ferme intention de se consacrer aux lettres. Il est introduit dans le milieu parisien par un ami peintre, qui lui fait connaître Picasso et il rencontre peu après Apollinaire et Max Jacob. Comme il travaille comme correcteur dans une imprimerie, il en profite pour imprimer ses propres poèmes, lesquels seront illustrés comme il se doit par Picasso. Il collabore également à une revue fondée par Apollinaire.
Ici, il convient donc se poser la question que je me suis souvent posée pour d’autres écrivains ou d’autres peintres. Quand nous relisons la biographie de ces artistes, nous apprenons souvent qu’ils entretenaient, au début de leur carrière, des relations sociales ou même amicales avec les célébrités du moment. Reste la question insoluble (et sans doute sans intérêt) de savoir si ce sont ces relations qui les ont « lancés » ou si c’est leur génie propre qui a fait qu’ils ont été remarqués et compris par leurs aînés à une époque où ils n’avaient encore rien produit (ou alors des choses insignifiantes). Un peu les deux sans doute. Ils avaient tellement conscience de la force créatrice qu’ils avaient en eux qu’ils n’hésitaient pas à monter à la capitale, où leurs conditions de vie étaient souvent précaires. En prenant de tels risques, cependant, ils ont pu se mettre dans les conditions idéales pour promouvoir leur carrière. Si Reverdy s’était replié sur Narbonne après ses études, que serait-il devenu ? Déjà, il n’aurait pas eu l’occasion d’imprimer gratuitement ses premiers poèmes ou alors ceux-ci auraient eu une répercussion beaucoup moins importante. Si Verlaine n’avait pas eu les penchants homosexuels qu’on lui connaît, se serait-il autant intéressé à Rimbaud ? Si Proust n’avait pas eu des relations pour influencer le jury du Goncourt, qui parlerait encore aujourd’hui de la « Recherche » ? Pourtant si nous sommes tous d’accord pour dire que Rimbaud et Proust méritent assurément leur gloire, l’idée ne nous effleure jamais que leur nom aurait pu ne jamais parvenir jusqu’à nous. Il y a donc toujours une part de chance dans toutes les entreprises humaines, y compris dans la consécration des plus grandes œuvres. Le hasard restera toujours un élément important.
Ce fut par exemple le cas pour ces vers d’Ovide qui viennent d’être retraduits par Marie Darrieusecq sous le beau titre de « Tristes Pontiques ». Le poète est en exil dans le Pont Euxin et il n’a plus que l’écriture pour survivre au milieu des « Barbares ». Ces textes sont donc comme une véritable bouteille lancée à la mer et il ne se doutait sans doute pas qu’ils arriveraient jusqu’à nous, pour nous toucher d’une manière incroyable car on n’a jamais vu quelqu’un pour qui l’acte même d’écrire était aussi primordial puisque sa survie mentale et physique en dépendait. Pourtant, en toute logique, jamais ces vers n’auraient dû nous parvenir. Il s’agit de lettres (en vers) adressées à des correspondants différents et qui étaient confiées aux rares bateaux en partance pour Rome. Il fallait déjà que la lettre atteigne son destinataire. Il fallait ensuite que quelqu’un puisse les rassembler toutes afin de reconstituer les deux recueils (« Tristes » et « Pontiques »). Il fallait enfin que ceux-ci traversent les siècles et passent au travers des invasions barbares, des guerres et des incendies. Il fallait encore qu’un éditeur veuille bien remettre les lettres latines à l’honneur. Bref, il fallait beaucoup de conditions…
Bon, tout cela nous éloigne un peu de Reverdy…
En 1917, celui-ci crée la revue Nord-sud. Il ne faut pas voir dans ce nom une allusion à la langue d’oc et à la langue d’oïl, mais simplement à la ligne de métro qui relie Montmartre à Montparnasse. On retrouve dans cette revue des textes de notre poète, bien entendu, mais aussi d’Apollinaire, de Max Jacob et des futurs surréalistes comme Breton, Tzara, Soupault et Aragon.
En 1926, Reverdy se convertit au catholicisme et s’installe avec sa femme à Solesmes, dans une rue près de l’abbaye. Il ne quittera plus ce lieu, sauf pour de brefs voyages à Paris liés à ses publications.
Remarquons qu’il ne fut pas le seul à se convertir de la sorte, au point qu’on peut se demander s’il n’a pas existé chez certains intellectuels une sorte de mode à se tourner vers la religion, peut-être par réaction envers une société qui se laïcisait radicalement. Ainsi, on pourrait citer Claudel, Péguy, Paul Bourget, Jacques Copeau, Jacques et Isabelle Rivière, Max Jacob et jean Cocteau.
"En allant à Dieu, on perd toute illusion sur soi pour gagner une vue sur son être réel", dira Reverdy.
Maintenant, on comprend, en lisant ses poèmes, que Reverdy ne devait pas se sentir à l’aise dans un monde qu’il trouve froid et distant. Rien d ‘étonnant donc, à ce qu’il ait cherché une voie qui le satisfît dans le domaine spirituel. Mais alors ses poèmes devraient être imprégnés de cette confiance retrouvée et éclairés de cet amour divin, or personnellement je n’y vois qu’une distance par rapport à un monde froid et incompréhensible. Ou alors en écrivant il n’a fait que démontrer à quel point il était en dehors de ce monde terrestre, pour lui incompréhensible et sa recherche personnelle et son cheminement auraient été tout intérieurs et tournés vers la foi et l’apaisement. En tout cas cela n’apparaît pas de manière évidente dans ses poèmes, mais je ne suis certainement pas un spécialiste de ces questions de foi et laisse les commentateurs plus compétents que moi sur ce sujet donner leur avis éclairé.
Il reste que l’abbaye de Solesmes est un haut lieu du chant grégorien et que c’est à ce titre que je la connais. Rien de plus envoûtant que ces chants monotones et gutturaux qui, sur le plan musical, parviennent à créer des équilibres et des architectures sonores époustouflants. Recherche d’harmonie donc, à partir du chaos, recherche du bonheur à partir du néant. Peut-être était-ce cela que Reverdy aimait à Solesmes ? Une manière pour l’être intérieur d’exprimer sa joie devant la création tout entière. Ou mieux : une manière de créer la joie en permettant à l’individu de dépasser l’étroitesse de son moi et de sa condition physique pour atteindre à une harmonie beaucoup plus vaste et pour ainsi dire cosmique.
Dommage que ce que je ressens en écoutant du grégorien, je n’en trouve pas vraiment la trace dans les poèmes de Reverdy. Il y a chez lui davantage d’angoisse que de sérénité et cette angoisse n’est pas exprimée humainement (avec des cris de désespoir ou de révolte par exemple) mais simplement retranscrite comme un constat. Un constat glacial qui fait froid dans le dos.

Abbaye de Solesmes
23:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, reverdy
28/01/2009
Pierre Reverdy
J’ai lu l’autre jour le poète Pierre Reverdy, que je n’avais jamais lu. Il s’agissait du recueil « Main d’œuvre », qui reprend des textes de 1913 à 1949 et qui est publié dans la collection Poésie-Gallimard. Ce livre fait tout de même 557 pages, ce qui devrait suffire pour se donner une idée de la production de l’auteur.
Et bien, moi qui adore la poésie, je dois avouer que pour une fois je ne suis pas parvenu à me trouver véritablement en harmonie avec l’auteur. Ce n’est pas que je ne comprenne pas ce qu’il dit, mais je n’arrive pas vraiment à partager son point de vue, comme s’il avait une sensibilité différente de la mienne.
En fait, ce qui m’effraie, c’est un peu cette absence de sensibilité. C’est comme si l’auteur contemplait le monde de l’extérieur, sans jamais parvenir à trouver un point de contact entre lui et ce monde. Il semble y avoir toujours une distance entre son être intime et la réalité qu’il décrit, comme si celle-ci était inaccessible. Souvent les écrivains parlent de la difficulté à retranscrire par l’écriture ce qu’ils ont vu ou ce qu’ils ont éprouvé. Ici, ce n’est pas vraiment cela. C’est plutôt comme si le monde était situé à distance et ne se laissait jamais saisir. Le poète donne un peu l’impression d’être un fantôme qui se promènerait dans un univers étrange, incompréhensible et qui ne le concernerait en rien.
Un poète comme Jaccottet, que j’adore, parle aussi de la difficulté à saisir le réel, mais il parvient tout de même à en percevoir une partie et même à nous relater son expérience par la magie de mots. Jaccottet semble nous dire qu’il n’a pas pu exprimer tout ce qu’il avait ressenti et qu’il n’a pas pu percevoir tout ce que le réel contenait comme nuances, mais ce qu’il nous donne à voir est déjà beaucoup. Ici, avec Reverdy, j’ai l’impression inverse, comme si le poète avait fait le constat une fois pour toutes que le monde extérieur lui était étranger et qu’il répétait ce message à l’infini, dans des centaines de poèmes qui sont tous finalement un peu les mêmes. Si on voulait s’exprimer autrement, on pourrait dire que Reverdy a compris que le monde n’était fait que de matière inerte et froide, sans rapport aucun avec notre sensibilité d’homme (et de femme, bien entendu) et qu’il était vain d’en attendre quelque chose. Sa poésie se veut donc un constat de cette froideur et de cette indifférence du milieu dans lequel nous vivons.
Mais il va plus loin, car les êtres humains qu’ils croisent sur sa route semblent eux aussi appartenir à ce même monde extérieur et incompréhensible, ce qui, j’avoue, me met assez mal à l’aise. Il n’y a pour ainsi dire aucun personnage dans ses poèmes ou alors ce sont de simples ombres qui passent ou bien encore une simple tête penchée à une fenêtre (un peu comme un objet détaché du corps).
On retrouve par exemple des formules comme :
« Quelqu’un vient »
« Ceux qui sont autour n’ont encore rien dit »
« Il y a toujours quelqu’un qui regarde »
« En haut une tête se penche »
Donc, ces êtres humains ressemblent finalement plus à des objets qu’à des êtres faits de chair et de sentiments. Le poète pourrait s’effrayer de sa solitude, perdu qu’il est au milieu d’un monde aussi hostile, mais non, il se contente de dire cette réalité d’un ton neutre et détaché. C’est cela, je crois, qui ne me plait pas trop chez lui. On aurait envie de le voir hurler ou même pleurer devant sa solitude mais il reste impassible, voulant sans doute, par cette attitude, dire précisément tout son malheur, mais donnant du même coup une impression de froideur à ses poèmes.
On croise des femmes, pourtant dans ses écrits. Enfin quelques-unes, pas beaucoup. Mais, il n’y a pas de sentiment non plus quand Reverdy évoque leur existence. Il s’agit chaque fois d’amours qui auraient pu exister mais qui ne se sont pas concrétisées ou bien d’amours qui sont déjà terminées. Autrement dit, une nouvelle fois, ces femmes se retrouvent à la même place que les objets et la matière : mises à distance, désormais inaccessibles, elles n’appartiennent pas au monde du poète. A vrai dire on en est peiné pour lui.
Je le rejoins plus dans les quelques poèmes où il exprime enfin autre chose que le vide qui l’entoure et où il semble enfin prendre conscience de sa solitude (mais ils sont rares, ces poèmes) :
« je suis seul sur la lèvre tremblante du rivage
Seul sur le roc glissant des fièvres de la mort."
Mais s’il revendique un instant le fait qu’il soit vivant, c’est pour nous faire comprendre que tout cela est éphémère puisque la mort est proche. Finalement, être de passage dans un monde minéral indifférent, il va bientôt lui-même atteindre l’immortalité privée de sens des pierres.
En fait, en exagérant un peu, on irait presque jusqu’à dire qu’il éprouve du dégoût pour ce qui l’entoure, que ce soit le ciel et les étoiles ou encore les champs et les forêts (alors que chez Jaccottet, les mêmes réalités semblaient détenir un secret qu’il nous appartenait de découvrir).
Pour illustrer mes propos, voici un poème de Reverdy, dans lequel on perçoit bien le monde glacé dans lequel il vit :
Poème
La neige tombe
Et le ciel gris
Sur ma tête où le toit est pris
La nuit
Où ira l'ombre qui me suit
À qui est-elle
Une étoile ou une hirondelle
Au coin de la fenêtre
La lune
Et une femme brune
C'est là
Quelqu'un passe et ne me voit pas
Je regarde tourner la grille
Et le feu presque éteint qui brille
Pour moi seul
Mais là où je m'en vais il fait un froid mortel.
Reverdy, Poème, in Sources du vent, 1929, repris dans « Main d’œuvre », page 134

16:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : littérature, reverdy, "main d'oeuvre"
28/12/2008
Ovide et la création de l'homme
Création de l'homme (I, 76-88)
« Un être plus noble et plus intelligent, fait pour dominer sur tous les autres, manquait encore à ce grand ouvrage. L'homme naquit : et soit que l'architecte suprême l'eût animé d'un souffle divin, soit que la terre conservât encore, dans son sein, quelques-unes des plus pures parties de l'éther dont elle venait d'être séparée, et que le fils de Japet, détrempant cette semence féconde, en eût formé l'homme à l'image des dieux, arbitres de l'univers; l'homme, distingué des autres animaux dont la tête est inclinée vers la terre, put contempler les astres et fixer ses regards sublimes dans les cieux. Ainsi la matière, auparavant informe et stérile, prit la figure de l'homme, jusqu'alors inconnue à l'univers. »
Ovide, Les métamorphoses, I
On retrouve dans ce texte une conception de la création de l’homme proche de celle de la Genèse. L’homme naît comme cela, d’un coup. Soit il est sorti du néant par la volonté divine (« l'architecte suprême » dit le texte) soit il est issu directement de la matière (ce qu’on ne trouve pas dans la version biblique. Encore que : c’est en soufflant sur de la terre que Dieu crée l’homme). Il est, nous dit Ovide, « formé à l’image des dieux », ce qui signifie qu’il se distingue des animaux par essence. La preuve, c’est qu’il n’incline pas la tête vers le sol mais qu’il fixe les cieux.
C’est amusant de voir comment l’homme se voit lui-même comme un être d’exception. Si les loups ou les lions savaient parler et écrire, il y a fort à parier qu’ils diraient la même chose de leur propre espèce, mais passons.
Voulu par les Dieux, façonné à son image, l’homme, en levant le regard vers le ciel, peut contempler la divinité pour ainsi dire d’égal à égal. Cette conviction qu’un destin exceptionnel lui a été accordé a légitimé sa domination sur les animaux et sur la nature. Se croyant élu, tout lui était permis.
On voit aujourd’hui les limites de cette conception anthropocentrique de l’univers, avec notre monde pollué, notre climat déréglé et toutes les espèces menacées…
Et si on cesse un instant de regarder le ciel et qu’on se penche vers cette partie du monde où toutes ces croyances ont pris naissance, en l’occurrence le Moyen-Orient et plus précisément la Palestine, on se dit que c’est parce qu’il s’est cru l’élu de Dieu que l’homme est devenu intransigeant, y compris envers ses semblables.
Ces massacres perpétuels où les tirs de roquettes entraînent des bombardements sanguinaires, lesquels à leur tour suscitent d’autres massacres, ont de quoi nous attrister et nous révolter. Se croyant choisi par Dieu, chaque camp voue une haine féroce à l’autre et s’apprête à l’exterminer. L’un a les moyens techniques de le faire, l’autre pas. Le premier empiète sans arrêt sur le territoire du second, qui recule en se défendant comme il peut. Partout ce ne sont que combats, guerres, attentats et sang versé.
« Homo homini lupus est » disait justement un dicton latin. L’homme est un loup pour l’homme. Se croyant l’élue des dieux, chaque race méprise l’autre et s’approprie une terre qu’elle estime lui revenir de droit divin. Comme ceux qui sont en face pensent à peu près la même chose, cela débouche sur des massacres sans fin et seule la supériorité militaire permet à un des protagonistes de faire valoir ce qu’il estime être son bon droit. Les hommes qui s’affrontent ainsi en des combats fratricides seraient-il donc les descendants de ces géants dont parle Ovide, ces mortels qui par leur audace osèrent s’en prendre à la divinité elle-même avant que d’être vaincus par Jupiter et de donner une race violente et assoiffée de sang ?
Les Géants (I, 151-162)
"Le ciel ne fut pas plus que la terre à l'abri des noirs attentats des mortels : on raconte que les Géants osèrent déclarer la guerre aux dieux. Ils élevèrent jusqu'aux astres les montagnes entassées. Mais le puissant Jupiter frappa, brisa l'Olympe de sa foudre; et, renversant Ossa sur Pélion, il ensevelit, sous ces masses écroulées, les corps effroyables de ses ennemis. On dit encore que la terre, fumante de leur sang, anima ce qui en restait dans ses flancs, pour ne pas voir s'éteindre cette race cruelle. De nouveaux hommes furent formés : peuple impie, qui continua de mépriser les dieux, fut altéré de meurtre, emporté par la violence, et bien digne de sa sanglante origine."

20:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, ovide
25/12/2008
Réflexion sur la littérature (3)
"Agir, c’est ce que l’écrivain voudrait par-dessus tout. Agir, plutôt que témoigner. Ecrire, imaginer, rêver, pour que ses mots, ses inventions et ses rêves interviennent dans la réalité, changent les esprits et les cœurs, ouvrent un monde meilleur. Et cependant, à cet instant même, une voix lui souffle que cela ne se pourra pas, que les mots sont des mots que le vent de la société emporte, que les rêves ne sont que des chimères. De quel droit se vouloir meilleur ? Est-ce vraiment à l’écrivain de chercher des issues ? N’est-il pas dans la position du garde champêtre dans la pièce du Knock ou Le Triomphe de la médecine, qui voudrait empêcher un tremblement de terre ? Comment l’écrivain pourrait-il agir, alors qu’il ne sait que se souvenir ?
La solitude sera son lot. Elle l’a toujours été. Enfant, il était cet être fragile, inquiet, réceptif excessivement, cette fille que décrit Colette, qui ne peut que regarder ses parents se déchirer, ses grands yeux noirs agrandis par une sorte d’attention douloureuse. La solitude est aimante aux écrivains, c’est dans sa compagnie qu’ils trouvent l’essence du bonheur. C’est un bonheur contradictoire, mélange de douleur et de délectation, un triomphe derisoire, un mal sourd et omniprésent, à la manière d’une petite musique obsédante. L’écrivain est l’être qui cultive le mieux cette plante vénéneuse et nécessaire, qui ne croît que sur le sol de sa propre incapacité. Il voulait parler pour tous, pour tous les temps : le voilà, la voici dans sa chambre, devant le miroir trop blanc de la page vide, sous l’abat-jour qui distille une lumière secrète. Devant l’écran trop vif de son ordinateur, à écouter le bruit de ses doigts qui clic-claquent sur les touches. C’est cela, sa forêt. L’écrivain en connaît trop bien chaque sente. Si parfois quelque chose s’en échappe, comme un oiseau levé par un chien à l’aube, c’est sous son regard éberlué – c’était au hasard, c’était malgré lui, malgré elle."
M.G. Le Clézio : Dans la forêt des paradoxes. Extrait du discours…
Nous retrouvons donc ici le problème, déjà évoqué, du rapport entre littérature et action. Puis Le Clézio continue en parlant de la solitude, qui semble souvent liée à l’écriture. Est-ce parce qu’on est solitaire de nature qu’on a tendance à écrire (dans une sorte de tentative désespérée pour parvenir à se faire entendre quand même) ou bien est-ce le fait d’écrire qui en lui-même nécessite un repli temporaire sur soi ? Un peu les deux, sans doute, car d’une part tout auteur, même amateur, écrit pour être lu et pour exprimer ce qu’il est et d’autre part son travail d’observation nécessite une distance par rapport à la société des hommes. Il observe les autres vivre plus qu’il ne vit lui-même (d’où la nécessité impérieuse d’écrire qu’il ressent, pour parvenir enfin à une réalité autre).
Ce qui me plait, dans le texte ci-dessus, c’est que cette solitude est bien comprise comme contradictoire, puisqu’elle est à la fois douleur et délectation. C’est un peu ce que j’avais dit ici, moi qui ne suis même pas écrivain. Certains lecteurs avaient pu voir de la douleur dans ma démarche. Ils ont en partie raison, mais ce serait oublier toute la jouissance qu’il y a à écrire et à entendre dans le silence de la nuit le petit bruit régulier du clavier.
Feuilly, Pyrénées, juillet 2008
01:58 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, le clézio
20/12/2008
Réflexion sur la littérature (2)
« Ayant assimilé le système de communisme primordial que pratiquent les Amérindiens, ainsi que leur profond dégoût pour l’autorité, et leur tendance à une anarchie naturelle, je pouvais imaginer que l’art, en tant qu’expression individuelle, ne pouvait avoir cours dans la forêt. D’ailleurs, rien chez ces gens qui pût ressembler à ce que l’on appelle l’art dans notre société de consommation. Au lieu de tableaux, les hommes et les femmes peignent leur corps, et répugnent de façon générale à construire rien de durable. Puis j’ai eu accès aux mythes. Lorsqu’on parle de mythes, dans notre monde de livres écrits, l’on semble parler de quelque chose de très lointain, soit dans le temps, soit dans l’espace. Je croyais moi aussi à cette distance. Et voilà que les mythes venaient à moi, régulièrement, presque chaque nuit. Près d’un feu de bois construit sur le foyer à trois pierres dans les maisons, dans le ballet des moustiques et des papillons de nuit, la voix des conteurs et des conteuses mettait en mouvement ces histoires, ces légendes, ces récits, comme s’ils parlaient de la réalité quotidienne. »
M.G. Le Clézio : Dans la forêt des paradoxes. Extrait du discours…
Le roman est mort, la littérature est morte, entend-on tous les jours. Gros mensonge, évidemment, la littérature existera toujours. Et là, dans cette forêt profonde et primitive, dès que deux hommes s’assoient au coin du feu, elle apparaît aussitôt, la littérature, sous la forme d’histoires qu’on se raconte ou qu’on invente, sous la forme de mythes fantastiques qui parlent de la création du monde. L’homme est fait pour conter, semble-t-il. Notre propre passion des livres ne remonte-t-elle pas à ces histoires merveilleuses qu’on nous lisait quand nous étions enfants ? Aux origines de notre vie comme aux origines de l’humanité, nous retrouvons les contes, issus de la grande tradition orale. La littérature existait donc avant l’écriture elle-même. Elle est tentative d’explication du monde ambiant, monde qu’elle rend par ailleurs compréhensible par l’interprétation qu’elle en donne.

23:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (8)
17/12/2008
Réflexion sur la littérature
"Mais les livres qui m’ont le plus marqué, ce sont les collections de récits de voyage, pour la plupart consacrés à l’Inde, à l’Afrique et aux îles Masacareignes, ainsi que les grands textes d’exploration, de Dumont d’Urville ou de l’Abbé Rochon, de Bougainville, de Cook, et bien sûr le Livre des Merveilles de Marco Polo. Dans la vie médiocre d’une petite bourgade de province endormie au soleil, après les années de liberté en Afrique, ces livres m’ont donné le goût de l’aventure, ils m’ont permis de pressentir la grandeur du monde réel, de l’explorer par l’instinct et par les sens plutôt que par les connaissances. D’une certaine façon ils m’ont permis de ressentir très tôt la nature contradictoire de la vie d’enfant, qui garde un refuge où il peut oublier la violence et la compétition, et prendre son plaisir à regarder la vie extérieure par le carré de sa fenêtre."
M.G. Le Clézio : Dans la forêt des paradoxes. Extrait du discours prononcé le 7 décembre 2008 lors de la remise du prix Nobel.
On retrouve ici le thème du voyage, de l’ailleurs, si important chez les écrivains, sans qu’on sache si ceux-ci se sont mis à écrire pour atteindre des pays sans doute imaginaires ou au contraire si, comme Le Clézio, ils se sont mis à voyager pour pouvoir visiter les contrées qu’ils avaient d’abord imaginées. Un peu les deux sans doute, car dans tous les cas cet «ailleurs» appartient au merveilleux et donne à la vie tout son sens. Dans l’extrait ci-dessus, on opposera cet «ailleurs» enchanté et prometteur à «la vie médiocre d’une petite bourgade de province endormie au soleil.»
Notons aussi l’importance d’être en dehors de la vie, ce désir d’en oublier «la violence et la compétition» pour mieux pouvoir la regarder par «le carré de sa fenêtre.» L’écrivain est donc en- dehors de l’arène et, de son observatoire, il contemple le monde ou, si vous préférez, il est au-dedans de lui et il observe ce monde qui pour lui représente l’altérité. Ce qui est important, c’est donc cette notion de regard porté sur les hommes et les choses, cette distance critique dans laquelle s’engouffre toute la sensibilité de l’écrivain.

11:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature
15/12/2008
De la littérature comme moyen de survie (2).
« Pourquoi écrit-on ? J’imagine que chacun a sa réponse à cette simple question. Il y a les prédispositions, le milieu, les circonstances. Les incapacités aussi. Si l’on écrit, cela veut dire que l’on n’agit pas. Que l’on se sent en difficulté devant la réalité, que l’on choisit un autre moyen de réaction, une autre façon de communiquer, une distance, un temps de réflexion.»
J.M.G. Le Clézio : Dans la forêt des paradoxes. Début du discours prononcé le 7 décembre 2008 lors de la remise du prix Nobel. «
"Si l’on écrit, cela veut dire qu’on n’agit pas» nous dit le nouveau Nobel. En effet et c’est le genre de question que l’on s’est déjà posée ici même, sans vraiment trouver de solution satisfaisante.
La réponse, cependant est peut-être dans ces mots «distance» et «temps de réflexion». L’écrivain serait toujours ailleurs, en retrait, en train d’observer et non en train de vivre. Il y a entre lui et l’existence une distance critique. Il regarde, il observe, puis il couche ses impressions sur le papier, ce qui lui permet de «dire» ce qu’il a ressenti face aux événements observés. C’est donc son point de vue subjectif qui l’emporte et non les faits eux-mêmes, son intériorité et non la vie qui passe. Ecrire serait donc par définition se raconter soi-même, dans une sorte d’autobiographie mentale en quelque sorte. Dès lors, c’est aussi affirmer la suprématie de sa propre sensibilité sur le monde ambiant et donc tenter de dire que l’on existe. Ecrire, ce serait donc une course de vitesse avec la mort, une course que l’individu tente désespérément de gagner, même s’il sait qu’il n’y parviendra pas. D’où sans doute ce sentiment du tragique si souvent présent dans la littérature.
14:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature, écriture, le clézio
13/12/2008
De la littérature considérée comme un voyage
Un lecteur a fait remarquer que plusieurs textes récents faisaient allusion aux voyages. C’est vrai. Pourtant à y réfléchir, il ne s’agit pas de voyages géographiques, mais plutôt poétiques et existentiels. Nous serions donc tous plus ou moins à la recherche d’un ailleurs imaginaire, autrement dit d’un monde meilleur et différent.
La littérature n’a-t-elle pas justement pour fonction de dire cette aspiration à un au-delà (sans qu’il n’y ait rien de mystique dans ce terme) ? L’individu veut s’affirmer, être pleinement lui-même, mais la réalité ne lui en donne pas toujours la possibilité. Quelques-uns y parviennent, mais ce sont des êtres d’exception. Encore que ces personnages célèbres dont l’Histoire a conservé le nom ne se sont bien souvent affirmés que dans un seul domaine et que leur personnalité et leurs aspirations profondes ne devaient sans doute pas se résumer uniquement à ce domaine.
Mais parlons des autres, c’est-à-dire tout de même des 99,99 pour cent de la population. Il y a toujours un fossé, un hiatus, entre leur for intérieur et la réalité dans laquelle ils doivent bien vivre. Certains se résignent, d’autres se révoltent, d’autres encore s’échappent par le rêve. C’est un peu ce que nous faisons tous ici en allant butiner de blogue en blogue. C’est une parenthèse dans notre journée, de petites coupures qui permettent d’aller respirer un peu d’air frais ailleurs. On va lire les pensées des autres, écouter leurs aspirations, les regarder vivre intérieurement, finalement.
D’où ces textes sur les voyages («la nef des fous», «les rêves d’Amérique ») ou sur leur inutilité (« l’antivoyage »). C’est d’un ailleurs de la conscience dont il s’agit. D’un lieu non géographique et atemporel où nous aurions enfin l’impression d’être pleinement nous-mêmes.
Utopie, certes. Les plus habiles parviennent à s’accommoder du monde ambiant en se construisant un petit nid douillet qui correspond plus ou moins à leurs désirs et pour le reste ils se résignent, sachant bien qu’ils ne changeront pas le monde et encore moins les hommes et leur folie.
D’autres, plus intransigeants (ou moins habiles) crieront leur désespoir à travers l’art. Qu’on pense aux toiles de Van Gogh ou au « Cri » de Munch.
Munch qui n’a pas peint que le « cri » mais aussi «la madone », ce qui fait resurgir la problématique déjà évoquée dans les commentaires antérieurs au sujet de la présence de la femme dans ce monde imaginaire. Encore faudrait-il voir si de leur côté les femmes artistes parlent des hommes dans leurs oeuvres…


01:49 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, voyages
26/11/2008
Stéfan Zweig "Amerigo" (2)
Dans la suite de son livre, Zweig démontre comment une suite de méprises a finalement imposé Vespucci au point de le faire passer pour celui qui avait découvert l’Amérique.
Il y avait eu ce « Mundus novus » où effectivement il disait bien qu’un nouveau continent avait été découvert. Mais voilà que quelques années plus tard paraît à Florence un mince cahier de seize feuilles en langue italienne, signé Amerigo Vespucci. Celui-ci, parle des quatre voyages qu’il avait réalisés (en fait comme marchand, ni comme capitaine ni comme explorateur. Il était présent sur ces bateaux, sans plus).
Ensuite, un éditeur italien, comprenant que la mode est à ce genre d’ouvrage, réunit en une seule édition le « Mundus novus » et les « quatre voyages » et il intitule ce livre « Nouveau monde et terres récemment découvertes par Vespucci ». Ce titre est ambigu. Certes il fait allusion au fait que Vespucci pense qu’on a découvert un nouveau continent, mais on peut croire, en le lisant rapidement, que c’est Vespucci lui-même qui l’a découvert. Dans l’imaginaire des foules, son nom commence à concurrencer celui de Colomb.
Plus tard encore, un autre éditeur, français celui-là (de Saint-Dié) décide de mettre à jour la « Cosmographia » de Ptolémée, en ajoutant sur les anciennes cartes les terres nouvellement découvertes. Son but est louable et logique. Le problème, c’est que dans cet ouvrage on ne cite même plus le nom de Colomb. Par contre, quand il parle du futur Brésil (où Vespucci est bien allé), on trouve cette phrase fatale : «… que l’on pourrait appeler désormais terre d’Americus ou America, puisque c’est Americus qui l’a découverte. » Et, puisque les autres continents portent des noms de femmes, il suggère le nom d’Amérique. Sur sa carte, il indique le nom « Amerique » à l’emplacement du Brésil. Quelques années plus tard, quand les contours des nouvelles terres sont mieux définis, on retrouve évidemment ce mot d’Amérique pour désigner le continent tout entier.
Ainsi donc, c’est tout à fait à l’insu de Vespucci que son nom fut mis en avant. Notons que pendant ce temps-là, Colomb continuait à affirmer qu’il avait découvert les Indes, mais plus personne ne le croyait. Lui qui avait été si célèbre, c’était maintenant un homme fini, disqualifié, répudié presque par le roi d’Espagne. Les marchands avaient perdu de l’argent à cause de ses promesses non tenues, les érudits étaient lassés de ses aberrations géographiques. Dans l’imaginaire des peuples, le grand homme c’est maintenant Vespucci. C’est lui qui allait remplacer le vrai découvreur.
Maintenant, peut-être était-ce justice que Vespucci l’emportât ainsi. Certes, il n’avait rien découvert personnellement, mais finalement il n’avait pas non plus massacré les Indiens. Il n’avait pas volé leur or. Il n’avait détruit aucun royaume. Au contraire, il avait observé ces peuples sauvages en humaniste, décrivant leurs coutumes sans les blâmer.
Le premier à montrer quelques réserves sur le rôle réel de Vespucci, c’est Michel Servet (avant d’être traîné sur le bûcher par Calvin). Puis ce sera le grand Las Casas lui-même, qui s’offusquera de cette gloire usurpée et qui dira qu’il est impossible que Vespucci ait découvert le Brésil deux ans avant que Colomb ne pose le pied sur le sol américain. Il a raison, évidemment. Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il y a eu confusion au sujet de la date du premier voyage. Erreur malheureuse des éditeurs ? Probablement. Volonté délibérée de Vespucci ? Il ne faut pas l’exclure non plus. Ce qui est certain, c’est que pendant des siècles les spécialistes vont se déchirer au sujet de l’intention réelle du commerçant-navigateur. Intrigué par cette affaire, Zweig, qui vient de débarquer au Brésil devant la montée du nazisme, décide de se pencher sur le dossier. Notons qu’affecté par ce qui se passait en Europe, il se suicidera avec son épouse en février 1942, près de Rio de Janeiro, sur cette terre à laquelle Vespucci donna son nom.

Image Internet ("Grandquebec.com")
10:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, zweig, "amerigo", vespucci
24/11/2008
Stefan Zweig "Amerigo"
Bon, revenons à notre devinette de l’autre jour. J’avais promis d’apporter des précisions sur Vespucci. En fait, je n’ai jamais lu une ligne de lui (son oeuvre est pourtant courte) et c’est via Stefan Zweig que je l’ai découvert. Zweig, que l’on connaît comme romancier, se fait historien dans son livre « Amerigo » et il s’y interroge sur le mystère qui entoure Vespucci. Cet homme, qui n’a écrit que trente-deux pages dans sa vie et qui n’était ni un romancier ni un explorateur, est parvenu à évincer Christophe Colomb de son vivant et à imposer son prénom, Amerigo, qui a été donné au nouveau continent que l’on venait de découvrir (l’Amérique).
Certains ont vu en lui un infâme imposteur, un usurpateur de premier plan. D’autres ont pris sa défense, expliquant qu’il n’avait rien fait pour s’approprier cette gloire au détriment de Colomb. Pendant plus de quatre siècles des spécialistes se sont battus pour défendre l’une ou l’autre de ces théories, sans que rien de décisif ne ressortît vraiment de leurs travaux. Zweig, lui, essaie dans ce livre de reconstituer l’enchevêtrement de circonstances, des hasards et des malentendus qui sont à l’origine de cette erreur. Pour y parvenir, il nous place d’abord dans le contexte de l’époque et nous invite à voir le monde avec les yeux d’un homme du XV° siècle. Colomb était persuadé d’avoir découvert les Indes (et il s’obstinera dans cette idée jusqu’à sa mort). Cela signifiait aussi que la terre n’était pas aussi grande qu’on l’avait cru puisqu’il suffisait de naviguer un peu vers l’Ouest pour se retrouver en Asie. Mais voilà qu’en 1503, se mettent à circuler, à Paris, à Florence, quelques feuilles imprimées, quatre ou six en tout, intitulées « Mundus novus » d’un certain Albericus (sic) Vespucius. Il s’agit d’un rapport en latin que celui-ci adresse à Petrus Franciscus de Medici au sujet d’un voyage qu’il aurait fait dans des terres inconnues sur l’ordre du roi du Portugal. Ces rapports commerciaux étaient fréquents à l’époque et permettaient aux établissements financiers de se renseigner sur d’éventuels investissements rentables. On se les volait d’une firme à l’autre et quand un de ces feuillets tombait dans les mains d’un éditeur qui avait le sens des affaires (déjà à l’époque), il le publiait aussitôt.
Mais qu’y avait-il de si extraordinaire dans le rapport de Vespucci ? D’abord on dit qu’il est traduit de l’italien en latin, ce qui intrigue déjà. Ensuite, ce Vespucci est « le premier de tous les navigateurs qui sache raconter et de manière amusante. » Les autres, ce sont des marins analphabètes, des soldats, éventuellement des juristes au style épais. Ici, le narrateur raconte avec sincérité les difficultés du voyage, comment ils ont failli périr dans leur bateau rongé des vers alors qu’aucune terre n’était en vue. Et puis finalement était apparue cette terre complètement merveilleuse : le paradis sur terre. On y trouve une nourriture abondante, les fruits poussent tout seuls, les animaux y sont extraordinaires et même les femmes se donnent sans penser à mal.
Or il se fait que les pères de l’Eglise avaient autrefois émis l’hypothèse que le paradis terrestre existerait toujours quelque part en un lieu éloigné et inaccessible. Et voilà ce Vespucius qui dit finalement qu’il en revient. Avouez qu’il y a de quoi lui prêter attention. Dans cette époque troublée où les guerres font rage, la découverte de ces sauvages du bout du monde qui vivent heureux, sans contrainte, sans morale, sans argent, fait fantasmer. Ils représentent le rêve de l’humanité, le retour aux sources, le temps d’avant la faute d’Adam.
Et ce n’est pas tout. Il n’y a pas que le contenu de la lettre qui est extraordinaire, il y aussi le titre : « mundus novus », un nouveau monde. « deux mots, quatre syllabes qui ont suscité une révolution sans précédent dans la manière de considérer l’univers » nous dit Zweig. Alors que Colomb assure qu’il est arrivé en Inde (mais il n’a pas ramené d’épices et n’a pas vu le grand Khan de Chine) Vespucci assure lui que c’est un nouveau continent qu’on a découvert là. Bouleversement dans la conception du monde, certes, mais aussi dans la conception de l’homme. Les anciens avaient affirmé qu’au-delà de Gibraltar s’étendait une mer infranchissable et voilà que cette mer, les hommes du quinzième siècle l’avaient traversée et avaient découvert des terres dont ces anciens n’avaient même pas imaginé l’existence. Epistémologiquement parlant, c’est l’image même que l’homme porte sur lui-même qui se modifie avec cette découverte. A partir de ce moment, c’en sera définitivement fini de s’en référer aux anciens.
Tout ceci explique donc pourquoi Vespucci prit soudain une importance considérable aux yeux de ses contemporains. Pourtant, probablement ne se doute-t-il pas lui-même de l’importance de ce continent qu’on vient de découvrir. Et puis, finalement, une route plus courte pour aller aux Indes, c’est une découverte qui n’intéressait que les commerçants et les armateurs. Dire subitement que le monde était plus vaste qu’on ne l’imaginait, cela concernait tout le monde. Les contemporains des événements ont soudain l’impression d’appartenir à une génération extraordinaire, celle qui va enfin explorer le monde, celle qui dépasse les anciens et qui remet en doute leur savoir.
(à suivre)

(image Internet:"ecole.free.fr")
22:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, zweig, "amerigo", vespucci
21/11/2008
Jaccottet (encore)
Pour ceux et celles qui aiment le poète Philippe Jaccottet, je signale que la revue EUROPE lui consacre son dernier numéro.
Je ne peux m’empêcher de citer ici quelques extraits de la présentation qui est faite du poète (présentation que l’on trouve sur le site Internet de la revue), tant ils sont éclairants :
« …émergeant du désastre, cette voix discrète, tâtonnante mais déterminée dans son souci de justesse et d’effacement, a toujours su se tenir à l’écart des formes modernes de l’idolâtrie, du culte du superficiel et du superflu. Cette voix continue de parler au lecteur contemporain. À la violence de notre siècle. À la violence de toute époque condamnée à naître ou à renaître dans une lumière blessée, dans l’ombre de la douleur. »
Et c’est bien cette discrétion, à l’écart des mondanités de l’univers littéraire, que l’on apprécie chez Jaccottet. Cet homme a toujours tenté de dire l’indicible. Conscient de la difficulté qu’il y a à y parvenir, il a su rester humble et modeste, préférant aux honneurs tapageurs le vrai contact avec les mots. Sa seule ambition, mais elle est de taille, consiste à trouver le mot et le ton justes, afin de faire passer l’indicible. Vaste tâche, on en conviendra, qui, même si elle est souvent tâtonnante, n’en est pas moins déterminée et obstinée.
On apprend que pour ce numéro spécial de la revue Europe, il n’a pas souhaité «voir s’ajouter un nouveau recueil d’études universitaires à ceux qui existent déjà. » On le reconnaît bien là. Joli pied de nez aux intellectuels qui tentent de l’analyser et de le faire entrer de force dans une catégorie. C’est qu’il sait que l’essentiel n’est pas dans ces études, intelligentes certes, mais souvent froides et cérébrales. Il a donc préféré laisser la parole à ses traducteurs, dont bon nombre sont par ailleurs écrivains, poètes et amis car il sait (lui qui est aussi traducteur) que ces gens-là travaillent au plus près des mots, dont ils connaissent toute la complexité.
C’est l’occasion de souligner par ailleurs le rayonnement international de notre discret poète. Lui qui se voulait un « passeur » a très bien rempli son rôle, puisque ses écrits rayonnent maintenant dans des pays étrangers où ils suscitent à leur tour des questionnements sur la manière de percevoir et de dire l’insaisissable.
Mais revenons à l’introduction de la revue Europe :
« Dans une société de consommation, de médiatisation et de profit qui exerce durement son emprise, la poésie de Philippe Jaccottet propose à qui sait l’entendre une façon de vivre et d’habiter le monde en préservant ou en retrouvant le lien à l’essentiel. » En effet, il faut sans doute voir dans cette notion « d’essentiel » une des raisons de l’intérêt que nous portons au poète. A la fois humble et ferme, Jaccottet nous trace le chemin, sans jamais s’en détourner et sans céder à la facilité. Nous qui sommes plongés, bien malgré nous, dans un tourbillon médiatique, où chaque nouvelle se veut plus sensationnelle que la précédente (pour être aussitôt oubliée), nous trouvons chez lui un regard lucide et constant, un regard qui se veut authentique et qui en cela nous émeut et nous interpelle. Moment privilégié, le poème analyse le rapport entre l’homme et le monde, tentant de décrire comme il peut tout ce qu’il y a d’invisible et d’incompréhensible dans la création (à commencer par le fait d’être en vie).
Du coup et sans même le vouloir, il est condamnation de cette société utilitariste que nous connaissons et propose d’autres voies, celles d’un « humanisme modeste, dans la conscience de ses limites. »
Notons encore, dans cette revue Europe, la présence de trois textes inédits de Jaccottet, curieusement intitulés « Trois proses »,. Titre étonnant, on en conviendra, comme si la poésie qui a été l’objet de toute sa vie était subitement niée pour laisser la place à une interrogation sur la mort. Dans ces textes, Jaccottet parle, paraît-il, de la disparition des êtres chers, ce qui l’amène à une réflexion sur le monde contemporain et la perte du sens (étant donné que notre société contemporaine nie la mort et tente de l’occulter). Mais tout demeure méconnaissance : le monde, la démarche poétique, la réflexion métaphysique (l’âme nous survit-elle ?), tout. Et comment une pensée agnostique, qui implique en elle-même son propre néant, peut-elle espérer se maintenir et être présente ?
Mais le message que personnellement je retiens de l’œuvre de Jaccottet, c’est ce face à face avec le monde et surtout l’émerveillement que ce face à face soit possible. Il y a de la stupeur chez Jaccottet, de l’étonnement devant la grandeur de la création. De l’incompréhension aussi, probablement. Maintenant que le poète a vieilli, on sent bien que le thème de la mort qui l’a toujours tracassé prend une autre dimension, qui n’est pas acceptation, mais qui n’est pas révolte non plus.
Une œuvre à lire et à relire, en tout cas.
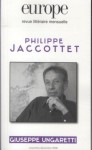
12:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, jaccottet
06/11/2008
Michel Ragon, "La Mémoire des vaincus"
Michel Ragon, dont nous avons déjà parlé l’autre jour, est né dans une famille paysanne en Vendée. A 14 ans, il travaille comme garçon de courses. Il lit l’écrivain anarchiste Henry Poulaille, qu’il retrouve à Paris quand il « monte » à la capitale. Poulaille, qui travaille chez Grasset, a toujours lutté pour l’apparition d’une littérature prolétarienne (une littérature faite par le peuple et pour le peuple, autrement dit il prône des écrivains comme le mineur wallon du borinage Constant Malva. « Pour parler de la misère, il faut l’avoir connue » déclare-il souvent). Il influencera considérablement le jeune Ragon.
Michel fréquente le groupe Cobra puis publie Les Écrivains du peuple ouvrage qui, remanié, donnera en 1974 L’Histoire de la littérature prolétarienne de langue française. Après avoir été, grâce à André Malraux, conférencier pour le ministère des Affaires étrangères, il obtient ensuite un poste de professeur à l’Ecole des Arts décoratifs (car entre-temps il est devenu historien de l’art et de l’architecture contemporaine, domaine dans lequel il publie plusieurs ouvrages). Cet ancien travailleur manuel obtient finalement un doctorat d'État ès lettres à plus de cinquante ans. On le retrouve alors comme professeur dans l'enseignement supérieur.
Personnellement, je le connais surtout pour son roman « La Mémoire des vaincus » (1989), qui offre un beau panorama des grandes figures de l’anarchie. Au fil de la lecture, on croise René Valet, Kropotkine, Doriot, Makhno et surtout Victor Serge. Le héros du roman, un certain Fred Barthélémy, sorte de gavroche du faubourg Poissonnière, devient conseiller de Zinoviev, avant de prendre ses distances avec l’étatisme russe. Ce qui m’a le plus marqué dans ce livre, c’est l’approche humaine de Ragon face à ces « oubliés de l’histoire », ces gens remplis d’un grand idéal égalitaire, mais qui ont finalement été broyés par le communisme d’état tel que l’envisageait Lénine et surtout Staline. Qui se souvient encore vraiment de leur nom aujourd’hui ? Dans quel cours d’histoire parle-t-on d’eux ?
J’ai été frappé aussi, dans ce livre, par le personnage de Victor Serge (Viktor Lvovitch Kibaltchiche, né à Bruxelles en 1890 de parents russes émigrés politiques et mort à Mexico en 1947). Il avait été impliqué dans l'affaire de la Bande à Bonnot et pour cela devra purger cinq années de prison. De son expérience, il écrira un livre : Les Hommes dans la prison. Ensuite, il adhère au parti communiste russe en mai 1919. Il renie donc l'anarchisme au profit du marxisme, ce qui sera considéré comme un reniement par ses pairs. Néanmoins, quand le régime russe tentera d’éliminer ces anarchistes gênants, qui prônent la liberté et qui ne veulent pas d’un état policier, il tentera de les défendre. Plus tard, il dénoncera la dégénérescence stalinienne de l'Etat soviétique (qu’il avait pourtant contribué à mettre sur pied, comme le montre bien Ragon), ce qui entraînera son exclusion du parti pour « activités fractionnelles ». Placé sous surveillance, les autorités l’empêchent d’émigrer hors de Russie. Finalement, il est condamné à trois ans de déportation dans l'Oural et ses manuscrits sont saisis. Il devra sa libération à une campagne internationale. Il quitte Moscou avant les premiers grands procès. Maltraité par la presse communiste, il se réfugie au Mexique où il écrit ses mémoires. Il meurt dans le dénuement, après avoir échappé à des tentatives d’assassinat.
Du livre de Ragon (revenons-y), je retiens encore le rôle (rarement connu) des agents communistes envoyés par Moscou lors de la guerre d’Espagne. Visiblement, ils étaient là plus pour éliminer les anarchistes indépendants que pour se battre contre les soldats de Franco.
Michel Ragon peut donc assurément être considéré comme un écrivain prolétarien au sens où Henry Poulaille définissait ce terme puisqu’il est issu du peuple et a connu la pauvreté. Néanmoins, il dira lui-même la difficulté qu’il a éprouvée à changer de classe sociale lorsqu’il devint un intellectuel. Il eut alors l’impression de trahir les siens tout en désirant lui-même accéder à ce monde de la culture qui l’intéressait et qui lui ouvrait de nouveaux horizons.
Quand on lui demande s’il existe encore des écrivains prolétariens, il avoue que non. Il cite François Bon, qui a été ouvrier très spécialisé et qui a écrit sur l'usine, (mais ce dernier récuse la qualification de prolétarien. Il a raison puisqu'il a une formation d'ingénieur en mécanique et s’est spécialisé dans la soudure par faisceau d'électrons). Sinon, il pense que la littérature prolétarienne a pris une autre voie, celle du polar, du roman noir (Manchette) et fait remarquer que depuis que les usines ont été fermées, le vrai milieu prolétarien aujourd'hui se rencontre dans les banlieues où vivent de nombreux immigrés.
Voilà donc la vision que j’avais de Michel Ragon et inutile de dire que celui-ci m’était particulièrement sympathique. Aussi, quelle ne fut pas ma surprise l’autre jour quand j’ai découvert qu’il était l’ami de Philippe de Villiers (lui qui avait côtoyé Noam Chomsky, Daniel Cohn-Bendit, Georges Brassens, Léo Ferré et Albert Camus…).
Etrange et incompréhensible. Sauf si on se souvient qu’il est né en Vendée et qu’il a conservé un amour profond envers sa terre natale (quel est celui d’entre nous qui n’a pas ce même amour, d’ailleurs ?). Or il se fait que Philippe de Villiers s’est toujours battu pour le développement de cette région et c’est visiblement ce qui rapproche les deux hommes, aussi différents qu’ils puissent être sur le plan politique.
Il faut savoir par ailleurs que Ragon a écrit aussi des romans qui constituent la Suite Vendéenne : Les Mouchoirs rouges de Cholet, La louve de Mervent, Le Marin des Sables, L'accent de ma mère, Le Cocher du Boiroux…
Je n’en dirai rien car je ne les ai pas lus. Visiblement, « Les Mouchoirs rouges de Cholet » traite du bocage vendéen et raconte la vie de ces paysans qui ont survécu à la guerre des Chouans. On pourrait s’étonner, une fois de plus, de voir Ragon soutenir les Vendéens contre les armées de la révolution (lui, l’anarchiste, ne peut être soupçonné d’être dans le camp du roi), mais cela s’explique par le fait qu’il défend les humbles contre le pouvoir étatique. D’ailleurs pour lui, il semblerait que la révolte des Chouans était à la base une révolution paysanne et non une révolution aristocratique.
Comme quoi tout trouve toujours une explication et le moins que l’on puisse dire c’est que Michel Ragon n’en finit pas de nous étonner dans son parcours intellectuel et idéologique.

00:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : littérature, michel ragon
30/10/2008
Jean-Louis Kuffer, "Ceux qui songent avant l'aube"
Je relaie ici la publication chez Publie.net (édition numérique dont nous avons déjà parlé) de « Ceux qui songent avant l’aube » de Jean-Louis Kuffer (en lien ici à droite). Cela fait déjà un bon moment que JLK, comme on dit, nous gratifie sur son blogue de ces petits exercices de style. Chaque phrase, qui commence par « ceux qui », en appelle une autre et ainsi de suite.
Ce qui est amusant, c’est que tous les lecteurs de son blogue ont pu à leur guise glisser quelques phrases de leur choix dans les commentaires pour prolonger son exercice. Moi-même je m’y étais exercé ici. Et voici que ce qui n’était initialement qu’un jeu (en fait au départ c’est une technique qui est utilisée dans les ateliers d’écriture) devient un livre. Numérique, certes, mais livre tout de même, ce qui suppose éditeur et diffusion.
Du coup, on touche ici, à mon avis, à une des spécificités de ce type d’édition moderne : une interaction permanente entre les lecteurs et l’auteur. Celui-ci écrit d’abord pour les lecteurs de son blogue, cela prend de l’ampleur, puis devient un livre numérique, lequel sera essentiellement acheté par des blogueurs (en tout cas par des gens fréquentant assidûment Internet). L’auteur peut ensuite poursuivre à loisir la rédaction de son livre sur son propre blogue et ses lecteurs peuvent continuer à l’imiter dans leurs commentaires. Parallèlement, le livre numérique s’enrichira au fur et à mesure des nouveaux textes de l’auteur. On vit donc un peu le travail de création en quasi-direct et chacun (même si c’est une illusion) a un peu l’impression d’y participer.

22:46 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature, j-l kuffer
Michel Ragon, "Un si bel espoir"
Michel Ragon place l’action de ce roman dans le Paris du Second Empire, celui des grands travaux d’Haussmann, celui de l’argent et des fortunes vite faites. Je ne suis pas un fanatique des romans historiques, mais il se fait que j’aime bien la petite musique qui émane toujours de l’écriture de Ragon. Ici, il met en scène un architecte issu du peuple, rempli d’idées avant-gardistes et plein d’idéal. Tout de suite, le problème est posé, celui de l’appartenance sociale. Sortant des milieux défavorisés, c’est par son seul talent qu’il parvient à obtenir son diplôme, mais il demeure rejeté par les autres étudiants, tous bourgeois, qui ne voient pas en lui un des leurs. Dans la vie active, il en sera de même. Tous les beaux projets architecturaux qu’il avance seront refusés à tous les concours, mais réalisés aussitôt par les concurrents qui pillent ses travaux sans vergogne. Notre architecte restera pauvre et méprisé dans une société où l’argent et les relations familiales comptent davantage que le vrai talent (rien n’a changé, donc). Sa compagne et son seul ami le quitteront pour jouer le jeu, se faire appuyer politiquement et devenir scandaleusement riches.
Derrière ce faste de la haute société, se trouve le peuple, que l’on veut cacher. Haussmann rase les vieux quartiers populeux et insalubres, repousse les miséreux dans des banlieues plus éloignées et trace ses grands boulevards (ceux que nous connaissons aujourd’hui : Sébastopol, St Michel, etc.) en ligne droite, pour permettre aux charges de cavalerie d’être plus efficaces en cas d’émeutes.
Ces émeutes, qu’on sentait depuis trop longtemps contenues, elles éclatent avec la fin de l’Empire et c’est l’épisode de la Commune. On devine bien que Ragon est proche de cette colère, mais il trace des événements un tableau objectif (montrant l’illusion d’une telle démarche, le manque de préparation, l’incohérence du commandement) sans occulter non plus les tirs des Versaillais, ces soldats français que les Prussiens (qui assiégeaient Paris) ont laissés passer pour aller rétablir l’ordre dans un bain de sang.
La répression qui suivra la chute de la Commune sera terrible et notre héros, l’architecte, finira ses jours déporté en Nouvelle Calédonie.
Au-delà de l’histoire racontée, c’est donc la tendresse de Michel Ragon pour les gens simples et miséreux que l’on retrouve (tiens, n’est-il pas lui aussi issu d’un milieu modeste et n’est-il pas devenu docteur d’Etat ès lettres alors qu’il travaillait manuellement à quatorze ans ? Sans oublier qu’il fut un grand critique des mouvements architecturaux modernes). Tendresse par ailleurs doublée de révolte quand il croise le chemin des riches ou des parvenus qui méprisent et qui affament ces gens simples.
Notons aussi que Michel Ragon fut proche des milieux libertaires et anarchistes. Mais nous en reparlerons une autre fois, car ce point est trop important pour nous contenter de seulement le citer.

00:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (24) | Tags : littérature, michel ragon
27/10/2008
Le regard poétique
Dans un ancien article (il y a tout juste un an), je me demandais si le fait de lire et d’écrire devait être considéré comme « une échappatoire, une percée décisive contre la bêtise ambiante » ou au contraire comme une « fuite en avant, un refuge, voire une régression ? » et j’ajoutais : « Un être normalement constitué a-t-il besoin de ce jeu qui consiste à vivre ou à créer des mondes imaginaires ? Un homme (une femme) adulte, en pleine maturité, est supposé(e) agir sur le monde qui l’entoure et non pas se complaire dans la fiction ou la poésie. »
Je n’ai toujours pas trouvé la réponse, encore qu’il me semble de plus en plus évident qu’écrire nous offre la possibilité d’accéder à autre chose, à un « je ne sais quoi » qui permet de rompre avec la banalité quotidienne. En ce sens, en mettant le doigt sur ce qui est vraiment important (du moins pour nous), la lecture comme l’écriture transcendent donc nos vies. Elles appartiennent donc bien de plein droit à notre existence et valent bien d’autres activités plus « concrètes », plus centrées sur les affaires du monde.
Mais si je reviens à ce vieil article et à la question qu’il posait, c’est que je viens de trouver chez Jaccottet un questionnement similaire :
On aura vu, dit-il, inopinément, à la dérobée, autre chose.
« On a commencé à le voir, adolescent ; si, après tant d’années (…), on le voit encore, est-ce pour n’avoir pas assez mûri, ou au contraire parce qu’on aurait tout de suite vu juste, de sorte qu’il faudrait inlassablement, jusqu’au bout, y revenir ?
Du moins quiconque écrit ou lit encore ce qu’on appelle de la poésie nourrit-il des intuitions analogues; tellement intempestives qu’il se prend quelquefois pour un dérisoire survivant. »Philippe Jaccottet, Après beaucoup d’années, Poésie Gallimard, pages 189-190
Ainsi donc ce poète considère que c’était son premier regard d’adolescent qui était le bon, lorsqu’il a appréhendé le monde autrement et qu’il a tenté de synthétiser son expérience dans des poèmes. On sent aussi chez lui, lorsqu’il vieillit, comme une fatigue un peu lasse et il avoue parfois ne plus parvenir à s’extasier comme par le passé. Quand il parle comme cela, ce n’est pas, cependant, pour remettre en cause l’essence de son activité de poète mais bien pour regretter de n’avoir plus la force de pénétrer dans le secret des choses ni celle de relater le côté indicible du monde. Il approuve donc toujours dans l’absolu la démarche poétique mais avoue ne plus pouvoir se maintenir en permanence dans cet univers. Enfin, c’est lui qui le dit, car les poèmes qu’il continue à nous donner sont toujours remplis de ce mystère indicible qu’il semble être un des seuls à percevoir.
20:32 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature
11/10/2008
"Chez Bonclou" de Bertrand Redonnet
On sait qu’il est toujours très difficile de trouver un éditeur qui veuille bien s’intéresser à votre cas. Avec Internet, il existe maintenant des sites qui proposent des textes d’écrivains connus ou moins connus, textes qu’il suffit alors de télécharger, soit gratuitement comme chez Feedbooks, soit en payant comme chez Publie.net.
Jean-Jacques Nuel avait parlé sur son blogue de son expérience chez Feedbooks (ici et ici). Quant à Publie.net, il suffit d’aller voir le site de François Bon pour comprendre de quoi il s’agit.
Mais mon propos aujourd’hui n’est pas d’analyser les avantages et les inconvénients de ce système d’édition électronique mais plutôt de parler d’un des textes que l’on peut y trouver, à savoir «Chez Bonclou et autres toponymes » de Bertrand Redonnet.
Pour les habitués de ce blogue, Bertrand n’est pas un inconnu puisqu’il vient régulièrement déposer des commentaires et que l’on trouve son site en lien ici à droite. Dès lors, je ne puis prétendre à une critique objective car il est toujours difficile de juger le texte d’une personne que l’on connaît (même si c’est par l’intermédiaire d’Internet) et dont on apprécie par ailleurs les qualités. Mais cela ne fait rien, Baudelaire lui-même ne revendiquait-il pas une critique d’humeur, forcément partiale, mais qui avait l’avantage de dire clairement ce que l’on pensait ? De son côté, un auteur préfère souvent une critique sincère qui prouve qu’on a lu son texte avec attention plutôt que des phrases toutes faites comme on en trouve trop souvent dans la presse, lesquelles ne visent qu’à faire vendre un livre que le journaliste a à peine effleuré. Rien de semblable ici, donc, mais un regard qu’on sait déjà amical avant que ne commence la lecture.
Ce texte, qui fait 118 pages tel qu’il est proposé (en grands caractères assez espacés pour faciliter la lecture à l’écran) mais qui en ferait environ une bonne soixante selon la présentation classique, parle de toponymie. Sujet érudit, me direz-vous ? Et bien non. Il ne faut point chercher ici un dictionnaire exhaustif des noms de lieu de votre région ni même espérer y trouver des arguments scientifiques prouvant que tel nom de village ou de lieu-dit provient bien d’un étymon latin et non d’un étymon celte. C’est qu’il ne s’agit point du travail d’un savant philologue mais d’un poète des mots (ou d’un poète tout court). L’auteur, en effet, s’est amusé à émettre plusieurs hypothèses quant à l’origine de quelques toponymes.
Il traite, comme c’est normal, des régions qu’il connaît, à savoir en gros le Poitou (département des Deux-Sèvres et un peu le Sud de la Vendée) qui est à l’origine de tout puisque c’est le pays de son enfance et la Pologne puisqu’il y vit actuellement (suite à ces hasards de la vie qui n’en sont jamais vraiment et qu’il vous racontera lui-même un jour s’il en a envie). A partir donc de quelques noms de villages, il envisage différentes hypothèses, par l’entremise de dialogues imaginaires entre les villageois, ce qui rend la lecture agréable et même ludique. Chaque participant propose son explication quant à l’origine du toponyme. Le ton monte, on s’affronte et à la fin on comprend qu’on ne découvrira jamais la vérité, enfouie au plus profond de l’Histoire la plus reculée.
Ce qui nous intéresse, en tant que lecteur, c’est cette remontée dans le passé, à la recherche des origines (car les lieux où nous sommes nés sont fondateurs) car dire les lieux, c’est dire d’où on vient donc dire qui nous sommes. Mais derrière cette démarche pour ainsi dire existentielle, il y a dans ce texte une réflexion sur la langue et ses possibilités.
Oléron est-elle l’île aux parfums (insula oleorum) ou l’île aux larrons ? Cela fait une belle différence. En remontant aux origines du nom nous renouons avec nos ancêtres, tous ces gueux et tous ces manants qui ont habité ces terres avant nous et qui les ont nommées, déformant le latin qu’ils maîtrisaient mal ou pas du tout pour créer sans le savoir notre belle langue française. « La magie des mots passe le flambeau toujours intact, loin par-delà les hommes. Les mots sont des monuments » nous dit l’ami Bertrand. Comprenez aussi : les hommes passent, les mots demeurent. Car derrière les phrases de ce texte, je sens poindre les questions existentielles. La recherche du mot originel, c’est aussi la recherche des origines et du paradis perdu. Nous ne faisons que passer, transmettant aux générations suivantes ces toponymes dont nous avons nous-mêmes hérité. Belle réflexion sur le temps qui passe donc, comme ces fleuves, qui n’en finissent pas de couler (quand ils ne s’immobilisent pas dans les marais du Poitou)
« Car les fleuves sont comme le temps et comme les mots, éternels et de passage. En les regardant bien, en fait, ils ne bougent pas. Ils vont. Pour matérialiser la fuite, capter leur éphémère, il suffit de jeter un bout de bois et de le suivre des yeux. Sans cela, rien ne bouge devant nous que de l’éternel et rien ne bougera devant les yeux des hommes de l’an quatre mille cent et même au-delà. C’est en cela peut-être que réside mon effroi du temps et de la mort promise au bout et que je m’accroche à ces mots impérissables, des milliards de fois prononcés, jamais les mêmes cependant. C’est en eux qu’on peut puiser une goutte d’éternité. »
Et c’est comme cela tout du long, le poète continuant à s’interroger sur les mots, mais aussi sur l’Histoire. Un toponyme comme «Les Alleuds» provient-il des terres libres octroyées aux serfs par les seigneurs du Moyen-Age ou bien sont-ce les terres que les conquérants germaniques se sont octroyées au dépend des paysans celtes ? Cela fait une belle différence pour celui qui habite cet endroit. Est-il le descendant d’un chef de guerre qui s’imposa par la force ou d’un paysan qui lutta pour sa liberté ?
Je ne vais pas ici passer en revue tous les toponymes étudiés, ce serait déflorer le sujet. Que celui que cela intéresse y aille voir par lui-même ! Il n’y trouvera pas de réponses à ses questions, mais il repartira au contraire avec plus de questions encore. Mais n’est-ce pas le propre des livres de nous faire réfléchir ?

01:44 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, redonnet, chez bonclou
05/10/2008
Alvaro Mutis "Et comme disait Maqroll el Gaviero"
Nous avons déjà parlé d’Alavaro Mutis et de son oeuvre en prose. Je termine maintenant le recueil de ses poèmes et je reste ébahi par l’intensité atteinte. C’est un petit livre (265 pages dans l’édition Poésie/Gallimard) si l’on considère qu’il renferme l’œuvre de toute une vie, à savoir les poèmes écrits de 1947 à 1986, mais c’est un grand livre si l’on regarde les thèmes traités et l’émotion ressentie.
Les titres des différents sous-recueils sont déjà tout un programme et donnent une bonne idée de la personnalité de l’auteur et de ses angoisses existentielles :
- Les éléments du désastre
- Les travaux perdus
- Inventaire des hôpitaux ultramarins, etc.
Colombien il passa sa première jeunesse en Europe où son père était diplomate, puis retourna dans son pays. Toute sa vie il conservera cette double culture, cette double appartenance, avec le sentiment d’être partout un exilé, quel que soit le côté de l’Atlantique où il se trouvait.
Exil (extrait)
Et c’est alors que je pèse tout ce que j’ai perdu dans mon exil,
que j’en mesure la solitude irrémédiable.
À cette part de la mort anticipée
apportée par chaque heure, chaque jour d’absence
que je remplis de choses et d’êtres
dont la condition étrangère me pousse
vers la chaux définitive
d’un rêve qui rongera ses propres vêtements
faits d’une écorce de matières
transplantées par les ans et l’oubli.
Il sera fasciné par les grands fleuves colombiens descendant de la cordillère. Lorsqu’ils sont en crue, ils transportent les choses les plus invraisemblables : des troncs d’arbres, des toitures de maisons, des cadavres d’animaux, etc. tandis que leurs eaux jaunes et tumultueuses emportent tout sur leur passage. Ces fleuves représentent pour le poète la fuite du temps qui irrémédiablement nous entraîne vers le néant. Mais paradoxalement ils sont aussi source d’apaisement, comme si, par leur mouvement continu, ils semblaient donner un sens à la vie et comme si, par leur démesure même, ils nous faisaient accepter l’inéluctable.
La solitude est évidemment un thème qui revient fréquemment et la femme, si elle est désirée, est cependant souvent absente :
Je suis venu t’appeler
sur les falaises.
J’ai lancé ton nom
et seule l’écume vorace et passagère
de la mer m’a répondu.
Sur le désordre éternel des eaux
vogue ton nom
comme un poisson qui se débat et qui fuit
vers le lointain immense.
Vers un horizon
de menthe et d’ombre
navigue ton nom
errant sur l’océan de l’été.
Avec la nuit qui tombe
Reviennent la solitude et son cortège
De rêves funèbres.
On trouve aussi de belles réflexions sur la littérature elle-même :
Chaque poème est un oiseau qui fuit
le lieu marqué par le fléau.
Chaque poème est un habit de mort
Sur la cire mortelle des vaincus
par les places et les rues inondées.
(…)
Chaque poème est un fracas
de voiles blanches qui s’écroulent
dans le rugissement glacé des eaux.
Chaque poème envahit et déchire
L’amère toile d’araignée de la lassitude.
Chaque poème naît d’une sentinelle aveugle
Qui lance au gouffre sans fond de la nuit
Le mot de passe de son malheur
Cette image de la sentinelle aveugle est absolument époustouflante. Une sentinelle, c’est bien un soldat qui est aux avant-postes et qui assure la protection des autres. Il est le premier à voir le danger. Le poète, de par sa position, perçoit donc ce que les autres n’aperçoivent pas ou ne comprennent pas. Il est là pour sonner l’alarme avec ses mots. Mais il est aussi aveugle (comme le vieux devin chez Homère, qui prédit l’avenir et voit donc ce que les autres ne voient pas). Cette cécité peut donc se comprendre de deux manières. Soit le poète est infirme (et tout homme l’est face à l’existence) et bien qu’il n’ait rien vu il compose tout de même son poème, lequel sera rempli de ses seuls pressentiments et de ses angoisses, soit comme chez Homère il a un don de voyance (« et j’ai cru voir ce que l’homme a cru voir » disait Rimbaud) bien que dans la vie courante il soit peu clairvoyant (et alors c’est l’albatros de Baudelaire avec ses ailes de géant qui l’empêchent de marcher).
Mutis est donc d’abord un poète avant d’être un romancier. C’est sur le tard, d’ailleurs, qu’il écrira son oeuvre en prose, en partant du personnage de Maqroll le gabier qui était déjà au centre de ses poèmes. Notons aussi que c’est comme romancier que la notoriété lui est venue, preuve une fois de plus que le message poétique passe difficilement tant auprès des éditeurs que des jurys des prix littéraires (il obtiendra le Médicis étranger pour son roman « La neige de l’Amiral »)
Donc, Mutis est avant tout poète, mais il ne cache pas que pour lui la poésie est ineffable. Elle tente de dire l’essentiel, mais ne fait jamais que l’approcher. Cet essentiel, c’est la condition humaine, bien entendu. Car Mutis est hanté par la mort et il est donc un adepte de la désespérance. Cette dernière implique lucidité, incommunicabilité et solitude. Se tenant toujours en marge, ne jugeant pas, Mutis observe les hommes et leur agitation quotidienne. Ils ne semblent pas s’apercevoir qu’ils sont mortels et vaquent à leurs petites occupations. Le poète, lui préfère se réfugier dans l’imaginaire et suivre son héros sur les routes désertes des Andes (où des trains à l’abandon restent immobilisés au bord des précipices – tout un symbole) ou le long des grands fleuves. Toujours, cependant, il dépasse l’instant présent et l’anecdotique pour nous élever par la réflexion et la lucidité. Ses descriptions de l’Alhambra de Grenade ne sont pas simplement un hommage à la beauté architecturale de ces lieux, c’est aussi une réflexion sur l‘Histoire, sur la chute des empires et finalement sur la destinée des hommes. Dans cet Alhambra, il croit encore entendre les pas des sentinelles arabes, ce qui amène le lecteur à une réflexion sur la fuite du temps et la vanité du monde. Mais la vanité, ce sont aussi ces touristes qui visitent en troupeau ces lieux sacrés et qui ne comprennent rien à leur dimension tragique ni au fait qu’ils sont devenus le porte-parole de la mémoire des siècles. A Cordoue, Mutis croit sentir subitement la présence de ses ancêtres et il a enfin l’impression, pour un instant, d’être enfin de quelque part, lui l’éternel exilé.
Notons encore le rythme de sa phrase, qui est exemplaire. Qu’elles soient en prose ou en vers, elles déroulent leur cheminement avec souplesse et nous font parvenir là où elles voulaient nous mener. Je salue au passage le travail exemplaire du traducteur François Maspéro (celui des éditions du même nom) qui est parvenu à nous rendre cette respiration naturelle dans le texte français. C’est assurément un tour de force.
Si je devais résumer Mutis en un mot, je dirais que j’ai surtout retenu ces mondes imaginaires qu’il crée à partir d’un seul mot, comme cette nuit qui s’avance et établit son royaume :
La nuit avançait pour établir ses domaines
faisant taire tout bruit éteignant toute rumeur
qui ne soient ceux de ses ténèbres répandues
de ses galeries tortueuses de ses lents labyrinthes
par lesquels elle progresse en se jetant contre les molles parois
où rebondit l’écho des paroles et des pas du passé
et flottent s’approchent et s’éloignent des visages
dilués dans la suie impalpable du rêve
etc. etc.

00:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, mutis, poésie, maqroll le gabier
29/09/2008
Annie Ernaux, "Les Années"
A la demande de quelques lecteurs(trices), voici la note de lecture consacrée aux "Années" d'Annie Ernaux et parue autrefois dans le "Magazine des livres".
Annie Ernaux a déjà beaucoup parlé d’elle-même dans ses livres, pourtant on ne peut pas dire qu’elle se cantonne dans la stricte autobiographie dans la mesure où elle inscrit le récit de sa vie dans le monde qui l’entoure. Loin du narcissisme ou du repli sur soi, son intention est plutôt de saisir son époque en partant de son propre personnage ou inversement de se comprendre soi-même en se replaçant dans la grande histoire du monde.
Son livre « Les Années », qui vient de sortir en février (1), est certes admirable de ce point de vue. Non seulement il représente un véritable concentré de son œuvre, mais c’est toute notre époque qu’elle nous fait revivre avec elle. Les plus jeunes d’entre nous découvrirons « de l’intérieur » les années qu’ils n’ont pas vécues, quant aux autres, c’est le cadre dans lequel ils ont vécu qui resurgira sous leurs yeux à travers les mots de la narratrice. Les années cinquante, mai soixante-huit, l’élection de Mitterrand, l’an deux mille, etc. C’est l’Histoire des historiens qui est au rendez-vous, mais une histoire à laquelle nous avons nous-mêmes participé, si pas comme acteurs, au moins comme témoins directs.
Autobiographie donc, mais autobiographie impersonnelle, puisqu’elle nous concerne tous. Elle tente de retrouver l’état d’esprit de ces périodes déjà révolues, à travers des mots, des images, des rumeurs. Cependant, elle ne les aborde pas comme on le ferait dans un traité scientifique, avec des chiffres et des statistiques, mais au contraire elle le fait à partir du milieu social qui était le sien. C’est donc une image subjective qu’elle donne de la réalité, celle qui était la sienne, autrement dit celle des gens avec qui elle vivait. A travers ce regard sur les choses, on la sent évoluer. D’abord, elle est la petite fille sage qui capte des échos de la conversation des grandes personnes, lors de ces interminables repas de famille qui l’ennuient un peu. Puis, adolescente, elle commence à prendre ses distances avec ce même milieu familial en qui elle ne se reconnaît plus , avant de s’en éloigner définitivement une fois qu’elle est diplômée de l’université. Elle porte alors un autre regard sur le monde, un regard de jeune femme adulte. Mais la manière dont elle aborde l’actualité reflète ses opinons : elle est de gauche, défend le droit à l’avortement, etc. Regard subjectif, donc, et qui se veut tel, d’une personne responsable qui subit finalement les événements plus qu’elle ne les domine (sa joie à l’arrivée de Mitterrand, sa déception par la suite).
Le livre est émouvant car il relate aussi l’avancée inexorable du temps. Annie Ernaux nous raconte son divorce, le départ de ses enfants, l’amant qu’elle prend pour passer le temps, le retour de la droite au pouvoir (époque de la cohabitation, suivie par les années Chirac) qui provoque chez elle un découragement certain, et puis surtout le vieillissement qui vient couronner cette vie dont elle se demande finalement quel en aura été le sens. C’est un peu comme si elle tentait de mettre en forme son absence future, seule manière de « sauver quelque chose du temps où l’on ne sera plus jamais.» Regard lucide donc, qui nous concerne tous car nous nous sentons vieillir avec elle, en même temps qu’elle.
Dans ce livre, on comprend aussi à quel point ce sont les événements qui conditionnent notre vie. Par exemple, jeune, elle vivait dans la peur de tomber enceinte. Son existence aurait donc été différente si elle était née quinze années plus tard, au moment de la généralisation de la contraception et de la liberté sexuelle. Liberté bien éphémère, car bientôt le sida fera son apparition, obligeant les partenaires à prendre de nouveau des précautions. L’individu, avec sa sensibilité et ses besoins, subit donc un peu son époque (il existe souvent des écarts entre les désirs et la réalité), époque qui a son tour conditionne son être intérieur. C’est en ce sens que l’œuvre d’Ernaux est intéressante et ce livre-ci en particulier. Nous comprenons à quel point une biographie écrite en dehors de tout contexte historique et social n’a pas de sens. L’individu s’inscrit irrémédiablement dans son époque, qui le façonne qu’il le veuille ou non. La narratrice se veut donc modeste, puisqu’elle n’est finalement qu’un produit de circonstances extérieures (milieu social, culturel, etc.). D’un autre côté, c’est cette appartenance involontaire à l’Histoire qui la sauve en partie puisque cette Histoire perdurera dans la mémoire de l’humanité. Du coup, ce qui est à la base de son destin individuel, ainsi que tous ses souvenirs, passeront un peu à la postérité. Il se trouvera toujours quelqu’un pour étudier cette époque qui fut la sienne et à laquelle elle doit tout.
A la fin du livre, elle aborde sa conception de l’écriture. Elle explique comment, étudiante, elle espérait trouver un langage inconnu « qui dévoilerait des choses mystérieuses, à la manière d’une voyante. Elle imaginait aussi le livre fini comme la révélation aux autres de son être profond , un accomplissement supérieur, une gloire » (2). Plus tard, professeur de lettres dans un lycée, mère de famille, complètement absorbée par la vie active, ces rêves d’écriture et de révélation d’un monde ineffable l’ont quittée. Elle s’est contentée d’utiliser la langue de tous pour manifester sa révolte face à un monde qui ne lui plaisait pas. Le livre dès lors, était devenu instrument de lutte. Une fois pensionnée, le besoin s’est fait sentir de révéler ce qui a été, de le sauver de l’oubli : « plus que tout, maintenant, elle voudrait saisir la lumière qui baigne des visages désormais invisibles, des nappes chargées de nourriture évanouies, cette lumière qui était déjà là dans les récits des dimanches d’enfance et n’a cessé de se déposer sur les choses aussitôt vécues, une lumière antérieure. » (3) Il s’agit donc pour elle de sauver ce qui a été et qui déjà n’est plus (sauf dans sa mémoire à elle). Il s’agit aussi de préparer ce temps où elle ne sera plus, en livrant un témoignage sur son époque, afin que les générations futures puissent se rendre compte de ce qui a été et de ce qu’elle a été. Ce témoignage qu’elle veut transmettre peut faire référence à l’avènement de la pilule ou à mai soixante-huit, mais aussi à des expériences plus intimes, comme « le regard de la chatte noire et blanche au moment de s’endormir sous la piqûre » (4), cette chatte qu’elle enterrera dans son jardin en accomplissant pour la première fois ce geste d’enfouissement, ce qui lui donnera l’impression d’enterrer à la fois ses parents décédés, son amant mort et même d’anticiper sur son propre enterrement.
Un beau livre assurément, que ces « Années », qui fait réfléchir sur notre destinée, sur le temps qui passe, sur l’Histoire des hommes avec laquelle notre vie s’est mélangée un instant avant que tout ne termine dans un grand silence.
---------------------------------------------------
Annie Ernaux, Les Années, Gallimard, 2008, 242 pages, 15,50 euros.
Op. Cit. page 240
Op. Cit. Page241.
Op. Cit. Page242.

00:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : littérature, annie ernaux, "les années"
22/09/2008
"Une Femme" d'Annie Ernaux
Je termine le livre Une Femme qu’Annie Ernaux a écrit à la mort de sa mère (atteinte de la maladie d’Alzheimer) pour tenter de faire revivre celle-ci et de l’immortaliser par l’écriture au moment précis où elle disparaît définitivement. L’auteure espère ainsi, par ce biais, retrouver le lien qui l’unissait à cette mère, mais aussi tracer le portrait de cet être qui a existé en dehors d’elle (en dehors, donc, de la relation mère/fille). Inconsciemment, donc, Annie Ernaux se retrouve d’un côté dans la position de la petite fille qui évoque ses souvenirs mais aussi d’un autre côté dans celle d’une mère puisque c’est elle, par ses mots, qui redonne naissance à la défunte. Ce livre, qu’elle mettra un an à écrire, est donc une sorte d’accouchement. Il s’agit de donner le jour à un personnage dont elle n’a connu finalement qu’un des aspects et de tenter de le faire revivre en étant fidèle au contexte historique dans lequel s’est déroulée sa vie.
Le début commence comme dans l’Etranger de Camus par une phrase forte : « Ma mère est morte le lundi 7 avril à la maison de retraite de l’hôpital de Pontoise, où je l’avais placée il y a deux ans. » (p.11)
Tout est déjà dit par cette simple phrase. On perçoit la déroute de l’auteure suite à cet événement dramatique mais aussi sa culpabilité latente d’avoir dû placer sa mère quand celle-ci avait perdu la raison.
Le livre retrace donc le parcours de cette mère, qui vivait en Normandie, dans un milieu modeste (ouvrier), mais qu’elle tentera de quitter en s’élevant un peu socialement (petit commerce). C’est elle qui poussera sa fille Annie à faire des études, à « s'en sortir » mais en faisant cela elle la fera passer de l’autre côté de la barrière, dans le monde bourgeois et cultivé où elle-même n’aura jamais accès. D’un côté, donc, elle sera fière du parcours de son enfant, mais de l’autre, cet enfant, elle l’aura perdu car elle ne la comprendra plus vraiment (et réciproquement).
L’écriture a finalement un rôle cathartique pour Annie Ernaux :
« Il fallait que ma mère, née dans un milieu dominé, dont elle a voulu sortir, devienne histoire pour que je me sente moins seule et factice dans le monde dominant des mots et des idées où, selon son désir, je suis passée. » Alors qu’Annie, adolescente, fuyait sa mère (dont elle ressentait cruellement le côté populaire au point d’en éprouver une certaine honte) elle va pourtant l’accueillir chez elle lorsque celle-ci sera âgée (mais en retrouvant cette impression d’être épiée dans son comportement d’intellectuelle). A la fin, lorsque la démence sera là, elle l’aura perdue une nouvelle fois, mais c’est la mort, évidemment, qui scellera l’adieu définitif :
« Je n'entendrai plus sa voix... J'ai perdu le dernier lien avec le monde dont je suis issue. »
Car si Annie Ernaux se sent coupable envers sa mère (de l’avoir reniée socialement et d’avoir dû la placer), elle éprouve également un certain malaise vis à vis de sa classe d’origine : elle ne la comprend plus et s’y sent mal à l’aise, mais elle n’oublie pas qu’elle en est issue et qu’une partie d’elle-même puise donc ses racines là. La disparition de la mère coupe donc définitivement les ponts avec un monde révolu. D’où la nécessité d’écrire tout cela pour retrouver la paix intérieure.
En lisant ce livre, je me demandais dans quelle catégorie il convenait de le ranger. Car finalement, écrire sur ses parents, est-ce déjà de la littérature ou bien est-ce que cela relève du journal intime ? A un certain moment, l’auteur donne elle-même la réponse :
« Ce que j’espère écrire de plus juste se situe sans doute à la jointure du social et du familial, du mythe et de l’histoire. Mon projet est de nature littéraire, puisqu’il s’agit de cherche rune vérité sur ma mère qui ne peut être atteinte que par des mots. (C’est-à-dire que ni les photos, ni mes souvenirs, ni les témoignages de la famille ne peuvent me donner cette vérité.) Mais je souhaite rester, d’une certaine façon, au-dessous de la littérature. » (p. 23)
Annie Ernaux considère donc que le fait d’utiliser les mots rattache d’emblée son travail à la littérature (tout en insistant sur le fait qu’il y a une part personnelle importante qui fait qu’elle reste un peu en dessous).
Evidemment, si elle s’était juste contentée de retracer pour elle seule un portrait de sa mère, on n’aurait pas pu qualifier son livre de littéraire. Mais elle va au-delà de la peinture individuelle en replaçant cette mère dans son contexte historique et social :
« J'essaie de ne pas considérer la violence, les débordements de ma mère comme seulement des traits personnels de caractère, mais de les situer aussi dans son histoire et sa condition sociale. Cette façon d'écrire, qui me semble aller dans le sens de la vérité, m'aide à me sortir de la solitude et de l'obscurité du souvenir individuel, par la découverte d'une signification plus généreuse. »
Petite fille, elle a donc connu sa mère avec certains traits de caractère qu’elle a crus lui être propres. Adulte, elle se rend compte qu’une bonne partie de ce caractère était lié à l’appartenance à une classe sociale bien définie (parler fort, déplacer les objets en faisant du bruit, etc.). Ecrire tout cela dépasse donc le simple compte-rendu individuel et permet d’atteindre une vérité plus générale. C’est en ce sens, à mon avis, que ce livre appartient de plein droit à la littérature.
Mais une fois ce point acquis, qui rassure l’écrivain, un autre doute surgit, qui concerne la petite fille que fut Annie :
« Mais je sens que quelque chose en moi résiste, voudrait conserver de ma mère des images purement affectives, chaleur ou larmes, sans leur donner un sens. »
En livrant sa mère aux lecteurs, elle la sauve de l’oubli mais elle en fait aussi un personnage quasi public, qui ne lui appartient plus vraiment. Autre paradoxe de l’écriture…
Finalement, demeure le problème de savoir dans quelle catégorie on va placer ce livre, puisque c’est bien de la littérature.
« Ceci n’est pas une biographie, ni un roman naturellement, peut-être quelque chose entre la littérature, la sociologie et l’histoire."
Comme quoi, rien n’est simple quand on se met à écrire pour clarifier ses pensées et exorciser ses démons.

22:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (25) | Tags : littérature, annie ernaux, "une femme"
16/09/2008
"Palestine" d'Hubert Haddad
Né à Tunis en 1947, Hubert Haddad à vécu son enfance a Ménilmontant. A vingt ans, il a fondé une revue de poésie le Point d'être, influencée par le surréalisme. Ecrivain (poète, romancier, nouvelliste, dramaturge et essayiste), il vit essentiellement des ateliers d'écriture qu’il anime dans les écoles mais aussi dans les hôpitaux et les prisons. D’origine à la fois juive et berbère, ce Français de l’immigration ne pouvait que se pencher un jour ou l’autre sur ses origines. Cela nous a donné ce très beau livre qu’est Palestine, où le conflit bien connu du Moyen-Orient est retracé sur un mode quasi poétique et dans une approche d’une grande humanité.
Le héros est un officier israélien qui tombe dans une embuscade. Il va perdre la mémoire et se retrouver du côté palestinien, vivant au jour le jour toutes les humiliations imposées à la population par Tsahal, qui défend, elle, les colonies juives de peuplement en Cisjordanie.
Rien que pour comprendre ce qu’est la vie quotidienne dans cette partie du monde, ce roman vaut la peine d’être lu car on découvre par l’intermédiaire du héros la difficulté de se déplacer (barrages militaires improvisés, chekpoints, etc.) ou même de survivre (maisons détruites en représailles, construction du mur, etc.). Pour ce qui est de ce côté « documentaire » et « reportage », Haddad me fait penser à Jasmina Khadra qui, dans son roman « L’Attentat », nous décrit aussi des situations particulièrement difficiles.
Mais « Palestine » est bien autre chose qu’une simple description de la réalité, c’est un livre rempli de symboles. Ainsi, c’est après avoir été jeté dans une tombe que le héros renaît à sa nouvelle vie et qu’il devient palestinien. Dès lors, il passe de son statut d’officier (à la situation relativement aisée) à celle d’un paria ne possédant rien, même plus sa mémoire. Belle métaphore pour désigner le peuple palestinien tout entier, à qui on ravit chaque jour un peu plus la terre et qui sombre dans la pauvreté et la misère. Son seul salut, c’est justement cette mémoire qu’on voudrait lui enlever et qui lui permet de se souvenir de son passé et donc de résister aux tentatives de l’occupant, lequel essaie de faire disparaître sa culture (villages rasés, maisons détruites, oliviers coupés, etc.). Le héros, lui, a perdu ses souvenirs judaïques et c’est avec un cœur neuf et sans préjugés qu’il découvre la triste vie quotidienne de ce peuple voisin du sien contre lequel il combattait encore le matin même.
Le voilà devenu Nessim, frère de Falastìn, étudiante anorexique, et fils d’Asmahane, veuve aveugle d’un responsable politique abattu dans une embuscade.
La cécité de la vielle dame est elle aussi tout un symbole. Sans doute préfère-t-elle ne plus voir les horreurs de la vie quotidienne depuis qu’on lui a tué son mari. Sa fille Falastin, jeune fille frêle et attachante, joue un peu le rôle d’une nouvelle Antigone en s’occupant de sa vieille mère. On notera que le mythe d’Œdipe est inversé puisque ici l’aveugle est une vieille femme et non plus un homme jeune. De plus elle n’a tué personne (au contraire on a tué son mari) involontairement mais c’est délibérément que les Israéliens assassinent son peuple. Loin de se laisser conduire sur les chemins, comme Œdipe guidé par l’antique Antigone, Asmahane reste cloîtrée dans sa maison et ne sort plus (symbole de l’enfermement de la Cisjordanie par le mur et Tsahal). Elle en sort tellement peu qu’elle y trouvera la mort le jour où l’armée vient raser l’immeuble car, étant aveugle, elle n’a évidemment pas pu lire l’ordre d’évacuation.
Si Asmahane est aveugle, sa fille est anorexique et refuse de se laisser vivre. Ainsi, elle n’a plus ses règles, malgré ses vingt ans, ce qui la plonge dans une stérilité qui renvoie elle aussi à celle, symbolique, de tout son peuple. D’ailleurs, d’une manière générale, de nombreux protagonistes ont un handicap. Ainsi un jeune berger devenu porteur d’eau boîte suite à une balle reçue dans la jambe. Qu’il s’agisse donc de voir, de se déplacer ou de procréer, tous ces actes qui font une vie normale semblent devenus impossibles.
A la fin du livre, Nessim est séparé de Falastin dont il est probablement amoureux (elle est la seule personne qui lui ait apporté un peu de douceur dans ce monde de fous où tout n’est que violences et brimades). Désemparé, il finit par se faire embrigader par des terroristes qui lui proposent d’aller se faire exploser à Jérusalem. Il accepte pour en finir, ne trouvant finalement aucun goût à la vie qu’il mène, laquelle n’a aucun sens. A la dernière minute, cependant, la mémoire lui revient mais c’est pour apprendre la mort de son frère (notons que le frère d’Hubert Haddad vivait à Hébron et qu’il est venu se suicider à Ménilmontant). On devine qu’il va se suicider avec la charge explosive qu’il porte sur lui, mais en ayant soin de ne faire aucune victime.
Beau portrait donc, dans ce livre, du peuple palestinien, pris entre radicalisme et résignation, entre Hamas et Fatah. La fatalité surtout domine, plus que la colère. On n’espère plus vraiment que la situation puisse évoluer, mais on reste sur place tout de même, par principe, par habitude, par respect de sa propre culture. Le lecteur vit tout cela de l’intérieur, comme s’il était l’un de ces personnages et c’est peut-être ce qui rend le livre si attachant et si humain. Le style de l’auteur est celui d’un poète. Il suffit de voir comment il décrit les levers de soleil pour comprendre que le regard qu’il porte sur cette terre est tendre. La présence de Falastin offre un contraste saisissant entre la barbarie du monde et la douceur intérieure de son être. Au fil des pages elle devient vraiment attachante et pour un peu le lecteur en deviendrait aussi amoureux que le héros a pu le devenir. C’est que malgré sa fragilité, tout repose sur les épaules de la jeune fille (s’occuper de sa mère, soigner Nessim, aider les enfants à aller à l’école en longeant les colonies juives, d’où on leur jette souvent des pierres, etc.). Alliant douceur et détermination, elle vit dans un monde de rêves (encore la poésie), un monde bien à elle qu’elle s’est créé et qui lui permet de ne pas voir l’horreur de la situation présente. On pourrait dire qu’elle s’échappe par l’imaginaire et c’est sans doute ce que Nassim aime en elle.
Un beau livre donc, que je qualifierais de reportage poétique et qui nous fait découvrir des hommes et des femmes, des soldats et des civils, des jeunes et des vieux, des aveugles et des voyants, des Arabes et des Juifs, des quasi-morts et des vivants. Un livre à lire, assurément.
Hubert Hadad, « Palestine », Zulma, mai 2007, 156 pages, 16,50 euros.

09:34 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature, hubert haddad, palestine
29/08/2008
Romans à lire
Avec 676 romans publiés à la rentrée 2008, il semblerait qu’on enregistre une baisse par rapport à 2007. On croit rêver. Quand pourrait-on trouver le temps de lire une pareille production ?
Ceci dit, si de tels chiffres donnent l’impression que le monde de l’édition se porte bien (je n’ai pas dit la littérature), il ne faudrait tout de même pas perdre de vue que la grosse majorité des ventes (et donc du chiffre d’affaires) tourne autour d’une bonne dizaine d’écrivains à succès. Et les autres, me direz-vous ? Ils rempliront les librairies quelques semaines avant de disparaître comme ils étaient venus.
Pour certains, ce n’est sûrement pas une grande perte, pour d’autres si. Chaque année je me dis qu’il y a sûrement quelques perles dans toute cette production, mais comment la dénicher ? Pas par la critique officielle, qui ne fait que renforcer le système publicitaire des éditeurs (volontairement sans doute, mais involontairement aussi : les critiques eux-mêmes sont noyés par l’abondante production et ils ne lisent que les livres dont on a bien voulu leur parler, autrement ceux sur lesquels les éditeurs, en marchands avisés qu’ils sont, ont misé).
Donc, tout cela, cela fait beaucoup de perte. Perte de temps et d’énergie pour l’écrivain qui ne sera quand même pas lu. Perte de temps pour l’éditeur puisque ces livres ne lui rapporteront rien et qu’ils ne serviront pas à établir sa réputation. Perte de temps pour moi ici qui bavarde sur des livres que je ne lirai jamais. Et je ne parle pas des arbres qu’on a dû couper pour réaliser ces milliers de pages.
Au moins ici, sur un blogue, on respecte la santé des arbres, on ne perturbe pas les éditeurs et on est obligé de faire court si on veut avoir quelques lecteurs. Certes, nous restons dans l’éphémère, mais finalement n’est-ce pas plus en adéquation avec notre destinée ? Tels des étoiles, nous brillons un instant avant de disparaître.
Bien sûr, si Homère, Sophocle, Montaigne ou Baudelaire avaient raisonné de la sorte, nous n’aurions pas le plaisir de lire leurs ouvrages aujourd’hui. Or nous sommes heureux de pouvoir les feuilleter sans cesse, ne serait-ce que pour ne pas devoir se pencher sur ces 676 romans dont on va nous rabattre les oreilles.
14:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (29) | Tags : littérature, rentrée littéraire
18/08/2008
Mahmoud Darwich (3)
Ainsi donc Mahmoud Darwich a bénéficié de funérailles nationales. C’est assez rare pour un poète et mérite que nous le soulignions. On pourrait comparer son enterrement à celui de Victor Hugo en France, lui aussi connu pour ses activités politiques. Car bien évidemment, c’est moins le poète que les Palestiniens ont célébré que l’infatigable défenseur d’un état palestinien. De même que les Occidentaux ont surtout vu en Soljenitsyne celui qui a condamné le goulag, beaucoup plus qu’ils n’ont vraiment apprécié l’écrivain.
Ceci étant dit, les différences entre les funérailles des deux hommes de lettres restent significatives. L’écrivain russe était retourné dans sa patrie, celle de ses jeunes années, qu’il avait trouvée changée (on peut tout de même espérer que c’était en mieux) et il a été enterré, comme il l’a voulu, selon le rite orthodoxe.
Mahmoud Darwich, lui, a reçu les honneurs d’un pays qui n’existe toujours pas. Quelque part, donc, cet hommage n’en est pas un puisqu’il émane du cœur des hommes mais n’est pas vraiment officiel.
De plus, s’il est bien revenu vivre en Palestine, c’est dans un pays étranger qu’il s’est retrouvé, en l’occurrence celui d’Israël (1). Sa situation est un peu comparable à celle d’un Alsacien d’expression française qui serait revenu en Alsace occupée en 1871. C’est chez lui et ce n’est pas chez lui.
Enfin, fait significatif entre tous, il a fallu demander l’accord de l’occupant israélien pour savoir où on allait l’enterrer. La logique aurait voulu que ce fût dans son village natal, en Galilée, mais ce privilège lui a été refusé. Il reposera donc bien en Palestine, mais pas dans son pays et encore moins dans son village, celui qu’il avait si bien chanté dans ses poèmes.
Ce village, c’était Birwa (Al-Birweh). Je dis « c’était » car il a été rasé en 1948 par les Israéliens et est devenu Akheï Ehud, à l’époque où ceux-ci construisaient leur état et jetaient sur les routes 750.000 Palestiniens. Il ne reste que le cimetière (2). Cela aurait tout de même suffi pour y inhumer notre poète, mais même cela lui fut refusé.
Il faut dire que si on se place du point de vue israélien, il était impossible de donner un tel accord. En effet, accorder une sépulture à un Palestinien en Galilée, c’était reconnaître que cette terre lui appartenait comme elle avait appartenu à ses ancêtres. En d’autres termes, outre le symbole politique dangereux qu’aurait représenté la tombe de Darwich, c’était prendre le risque de voir les descendants des 750.000 expulsés revenir prendre possession de leurs terres (je ne dirais pas de leurs biens puisque tout a été détruit).
Le cimetière lui-même est menacé. Son accès est contrôlé entièrement par deux municipalités juives, Yasur et Achihud, lesquelles ont pris possession de toutes les terres de l’ancien village.
Darwich savait que ce retour au pays natal lui serait refusé, aussi avait-il simplement manifesté le souhait d’être enterré en Palestine. D’où l’autorisation qui a été accordée de l’inhumer à Ramallah.
Pourtant, de son propre aveu, c’est le souvenir de ce village, d’où il a été chassé avec ses parents alors qu’il avait sept ans, qui est à l’origine de toute sa poésie, une poésie de l’absence, du souvenir et de la nostalgie.
Voici comme il s’exprimait :
« Je préfère garder les souvenirs qui s’attardent toujours dans des espaces ouverts, des champs de pastèques d’oliviers et d’amandiers. Je me souviens du cheval attaché au mûrier dans la cour et comment j’étais monté dessus avant qu’il me fasse tomber et que je sois puni par ma mère… Je me souviens des papillons et du net sentiment que tout était ouvert. Le village était sur une colline et tout s’étendait en contrebas.»
Plus rien n’est ouvert, aujourd’hui en Palestine. Ce qui n’a pas été détruit est maintenant isolé par le mur.
Certes, on aurait pu enterrer Darwich à Judeidi, le village arabe le plus proche de l’ancien Birwe (là où la famille du poète est revenue s’installer, le plus près possible de leurs anciennes terres). Mais comme disait son frère, Mahmoud n’était pas de Judeidi, il était de Birwe. Et sa mère, qui vit toujours (85 ou 95 ans selon les versions que j’ai consultées), avoue « Je voudrais que mon fils soit enterré ici, mais ce n’est pas que mon fils, c’est le fils du monde arabe tout entier.»
Sa mère !
J’ai la nostalgie du pain de ma mère,
Du café de ma mère,
Des caresses de ma mère...
Et l'enfance grandit en moi,
Jour après jour,
Et je chéris ma vie, car
Si je mourais,
J'aurais honte des larmes de ma mère !
Enfin, bref, voilà pourquoi Mahmoud, aujourd’hui, est enterré à Ramallah et non à Birwe.
Le comble, c’est que du coup les membres de sa propre famille ont dû demander des autorisations pour assister à l’enterrement. Comme Arabes ayant la citoyenneté israélienne, ils n’ont pas le droit de pénétrer dans des zones contrôlées par les Palestiniens telle que Ramallah.
Enfin, finalement, les difficultés furent aplanies et les Darwich purent voir le cercueil mis en terre. C’est déjà cela car Mahmoud, lui, après trois années consécutives d’assignation à domicile, avait été déchu de sa citoyenneté et on lui avait refusé le droit de voir sa famille jusqu’au milieu des années 90 (accords d’Oslo).
Quant à son œuvre poétique, elle est interdite dans les écoles israéliennes, même les écoles arabes.
Pauvre poète. Le voilà issu d’un village détruit et d’une terre confisquée. Enterré en dehors de sa Galilée natale, il repose certes en terre palestinienne, mais pas dans un état palestinien. Quant à ses textes, ils sont officiellement censurés chez lui, même s’ils sont lus par le monde entier. Car aucun mur, jamais, n’arrêtera la poésie et son message de liberté.
==========================================
1. Enfin pas vraiment. Depuis 2005, Israël a décidé de se désengager d'une partie de la Cisjordanie et de Gaza. Ces territoires sont donc « occupés par fait de guerre et ne font pas partie du territoire d’Israël, mais ils ne constituent pas non plus un état palestinien indépendant.
2. Pendant des années, les Palestiniens ont essayé d’empêcher les fermiers israéliens de faire paître leurs troupeaux dans le cimetière. Ils ont finalement pu mettre une clôture. Mais aujourd’hui, on construit une grande étable et celle-ci dresse sa structure métallique au-dessus des tombes. La maison du grand-père Darwich se trouvait près de l’entrée de ce cimetière. Des nombreux arbres fruitiers qu’il possédait, il ne reste qu’un grenadier. Un vieil habitant, qui avait 18 ans en 1948, conserve encore la clef rouillée de sa maison détruite et la montre à qui veut la voir.

23:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : littérature, mahmoud darwich
16/08/2008
Leo Ferré, "Le bateau espagnol"
Le Bateau Espagnol
J'étais un grand bateau descendant la Garonne
Farci de contrebande et bourré d'Espagnols
Les gens qui regardaient saluaient la Madone
Que j'avais attachée en poupe par le col
Un jour je m'en irai très loin en Amérique
Donner des tonnes d'or aux nègres du coton
Je serai le bateau pensant et prophétique
Et Bordeaux croulera sous mes vastes pontons
Qu'il est long le chemin d'Amérique
Qu'il est long le chemin de l'amour
Le bonheur ça vient toujours après la peine
T'en fais pas mon ami, je reviendrai
Puisque les voyages forment la jeunesse
T'en fais pas mon ami, je vieillirai.
Rassasié d'or ancien ployant sous les tropiques
Un jour m'en reviendrai les voiles en avant
Porteur de blés nouveaux avec mes coups de triques
Tout seul mieux qu'un marin, je violerai le vent
Harnaché d'Espagnols remontant la Garonne
Je rentrerai chez nous éclatant de lueurs
Les gens s'écarteront saluant la Madone
En poupe par le col et d'une autre couleur
Qu'il est doux le chemin de l'Espagne
Qu'il est doux le chemin du retour
Le bonheur ça vient toujours après la peine
T'en fais pas mon ami je reviendrai
Puisque les voyages forment la jeunesse
J' te dirai mon ami : à ton tour !
À ton tour...
Le thème du bateau, comme chez Rimbaud, symbolise le désir de partir au loin, vers des pays inconnus, des pays de rêve.
La Garonne elle-même, ce grand fleuve du Sud, contient déjà des éléments oniriques évidents. L’Amérique, dans l’imaginaire européen, est par définition le pays de tous les possibles depuis l’épopée de Christophe Colomb (voir aussi l’immigration italienne).
Le bateau de Ferré ne doit pas naviguer dans la légalité, on s’en doute. Il s’agit de prendre des chemins de traverse, d’où la contrebande.
Contrebande dont le bateau est « farci » histoire de montrer qu’il est rempli jusque dans ses moindres recoins de produits interdits. Ce terme « farci » connaît un prolongement avec le mot « bourré », qui dénote un aspect quantitatif.
Le thème de l’Espagne revient souvent chez Ferré. Dans son imaginaire, c’est l’Espagne de Garcia Lorca, de la guerre civile, bref un pays où, politiquement, on se bat contre le fascisme pour conquérir sa liberté. De plus, d’une manière générale, l’Espagne est un pays qui fait rêver (voir l’expression « bâtir des châteaux en Espagne »).
La Madone attachée en poupe par le col a de quoi surprendre. Habituellement, c’est une figure féminine à connotation érotique que l’on fixe à la proue du navire (notamment une sirène qui a de préférence les seins nus). Ici, il y a renversement de la situation classique : la statue se trouve à l’arrière du navire. Ainsi, au lieu de se dresser fièrement contre les flots et d’ouvrir symboliquement le passage , elle suit dans une attitude passive. D’ailleurs elle est pendue par le cou (allusion à la balade des pendus de Villon ?) et donc est balancée au gré des courants et des vents. De plus, il s’agit d’une madone, ce qui renvoie à un contexte religieux. Faut-il interpréter cela comme un acte de provocation de la part du capitaine du navire ? Sans doute. Au lieu de mettre son voyage sous la protection divine, en plaçant une statue de saint à l’avant, il fait suivre son bateau par cette madone qui pend ridiculement à l’arrière.
D’un autre côté, tout texte étant polysémique, le lecteur/auditeur est libre d’y trouver une autre interprétation. Ainsi la madone ne renvoie par forcément au contexte religieux. Elle est peut-être tout simplement un symbole de la virginité. Virginité de la jeune fille pure qui contraste avec les marins espagnols contrebandiers. Désir de tourner cette pureté en ridicule ? Peut-être, mais personnellement je pencherais plutôt pour une métaphore. Même si ce voyage est par définition répréhensible (on ne doit pas faire de contrebande comme on ne doit pas fait réaliser un pareil voyage au pays du rêve), il est placé tout de même sous le signe de la virginité. Non seulement il s’agit d’un premier voyage, mais le motif qui l’anime est pur : conquérir l’impossible.
Le but du voyage n’est pas d’aller fonder une colonie ou de piller ces contrées lointaines mais de « donner des tonnes d'or aux nègres du coton ». Une nouvelle fois on assiste à un renversement de la conduite habituelle. Ferré ne part pas en Amérique pour s’enrichir mais pour soulager les descendants des anciens esclaves. Comment ? En leur distribuant les « tonneaux d’or » que les Conquistadores ont volés aux Indiens.
Du coup, le bateau est dit « prophétique », ce qui replace l’expédition en cours sous le signe de la religion. Mais ici, il ne s’agira pas d’aller évangéliser les sauvages de force mais plutôt de soulager leurs misères. La bonté ne se trouve donc pas du côté des officiels (soldats ou religieux) mais du côté de ces contrebandiers au cœur tendre.
« Bordeaux » : allusion au port de l’Atlantique d’où partaient souvent les bateaux pour l’Amérique. Bordeaux c’est aussi la ville où Montaigne fut magistrat et même si rien n’indique que Ferré pensait à cela, rien n’empêche le lecteur, qui vient avec son propre imaginaire, de faire référence à cette haute figure de la littérature qu’était Montaigne.
Mais Bordeaux c’est aussi une ville indépendante, longtemps éloignée de la France puisque sous influence anglaise pendant une bonne partie du Moyen-Age. Bordeaux c’est le commerce du vin et une ville tournée vers le grand océan (idée de liberté).
« mes vastes pontons. » On s’attendrait plutôt à ce qu’il soit fait allusion aux larges quais de Bordeaux ou à ses embarcadères, mais une nouvelle fois nous assistons à un renversement des valeurs : c’est le bateau qui a de larges pontons et Bordeaux en sera tout ébranlé.
Ensuite, le poète nous indique bien que ce voyage vers l’Amérique n’est pas vraiment un voyage dans l’espace mais plutôt un voyage intérieur (initiatique ?). Il s’agit de conquérir l’amour, mais hélas, le chemin qui y mène est long.
Arrivé à ce stade, l’engouement du début semble marquer le pas et les marins découvrent la difficulté de leur entreprise. Comme chez Rimbaud, l’idée du retour surgit. («je reviendrai »)
« Rassasié d'or ancien » : idée de plénitude confinant au dégoût. Cet or est dit ancien probablement par référence à celui des conquistadores. « Les tropiques » renvoient à ce
monde mythique et imaginaire où le bateau est parvenu.
« Un jour m'en reviendrai les voiles en avant » : ici, pour le retour, les voiles sont en avant (on ne parle plus de la madone à la poupe).
« blés nouveaux » : le blé est le symbole par excellence de la germination. Ferré veut donc dire qu’il ramène des tropiques des souvenirs et des expériences qui vont fructifier dans sa nouvelle vie en Europe.
« je violerai le vent » : idée opposée à la virginité de la Madone. Le vent représente évidemment l’élément porteur mais il est aussi un élément hostile et dangereux. Le fait de le violer indique que c’est bien le marin qui est maître de sa destinée. C’est lui qui décide où ce vent va l’emporter.
Puis le voilà de retour au pays, « harnaché d'Espagnols, remontant la Garonne ».
« chez nous » est donc le foyer, le pays où on est né. Ferré revient chez lui, tel Ulysse revenant à Ithaque. Les gens saluent toujours la Madone, amis cette fois ils ne la contemplent plus, ils s’en écartent avec respect (ou crainte) car le poète est désormais porteur d’une vérité supérieure.
Madone qui est devenue d’une autre couleur à la suite du voyage. Effet de la mer et des grands vents ? Ou bien est-elle devenu une Indienne ?
« Qu'il est doux le chemin de l'Espagne » Car la Garonne prend sa source dans les Pyrénées espagnoles (massif de la Maladeta), ce qui permet de renvoyer à ce pays mythique pour Ferré. Le « chez nous » devient étrangement l’Espagne peut-être à cause du nombre d’Espagnols embarqués à bord, peut-être pour indiquer qu’on remonte jusqu’à la source. Dans tous les cas, il s’agit bien d’atteindre un pays hors du commun.
« Le bonheur ça vient toujours après la peine .» Sous la forme d’une sentence, Ferré indique que le bonheur est finalement ici, mais à condition bien entendu, d’être d’abord allé là-bas.
Conseil qu’il lance à son public : « A ton tour... »

01:52 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, léo ferré, le bateau espagnol
11/08/2008
Mahmoud Darwich (2)
« J’ai trouvé que la terre était fragile, et la mer, légère ; j’ai appris que la langue et la métaphore ne suffisent point pour fournir un lieu au lieu. (…) N’ayant pu trouver ma place sur la terre, j’ai tenté de la trouver dans l’Histoire. Et l’Histoire ne peut se réduire à une compensation de la géographie perdue. C’est également un point d’observation des ombres, de soi et de l’Autre, saisis dans un cheminement humain plus complexe. (…) Est-ce là simple ruse artistique, simple emprunt ? Est-ce, au contraire, le désespoir qui prend corps ? La réponse n’a aucune importance. L’essentiel est que j’ai trouvé ainsi une plus grande capacité lyrique, et un passage du relatif vers l’absolu. Une ouverture, pour que j’inscrive le national dans l’universel, pour que la Palestine ne se limite pas à la Palestine, mais qu’elle fonde sa légitimité esthétique dans un espace humain plus vaste. "
Mahmoud Darwich
Ainsi donc, cette Palestine qui lui a été refusée pour les raisons que l’on sait est devenue non seulement un pays concret qu’il convient de défendre et de revendiquer, mais aussi un lieu mythique et pour ainsi dire imaginaire (ou en tout cas qui ouvre les portes à l’imagination), la terre rêvée par tous les poètes du monde entier. Partant de son expérience personnelle (l’exil et la séparation) et de celle de son peuple (l’occupation), Darwich ne se contentera pas d’une revendication politique, il fera beaucoup plus en chantant d’une manière lyrique son pays perdu. Pays qui n’est plus simplement la Palestine dont on nous parle tous les jours à la télévision, mais une terre inconnue, une terre de poésie où règnent les mots et l’espoir d’un monde meilleur. De même que Pablo Neruda, dans son « Canto general » ne parle pas seulement du Chili mais de tous les opprimés en général, Darwich, dans son œuvre, nous invite à un voyage vers une terre plus belle, plus humaine, une terre, malheureusement qui n’existe que dans l’univers sacré de la poésie.
Sur le même thème, voir ici.
Les étoiles n’avaient qu’un rôle :
M’apprendre à lire
J’ai une langue dans le ciel
Et sur terre, j’ai une langue
Qui suis-je ? Qui suis-je ?
Je ne veux pas répondre ici
Une étoile pourrait tomber sur son image
La forêt des châtaigniers, me porter de nuit
Vers la voie lactée, et dire
Tu vas demeurer là
Le poème est en haut, et il peut
M’enseigner ce qu’il désire
Ouvrir la fenêtre par exemple
Gérer ma maison entre les légendes
Et il peut m’épouser. Un temps
Et mon père est en bas
Il porte un olivier vieux de mille ans
Qui n’est ni d’Orient, ni d’Occident
Il se repose peut-être des conquérants
Se penche légèrement sur moi
Et me cueille des iris
Le poème s’éloigne
Il pénètre un port de marins qui aiment le vin
Ils ne reviennent jamais à une femme
Et ne gardent regrets, ni nostalgie
Pour quoi que ce soit
Je ne suis pas encore mort d’amour
Mais une mère qui voit le regard de son fils
Dans les œillets, craint qu’il ne blessent le vase
Puis elle pleure pour conjurer l’accident
Et me soustraire aux périls
Que je vive, ici là
Le poème est dans l’entre-deux
Et il peut, des seins d’une jeune fille, éclairer les nuits
D’une pomme, éclairer deux corps
Et par le cri d’un gardénia
Restituer une patrie
Le poème est entre mes mains, et il peut
Gérer les légendes par le travail manuel
Mais j’ai égaré mon âme
Lorsque j’ai trouvé le poème
Et je lui ai demandé
Qui suis-je ?
Qui suis-je ?
10:35 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, mahmoud darwich
10/08/2008
Mahmoud Darwich
""Mais nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir de libération et d'indépendance. Espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros, ni victimes. Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école. Espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé vivant, dans un hôpital, et pas à un enfant mort devant un poste de contrôle militaire. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. Espoir que cette terre retrouvera son nom original : terre d'amour et de paix. Merci pour porter avec nous le fardeau de cet espoir. "
Mahmoud Darwich, poète palestinien, qui s’est éteint samedi à l’âge de 67 ans.
Décidément, ce blogue commence furieusement à ressembler aux pages nécrologiques des quotidiens. Après Soljenitsyne, c’est donc le plus grand poète de langue arabe, en tout cas le plus connu, qui est décédé. Nous avions parlé de lui ici.
De même que l’écrivain russe a d’abord été reconnu pour son opposition au régime de Staline, Darwich l’a été pour son combat contre l’occupation israélienne. Pourtant, l’un comme l’autre sont avant tout des hommes de lettres et leur pensée fut bercée par le souffle des mots. Darwich lui-même, qui pleurait son pays occupé, avait compris à un certain moment que son succès auprès de ses compatriotes palestiniens venait surtout de ses prises de positons politiques (voir le poème « l’Arabe ») alors que lui souhaitait retourner à des chants plus personnels et authentiques : peindre la beauté de sa terre de Galilée. Mais comment, évidemment, chanter cette terre si elle vous a été ravie et si chaque jour de nouvelles colonies viennent grignoter le peu qu’on vous avait laissé ? Comment se taire lorsqu’un mur sépare désormais les habitants d’un même lieu, accordant tout aux uns et rien aux autres et excluant arbitrairement ces derniers du droit de fouler le sol de leurs ancêtres ?
Bien sûr il y a les attentats. Mais pourquoi y a-t-il des attentas ? Le gouvernement israélien devrait le savoir puisque beaucoup de ses ministres historiques en avaient pratiqué eux-mêmes avant 1948 contre l’occupant anglais. Tout est question de succès, évidemment. Nos propres résistants qui faisaient sauter des ponts en 1943 étaient catalogués de terroristes par les Allemands. Ils ne devinrent des héros qu’à la libération.
En attendant, on est loin d’avoir trouvé une solution en Palestine et nos enfants ont beau demander à leurs parents pourquoi Juifs et Arabes ne parviennent pas à s’entendre, ces pauvres parents ne parviennent pas à donner une réponse, tant la situation est complexe. Il y a eu trop de morts de part et d’autres pour que chaque camp puisse oublier.
Et voilà, pour couronner le tout, que le peuple palestinien est maintenant divisé et plonge dans la guerre civile (Hamas/ Fatah) tandis que son plus grand poète vient de quitter définitivement la scène.

23:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, mahmoud darwich
07/08/2008
Soljenitsyne
Dommage d’ouvrir à nouveau ce blog et de devoir commencer par le décès de Soljenitsyne. C’était là assurément ce qu’on appelle un grand écrivain. Ce qui me dérange, cependant, c’est que l’Occident a surtout vu en lui l’opposant au régime communiste et c’est cet homme manifestement qu’il honore aujourd’hui, en insistant bien sur les chants orthodoxes qui sont désormais permis en Russie post-stalinienne.
En réalité, Soljenitsyne était beaucoup plus que cela. D’abord, ce fut un opposant aux régimes dictatoriaux, dont il a dû subir l’injustice. Il se fait que là où il se trouvait ce régime était communiste, mais eût-il été fasciste qu’il se serait indigné de la même façon, ne l’oublions pas.
Car c’est à cela qu’on reconnaît un grand homme, dans le fait qu’il ose s’attaquer seul à des systèmes puissants et surtout dans le fait qu’il reste fidèle toute sa vie à la ligne de conduite qu’il s’est tracée, sans jamais se laisser influencer.
Ensuite, il ne faut pas perdre de vue son génie d’écrivain. Il a fait autre chose que de dénoncer un pouvoir inique (ce qui est déjà beaucoup), il a su en parler en maniant les mots avec dextérité et en agençant son récit de main de maître.
Enfin, c’est quelqu’un qui se penchait avec compassion sur la vie des hommes, dont il a tenté de peindre la destinée dans ses romans. Je pense surtout au « Pavillon des cancéreux », qui constitue un sommet sur la réflexion devant la mort inéluctable qui approche.
Pour terminer, n’oublions pas qu’il se sentait profondément russe et qu’il est retourné vivre dans sa patrie dès qu’il l’a pu. N’en faisons donc pas un chantre du libéralisme, ce qu’il n’était pas. Lui, il luttait pour la dignité humaine, ce qui est un tout autre combat.

00:59 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, soljenitsyne
10/07/2008
Numérisation des livres
On apprend que la ville de Lyon serait sur le point de choisir Google pour numériser les 500 000 livres anciens de sa bibliothèque municipale.
Google s’occupe déjà de la numérisation de l'université d'Oxford.
D’un côté, il faut se réjouir de cette numérisation, qui, d’une part, offre une solution au fait que les livres se dégradent et qui, d’autre part, les rend accessibles à tous. D’un coup de souris, il vous est alors possible de consulter des ouvrages situés à l’autre bout du monde, des ouvrages dont nous n’aurions même jamais soupçonné l’existence autrefois.
Il avait été question également de numériser la Bibliothèque nationale de France (BNF), mais certains avaient fait remarquer, à juste titre, que le choix des livres ne devait pas être fait par Google lui-même, qui travaillait dans un esprit trop « américain ». C’est vrai que nous sommes là devant un dilemme. Soit laisser nos livres prendre la poussière et rester inconnus (or à l’ère du numérique, il faut se montrer et être visible), soit en sortir un certain nombre de l’oubli, mais savoir que d’autres seront sacrifiés. Le problème est donc celui du choix. Quel critère retenir et qui va décider de ce critère ?
Mine de rien, c’est un débat idéologique qui s’engage ici. Prenons la période de la fin de l’Ancien Régime. Vais-je privilégier les livres conservateurs ou au contraires ceux qui annoncent la Révolution ? On le voit, selon le choix que j’aurai fait, j’orienterai la perception que l’on aura de cette époque. Voire même j’orienterai nos conceptions actuelles. Imaginons que les créationnistes détiennent majoritairement les actions de Google, il y a fort à parier qu’ils ne vont pas numériser les œuvres de Darwin ou en tout cas qu’ils censureront les passages les plus compromettants pour leur théorie. On pourrait d’ailleurs imaginer qu’on ne numérise qu’une partie d’un ouvrage, faussant ainsi la diffusion de certaines idées. Bon, je vais peut-être trop loin dans mon raisonnement, mais on n’est jamais assez prudent quand il s’agit de la diffusion du savoir.
De toute façon, les carottes sont déjà cuites, si je puis m’exprimer ainsi. Il est clair que les oeuvres américaines et finalement européennes vont se retrouver sur la Toile. Mais qu’en est-il des autres cultures ? Verra-t-on les contes africains (qui appartiennent encore souvent à la littérature orale) faire partie des pages consultables ? Non bien sûr. Et s’il existe en Amérique latine des bibliothèques qui possèdent des livres rares (sur la découverte du Nouveau Monde, par exemple), les pays qui les possèdent auront-ils les moyens de faire numériser leurs archives ? Probablement pas. Du coup, n’étant pas présents sur Internet, ces livres resteront dans l’ombre, ce qui permettra à une seule culture (occidentale, mais surtout américaine) de s’imposer dans le monde.
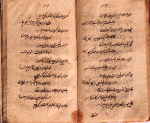
22:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : numérisation des livres








