22/09/2008
"Une Femme" d'Annie Ernaux
Je termine le livre Une Femme qu’Annie Ernaux a écrit à la mort de sa mère (atteinte de la maladie d’Alzheimer) pour tenter de faire revivre celle-ci et de l’immortaliser par l’écriture au moment précis où elle disparaît définitivement. L’auteure espère ainsi, par ce biais, retrouver le lien qui l’unissait à cette mère, mais aussi tracer le portrait de cet être qui a existé en dehors d’elle (en dehors, donc, de la relation mère/fille). Inconsciemment, donc, Annie Ernaux se retrouve d’un côté dans la position de la petite fille qui évoque ses souvenirs mais aussi d’un autre côté dans celle d’une mère puisque c’est elle, par ses mots, qui redonne naissance à la défunte. Ce livre, qu’elle mettra un an à écrire, est donc une sorte d’accouchement. Il s’agit de donner le jour à un personnage dont elle n’a connu finalement qu’un des aspects et de tenter de le faire revivre en étant fidèle au contexte historique dans lequel s’est déroulée sa vie.
Le début commence comme dans l’Etranger de Camus par une phrase forte : « Ma mère est morte le lundi 7 avril à la maison de retraite de l’hôpital de Pontoise, où je l’avais placée il y a deux ans. » (p.11)
Tout est déjà dit par cette simple phrase. On perçoit la déroute de l’auteure suite à cet événement dramatique mais aussi sa culpabilité latente d’avoir dû placer sa mère quand celle-ci avait perdu la raison.
Le livre retrace donc le parcours de cette mère, qui vivait en Normandie, dans un milieu modeste (ouvrier), mais qu’elle tentera de quitter en s’élevant un peu socialement (petit commerce). C’est elle qui poussera sa fille Annie à faire des études, à « s'en sortir » mais en faisant cela elle la fera passer de l’autre côté de la barrière, dans le monde bourgeois et cultivé où elle-même n’aura jamais accès. D’un côté, donc, elle sera fière du parcours de son enfant, mais de l’autre, cet enfant, elle l’aura perdu car elle ne la comprendra plus vraiment (et réciproquement).
L’écriture a finalement un rôle cathartique pour Annie Ernaux :
« Il fallait que ma mère, née dans un milieu dominé, dont elle a voulu sortir, devienne histoire pour que je me sente moins seule et factice dans le monde dominant des mots et des idées où, selon son désir, je suis passée. » Alors qu’Annie, adolescente, fuyait sa mère (dont elle ressentait cruellement le côté populaire au point d’en éprouver une certaine honte) elle va pourtant l’accueillir chez elle lorsque celle-ci sera âgée (mais en retrouvant cette impression d’être épiée dans son comportement d’intellectuelle). A la fin, lorsque la démence sera là, elle l’aura perdue une nouvelle fois, mais c’est la mort, évidemment, qui scellera l’adieu définitif :
« Je n'entendrai plus sa voix... J'ai perdu le dernier lien avec le monde dont je suis issue. »
Car si Annie Ernaux se sent coupable envers sa mère (de l’avoir reniée socialement et d’avoir dû la placer), elle éprouve également un certain malaise vis à vis de sa classe d’origine : elle ne la comprend plus et s’y sent mal à l’aise, mais elle n’oublie pas qu’elle en est issue et qu’une partie d’elle-même puise donc ses racines là. La disparition de la mère coupe donc définitivement les ponts avec un monde révolu. D’où la nécessité d’écrire tout cela pour retrouver la paix intérieure.
En lisant ce livre, je me demandais dans quelle catégorie il convenait de le ranger. Car finalement, écrire sur ses parents, est-ce déjà de la littérature ou bien est-ce que cela relève du journal intime ? A un certain moment, l’auteur donne elle-même la réponse :
« Ce que j’espère écrire de plus juste se situe sans doute à la jointure du social et du familial, du mythe et de l’histoire. Mon projet est de nature littéraire, puisqu’il s’agit de cherche rune vérité sur ma mère qui ne peut être atteinte que par des mots. (C’est-à-dire que ni les photos, ni mes souvenirs, ni les témoignages de la famille ne peuvent me donner cette vérité.) Mais je souhaite rester, d’une certaine façon, au-dessous de la littérature. » (p. 23)
Annie Ernaux considère donc que le fait d’utiliser les mots rattache d’emblée son travail à la littérature (tout en insistant sur le fait qu’il y a une part personnelle importante qui fait qu’elle reste un peu en dessous).
Evidemment, si elle s’était juste contentée de retracer pour elle seule un portrait de sa mère, on n’aurait pas pu qualifier son livre de littéraire. Mais elle va au-delà de la peinture individuelle en replaçant cette mère dans son contexte historique et social :
« J'essaie de ne pas considérer la violence, les débordements de ma mère comme seulement des traits personnels de caractère, mais de les situer aussi dans son histoire et sa condition sociale. Cette façon d'écrire, qui me semble aller dans le sens de la vérité, m'aide à me sortir de la solitude et de l'obscurité du souvenir individuel, par la découverte d'une signification plus généreuse. »
Petite fille, elle a donc connu sa mère avec certains traits de caractère qu’elle a crus lui être propres. Adulte, elle se rend compte qu’une bonne partie de ce caractère était lié à l’appartenance à une classe sociale bien définie (parler fort, déplacer les objets en faisant du bruit, etc.). Ecrire tout cela dépasse donc le simple compte-rendu individuel et permet d’atteindre une vérité plus générale. C’est en ce sens, à mon avis, que ce livre appartient de plein droit à la littérature.
Mais une fois ce point acquis, qui rassure l’écrivain, un autre doute surgit, qui concerne la petite fille que fut Annie :
« Mais je sens que quelque chose en moi résiste, voudrait conserver de ma mère des images purement affectives, chaleur ou larmes, sans leur donner un sens. »
En livrant sa mère aux lecteurs, elle la sauve de l’oubli mais elle en fait aussi un personnage quasi public, qui ne lui appartient plus vraiment. Autre paradoxe de l’écriture…
Finalement, demeure le problème de savoir dans quelle catégorie on va placer ce livre, puisque c’est bien de la littérature.
« Ceci n’est pas une biographie, ni un roman naturellement, peut-être quelque chose entre la littérature, la sociologie et l’histoire."
Comme quoi, rien n’est simple quand on se met à écrire pour clarifier ses pensées et exorciser ses démons.

22:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (25) | Tags : littérature, annie ernaux, "une femme"


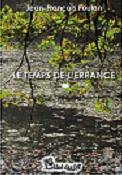



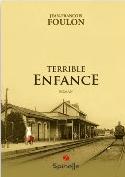
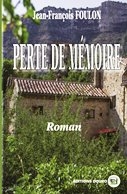
Commentaires
Elle passait avec ces deux livres, du roman (ses trois premiers livres) au non-roman. Choisissant la voie étroite qui lui permettait de rester dans la saisie des signes de la réalité de la vie de ses parents.
Un livre "entre" oui, car toujours chez elle le sentiment d'être entre deux mondes. Celui de l'origine, marqué par le langage des choses et de la nécessité, une langue d'une grande violence aussi, et puis le monde des livres, de la culture légitime. Je me souviens d'une rencontre avec elle où elle disait sa difficulté à resituer les choses dans l'Histoire, car elle avait la mémoire de ses sensations, pas de ce qu'elle pensait.
Presque dix ans après "Une femme", Annie Ernaux a publié "Je ne suis pas sortie de ma nuit" : c'était une phrase de sa mère, une phrase que sa mère avait écrite à une amie, lorsqu'elle était chez elle. Et ce texte publié, c'était le journal que tenait Ernaux pendant la maladie de sa mère et qu'elle avait rangé parce que ça la culpabilisait d'y noter ce que disait sa mère malade. Elle a fini par le publier car il contenait, disait-elle, une vérité différente de ce qu'elle avait écrit dans "Une femme".
J'ai lu tous les livres d'Annie Ernaux et votre chronique me touche beaucoup par sa justesse. C'est celle du lecteur idéal que rêve sûrement Annie Ernaux. Ce n'est pas un jugement, non plus un compliment, juste une évidence.
Écrit par : michèle pambrun | 23/09/2008
Vertige...
Écrit par : christiane | 23/09/2008
Écrit par : Feuilly | 23/09/2008
Et puis il y a eu la lecture de ses petits carnets. Nous l'avions toujours vu les écrire, nous disant : - vous n'aurez le droit de les lire qu'après ma mort ! Et ce temps était venu et nous nous glissions, mon frère et moi, dans ces petites notes écrites au jour le jour, modestes et simples, et combien émouvantes, captant les mille et un faits de nos vies, égrenant les repas, les fêtes, les rendez-vous chez les médecins, les naissances, les vacances... Le dernier jour , elle avait noté : "Il fait si doux...", par trois fois cette petite phrase..." Il fait si doux" et puis rien ! Plus un mot, rien...
Quel chemin périlleux que celui d'écrire une mère, de mettre au monde une mère après sa mort.
Passer des "années" à ce livre-là, c'est naturel et déchirant... Déchirer...un voile...
Déjà "Les années" l'avaient introduite dans une fête crépusculaire, alors, ce dernier livre si finement et lentement cheminé par vous, Feuilly, ouvre une béance dans le temps des paroles de filles... Vous lisez différemment des critiques littéraires de "rentrée", lentement, attentivement, savourant chaque mot du livre que vous avez choisi, lui accordant le temps qu'il exige de vous et laissant tous les autres livres en attente, tranquillement... Avant, c'était "Palestine" et là aussi, le temps s'était arrêté...et par vous, nous glissons non pas dans une lecture, mais dans votre lecture et peu à peu, si l'on dresse l'oreille , on entend, deux voix...
Écrit par : christiane | 23/09/2008
Écrit par : christiane | 23/09/2008
Je préfère le mot de "chronique"(donc chroniqueur) qui évite la connotation négative qu'on peut mettre parfois dans la critique.
Le Magazine des livres de mai-juin 2008 va être en rupture de stock!
Écrit par : michèle pambrun | 23/09/2008
Écrit par : michèle pambrun | 23/09/2008
Écrit par : christiane | 23/09/2008
Pour le reste, un véritable critique littéraire fait cela à temps plein et est payé pour cela. Je reste donc du côté des amateurs.
Écrit par : Feuilly | 23/09/2008
Écrit par : christiane | 23/09/2008
Quant à dire que vous ne nous payez pas, hum, c'est à voir. Enfin, je ne parle que pour moi.
Et troisièmement (puisque tout va par trois au matin du monde), évoquer le travail d'écriture n'a rien à voir avec la psychanalyse, que nous chantez-vous là ?
Dire qu'un écrivain c'est d'abord celui qui lit beaucoup est un rappel qui me semble essentiel.
S'il y avait un quatrièmement, je dirais qu'à partir de maintenant, les compliments seront facturés encore plus cher !
Écrit par : michèle pambrun | 23/09/2008
Écrit par : solko | 23/09/2008
Écrit par : Feuilly | 23/09/2008
Écrit par : solko | 24/09/2008
Par ailleurs, je n'aime pas l'auto-fiction contemporaine qui est effectivement désespérément narcissique et je ne la lis jamais. Ici, cependant, il y a une dimension disons existentielle en plus, une sorte de fatalité (le milieu social) qui pèse de tout son poids. C'est la liberté de l'individu qui est en jeu. Et en même temps cet individu a intériorisé comme faisant partie de lui des notions qui ne sont finalement que sociales et éphémères. D’où un certain malaise pour parvenir à se définir soi-même.
Écrit par : Feuilly | 24/09/2008
Ah bon vous trouvez, vous, qu'on peut ne pas tenir compte des conditions sociales ? Vous rigolez j'espère ?
Écrit par : michèle pambrun | 24/09/2008
Justement, le côté social extérieur est déterminant dans la formation de l'individu. Mais il est éphémère aussi. Les idées et les mentalités changent.
Écrit par : Feuilly | 24/09/2008
Ce qui ne change pas par contre, ce sont les inégalités sociales, de plus en plus criantes.
Écrit par : michèle pambrun | 24/09/2008
J'aime énormément Annie Ernaux car, comme vous le faites ressortir, bien qu'elle se décortique constamment, en particulier dans ses relations avec son milieu, elle oublie son ego pour nous toucher et nous intéresser, évitant ainsi le nombrilisme ce qui est une performance dans la littérature française actuelle.
Avez-vous lu Les Années ?
Très intéressant également, comme toute son oeuvre.
Écrit par : Rosa | 25/09/2008
Le spleen concernait la tournure que prenait le blogue, qui commençait un peu à faire café du commerce, où l'on parlait de tout et de rien. Il est recentré sur l'aspect littéraire et se veut plus intimiste. Reste le problème des commentaires qui sont certes toujours intéressants mais qui risquent de rompre ce côté disons... discret. Il m'appartient sans doute de les canaliser pour qu'ils restent bien dans la droite ligne du billet auquel ils se rapportent.
Écrit par : Feuilly | 25/09/2008
Le café du commerce c'est moi (très assumé) et je n'ai jamais vu que votre blogue prenait cette tournure.
Écrit par : Rosa | 26/09/2008
Encore bravo.
Écrit par : Léthée | 24/10/2008
Sinon, dans "la mort du petit cheval" de Bazin on doit pouvoir trouver quelque chose (mais j'ai lu cela adolescent, cela remonte loin).
Il y a aussi "Le livre de ma mère" d'Albert Cohen.
Il faudrait aussi aller fouiner chez Duras, qui parle tout le temps de sa mère.
Je pense encore à Nicole Malincoli, auteure belge: "Nous deux" chez labor
Écrit par : Feuilly | 24/10/2008
pourquoi ernaux n`a pas de nom pour les personnages dans (une femme) ? pourquoi l`absence de nom des personnages.?
Écrit par : karwan | 03/04/2013
Écrit par : Feuilly | 03/04/2013
Les commentaires sont fermés.