24/09/2008
Les lauzes
Dans un de ses billets, consacré à l’automne qui arrive, Angèle Paoli parle des lauzes.
« Je me chauffe au soleil, sur le fil du lézard. Qui file sa trajectoire sur les lauzes. »
Ce terme « lauze » ne m’était pas inconnu, mais je l’avais un peu perdu de vue. Évidemment, ici, il est surtout amené par sa sonorité, proche de celle de lézard, mais le sens aussi est respecté, puisque la lauze désigne la pierre plate que l’on utilisait dans le Sud de la France pour faire les toits.
Le terme a une orthographe incertaine (lauze, lause ou même lose) et, curieusement, il n’est repris sous aucune des trois formes dans mon Petit Robert et je ne l’ai trouvé que dans le Grand Larousse de la langue française en sept volumes.
Le mot provient de l’ancien provençal « lauza », lui-même issu du gaulois « lausa », qui signifiait dalle. Au XVI° siècle, on le retrouve dans l’expression « pierre lause » Il s’agit bien d’une pierre plate détachée par lits et utilisée comme dalle ou pour couvrir les bâtiments. Manifestement, la pierre en question doit être du schiste et pourtant le dictionnaire donne le terme « lave « comme synonyme. Il précise aussi que dans la région de Saint-Étienne, la lauze désigne un grès houiller micacé.
Le Robert historique, toujours aussi précieux, précise que l’usage de la lauze s’étendait de la Provence à la Lorraine et que le terme a été utilisé par Stendhal (il est vrai qu’il était originaire de Grenoble et qu’il n’a fait là que reprendre un régionalisme, peut-être à son insu). Ceci dit, pour ce qui est de l’origine du mot, Alain Rey nous renvoie, via le gaulois, à un mot inconnu d’origine préceltique et probablement non indo-européen. On ne peut être plus vague, mais finalement ces origines obscures, qui remontent à la nuit des temps, ont elles aussi leur charme.
Ce qui est étonnant, cependant, c’est que ce terme, qui a bien transité par le gaulois, n’ait finalement survécu que dans la partie méridionale du pays. Le massif armoricain et le massif ardennais connaissaient pourtant aussi ce genre de toiture faite de pierres entrecroisées. Quel nom leur donne-t-on dans ces régions ? J’avoue que je l’ignore.
En cherchant sur Internet, je trouve ceci sur un site professionnel d’ardoisiers :
Aussi appelée "ardoise de montagne",
la lauze est le produit rustique par excellence,
brut de clivage, épais, il résiste à tout.
Adaptée aux conditions extrêmes, la lauze fera merveille
l'hiver dans les zones très enneigées, ainsi que l'été
pour conserver la fraîcheur d'une maison en pierre.
Son aspect de pierre naturelle permet une intégration
harmonieuse dans le paysage.
L’explication réside peut-être dans le fait que le Midi est resté plus authentique par certains côtés que le Nord et que l’habitat traditionnel y a perduré d’autant plus facilement qu’il offrait des avantages (résistance au poids de la neige en montagne et fraîcheur pour les étés torrides des plaines).
Remarquons que notre mot losange vient lui aussi du gaulois « lausa », pierre plate, dalle. Par la suite, c’est la forme géométrique de ces pierres qui a prévalu et le mot est d’ailleurs devenu masculin au XVIII° siècle sous l’influence du genre des autres noms désignant des formes géométriques (carré, rectangle, etc.).
Quand je consulte le Robert historique pour le mot losange, je m’aperçois qu’il se montre aussi perplexe que moi. Il dit en effet que le terme viendrait du gaulois « lausa » , ce qui, sémantiquement, semble satisfaisant comme explication, mais il signale le problème géographique, le mot étant surtout limité à l’aire provençale et franco-provençale. Du coup, certains linguistes ont émis l’hypothèse d’une origine orientale avec l’arabe « lawzinag », mot désignant un gâteau (d’après lawz, amende). En réalité rien ne permet de retracer l’évolution du mot et le sens de gâteau, attesté en français au XIV° siècle, pourrait n’être qu’une analogie de forme avec le losange. Des spécialistes, cependant, veulent voir une origine arabe commune pour les mots « losange » (au sens de gâteau), «lasagne » et son synonyme provençal « lauzan. »
Nous voilà bien loin des toitures en pierre et plus loin encore du lézard du poème qui paressait au soleil.
12:19 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : lauze


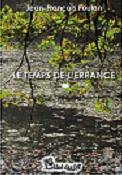



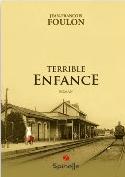
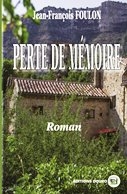

Commentaires
Écrit par : Cigale | 24/09/2008
Écrit par : Feuilly | 24/09/2008
Harpé : Superposition de pierres appareillées alternativement longues et courtes.
Fenestrou : Petite fenêtre pour l'aération.
Mur gouttereau : Mur latéral placé sous la gouttière du toit, par opposition au mur pignon.
Refend : Mur à l'intérieur de la maison.
Volige : Planche utilisée en couverture pour composer un platelage jointif ou non destiné à fixer les ardoises.
L'ardoise de Bigorre est un schiste dur qui ne se débite pas facilement, elle est en plaques épaisses de 15 à 30 cm. Posée sur les toits à forte pente, elle est traditionnellement clouée sur une volige en bois de peuplier ou de sapin.
(Extrait de "Maisons du Pays des Coteaux" - CAUE des Hautes-Pyrénées)
J'irai voir le lézard du poème.
Écrit par : michèle pambrun | 24/09/2008
http://www.vivreaupays.fr/photos/portes/fenestrou.shtml
Écrit par : Feuilly | 25/09/2008
J'ai regardé longtemps ces pierres taillées pour le temps qui passe... J'ai touché des lauzes et senti cette respiration de la pierre qui unit la maison et la terre...
Et ce mot, ce matin, traverse ce temps qui fuit et me murmure quelque chose venu du temps d'avant, un chant d'anciens...de vignes et de vent...
Écrit par : christiane | 25/09/2008
Écrit par : debla | 25/09/2008
Les bories, en effet, ont toujours des toits de pierre.
Écrit par : Feuilly | 25/09/2008
Elle a plus d'un siècle, et ne semble pas donner des signes de faiblesse...
C'est pas comme chez moi : ma toiture à 30 ans et semble malheureusement se rapprocher des soins palliatifs...
Écrit par : alainx | 25/09/2008
Je laisse ce message ici, puisque votre site, que je découvre, fait une pause.
Bons et beaux voyages !
Écrit par : michèle pambrun | 25/09/2008
Écrit par : debla pour Michèle Pambrun | 25/09/2008
En réalité c’est l’inverse qui semble s’être produit. De louange à losange. Du contenu symbolique à la forme qui le tenait enclos. Littré évoque l’héraldique, les armoiries destinées à la louange d’une famille seigneuriale, étant encloses, en héraldique, dans des losanges.
D’autre part, toujours d’après Littré, le provençal « lausa » désigne la pierre sépulcrale et l’espagnol « lauda/losa » (du latin « laudes », louange), au-delà de la pierre tombale, le tombeau entier. Que de tropes !
NOTE : les commentaires d’Alain Rey et de son équipe sont fortement inspirés de ceux du TLFi, dont c’est un bonheur de savoir qu’il est consultable en ligne.
Écrit par : Angèle Paoli | 27/09/2008
Pourquoi je n'ai pas parlé de la louange? Et bien d’abord parce que cela ébranlerait toute ma théorie qui dit que « losange » vient lui aussi du gaulois « lausa », mais surtout parce que le spécialiste qu’est Alain Rey n’en dit pas grand chose :
« Le mot est d’origine controversée bien qu’indiscutablement à dissocier de son homonyme ancien français « losenge » (flatterie, mensonge) lequel vient du francique « lausingua ».
Ensuite, Alain Rey reconnaît, comme je l’ai signalé, que si « lausa » au sens de pierre est satisfaisant sémantiquement, il ne l’est pas géographiquement puisque l’usage du mot est essentiellement provençal, du moins à ses débuts. Pourquoi ne couvre-t-il pas toute l’aire francophone ?
Maintenant, tout est toujours délicat en étymologie car après avoir fait remonté « losenge » (flatterie) au francique « lausingua », on nous dit par ailleurs que « louer » vient de « laudare », d’après « laus, laudis » (éloge, mérite, gloire) et renvoie à l’appel funèbre que l’on adressait à un défunt, avant de désigner l’éloge funèbre proprement dit.
Notre mot « louange » a perdu son sens de « titre de gloire » (sauf dans les expressions « chanter les louanges » et «c’est tout à sa louange ») pour prendre celui « d’action de louer », éliminant du même coup l’ancien français « los » du latin « laus /laudes au pluriel). Quant à ce « laudes », il ne survivrait que dans le terme liturgique « laudes ».
En résumé :
Laudare a donné louer
Laudes a donné los qui a disparu et laudes qui a survécu (liturgie)
Louange, orthographié löange vers 1120 vient de… Le dictionnaire ne le dit pas en fait, se contentant de le distinguer de « losenge » (flatterie) d’après le francique « lazusingua ».
Ce silence est inquiétant et peut-être en effet faut-il faire remonter ce « löange » à « losange » et suivre Littré dans son hypothèse. Il est certain qu’en héraldique les armoiries destinées à la louange d’une famille seigneuriale (encloses, donc, dans des losanges) renvoient bien à l’idée de faire l’éloge de cette famille, de vanter ses mérites. De « laudare » on aurait eu « löange » (mérite), puis, par le biais de l’héraldique, on serait passé du contenu symbolique à la forme qui le tenait et « losange » aurait désigné la forme géométrique que l’on connaît, passant du genre féminin (comme « lauda ») au masculin sous l’influence du genre des autres formes géométriques. (carré, rectangle, etc.).
Il y a de quoi y perdre son latin !
Écrit par : Feuilly | 27/09/2008
Je n'ai pas réussi à expliquer cela à B.Redonnet. Pourtant, c'est uniquement cela que j'essayais de lui dire. J'avais trouvé que sa chanson, délicieuse, était devenue agressive par son drôle de chapeau : "aux flagorneurs de tout poils..."
J'ai longtemps travaillé auprès des enfants et ils savaient louer et recevoir les louanges avec autant de simplicité qu'éclater de rire ou bondir de joie. Le monde des adultes est plus compliqué : il faut toujours se retenir et cacher ses sentiments, les sasser, ne pas avoir des mots immodérés. Je ne sais pas parler comme cela, en rapetissant les mots, en les décolorant.
C'est comme une peinture de Nolde : mes rouges sont vibrants, comme mes bleus et mes jaunes, sauvages et bouillonnants et parfois juste calmes et paisibles...
Enfin...
Je n'y perds pas mon latin ! mais ma langue comme le Gaspard de Petre Handke...
Bonne soirée à vous deux...
Écrit par : christiane | 28/09/2008
Écrit par : Feuilly | 28/09/2008
J'explore, je fouille dans les strates lointaines du langage qui était le mien avant... J'en suis rendue à la langue de l'enfance dans une vieille expérience d'adulte. La rencontre des deux fait une langue hybride qui ne sourd que si je la laisse aller sans la contrôler. Cela m'intéresse comme de retrouver de vieux manuscrits ou de vieilles photos. C'est avec cette langue que je fonctionne sur une dizaine de blogs, dont le vôtre. Elle est tout sauf flagorneuse ! Je la risque sur ces blogs parce qu'il y a du vrai inédit et du lourd ! C'est passionnant ! De l'imprévu total qui laisse rarement indifférent et qui oblige à sortir de soi, à se lancer à l'aventure d'un dialogue parfois difficile, opaque... Mais comme c'est bon. C'est une activité intérieure intense, qui rassemble toute notre énergie, le temps d'un dialogue. C'est une sacrée découverte. On en prend plein les mirettes !, un plaisir de ce qui est écrit et de l'art avec lequel c'est écrit, une langue bien organisée que j'apprécie en esthète , un souffle que j'apprécie par le coeur. Voilà, l'aventure qui me retient chez vous et chez mes 9 autres amis. Avec , ici, en plus le bonheur de retrouver certains commentateurs.
Écrit par : christiane | 28/09/2008
Écrit par : Feuilly | 28/09/2008
Non, je ne règle pas des différends avec Bertrand, je réfléchis au langage et c'est ma dernière expérience vécue dans ce domaine de la "louange" !!! Les choses sont plus simples avec vous , je ne pouvais donc expliquer à partir de nos dialogues, quant à Angèle, tout est pour l'instant de l'ordre de la transparence
Et puis le sommeil a du bon, il met à distance , la parole.
Donc je vous laisse avec Angèle. Bonne journée
amitiés.
Écrit par : christiane | 28/09/2008
Merci de ce passionnant et brillant filage philologique.
Pouvez-vous, l'un ou l'autre, nous indiquer le lien vers le TLFi dont Angèle dit qu'il est consultable en ligne ?
Grazie.
Écrit par : michèle pambrun | 28/09/2008
Merci. C'est une découverte.
Écrit par : michèle pambrun | 28/09/2008
Les commentaires sont fermés.