21/09/2007
Réflexion
Et revoici l’automne qui pointe son nez avec, ironie du sort, un rayon de soleil. Or qu’y a-t-il de neuf, sous ce soleil ? Rien de très bon, assurément.
En effet, que nous promet Monsieur Kouchner ? Qu’il y aura inévitablement la guerre au Proche-Orient et que nous y serons impliqués.
Que nous annonce le sieur Sarkozy-Bocsa ? Qu’il part lui aussi en guerre, mais contre nos honteux privilèges. Il nous faudra désormais travailler plus pour gagner moins et quant à nos retraites, on verra…
Que sait-on de Mme Rachida Dati ? Qu’elle est incompétente.
Comment voit-on le Premier Ministre ? Comme un homme fini.
Alors, si on part en guerre avec des incompétents et des hommes finis, il est fort à craindre que la victoire ne soit pas pour demain.
13:18 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (1)
Quand la France rejoint l'Empire.
Ci-dessous, un article de Bernard Langlois consacré à « Nicolas de Neuilly-Bocsa » et à sa politique internationale. Comme il fait un bon résumé de la situation et que son analyse rejoint la mienne, cela me dispense d’écrire moi-même sur le sujet et de m’échauffer la bile inutilement.
http://www.politis.fr/La-guerre,1940.html
Par ailleurs on ne peut que conseiller de lire de temps à autre (autrement dit tous les jours) la revue POLITIS, fondée par Bernard Langlois et qui offre l'avantage de présenter une infomation qui sort des sentiers empruntés par TF1.
http://www.politis.fr/
12:30 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (0)
19/09/2007
Des contestataires au sein de l'Eglise
"Aussi longtemps que je demandais aux gens d'aider les pauvres, on m'appelait un saint. Mais lorsque j'ai posé la question: pourquoi y a-t-il tant de pauvreté ? on m'a traité de communiste..."
dom Helder Câmara, cardinal brésilien.
Nous parlions hier de la résistance civile, cette attitude qui consiste à refuser les ordres donnés par les autorités. Or, s’il y a bien une institution où on ne s’attendrait pas à trouver ce genre d’attitude, c’est bien l’Eglise. Moi qui me détourne souvent des problèmes religieux, athéisme oblige, j’ai sans doute trop tendance à considérer que l’Eglise est conservatrice et qu’elle est tournée du côté des puissants (manière habile d’asseoir sa propre autorité). Ainsi, je conserve encore en mémoire le discours que le pape précédent (Jean-Paul II donc, plus conservateur encore que toute la Pologne, ce qui n’est pas peu dire) avait prononcé lors de son premier voyage en Amérique du Sud. En gros il félicitait les pauvres d’être pauvres car leur dénuement les rapprochait de Dieu. Il leur demandait surtout de ne pas se révolter car ce serait désobéir aux volontés divines (après tout, si Dieu avait voulu qu’ils soient aussi démunis, il devait avoir ses raisons). Accepter son destin était donc ce qu’ils avaient de mieux à faire. Les portes du paradis ne manqueraient sans doute pas de s’ouvrir un jour pour eux, mettant enfin un termes à leurs misères. A l’écouter, on comprenait que le plus tôt serait finalement le mieux. Enfin pas trop tôt tout de même, le temps de concevoir et d’élever chrétiennement six ou sept enfants, ce qui était sûrement leur mission en ce bas-monde.
Qu’en savait-il, le bougre (comme aurait dit Brassens) ? Il n’en savait rien du tout, évidemment. Mais il savait que l’Eglise ne devait pas jouer le jeu de la révolution dans ce continent où ce n’étaient pas les occasions qui manquaient de se révolter. Par ce discours axé sur la résignation, il faisait comprendre qu’il désapprouvait l’attitude des prêtres contestataires qui s’étaient regroupés dans la Théologie de la libération (à ne pas confondre avec le Sentier lumineux, qui lui est une dissidence du parti communiste). Car il s’est trouvé des religieux pour porter la contestation au sein de l’Eglise et oser critiquer son discours sur la société.
Au départ, la Théologie de la libération, c’est d’abord des écrits et une réflexion théorique et politique. On y retrouve par exemple des figures comme celle du philosophe Gustavo Gutierrez (Pérou). Celui-ci veut lutter contre la pauvreté et il se place dans l’esprit d’ouverture de Vatican II (on en est loin). Ainsi, sa réflexion le conduit à contester l’attitude ancienne de l’Eglise, fondée sur la seule charité. Pour lui et ses émules, les pauvres ne sont plus essentiellement des objets de charité, mais les sujets de leur propre libération. Notons que les organisations humanitaires ne disent pas autre chose : mieux vaut apprendre à pêcher à un homme que de l’entretenir en lui donnant du poisson. Acteur de sa propre destinée, le pauvre retrouve donc sa dignité. C'est ici que s'opère la jonction avec un principe fondamental du marxisme, à savoir que "l'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes". C’est là évidemment un changement radical. Ces prêtres et ces théoriciens chrétiens contestent donc l’attitude classique de l’Eglise et demandent en fait que la réflexion soit portée sur le plan politique. Ce qui ne les empêchent pas de se placer également sur le plan religieux. Ainsi, ils refont une lecture des écritures et arrivent à la conclusion que si la pauvreté doit être combattue, elle peut aussi être une source d’enrichissement spirituel (« Heureux les pauvres car le Royaume de Dieu leur appartient ») La population sud-américaine aurait donc à la fois faim de Dieu et faim de pain. Gustavo Gutierrez voudrait conserver la première et éradiquer la seconde. Car la faim tout court conduit à nier la dignité humaine et donc la part divine que chacun renferme en soi. Il condamne donc tous les discours qui visent à mépriser les pauvres au nom de critères économiques (et dire « développez-vous », c’est encore les culpabiliser), sociaux, culturels ou raciaux.
La pauvreté n’est pas inévitable, elle provient d’une mauvaise organisation de la société. La pauvreté n’est donc pas une fatalité, c’est une condition (ce qui suppose chez les pauvres une manière d’être et de penser qui leur est propre, une culture spécifique en quelque sorte). Le rôle de l’Eglise (et un des buts de ceux qui ont la foi) est donc de changer l’Histoire. L’Histoire doit se voir comme un moyen de créer le Royaume de Dieu sur terre en améliorant sans cesse les conditions de l’homme (matérielles, certes, mais aussi spirituelles car il s’agit non seulement de donner du pain, mais aussi de faire retrouver une véritable dignité). D’où la notion de praxis. La foi doit se comprendre comme un engagement dans l’Histoire et l’Histoire a pour but de rendre les hommes plus hommes, c’est-à-dire débarrassés de leurs soucis alimentaires et donc plus disponibles pour se rapprocher de Dieu et des autres hommes. Autrement dit, au lieu d’attendre un futur meilleur au sens où les Chrétiens le font habituellement (attendre la venue du Christ Roi à la fin des temps), la Théologie de la libération veut construire ici et maintenant ce monde meilleur, non certes dans une perspective marxiste, mais spirituelle. C’est dans la rencontre avec les autres que se trouve le véritable amour de Dieu. Nous sommes donc en présence d’une eschatologie de la praxis.
Pour justifier ses dires, Gustavo Gutierrez chercha des réponses dans la Bible (aimer son prochain, etc.). Evidemment, beaucoup lui reprochèrent d’annexer la pensée athée marxiste dans son analyse de la réalité sociale. D’autres virent un danger dans sa théorie. Celui de ne proposer qu’une théologie sociale, fondée sur l’instant présent. De plus, il finirait par nier le péché originel (le mal) qui, selon les Chrétiens, gît au fond de chacun de nous (notion par ailleurs assez incompréhensible pour la pensée athée, il faut le préciser). Les autres théologiens reprochèrent donc à cette théorie pourtant séduisante de ne prêcher qu’une révolution sociale autrement dit de n’être pas assez eschatologique. De plus, ils lui reprochèrent également de « collaborer » avec la pensée et le pouvoir marxiste. Attitude assez hypocrite, de mon point de vue, étant entendu que l’Eglise elle-même n’a jamais fait autre chose que de collaborer avec les puissances de ce monde. Il est vrai, à sa décharge, que ces puissances n’étaient pas athées, mais chrétiennes puisqu’elle appuyaient à leur tour leur autorité sur cette même Eglise dont elles avaient besoin (Franco, Pinochet, etc.).
Il reste qu’on a voulu diaboliser cette Théologie de la libération, sur laquelle, en tant qu’athée, je ne me prononcerai pas, mais qui me semble avoir un grand respect pour les hommes en général et les pauvres en particulier. Des phrases comme la suivantes vont très loin :
"Il faut vaincre le capitalisme: c'est le plus grand mal, le péché accumulé, la racine pourrie, l'arbre qui produit tous les fruits que nous connaissons si bien: la pauvreté, la faim, la maladie, la mort. Pour cela, il faut que la propriété privée des moyens de production (usines, terre, commerce, banques) soit dépassée." (Obispos Latinoamericanos, 1978, p. 71).
On a rarement vu une critique aussi acerbe du capitalisme, vu comme source de tous les maux. Partis en croisade contre les faux Dieux (le dieu argent), ces théologiens remettent en question le côté sacrificiel que le capitalisme exige des pauvres (lesquels, si je ne me trompe, doivent accepter de se sacrifier au nom de raisons économiques). Le catholicisme d’un Bush a certes de quoi inquiéter. Non seulement parce qu’il mélange le sacré et la profane, la religion et l’Etat (ce qui débouche sur son conflit des civilisations avec le monde arabo-musulman), mais aussi parce qu’il justifie l’oppression des pauvres au nom d’une théologie de l’économie et de l’argent. On se doute que les deux derniers papes conservateurs qu’a eu l’Eglise ont plutôt condamné cette Théologie de la libération, préférant mettre en avant la piété, la recherche intérieure ou la prière. Ce sont là, pour des croyants, et il faut le reconnaître, des choses certes importantes, mais derrière cette recherche affichée de spiritualité se cache sans doute une autre volonté, celle d’éloigner les prêtres des réalités sociales en leur demandant de laisser les choses dans l’état où ils les ont trouvées, c’est-à-dire d’accepter que les riches soient de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres.
23:00 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Théologie de la libération, marxisme, Eglise
17/09/2007
Utopie sociale?
On a souvent contesté les arguments avancés par les criminels nazis, lesquels se défendaient en disant qu’ils n’avaient fait qu’obéir aux ordres. Au regard des atrocités commises par le régime de Hitler, une telle ligne de défense nous semble bien fragile. Il nous paraît évident, en effet, que ces gens devaient se révolter et désobéir ou en tout cas mettre tout en œuvre pour limiter au maximum l’application d’ordres aussi injustes.
A y réfléchir d’un peu plus près, cependant, on se rend compte que cette attitude de désobéissance civile n’est pas aussi facile qu’on le croit à mettre en place. Certes, avec le recul historique qui est le nôtre, il nous semble évident qu’il aurait fallu faire ceci ou ne pas faire cela. Pourtant, de nos jours, même si beaucoup constatent que le monde dans lequel ils vivent n’évolue pas dans la bonne direction, les décisions politiques étant uniquement prises en fonction des thèses économiques néolibérales à la mode, peu de personnes osent une critique ouverte de la situation. Quant aux quelques courageux qui s’aventurent dans cette voie de la contestation, ils sont rapidement diabolisés, un peu comme l’étaient autrefois aux Etats-Unis les gens soucieux de justice sociale, qui étaient aussitôt catalogués de communistes.
Ainsi en va-t-il des alter mondialistes, qu’on présente facilement comme des doux rêveurs. Une bande d’illuminés en quelque sorte, qui ne parviennent même pas à se mettre d’accord entre eux.
Ainsi en va-t-il également des tenants d’une culture anti-OGN. Des bandits, finalement, qui saccagent des champs pourtant cultivés avec toutes les autorisations voulues et qui refusent finalement le progrès de la science. Des attardés, en quelque sorte, qui luttent à contre-courant pour une agriculture dépassée.
Ainsi en va-t-il encore des opposants au néolibéralisme ambiant. Des attardés eux aussi, qui ne comprennent pas que la France va rater le train du XXI° siècle si elle veut s’accrocher à un état social désuet. Car celui-ci est définitivement mort, étant impossible à financer. Seuls s’en sortiront les pays (et les individus) qui iront de l’avant, osant prendre des risques et récoltant les fruits mérités de leur travail. Assez de tous ces fainéants qui veulent profiter de la société et qui voudraient qu’on leur rembourse leurs médicaments alors qu’ils ont eu le toupet de tomber malade.
Pourtant, quand on reprend ces trois groupes d’opposition, on se rend compte :
Que les alter mondialistes, s’ils sont parfois inconséquents, ont cependant en commun de ne pas vouloir d’une société qui mise tout sur le profit, ce qui est un point de vue légitime.
Que les faucheurs d’ONG sont peut-être fous, mais qu’aucun scientifique n’a pu leur donner une réponse satisfaisante quant à la nocivité ou non de ces nouvelles plantes.
Que les frondeurs anti-libéraux ne font que réclamer un peu de dignité pour les hommes (et les femmes bien entendu) et que réduire en esclavage 90% d’une population pour que les 10% qui restent s’enrichissent scandaleusement ne peut être acceptable sur le plan de l’éthique. Sans compter qu’il n’est pas si sûr que l’Etat social ne puisse perdurer. Plutôt que de faire des dépenses excessives et de tout privatiser (ce qui appauvrit l’Etat à moyen terme en le privant de pas mal de recettes), il conviendrait plutôt de constituer des fonds de pensions ou de sécurité sociale. Evidemment, à partir du moment où on veut qu’une firme privée fasse 100% de bénéfice et qu’elle ne paie plus d’impôts (afin de rester concurrentielle nous dit-on, ce qui apporte de l’eau au moulin des alter mondialistes qui ne veulent pas précisément de cette course à la concurrence) alors il est clair que l’Etat n’a plus d’argent à redistribuer à ses citoyens (sauf ce qu’il aura prélevé sur le salaire de ces mêmes citoyens ou bien en leur imposant une TVA dite sociale).
Le paradoxe ; c’est que l’Union européenne a tout fait pour permettre aux firmes de se délocaliser ou de s’implanter ailleurs (libre circulation des personnes et des biens) et puis après, devant cet état de fait, elle nous dit qu’il faut accepter des baisses de salaires et des horaires accrus sinon on verra ces mêmes firmes quitter notre beau pays. Elle oublie de dire que c’est elle qui a fortement contribué à légaliser la situation actuelle. Avant les syndicats pouvaient encore contraindre un patron à négocier. Aujourd’hui ce n’est plus possible. Où sont les perdants ? Ce sont ceux qui ont dit non au référendum sur l’Europe. Et ce sont les mêmes qui ont voté pour l’ami Sarkozy. Comprenne qui pourra.
15:41 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (3)
14/09/2007
Alphabet grec
Pour compléter l’article précédent, il faut encore noter que l’expression « soleil noir» a connu un beau succès en littérature. On la retrouve chez Kristeva, en rapport avec la dépression et la mélancolie :
Ainsi que chez l’illustrissime poète de Villepin (quoi ? Ce n’est pas pour sa poésie qu’il est devenu célèbre ?) 
Enfin, pour être plus sérieux, je regrette que Hautetfort n’accepte pas les lettres grecques quand on veut donner un étymon. Je passe mon temps à insérer les lettres une à une via la fonction « insertion », « caractères spéciaux » de Word et Hautetfort transforme tout en alphabet latin.
16:36 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (2)
Oxymore
Sur son blogue, (http://www.josephetorban.canalblog.com/)
Joseph Orban, poète très mal connu comme il se définit lui-même, fait allusion à « un important responsable culturel socialiste », précisant que cette formulation relève d’une figure de rhétorique, en l’occurrence l’oxymore. Nous laisserons de côté l’analyse politique car il serait vain de savoir qui, des socialistes ou des sarkoziens, est le plus proche de la culture et nous profiterons plutôt de l’occasion qui nous est donnée pour rappeler que le terme oxymore (ou oxymoron) vient du grec « oxumoros » (de « oxus », aigu et « moros », émoussé) et qu’il désigne une figure de rhétorique où deux mots désignant « des réalités contradictoires ou fortement contrastées sont étroitement liés par la syntaxe. » Exemple : « un merveilleux malheur ».
On parle parfois d’antilogie, mais ce terme renvoie surtout à quelque chose d’illogique. Dans ce cas, on pousse tellement loin l’antithèse qu’on se retrouve dans une situation absurde.
Le grammairien français Pierre Fontanier, qui avait consacré sa vie à étudier les tropes, parle lui de paradoxisme. Il est dans le vrai car c’est pour le moins un paradoxe d’accoler ensemble des termes contradictoires.
Certains oxymores servent à désigner des réalités qui ne possèdent pas encore de nom, comme par exemple « aigre-doux » (pour les amateurs de cuisine chinoise) ou « clair-obscur » (pour les amateurs de la peinture de Rembrandt).
Généralement, cependant, les écrivains qui emploient l’oxymore cherchent à attirer l’attention de leur lecteur. L’encyclopédie en ligne Wikipédia (dont il faut certes se méfier mais qui est parfois bien utile) nous propose quelques exemples :
- Les azurs verts (Rimbaud)
- Les splendeurs invisibles (id.)
- La clarté sombre des réverbères (Baudelaire)
- Cette obscure clarté qui tombe des étoiles (Corneille)
- Un jeune vieillard (Molière)
- Hâtez-vous lentement (Boileau)
- Je la comparerais à un soleil noir si l’on pouvait concevoir un astre noir versant la lumière et le bonheur (Baudelaire)
- Un affreux soleil noir d’où rayonne la nuit (Hugo)
Alors là, je fais appel à l’équipe. Si je connaissais la phrase de Baudelaire, c’est surtout à Nerval que je pense quand je rencontre l’expression « soleil noir », Nerval qui avait écrit ce beau poème « El desdichado » :
EL DESDICHADO
Je suis le ténébreux, -le veuf, -l'inconsolé,
Le prince d'Aquitaine à la tour abolie:
Ma seule étoile est morte, -et mon luth constellé
Porte le soleil noir de la Mélancolie.
Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé,
Rends-moi le Pausilippe et la mer d'Italie,
La fleur qui plaisait tant à mon coeur désolé,
Et la treille où le pampre à la rose s'allie.
Suis-je Amour ou Phébus, Lusignan ou Biron?
Mon front est rouge encor du baiser de la reine;
J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène...
Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron,
Modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée
Les soupirs de la sainte et les cris de la fée
Nerval aurait pu prendre cette expression « soleil noir » chez Baudelaire, mais plus vraisemblablement il la tient des livres d’occultisme dont il était friand, notamment ceux de Don Pernety. Certains ont parlé aussi de la gravure « Melancolia » de Dürer

Mais j’ignorais totalement qu’Hugo avait aussi employé cet oxymore. Quelqu’un pourrait-il me dire dans quel livre ?
15:45 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : oxymore, Nerval, littérature
13/09/2007
Goncourt
Voici la liste de la sélection du Goncourt 2007. Qu’en dire ? Qu’on s’éloigne à chaque fois davantage de l’esprit initial des frères Goncourt, qui voulaient encourager un écrivain débutant et méritant. En effet, on retrouve des archi-connus comme Assouline, Nothomb ou Poivre d’Arvor (lequel n’écrit par seul mais avec son frère). A côté de cela, on a le livre de Darrieusecq, qui a surtout fait parler de lui devant les tribunaux (ce qui est une publicité comme une autre). On notera la présence des éditeurs traditionnels et on se réjouira pour Gallimard qui présente quatre poulains, ce qui multiplie ses chances de succès commercial. Pour le reste, retournons à nos affaires et laissons les loups se manger entre eux. Réjouissons-nous, cependant, de l’absence, dans cette sélection, de Yasmina Reza. Il n’aurait plus manqué que cela : voir la photo de Sarkozy s’étaler dans toutes les librairies de France et de Navarre.
Olivier Adam : "A l'abri de rien" (L'Olivier)
Pierre Assouline : "Le portrait" (Gallimard)
Philippe Claudel : "Le rapport de Brodeck" (Stock)
Marie Darrieussecq : "Tom est mort" (P.O.L.)
Vincent Delecroix : "La chaussure sur le toit" (Gallimard)
Delphine De Vigan : "No et moi" (J.C. Lattès)
Michèle Lesbre : "Le canapé rouge" (Sabine Wespieser)
Clara Dupont-Monod : "La passion selon Juette" (Grasset)
Yannick Haenel : "Cercle" (Gallimard)
Gilles Leroy : "Alabama Song" (Mercure de France)
Amélie Nothomb : "Ni d'Eve ni d'Adam" (Albin Michel)
Olivier et Patrick Poivre d'Arvor : "J'ai tant rêvé de toi" (Albin Michel)
Grégoire Polet : "Leurs vies éclatantes" (Gallimard)
Lydie Salvayre : "Portrait de l'écrivain en animal domestique" (Seuil)
Olivia Rosenthal : "On n'est pas là pour disparaître" (Verticales)
Enfin, si vous étiez découragés par la vague déferlante des 740 (?) romans de l'automne, réjouissez-vous puisque les dieux de l'édition, qui sont cléments, vous permettent de restreindre votre choix. Les plus fainéants peuvent même attendre le nom du lauréat pour commencer leur lecture. Evidemment, vous n'aurez pas le meilleur des livres mais celui que tout le monde aura acheté. C'est déjà cela, non? Dans nos républiques moutonnières où la consommation est de mise, que rêver d'autre?

11:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, Goncourt
11/09/2007
Une femme indépendante.
Dans la Tribune de Genève d’hier, je tombe sur un article intéressant et surtout sur cette phrase, prononcée par une dame exaspérée : « Je ne vois pas au nom de quoi une femme devrait sacrifier son parcours professionnel à celui de son conjoint, surtout quand celui-ci bénéficie d'un emploi précaire"
La phrase est lancée, péremptoire. Pleine de bon sens aussi. Qui oserait contester à la femme qui s’exprime ainsi le droit qu’elle a d’exercer un métier ? Personne évidemment. Elle ne va pas sacrifier sa carrière pour son mari, surtout si celui-ci n’a qu’un emploi précaire. Elle préfère donc miser sur le long terme et ne pas renoncer à un travail stable.
Et pourquoi ce mari macho lui a-t-il demandé d’interrompre ses activités professionnelles ? Qui est-il pour avoir de telles exigences ? Après tout il n’a qu’un emploi précaire. Et qu’était-il avant cela ? Chômeur ? Clochard ?
Non, vous n’y êtes pas. En fait le mari n’a rien demandé du tout à son épouse. C’est la « société » qui en fait conseillerait à l’épouse de démissionner et pour être plus précis, les syndicats.
Alors là, on ne comprend plus du tout. Les syndicats qui se sont toujours battus pour le travail des femmes et contre les emplois précaires, les voilà qui demandent à une femme de renoncer à un poste sûr et bien payé. Convenez qu’ils adoptent une étrange position.
Pour y voir plus clair, examinons la situation calmement et reprenons au début. Que fait exactement le mari ? Quel est cet emploi précaire dont on nous parle ? Et bien le mari est ministre. C’est un des transfuges qui est allé rejoindre l’équipe de Sarkozy. Son nom ? Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères. Son épouse ? Christine Ockrent, qui va lancer sur FR3 une nouvelle émission politique. Et les syndicats ? Et bien ils ont peur qu’elle ne soit pas objective et qu’elle interprète à sa manière les événements politiques qu’elle va présenter. Allons, quelle idée ! Christine est une femme libérée, elle ne va pas se soucier des activités de son mari. Et puis ils ne vont tout de même pas parler boulot le soir sur l’oreiller. Venir dire qu’elle serait partiale ! Il est vrai qu’elle est proche des cercles qui gravitent autour de l’OTAN et membre des amitiés franco-américaines, mais bon, tout cela c’est sa vie privée après tout, non ? Elle pas objective ? Voyons ! C’est comme ceux qui ont reproché à Kouchner, qui investiguait autrefois sur les rapports entre le groupe Total et la junte birmane, d’avoir rendu un rapport biaisé. Tout cela parce qu’il était payé par Total. Ridicule. Il y a vraiment des gens médisants. Il leur a bien répondu d’ailleurs, en expliquant qu’il n’allait pas compromettre sa réputation pour un rapport qui ne lui a presque rien rapporté alors que pour la moindre conférence qu’il donne il se fait payer 4.000 euros la soirée. Enfin, cela, c’était avant qu’il n’accepte l’emploi précaire chez Sarkozy.
Par contre, pour revenir à Ockrent, elle pourrait expliquer tout de même à son cher époux que ce n’est plus JP Raffarin qui est Premier Ministre en France, comme il l’a dit l’autre jour. Ne pas connaître le nom de son patron, c’est quand même étrange. Mais il ne faut pas lui en vouloir, il vient d’arriver et après tout, comme on l’a dit, il n’a qu’un emploi temporaire.
http://www.tdg.ch/pages/home/tribune_de_geneve/info_expre...
Ps. : vous remarquerez que la date de l’article est erronée, puisque celui-ci est daté du 01.01.1970. Et on dira encore que la Suisse est le pays des horloges…
09:32 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (10)
10/09/2007
De la presse
Voici des articles de presse comme on les aime, d’une grande transparence et rédigés dans une langue digne de Flaubert. :
La maison de la victime du meurtre commis le samedi 1er septembre dans le quartier D… à B…, située rue du Cheval Noir à M…, a été visitée entre la nuit de vendredi et celle de samedi, a-t-on appris dimanche de source judiciaire.
On admirera les compléments déterminatifs en cascades (de type gigogne) et la tournure à la voix passive, qui complique tout. Sans oublier l’emploi forcé des trois jours de la semaine pour signifier que l’on ne peut pas dire avec précision quand l’intrusion a eu lieu. Cela tourne à l’hermétisme mallarméen. Les rimes en moins, bien entendu. Cela donne envie de lire les journaux.
12:45 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : presse
07/09/2007
Voyage au pays de l'enfance

Il existe de nombreuses versions de Chaperon rouge. Celles qui nous sont les plus familières sont dues respectivement à Charles Perrault et aux frères Grimm. Chez Perrault, le loup mange le chaperon, tandis que les Grimm nous offrent une fin plus adaptée aux oreilles enfantines : un chasseur providentiel vient éventrer le loup et délivre ainsi la petite fille et sa grand-mère.
Il existe d’autres différences. Ainsi chez Perrault, c’est une galette et un pot de beurre, qu’il faut aller porter à l’aïeule. Chez les Grimm, le beurre est remplacé par une bouteille de vin. Notons que dans la tradition orale, on parle surtout d’un morceau de pain encore chaud et d’une bouteille de lait. Dans cette même tradition orale, on retrouve le choix qui est demandé à l’enfant : choisira-t-elle le chemin des aiguilles ou celui des épingles ? Ailleurs, le chaperon n’a pas à choisir. Le loup, d’autorité, emprunte le chemin le plus court tandis que la belle étourdie s’attarde à cueillir des fleurs le long du chemin le plus long (Perrault). Ou bien encore elle quitte carrément le chemin et s’aventure dans le sous-bois (Grimm).
La fameuse réplique « tire sur la chevillette et la bobinette cherra » se trouve chez Perrault. Elle reflète manifestement des versions antérieures. Il est étrange que cette formule ait été reprise telle quelle car elle est devenue pour ainsi dire incompréhensible. Pourtant, quand on nous parle aujourd’hui du Chaperon rouge, c’est invariablement à cette phrase que l’on songe. Manifestement, on se la répète de génération en génération comme une formule magique.
Est-ce les sonorités qui plaisent? Sans doute. A moins que la formule ne soit un résumé de toute l'histoire. Tirer la chevillette suppose une décision à prendre (comme le petit Chaperon qui a décidé de s'écarter du droit chemin afin de folâtrer dans les bois), décision qui a des conséquences: la bobinette choit irrémédiablement (de même que le Chaperon ne manquera pas, en principe, de se faire dévorer par le loup).Et puis il y a aussi la survivance du verbe choir, qui est le seul terme de la formule a encore être compris et qui renvoie, nostalgiquement, à un état ancien de la langue que nous désirerions encore comprendre. Il est vrai que l’histoire du chaperon renvoie elle aussi à notre petite enfance et donc à un monde primitif qui est pour nous sacré. On ne touche pas aux souvenirs.
Mais revenons à nos différentes versions. Chez les Grimm on ne parle ni de bobinette ni de chevillette, mais plus simplement de loquet. Dans les deux cas le loup mange la grand-mère et prend sa place dans le lit (car l’aïeule, étant malade, était alitée). Dans la tradition orale, le loup (le bzou) ne mange pas la grand-mère, mais il met « de sa viande dans l'arche et une bouteille de sang sur la bassie (« petite pièce où on fait la vaisselle, évier »). On remarquera comment l’épisode du sang dans la bouteille a été transformé en bouteille de lait, puis en beurre dans les versions policées du conte.
Il conviendrait donc de faire de ce conte une analyse anthropologique, en mettant en évidence les oppositions entre la nature (le bois, le loup) et la culture (habits rouges de la fillette, bon chemin, maison à la porte bien fermée, etc.). De même le thème alimentaire est prédominant. C’est du pain ou une galette que l’on apporte à la mère-grand (pas des fruits sauvages mais un aliment cuit et travaillé par l’homme), tandis que c’est de la chair crue qui est exposée par le loup. Ou bien on apporte du vin (symbole également de la domination des hommes sur la nature) qu’on opposera au sang de l’aïeule. S’il était entendu que celle-ci devait manger les mets préparés à son intention, elle se retrouve en fait mangée par le loup, cet animal sauvage par excellence. Quant au Chaperon, elle devient elle-même une proie pour le loup, non seulement sur le plan alimentaire, mais aussi sexuel. La version orale est on ne peut plus explicite à ce sujet. La fillette se déshabille entièrement sur les conseils du bzou, afin d’aller le rejoindre dans le lit, tout en remarquant l’étrange virilité de sa prétendue grand-mère : « Oh, que vous êtes poilouse ! ». Entre-temps, elle aura consommer les morceaux de viande humaine (cannibalisme et anthopophagie) malgré les avertissement de la chatte de la maison (un animal, pourtant). Manger et être mangé, désirer et être désirée constituent donc bien deux des axes importants de ce conte qui ne semble plus tout à fait convenir aux enfants quand on l’analyse sous cet angle.
Dans la version orale, le loup ne dévore pas le Chaperon (c’est elle qui a mangé des morceaux de sa grand-mère), qui réussit à s’enfuir par ruse (ne poussant pas la régression à l’état naturel au point de coucher avec le loup). Chez Grimm et Perrault, on sait ce qu’il en est. De plus, un chasseur (tueur d’animaux) ou un bûcheron (coupeur d’arbres) tue le loup et ouvre son ventre où on retrouve l’aïeule et sa petite-fille. Tout finit bien. L’homme domine de nouveau la nature, la jeune fille devra rester prudente à l’avenir (se méfier de la nature, des loups, des hommes et de leur désir et obéir à sa mère) et il semble légitime de tuer des animaux cruels. L’ordre est rétabli. Par contre, on conviendra que le sens premier, tel qu’il apparaît dans la tradition orale, est beaucoup plus inquiétant. La fille est maîtresse de sa destinée, elle choisit le chemin qu’elle veut, se déshabille sans honte, mange sa grand-mère, etc. C’est par son intelligence et sa ruse qu’elle parvient à s’échapper quand elle trouve que le jeu ne lui plait plus (alors que chez Grimm et Perrault, c’est le loup qui est rusé et intelligent, tandis que le Chaperon est naïve et étourdie). On voit donc comment les versions policées ont complètement dénaturer le sens premier et ont inversé toutes les valeurs.

22:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : chaperon rouge, littérature, anthropologie
05/09/2007
Tant va la cruche à l'eau...

Dans la suite logique de l’article d’hier, voici qui va venir mettre un peu de baume au cœur de ceux qui n’apprécient que fort modérément leur nouveau président (si, si il y en a tout de même quelques–uns).
Un professeur en communication politique à l’Institut d’études politique de Paris prédit que Nicolas Sarkozy ne parviendra pas, sur le long terme, à maintenir de lui-même une image positive parce qu’il se montre trop. Il prévoit une usure de cette image.
Il estime que Sarkozy fait du marketing politique, autrement dit qu’il analyse les besoins de certains groupes de citoyens pour répondre aussitôt à leur attente avec une solution. Mais à vouloir trop jouer à ce jeu, on prend des risques. Tant va la cruche à l’eau…
« Il y a bien sûr un revers évident à la saturation médiatique, c'est l'usure de l'image et de la parole, la banalisation de la parole, et le risque de se contredire. » Voilà qui rassure.
« Nicolas Sarkozy est un "voleur de lumière" et il irrite aussi bien son premier ministre que la chancelière allemande. Et cela finira par avoir un coût politique. » Encore mieux. Et notre politologue de comparer Sarkozy à Blair, qui, lors du décès de la princesse Diana, a su faire de la politique compassionnelle. Il avait compris la charge émotionnelle que cette mort avait suscitée dans la population. Pourtant, à la fin de son « règne », il était mal vu de tous et surtout des médias (et pour cause, on ne peut pas oublier ses mensonges sur la nécessité d’envahir l’Irak).
Sarkozy finira bien, lui aussi, par se mettre dans une position embarrassante. En attendant le mal sera fait. On le voit envoyer Kouchner en Irak. Outre que celui-ci a dû présenter des excuses au premier ministre de ce pays pour avoir prédit un peu vite son départ pour incapacité, l’homme de l’humanitaire a estimé qu’il était temps pour la France d’être présente en Irak. Comprenez : changeons de politique et soutenons les Américains, nous en retirerons bien quelques bénéfices économiques. Une telle attitude va retourner les opinions arabes contre la France, qui apparaissait pourtant comme une exception parmi les pays occidentaux. Si un jour une présence militaire française devait être présente en Irak, même si c’est sous le couvert de rétablir la paix ou de mener une mission humanitaire, il est clair que les pertes humaines seront lourdes, non seulement parmi les soldats mais aussi parmi les civils à Paris car il y a fort à parier que les attentats reprendront. De plus, s’ils reprennent, ce sera un beau prétexte pour justifier une guerre des civilisations. Après tout les guerres ont toujours fait tourner l’économie, n’est-ce pas ?
Remarquons que la politique africaine de Sarkozy n’est pas meilleure que sa politique au Moyen-Orient. En tout cas les propos qu’il a tenu récemment à Dakar (« l'imaginaire" du paysan africain "où tout recommence toujours" et où "il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès"), qui semble dénier aux Africains la possibilité de se tourner vers l’avenir, ne lui aura pas fait que des amis. Comme quoi les paroles elles-mêmes peuvent blesser. Parions que notre grand orateur national finira par se mettre tout le monde à dos et par se brûler à son propre jeu. Quelle idée aussi de vouloir imiter Bush ! On voit où ses discours et sa politique ont mené ce dernier. Quand il se rend en Australie, qui est tout de même une terre amie pour lui, peuplée d’Anglo-Saxons, il faut couper une ville en deux pour assurer sa sécurité. On croit rêver.
16:45 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Sarkozy, politique
04/09/2007
Nicolas ou de l'éducation
Une nouvelle fois, la famille Sarkozy, au grand complet, fait parler d’elle. En effet, dans Le Monde d’aujourd’hui, les lecteurs médusés et époustouflés peuvent découvrir trois articles sur la nouvelle dynastie qui dirige désormais la France. En fait, il ne se passe pas un jour sans que la presse ne relate les faits et gestes du président ou de son entourage. A croire qu’elle est payée pour cela. Il est vrai que ceux qui en sont les propriétaires sont aussi les grands amis du petit Nicolas. N’avait-il pas lui-même fait des reproches autrefois au fils Lagardère quand ses journaux avaient évoqué la possible séparation de Nicolas et de Cécilia ? « Ou bien c’est un traître, ou bien il ne sait pas tenir son groupe » se serait-il écrié. Cela veut tout dire.
Donc aujourd’hui trois articles.
Le premier consacré à Cécilia, qui s’explique (sans rien révéler, en fait) sur son rôle dans la libération des infirmières bulgares. Non, elle ne veut pas être entendue par la Commission parlementaire car elle était en Libye pour ainsi dire à titre privé. Ce qui ne l’a pas empêchée de dialoguer en anglais avec Kadhafi et sans traducteur encore bien. Si elle n’avait pas été la femme du président, aurait-elle ainsi rencontré Kadhafi et bu le thé avec lui ? Non, évidemment. C’est bien la preuve qu’on joue ici un double jeu. Si elle échoue dans son entreprise, cela n’a aucune conséquence pour la France, puisqu’elle agit en son nom propre. Par contre si elle réussit, c’est Sarkozy qui en sort vainqueur, tout en évitant les questions indiscrètes des parlementaires puisque après tout on est dans la sphère privée. D’ailleurs, quand elle dit : « "J'ai offert à l'hôpital de Benghazi des médecins chargés de former leurs homologues palestiniens, des équipements, des traitements contre le sida et des visas rapides pour que ces cas urgents puissent venir se faire traiter en France", on peut se demander si c’est avec son argent personnel qu’elle comptait payer tout cela. Il faut le supposer puisqu’elle a ajouté : "On ne m'empêchera jamais d'essayer d'aider ou de soulager la misère du monde, dans quelque pays que ce soit." On n’a jamais douté que les riches s’intéressent au pauvres. C’est d’ailleurs bien pour cela qu’on a élu son mari.
Le deuxième article relate les mésaventures du gamin. Celui à qui on avait volé le vélomoteur autrefois et pour lequel toutes les polices de France et de Navarre s’était coupées en quatre. Maintenant qu’il l’a récupéré, son vélomoteur, voilà qu’il tamponne l’arrière d’une BMW à un feu rouge. Il est accusé de délit de fuite et de geste grossier envers le conducteur du véhicule tamponné. Comment interpréter ce fait ? Soit, de nouveau, M. Lagardère ne sait pas tenir son groupe de presse, qui n’aurait jamais dû publier cela, soit au contraire c’est voulu. Dans le plus pur style américain, c’est la famille du politicien que l’on met en avant. Quoi de plus sympathique, de plus proche du peuple, qu’un président qui a, comme tout le monde, des problèmes avec ses enfants ? Ah, ces adolescents ! Incorrigibles… Nicolas nous en deviendrait presque sympathique (j’ai bien dit presque). On l’imagine le soir, autour de la soupe fumante (enfin, quand il n’est pas en croisière ou dans les grands hôtels parisiens), en train de réprimander le geste grossier de son rejeton et de lui donner une leçon de morale sur ce qui se fait et ne se fait pas.
Le troisième article est plus sérieux puisqu’il traite de l’empereur lui-même et de sa fonction de dirigeant. Dans un texte « républicain et fondateur » qu’il adresse à tous les enseignants (c’est la Poste qui va se frotter les mains, dommage qu’elle ne soit pas encore privatisée), il se place dans la droite ligne historique de Jules Ferry. Mais là où son illustre prédécesseur se contentait de répandre le savoir, Nicolas I se risque à une synthèse dialectique digne d’Hegel. Autrefois, dit-il en, substance, on a tout misé sur le savoir au détriment de l’enfant. Par la suite (il ne cite plus mai 68 pour ne pas se mettre à dos ces enseignants auxquels il s’adresse), on a respecté l’enfant au détriment du savoir. Il propose donc une synthèse des deux doctrines, dont l’élève sortirait victorieux puisqu’il serait respecté tout en ayant appris beaucoup de choses. Vu comme cela on ne peut qu’applaudir. Il est vrai que la gauche, trop souvent, a contribué à abaisser le niveau des programmes croyant venir ainsi en aide aux plus défavorisés. Il est vrai aussi, si on s’en tient au seul cours de français, que l’analyse et la grammaire sont à peine effleurées, ce que l’on regrettera évidemment. Mais là où on ne suit plus très bien le discours sarkozien, c’est quand on se rend compte qu’à côté de sa lettre aux éducateurs, il supprime 20.000 postes d’enseignants. N’y aurait-il pas là un petit paradoxe ? Sans doute faut-il attendre quelques jours encore afin que, dans un nouveau discours adressé cette fois « aux éducateurs qui sont restés en place », il ne nous offre une nouvelle synthèse dialectique qui nous fera comprendre comment on apprend mieux avec moins d’enseignants.
Notons en passant qu’il a même plaidé pour la culture générale, ce qui est admirable de la part de quelqu’un qui en possède peu et qui en principe doit surtout viser à ce que le patronat dispose de la main d’œuvre nécessaire en temps voulu. Alors, venir en plus nous parler de culture, c’est là un geste gratuit qu’on n‘attendait pas (plus).
19:41 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Sarkozy, éducation
31/08/2007
Qu'est-ce que la littérature?
Joseph Vebret, pour son ancien site, m’avait autrefois demandé de mettre par écrit quelques réflexions sur la nature de la littérature. Ce site ayant disparu au profit d’un nouveau (http://www.vebret.com/) mon texte a été perdu. Je le remets donc ici, imitant en cela Jean-Jacques Nuel, qui remet lui aussi sur son blogue le texte qu’il avait donné à l’époque. (http://nuel.hautetfort.com/archive/2006/06/12/la-litterat...)
Pourquoi la littérature ? Question à laquelle il est difficile de répondre dans la mesure où pour beaucoup de personnes la littérature est comme une seconde nature et qu’elle fait partie intégrante de leur être et de leur personnalité.
Et d’abord, est-elle du domaine de l’inné ou de l’acquis (pour remettre au goût du jour cette vieille querelle à laquelle les psychologues ne sont jamais parvenus à répondre) ? Il vaut mieux rester prudent avant d’affirmer quoi que ce soit dans ce domaine, mais c’est un fait qu’on observe souvent, parmi ceux qui deviendront de futurs grands lecteurs ou de futurs auteurs, un goût manifeste pour les histoires racontées, et ce dès la petite enfance. Ainsi, Gabriel Garcia Marquez a toujours expliqué que sa vocation d’écrivain trouvait son origine dans les contes que lui lisait sa grand-mère. Il s’en serait même inspiré pour créer son univers romanesque, connu sous le nom de réalisme magique. A cette passion pour la littérature orale, succède naturellement chez ces enfants la passion de la chose écrite. Ils dévorent tout, depuis les BD de Tintin jusqu’à l’entièreté de la collection verte, en passant par la Comtesse de Ségur ou les livres de Jules Vernes. Plus tard, bien entendu, on les retrouvera dans les couloirs des bibliothèques ou dans les allées des librairies. Mais quand on a dit cela on n’a encore rien dit, car on ne sait toujours pas d’où leur vient vraiment cet engouement. Est-il inné, et faut-il voir dans ce travers un atavisme familial ou une quelconque déviation génétique ? Est-il au contraire acquis et cette passion précoce traduirait-elle quelque part un manquement, comme par exemple la nécessité de découvrir dans les livres une réalité plus belle que celle de la vie ? Est-ce l’exploration de l’imaginaire, mise ainsi à leur portée, qui enchante ces enfants ? La lecture précoce ouvre-t-elle la porte d’un monde privilégié, qui restera à jamais inaccessible pour les autres ? Le besoin de lire était-il préexistant ou est-ce la lecture qui a alimenté et développé ce besoin? Bien malin qui pourrait répondre à ces questions. Il semble pourtant qu’il y ait quelque part une faille, une déchirure, que viendrait combler l’exploration du monde de l’imaginaire. Comme il n’est pas douteux que cette exploration vous entraîne de plus en plus loin au point que parfois le lecteur devient lui-même écrivain.
Evidemment, à force de s’imprégner de la vision du monde offerte par d’autres, le lecteur invétéré finit par vouloir proposer sa propre vision. Car tout est là. Devant le monde imparfait dans lequel nous vivons, nous pouvons être tentés d’élaborer une version plus parfaite, qui soit de notre cru et qui corresponde mieux à nos aspirations. Puisque la vie est un rêve et même un mauvais rêve, c’est que la réalité, la vraie, se trouve dans l’imaginaire (concept qui englobe à la fois le roman et la poésie). D’ailleurs, s’ils parlent du monde tel qu’il est, les livres ont d’abord tendance à le dénoncer. C’est que la littérature n’est pas un simple jeu, évidemment. Elle prend sa source au cœur même de la personnalité de l’auteur et sa démarche a un caractère ontique. Ecrire, c’est d’abord dire le mal qui nous entoure, le dénoncer, et par-là le condamner. Ainsi, on peut écrire sur la politique, sur l’inconstance de la nature humaine (en amour comme en amitié), sur les choix culturels de notre société, sur la présence de Dieu ou son absence. Bref, on peut dénoncer ce qui ne correspond pas à notre moi intime. Ecrire, c’est donc rejeter le monde réel pour tenter d’imposer sa propre vision des choses. Parfois, plus modestement, c’est tenter de concilier ces deux contraires et faire en sorte que l’individu, malgré toutes ses blessures et toute sa révolte, puisse trouver une place plus ou moins acceptable dans ce monde injuste qui n’était pas fait pour lui. La littérature dépasse alors la critique pour essayer de trouver l’équilibre et l’harmonie. Elle est donc quelque part une recherche du bonheur, mais cette recherche, par définition, est illusoire, puisqu’elle repose sur la fiction. A peine un roman est-il achevé, à peine un poème est-il terminé, que l’auteur doit reprendre sa tâche pour créer de nouvelles fictions, de nouveaux personnages de papier, de nouveaux rêves. Tel Sisyphe, il est condamné à toujours écrire et à repousser autant qu’il peut les limites des possibles, sans parvenir jamais à trouver un terme à sa recherche.
Pourquoi lire, donc ? Et bien pour trouver chez les héros de romans un sens à la vie, tant il est vrai que ceux-ci sont représentés selon cette seule optique. Le héros amoureux est uniquement préoccupé par son amour, l’aventurier par ses explorations, le révolté par son combat. Nous, au contraire, dans notre vie de tous les jours, nous cumulons les rôles. A la fois père, mari, fils, parent d’élève, employé d’une société, consommateur, conducteur, vacancier, spectateur, mélomane, citoyen, usager des transports en commun (et bien d’autres choses encore), nous ne parvenons pas toujours à concilier tous ces aspects et donc à trouver un sens cohérent à notre existence. Les personnages littéraires, au contraire, nous offrent cette possibilité puisque, même s’ils sont complexes, ils ne jouent généralement qu’un rôle à la fois.
Mais pourquoi écrire alors, puisqu’il y a déjà la lecture ? Sans doute pour ne pas mourir. Alors que toutes nos actions, si elles ont un sens à court terme, ne signifient souvent pas grand chose sur un plan existentiel, le fait pour un individu de s’asseoir devant une feuille de papier et de commencer à la remplir de signes intelligibles donne souvent l’impression (et peut-être l’illusion) de réaliser enfin quelque chose d’important. Pourquoi ? Et bien précisément parce que cet individu, qui n’est pas encore écrivain mais qui est déjà « écrivant », peut enfin proposer clairement, noir sur blanc, sa propre vision du monde. L’être humain est sans doute programmé génétiquement pour s’imposer et survivre. Les animaux aussi, d’ailleurs. Observez un chat qui marche dans la rue et vous verrez qu’il est chat jusqu’au bout des griffes. Il se déplace avec fierté, conscient de sa propre perfection et ne doute pas de lui-même. Au contraire, il est indéniablement convaincu de la supériorité de la gent féline. L’homme, par sa complexité, n’a pas toujours cette fierté et cette assurance naturelle. C’est que la vie en société l’a obligé à beaucoup de compromis. En se tournant vers l’écriture, l’individu peut enfin exprimer ce qui restait caché au plus profond de lui et qui n’avait jamais pu s’exprimer à cause des conventions sociales.
L’écrivain espère-t-il la gloire ou l’éternité en couchant ainsi des mots sur le papier ? Sans doute en rêve-t-il et les exemples ne manquent pas, de Sénèque à Montaigne ou de Voltaire à Flaubert, pour lui donner l’illusion qu’il pourrait atteindre ainsi l’éternité. Mais il est trop sage et trop lucide pour se laisser attraper par de telles illusions. S’il écrit, c’est pour être lui-même ici et maintenant (enfin lui-même, pourrait-on dire) et dire à ses « frères humains » ce qu’il pense et ce qu’il ressent, autrement dit exprimer ce qu’il est.
Il y a donc un plaisir, dans l’acte d’écrire. Les idées s’enchaînent les unes aux autres, les impressions aussi, et de toutes ces pages naît un équilibre et donc finalement un contentement certain. Mais pour parvenir à ces sommets, combien d’heures passées à douter, à raturer, à recommencer. Rien de plus décevant qu’un texte que l’on croyait terminé et qui, à la relecture, vous semble bien éloigné de ce que l’on avait voulu lui faire dire. Ecrire est donc un acte solitaire, profondément solitaire. Non seulement parce qu’il suppose un repli passager sur soi, un isolement géographique au sens propre (afin de tenter de capter les rumeurs du monde sans être dérangé par elles), mais surtout parce personne ne peut venir vous souffler les mots à employer ou les idées à exprimer. L’auteur est seul avec lui-même et il sait qu’il sera jugé sur sa production. Dans la vie courante, ce qui fait la valeur d’un individu ne correspond pas forcément avec ses actes. Vous pouvez être un mauvais chauffeur de camion ou une dactylo distraite, intrinsèquement, cela ne change rien. Votre valeur en tant qu’individu n’en est pas affectée. Par contre, un écrivain a mis tellement de lui-même dans ses écrits que son texte reflète vraiment (ou en tout cas devrait refléter, s’il n’a pas triché) ce qu’il est. C’est son moi le plus profond qui se trouve ainsi exprimé et le regard des autres, du coup, devient une menace.
Mais le besoin d’écrire est le plus fort et, malgré les critiques, l’écrivain, le vrai (je ne parle évidemment pas des marionnettes qui occupent souvent le devant de la scène et dont les préoccupations semblent surtout mondaines ou pécuniaires) poursuivra sa tâche, inlassablement. Même s’il a conscience que ses textes sont imparfaits, il continuera son travail malgré tout, tant c’est un besoin chez lui d’exprimer ce qu’il a à dire. Sûr de son bon droit et de la valeur, non pas de ses écrits mais de son message, il ne s’arrêtera jamais d’écrire. C’est qu’une petite voix lui siffle à l’oreille d’être persévérant. Sans doute, cette petite voix, est-il le seul à l’entendre, mais cela ne fait rien. Un jour, sans doute, ses écrits atteindront l’harmonie des grandes symphonies et ce qu’il avait à dire deviendra enfin intelligible pour les autres. En tant qu’être de culture, il aura, par la littérature, transcender sa condition première, qui le rapprochait de l’animalité, pour accéder au divin ou du moins au paradis artificiel qu’il se sera créé lui-même. Et même si tout cela n’est qu’illusion, son action sera d’autant plus belle qu’elle sera inutile. Devenu démiurge, il régnera en maître sur son univers imaginaire et croira, un instant seulement, être semblable aux dieux.
10:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Littérature
27/08/2007
Pauvre foi
La navigation sur Internet nous livre parfois bien des surprises. Voici ce que je découvre à l’instant :
« Mère Teresa, qui pourrait être canonisée, a souffert dans sa foi tout au long de sa vie et même douté de l’existence de Dieu, selon de nouvelles lettres de la religieuse, qui viennent d’être rendues publiques. « Jésus a un amour tout particulier pour vous. Pour moi, le silence et le vide sont si importants que je regarde et ne vois pas, que j’écoute et n’entends pas », a-t-elle écrit en 1979 à un confident. »
Ce n’est pas moi qui le dis, mais un journal chrétien, qui ajoute, sachant sans doute de quoi il parle :
« Où est ma foi — tout au fond de moi, où il n’y a rien d’autre que le vide et l’obscurité — mon Dieu — que cette souffrance inconnue est douloureuse — je n’ai pas la foi », a-t-elle écrit dans une lettre non datée adressée à Jésus.
Me voilà rassuré. Moi qui n’ai pas la foi et qui n’écris jamais de lettre à Jésus, voilà que je découvre qu’un des chantres du catholicisme doutait sérieusement de l’existence de Dieu. Du coup, cela me rend Mère Teresa beaucoup plus sympathique. D’abord elle nous apparaît ainsi plus humaine puisqu’elle a des doutes et en plus, le seul fait qu’elle ait ces doutes prouve qu’elle a réfléchi et qu’elle n’a pas accepté la vérité toute faite proposée par l’Eglise. Par ailleurs, son action humanitaire, qui est assurément exemplaire, prend un tout autre sens. Ce n’est donc pas pour accéder à un improbable paradis qu’elle a agi en faveur des pauvres, mais par pure humanité.
Je me suis d’ailleurs toujours demandé comment on pouvait côtoyer ainsi la misère la plus noire et continuer à croire en un Dieu juste et bon. Relisez à ce propos la phrase de Camus, dans la Peste, celle par laquelle le docteur Rieux interpelle le père Paneloux : « Je refuserai jusqu’à la mort d’aimer cette création où les enfants sont torturés. »Ceci étant dit, ces gens qui se dévouent jusqu’à l’abnégation pour leurs semblables sont assurément des héros, mais par la démesure de leur action ils m’inquiètent toujours un peu. N’y aurait-il pas chez eux comme une volonté de jouer aux martyrs afin de se grandir à leurs propres yeux et aux yeux des autres ? Difficile à dire. Difficile de juger aussi sans se faire aussitôt taxer de médisant. C’est vrai. Mais enfin, que serait Mère Teresa s’il n’y avait pas tous ces pauvres ? De là à dire que plus il y en a mieux c’est, il n’y a qu’un pas. D’ailleurs je ne comprends pas pourquoi ces religieux qui font dans l’humanitaire ne tiennent jamais un discours politique. En effet, ils pourraient dire que ce sont les régimes mis en place dans le tiers-monde (souvent avec la bénédiction de l‘Occident) qui sont en partie responsable de la misère des populations. Mais non, ils préfèrent dire d’un côté que Dieu est bon et de l’autre que c’est à nous, citoyens ordinaires, de nous bouger pour remédier à toute cette misère. Il est vrai que l’Eglise s’est rarement montrée révolutionnaire. Alors vous comprendrez pourquoi les révélations sur les doutes de mère Teresa (qu’on savait ne pas être une mystique mais plutôt une personne efficace dans la pratique) m’intéressent. D’autant qu’on apprend par-là qu’on pourrait très bien être canonisé sans avoir la foi. Tous les espoirs me sont donc encore permis.
16:38 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (2)
24/08/2007
Antiquité
Le 24 août 79, Pompéi et Herculanum ont été victimes de l’éruption du Vésuve. Pompéi s’est retrouvée enfouie sous 6 mètres de roches volcaniques et Herculanum sous 16 mètres de boues. Il faudra attendre 1700 ans pour les redécouvrir.
Ce malheur nous a permis de mieux connaître la civilisation romaine. Les habitants ne se doutaient manifestement pas que leur mort servirait à l’histoire de l’humanité.

15:26 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Pompéi
Néologismes
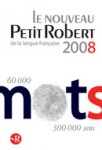
Le Robert 2008 vient de sortir. Pierre Assouline, sur son blogue (où je ne vais jamais), nous donne quelques-uns des néologismes acceptés par le dictionnaire. C’est ainsi qu’on apprend que quelques régionalismes feront désormais partie de la langue française :
« … en Belgique (carabistouille, brol, babelutte, jouer avec ses pieds…), au Luxembourg (auditoire pour salle de cours, et contournement pour périphérique), en Suisse (grimpion, se miner le plot, bringues…), en Afrique (ambianceur désignant le boute-en-train, deuxième bureau la maîtresse d’un homme marié, matabiche pour pot-de-vin, et faire couloir pour chercher à obtenir une faveur), au Québec (faire la baboune pour bouder, avoir de la façon pour être poli, chanter la pomme pour courtiser), aux Antilles (habitation pour exploitation agricole)… »
Il n’y a pas si longtemps, il me semble, que les dictionnaires se risquent en dehors de l’hexagone, ce qui nous amène à une réflexion sur la frilosité du français.
Le gros problème du français c’est en effet sa rigidité par rapport aux nouveautés.
Cela tient sans doute au poids du bon usage. Dans les autres langues, il me semble que les locuteurs s'expriment naturellement sans penser à mal. En français au contraire nous craignons toujours de commettre une faute, même les plus cultivés d'entre nous. Peut-être est-ce le regard de Richelieu, ce fondateur de l'Académie, qui continue à peser sur nous. On a l'impression que la moindre faute de langue est aussitôt sanctionnée par la société et passible de prison. Je dis cela, mais je suis le tout premier à essayer de respecter ce bon usage. Il y a même un certain plaisir à y parvenir. D'ailleurs nous tous sur nos blogues, ne faisons pas autre chose que de tenter de trouver le mot juste, la bonne définition, la nuance pertinente etc.
Malheureusement je crois que cette norme qui est imposée au français nous handicape dans l'apprentissage des autres langues. S'est-on déjà demandé pourquoi les Français semblent si peu doués pour les langues étrangères? Il y a à mon avis plusieurs raisons:
1) Le prestige passé du français continue à donner l'impression à ses locuteurs que cette langue se suffit à elle-même, y compris sur le plan international. Malheureusement c’est là une réalité dépassée, dont seuls les anglophones peuvent désormais se prévaloir pour leur propre langue.
2) Je me suis laissé dire que le nombre de sons (et leur complexité) était moins important en français par rapport à d’autres langues. Un Vietnamien aurait donc plus « facile » en apprenant le français (car il retrouverait des sons qu’il connaît déjà dans sa propre langue ou des sons moins complexes que ceux auxquels il est habitué) qu’un Français en apprenant le vietnamien.
3) Le poids du bon usage fait qu’un locuteur francophone a peur de « se lancer » dans l’élaboration d’une phrase dans une autre langue. A l’inverse les Allemands ou les Hollandais oseront davantage. Ils font des fautes ? Aucune importance, on les comprend tout de même. Et puis personne ne va se mettre à rire de leurs fautes. Du coup, petit à petit, ils progressent dans leur apprentissage. Nous, de peur de commettre le moindre impair, nous préférons nous taire. Et nous n’apprenons rien.
Pour revenir aux termes techniques (car c’est finalement là qu’on retrouve la plupart des nouveautés), il faudrait absolument créer rapidement des néologismes. L’Académie le tente bien, mais avec un tel retard que les mots qu’elle propose sont déjà passés dans l’usage (ex. : effeuillage pour streap-tease). L’initiative devrait donc venir des locuteurs eux-mêmes (ainsi j’utilise « courriel » de préférence à « mail », tentant ainsi d’imposer mon choix à d’autres. Cela donne parfois de bons résultats). Mais là on se retrouve confronté à un double problème :
1) De quel droit est-ce que moi, simple usager, je me permettrais d’innover et donc de modifier cette langue que j’ai reçue en héritage ? C’est de nouveau le poids du bon usage et de la norme.
2) Beaucoup de locuteurs francophones restent à ce point fascinés par la langue anglaise, qui leur semble symboliser la société idéale (et de fait, c’est bien ce type de société commerciale qu’on veut nous imposer. L’individu qui y souscrit est donc valorisé), qu’ils se croient obligés, par snobisme, d’employer systématiquement le terme anglais quand celui-ci existe. Or il existe souvent un mot français correspondant.
15:14 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : néologisme, langue française, dictionnaires
23/08/2007
Ecriture

Certains distinguent à juste titre l’écrivain de l’écrivant. L’écrivain est reconnu, publié et lu. L’écrivant, lui, se contente de griffonner chez lui. Entre les deux, il y a la barrière qui sépare le professionnalisme de l’amateurisme. Si tout le monde ne peut être écrivain, tout un chacun a le droit d’écrire à ses heures perdues, même si ce n’est qu’un journal. Généralement, le premier vise un large public à qui il propose des œuvres de fiction. Le second se contente souvent de mettre sur papier un ensemble de réflexions qui vont l’aider à voir clair en lui et donc à survivre.
Le problème, pourtant, n’est pas aussi simple. D’abord parce qu’on publie n’importe quoi. Parmi les 740 livres annoncés pour cet automne, on peut raisonnablement supposer que certains ne seront pas bons (c’est un euphémisme). Ces écrivains-là auraient mieux fait de rester « écrivants ». D’un autre côté, on peut tout aussi raisonnablement supposer que chez les écrivants, on rencontrerait des textes de qualité. Certains en effet dépassent la simple rédaction d’un journal et écrivent de la fiction ou de la poésie. S’ils ne sont pas publiés, c’est soit qu’ils n’ont entrepris aucune démarche dans ce sens, soit que les éditeurs ont refusé leurs textes.
Dans ce dernier cas, me direz-vous, ce ne sont donc pas des écrivains puisqu’ils n’ont pas passé le cap de la barrière éditoriale. En effet. Mais cependant, on se rend de plus en plus compte que les éditeurs cherchent avant tout le profit (ce n’est pas leur faute, leur maison ayant été rachetée par de grands groupes, ils sont eux-mêmes à la merci des décisions des actionnaires). Il y aura donc des textes de qualité qui auront été rejetés parce que leur diffusion serait restée confidentielle. Ces écrivants-là auraient dû être écrivains. Ils ne le sont pas devenus. Ils le sont d’autant moins devenus qu’ils ont en fait un autre métier, l’écriture chez eux n’étant finalement qu’un passe-temps. Oui, mais attention. Il ne faut pas s’imaginer que les écrivains, les vrais (ceux qui sont publiés donc) vivent de leur plume. Quelques-uns en sont capables, mais ils sont rares et à la limite ce ne sont pas forcément les meilleurs. Disons que ce sont les plus vendus. A la limite, on pourrait donc vivre de son écriture tout en étant un mauvais écrivain. A l’inverse, de bons écrivains perdent leur temps à exécuter du travail alimentaire (presse, nègre, etc.), ce qui leur laisse peu de loisir pour accomplir une vraie œuvre. On pourrait tenir le même raisonnement pour certains écrivants. S’ils avaient plus de temps et s’ils étaient publiés…
Donc, ni l’autonomie financière procurée par l’écriture ni le choix de l’éditeur ne semblent être un critère suffisant. Qu’est-ce donc alors qu’un écrivain ?
Si on n’a pas de lecteurs, on ne peut raisonnablement se dire écrivain. Si j’écris chez moi et que personne ne me lit, je ne suis manifestement pas un écrivain. D’un autre côté, certains écrivains sont si peu lus (même s’ils sont bons) qu’on pourrait se demander si on a encore le droit de les appeler ainsi.
Ou donc est la barrière ? Suffit-il d’être publié ? On a vu que non. Il faut encore être lu. Mais si le livre que je serais parvenu à faire éditer est mal diffusé, si on ne lui fait pas un peu de publicité, il va rapidement se retrouver au pilon. Serai-je alors un écrivain ? Oui, mais un écrivain malheureux.
D’un autre côté, on se rend bien compte que mon nombre de lecteurs, au début du moins, va dépendre de cette publicité faite autour du lancement du livre. Ce n’est donc plus le contenu de celui-ci qui serait primordial, mais le tapage médiatique fait autour. Voilà qui est troublant. Ne serait écrivain (et non simple écrivant) que celui que le système a choisi. On retombe dans la théorie de Roland Barthes. Tel texte est littéraire parce que j’ai décrété qu’il le serait (d’une manière unilatérale et arbitraire). Tel individu serait donc écrivain parce que la société en a ainsi décidé, indépendamment de la qualité du texte (fond et forme). Voilà qui est inquiétant.
Un autre critère parfois avancé, est le temps consacré à l’écriture. Pas le temps envisagé dans sa durée, mais le fait de ne rien faire d’autre qu’écrire. J’ai ainsi rencontré quelqu’un qui possédait une fortune familiale. Dispensé de travailler, il s’était retiré à la campagne et écrivait. Il avait publié un roman qui n’avait pas eu beaucoup de succès et ensuite avait collaboré avec un photographe pour réaliser un ou deux livres sur la nature. C’est peu pour toute une vie. Il se disait pourtant écrivain puisqu’il ne faisait rien d’autre. Il n’avait pas tort. A l’inverse, j’ai croisé sur Internet des gens qui refusaient de travailler et qui dépendaient de la collectivité pour survivre. Ils n’étaient pas édités, mais comme ils n’avaient jamais rien fait d’autre qu’écrire, ils se qualifiaient d’écrivains. Ils n’avaient pas tort non plus, évidemment. Mais si la même personne avait travaillé tout en écrivant la même chose, on l’aurait qualifiée d’écrivant. Comme quoi tout est complexe.
Le dictionnaire ne nous aide pas beaucoup dans la recherche de notre définition.
Ecrivain : personne qui compose des ouvrages littéraires, scientifiques etc.
Ainsi donc, si j’écris un livre sur la description d’une presse hydraulique ou sur un nouveau procédé de construction, je suis déjà un écrivain ? Je ne l’aurais pas cru.

10:16 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : Littérature, écriture, écrivain
21/08/2007
De la modernité des classiques
"Qu’on abatte les arbres quand c’est nécessaire, mais qu’on cesse d’anéantir les forêts. Toutes les forêts russes gémissent sous les coups de hache, des millions d’arbres sont perdus, les bêtes et les oiseaux quittent leurs refuges, les rivières baissent et se dessèchent, les plus beaux paysages disparaissent à jamais – tout cela parce que l’homme paresseux n’a pas le courage de se baisser pour ramasser le combustible qui traîne. Il faut être un barbare insensé (il montre les arbres) pour brûler cette beauté dans un poêle, pour anéantir ce que nous sommes incapables de créer. L’homme a été doué d’intelligence et de force créatrice pour augmenter son patrimoine mais jusqu’à présent il n’a rien créé, il n’a fait que détruire. Il y a de moins en moins de forêts, les cours d’eau se tarissent, le gibier disparaît, le climat est détérioré et, tous les jours, la terre s’appauvrit et s’enlaidit."
Tchékov, Le Sauvage, Acte I, scène VII
14:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2)
20/08/2007
La fin (faim) des haricots.
Le mot haricot viendrait du mot ayacotl (langue aztèque).
Parmi les variétés de haricots, citons la Mogette, qui est un haricot blanc, de l’espèce Phaseolus vulgaris. C’est une spécialité de la Vendée. Elle est parfois orthographiée mojhette ou mojette. Ce mot a une origine dialectale, en l’occurrence poitevine.
Notons à ce propos que la position fondamentale de l’Etat français envers les dialectes a souvent été de les éradiquer. S’ils étaient tolérés dans l’Ancien Régime, il n’en a plus été de même au moment de la Révolution. Tout citoyen ayant les mêmes droits et obligations, il ne convenait pas que certains se singularisassent par un langage différent. Les locuteurs eux-mêmes ont fait alors l’effort de parler en français car en continuant à s’exprimer en patois on aurait pu les considérer comme de dangereux réactionnaires. Ensuite vint l’enseignement obligatoire qui généralisa l’usage de la langue française au détriment des parlers locaux. Il aura fallu l’influence de l’Union européenne (voir la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires) pour que contraint et forcé l’Etat central reconnaisse les richesses des langues locales.
http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/lgfrance/lgfrance...
Mais revenons à notre mogette. Le Poitevin-saintongeais (parlanjhe) n’existe plus comme tel et on distingue désormais le poitevin proprement-dit du saintongeais. Tous deux appartiennent à la langue d’oïl. Pourtant c’est dans ces régions que l’influence de la langue d’oc s’est le plus manifestée. Des spécialistes considèrent même que ces patois appartenaient à l’origine à la langue d’oc avant de passer ensuite dans la sphère des parlers d’oïl. Pour comprendre, il faut remonter à la conquête de César. A cette époque, le Poitou est rattaché à la province d’Aquitaine, tandis que la langue gauloise originelle disparaît petit à petit et que naît le bas-latin (dérivé non du latin classique, mais du latin parlé), employé par cette nouvelle société gallo-romaine qui est en train d’émerger.
Puis ce fut l’époque des invasions barbares. Le Poitou fut quant à lui sous l’influence wisigothique, comme le reste de l’Aquitaine, ce qui le rattache une nouvelle fois aux parlers du Sud. Notons que ces envahisseurs germaniques ne furent pas en état d’imposer leur langue du fait qu’ils étaient peu nombreux. Le peuple continua donc de s’exprimer en bas-latin (lequel commençait cependant à être différent d’une région à une autre puisqu’il n’y avait plus d’unité politique). Celui-ci, cependant, dut subir l’influence de ces langues germaniques, mais sous la forme d’un simple superstrat. On parle alors, pour la France, non plus de bas-latin, mais de gallo-roman. Celui-ci, parlé par le peuple, se diversifia donc de village à village, tandis que le clergé continuait à employer le latin.

En 987, en île de France, Hugues Capet parlait en francien (langue romane) et non plus en francique (langue germanique du peuple franc). Dans la France féodale du X° et XI° siècle, les ducs de Poitiers et Comtes d’Aquitaine avaient un pouvoir comparable à celui du roi de France, trop faible pour unifier son pays au-delà de la région parisienne. Cependant, après être passé sous domination anglaise (suite au mariage d’Aliénor d’aquitaine avec Henri II Plantagenêt), le Poitou redeviendra une dernière fois indépendant avant d’être définitivement rattaché à la couronne de France. N’étant plus autonome, il n’avait plus de raison de se singulariser par une langue spécifique. Le français l’emporta donc définitivement et les mots occitans demeurèrent sous forme de substrat.
La réalité est encore un peu plus complexe. Au sens propre, le poitevin est un dialecte frère du francien (parlé par le roi de France). Il appartient donc bien à la langue d’oïl. Pourtant, à la cour du Comte de Poitiers, on préférait l’occitan, sans doute pour des raisons de richesse culturelle (poésie des troubadours, etc.) Il y aurait donc eu interpénétration des langues d’oc et d’oïl dans cette région. On peut même supposer que le poitevin primitif offrait lu aussi des ressemblances avec ces deux langues.
Aujourd’hui, c’est dans le pays gabaye que la langue poitevine a le mieux résister à l’influence du français. Le pays gabaye (grande gavacherie) se situe entre la Saintonge et l’Entre-deux-Mers (Blaye) Les Gavaches ou Gabayes étaient des gens de langue d’oïl (appelés ainsi par les gens de langue d’Oc ou Gascons), qui s’étaient implantes là après les pertes humaines dues à la guerre de Cent ans. C’est donc dans cette région que le saintongeais primitif a le mieux survécu. Le terme gavache viendrait de l’espagnol gavacho (« canaille ») et désignerait ceux qui viennent du Nord (donc, les Français pour les Espagnols, les Languedociens pour les Catalans, les Auvergnats pour les Languedociens, etc.)
Dans le vocabulaire gabaye, on retrouve des mots comme
Aive (eau)
A’cet heure (maintenant)
Drôle (garçon)
Drôlesse (fille)
Termes que l’on retrouve aussi dans le Sud du département des Deux-Sèvres (Niort). Notons encore que le patois saintongeais a fortement influencé le québécois, l’acadien et le cajun.
Terminons par où nous avons commencé, c’est-à-dire avec nos mogettes. Ce mot est manifestement d’origine méridionale puisqu’on le retrouve en Comminges (Haute-Garonne). Là, on parle de moungelades (réunions de village autour d'un plat de haricot - moungetes - et de mouton).
15:10 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : saintongeois, patois
17/08/2007
Toponymes
Puisque nous parlions du siège de Saragosse, il n’est pas sans intérêt de connaître l’origine de ce nom et de quelques autres.
Zaragoza vient en fait du latin Caesar Augustus (comme Cologne, en Allemagne, vient de Colonia Claudia Ara Agrippinensium).
BARCELONE: Le nom de la ville aurait une origine carthaginoise puisqu’il viendrait d’Hamilcar Barca, le père d’Hannibal (ah, les guerres puniques et le récit de Tacite lorsqu’il relate le passage des Alpes avec les éléphants…). Ensuite, les Romains auraient transformé ce Barca en Barcino
MADRID (ville fondée par les arabes comme forteresse) : son nom vient d'un mot arabe signifiant 'arroyo matriz' (ruisseau matrice?), qui lui-même viendrait du latin matricem.
Pampelune (Pamplona): ville fondée par Pompée en 75 avant JC, qui lui aurait donné son nom (Pompaelo). Notons que le nom basque est Iruña ou Iruñea (à ne pas confondre avec Irun, qui est la ville frontière avec la France, sur la Bidassoa).
16:42 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : toponymie
Histoire, légende et littérature

Commémorons, avec quelques jours de retard, la mort de Roland, survenue comme chacun sait à Roncevaux le 15 août 778. Trois siècles plus tard, cet épisode tragique (l’arrière-garde de l’armée de Charlemagne avait été massacrée par les Basques, lesquels, soit dit en passant, ne faisaient que se venger de la destruction de Pampelune, tout en ruinant les prétentions franques dans la région du grand Sud-Ouest) allait donner lieu à la Chanson de Roland, un de nos premiers grands textes littéraires.
On sait que Charlemagne (qui n’était pas encore empereur puisqu’il n’allait le devenir qu’en l’an 800) était parti assiéger Saragosse (Zaragoza) afin de lutter contre les musulmans et faire progresser la foi chrétienne. Ce que l’on sait moins, c’est qu’en 777, le gouverneur musulman de Saragosse, le wali Sulayman ibn al-Arabi était allé trouver Charlemagne pour se plaindre de l’émir de Cordoue (Abd er-Rahman 1er), lequel venait de rejeter l'autorité du calife de Bagdad (Al-Mansour) . Or, Charlemagne avait tout intérêt à soutenir le calife dans la mesure où celui-ci avait comme ennemi naturel l'empereur chrétien de Byzance (qui risquait de faire de l’ombre à Charlemagne). En luttant contre l'émir de Cordoue, l’aspirant empereur se faisait bien voir du Calife de Bagdad en qui il espérait sans doute trouver un allié futur. De plus, cette guerre serait l’occasion de s’imposer dans le Sud et de défendre le monde chrétien contre la pression musulmane.
En 778, il traverse donc les Pyrénées et prend Pampelune, Barcelone et Gérone. Mais pendant que l’émir de Cordoue monte à sa rencontre avec son armée, Charlemagne apprend que sa frontière sur le Rhin est menacée par les Saxons. Il lui faut donc remonter au plus vite. D’autant plus que les Chrétiens qui vivaient sous occupation musulmane ne se plaignent pas vraiment de leur sort (ils devaient juste payer une taxe à l’occupant) dans la mesure où les musulmans, minoritaires, les laissaient relativement libres. Difficile, pour Charles, d’apparaître en libérateur dans ces conditions. Il préfère donc faire demi-tour et, après avoir détruit les murs de Pampelune, il repasse les Pyrénées. C’est là que survient l’épisode de Roland, lequel est raconté par le moine Eginhard dans la Vita Caroli Magni.
Il faudra trois siècles pour que cet incident finalement mineur (Roland n’est qu’un obscur préfet de la Marche de Bretagne) devienne la chanson épique que nous connaissons. Ce n’est d’ailleurs que dans ce texte qu’on présente Roland comme le neveu de Charlemagne (voir manuscrit d’Oxford). Eginhard ne dit rien de tel. Nous touchons donc du doigt le génie de la création littéraire qui déforme et amplifie un fait (par ailleurs déjà très ancien) pour en faire une œuvre nationale. Car il est évident que les Chansons de geste, outre leur qualité artistique, répondent à des besoins précis : glorifier les ancêtres afin de poser les bases de la nouvelle société en train de se créer, lui donnant ainsi une sorte de légitimité. Tous les peuples ont agi de la sorte, que ce soit les Grecs (Iliade et Odyssée) ou les peuples nordiques (Veda). Plus tard, ces chansons de geste deviendront ce que nous appelons le roman.
15:45 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Histoire, littérature, Chanson de Roland, Roncevaux
16/08/2007
palin
Nous parlions l’autre jour de palimpseste à propos d’une peinture de VanGogh.
A partir du même préfixe palin (à nouveau), on a formé les mots suivants, qui font rêver par leur sonorité ou leur côté mystérieux :
Palindrome(palin et dromos, la course) :
groupe de mots qui peut être lu de gauche à droite ou de droite à gauche en conservant le même sens (« Esope reste ici et se repose »)
Palingénésie :
1) retour cyclique des mêmes événements
2) retour à la vie, nouvelle vie
3) pour les anciens Chrétiens : régénération par le baptême.
Palingénésique (adj) :
Relatif à la palingénésie.
Palinodie (palin et odh, le chant) :
1) rétraction de ce que l’on a dit ou fait
2) dans l’Antiquité, pièce de vers dans laquelle l’auteur rétractait ce qu’il avait exprimé précédemment.
On notera au passage dans cette dernière phrase l’emploi transitif de « rétracter », d’après le latin retractare (retirer). On connaît mieux la forme pronominale « se rétracter» (revenir sur ce qu’on a dit). Par contre, on ne confondra pas avec l’autre verbe rétracter, également transitif, mais provenant du latin retrahere et qui signifie « faire se rétrécir, contracter » (l’escargot rétracte ses cornes). Lui aussi possède une forme pronominale : se rétracter, au sens de « se contracter, subir une contraction ». Existent aussi les adjectifs « rétractif » (qui produit une rétraction), « rétractiles » (qui a la possibilité de se rétracter) et les substantifs « rétractilité» (qualité de ce qui est rétractile) et « rétraction» (diminution du volume d’un matériau durant sa prise).
A vous de trouver le sens exact de rétractabilité, rétractable et rétractation...
15:23 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vocabulaire, langue française
De la vie privée des hommes publics

Les admirateurs de Sarkozy Premier (et ils sont forcément nombreux puisque celui-ci a été élu démocratiquement) dénoncent unanimement les critiques qui pleuvent sur leur pauvre président (je n’ai pas dit président des pauvres). Ils regrettent surtout que l’opposition, au lieu de s’en tenir au domaine des idées politiques, semble s’en prendre à la personne-même du petit Nicolas. Il est vrai que ce n’est pas sympathique et pour un peu on verserait une larme sur le sort peu enviable de la vedette. Mais à y bien réfléchir, on se rend compte que c’est Sarkozy lui-même qui a placé le débat sur ce plan-là.
Depuis le début, il se complait à jouer un film devant les caméras. Plutôt que de rester dans le rôle sérieux du Président de la France, comme Chirac ou Mitterrand l’avaient fait avant lui (quitte à être un peu trop guindé et un peu trop protocolaire), il a voulu se montrer décontracté. Sur toutes les photos on le voit soit en training en train de faire de la course à pied, soit torse nu en train de bronzer sur un yacht ou sur la plage d’un lac américain. Manière habile de ne pas se faire oublier et manière encore plus habile de neutraliser les critiques à l’égard de ses décisions politiques. On ne parle donc plus de ce qu’il a fait comme président, on se concentre sur sa personne. D’ailleurs si vous écrivez un article de quatre pages pour dénoncer son projet de loi sur la récidive, personne ne le lira, les gens préférant voir les photos de leur idole en train d’accoster brutalement un bateau de journalistes. En fait, politiquement, il pourra décider à peu près n’importe quoi, il l’emportera à l’esbroufe sur le plan médiatique. Il aurait pu être chef de rayon dans une grande surface, il serait parvenu à vendre très cher des produits de mauvaise qualité tout en ayant l’assentiment de la clientèle.
Dès lors, puisqu’il gagne toujours et qu’il joue de son personnage pour faire passer ses idées, rien d’étonnant à ce que l’opposition (qu’elle en soit consciente ou non) se concentre elle aussi sur sa petite personne plutôt que sur ses idées néo-libérales. Bien entendu, une fois qu’elle a mis le pied dans ce bourbier, on le lui reproche aussitôt : elle ferait du harcèlement en guettant les moindres faits et gestes de l’empereur. Sans doute, mais à qui la faute ? A force de se faire photographier devant le yacht de votre ami milliardaire, il fallait s’attendre à une réaction de ce genre.
Les choses vont plus loin qu’il n’y paraît, cependant. En envoyant sa tendre moitié Cécilia jouer les négociatrices en Lybie, le petit Tsar de toutes les Sarkozies s’est montré très habile. D’une part il a fait intervenir une femme dans une affaire qui concernait surtout les femmes (les infirmières bulgares) et d’autre part il est resté en retrait, ce qui lui a permis de négocier son contrat d’armement en toute discrétion. De ce contrat, il ne dira évidemment pas qu’il fait plaisir à ses amis milliardaires (il en a combien, au fait, d’amis milliardaires ?), il dira qu’il donne de l’emploi aux Français (enfin, à ceux qui veulent bien se donner la peine de se lever tôt). On ne s’étonnera pas non plus de la soudaine discrétion qui a été de mise dans cette affaire, discrétion à laquelle il ne nous a pas habitués lors de ses vacances luxueuses. Par contre on notera l’habileté du procédé. Quand l’opposition demande à voir clair dans cette affaire et réclame que la belle Cécilia soit entendue par une commission parlementaire (puisqu’elle a agi au nom et sur ordre de son président de mari, dont elle était en quelque sorte le porte-parole officiel), on répond que cela relève de la sphère privée. De nouveau, donc, on joue sur le côté personnel pour faire passer une manœuvre politique. Mais comme l’argument ne semble pas tout à fait convaincant, on trouve une autre réponse : Cécilia, ce n’est pas Bobonne (allusion à l’épouse de Charles de Gaulle, qui tricotait des chaussettes à l’Elysée pour passer le temps) s’est écrié André Santini, le secrétaire d’Etat chargé de la Fonction publique :
"Cécilia est une femme très moderne, indépendante. (...) Je suis toujours surpris de l'image qu'elle a chez les femmes, qui disent: "elle a raison, elle ne veut pas être bobonne, elle ne veut pas faire le yucca, le caoutchouc, elle veut pas être là quand on sonne, et bien c'est très bien""
Donc, la nouvelle première dame de France fait elle aussi de la politique. Elle qui n’avait pas été voté en même temps que son mari et qui se moquait pas mal du rôle qu’on voulait lui faire jouer, voilà maintenant qu’elle remplace le Président débordé. Mais, que je sache, ce n’est pas pour elle que les Français ont voté (enfin, certains, pas tous) mais pour Nicolaou. Une nouvelle fois on confond les registres privés et publics et on ne sait plus où est la limite. Cela permet de créer des zones d’ombre et d’éviter les critiques. Si les infirmières sont libérées, c’est grâce à Sarkozy (qui est arrivé juste au bon moment, quand Kadhafi avait suffisamment fait monter la pression afin d’en retirer un avantage : sa réinsertion sur le plan international). Si par malheur les démarches avaient échoué, on aurait dit que Cécilia, en tant que femme, avait fait une simple visite de courtoise.
Enfin, on n’est pas à une contradiction près. C’est comme quand Santini, chargé, comme on l’a dit, de la Fonction publique trouve anormal que 24% de la population soit fonctionnaire. C’est peut-être vrai, mais le fait que ce soit lui qui le dise a de quoi surprendre.
13:31 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Politique, Sarkozy
11/08/2007
Eloge de la lecture

Fragonard, La lectrice, 1772
Avez-vous remarqué comment le fait de lire isole celui qui s’adonne à cette activité ? Dans un train ou sur un banc public, le lecteur plongé dans son livre ne voit rien du monde qui l’entoure. Impossible d’entrer en contact avec lui. Les yeux baissés, il vit en apnée dans un autre univers, il est ailleurs, à mille kilomètres de vous.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la lecture ne facilite pas les contacts sociaux. Et pour cause. Le lecteur ignore superbement ceux qui l’entourent. C’est que ce qu’il recherche dans un livre, c’est avant tout une coupure avec son quotidien. La lecture, quelque part, est donc une fuite. Une fuite dans l’imaginaire, enrichissante, certes, mais une fuite tout de même. S’isoler et partir ailleurs, tel est finalement le moteur de cette démarche. Rechercher d’autres univers, d’autres mondes, où la vie serait enfin supportable. Ou au contraire plonger dans l’horreur de l’existence, toucher du doigt son non-sens et cela par la découverte de la vie fictive de personnages de papier.
Car le paradoxe est là : celui qui vous regarde lire a l’impression que vous ne faites rien, que vous êtes inactif. Yeux baissés, vous semblez endormi. Refusant de vous engager dans la vie ordinaire, vous êtes perpétuellement en retrait. Pourtant, vous qui dévorez les lignes qui défilent devant votre rétine, vous avez au contraire l’impression inverse : celle d’une activité primordiale. C’est que dans les livres, on va à l’essentiel, sans se perdre dans la grisaille insignifiante du quotidien. Don Juan voudra essentiellement conquérir les belles et Rodrigue épouser Chimène. Madame Bovary courra droit au suicide tandis que Rimbaud plongera pour une saison dans l’enfer qu’il s’est créé. Beckett dira l’absurde, Camus le dénoncera et Malraux tentera d’y échapper comme il pourra. Ce qui fait que vous en apprenez plus sur la vie et sur vous-même en un seul livre qu’en une année d’existence. Ce qui ne semblait qu’un loisir, un passe-temps, se révèle être un catalyseur. C’est pour cela que les yeux baissés, plongé dans votre lecture, vous vous coupez du monde et ignorez celui (ou celle) qui vous observe.
On pourrait faire la même remarque au sujet de l’écriture. Est-elle fuite en avant, refus d’avoir un comportement normal ou bien au contraire une activité essentielle, vous permettant d’exister enfin par le processus de la création ? Autrefois je me suis souvent posé cette question. Les gens « normaux » n’écrivent pas, ils vivent, tout simplement. Ils ont un travail, des enfants, des loisirs. Ils sont engagés dans la société qu’ils tentent de modifier dans le sens qui leur convient par leurs actions (actions humanitaires, engagement politique ou syndical, etc.). L’écrivain, lui, s’isole devant sa feuille blanche comme le lecteur le faisait devant la page écrite. Il est ailleurs. Le fait d’écrire est-il donc condamnable ? Participe-t-il à un refus de vivre la vraie vie en le remplaçant par la création d’un monde imaginaire qui serait meilleur ? Autrement dit, écrire serait-il une démarche puérile, proche du jeu, qui éviterait les engagements réels ? Je l’ai cru autrefois, mais ayant pourtant un travail, des enfants et étant engagé dans différentes actions, il m’apparaît aujourd’hui que c’est l’écriture, comme la lecture, qui va à l’essentiel. Coupée du monde en apparence, elle peut, non seulement donner un certain sens à votre existence (puisqu’elle vous incite à mettre clairement, noir sur blanc, ce que vous ne faisiez que pressentir confusément) mais aussi, par la force des mots, agir indirectement sur le monde extérieur.
Mais dans tous les cas, l’écriture comme la lecture sont des activités qui relèvent d’une même vocation et qui sont finalement liées à une certaine ascèse. C’est sans doute pour cela que l’attitude du lecteur, les yeux baissés, non par modestie mais par concentration intérieure, le fait ressembler à un religieux plongé dans la méditation. Sorte d’ermite contemporain, il vit en marge de ses frères humains, ne communiquant vraiment qu’avec les autres lecteurs, avec lesquels il a des affinités et avec lesquels il partage une pensée commune. Semblable à un ordre monacal, la secte des lecteurs ne comporte que des initiés, sensibles aux choses intemporelles et intangibles. Ils se comprennent entre eux, mais s’ils aiment les échanges, il faut surtout leur accorder le temps de s’isoler car c’est de la rencontre entre leur regard et la chose écrite que naît leur plaisir.
Après le portrait d’une lectrice par Fragonard, représenté ci-dessus, on pourrait proposer d'autres peintures abordant le même thème (ce qui, soit dit en passant, est une manière de concilier deux arts: la peinture et la littérature, la première parlant de la seconde). On aura bien entendu le tableau de Van Gogh:

Mais aussi celui-ci, intitulé jeune femme en bleu, de JohannesVermeer (Vermeer de Delft):

Ou bien encore, la liseuse, toujours de Vermeer:

Sans oublier, de Friedrich Heinrich Füger, une Marie-Madeleine sortant de sa lecture et méditant:

Chez les modernes, citons la liseuse de Monet:

Celle de Matisse:

Ou encore celle de Renoir:

Bref, on n'en finirait plus de répertorier les peintres qui ont représenté le phénomène de la lecture. Remarquons en passant que pour ce faire ils se sont surtout intéressés aux jeunes femmes plutôt qu’aux hommes. Ces femmes ont toujours les yeux baissés ce qui renforce leur inaccessibilité. Un parallèle se dessine donc entre la lectrice qu’on ne peut déranger dans sa lecture et la femme dont on ne peut attirer l’attention. Inabordable par définition, fermée à l’amour de l’homme qui la désire, elle reste isolée, perdue dans son fort intérieur, telle qu’en elle-même l’éternité la change.
C’est sans doute de cela que Dominique Autié voulait parler sur son blogue
(http://blog-dominique.autie.intexte.net/blogs/index.php/2...), quand il a établi un parallèle entre l’obscénité qu’il y a à contempler la lectrice et celle qu’il y aurait à imaginer la scène primitive telle que Freud la définissait. Il ne nous appartient pas de déranger cette lectrice, isolée dans sa lecture comme la femme l’est dans sa perfection.
01:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, lecture
09/08/2007
Essai de sémiotique ou étude de la gestuelle présidentielle.
On sait qu’en littérature, on ne publie que ce qui se vend. On sait aussi qu’on ne vend que ce dont on parle. Autrement dit, le contenu d’un livre a moins d’importance que la publicité qui est faite autour de lui. Plus on en parle et mieux c’est.
Le petit président de la grande Sarkozie a visiblement compris la leçon (il ne me semble pourtant pas un fervent adepte de la lecture) puisque qu’il ne se passe pas un jour sans qu’on ne parle de lui. Après l’affaire du yacht privé qu’un riche ami industriel lui avait prêté (croisière qui, on s’en souvient, avait remplacé la retraite initialement annoncée, laquelle aurait dû avoir pour fonction de réfléchir sur le poids de la fonction présidentielle), le voici, sur son lieu de villégiature, qui passe à l’abordage du canot des journalistes occupés à le photographier. Il s’ensuit des propos assez virulents, du moins peut-on le supposer d’après le ton employé, car pour ce qui est du fond, exclusivement exprimé en français, les pauvres photographes américains n’en on pas compris le sens.
Comment interpréter un tel geste ? On n’avait jamais vu Mitterrand invectiver la presse en maillot de bain ou Giscard apostropher les journalistes en pyjama. Il faut dire que le nouvel occupant de l’Elysée a un style bien à lui, un style qui mérite qu’on s’y attarde.
Faut-il voir dans l’abordage du canot un trait de colère incontrôlé ? Si c’est le cas, ce n’est pas là un geste digne du représentant d’une grande nation. Le sieur Sarkozy aurait dû comprendre, même s’il est en vacances privées, qu’un tel geste risquait d’alimenter la critique et de se retourner contre lui. Un mauvais point pour lui, donc. Mais l’homme aime trop se pavaner devant les caméras pour qu’une autre explication ne puisse être envisagée. Le Président aurait délibérément accosté les journalistes précisément parce qu’il savait qu’on en parlerait. Même en période estivale, il ne faut pas que l’attention médiatique se détourne de sa personne. Eternel candidat, il prolonge la campagne électorale (où il a été excellent puisqu’il est parvenu à ce que les pauvres votent pour lui alors qu’il n’il n’a pas caché qu’il ne travaillerait que pour les riches) en se mettant lui-même sur le devant de la scène, ce qui détourne l’attention des mesures qu’il a prises en tant que Président. De plus, en pleine polémique suite à la signature d’un contrat d’armement avec la Libye (lequel intervenait après la libération des infirmières bulgares, épisode dans lequel c’est surtout Cécilia qu’on avait habilement mise en avant), il n’était pas mauvais de lancer les médias sur d’autres pistes.
On remarquera en passant que le petit Nicolas n’a pas envoyé ses gardes du corps pour faire la morale aux photographes, mais que, tel superman, il s’est déplacé lui-même. D’un côté, il rabaisse donc la fonction présidentielle en la confinant dans des tâches subalternes et secondaires, mais de l’autre il montre qu’il n’a pas peur de donner de lui-même et que comme tout bon citoyen ordinaire il protège sa famille.
Ce côté « démocratique » qui le fait ressembler à monsieur tout le monde, il le cultive volontiers. Quand on ne le voit pas en train de faire son jogging matinal, on le découvre en maillot de bain et torse nu. Il y a là, manifestement, une tendance à l’exhibitionnisme. Le but est donc bien de se faire voir et de faire en sorte qu’on en parle.
De toute façon, qu’il ait été réellement en colère, lassé d’être harcelé par les paparazzis, ou au contraire qu’il ait délibérément provoqué l’incident, le résultat est le même : on ne parle plus que de cela. En ce mois d’août, aucun article de fond sur la TVA sociale (destinée à faire payer par les consommateurs ordinaires les avantages fiscaux accordés aux entreprises), la loi sur la récidive ou le démantèlement programmé de la fonction publique. Il faut savoir à ce sujet qu’on ne remplacera plus tous les fonctionnaires qui partiront à la retraite afin de faire des économies budgétaires. C’est peut-être une bonne idée à court terme, mais sur une longue période cela aura pour conséquence d’empêcher les ministères de remplir leur rôle avec efficacité (ce qui permettra sans doute de proposer des privatisations partielles). A côté de cela on parle de supprimer des milliers de postes de professeurs, ce qui entraînera immanquablement une explosion de la petite criminalité. Cela ne fait rien. Le nombre des gardiens de prison a, lui, été revu à la hausse.
C’est donc de tout cela qu’il ne faut surtout pas parler, en recentrant le débat sur la personne du Président lui-même, cet éternel candidat qui prolonge la campagne électorale en la transformant en campagne de séduction. Et qui dit séduction, dit représentantes de la gent féminine. Or, des femmes, il n’en manque pas dans l’entourage de Sarkozy. D’abord il y a la belle Cécilia, dont la presse « people » s’est emparée et dont on se demande toujours si elle sera toujours là le lendemain. Et puis il y a toutes les femmes du gouvernement et plus particulièrement Rachida Dati, cette superbe étrangère (père marocain et mère algérienne) qui symbolise la réussite sociale promise à la population immigrée (pour autant que celle-ci fasse l’effort de s’intégrer). Choisie précisément pour ce qu’elle incarne, elle aura le triste rôle de mettre en prison ceux de ses frères de race qui n’auront pas respecté les lois françaises.
Nicolas Sarkozy joue donc un rôle en permanence. C’est en acteur qu’il s’est fait élire et c’est en acteur encore qu’il dirige le pays. Rien d’étonnant dès lors à ce que les photographes le harcèlent comme ils le font d’habitude avec les vedettes du festival de Cannes. En rabaissant le prestige présidentiel et en donnant de lui-même une certaine image (genre faux sportif décontracté), le locataire de l’Elysée nous fait oublier son manque de culture, son manque de style et surtout ses idées néo-libérales et pro-atlantistes si déplaisantes. En attendant une bonne partie des Français sont en vacances (les autres travaillent ou ne savent pas partir) et, sous la pluie, dans leur camping en Normandie ou en Auvergne, ils rêvent de cette villa américaine où leur président peut jouir de onze salles de bain. Il l’avait bien dit : l’avenir appartient manifestement à ceux qui se lèvent tôt.
16:14 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Sarkozy, politique
08/08/2007
Surimpression

Ainsi donc on a découvert un nouveau Van Gogh. La peinture se trouvait sous l’oeuvre « Ravijn » (qui appartient à la collection du musée de Boston), laquelle, passée aux rayons X, a laissé apparaître un autre thème, proche du tableau. Cela tombe bien car au même moment on apprend que la pièce maîtresse du musée de Melbourne, « Tête d’homme » ne serait pas de Van Gogh.

Tout cela laisse rêveur, surtout quand on connaît le prix des toiles du peintre hollandais. Nous nous retrouvons donc avec deux vrais Van Gogh sur une même toile et un faux. Mais ce faux n’en est pas vraiment un nous explique-ton. C’est une vraie peinture, peinte par un inconnu, sans intention d’en faire un faux Van Gogh. C’est donc un vrai, mais attribué par erreur à Van Gogh.
Tout ceci mérite quelques réflexions. D’abord on se demanderait bien si les experts ne jouent pas à créer les vrais et les faux. Sans doute sont-ils sincères et objectifs, mais il est certain que leur avis permet de multiplier le prix d’une toile par mille ou au contraire de le réduire à néant. Ceci dit, on regrettera que l’argent, une fois de plus, soit devenu la seule manière pour certains d’apprécier la valeur d’une toile. L’émotion esthétique semble en effet souvent passer au second plan. Quel est l’intérêt d’acheter une peinture pour l’enfermer dans un coffre à la banque ? Ne devrait-il pas exister une loi qui obligerait ces propriétaires à prêter leurs collections aux grands musées afin que le public puisse les admirer ? Il est vrai que ces mêmes musées disposent souvent d’un droit de préemption lors des ventes, mais les prix atteints ne leur permettent généralement pas de se porter acquéreurs. Il me semble pourtant que les tableaux des grands maîtres appartiennent quelque part au patrimoine de l’humanité et qu’ils devraient pouvoir être vus pas tous. Imagine-t-on le Colisée appartenir à un particulier ? Il est vrai qu’en son temps Berlusconi avait penser le vendre…
Mais ce qui me fascine surtout, dans l’histoire des deux Van Gogh sur une même toile, c’est cette notion de palimpseste. Le mot vient du latin palimpsestus, d’après l’adjectif grec palimsestoz, servant à désigner un parchemin que l’on gratte pour écrire de nouveau (palin ). Technique normale dans l’Antiquité, le mot est attesté chez Cicéron. Au XIX° siècle, il est repris par la paléographie avec le sens actuel. De leur côté, Baudelaire et Hugo définiront l’oubli comme un palimpseste.
Car le palimpseste ne caractérise pas uniquement la peinture. Toute œuvre littéraire, si on y réfléchit, est toujours un palimpseste puisqu’elle se nourrit des oeuvres antérieures déjà écrites. Chaque écrivain est avant tout un grand lecteur et nul ne peut prétendre être original au point de ne pas s’inspirer de ce qu’il a lu.
Notre vie elle-même n’est qu’une éternelle superposition d’impressions, chacune remplaçant la précédente sans l’effacer tout à fait. Ainsi on peut supposer que notre comportement actuel est déterminé par ce que nous avons vécu antérieurement (par exemple dans notre enfance, mais pas uniquement) et cela sans que nous en ayons vraiment conscience. Certains spécialistes parlent même de psychanalyse « transgénérationnelle ». Ainsi, tel problème rencontré aujourd’hui par un individu pourrait provenir de son éducation, ses parents ayant de leur côté intériorisé les conflits et les problèmes de leurs propres parents. Il faudrait donc remonter quatre-vingts ans en arrière et rechercher dans le comportement d’un grand-père depuis longtemps disparu et dans le non-dit qui a entouré ce comportement, l’origine du mal-être d’un enfant aujourd’hui par exemple. Tout ceci doit nous rendre très modestes. Nous qui avons souvent l’impression d’agir en fonction de nos convictions et après mûre réflexion, nous nous rendons compte que nous ne sommes que le fruit d’un déterminisme qui nous échappe. La question n’est pas neuve et elle a déjà fait couler beaucoup d’encre dans le domaine de la religion. Souvenons-nous de Luther et de Calvin. Face à l’Eglise romaine et à ses indulgences que l’on pouvait acheter (ce qui faisait que seuls les riches allaient au paradis), Luther avait permis à l’individu de lire la Bible et de réfléchir par lui-même (en se passant des prêtres) sur la meilleure manière de régler sa vie en fonction du livre saint. Chacun devenait donc responsable de sa vie et de son salut. Mais voilà Calvin qui vient annoncer que tout est prédestiné et que malgré tous ses efforts celui qui doit être damné le sera par volonté divine (et inversement). On n’échappe pas à son destin, en quelque sorte. Ce qui nous ramène aux Grecs et à leur conception de la divinité : les Dieux se jouent des hommes et Œdipe, malgré tous ses efforts, tuera son père et épousera sa mère.
D’ailleurs qui sommes-nous, finalement. Au moment où j’écris ces lignes il me semble le savoir clairement. Et pourtant je ne suis plus celui que j’étais il y a vingt ans (simplement parce que n’ayant plus le même âge mes préoccupations sont devenues autres) sans pourtant que je me sois rendu compte de la transformation. De plus, entre-temps l’époque a changé et les mentalités aussi. Du coup, tout en ayant l’impression d’être resté moi-même, il s’est opéré une double transformation, une double distorsion, un peu comparable à cet espace-temps courbe défini par Einstein. Tout est relatif. Je crois être moi-même mais je ne suis que le fruit de mon époque. Aurais-je vécu au Moyen-Age que j’aurais pensé des choses différentes. Et en grattant au fond de ma mémoire je retrouve des événements qui ont fait ce que je suis devenu. L’Histoire, notre histoire, n’est qu’un immense palimpseste, finalement.
Van Gogh le savait, lui qui peignait frénétiquement toutes ses impressions.
11:42 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Van Gogh, palimpseste
16/07/2007
Fermeture annuelle
FERME pour cause de vacances.
20:46 Publié dans Blogue | Lien permanent | Commentaires (0)
13/07/2007
De l'ordre des livres
Les livres, dans ma bibliothèque, sont rangés, ce qui est déjà bien. Le problème, c’est que le classement peut parfois sembler arbitraire, seul le maître des lieux s’y retrouvant plus ou moins. Doit-on classer par genre, par pays, par thème ? J’ai opté finalement pour le classement par genre (essais, romans, poésie, livres de critiques, peinture, histoire, dictionnaires et encyclopédies, histoires de la littérature, divers), doublé d’un classement alphabétique. Il y a, bien entendu, quelques petites entorses, comme le fait qu’un rayonnage spécial soit réservé à la littérature d’Espagne et d’Amérique du Sud, ce qui crée quelques confusions : où placer Neruda : dans ce rayon ou dans la poésie ? C’est curieux d’ailleurs. Un roman de Péruvien Vargas Llosa sera rangé d’office dans ce rayon hispanique, tandis que pour la poésie, j’hésite. Est-ce dû à l’essence même de la poésie, qui semble mériter sa rubrique à part, quelle que soit la nationalité de l’auteur ou bien tout simplement mon choix est-il guidé par le fait que souvent ces livres de poésie appartiennent à la collection Poésie de chez Gallimard et qu’il est donc logique de les regrouper tous ? Il serait intéressant de savoir ce qui se passe dans notre subconscient quand nous classons nos livres et notre choix définitif, s’il était analysé, révélerait peut-être beaucoup plus de choses que nous ne l’imaginons sur nos goûts et nos priorités en matière de littérature.
Finalement, avec mon classement, il ne subsiste qu’un inconvénient majeur : celui de savoir comment intégrer les nouveaux livres qu’on vient de lire. Il est difficile, en effet, de déplacer des rangées entières chaque fois qu’il faut venir intercaler un ou deux volumes dans l’ordre alphabétique préexistant. La solution trouvée consiste à consacrer un rayonnage provisoire à ces nouvelles acquisitions. Idéalement, une fois le rayonnage rempli, il faudrait alors incorporer l’entièreté des volumes présents dans le classement alphabétique général de la bibliothèque (tout en respectant toujours les subdivisions par genres : romans, essais, etc.), ce que je fais bien rarement, il faut bien l’avouer. Moralité : je me retrouve avec plusieurs classements alphabétiques parallèles, ce qui ruine d’un coup l’intérêt d’un tel classement.
Il faudrait aussi parler des volumes non-lus, qui représentent tout de même une pile importante, que mes flâneries dans les librairies viennent alimenter en permanence. Ces non-lus, eux, sont sur un rayonnage à part, sans classement aucun, ce qui permet de choisir le livre que l’on désire selon les affinités du moment, sans devoir se plier à une quelconque logique. (Cela signifie que l’ordre de lecture ne respectera pas la date d’achat). D’une manière générale, j’ai tendance à alterner les genres. Après un roman très long, j’éprouve le besoin de lire de la poésie. Après la poésie, je passerai à de l’histoire ou à un essai, avant de revenir à quelques romans courts, etc. L’avantage, c’est que j’aborde toujours un nouveau livre dans un bon état d’esprit. Je ne me dis jamais : « il faudrait tout de même bien que je me décide à lire cette brique ». Non, chaque livre arrive au stade de la lecture quand il est attendu. Cela ne m’empêche pas, d’ailleurs, de l’avoir déjà feuilleté une ou deux fois au préalable, histoire d’en deviner le contenu et de jouir à l’avance du moment où je pourrai enfin le lire.
Bon, j’avais dit plus haut que le seul problème non solutionné était l’intégration des livres lus dans le classement alphabétique général. A bien y réfléchir, il en subsiste également un autre, qui est le critère esthétique. En effet, il peut paraître souhaitable de regrouper ensemble tous les Gallimard, tous les Stock, tous les Seuils, etc. Un alignement de livres de la même couleur et de la même taille peut sembler plus harmonieux au regard que d’alterner un grand volume bleu avec un petit volume rouge. Sur un plan purement intellectuel, un tel souci esthétique n’a aucun sens, j’en ai bien conscience. Néanmoins, j’ai eu tendance à regrouper tous les NRF ensemble, comme tous les Pléiades, sans doute à cause du prestige dont jouissent ces deux collections. Pour les Pléiades, tout le monde agit comme moi, je crois, mais pour les NRF, pas forcément. Pourtant, il y a un plaisir certain à pouvoir passer la main sur la tranche de ces livres au ton chaud et discret. La couverture cartonnée mais non plastifiée offre une jouissance qu’on n’a pas forcément l’occasion d’éprouver avec d’autres collections. Il me semble toujours qu’il émane de ces Gallimard comme une « aura littéraire », qui ne tient pas seulement au prestige de la NRF, mais peut-être aussi au fait que ces volumes renvoient à l’Histoire littéraire de la France. Ils SONT la littérature française et leur côté un peu vieillot (uniquement cartonnés et de couleurs discrètes) permet de faire rêver de temps plus reculés encore, temps dont ils semblent avoir conservés l’âme pour nous la restituer à notre époque de l’électronique.
Du coup, si les Gallimard sont à part (sauf ceux qui ne sont pas encore lus et sauf ceux qui viennent juste d’être lus et qui sont donc sur le rayonnage provisoire, vous me suivez toujours ?), il m’a paru logique de regrouper également les livres de poche et tant que faire de se donner ce mal, de les regrouper par collections : Folio, Livre de poche et Livre de poche classique (ceux avec une couverture rouge cartonnée, qu’on ne trouve plus qu’en occasion). Cela nous donne donc un classement alphabétique pour les Folio, un pour les Livres de Poche, un pour les Gallimard, un pour les autres collections originales, un pour la poésie Gallimard et un pour les auteurs hispaniques. Quand je vous disais qu’il n’y avait que moi pour m’y retrouver !
En fait, je m’en rends compte, le problème vient du fait de croiser plusieurs critères : critère alphabétique, critère esthétique, critère du genre (roman, poésie…), critère de langue (les Hispaniques). Mais bon, le principal n’est-il pas que je puisse toujours aller chercher le bon volume quand j’en ai besoin ? Les soirs d’hiver, quand il me prend l’envie, à deux heures du matin, de relire quelques pages de mon Montaigne, je sais où aller le trouver. De mémoire je me souviens que c’est une édition de poche et qui plus est chez Garnier-Flammarion. Tiens, je ne l’avais pas encore citée, cette collection... Commencerais-je tout de même à m’y perdre un peu ?

Sur cette photo, découverte sur Internet et qui n’est donc pas une photo de ma bibliothèque, on remarquera que l’ensemble reste harmonieux, la taille des livres étant plus ou moins identique.
11:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Littérature, livres
12/07/2007
Autopromotion

http://www.vebret.com/actualite/
Dans "La Presse littéraire", actuellement en vente dans les kiosques parisiens, on trouvera:
1. Mon article sur Oriana Fallaci (rapport entre écriture journalistique et écriture littéraire). Ce thème avait d’abord été abordé ici-même
(http://feuilly.hautetfort.com/archive/2007/04/11/roman-et...l) et puis finalement il a donné lieu à cet article.
2. Ma nouvelle « Un écrivain plein d’avenir ». C’est la première fois qu’une de mes nouvelles paraît ainsi dans une revue, c’est pourquoi je me permets de le signaler. Sur un ton mi-ironique, mi-amusé, on découvrira les déboires d’un aspirant écrivain qui recherche un éditeur. Allez savoir d’où cette idée m’est venue…
15:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, La Presse littéraire
10/07/2007
Paysage (5)

Que connaissons-nous des campagnes d’autrefois ? Rien, sans doute. Les villes elles-mêmes, il n’est pas facile de se les représenter. Comment était Paris au Moyen-Age ou Toulouse ou Bordeaux ? Nous ne le savons pas vraiment et seule notre imagination permet de suppléer à cette carence. Il existe des documents, pourtant, qui représentent ces villes, des plans, des cartes, que sais-je encore. Il y a aussi les vestiges monumentaux qui nous viennent de ces époques lointaines et que nous avons conservés tant bien que mal : les châteaux-forts, les murailles de Carcassonne, mais aussi les rues sinueuses du vieux Rouen ou celles plus modestes de certains villages (Saint –Cirq Lapopie, dans le Quercy, Castelnou, dans les Pyrénées, etc.).

On parvient donc à se représenter tant bien que mal à quoi devaient ressembler ces villes et villages médiévaux. Je ne parle évidemment que de la configuration des lieux pas de l’ambiance qui devait y régner, car là c’est bien plus difficile.
Et les campagnes ? Les champs qui entourent le village, la forêt qui longe les champs, les chemins de terre qui relient un lieu à un autre ? Tout cela était-il désert, comme aujourd’hui ou au contraire était-ce peuplé par toute une population de paysans occupés à travailler ou de voyageurs en train de se déplacer ? Ici, point de vestiges, peu de croquis, pas de traces du temps passé. Des millions et des millions de personnes ont ainsi vécu du travail de la terre et nous n’en avons conservé pour ainsi dire aucun témoignage.
Notre conception contemporaine est faussée. Si je me promène aujourd’hui dans les Causses ou dans les paysages de la Haute-Loire, j’apprécierai, moi le citadin, le calme reposant de ces lieux. Mais la désertification ambiante, l’abandon de ces hautes terres par leurs habitants, ne doivent pas me faire oublier qu’il n’y a pas si longtemps, ces contrées étaient encore bien peuplées. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder la liste des noms inscrits sur les monuments aux morts. Tel village qui ne compte plus aujourd’hui qu’une centaine d’habitants avait pourtant « donné à la France » une bonne cinquantaine de ses fils. Cela veut bien dire que les habitants ont tous quitté leurs activités agricoles pour s’en aller vers les villes, où ils sont devenus « flics ou fonctionnaires » comme disait Ferrat dans sa chanson. Cela veut dire aussi qu’autrefois les champs étaient peuplés de ces travailleurs manuels, occupés à faucher le foin ou à mettre en gerbes la récolte de blé. Tout cela m’a encore été confirmé par mes parents. Il était impossible de sortir du village sans croiser des dizaines de villageois s’en allant ou revenant de leurs champs, tandis que si le regard se portait à l’horizon, il rencontrait une campagne animée et peuplée par tous ces paysans occupés à leurs tâches. On s’interpellait d’un lopin de terre à un autre, on prenait des nouvelles de la maladie d’un voisin, on voulait savoir si la petite Marie avait déjà accouché et si c’était un garçon. Bref, toute une vie sociale se déroulait à l’extérieur, là où aujourd’hui vous n’avez plus que le passage rapide et bruyant d’un unique tracteur.

Je ne dis pas que c’est mieux ou plus mal, je dis que c’est différent.. Et j’ajoute qu’il nous est difficile d’imaginer ce qu’étaient nos campagnes il n’y a pas encore si longtemps. Et pourtant… Et pourtant c’est une activité millénaire qui est venue mourir ainsi dans le courant de la deuxième moitié du vingtième siècle. Un fromage comme le cantal, la fourme d’Ambert ou le Saint Nectaire, que l’on fabrique encore de manière artisanale (mais de moins en moins) dans les fermes du massif central, ce fromage, dis-je, remonte au moins à nos ancêtres gaulois. C’est toute une tradition et un savoir-faire millénaire qui est ainsi arrivé jusqu’à nous, pour être remplacés par des laiteries industrielles aux produits insipides.
Mon but ici n’est pas d’être nostalgique, mais de faire comprendre que nous avons assisté, bien malgré nous, à la fin d’un monde et au remplacement de celui-ci par un autre. Il faudrait tout de même se souvenir que ces activités traditionnelles étaient finalement celles des agriculteurs-éleveurs du néolithique et qu’il n’y avait peut-être pas une différence aussi fondamentale qu’on pourrait le croire entre un paysan de 1930 et son ancêtre qui vivait en moins 3000 avant JC. Ou que cette différence était moindre qu’entre ce même paysan et un Parisien vivant dans son HLM et fréquentant assidûment les Mac Donald.
Alors, parfois, je me plais à imaginer cette vie d’autrefois. Sur les sentiers de terre des campagnes, il me semble voir les clercs du Moyen-Age se rendant d’une abbaye à l’autre afin d’aller étudier. Quand parfois une ombre se dessine à l’horizon, il me plait de penser que c’est peut-être Zénon, le héros de L’Oeuvre au noir de Yourcenar que je vais croiser. A l’approche du village, je finis par sentir l’odeur du pain que l’on vient de cuire dans le four banal et devant la vieille forge en ruine il me semble entendre le bruit des marteaux qui battent encore le fer.
Qu’êtes-vous devenus, frères humains qui avez été ? En quel lieu êtes-vous partis, avec tout votre savoir-faire et votre simple sagesse faite de bon sens ?

15:38 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (0)







