07/07/2007
Qu'est-ce que l'utopie?
Quelle est l’origine du mot Utopie ? Il vient de l’Utopia de Thomas More, bien entendu. Au moins voilà un écrivain qui non seulement osait rêver mais qui en plus n’avait pas peur de créer des néologismes. Formé de toute pièce à partir d’étymons grecs (« υ », prononcé « ou » pour la négation, « τοπος » pour le lieu et un suffixe « ia »), ce mot désignait donc un lieu qui ne se trouve nulle part. Notons que More a aussi employé le mot « eutopia » (d’après « ευ », bon), qui voulait dire alors le bon lieu, le lieu agréable, l’endroit où il est bon de se trouver. La langue française n’a retenu qu’utopie, lequel est devenu un nom commun. Pourtant, dans l’esprit de l’auteur, les deux termes sont complémentaires. L’utopie est un lieu fictif (utopie) dans lequel il souhaite réfléchir sur l’établissement d’une société idéale (voir la note sur Rousseau, son bon sauvage et ses projets de constitution corse). Alors qu’aujourd’hui le terme renvoie à quelque chose qui n’existe pas, qui est du domaine de l’impossible, pour More, au contraire, il ne s’agissait que d’un lieu fictif, imaginaire, mais qu’il aurait voulu voir exister et dans lequel une société plus juste aurait pu s’épanouir.
Sur le plan littéraire, les auteurs qui ont imaginé des lieux dans lequel se développent des sociétés idéales sont nombreux, à commencer par Platon dans sa République. On pourrait aussi citer Rabelais avec son abbaye de Thélème mais aussi Voltaire avec Candide ou Sébastien Mercier dans L’an 2440 . Avec le Télémaque de Fénelon, nous avons un genre un peu particulier puisqu’on y décrit des pays existants (l’Orient) pour en vanter les mérites (en partie imaginés et fictifs) afin de mieux faire ressentir les travers de la société française. L’idéal est donc toujours ailleurs. D’où cette dérivation du mot utopie, qui finit par désigner un conte romanesque qui décrit des choses impossibles.
Mais revenons à Thomas More. Manifestement celui-ci connaissait Platon. On peut supposer aussi qu’il a été influencé par les récits des voyageurs qui venaient de découvrir le nouveau monde. Quand vous vivez dons une société qui ne vous satisfait pas, vous allez voir ailleurs et si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous faites preuve d’imagination. N’est-ce pas là le propre de la littérature, inventer des rêves qu’on souhaite réalisables, même si on sait qu’ils sont du domaine de la fiction ? Enfin, comme dans tout le courant de la Renaissance, on retrouve chez More ce besoin de s’intéresser à l’homme (et beaucoup moins à Dieu). Au lieu d’attendre la fin du monde et la parousie pour découvrir un monde meilleur, autant s’atteler à le construire ici-bas.
Pauvre Thomas More, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il avait raison de vouloir fuir le lieu et l’époque où il vivait. Le 6 juillet 1535, il quitte la Tour de Londres où il a été emprisonné pendant quinze mois pour être décapité sur ordre du roi Henri VIII Tudor. (il aurait déclaré au bourreau : «Ayez l'obligeance de me donner la main pour monter, car pour descendre, je me débrouillerai bien tout seul !»)
Quelle faute avait-il donc commise ? Et bien aucune. Disons simplement qu’il avait déplu au prince. Celui-ci voulait rompre son mariage avec Catherine d’Aragon, qui ne lui avait pas donné de successeur mâle (on imagine en passant la douleur de ces femmes, mariées souvent contre leur gré pour des raisons politiques et qui se voyaient ainsi répudiées parce qu’elles ne parvenaient pas à avoir de garçons, alors qu’on sait aujourd’hui que c’est l’époux qui détermine ce genre de chose). Comme le pape tarde à donner son accord pour le divorce et que les choses pressent (la maîtresse, Anne Boleyn est enceinte et pourrait précisément offrir au trône cet héritier qui lui manque), le roi décide de se passer de son avis. L’archevêque de Canterbury déclare donc le premier mariage nul et marie Henri VIII et Anne Boleyn. Aussitôt, la pape, furieux qu’on ait passé outre à ses décisions, excommunie le roi. Celui-ci réplique en rompant avec le Saint Siège. Il reste donc catholique mais considère le pape comme l’évêque de Rome, sans plus. C’est le début du schisme anglican, qui trouve finalement son origine dans une affaire privée, même s’il ne faut pas perdre de vue que c’est l’époque où Luther va commencer, en Allemagne, à s’opposer lui aussi aux excès du catholicisme. Notre pauvre Thomas More refuse de prêter serment entre les mains du chef de l’église anglicane et c’est ce qui lui vaut sa condamnation à mort. Triste fin, on en conviendra pour celui qui rêvait d’un monde meilleur, mais d’un autre côté on se dit que c’est avec une intuition incroyable de son destin qu’il avait auparavant imaginé une société où les hommes vivraient enfin en harmonie.
Cet ailleurs est finalement celui de tous les poètes, c’est un monde perdu ou à venir, un monde parallèle au nôtre et que l’on souhaiterait parfois voir vraiment arriver.

02:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, Thomas More, utopie
05/07/2007
Le mythe du bon sauvage
 Revenons au mythe du bon sauvage, cher à Rousseau. Il faut se rendre compte qu’en développant une telle théorie, le pauvre Jean-Jacques ne s’est pas fait que des amis. C’est qu’à l’époque, l’avenir de l’humanité semblait tout tracé, à savoir que la science et la technique allaient dominer la nature et rendre tout le monde heureux. N’oublions pas que l’ouvrage fondamental du XVIII° siècle, c’est avant tout l’Encyclopédie. Or, si l’Encyclopédie comporte pas mal de sujets philosophiques et si elle a pu faire preuve d’esprit critique à l’encontre du système politique de l’Ancien Régime, elle est d’abord un ouvrage technique, comportant de nombreuses planches et croquis. Cette confiance dans la science débouchera au siècle suivant sur le scientisme (dont le pharmacien Homais, admirablement décrit dans Madame Bovary, offre une caricature désopilante). De leur côté, les Idéologues (avec Destutt de Tracy), voulurent établir une science des idées afin de lutter contre l’obscurantisme ambiant.
Revenons au mythe du bon sauvage, cher à Rousseau. Il faut se rendre compte qu’en développant une telle théorie, le pauvre Jean-Jacques ne s’est pas fait que des amis. C’est qu’à l’époque, l’avenir de l’humanité semblait tout tracé, à savoir que la science et la technique allaient dominer la nature et rendre tout le monde heureux. N’oublions pas que l’ouvrage fondamental du XVIII° siècle, c’est avant tout l’Encyclopédie. Or, si l’Encyclopédie comporte pas mal de sujets philosophiques et si elle a pu faire preuve d’esprit critique à l’encontre du système politique de l’Ancien Régime, elle est d’abord un ouvrage technique, comportant de nombreuses planches et croquis. Cette confiance dans la science débouchera au siècle suivant sur le scientisme (dont le pharmacien Homais, admirablement décrit dans Madame Bovary, offre une caricature désopilante). De leur côté, les Idéologues (avec Destutt de Tracy), voulurent établir une science des idées afin de lutter contre l’obscurantisme ambiant.
 Dès lors, venir vanter les mérites de mère Nature dans un tel contexte avait de quoi déplaire. Quand Rousseau dit qu’il est persécuté et que des complots se trament contre lui, il exagère sans doute, mais il est certain qu’il a dû percevoir de la désapprobation dans le regard de beaucoup de ses contemporains. Cette idée du bon sauvage remonte finalement à la Bible et à la création du paradis telle qu’on peut la lire dans le livre de la Genèse. L’homme et la femme vivaient au milieu de la nature et des animaux sans se soucier de rien, dans un état de bonheur indescriptible et sans devoir travailler. Pendant que d’autres voyaient dans la civilisation le seul moyen de dominer cette nature et donc de distinguer l’homme de l’animal, Rousseau, lui, rapproche l’humain de l’animalité et c’est ce que ses contemporains ne peuvent admettre. Tant qu’on s’en tenait à la version biblique, il n’y avait pas de problème : Dieu ayant créé l’homme à son image, celui-ci se voyait distingué du reste de la création par son essence-même. A partir du moment où cette théorie n’est plus crédible, tout s’effondre et l’homme redevient un animal parmi les autres. C’est bien pour cela que l’Eglise avait déjà fait brûler Giordano Bruno et qu’elle avait obligé Galilée à se rétracter. Dire que la terre tournait autour du soleil, s’était avouer que cette terre n’était plus qu’une planète parmi des millions d’autres, tournant au hasard dans l’espace et qu’elle n’était plus le centre d’univers. Dès lors, l’homme non plus n’était plus le centre du monde. Ramené ipso facto à son animalité, fruit du hasard, il se devait, s’il ne voulait pas perdre la face à ses propres yeux, se distinguer par la culture. D’où l’importance de la science qui va dominer la nature. D’où l’hérésie de Rousseau, qui vient donner une version laïque du mythe de la Genèse. Agir ainsi, pour ses contemporains, c’est faire preuve d’un anachronisme coupable.
Dès lors, venir vanter les mérites de mère Nature dans un tel contexte avait de quoi déplaire. Quand Rousseau dit qu’il est persécuté et que des complots se trament contre lui, il exagère sans doute, mais il est certain qu’il a dû percevoir de la désapprobation dans le regard de beaucoup de ses contemporains. Cette idée du bon sauvage remonte finalement à la Bible et à la création du paradis telle qu’on peut la lire dans le livre de la Genèse. L’homme et la femme vivaient au milieu de la nature et des animaux sans se soucier de rien, dans un état de bonheur indescriptible et sans devoir travailler. Pendant que d’autres voyaient dans la civilisation le seul moyen de dominer cette nature et donc de distinguer l’homme de l’animal, Rousseau, lui, rapproche l’humain de l’animalité et c’est ce que ses contemporains ne peuvent admettre. Tant qu’on s’en tenait à la version biblique, il n’y avait pas de problème : Dieu ayant créé l’homme à son image, celui-ci se voyait distingué du reste de la création par son essence-même. A partir du moment où cette théorie n’est plus crédible, tout s’effondre et l’homme redevient un animal parmi les autres. C’est bien pour cela que l’Eglise avait déjà fait brûler Giordano Bruno et qu’elle avait obligé Galilée à se rétracter. Dire que la terre tournait autour du soleil, s’était avouer que cette terre n’était plus qu’une planète parmi des millions d’autres, tournant au hasard dans l’espace et qu’elle n’était plus le centre d’univers. Dès lors, l’homme non plus n’était plus le centre du monde. Ramené ipso facto à son animalité, fruit du hasard, il se devait, s’il ne voulait pas perdre la face à ses propres yeux, se distinguer par la culture. D’où l’importance de la science qui va dominer la nature. D’où l’hérésie de Rousseau, qui vient donner une version laïque du mythe de la Genèse. Agir ainsi, pour ses contemporains, c’est faire preuve d’un anachronisme coupable.
Remarquons que les théories écologiques modernes ne sont pas si éloignées, finalement, des thèses rousseauistes. Le retour à la nature que nous avons connu dans les années soixante-dix (élever des moutons dans le Larzac, etc.) s’en rapprochait. Conscients de la faillite de la science et de la technique (pollution, déforestation, changement climatique), nous aspirons tous inconsciemment à retrouver un peu de verdure autour de nous ainsi qu’une vie plus simple, plus en harmonie avec la nature. Cette démarche, par ailleurs légitime, semble pourtant se fonder sur une réalité qui appartient déjà au passé et donc au rêve. Pour le moment, aucun retour en arrière ne se dessine très clairement. On commence seulement à prendre conscience qu’il serait temps de faire machine arrière et à réaliser que les réserves de la planète ne sont pas illimitées, pas plus d’ailleurs que sa capacité à se régénérer perpétuellement.
Le nouveau paradoxe, c’est que nous, qui avons contribué gravement à polluer la terre, sommes en train de demander au tiers-monde de limiter son expansion économique sous le prétexte que la planète est en danger. Autrement dit, nous nous tournons vers les contrées qui ne sont pas encore industrialisées ni fortement urbanisées pour leur suggérer de ne pas se développer et de rester finalement proches de ce monde sauvage que nous voudrions préserver pour notre plus grand profit. Le mythe du bon sauvage de Rousseau est donc devenu une réalité. Seul l’homme sauvage peut sauver la planète pour autant qu’il reste sauvage et sous-développé.

14:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, JJ Rousseau, mythe du bon sauvage
04/07/2007
Le mur
Quelques petites citations extraites du Contrat social
«Les esclaves perdent tout dans leurs fers, jusqu'au désir d'en sortir.»
«Les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n’ont rien.»
«Renoncer à sa liberté c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs.»
«Ou le luxe est l'effet des richesses, ou il les rend nécessaires ; il corrompt à la fois le riche et le pauvre, l'un par la possession, l'autre par la convoitise.»
«S'il faut obéir par la force on n'a pas besoin d'obéir par devoir et si l'on n'est plus forcé d'obéir on n'y est plus obligé.»
«L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit maître des autres, qui ne laisse pas d’être plus esclave qu’eux.»
«Souvenez-vous que les murs des villes ne se forment que du débris des maisons des champs. »
A propos de murs, Rousseau n’aurait sans doute jamais imaginé qu’on pût construire un mur dans une ville comme Berlin. La chute de ce mur a été saluée comme elle se devait. Le problème, c’est que depuis on en a construit d’autres, avec un but sensiblement différent. Celui de Berlin voulait empêcher les habitants de l’Est de fuir le régime dictatorial communiste. Celui que l’on érige en ce moment en Palestine ou celui que l’on va ériger entre les Etats-Unis et le Mexique, visent au contraire à protéger ceux qui sont à « l’intérieur ». Il ne s’agit plus d’empêcher de sortir, mais bien d’empêcher d’entrer. Symbole d’une société où l’argent domine tout, ces murs permettent de rester entre soi, entre bourgeois bien pensants, tout en laissant à l’extérieur ceux que l’on ne désire surtout pas voir entrer. Il fut un temps, pourtant, où le Texas appartenait encore au Mexique. Il fut un temps, pourtant, où la Palestine appartenait d’abord aux Palestiniens.

09:42 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, Rousseau
02/07/2007
Rousseau
Le 02 juillet 1778, Jean-Jacques Rousseau s’éteignait. Autodidacte, il côtoiera cependant les plus grands écrivains de son temps, comme Fontenelle, Diderot, Marivaux, Voltaire, Grimm ou encore Rameau. Vivant petitement en composant des morceaux de musique, c’est en vain qu’il proposera à l’Académie un nouveau système de notation musicale. Il faudra attendre qu’il remporte le premier prix d’un concours organisé par l'Académie de Dijon (dont le thème portait sur le fait de savoir si le progrès des arts avait ou non contribué à corrompre et à épurer les mœurs) pour qu’il devienne célèbre. Son opéra Le devin du village est remarqué du public. Mais c’est comme philosophe qu’il va évidemment s’affirmer, donnant au XVIII° siècle un de ses penseurs les plus importants. Il s’opposera à Voltaire sur le raffinement de la société et les excès de la civilisation. Fasciné par l’état de nature, il nous donnera le mythe du « bon sauvage », théorie qui sera reprises par certains, décriée par d’autres. Si c’est la société qui corrompt l’homme, il faut redonner à ce dernier un contrat social digne de ce nom, c’est-à-dire fondé exclusivement sur la souveraineté du peuple. Il fut d’ailleurs sollicité par Pasquale Paoli afin de rédiger un projet de Constitution pour la Corse, alors en opposition avec le pouvoir génois (sur ce sujet, voir le beau blogue d’Angèle Paoli :http://terresdefemmes.blogs.com/mon_weblog/2007/06/pasqua...)
Loin d’être démodées, les idées de Rousseau sont particulièrement d’actualité alors que nous sombrons dans une crise de la démocratie et du système parlementaire (pouvoir absolu des partis politiques, prééminence du gouvernement sur les députés, présence de la haute finance dans les décisions, démantèlement programmés du droit du travail et de la sécurité sociale, etc.)
Sur le plan strictement littéraire, notons encore ses Rêveries du Promeneur solitaire et ses Confessions, qui ouvrent la voie à l’autobiographie en France. :
«Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature; et cet homme ce sera moi (…) Etre éternel, rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables; qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères. Que chacun d'eux découvre à son tour son cœur aux pieds de ton trône avec la même sincérité; et puis qu'un seul te dise, s'il l'ose: "Je fus meilleur que cet homme-là"...».
Tourné vers la sentimentalité, osant afficher ses sentiments, il ouvrira les portes au romantisme.
16:43 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, JJ Rousseau
29/06/2007
Ville à la campagne

De plus en plus de personnes vivent en ville, nous assure-t-on dans la presse. C’est une vérité incontournable, en effet, que ce soit dans notre vieille Europe ou dans des pays émergeants comme le Mexique ou la Chine. Répercutée dans la blogosphère, la nouvelle a débouché sur l’idée que de tels propos ne voulaient pas dire grand chose, la différence entre la ville et la campagne semblant être devenue particulièrement ténue de nos jours. C’est vrai, évidemment. Et pourtant…
Et pourtant il me semble qu’il n’y a pas si longtemps on pouvait encore faire une distinction bien nette entre ces deux mondes. Il y avait d’un côté la ville (avec ses cinémas, ses théâtres, son mode de vie nocturne) et de l’autre la campagne profonde, celle des paysans (avec ses coutumes, sa parcimonie, sa prudence, son bon sens, sa rudesse, etc.). Entre ces deux mondes, régnait une incompréhension totale, doublée d’une grande indifférence. De plus, là où le citadin en vacances regardait avec une condescendance amusée, voisine du mépris, le paysan en train de gratter la terre, ce dernier lui rendait la pareille (non sans une certaine envie devant celui qui avait accès au raffinement, à la culture et aux distractions), considérant avec réserve cet habitant de la ville en tout point semblable à la cigale de la fable.
Donc, quoi qu’en disent certains, il y avait bien deux modes de vie distincts. En ville, par exemple, on pouvait sortir en semaine, aller voir un film et repasser dans un café boire un verre ou déguster une pâtisserie. Une telle attitude aurait été inconcevable à la campagne, où il fallait attendre la fête au village pour manger un morceau de tarte, une ou deux fois par an (tarte par ailleurs cuite à la maison). D’un côté on avait donc l’insouciance et les loisirs, de l’autre la nécessité de travailler une terre au demeurant souvent ingrate. En ville l’argent venait naturellement et régulièrement d’une activité de salarié, à la campagne on n’était jamais sûr de rien, étant à la merci du moindre orage ou de la moindre gelée, ce qui à la longue rend prudent et économe.
Enfant, j’ai côtoyé ces deux mondes, très différents comme je l’ai dit. Les années passant, mon point de vue, inévitablement, est devenu plus citadin et j’ai commencé, moi aussi, à regarder de l’extérieur ce monde paysan. Le rapport à la nature était différent. Alors que les gens de la ville, dans une volonté écologique, voulaient la préserver en l’état où elle se trouvait, les habitants de la campagne, qui étaient lassés de vivre au milieu des champs et des bois, auraient presque souhaité voir une autoroute passer devant leur ferme. On peut les comprendre. Isolés au cœur de l’hiver, ils devaient emprunter de vieilles routes communales défoncées et étroites pour se rendre au magasin le plus proche. Pourquoi leur aurai-je refusé le droit d’avoir eux aussi une route convenable et sûre qui aurait diminué le temps de leurs trajets ? Moi-même, pour venir me ressourcer chez eux, j’avais bien emprunté l’autoroute. Lassés des buildings, rien n’était plus reposant pour moi que le petit village avec son église et son vieil arbre. Mais au nom de la modernité l’arbre a été coupé et la place devant de l’église s’est transformé en une esplanade de macadam. Je l’ai regretté. Ceux du coin, s’en sont félicités. Ce jour-là j’ai bien dû admettre que j’étais devenu un citadin.
Parallèlement à cela, la dépopulation a fait des ravages. Les maisons, vidées de leurs habitants, ont été rachetées par des touristes. Un autre mode de vie s’est alors introduit dans ces contrées reculées (reculées pas tant géographiquement que sociologiquement). Les dimanches, on pouvait voir les cultivateurs travailler dans leurs étables ou dans leurs champs tandis que les touristes se prélassaient dans les premières pelouses (avant il n’y avait jamais eu de pelouses, évidemment). Etant un peu du coin, je n’aurais pas trop osé m’afficher ainsi ostensiblement dans l’inaction. Je préférais donc les grandes marches dans la forêt profonde, ce qui convenait à ma solitude et me permettait par ailleurs de trouver du temps à consacrer à la réflexion (on ne dira jamais assez le côté apaisant que peut procurer une marche en pleine nature et comment nos idées prennent alors une tournure beaucoup plus équilibrée). Puis le temps passant, les touristes ont continué à affluer et les cultivateurs, ayant atteint l’âge de la pension, se sont mis à aménager les abords de leur demeure en les entourant de pelouses. Leurs enfants, devenus facteurs ou professeurs, les ont imités. Les champs à la limite du village sont devenus des terrains à bâtir. Un entrepreneur est venu s’installer, donnant du travail et massacrant le paysage avec ses pelles mécaniques et ses hangars.
Aujourd’hui on peut dire que l’esprit a changé et que la ville est à la campagne. Celle-ci demeure pourtant encore en moi, enfouie dans les souvenirs.

16:29 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (0)
28/06/2007
Ecrire pour survivre
Cherchant à s’exprimer, désirant faire du « neuf », l’écrivain veut avant tout atteindre à l’immortalité. C’est que l’acte d’écrire semble en effet indissociable de cet ancrage temporel dans un futur par ailleurs fort improbable. On écrit pour échapper à la mort et à l’oubli, espérant trouver dans le regard des générations futures (regard qu’on n’aura pourtant jamais l’occasion de croiser) une justification de sa vie d’aujourd’hui. Démarche illusoire s’il en est, car combien, en fait, parviendront à produire une œuvre assez importante pour marquer les générations futures ? Combien de Cervantès, de Rabelais, de Molière notre siècle comptera-t-il ? Très peu, sans doute. Encore faut-il se rendre compte que parmi les écrivains du passé qui ont eu la chance d’arriver jusqu’à nous, beaucoup sont appréciés pour des raisons différentes de celles qui avaient justifié leur succès auprès de leurs contemporains. Ainsi en va-t-il de Voltaire, qui se croyait un grand dramaturge. S’il est connu aujourd’hui, ce n’est certes pas en tant que dramaturge, mais plutôt par le rôle éminent qu’il a joué comme contestataire de l’Ancien Régime. De plus, si on prend son œuvre littéraire proprement dite, ce sont assurément ses contes qui nous enchantent le plus, situation qui le surprendrait probablement beaucoup. De son côté, Rabelais était avant tout un grand médecin et les aventures de Gargantua qu’il nous a laissées devaient sans doute relever pour lui du simple délassement. Théophile Gautier, quant à lui, s’est sans doute cru un poète de génie avec ses Emaux et Camées (voir sa théorie de l’art pour l’art : « C’est encore plus beau quand c’est inutile »), mais nous sommes plutôt sensibles aujourd’hui à ses écrits fantastiques.
Inversement, beaucoup de ceux qui ont eu du succès de leur vivant et qu’on croyait précisément immortels ne sont pas passés à la postérité. Il n’y a qu’à feuilleter la liste des membres de l’Académie pour ce rendre compte que bien des noms nous sont inconnus. D’autres, tels Lamartine, se sont imposés par le biais des anthologies scolaires, mais honnêtement, qui lit encore Lamartine aujourd’hui ?
Notons que cette recherche systématique de l’immortalité comme justification de l’acte d’écrire semble être liée au rôle primordial joué par l’individu dans notre civilisation contemporaine. Dans des sociétés plus primitives, telles notre Moyen-Age occidental (j’ai dit plus primitives, pas moins complexes), on voit que les chansons de geste sont anonymes. Les poèmes épiques sont faits pour être transmis oralement et chaque récitant y va de sa version personnelle. Les manuscrits que nous avons conservés ne sont finalement que de vastes compilations de chants préexistants, une magnifique synthèse, en quelque sorte, superbement rédigée. Celui qui l’a faite n’a pas trouvé utile d’y apposer son nom, tout simplement parce que seuls les exploits racontés avaient de l’importance et non la personnalité de l’écrivain. Il en a été de même dans la Grèce antique (certes on cite Homère comme auteur possible de l’Iliade et de l’Odyssée, mais que sait-on de lui, finalement ?), dans la civilisation nordique (Eddas) ou encore en Inde avec le Rig-Veda. C’est plus tard, quand le rôle du « clan » a été moins déterminant, que l’individu a pu s’affirmer pleinement, au point de vouloir s’imposer par son oeuvre personnelle. Dans cette optique, rien de plus logique que de vouloir écrire quelque chose d’inédit. Au lieu de perpétuer une tradition et d’imiter les anciens, il faut faire du neuf et de l’original, en exprimant sa propre spécificité.

16:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Littérature
26/06/2007
Apologie de l’antique
C’est devenu un fait évident et que plus personne ne conteste : en art, il faut faire du neuf. En littérature aussi, apparemment. A quoi bon, en effet, réécrire ce que d’autres ont déjà mieux exprimé que vous ? Inutile de donner une nouvelle Madame Bovary, que tout le monde connaît déjà, on en conviendra. On ne va pas non plus proposer une version personnelle d’Une saison en enfer ni imiter Philippe Jaccottet. Non, il n’y a que ce qui n’a jamais été dit qui peut être exprimé. Fiers de leur ego, les littérateurs s’en donnent donc à cœur joie. Chacun y va de sa rengaine propre, de ses souvenirs personnels ou de sa vision du monde forcément originale puisque c’est la sienne propre.
Tout cela est bien beau, sauf que cela nous donne sept cents romans à la rentrée d’automne, sept cents romans qui se ressemblent à peu près tous, tous les auteurs ayant misé sur la même modernité.
Pourtant, si on conçoit facilement qu’il ne sert à rien de réécrire les chefs-d’œuvre antérieurs, s’il semble évident que seule une vision personnelle et originale mérite d’être mise en avant, il n’en reste pas moins que cette course à la modernité comporte quelques dangers, parmi lesquels le refus des grands classiques n’est pas le moindre. A force de vouloir être modernes et résolument tournés vers l’avenir certains en ont oublié de regarder derrière eux. Privés du terreau originel, ils n’ont plus d’assises et leurs écrits semblent s’étioler comme des plantes poussant sur un sol caillouteux. Négligeant la richesses inouïe de leurs devanciers, ils préfèrent puiser en eux la source de l’inspiration, ce qui nous donne souvent des œuvres introspectives, tournées vers le dedans, où le nombril de l’auteur semble être devenu le centre du monde. Ces écrits-là manquent de souffle et sentent la philosophie en chambre. Seules les œuvres ouvertes sur le monde, reflétant la complexité de la société, cherchant à donner à l’individu une place dans l’univers, méritent en fait d’être publiées.
Or, s’il y a bien des livres qui ont fait leurs preuves, ce sont bien ceux du passé. S’ils sont parvenus jusqu’à nous et s’ils nous parlent toujours, c’est qu’ils possèdent en eux-mêmes un « je ne sais quoi » qu’on ne peut certes pas assimiler à un phénomène de mode. Et parmi ces livres anciens, il me semble que ceux de l’Antiquité sont particulièrement méconnus. Qui lit encore Virgile, Plaute ou Sénèque ? Sans parler des historiens comme Tite-Live, Tacite et quelques autres ? Les Humanités classiques ont quasi disparu de nos collèges et lycées. Il est vrai que dans notre société mercantile, mieux vaut un bon diplôme en « marketing » qui vous permettra non seulement de trouver un emploi mais aussi de vendre à un tas de gens (et pour votre plus grand profit) des produits dont ils ignoraient jusqu’à l’existence avant votre intervention, mieux vaut un tel diplôme, disais-je, plutôt que d’écouter le chant des sirènes avec Ulysse ou de vous pâmer sur les amours de Didon.
Et pourtant… Et pourtant, je plaiderai toujours, avec Jacqueline de Romilly, pour les études classiques, qui ouvrent des portes insoupçonnées. Outre la rigueur de l’analyse grammaticale (ah ! ces aoristes et ces verbes en « Mi » de la conjugaison grecque !), elles permettaient de se familiariser avec de grands textes littéraires à un âge où l’esprit était encore suffisamment malléable pour pouvoir en être imprégné. Les élèves parcouraient en imagination les plaines d’Asie mineure en suivant avec Xénophon la retraite des dix mille, ils s’initiaient à la démocratie en lisant les discours de Démosthène ou découvraient les horreurs du pouvoir en méditant sur les descriptions que Tacite nous donne de Néron.
Mais qui se souvient encore de tout cela aujourd’hui ? Quelques-uns, qui disparaissent les uns après les autres. N’ayant pas été initiés, les jeunes d’aujourd’hui ne se donneront même pas la peine d’ouvrir une traduction, tant il est vrai que pour eux tout ce qui précède le XIX° siècle leur semble inabordable et complètement révolu. Et je parle de ceux qui lisent, bien entendu, c’est-à-dire finalement d’une minorité, tant les jeux vidéo et autres joyeusetés ont supplanté l’écrit. Parlant de la sorte, je me fais l’effet de tenir le discours d’un vieillard décati, plein d’amertume et de rancune. Et pourtant ma propre jeunesse ne remonte pas encore si loin, même si elle commence, il est vrai, à prendre le large dangereusement. « Ύνωθι σεαύτον », nous disait Socrate. Connais-toi toi-même. Connais les autres, aussi, avec qui tu as la chance de vivre. Et cette connaissance, à mon sens, doit passer par les auteurs classiques, qui l’emportent, et de loin, sur certains de nos auteurs contemporains. Quant à tous ceux qui demanderaient quelle est l’utilité de se frotter ainsi aux textes antiques et quel profit ils pourraient bien retirer de l’apprentissage du latin, je répondrais, comme un certain professeur : « Cela sert à ce que vous ne me posiez plus la question. »

09:01 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Littérature, Antiquité
25/06/2007
Paysage (4)

Qui dira jamais ce qui nous fascine devant le spectacle époustouflant de la marée haute ? Cette masse liquide qui, inlassablement, monte à l’assaut des terres devrait nous inquiéter, voire nous révulser, pourtant il n’en est rien. Plus l’eau gagne du terrain et plus notre enthousiasme grandit. C’est contre nous, pourtant, que l’océan lance ses assauts, contre le monde de la terre ferme, dont nous faisons partie. Elément hostile par excellence, la masse des eaux tente d’envahir notre univers. Nous devrions être au désespoir et c’est l’inverse qui se produit. Chaque vague qui dépasse la précédente suscite notre admiration. Nous laissant prendre au jeu, nous prenons parti pour la mer. Si en plus, à cette marée haute, vient s’ajouter la tempête, notre excitation est à son comble. La grande houle profonde, venue du fond, qui vient se briser en gerbes éclatantes contre les rochers semble éveiller en nous une sorte de vengeance. Ce combat des vagues est un peu le nôtre. Il semble correspondre à notre désir d’aller toujours plus haut, toujours plus loin. Brisés quelque part par la vie, qui ne nous a pas permis de réaliser nos rêves (ou de ne les réaliser que partiellement), condamnés à mener une existence ordinaire, il nous semble voir dans cette force de l’océan l’ultime possibilité d’accéder à la démesure. Ces vagues qui déferlent contre les falaises, dans un fracas d’enfer, deviennent un peu nous-mêmes, par procuration. Comme elles, nous souhaiterions anéantir tout ce qui s’oppose à notre extension et imposer enfin notre loi, dans le tumulte de la victoire.
Remarquons qu’une marée basse, même si l’eau est agitée, ne procure jamais le même sentiment de plénitude. Ici, on sent la mer vaincue, qui se retire inexorablement, malgré quelques grognements sauvages qui n’en imposent plus à personne. Non, il n’y a que la marée haute, surtout si elle est renforcée par une tempête, pour éveiller en nous ce sentiment de destin à accomplir, de lutte à mener, de victoire à remporter enfin. La mer transgresse les interdits, elle a toutes les audaces, elle entreprend tout ce que nous n’aurions même pas osé imaginer. Elle est nous-même dans sa violence bestiale, pure et belle dans sa lutte acharnée, merveilleuse dans son désir d’accomplissement.

J’ai connu ainsi, enfant, des soirées remarquables, dans la Bretagne du Nord. Juillet, là-bas, prend parfois des airs d’automne, surtout quand la lune est pleine et que la mer vient s’écraser contre les falaises avec une obstination inimaginable. Dans la pénombre, l’écume blanche jaillissait en grandes gerbes contre les rochers, avant de se retirer, emportant avec elle des milliers de galets dans un roulement de fin du monde. Ce bruit des galets, laissant deviner la puissance de la force qui les entraînait, m’a toujours semblé être celui de la création du monde. Qui pourrait résister à cette masse océane capable de déplacer ainsi en une seconde des milliers de pierres, les roulant dans tous les sens, les réduisant aux éléments d’un jeu dont elle seule a inventé les règles ? Eclaboussé parfois par les gerbes d’eau, tout couvert d’embruns, l’enfant de dix ans que j’étais regardait avec respect la nature à l’œuvre, en train de s’inventer de nouveaux mondes.
Dans l’univers littéraire, l’océan, on s’en doute, a inspiré les poètes, depuis le vieil Homère, et sa « mer aux flots tumultueux », jusqu’à Valéry (« La mer, la mer, toujours recommencée »), en passant par les poésies d’Ossian, sans oublier, bien entendu, Léo Ferré :
« La marée je l'ai dans le cœur
Qui me remonte comme un signe
Je meurs de ma petite sœur
De mon enfant et de mon cygne
(…)
Je me souviens des soirs là-bas
Et des sprints gagnés sur l'écume
Cette bave des chevaux ras
Au ras des rocs qui se consument
Ô l'ange des plaisirs perdus
Ô rumeurs d'une autre habitude
Mes désirs dès lors ne sont plus
Qu'un chagrin de ma solitude »
La mémoire et la mer
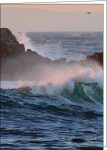
15:47 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (0)
22/06/2007
Art roman
On ne dira jamais assez de bien de la collection Zodiaque. Celle-ci a été créée par « l’abbaye de la Pierre qui vire », qui éditait et imprimait elle-même les volumes, perpétrant ainsi la tradition monastique de l’Occident médiéval.
http://www.abbaye-pierrequivire.asso.fr/
La collection zodiaque s’est rendue célèbre par ses ouvrages sur l’art roman en Europe, réalisés à la fois par les moines de l’abbaye et des universitaires de renom.
http://www.romanes.com/biblio/zodiaque_fr.html
J’ai été particulièrement impressionné autrefois lorsque j’ai lu le livre France romane, rédigé par Raymond Oursel.

D’abord, tout lecteur, même profane, ne peut qu’être admiratif devant la qualité des photographies proposées, certaines en couleur, d’autres en noir et blanc.
Ensuite, jamais comme dans ce livre je n’ai ressenti l’impression d’insécurité permanente qui devait être celle de nos ancêtres confrontés aux invasions barbares. Bien sûr, de par l’école, nous connaissons tous les Wisigoths et autres Ostrogoths, sans parler des Huns et du célèbre Attila (lequel, soit dit en passant, fut vaincu un 20 juin 451 aux Champs catalauniques, près de Troyes), mais il faut lire le texte d’Oursel pour comprendre de l’intérieur et comme si nous y étions, ce que représentait l’arrivée d’un bateau normand ou viking dans un village du Moyen-Age. Il en va de même pour le massif des Maures, si bien nommé. Si aujourd’hui ce terme évoque des vacances le long de la Méditerranée, il ne faut pas oublier que pendant des siècles ce massif a abrité des pirates mauresques, lesquels enlevaient tous les imprudents qui s’aventuraient seuls sur une plage ou dans la montagne. Ces malheureux finissaient souvent leurs jours comme esclaves dans un Orient qui, pour eux, n’avait rien de commun avec les Mille et une nuits.
Enfin, ce qu’il y a de plus remarquable dans le livre d’Oursel, c’est la manière dont il fait parler les pierres de nos vieilles églises romanes. Je dois dire que j’ai un faible pour cette architecture primitive et que je ne manque jamais d’aller en visiter une si d’aventure ma route m’amène à proximité. Derrière le mystère qui émane naturellement de ces vieilles pierres (doublé de la méditation qui s’empare de nous quand nous réfléchissons sur ces hommes qui nous ont précédés et qui ont construit ces merveilles), j’avais surtout été sensible, jusque là, à l’aspect esthétique de ces églises. Dans leur simplicité et parfois même leur naïveté, elles ont en effet quelque chose d’attachant qui parle au cœur. Mais Oursel a su me les faire voir avec les yeux des religieux qui les ont fait construire. Mon regard esthétisant s’est doublé d’un regard quasi mystique. Certes telle ogive peut être belle en elle-même, par ses courbes ou la couleur de la pierre qui la compose, mais au-delà de cet aspect purement matériel, il a su montrer ce qu’elles veulent dire, les faisant parler et libérant ainsi l’esprit qui a présidé à leur érection. Devenues poèmes de pierres, elles révèlent, dans leur majesté architecturale, l’aspiration de l’homme du Moyen-Age à dire le sacré.
Ce sacré, c’est sans doute ce à quoi aspirent les moines de l’abbaye de la Pierre qui vire. Sur le site donné en lien plus haut, on peut lire qu’ils se consacrent au travail pour subvenir à leurs besoins, mais qu’ils en limitent la durée à cinq heures par jours pour pouvoir s’adonner à leurs activités religieuses, ce qui est bien la moindre des choses de la part de religieux. Etrangement, du fond de mon athéisme (fût-il mystique), je les rejoins pleinement. Le travail devrait permettre à l’homme de survivre et ne devrait jamais devenir une fin en soi. Il faut du temps libre pour se consacrer à la pensée, à la recherche intérieure, à l’art, à la littérature. Si les hommes préhistoriques avaient dû passer toutes leurs journées à poursuivre le gibier, ils n’auraient jamais peint les murs de Lascaux ou la grotte de Gargas, si chère à Dominique Autié.
http://blog-dominique.autie.intexte.net/blogs/index.php/all?cat=47
A une époque où la compétitivité économique est à l’ordre du jour, dans une société marchande où seule l’acquisition de la richesse semble donner du prestige, il est peut-être bon, parfois, de prendre du recul et, tels les bâtisseurs des églises romanes, tenter de jeter un autre regard sur le monde, un regard plein d’admiration sur ce qui nous entoure. Car c’est à n’en pas douter l’harmonie qu’avaient trouvée ces moines du Moyens-Age. A une époque où la mort était partout et la vie ô combien fragile, ils étaient parvenus par leurs chants et leurs constructions, à dire la beauté de l’univers dont ils faisaient eux-mêmes partie.
Pour terminer, je voudrais reproduire ici le petit texte qui explique pourquoi c’est le nom « Zodiaque » qui a été donné à la collection des livres de l’abbaye de la Pierre qui vire :
…(P)arler de zodiaque, c'était parler du temps : du temps naturel, de celui que mesure le mouvement des planètes dans la sphère céleste. Cette question de temps nous paraissait l'une des plus cruciales de l'époque. L'accélération constante du progrès nous semblait un risque majeur. "En prônant le zodiaque, disions-nous, nous réclamons le retour à une vraie notion de temps basée sur les lois de la nature : à une vie normale, inscrite dans le déroulement, voulu par Dieu, du monde des choses." Nous pensions bien laisser entendre que l'art ne nous intéressait que dans la mesure où il débouchait sur l'humaine aventure, la révélant mieux que tout autre indice, l'engageant aussi. "On n'atteint la beauté que dans l'amour, et l'amour exige le temps et la liberté.
Un beau texte à méditer...

16:40 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : art roman, éditions zodiaque
21/06/2007
Quand le vin monte à la tête.
Avec deux jours de retard, il conviendrait de se souvenir du centenaire des incidents de Béziers. Il faut savoir que l’Aude, le Gard, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales survivaient au début du XX° siècle grâce à leur production viticole. Ils alimentaient toute la France en vin bon marché, boisson jugée antiseptique par Pasteur et finalement préférable à une eau peu potable. Après la crise du phylloxéra (1865), les viticulteurs, courageusement, reconstituent leur vignoble avec des ceps algériens. Dans les années 1900, la production devient excédentaire, d’autant plus qu’elle commence à être concurrencée par les vins espagnols, italiens et surtout algériens. Comme la Rome antique, la France devient donc la victime de sa principale colonie, laquelle parvient à vendre à des prix plus intéressants. Pourquoi ? Et bien simplement parce que dans ces vins étrangers, on ajoute du sucre pour élever le taux d’alcool et que le gouvernement français en a accepté le principe. Comme il fallait s’y attendre, avec cette surproduction, les prix chutent d’une manière vertigineuse et beaucoup de paysans français sont ruinés. Les Languedociens se mobilisent donc pour réclamer l'abrogation de la loi de 1903 qui autorisait l’ajout de sucre, mais Clemenceau refuse. On s’organise et un mouvement de contestation prend naissance avec à sa tête un certain Marcelin Albert. 150.000 personnes viennent l’écouter le 12 mai 1907 à Béziers. Il menace le gouvernement de faire la grève de l’impôt si aucun geste n’est fait avant le 10 juin. A la veille de cette date, le 09 juin, Montpellier rassemble 600.000 manifestants. De son côté, Clemenceau envoie 27 régiments (issus de régions éloignées afin d’éviter que les troupes ne prennent parti pour les vignerons), soit 25.000 hommes de troupe et 8.000 cavaliers.
Comme il fallait s’y attendre, la situation dégénère et le 19 juin, à Narbonne, les soldats tirent sur la foule, faisant deux morts. Le lendemain, c’est cinq morts qu’il faut déplorer. À Agde, 600 soldats du 17e régiment d'infanterie (bizarrement tous issus de la région, Clemenceau n’ayant sans doute pas été assez vigilant) se révoltent. Ils gagnent Béziers où ils sont acclamés par la foule. Pourtant, le 21 juin, Clemenceau peut annoncer à la Chambre que les mutins sont rentrés dans le rang. Ils seront expédiés au fin fond de la Tunisie. Plus tard, le même Clemenceau veillera à ce que ce régiment soit toujours en première ligne en 1914, dans l’Est de la France.
Dans le Languedoc, les principaux meneurs sont arrêtés. Marcelin Albert parvient à s’échapper. Il se rend à Paris où il rencontre Clemenceau. Celui-ci, autoritaire, lui fait la morale avant de lui remettre un billet de 100 francs pour le train du retour. Le pauvre Marcelin accepte, tout en promettant de rembourser le prix du billet. Discrédité auprès des siens, qui s’estiment trahis à juste titre, il devra s’exiler en Algérie et finira ses jours dans la misère. De son côté, le gouvernement établit une surtaxe sur le sucre et réglemente sévèrement le négoce du vin, donnant ainsi raison aux manifestants.
Au-delà du geste de « ces braves soldats du 17° », on retiendra le choc qu’a constitué pour la production locale languedocienne la venue des vins étrangers. Prémices à l’actuelle mondialisation du commerce, les incidents de Béziers symbolisent la confrontation entre un mode de production ancestral (la culture de la vigne remonte à l’époque romaine dans ces régions) et les premiers produits « industriels ». Un problème bien d’actualité, finalement. Il n’est pas étonnant qu’on n’en ait pas beaucoup parlé.

15:12 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Histoire, Béziers
20/06/2007
De l'usage d'Internet.
On connaît la difficulté qu’il y a à lire des textes longs à l’écran. Pourtant, certains journaux sont parfois écrits en petits caractères et les textes qu’ils nous proposent défilent souvent en longues colonnes parallèles. On conviendra que ce n’est pas très reposant pour le regard et pourtant nous lisons tous ces articles. Le confort de l’œil ne serait donc pas seul en cause dans notre refus de rester de longues minutes devant notre écran. La souris qui est à notre disposition en permanence pourrait bien être la responsable. Elle est en effet un incitateur à aller cliquer sur tous les liens qui se trouvent généralement à gauche et à droite de toute page Internet qui se respecte. Distraits dans notre lecture (ce que nous ne sommes pas quand nous lisons un journal puisque nous le tenons en main), nous ne résisterions pas à l’envie de saisir la souris, dans une sorte de geste mécanique machinal. Ensuite, l’esprit, qui est avide de découverte, nous pousserait inconsciemment à aller cliquer sur tous les liens mis à notre disposition, abrégeant du coup la lecture commencée. Celle-ci nous apparaît subitement rébarbative et nous passons à autre chose.
Il faut d’ailleurs souligner le danger qu’il y a à « surfer » ainsi, faisant défiler les écrans les uns après les autres sans rien approfondir, dans une recherche aussi vaine que désespérée. Outre le fait que dans une telle démarche nous n’avons généralement rien retenu des articles entrevus, quand nous quittons notre ordinateur c’est souvent un sentiment d’impuissance qui s’est emparé de nous. Impuissance devant l’impossibilité qu’il y a à lire le contenu des dizaines de sites entrevus. Il est loin le temps de la Renaissance où l’homme s’imaginait encore pouvoir acquérir tous les savoirs. Relégués dans une branche, notre spécialité se réduit habituellement à presque rien. Et pourtant, ce presque rien est encore de trop pour nous puisque nous n’arrivons même pas à prendre connaissance de la millième partie.
D’un autre côté, pour nous rassurer et ne pas finir sur une note trop pessimiste, il faut se dire qu’on trouve de tout sur Internet, le meilleur et le pire. Notre incapacité physique à tout ingurgiter est sans doute un bienfait de la nature, qui nous évite ainsi de nous abrutir sur des sites remplis d’erreurs ou peu dignes d’intérêts.

15:50 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Internet, lecture à l'écran
14/06/2007
Grandes surfaces du livre
Lors de ma dernière visite à la FNAC, j’ai été surpris, une fois de plus, par la place occupée par la littérature, laquelle semble se réduire à chaque fois comme une peau de chagrin. J’en suis arrivé au point où j’aurai bientôt peur de mettre un pied dans ce magasin, tant j’en ressors à chaque fois déconfit et désespéré.
Il n’y avait pourtant pas si longtemps que les spécialistes en rayonnages et les diplômés en marketing avaient complètement restructuré l’ensemble. Dans la bataille, on avait déjà perdu pas mal de mètres de rayonnages, sans compter que les parties biographie, critique et poésie s’étaient retrouvées décalées par rapport à l’ensemble de la production littéraire, reléguées qu’elles étaient dans une allée à grand passage.
L’autre jour, donc, qu’elle ne fut pas ma surprise de constater que ce rayon poésie avait complètement disparu. En cherchant bien, j’ai retrouvé, coincé entre les nouvelles sorties romanesques et la rubrique théâtre (comprenez : les pièces de théâtre qu’on fait lire aux lycéens), un présentoir qui offrait royalement dix titres de poètes contemporains. Pour le reste, rien. N’en croyant pas mes yeux, j’ai poursuivi mes investigations au milieu de la foule toujours abondante durant la pause de midi Finalement, c’est pour ainsi dire à quatre pattes que j’ai fini par découvrir la collection de poche Poésie Gallimard, laquelle devait se limiter à une bonne soixantaine de titres (parmi les plus célèbres, bien entendu). En dehors de cette collection de poche, que j’aime bien par ailleurs, le vide absolu. Encore faut-il parvenir à la découvrir au ras du sol, tout en se faufilant entre les jambes des jeunes clientes qui viennent en ces lieux passer un moment au sec en ce printemps pluvieux (opération périlleuse par ailleurs et qui vous distrait vite de votre investigation première).
Donc, des poètes qui sortent un peu de l’ordinaire, disais-je, vous n’en trouverez pas ou fort peu. Et quand je dis qui « sortent de l’ordinaire », je ne demande rien d’extraordinaire, bien entendu…
Tout ceci nous amène à un autre débat, celui des librairies de qualité, lesquelles me semblent se faire de plus en plus rares. Elles disparaissent les unes après les autres, nous laissant la nostalgie de temps révolus qui pourtant ne sont pas encore si lointains. Est-ce cela, vieillir ? Commencer à regretter un monde qui meurt et se réfugier dans les souvenirs ? Ou bien est-ce l’époque elle-même qui devient boutiquière au point de ne plus proposer que ce qui se vend bien ? Un peu les deux, sans doute.
Demain, peut-être, on ira à la FNAC pour faire ses emplettes. Entre les plats surgelés et les boîtes de Coca on pourra peut-être encore découvrir le dernier Goncourt. Un livre écrit sur commande et signé par une célébrité ? A moins que vous ne préféreriez un CD reprenant les meilleurs discours de Sarkozy ?
En attendant j’achète et je stocke chez moi des livres pour les années à venir. On n’est jamais assez prudent.
19:38 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature, Fnac
08/06/2007
De la consécration littéraire
Dans ses Carnets du grand chemin, déjà cités, Julien Gracq fait remarquer que la seule consécration littéraire qui ait quelque valeur à ses yeux, doit être le fait d’un écrivain réputé. Les critiques comme les lecteurs avisés ne le convainquent pas. Pourtant il reconnaît que les propos tenus par ceux-ci comme par ceux-là sont souvent profonds et non dénués d’intérêt. Mais il n’y a rien à faire, rien ne vaut l’approbation et l’encouragement d’une sommité littéraire.
On sait que son Château d’Argol avait reçu les éloges de Breton avant même sa publication. Pour le jeune Gracq, le fait d’être ainsi reconnu par une personnalité aussi importante, qui faisait figure de « pape » des lettres, constituait une sorte de laissez-passer qui l’autorisait à entreprendre une carrière littéraire.
Il regrette d’ailleurs dans les Carnets (soit en 1986) qu’il n’y ait plus personne dont l’opinion lui importe encore. Breton, Malraux, Gide et Valéry s’en sont allés depuis longtemps. Les quelques écrivaillons contemporains le laissent indifférent, concentrés qu’ils sont sur leurs propres sillons. Quant aux critiques et aux lecteurs, leurs éloges ne font pas autorité pour l’assurer de la valeur de sa production récente. Il compare en fait cette reconnaissance par des gens du métier qui ont fait leur preuve à une sorte d’adoubement moyenâgeux. Tels les Compagnons, qui devaient produire une pièce maîtresse et recevoir l’avis positif des maîtres de la corporation, il estime qu’il n’y a que les vieux routiers de l’écriture, ceux qui ont vécu le fait littéraire de l’intérieur, qui peuvent avoir un avis pertinent.
Tout ceci est évidemment un peu frustrant pour les lecteurs et les critiques que nous sommes tous un petit peu. Quelque part, cependant, il doit avoir raison. Il faut avoir écrit soi-même une œuvre pour mieux cerner la difficulté qu’il y a à en agencer tous les rouages. D’un autre côté, il me semble que cette recherche systématique d’approbation de la part d’un aîné (ce qui est difficile à trouver quand on a plus de quatre-vingt-dix ans) repose davantage sur la réputation de ce donneur d’avis que sur sa capacité réelle à juger de l’œuvre d’autrui. De plus, n’y a-t-il pas là une attitude quelque peu puérile de vouloir à tout prix être reconnu par ses aînés ? Rimbaud attendait-il les éloges du Parnasse pour écrire Une Saison en enfer ? Il est vrai qu’il eut les encouragements chaleureux de Verlaine, ce qui n’était pas rien.
00:42 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Littérature, Gracq, critique littéraire
06/06/2007
Littérature et peinture
Si on s’interroge sur les différences qui existent entre un écrivain et un peintre, on en trouvera plusieurs.
D’abord, le peintre, s’il est artiste, est avant tout un artisan. Il lui faut savoir manier le pinceau avec une certaine dextérité, ce qui est la condition première à la réalisation de tout tableau de qualité, on en conviendra. Quelque part le peintre est donc un « manuel ». L’écrivain, lui, n’a besoin d’aucune disposition particulière, si ce n’est d’avoir appris à écrire à six ans et de savoir utiliser le clavier et la souris de son ordinateur. S’il n’est vraiment pas doué, un simple stylo fera l’affaire.
Ensuite, le peintre (qui ne peut, comme un romancier, décrire le paysage et les personnages avant de raconter finalement une histoire, laquelle comporte habituellement de nombreux rebondissements) doit choisir un moment « in medias res » pour illustrer au mieux l’action représentée. Si on reprend le célèbre tableau « Le radeau de la Méduse » de Géricault, on se rend compte que la scène choisie se trouve à la fin du drame. Par le radeau on comprend qu’il y a eu un naufrage et par l’air hagard des personnages, on devine que leur calvaire dure depuis plusieurs jours. Les gestes désespérés qu’ils font en direction de l’horizon indiquent qu’un bateau vient d’apparaître mais que celui-ci ne les voit pas, ce qui les renvoie à leur désespoir et à leur sauvagerie. Un romancier, lui, aurait d’abord raconté pourquoi tel personnage avait décidé de prendre le bateau, aurait décrit l’embarquement, aurait imaginé une histoire à bord (intrigue entre les soldats par exemple), nous aurait fait frémir sur le naufrage proprement dit avant de nous angoisser davantage encore en décrivant la situation de plus en plus scabreuse de tous ces hommes. Les rapports psychologiques entre les survivants auraient été analysés méticuleusement, avant d’arriver aux scènes d’horreur de cannibalisme. Enfin, quand un bateau serait apparu à l’horizon, il nous aurait fait vibrer d’espoir avant de nous replonger, avec les naufragés, dans l’abandon le plus absolu. Bref, tout cela, qui aurait pu compter quatre cents pages bien serrées, Géricault, parce qu’il est peintre, nous le révèle en un instant, dans une scène statique qui résume le tout. Il existe donc en peinture une économie de moyens qui oppose cet art à la littérature, laquelle demande finalement un esprit analytique.
Enfin, il existe encore une autre différence entre le peintre et le romancier. Elle est de taille et pourtant on ne l’envisage pratiquement jamais. C’est ce qu’il advient de leur production respective. Ainsi un tableau, à la différence d’un livre, se caractérise par son unicité. Il peut être endommagé ou détruit, ce qui ne doit pas manquer d’angoisser l’artiste. Une fois vendu, il disparaît à jamais et physiquement de son univers. A peine s’il parvient à se souvenir de la technique qu’il a employée ou des effets de couleurs qu’il est parvenu à rendre. En cas de doute, il lui sera bien difficile de procéder à des vérifications si le tableau a été acquis par un particulier. D’ailleurs ce particulier unique, qui est-il ? Mystère. Pourquoi a-t-il acheté précisément ce tableau-là ? Le peintre ne le saura jamais. L’auteur de littérature, lui, peut à loisir contempler ses œuvres sur les rayonnages des librairies ou des bibliothèques (y compris dans la sienne propre). Son livre, par la magie de l’imprimerie, s’est multiplié à des milliers d’exemplaires, ce qui lui assure une certaine pérennité. Veut-il en relire un passage qu’il n’y a rien de plus facile, il n’a qu’à tendre le bras.
Pourtant, d’un autre côté, l’œuvre écrite et éditée lui échappe autant que la toile du peintre. Elle n’est plus vraiment sienne. Dans son travail d’écriture, il en avait amélioré la forme et le fond à plusieurs reprises avant de se décider d’arrêter à un certain moment cette recherche de perfection. Imprimé, le livre devient immuable, « tel qu’en lui-même, l’éternité le change». S’il le relit, l’auteur pourra le trouver imparfait. Il souhaitera peut-être le modifier, faire des retouches, améliorer certains passages. Trop tard, le livre appartient désormais aux lecteurs, qui pourront lui reprocher de l’avoir laissé en cet état d’imperfection alors que déjà lui-même pense le récrire autrement. Jamais fini, imparfait à ses yeux, il doit bien pourtant le laisser vivre sa propre vie. Si par hasard, à l’occasion d’une seconde édition, il décide d’y apporter des corrections importantes, il écrit en fait une nouvelle œuvre.
Le livre écrit, bon ou mauvais, reste donc physiquement dans l’entourage de l’écrivain, à la différence d’une toile. Ecrivain qui ne pourra pas faire comme s’il ne l’avait jamais écrit. Quelque part, cette « présence » des livres (en tant qu’objets, mais aussi en tant que symboles occupant un espace dans l’imaginaire personnel de l’auteur) définissent l’écrivain. Jamais il ne pourra plus être comme s’il ne les avait pas écrits.

00:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Littérature
01/06/2007
L'académicien immortel
Max Gallo a été élu à l’Académie française. Il est vrai qu’il y a beaucoup de fauteuils vides, en ce moment, parmi les immortels. Les places de Bertrand Poirot-Delpech, Jean-François Deniau, Henri Troyat, Pierre Moinot et René Rémond sont d’ailleurs encore à vendre.
Max Gallo, manifestement, est un homme qui se lève tôt, car il a écrit une centaine de livres (romans, biographies et études historiques). Voilà qui ne devait pas déplaire à Monsieur Sarkozy. Né en 1932 dans une famille d’immigrés italiens, il incarne donc à suffisance les « bons étrangers » parfaitement intégrés qui ont su se faire une place à la force du poignet. D’historien, il s’est transformé en romancier, et nous a donné des biographies historiques à succès. Rien de tel pour se faire connaître du grand public. De plus ces biographies ont un accent franco-français, ce qui est encore mieux (Napoléon, De Gaulle, etc.).
Bien sûr, nul n’étant parfait, il avait commencé comme militant communiste, mais qui s’en souvient encore ? Porte-parole du gouvernement socialiste au début des années quatre-vingts, il avait rallié récemment les troupes du petit Nicolas. Le hasard fait bien les choses.

16:41 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, Académie française, Max Gallo
Vocabulaire
N’allez pas confondre une Nigériane avec une Nigérienne, les mots ayant leur importance Mais encore faudrait-il que vous sachiez où se trouvent ces deux pays et lequel se situe au Nord-Est de l’autre… Hé hé !
Comme il ne faut pas confondre un Hindou avec un Indien. Tous les Indiens ne sont pas hindous, mais est-ce qu’il y a des Hindous qui ne sont pas indiens ?
En tout cas il y a plusieurs Indiens, ceux d’Inde et ceux d’Amérique. Dans ce dernier cas on parle alors d’Amérindiens, par commodité. Encore faut-il distinguer ceux du Nord et ceux du Sud. Il est facile de les différencier. Ceux du Sud sont en voie de disparition tandis que ceux du Nord ont déjà disparu.
Une Indienne sera donc une femme vivant en Inde (qu’elle soit hindoue ou non) ou en Amérique (pour autant, bien entendu, qu’elle soit de race indienne. Georges Bush, par exemple et comme chacun sait, n’est pas un Indien même s’il joue souvent au cow boy). Mais une indienne (sans majuscule) est une toile de coton légère et colorée. Tout le monde peut s’habiller d’une simple indienne, les Indiennes hindoue d’Inde, mais aussi les Nigérianes du Nigeria.
Et les hommes dans tout cela ? N’allez pas confondre le substantif bonhomme avec l’adjectif homonyme. Un bonhomme (qui n’est pas forcément un homme bon) est une personne jugée sympathique ou au contraire qui inspire la réserve ou la méfiance. Ainsi, on dira : « Ce bonhomme me fait peur ». Le féminin est bonne femme (en deux mots). Par contre, pour un dessin représentant grossièrement l’être humain, on parlera toujours de bonhomme. L’adjectif bonhomme, quant à lui, signifie « qui exprime la franchise, la simplicité » (avoir un air bonhomme). Le substantif correspondant est évidemment bonhomie (avec un seul M), qui signifie « caractère d’une personne bonhomme » (et non bonne).
Bon, bon. Nous en aurons fini quand nous aurons parlé des bons-chrétiens, mot qui ne désigne pas les supporters de Benoît XVI mais une variété de poire.
On dit d’ailleurs « C’est une bonne poire » pour dire finalement qu’une personne a tellement l’air bonhomme qu’elle se fait toujours avoir. Etant trop bonne, elle en devient bonasse (le substantif correspondant est bonasserie, à ne pas confondre avec bonneterie, lequel soit-dit en passant s’écrit sans accent sur le « e »)
J’en ai fini et ne vais pas vous ennuyer avec la bonace, terme vieilli qui désignait le calme plat en mer (du latin malacia lequel a été contaminé par « bon »).
Il suffit maintenant de mettre tout cela en musique :
Une bonne femme nigériane se rendant au Niger vêtue d’une indienne rencontra un bonhomme bonasse. C’était un Indien hindou qui travaillait dans une bonneterie. « Que votre indienne est jolie », dit l’Indien à la Nigériane, « ne voudriez-vous pas me la céder pour mon épouse? ». « Merci pour le compliment, vous êtes trop bon », répondit la dame, mais ma religion m’interdit de parler aux hommes, qu’ils soient bons ou pas et encore moins de me dévêtir devant eux. ». « Je comprends », répond l’Indien, de mon côté je suis hindou et apprécie votre pudeur. Allons, n’en parlons plus. Comme je suis bonne-poire, je vous offre quelques bons-chrétiens pour la route. » « J’espère qu’ils sont bons », répond la bonne femme d’un air bonasse.
Ps. : je connais une ville qui possède une rue « de la bonne femme ». Ce terme n’est pas à opposer à "bonhomme » et pour en comprendre le sens il faut remonter à l’étymon latin : mala fama. Cette notion de « mauvaise réputation » fut ensuite transformée, par ironie ou par discrétion, en bonne réputation. On retrouve là l’hypocrisie habituelle de la bourgeoisie qui n’ose pas désigner les réalités par leur nom, ici en l’occurrence le monde de la prostitution.

13:52 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : langue française, vocabulaire
31/05/2007
Paysage (3)
Pays de frontières, plein de contrastes, le Roussillon est étrange à plus d’un titre.
D’abord, il y a cette rencontre géologique improbable et peu commune entre la plaine, habitée depuis toujours, rectiligne et uniforme (tellement plate qu’on a l’impression que la mer, hier encore, s’avançait en ces lieux), et les montagnes pyrénéennes qui l’encerclent et qui bordent son horizon de leurs masses sombres et vertes. Habituellement, une zone montagneuse se signale par des contreforts qui laissent le temps au voyageur de se préparer à une modification du relief. L’Ardenne, par exemple, est précédée au Nord par le Condroz et la Famenne, au Sud par l’Argonne et les Côtes de Meuse. Il en va de même du Massif central, auquel on accède au Nord par une pente douce (les départements de l’Allier et de la Creuse) et dont le flanc Ouest n’est qu’une longue descente vers l’Atlantique tandis qu’au Sud, les Cévennes dévalent en dégradé vers la plaine languedocienne. Les Pyrénées, au contraire, se dressent fièrement d’un bloc, tranchant nettement avec le milieu environnant. Ce contraste est semblable à celui de la plaine du Pô, laquelle est ceinturée tout de son long par la chaîne des Alpes. Je me souviens ainsi d’un train de nuit dans lequel je roulais vers Venise. Quelle impression, après l’obscurité de la nuit, de découvrir aux premières lumières de l’aube cette plaine immense bordée ainsi, d’une manière ininterrompue, par la masse bleutée des montagnes. Il me semblait voir les pays du Sud s’offrir à moi sans résistance, tels qu’il se donnèrent à Hannibal et à ses éléphants.
Mais revenons au Roussillon. Sa deuxième curiosité, sur le plan botanique, c’est que les Pyrénées, qu’on connaît ailleurs pour leurs sommets et leur végétation montagnarde, sont revêtues ici d’une flore méditerranéenne. Ce ne sont partout que chênes-lièges, chênes-verts, châtaigniers, arbustes et maquis, qui donnent à la montagne un air de Provence. Sans parler de la mer toute proche, qui fait de cette région une étrange synthèse de deux mondes antagonistes. On passe en un quart d’heure des plages de sable fin aux sommets caillouteux et l’on peut, en juin, se baigner en admirant les sommets encore enneigés du Canigou.
Autre particularité, c’est que nous sommes dans un pays de frontières. Ici s’arrête en principe quelque chose, à savoir l’ère d’influence des rois de France. Pourtant, sur le versant espagnol, commence la Catalogne, qui est le véritable berceau culturel et linguistique de la Catalogne française. Cette frontière est une limite sans l’être vraiment, au point qu’on se demanderait parfois si le véritable partage ne se fait pas entre les autochtones catalans (de quelque côté qu’ils soient des Pyrénées) et les touristes venus du Nord, lesquels, tels les croisés venant conquérir Montségur, s’expriment en langue d’oïl. Cette dichotomie franco-française on la ressent dans les vieux villages, dont les maisons anciennes aux volets clos sont groupées autour de la place de la mairie, tandis que dans les alentours les résidences secondaires sont principalement occupées par des retraités normands ou parisiens venus passer leurs vieux jours au soleil.
Terre étrange donc, que ce Roussillon, écrasé de soleil entre terre et montagne, repeuplé de pensionnés et qui tente de son identité propre en cherchant dans ses souvenirs les vieilles techniques artisanales de ses ancêtres, aujourd’hui dépassées et révolues.
Tandis que sur la côte les firmes hôtelières étrangères vivent du commerce et de l’exploitation touristique, les gens du coin tentent de préserver ce que fut leur vie en se demandant à quoi demain ressemblera.

15:46 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (0)
30/05/2007
Paysage (2)
Moi qui avais visité les Pyrénées durant mon adolescence, j’aspirais à voir l’endroit où cette chaîne de montagnes se jette dans la mer. Cette rencontre contrastée entre le géant rocheux et l’élément liquide, méditerranéen de surcroît, ne devait pas manquer d’intérêt. La nature, en effet, semble parfois, par son spectacle, éveiller en nous tout un réseau de correspondances symboliques. Bachelard a bien décrit cela dans ses différents livres, montrant comment certains individus sont fascinés par le feu, d’autres par l’eau et ainsi de suite. Personnellement, je déteste l’eau (et encore plus les marécages) et il n’y a que les rochers écrasés de chaleur, dans la sécheresse de l’été, qui me parlent. Les masses montagneuses, par leur assise et par leurs sommets vertigineux me rassurent, sans doute parce qu’elles évoquent la stabilité, à l’inverse des zones marécageuses, qui elles me semblent renvoyer à un monde de l’entre-deux, à un univers du mensonge et de la fourberie. Rien de plus angoissant que ces terrains humides où naît une source et dans lesquels vous vous enfoncez irrémédiablement sans savoir comment vous en sortir. Avec les humains, il en va de même. Je préférerai toujours quelqu’un qui dit clairement ce qu’il pense (pour autant bien entendu qu’il fasse dans la nuance et qu’il ne réduise pas sa pensée à des idées toutes faites et inébranlables) à ces personnes qui vous captent dans leurs filets et qui vous mentent avec d’autant plus de conviction qu’elles finissent par ne plus savoir elles-mêmes ce qu’elles pensent vraiment.
On comprendra, dès lors, que les politiciens, quelle que soit leur couleur, n’ont pas vraiment ma sympathie, surtout quand ils arrivent au pouvoir et qu’on voit par leurs actions qu’ils n’ont fait que nous tromper.
Mais revenons à nos Pyrénées, lesquelles devaient, quelque part, imposer leur présence à l’élément liquide. Cette rencontre tant attendue, il ne me fallut attendre pas mal d’années avant de pouvoir l’observer. Ayant pris un jour d’été le train à Cahors en direction de Barcelone, je me suis retrouvé dans la plaine languedocienne, aride et étouffante de chaleur. Un enchantement pour qui vit habituellement dans un pays de pluie. Puis soudain, après Sète, surgirent les étangs et notamment le bassin de Thau.

A cet endroit (ou était-ce plus loin, près de l’étang de Leucate ?), le train circule entre mer et marais dans un paysage improbable, la terre ferme étant réduite à une bande étroite à peine suffisante pour les rails. Cette omniprésence de l’eau, après quelques jours passés dans le Lot, avait de quoi surprendre et je n’ai jamais connu ailleurs cette impression de rouler au milieu de l’élément liquide. Que l’on portât le regard à gauche ou à droite, l’œil ne rencontrait qu’une même étendue uniformément bleue, conférant au voyage une portée onirique encore renforcée par la fatigue qui commençait à se faire sentir.
Mais bientôt, à l’horizon, dans une brume de chaleur, apparurent enfin les Pyrénées. Seul élément solide de tout le paysage, leur masse si caractéristique en imposa aussitôt. Il est vrai qu’après tous ces marécages dans lesquels je pataugeais depuis une heure, la présence de ces roches dures et stables offrait un côté rassurant, comme quelque chose de connu à quoi enfin se raccrocher. Mes Pyrénées se rapprochèrent à la vitesse du train et bientôt les détails des contreforts furent visibles. A la gare d’Argelès, perdue au milieu de la végétation, les derniers voyageurs descendirent. Deux couples avec enfants, qui restaient là, sur le quai unique, se demandant à quelle extrémité du monde ils avaient atteint et comment ils allaient bien pouvoir gagner le lieu de leur villégiature avec tous ces bagages qui les encombraient.
Les laissant à leur désarroi, je repartis seul, dans un compartiment déserté, pour la rencontre tant attendue. Après avoir roulé quelques minutes encore sans se presser, comme s’il redoutait un obstacle, le train butta soudain contre le rocher, dans lequel il se fraya tant bien que mal un passage. La mer avait disparu et nous étions maintenant au cœur même de la montagne, tels les héros de Jules Verne de mon enfance. Après Cerbère (dont le nom, pour tout amateur d’Antiquité grecque, n’est pas sans symboliser l’entrée dans un autre monde), apparut enfin la gare de Port-Bou (qui, étymologiquement signifie « port de pêcheurs »), terme provisoire du voyage, la SNCF renonçant à explorer les terres plus méridionales. Port-Bou, avec sa gare internationale, donne donc l’impression d’être un cul de sac, un lieu au-delà duquel il n’y aurait plus rien, sauf si on accepte de changer de registre et de passer de la langue de Voltaire à celle de Cervantès, auquel cas le voyage peut continuer.
Cette impression de cul de sac est encore renforcée par la géographie de la ville, coincée entre la mer et la montagne ou plus exactement, poussée dans la mer par la montagne. J’eus tout le loisir d’observer ce phénomène, car les correspondances ne semblaient pas assurées entre la France et l’Espagne (du moins en ce temps-là) et il me fallut patienter quelques heures avant de poursuivre mon voyage. Je les passai donc à visiter cette ville minuscule, composée dans mon souvenir d’une seule rue commerçante à forte déclivité. Ayant peu de goût pour le lèche-vitrines, je me retrouvai assez vite assis sur un parapet devant la mer, laquelle est coincée entre les masses de la montagne qui occultent pratiquement tout l’horizon. Alors que partout ailleurs, des falaises de Bretagne aux grandes plages de l’Atlantique, le regard, dans ces zones côtières, embrasse l’immensité de l’espace, ici, la vue est réduite à gauche comme à droite par des pans de montagne qui font ressembler ce qu’on voit de la mer à un fleuve se faufilant entre une rangée de HLM. Sur une étendue de galets (car même le sable jaune avait été refusé à ce qu’il fallait pourtant bien se résoudre à appeler une plage) se trouvait une jeune dame avec sa petite fille, uniques vacancières insolites en ce lieu de nulle part, où la montagne semblait avoir annihilé tout ce qui nous était familier. Aurait-on voulu les aborder, qu’on n’aurait même pas su en quelle langue il aurait fallu le faire.

10:54 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, voyages
29/05/2007
Carnets du grand chemin
Dans ses Carnets du grand chemin, Julien Gracq nous invite à un voyage à travers les paysages qu’il a traversés. En une page, il parvient chaque fois à révéler l’âme d’une région, avec un sens aigu de l’intuition. Négligeant les habitations et les hommes qui les occupent, il s‘attarde essentiellement sur l’aspect géographique, passant de la sécheresse des Causses à la baie de Somme avec une facilité déconcertante. Soulevant un pan du voile, c’est en poète qu’il parvient à toucher du doigt le mystère de ces lieux. Pas en poète bucolique, certes, mais en connaisseur des réalités du terrain, auxquelles il est sensible et avec lesquelles il tente d’entrer en symbiose, nous révélant des réalités insoupçonnées.
Ce « grand chemin », dit-il, est « aussi, quelquefois, celui du rêve, et souvent celui de la mémoire, la mienne et aussi la mémoire collective, parfois la plus lointaine : l’histoire, et par-là il est aussi celui de la lecture et de l’art. »
Qu’il nous soit permis, à son exemple, de parcourir ainsi quelques lieux qui sont restés présents dans nos souvenirs.
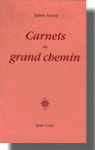
12:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, gracq
26/05/2007
Paysage (1)

D’abord, il y a la montagne
La montagne et le ciel
Et puis la mer qu’on devine
Ou qu’on imagine.
La mer.
Dans le ciel, si bleu, si pur, tourne un vautour.
Il tourne au-dessus des ruines d’un improbable château.
Il tourne depuis mille ans
Le gypaète barbu.
Nous sommes dans la montagne
Aux marches du royaume.
Midi scintille de tous ses feux
Tandis qu’une lézarde se chauffe au soleil
Sur une roche de schiste,
Les yeux ouverts, aux aguets,
La respiration palpitante.
Un ermitage est là, dans ce désert de pierres.
D’une source coule une eau froide,
Salutaire au voyageur.
Dans la chapelle à l’abandon
Point de chants liturgiques
Mais une musique obsédante qui emplit l’espace.
Celle des insectes qui, par milliers, crient leur certitude
Et leur volonté de vivre.
Sur l’autre versant, se dresse une tour
Qu’on appelle sarrasine car le Maure la construisit
En des temps reculés,
Quand ce pays était frontière d’un autre empire
A jamais disparu.
En bas, s’étend la plaine et ses villas romaines
La plaine antique et ses vignobles
La terre des hommes et du vin fou.
En bas c’est la plaine.
L’ombre du vautour a décrit un cercle plus étroit.
Il est midi et l’on reprend sa marche
Vers d’autres destinées
Vers d’autres montagnes
Où la vie n’est plus qu’un songe
Dans la chaleur de l’été.

00:55 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (2)
25/05/2007
L'invitation au voyage
Ces derniers temps, la politique est devenue déconcertante. Une majorité de la population semble aspirer à un régime fort, qui va pourtant réduire ses droits sociaux (généralisation des emplois précaires, diminution des indemnités de chômage, droit de grève remis en question,, démantèlement du service public, heures supplémentaires, etc.) et son pouvoir d’achat (la sécurité sociale comme les pensions basculant vers le secteur privé, il faudra bien cotiser auprès de ces nouvelles caisses). L’eau, le gaz, l’électricité ne seront plus vus comme des biens auxquels la population aurait droit, afin d’améliorer son confort de vie, mais comme des produits à vendre. Dans ce contexte, se chauffer en hiver pourrait bientôt devenir un luxe… Insensiblement, on assistera donc à une paupérisation manifeste d’une partie des citoyens et à l’enrichissement de quelques-autres.
Par ailleurs, le travail n’est plus présenté comme un moyen de gagner sa vie mais bien comme une fin en soi. Il faut se lever de plus en plus tôt, travailler davantage, faire des heures supplémentaires, soutenir un rythme quasi infernal… L’argent gagné au détriment du temps que vous auriez pu consacrer à votre famille ou à vos loisirs (et pour moi ce terme évoque d’abord la culture et la lecture) ne servira qu’à acheter des biens de consommation futiles, donc à faire tourner la machine économique et à permettre à quelques privilégiés de s’enrichir encore plus.
Comment peut-on approuver cela ?
Afin de garder le moral, en ces temps difficiles, prenons le large et réfugions-nous dans notre imagination. Notre monde intérieur n’appartient qu’à nous, on ne peut pas nous l’enlever, profitons-en.
Partons donc en voyage, non pas, comme Ulysse, pour dix années, mais seulement pour cinq, le temps que les choses se calment un peu du côté de l’occupant de l’Elysée. Voguons sur la vaste mer à la recherche d’une vérité improbable, découvrons des îles vierges, écoutons le chant des sirènes ou plus simplement le bruit des vagues. Laissons-nous séduire quelque temps par la belle Calypso puis retournons à Ithaque, la terre de nos ancêtres, où nous attend depuis toujours la belle Pénélope.

14:10 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (2)
22/05/2007
Dire et faire
Peut-on dire une chose et faire le contraire ? En éducation, cela me semble difficile. Expliquez à un enfant qu’on ne met pas les pieds sur la table du salon en regardant la télévision, il comprendra votre discours et approuvera votre point de vue, même s’il lui en coûte. Mais ne vous laissez pas aller à commettre l’irréparable, à savoir étendre vos propres jambes sur ladite table un jour de grande fatigue ou de lassitude, un de ces jours où les événements de la vie sont les plus forts et vous laissent comme anéanti (par exemple quand vous découvrez qu’il y a plus de 53% de vos contemporains qui admirent Sarkozy). Aussitôt, d’une manière implacable, logique et cinglante, on vous rappellera vos propres paroles : « On ne met pas les pieds sur la table du salon en regardant la télévision.» Que répondre à cela ? Rien, si ce n’est que le mieux serait de ne jamais regarder la télévision, cette boite creuse dont la fonction semble être d’abêtir les masses. Mais allez expliquer cela à des enfants ! Allez leur dire qu’ils doivent arrêter de zapper et qu’ils doivent couper définitivement la source des images au moment même où ils vous ont pris en flagrant délit de parjure. Le moment serait mal choisi. C’est que, traître à vos propres paroles, vous avez commis l’irréparable, vous avez transgressé l’interdit, cet interdit dont vous aviez vous-même énoncé les règles d’une voix ferme et implacable.
Rien à redire. L’enfance vit dans un rêve, mais son monde est logique. Les actes doivent suivre les paroles, sinon on prend le risque de se discréditer soi-même.
En politique, apparemment, il n’en va pas de même. Comme les citoyens ne sont plus des enfants, ils peuvent comprendre que dans certains cas ceux qu’ils ont élus peuvent avoir une certaine marge de manœuvre et ne pas faire exactement ce qu’ils avaient dit qu’ils feraient, c’est-à-dire, en fait, faire exactement le contraire.
Ainsi, on a vu le petit Nicolas réclamer un état impartial, qui fonctionnerait avec plus de transparence. Il a raison et je l’approuve quand il parle comme cela (tout en en comprenant pas bien pourquoi en même temps il demande plus de liberté pour les firmes privées et donc moins de lois contraignantes, c’est-à-dire moins d’Etat, mais bon, c’est sans doute moi qui n’arrive pas à emmagasiner tout ce qu’il dit car il dit tant de choses…). Donc, il faut un état fort, qui se fasse respecter et qui mette tous les citoyens sur le même pied. Plus de manœuvres louches, plus de passe-droit, rien que la légalité. Enfin ! A peine élu, le futur président, conscient de la tâche qui l’attend et de la difficulté qu’il y a à remplir une telle mission, nous annonce qu’il va se retirer pour prendre toute la mesure du poids qui pèse maintenant sur ses épaules. Voilà qui est digne d’un homme d’Etat, ce qui laisse loin derrière lui tous ces petits politiciens qui ne pensent qu’à leur carrière personnelle. De Gaulle est de retour et la France dans de bonnes mains.
Dommage qu’après avoir annoncé tout cela, le petit Nicolas a fait exactement le contraire. La retraite mystico-étatico-présidentielle est en effet devenue des vacances au soleil. Bon, pourquoi pas ? Moi aussi je prends des vacances. Il a sans doute voulu montrer par-là, par un geste fort, qu’il se rapprochait de la majorité des Français. Il agit « comme tout le monde » en quelque sorte. On applaudit encore, même si c’est un peu moins fort.
Le problème, c’est que ces vacances sont payées par un industriel richissime. A ce dernier, on ne va pas reprocher sa fortune puisqu’il s’est levé tôt pour l’acquérir. Mais enfin, en ce qui concerne le futur président, cela fait un peu tâche de s’afficher ainsi ouvertement avec le monde des affaires. Tant pis. Comme je l’ai dit, il y a ce que l’on dit et ce que l’on fait. Les citoyens étant adultes, ils ne vont pas s’en émouvoir comme des enfants.
Evidemment, une fois que le pli est pris, on continue. Ainsi, après avoir volé les voix de Le Pen en lui prenant ses idées et après avoir proclamé que la droite ne devait plus avoir peur d’être la droite, voilà qu’il recrute au centre et à gauche, au plus grand étonnement de son propre électorat qui ne l’avait pas élu pour qu’il mette des ministres socialistes au gouvernement. Mais il va plus loin encore, en nommant Juppé comme ministre de l’écologie. Là on rigole franchement. Juppé qui avait toujours travaillé pour les grands groupes industriels, voilà qu’il va aller leur mettre des taxes parce qu’ils polluent. Allons, qui va croire cela ? Et puis, en tant que ministre intègre, il laisse un peu à désirer, lui qui avait été inéligible pendant quelque temps. Qu’est-ce qu’il avait fait encore ? N’est-ce pas lui qui avait franchi le portillon du métro sans payer ? Non, je confonds, ce devait être un autre.
Enfin, bon, pour ce qui est de notre Etat de droit, propre et intègre, cela commence plutôt mal. Mais je vous l’ai dit : l’électeur est adulte et il ne va se formaliser pour ces petits revirements. Il faut dire que l’habitude rend la chose aisée. On avait déjà vu Mitterrand mener une politique de droite, alors on est blindé. Et puis, finalement, tout est dans la parole. « Au commencement était le Verbe », lit-on dans la Bible. C’est ce que l’ami Sarkozy a bien compris, en demandant de lire aux élèves des lycées la lettre de Môquet. Plutôt que de réformer les programmes qui en ont bien besoin (comme il l’avait annoncé), il commence par faire pleurer la jeunesse. Ce n’est pas que Nicolas ait l’intention de mourir lui aussi pour la France. Non pas du tout, ce n’est pas le style de se laisser exterminer. Il repartirait plutôt en croisière sur son yacht, surtout si les frais sont payés... Par contre, les jeunes, il est bon qu’ils connaissent le prix du sacrifice. Et puis comme cela, si la France se trouve engagée en Iran, au Liban, en Afghanistan ou ailleurs (en fait partout où Bush va mettre les pieds et la liste est longue), il n’est peut-être pas mauvais de la préparer à mourir, cette jeunesse oisive, qui n’a rien d’autre à faire que de brûler des voitures.
14:53 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique
21/05/2007
De la culpabilité
La France, nous dit Sarkozy, ne doit plus avoir honte de son passé. Donc acte. Nos guerres étaient donc justes et la colonisation une bonne chose. Soit. Pourquoi, dès lors, avoir mis à la politique étrangère une personne passée maître dans l’art de la culpabilité ?
Car c’est bien Kouchner qui fut jadis à l’origine du slogan en faveur des enfants de Somalie ou en tout cas qui le cautionna fortement. Souvenez-vous. On voyait un petit Africain squelettique à côté d’un kilo de riz. La légende était : « Un enfant de France donne un paquet de riz pour un enfant de Somalie.»
Je ne dis pas ici qu’il ne fallait pas aider la Somalie, je dis que ce slogan racoleur ne posait pas les vrais problèmes, à savoir :
1) pourquoi la Somalie était-elle dans cet état ?
2) pourquoi les pays occidentaux ne faisaient rien pour l’aider à sortir de cette situation ?
3) pourquoi il revenait finalement aux citoyens occidentaux, à titre individuel, de secourir la population somalienne ?
Il était donc quasiment impossible de ne pas se sentir coupable si on ne donnait pas un kilo de riz. Mais pourquoi les chômeurs ou les « RMIstes » de France et de Navarre devaient-ils ainsi suppléer aux carences des dirigeants africains, lesquels avaient été mis en place pour le plus grand profit des gouvernements occidentaux ?
De plus, on sait qu’une assistance humanitaire de ce type, qui ne résout pas les problèmes de fond, ne sert pas à grand chose, tant son action est ponctuelle et limitée dans le temps. De plus, elle fait de l’assistanat plutôt que d’aider le peuple en détresse à s’en sortir vraiment.
Dans le cas de évoqué de la Somalie, quelques mois après cette campagne de Kouchner (qui en fut le grand bénéficiaire médiatique, asseyant ainsi sa réputation d’homme au service de l’humanité), les Américains, sur mandat de l’ONU, débarquaient avec 30.000 soldats, soi-disant pour des raisons humanitaires. Il s’ensuivit une guerre civile qui se solda par des milliers de morts. On peut se demander d’ailleurs si la raison de l’intervention ne tenait pas plus à la situation stratégique de la Somalie qu’au désir d’aider sa population. Auquel cas l’opération médiatique de Kouchner n’aurait été qu’une manière (consciente ou inconsciente) de préparer les esprits à cette intervention.
Il y a fort à parier que le Darfour sera une des prochaines zones où le « French Doctor » pourra montrer son savoir-faire.
14:20 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : politique
17/05/2007
Résistance
La première sortie de notre nouveau président aura donc été un devoir de mémoire envers la Résistance. Curieux. On savait déjà qu’il avait incorporé dans ses troupes les centristes de Bayrou et qu’il était en tain de grignoter un à un les élus du PS. On ignorait par contre qu’il lorgnait aussi sur les communistes, au point d’aller se recueillir sur les lieux de leur exécution par les fascistes.
Trêve de plaisanterie. Quel symbole peut bien cacher ce geste, si ce n’est celui de vouloir s’inscrire lui-même, Sarkozy, dans l’Histoire de France. Après avoir déposé une gerbe en souvenir de Clemenceau et de De Gaulle, le voilà qui verse une larme sur ces jeunes gens qui sont morts pour notre liberté. Manière habile de se réconcilier une partie de la gauche, toute prête à entrer précisément en résistance ? Peut-être. Ou bien s’agit-il de souligner l’importance de ces immigrés juifs qui ont fait la France au point de mourir pour elle ? De bons immigrés, donc, pas comme cette racaille qui brûle les voitures parce qu’elle conteste le vote démocratique… C’est que Nicolas a besoin de montrer qu’il aime la France lui aussi, peut-être pas au point de lui sacrifier sa vie, mais au moins tout son temps libre. D’origine hongroise par son père (un petit noble qui dut fuir la Hongrie devant l’avancée soviétique. On se demanderait bien en passant quelle avait été sa réaction quand les Allemands envahirent sa belle terre de Bohème), juif français par sa mère, ayant épousé une jeune fille corse en premières noces, notre bon Nicolas ne semble pas à priori incarner le « Français de souche » qu’il a promis de défendre pendant sa campagne. Il lui faut donc en rajouter en usant de la symbolique. Jeanne d’Arc était déjà prise. Il s’écarte donc de la pucelle pour se tourner vers ces jeunes gens virils qui ont combattu contre les nazis. Rien à redire.
Rien à redire si ce n’est précisément qu’il en fait trop. Personne ne lui conteste le droit de représenter la France, pays d’ailleurs où il est né. La France de 1789 est trop démocratique pour venir lui reprocher ses origines hongroises ou juives. Là où le bât blesse, c’est que cette terre qui a accueilli son père, il ne veut plus qu’elle en accueille d’autres. Dehors tous ces étrangers qui ne travaillent pas et qui viennent épuiser la mère patrie. Seuls les méritants (comme lui) pourront rester. Et c’est vrai qu’il est méritant, le petit Nicolas. Toujours le premier (enfin, sauf à l’école, mais passons), il a dépassé tout le monde, ayant bien travaillé et surtout pour lui. D’où sans doute sa théorie sur le capital et sur les gens qui se lèvent tôt. Soyez méritants comme moi, nous dit-il et l’avenir vous sourira. En attendant, il nous invite à verser une larme sur ceux qui ont fait l’Histoire de France. Il se fait même professeur en proposant de faire lire dans toutes les écoles la dernière lettre de Guy Môquet, poignante à souhait, il est vrai. Sur le site de Champignac (http://champignac.hautetfort.com/), Dominique nous fait remarquer qu’il eût été plus subtil de proposer la lettre de Manoukian, tout aussi émouvante, mais beaucoup plus profonde.
Rappelons que tout cela déboucha sur l’Affiche rouge, de laquelle s’est inspiré Aragon pour son célèbre poème. Qu’il nous soit permis de redonner ici ce beau texte, puisque nous aussi, en quelque sorte, nous entrons en résistance.
« Vous n’avez réclamé la gloire ni les larmes
Ni l’orgue ni la prière aux agonisants
Onze ans déjà que cela passe vite onze ans
Vous vous étiez servis simplement de vos armes
La mort n’éblouit pas les yeux des Partisans.
Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes
Noirs de barbes et de nuit hirsutes menaçants
L’affiche qui semblait une tache de sang
Parce qu’à prononcer vos noms sont difficiles
Y cherchait un effet de peur sur les passants.
Nul ne semblait vous voir Français de préférence
Les gens allaient sans yeux pour voir le jour durant
Mais à l’heure de couvre-feu des doigts errants
Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA FRANCE
Et les mornes matins en étaient différents.
Tout avait la couleur uniforme du givre
A la fin février pour vos derniers moments
Et c’est alors que l’un de vous dit calmement
Bonheur à tous bonheur à ceux qui vont survivre
Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand.
Adieu la peine et le plaisir Adieu les roses
Adieu la vie Adieu la lumière et le vent
Marie-toi sois heureuse et pense à moi souvent
Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses
Quand tout sera fini plus tard en Erivan.
Un grand soleil d’hiver éclaire la colline
Que la nature est belle et que le cœur me fend
La justice viendra sur nos pas triomphants
Ma Mélinée O mon amour mon orpheline
Et je te dis de vivre et d’avoir un enfant.
Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent
Vingt et trois qui donnaient leur cœur avant le temps
Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir
Vingt et trois qui criaient la France en s’abattant. »
01:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, politique, Sarkozy
11/05/2007
L'éternité de Philippe Jaccottet
Puisque nous parlions l’autre jour de Philippe Jaccottet, voici un de ses poèmes, assez représentatif de sa manière d’écrire.
Images plus fugaces
que le passage du vent
bulles d'Iris où j'ai dormi !
Qu'est-ce qui se ferme et se rouvre
suscitant ce souffle incertain
ce bruit de papier ou de soie
et de lames de bois léger ?
Ce bruit d'outils si lointain
que l'on dirait à peine un éventail ?
Un instant la mort paraît vaine
le désir même est oublié
pour ce qui se plie et déplie
devant la bouche de l'aube
Sans avoir la prétention, ici, d’en donner une analyse, on notera tout de même le recours à des registres différents, qui s’entrecroisent. Le poète, en effet, fait référence à la vue (images fugaces), à l’ouïe (ce bruit d’outils) et éventuellement au toucher (passage du vent sur la peau). Ces images doivent être celles d’un rêve, comme le laisse suggérer les termes j’ai dormi. Fugaces, elles nous échappent aussitôt, comme le passage du vent. Cette idée d’air déplacé se retrouve dans la deuxième strophe (souffle incertain), ce qui assure une transition en douceur. On passe alors au registre sonore (bruit de papier), tout en signalant qu’il s’agit d’un bruit à peine perceptible (celui que fait un papier, de la soie, ou un bois dit léger). Du coup, on passe, dans la strophe trois, à l’idée d’éloignement. Ce bruit ténu pourrait être celui d’un outil, mais éloigné par la distance. De l’espace proche, le regard se porte donc vers le lointain. Le poète joue par petites touches impressionnistes. On est en pleine délicatesse : le bruit est SI lointain qu’on dirait A PEINE un éventail. Nous sommes dans le monde de l’indicible. Les sensations sont si ténues qu’elles sont à peine transposables dans le poème. On n’est d’ailleurs pas sûr de les avoir perçues (emploi du conditionnel dirait). Peut-être même n’ont –elles pas existé. Et pourtant si, elles existent. A l’horizon se lève l’aube, dans un instant intemporel. Alors que la première strophe était tournée vers le passé (le rêve que l’on vient de faire) et que la deuxième et la troisième se situaient au présent, on accède maintenant au monde de l’immortalité (la mort paraît vaine). Alors que le sommeil du début, s’il n’était pas une petite mort (puisqu’on y construisait des images en rêvant), était toutefois lié à l’éphémère (images fugaces), on accède maintenant à une durée hors du temps, même si on sait que cette durée est, elle aussi, provisoire (cf. l’emploi du conditionnel dans paraît vaine, qui souligne que ce n’est qu’une illusion).
Cette aube qui se lève dans cet instant unique et a-temporal est caractérisée par sa bouche. Sorte d’érotisation du phénomène qui nous renvoie sans doute au rêve de la première strophe. La bouche, comme l’éventail ou comme le store de bois léger, peut s’ouvrir ou se fermer. Son idée était donc bien annoncée précédemment. Le désir, pourtant, est oublié, nous dit-on. Quel désir ? Celui de la femme, sans doute. Il est remplacé par la contemplation de cette aube qui naît dans un instant d’éternité. On touche ici du bout du doigt le génie de Jaccottet, qui parvient à coucher sur le papier ces instants à peine perceptibles à qui ne sait pas les regarder. Avec lui, nous sommes dans le domaine de l’indicible. Remarquons encore qu’il nous guide dans la prise de conscience. Il nous tient par la main et nous amène du sommeil initial vers cette vérité, posant les questions à notre place (Qu'est-ce qui se ferme et se rouvre?) pour nous guider, à travers les images (l’éventail, le store). C’est un plaisir de cheminer en sa présence.
14:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, poésie, Jaccottet
10/05/2007
De l'être et du monde
Je voudrais reprendre la réflexion précédente et la développer davantage. La littérature doit-elle être tournée vers le monde extérieur ou au contraire tenter d’exprimer la part indicible de l’individu ? La réponse est aussi vaine, sans doute, que celle que se posent les psychologues quand ils tentent de déterminer ce qui, de l’inné ou de l’acquis, détermine les choix des individus.
D’un côté chacun est unique, de l’autre nous vivons dans un monde dont nous subissons les aléas tout en contribuant à le modifier. Entre le monde intérieur et le monde extérieur, il y a forcément des passerelles. Un être humain ne vit pas dans une chambre close et le contexte qui l’entoure le définit à peu près autant que son caractère personnel.
Sans doute, en littérature, faut-il trouver un équilibre harmonieux entre ces deux tendances pour avoir une oeuvre de qualité. Les écrivains qui passent leur temps à s’analyser sans fin n’ont qu’un intérêt limité, surtout s’ils redoublent cette démarche psychologique de considérations interminables sur les raisons qui les poussent à écrire. Ils finissent par ne plus livrer aucun message si ce n’est précisément celui qui consiste à dire qu’ils écrivent. Ce nombrilisme viscéral n’a qu’un intérêt fort limité, on en conviendra.
A l’opposé, certains écrivains sont tellement focalisés sur ce qui les entoure qu’ils se saisissent du moindre sujet d’actualité pour en faire un roman. Malheureusement, souvent, il leur manque le recul nécessaire pour porter une vision personnelle sur ces événements. La mode des romans historiques n’échappe pas à cette tendance. Tant qu’il y a de l’action, du bruit, des armes, un peu d’amour, on va de l’avant. Le lecteur doit se contenter de faits bruts par ailleurs imaginaires, sans recevoir de celui qui écrit le moindre éclairage subjectif.
Les risques d’une littérature engagée sont précisément de cet ordre. Trop occupé à dénoncer les injustices sociales, l’auteur en oublierait de nous parler de lui. Une fois qu’il s’est fait un nom dans ce genre de discipline, il a du mal à s’en défaire. Ainsi, j’avais été frappé par ce phénomène lorsque j’avais lu La terre nous est étroite du poète palestinien Mahmoud Darwich,

Après avoir écrit des poèmes manifestement politiques, qui lui avaient valu une grande réputation parmi ses concitoyens, Darwich disait la nécessité de revenir à l’intime. Sa Palestine à lui n’est pas qu’une terre à reconquérir (même si elle est cela aussi), elle est d’abord celle des souvenirs de son enfance. C’est un pays tout intérieur, donc, qu’il veut d’abord décrire et chanter, même si à ce moment-là il déroute ses lecteurs habituels, qui attendent de lui un engagement dans les conflits du moment. Ces conflits, il n’est pas sans les voir, lui qui habite à Ramallah depuis son retour d’exil, mais il estime qu’il fait plus pour son pays lorsqu’il tente d’en capter les parfums évanouis que lorsqu’il écrit des poèmes politiques. La lutte est une chose, la vraie poésie est ailleurs, en quelque sorte. Comme dans ce beau texte consacré aux souvenirs d’enfance, vécus dans un village aujourd’hui disparu :
A ma mère
Je me languis du pain de ma mère
du café de ma mère
des caresses de ma mère
jour après jour
l'enfance grandit en moi
j'aime mon âge
car si je meurs
j'aurai honte des larmes de ma mère
si un jour je reviens
fais de moi un pendentif à tes cils
recouvre mes os avec de l'herbe
qui se sera purifiée à l'eau bénite de tes chevilles
attache -moi avec une natte de tes cheveux
avec un fil de la traîne de ta robe
peut-être deviendrai-je un dieu
oui un dieu
si je parviens à toucher le fond de ton cœur
si je reviens
mets-moi ainsi qu'une brassée de bois dans ton four
fais de moi une corde à linge sur la terrasse de ta maison
car je ne peux plus me lever
quand tu ne fais pas ta prière du jour
j'ai vieilli
rends-moi la constellation de l'enfance
que je puisse emprunter avec les petits oiseaux
la voie du retour
au nid de ton attente
(…)
13:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, Darwich, poésie
08/05/2007
La littérature, une ouverture sur le monde ou sur soi?
Les propos de Jean d’Ormesson me laissent perplexe. Je ne veux pas parler, ici, du déterminisme social qui fait que chaque individu adopte telle ou telle position politique, car c’est finalement inévitable. Non, je veux parler du rapport à l’écriture.
Ainsi, certains, dans la blogosphère, disent clairement qu’il n’y a de littérature que de droite. Autrement dit, un écrivain de gauche ne serait pas un écrivain dans la mesure où il ne ferait que parler du social et donc qu’il se contenterait de dénoncer des injustices. Je veux bien, mais cela signifierait que la littérature n’a pas à être engagée, qu’elle n’a pas à jeter un regard sur le monde, qu’elle n’a pas à dénoncer quoi que ce soit. Pourtant, tout un chacun concède habituellement aux artistes (et donc aux écrivains) un sixième sens qui leur permet de « sentir » une situation et donc prévoir avant leurs contemporains ce qui va se passer. Refuser systématiquement qu’une œuvre s’ouvre sur le monde c’est, me semble-t-il, la priver d’une grande partie de son importance.
D’un autre côté, on comprend quelque part qu’un livre se doive de faire appel à l’introspection. Raconter simplement ce qui se passe autour de soi, c’est faire œuvre de journalisme. Par contre, réfléchir, entrer en soi, écouter le silence, permet précisément d’entrer dans le monde des dieux et de tenter d’en percer le mystère. On n’imagine pas un Philippe Jaccottet écrire ses poèmes au milieu d’une manifestation. Cette « oreille intérieure » qui recherche au plus profond de l’individu ce qui y est caché est assurément aux sources même de l’inspiration et de la création. Car chacun écrit avec ses tripes et il n’a rien d’autre à dire que ce qu’il est. Ecrire serait donc un acte anatomique, visant à exprimer au grand jour notre personnalité la plus profonde.
Mais cette capacité d’introspection est le propre de tous les hommes et pas d’une classe sociale déterminée. Evidemment, plus votre éducation et votre culture vous auront exercé à cette activité, plus vous y excellerez. Et quand Marcel Proust pouvait se souvenir avec bonheur des madeleines qu’il dégustait lorsqu’il était enfant, un Jules Vallès, par exemple, nous rapportait une réalité tout autre.
13:59 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature
07/05/2007
Les écrivains et la politique
L’élection terminée, le roi assis sur son trône, revenons lentement mais sûrement au thème qui nous préoccupe avant toute chose, la littérature. Il est vrai que ces derniers jours ce blogue, comme beaucoup d’autres, s’est insensiblement transformé en tribune politique au détriment de sa première raison d’être, à savoir une réflexion sur les livres et leur contenu.
Afin d’assurer une transition douce, voici un article où Jean d’Ormesson vante les mérites de Sarkozy :
http://www.lefigaro.fr/election-presidentielle-2007/20070506.WWW000000091_un_president_pour_rassembler_par_jean_dormesson_de_lacademie_francaise.html
Vous remarquerez que l’article est extrait du Figaro, journal qu’il faut bien se mettre à lire, maintenant, si on ne veut pas se faire taxer de déviance gauchiste. Ainsi donc, d’Ormesson, qu’on voit beaucoup à la télévision mais qu’on lit peu, admire Sarkozy. Il n’y a rien d’étonnant à cela. Fils d’ambassadeur, élève brillant, libéral, haut fonctionnaire à l’Unesco, le comte d’Ormesson n’allait tout de même pas se compromettre avec la populace inculte. Habitué qu’il est aux paillettes de l’Académie, il ne pouvait que soutenir le candidat de la droite riche et aisée. Et s’il n’a pas compris que Sarkozy n’était pas un homme de culture, nous mettrons cela sur le compte de son grand âge. Qu’il soit donc pardonné.
19:01 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature
La France du changement
Tout va enfin changer a promis le candidat Sarkozy. Il était temps et c'est pour cela que plus de la moitié de la population a voté pour lui. Voici donc ce qui pourrait bien se passer demain. L'édification d'une société digne du Meilleur des mondes de Huxley ou du 1984 d'Orwell. Politique fiction? Pas si sûr.
- Baisse des impôts pour les riches et pour les entreprises, creusant encore plus le déficit public et l'endettement de la France, une mesure purement idéologique et totalement irresponsable.
- Démantèlement du droit du travail, CPE pour tout le monde, précarité généralisée, avec un licenciement possible pendant 2 ans, sans justificatif ni recours.
- Retraite à 70 ans, et encouragement des retraites privées (fond de pension) pour ceux qui souhaitent partir plus tôt à la retraite et dans de meilleures conditions
- Semaine de 48 heures (alignement sur la norme européenne), et autorisation des heures supplémentaires jusqu'à 70 heures par semaine (opt-out, comme en Angleterre)
- Suppression des charges sociales sur les heures supplémentaires, ce qui encouragera les entreprises à recourir aux heures supplémentaires plutôt qu'embaucher
- Obligation d'effectuer un "travail d'utilité collective" (des travaux forcés payés moins que le SMIC) pour les bénéficiaires de minima sociaux
- Restauration du service national obligatoire pour les jeunes
- Adoption de la constitution européenne par le parlement, sans consulter les Français par référendum
- Privatisation d'EDF, de la SNCF, de la Poste. ANPE remplacée par des agences privées pour le placement des chômeurs.
- Autorisation des OGM. (Nicolas Sarkozy est le seul candidat à la présidentielle à ne pas s'être engagé à un moratoire sur les cutures d'OGM).
Immigration choisie, c'est à dire appel à l'immigration quand le rapport entre l'offre et la demande sur le marché du travail est défavorable aux entreprises, risquant ainsi de les obliger à augmenter les salaires
- Suppression de la séparation des églises et de l'état, pour permettre aux lieux de culte d'être financées par l'argent du contribuable
- Réduction du nombre d'enseignants, réduction du budget de l'éducation nationale, l'argent restant devant être partagé avec les écoles privées (suppression de la loi Falloux)
- Augmentation du budget militaire pour renforcer les capacités de la France à participer aux guerres des Etats-Unis, au grand bénéfice des multinationales de l'armement, notamment Dassault (dont le PGD Serge Dassault est député UMP et sarkozyste convaincu), et Lagardère (dont le PDG Arnaud Lagardère est le parrain d'un fils de Sarkozy).
- Extension des pouvoirs présidentiels, au détriment du premier ministre et du parlement
- Généralisation des machines à voter, afin de pouvoir truquer les futures élections
- Modification probable du jeu électoral en autorisant à nouveau les entreprises à financer les partis politiques, et en légalisant les publicités politiques à la télévision (comme aux USA), afin de donner l'avantage au parti le plus riche, c'est à dire le plus favorable aux intérêts des multinationales afin de bénéficier de leur "générosité"
- Généralisation de la vidéosurveillance "intelligente", avec détection automatique des comportements
interdits ou jugés suspects y compris pour les infractions anodines, comme allumer une cigarette dans un lieu public. La vidéosurveillance "intelligente" aura pour effet de multiplier les bavures policières (comme l'assassinat d'un jeune brésilien par la police à Londres après les attentats)
- Fichage des enfants dès la maternelle, pour repérer les "futurs délinquants".
(En tant que ministre de l'intérieur, Nicolas Sarkozy avait prévu de faire adopter cette mesure début 2007, mais il l'a finalement retirée à cause de la polémique qu'elle pouvait susciter avant l'élection présidentielle)
- Création de prisons privées, comme dans le film "Fortress". Aux Etats-Unis, un tiers des prisons sont déjà privées, et l'un des buts de la répression est désormais de gonfler les profits des sociétés qui gèrent ces prisons et qui sont rémunérées en fonction du nombre de prisonniers.
Et à plus long-terme:
- Arrestations préventives, comme dans "Minority Report", avec emprisonnement des personnes en raison des crimes qu'elles "pourraient commettre" en fonction de probabilités établies par la police grâce au recoupement des fichiers informatiques publics et privés. Ces fichiers enregistrent de multiples données qui permettent de presque tout savoir sur chaque individu (consommation, déplacements, fréquentations, situation professionelle, financière, familiale, santé, horaires et habitudes de vie, lectures et sites internet consultés, caméras de surveillance, etc)
- Utilisation du terrorisme comme prétexte pour rendre obligatoire le marquage de chaque citoyen avec une puce électronique insérée sous la peau et lisible par un scanner ou par satellite. (voir l'article sur les implants)
Avec Nicolas Sarkozy, vivre en France deviendra un cauchemar digne des visions les plus sombres de la science-fiction, comme "1984" de George Orwell ou "un bonheur insoutenable" d'Ira Levin. Une minorité de privilégiés vivront dans l'opulence et à l'abri de la répression, tandis que le reste de la population vivra dans la misère et dans la peur (peur de la répression, peur des délinquants, peur des attentats, peur de perdre son misérable emploi ou son logement
- http://www.syti.net/SarkozyDanger
12:00 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, élections, Sarkozy
Discours royal.
Dans son premier discours après les élections, l’ancien candidat devenu le nouveau président a insisté sur son désir de rassembler tous les Français. C’est la moindre des choses quand on est à la tête d’un pays. Cependant, je ne sais pas s’il va y parvenir dans la mesure où il a déjà eu bien du mal à faire venir sa femme Cécilia place de la Concorde. Enfin, il y est arrivé, c’est l’essentiel. Il est vrai qu’elle ne semblait pas écouter le discours de son président de mari et qu’elle s'entretenait plutôt avec les autres personnes présentes, mais bon, je suppose que les baratins du petit Nicolas, elle doit déjà les connaître par cœur.
09:49 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (5)







