21/06/2007
Quand le vin monte à la tête.
Avec deux jours de retard, il conviendrait de se souvenir du centenaire des incidents de Béziers. Il faut savoir que l’Aude, le Gard, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales survivaient au début du XX° siècle grâce à leur production viticole. Ils alimentaient toute la France en vin bon marché, boisson jugée antiseptique par Pasteur et finalement préférable à une eau peu potable. Après la crise du phylloxéra (1865), les viticulteurs, courageusement, reconstituent leur vignoble avec des ceps algériens. Dans les années 1900, la production devient excédentaire, d’autant plus qu’elle commence à être concurrencée par les vins espagnols, italiens et surtout algériens. Comme la Rome antique, la France devient donc la victime de sa principale colonie, laquelle parvient à vendre à des prix plus intéressants. Pourquoi ? Et bien simplement parce que dans ces vins étrangers, on ajoute du sucre pour élever le taux d’alcool et que le gouvernement français en a accepté le principe. Comme il fallait s’y attendre, avec cette surproduction, les prix chutent d’une manière vertigineuse et beaucoup de paysans français sont ruinés. Les Languedociens se mobilisent donc pour réclamer l'abrogation de la loi de 1903 qui autorisait l’ajout de sucre, mais Clemenceau refuse. On s’organise et un mouvement de contestation prend naissance avec à sa tête un certain Marcelin Albert. 150.000 personnes viennent l’écouter le 12 mai 1907 à Béziers. Il menace le gouvernement de faire la grève de l’impôt si aucun geste n’est fait avant le 10 juin. A la veille de cette date, le 09 juin, Montpellier rassemble 600.000 manifestants. De son côté, Clemenceau envoie 27 régiments (issus de régions éloignées afin d’éviter que les troupes ne prennent parti pour les vignerons), soit 25.000 hommes de troupe et 8.000 cavaliers.
Comme il fallait s’y attendre, la situation dégénère et le 19 juin, à Narbonne, les soldats tirent sur la foule, faisant deux morts. Le lendemain, c’est cinq morts qu’il faut déplorer. À Agde, 600 soldats du 17e régiment d'infanterie (bizarrement tous issus de la région, Clemenceau n’ayant sans doute pas été assez vigilant) se révoltent. Ils gagnent Béziers où ils sont acclamés par la foule. Pourtant, le 21 juin, Clemenceau peut annoncer à la Chambre que les mutins sont rentrés dans le rang. Ils seront expédiés au fin fond de la Tunisie. Plus tard, le même Clemenceau veillera à ce que ce régiment soit toujours en première ligne en 1914, dans l’Est de la France.
Dans le Languedoc, les principaux meneurs sont arrêtés. Marcelin Albert parvient à s’échapper. Il se rend à Paris où il rencontre Clemenceau. Celui-ci, autoritaire, lui fait la morale avant de lui remettre un billet de 100 francs pour le train du retour. Le pauvre Marcelin accepte, tout en promettant de rembourser le prix du billet. Discrédité auprès des siens, qui s’estiment trahis à juste titre, il devra s’exiler en Algérie et finira ses jours dans la misère. De son côté, le gouvernement établit une surtaxe sur le sucre et réglemente sévèrement le négoce du vin, donnant ainsi raison aux manifestants.
Au-delà du geste de « ces braves soldats du 17° », on retiendra le choc qu’a constitué pour la production locale languedocienne la venue des vins étrangers. Prémices à l’actuelle mondialisation du commerce, les incidents de Béziers symbolisent la confrontation entre un mode de production ancestral (la culture de la vigne remonte à l’époque romaine dans ces régions) et les premiers produits « industriels ». Un problème bien d’actualité, finalement. Il n’est pas étonnant qu’on n’en ait pas beaucoup parlé.

15:12 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Histoire, Béziers


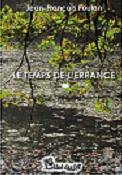



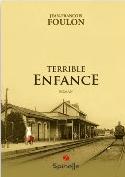
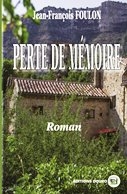
Commentaires
http://www.rayonsud.com/?page_id=8
Écrit par : Jacques Layani | 21/06/2007
Écrit par : Feuilly | 21/06/2007
http://www.champagne-multimedia.com/otsi/bar.htm
Le résultat sera multiple :
1) Il existe toujours un ressentiment des Aubois et des Sud-Marnais face à Reims, Epernay et le vignoble environnant. Je l'ai encore vu lorsque j'ai été dans le Sud-Marnais où on estime injuste que le TGV passe trop au nord ou que l'université ne se trouve pas à Troyes.
2) Cela va aboutir à la création du CIVC, mais surtout des AOC (qui seront vraiment établies par Vichy et à ce sujet la compromission des maisons de champagne avec le régime d'occupation ou le gouvernement de l'époque serait un sujet passionnant).
3) Il existe encore des chansons populaires célébrant les paysans de l'Aube, mais elles sont moins célèbres que celles des paysans du Midi. D'une part parce que la révolte a été réprimée plus sévèrement, d'autre part parce que la guerre de 14 est passée juste après dans la Marne et que les chansons parlent alors des paysages de la guerre, non plus de l'affrontement entre deux régions de la même province ou de la lutte contre l'armée française force de police autoritaire.
Écrit par : Dominique | 21/06/2007
Pour moi, la Champagne, avec ses hectares de blé, représente, face à l'Ardenne voisine, une terre de cocagne. L'étendue des exploitations, qui bénéficient par ailleurs des subsides de la CEE, symbolise la richesse, par opposition à la petite monoculture familiale qui était encore pratiquée en Ardenne il n'y a pas si longtemps.
On remarquera en passant la manière dont les régions ont été constituées, soit en mettant ensemble des morceaux de territoires bien différents. On s’est sans doute inspiré de l’esprit révolutionnaire et napoléonien qui avait présidé à la constitution des départements. Si le Sud du département des Ardennes appartient déjà à la grande culture céréalière, le Nord forestier ou industriel n’a vraiment rien de commun. Le plateau de Rocroi n’est pas la région de Vouziers.
Pour ce qui est de l'exploitation de la vigne, n'oublions pas qu'au Moyen-Âge (vin de messe oblige) celle-ci remontait jusqu'en Wallonie et ensuite jusqu'au Rhin.
Écrit par : Feuilly | 21/06/2007
Rien de tel dans la constitution des régions.
Écrit par : Jacques Layani | 21/06/2007
Pour ce qui est de la richesse régionale, les écarts sont énormes, plus grands que dans les autres régions. J'ai été dans trois des cantons les plus pauvres de mon département et leur situation n'est pas meilleure que celle des Ardennes du nord. Mais ce ne sont pas les céréaliers ou betteraviers qui font le plus d'argent, non l'argent est dans le vignoble. Le prix de l'hectare ou du mètre carré constructible ferait frémir.
Pour la vigne, on en cultive de nouveau dans le sud-est de l'Angleterre depuis dix ans, et avec le réchauffement climatique cela va continuer (c'est aussi pourquoi la Chine s'apprête à devenir la première puissance viticole mondiale, elle est déjà au neuvième rang). La vigne avait disparu de la Grande-Bretagne et du nord de l'Europe du fait de la petite ère glaciaire (époque qui va de la fin du XIVe s. au début du XIXe s.)
Écrit par : Dominique | 21/06/2007
Les commentaires sont fermés.