23/12/2007
Gracq, tel qu'en lui-même l'éternité le change.
Gracq, paradoxe d’un homme qui a refusé le Goncourt mais qui a accepté de rentrer dans la Pléiade de son vivant. Ou qui n’a pas daigné être édité en collection de poche, mais qui jouit tout de même d’un grand prestige. Qui s’est montré très réservé envers la modernité et la culture de masse mais qui a vu, cependant, certains de ses livres portés à l’écran. Compagnon de route d’André Breton, on se demanderait bien en quoi son œuvre se rapproche du surréalisme.
Ceci dit, c’est un grand écrivain, au langage pur. Nous l’avions évoqué ici même dans une courte note. Certains lui reprocheront de n’être pas un grand narrateur, ses intrigues se résumant souvent à peu de choses. D’un autre côté, il y a souvent derrière les situations décrites une grande finesse d’analyse et un esprit aiguisé qui cherche à comprendre. Il y a du Proust, chez lui (ce côté vieille France un peu désuet, la préciosité du style, le regard essentiellement littéraire), du Huysmans aussi (il me semble parfois incarner lui-même le personnage de Des Esseintes, ce anti-héros esthète d’A Rebours).
Maintenant, Gracq a conservé jusqu’au bout une certaine logique. Méfiant envers les prix littéraires et toute l’intelligentsia parisienne (voir La littérature à l’estomac), il refuse la Goncourt pour cette raison. Méprisant le grand public manquant de culture, il refuse les éditions de poche, tandis que la Pléiade lui ouvre officiellement les portes du Panthéon littéraire. Au moins on ne peut pas lui reprocher d’avoir sacrifié au goût du temps et d’avoir truffé ses écrits de thèmes triviaux plaisant au public. Solitaire, il sera resté à l’écart du monde, ce qui lui aura permis de conserver un regard personnel, loin des modes du moment.

18:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Gracq, littérature
08/06/2007
De la consécration littéraire
Dans ses Carnets du grand chemin, déjà cités, Julien Gracq fait remarquer que la seule consécration littéraire qui ait quelque valeur à ses yeux, doit être le fait d’un écrivain réputé. Les critiques comme les lecteurs avisés ne le convainquent pas. Pourtant il reconnaît que les propos tenus par ceux-ci comme par ceux-là sont souvent profonds et non dénués d’intérêt. Mais il n’y a rien à faire, rien ne vaut l’approbation et l’encouragement d’une sommité littéraire.
On sait que son Château d’Argol avait reçu les éloges de Breton avant même sa publication. Pour le jeune Gracq, le fait d’être ainsi reconnu par une personnalité aussi importante, qui faisait figure de « pape » des lettres, constituait une sorte de laissez-passer qui l’autorisait à entreprendre une carrière littéraire.
Il regrette d’ailleurs dans les Carnets (soit en 1986) qu’il n’y ait plus personne dont l’opinion lui importe encore. Breton, Malraux, Gide et Valéry s’en sont allés depuis longtemps. Les quelques écrivaillons contemporains le laissent indifférent, concentrés qu’ils sont sur leurs propres sillons. Quant aux critiques et aux lecteurs, leurs éloges ne font pas autorité pour l’assurer de la valeur de sa production récente. Il compare en fait cette reconnaissance par des gens du métier qui ont fait leur preuve à une sorte d’adoubement moyenâgeux. Tels les Compagnons, qui devaient produire une pièce maîtresse et recevoir l’avis positif des maîtres de la corporation, il estime qu’il n’y a que les vieux routiers de l’écriture, ceux qui ont vécu le fait littéraire de l’intérieur, qui peuvent avoir un avis pertinent.
Tout ceci est évidemment un peu frustrant pour les lecteurs et les critiques que nous sommes tous un petit peu. Quelque part, cependant, il doit avoir raison. Il faut avoir écrit soi-même une œuvre pour mieux cerner la difficulté qu’il y a à en agencer tous les rouages. D’un autre côté, il me semble que cette recherche systématique d’approbation de la part d’un aîné (ce qui est difficile à trouver quand on a plus de quatre-vingt-dix ans) repose davantage sur la réputation de ce donneur d’avis que sur sa capacité réelle à juger de l’œuvre d’autrui. De plus, n’y a-t-il pas là une attitude quelque peu puérile de vouloir à tout prix être reconnu par ses aînés ? Rimbaud attendait-il les éloges du Parnasse pour écrire Une Saison en enfer ? Il est vrai qu’il eut les encouragements chaleureux de Verlaine, ce qui n’était pas rien.
00:42 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Littérature, Gracq, critique littéraire
29/05/2007
Carnets du grand chemin
Dans ses Carnets du grand chemin, Julien Gracq nous invite à un voyage à travers les paysages qu’il a traversés. En une page, il parvient chaque fois à révéler l’âme d’une région, avec un sens aigu de l’intuition. Négligeant les habitations et les hommes qui les occupent, il s‘attarde essentiellement sur l’aspect géographique, passant de la sécheresse des Causses à la baie de Somme avec une facilité déconcertante. Soulevant un pan du voile, c’est en poète qu’il parvient à toucher du doigt le mystère de ces lieux. Pas en poète bucolique, certes, mais en connaisseur des réalités du terrain, auxquelles il est sensible et avec lesquelles il tente d’entrer en symbiose, nous révélant des réalités insoupçonnées.
Ce « grand chemin », dit-il, est « aussi, quelquefois, celui du rêve, et souvent celui de la mémoire, la mienne et aussi la mémoire collective, parfois la plus lointaine : l’histoire, et par-là il est aussi celui de la lecture et de l’art. »
Qu’il nous soit permis, à son exemple, de parcourir ainsi quelques lieux qui sont restés présents dans nos souvenirs.
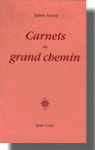
12:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, gracq







