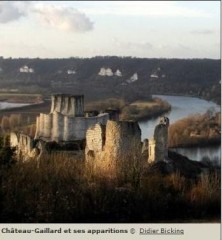02/03/2017
Mardi gras
Le Mardi gras était à l’origine une fête païenne, où on fêtait le retour du printemps et le renouveau de la nature. L’Eglise catholique, comme d’habitude, a incorporé cette fête dans son calendrier. Le mot « gras » indique qu’on peut manger copieusement une dernière fois (et même de la viande) avant que ne commence le carême, soir le Mercredi des cendres.
C’est l’époque des carnavals. Ce mot vient de l'italien carnevale ou carnevalo, altération du latin médiéval « carnelevare », lui-même issu de « carne » (la viande) et « levare » (enlever). Il s’agit donc bien de l’entrée en carême, cette époque durant laquelle la consommation de viande était interdite.
Pendant longtemps, le mot carnaval a eu le même sens que celui de « carême-prenant », autrement dit celui d’entrée en carême. Puis le terme a désigné la veille du carême et l’accent a été mis sur les réjouissances qui caractérisent ce jour-là.
Notons en passant que « carême » (d’abord orthographié « quaresme »), provient lui du latin populaire « quaresima », altération du latin classique « quadragesina » (quarantième jour avant Pâques).
Mais revenons au carnaval. Cette fête trouve son origine dans les Lupercales des Romains et les fêtes dionysiaques en Grèce.
L’historien des religions Mircea Eliade a écrit : « Toute nouvelle année est une reprise du temps à son commencement, c’est-à-dire une répétition de la cosmogonie. Les combats rituels entre deux groupes de figurants, la présence des morts, les saturnales et les orgies, sont autant d'éléments qui dénotent qu’à la fin de l’année et dans l’attente du Nouvel An se répètent les moments mythiques du passage du chaos à la cosmogonie »
Claude Levi-Strauss a étudié également ce besoin de se déguiser, d’inverser les valeurs (les pauvres devenant rois pour une journée) et de faire du bruit afin de marquer une rupture dans l’écoulement classique du temps. Le temps s’est arrêté et un nouveau cycle commence (le retour du printemps renvoie à la conception antique de l’éternel retour, de l’âge d’or qui immanquablement finira par revenir périodiquement).
Pour un jour, le vieux monde s’écroule. Le carnaval est en effet une sorte de « fin du monde », où les barrières sociales tombent ou s’inversent, où les licences érotiques sont permises. Bref, c’est un retour au chaos primitif avant la renaissance d’un temps nouveau.
Pour terminer, n’oublions pas la Laetare, qui a lieu le quatrième dimanche du carême (à la mi-carême donc) et qui marque une pause dans les privations. Le mot latin laetare est en fait l'impératif présent du verbe « laetari » et signifie donc « réjouis-toi ». C’est une époque où on retrouver également des fêtes carnavalesques.
Stavelot, Wallonie, dimanche de Laetare.
00:05 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Étymologie, carême, mardi gras
01/02/2016
Le chaperon rouge, étymologie
Revenons encore une fois au conte du Petit Chaperon rouge.
Mais avant d’aller plus loin, il conviendrait de s’interroger sur le sens de ce « chaperon ». Ce terme désigne une coiffure à bourrelet terminée par une queue que portaient les hommes et les femmes du Moyen Âge. Selon Furetière, cette coiffure serait restée en usage pour les hommes jusque sous le règne de Charles VII. Pour les femmes, le chaperon était plutôt « une bande de velours qu’elles portaient sur leur bonnet ; et c’était marque de bourgeoisie ». Le terme a désigné également un grand voile dont les veuves se couvraient la tête et le «bourrelet à pendant d'étoffe, garni d'hermine, fixé sur l'épaule gauche de la robe des magistrats, docteurs, professeurs ».
L’idée de base est donc bien celle d’une étoffe qui recouvre. Chaperon est en fait un diminutif de chape.
Le Robert historique nous apprend que « cape », puis « chape » est issu du bas latin « cappa », désignant un capuchon et manteau à capuchon. Notre mot « cape » actuel est de formation savante.
La « chape de plomb » était le nom d’un ancien instrument de torture qui est passé dans l’usage avec une valeur figurée. Sinon, le terme a pris une valeur technique en maçonnerie : la chape qui recouvre un mur.
Le chaperon, quant à lui, est comme je l’ai dit un diminutif de chape et désignait donc une coiffure à bourrelet terminée par une queue. Dans le conte de Perrault, c’est par métonymie que le terme a désigné la petite fille qui portait le chaperon. A mon avis la couleur rouge choisie n’est pas innocente puisqu’elle préfigure le carnage perpétré par le loup. Si on veut bien accepter la théorie qui veut voir dans le conte l’éveil d’une jeune fille à la sexualité (cf. aussi l’expression « voir le loup », « avoir déjà vu le loup ») cette couleur rouge pourrait faire référence aux premières règles de la puberté. Quant à voir une autre allusion sexuelle dans la queue du bonnet, il y a un pas que je ne franchirai pas.
Revenons plutôt à l’histoire de la langue.
Par extension et au figuré, le chaperon a fini par désigner « une personne respectable, généralement d'un certain âge à qui l'on confiait naguère (parfois encore aujourd'hui) pour des raisons de convenance et notamment pour les sorties, la surveillance d'une jeune fille ou d'une jeune femme. » (Dictionnaire de l’Académie, 1932).
Furetière parle de « grand Chaperon » pour désigner ces dames respectables qui accompagnent les jeunes filles. Le Dictionnaire de l’Académie (1694) reprend la même définition : « on appelle figurément grand chaperon les femmes d’âge qui accompagnent les jeunes filles dans les compagnies, par bienséance et comme pour répondre de leurs conduites ».
L’idée de protection que contenait le mot chaperon est donc passée dans le sens moral.
Notons aussi que ce sens du mot « chaperon » renvoyait donc bien une personne et dès lors Perrault n’a eu aucune difficulté à nommer la petite fille de son conte par sa coiffe.
Quant au verbe « chaperonner », utilisé surtout au participe passé, il signifiait à l’origine « coiffé d’un chaperon », mais le sens strict s’est limité au domaine de la fauconnerie (« Petit casque de cuir dont on recouvre le crâne et les yeux des rapaces »). Au sens dérivé, chaperonner veut dire « accompagner une jeune personne pour la protéger et la surveiller ».
Pour revenir à notre conte de Perrault, on remarquera donc toute l’ambiguïté du terme « chaperon » puisque la petite fille ainsi habillée était supposée être protégée (contre les intempéries, mais aussi moralement) alors qu’en réalité elle est livrée à elle-même sur les routes où rode le loup. C’est d’ailleurs sur les conseils du loup qu’elle prend le chemin le plus long (tandis que le loup prend le plus court). De plus, tandis que le loup se met à courir, la petite fille prend le temps de cueillir des fleurs (reflet de ses états d’âme romantique, préfiguration de l’amour ?)
La couleur rouge, celle du sang, accolée au chaperon supposé la protéger est donc une sorte de contradiction ou si vous aimez les figures de style, un oxymore.

00:05 Publié dans Langue française, Littérature | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature
28/06/2015
La France, le français et les langues régionales.
J’avais écrit autrefois un article sur les langues régionales et on avait pu le lire ici même sur Marche romane. En substance je disais toute l’affection que je pouvais avoir pour les langues régionales, tout en insistant sur le danger qu’il y avait à les reconnaître trop. En effet, sous prétexte de défendre les minorités culturelles, l’Europe visait surtout à affaiblir politiquement les Etats. Que serait la France si un Breton ne se sentait pas d’abord Français et s’il ne pouvait pas s’entretenir avec un Marseillais qui lui ne voudrait parler qu’en Occitan ? Car reconnaître les langues régionales peut aller loin (accès à l’administration, à la justice, etc.). Tout en reconnaissant que tous les patois méritaient certes le titre de langue à part entière, j’insistais sur le danger qu’il y avait à leur donner un statut officiel.
C’est le seul article qui a été censuré, Hautetfort me demandant de le retirer sous menace de fermeture de mon site. Le prétexte était que j’avais utilisé une carte géographique pour illustrer la répartition des langues régionales en France et que cette carte était propriété de l’agence France presse. Pour ne pas tout perdre, j’ai retiré l’article, mais je reste persuadé que ce qui était visé, ce n’était pas l’origine de la carte mais le contenu de mon article.
Bref, puisque je ne peux plus m’exprimer sur ce sujet, pourtant capital et qui me tient à coeur, je suppose que j’ai quand même le droit de citer les articles des autres. En voici un qui reprend en substance ce que j’avais dit, tout en insistant sur le rôle trouble de l’Allemagne dans ce jeu. J’ajouterai qu’il ne faut pas perdre de vue que l’Europe qui cherche à affaiblir les langues officielles de ses Etats membres (français, espagnol, italien) au profit de leurs différentes langues régionales, ne s’exprimera bientôt plus qu’en anglais. Curieux paradoxe, n’est –il pas vrai ?
Pour lire l'article, c'est ici.

01:03 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : langue française, patois, langues régionales
23/09/2013
Étymologie (suite et fin)
Avaler : on oublie parfois que ce terme est lié à « aval » et indiquait à l’origine l’action de descendre ou de faire descendre. Ensuite, par restriction sémantique, il a désigné le fait de faire descendre un aliment par le gosier.
Merci. Du latin « mercedem » (salaire, récompense), il a pour sens premier « grâce, pitié, miséricorde ». Il a aussi le sens de « cadeau, faveur » avant d’exprimer la gratitude pour une faveur accordée. Depuis le XVI° siècle, le substantif féminin signifie « grâce », le masculin exprime le remerciement et la politesse.
Franc. Le mot a d’abord une valeur ethnique (le peuple franc) avant de désigner au VI° siècle un homme libre puis un noble par naissance. A ce caractère social s’ajoute une connotation morale : le noble ne peut être que bon, généreux et affable. A partir du XVII° siècle, franc désigne surtout la sincérité et la droiture. Il garde cependant son ancien sens dans des expressions comme «avoir les coudées franches », « franc-tireur » ou « coup-franc ».
Beau, du latin « bellus » qualifie la perfection physique ou morale. Il peut aussi traduire l’affection ou le respect quand il est en apostrophe. Cette dernière signification est à l’origine des termes de parenté indirecte (« beau-frère », « belle-mère »).
Port (porz en ancien français) vient du latin « portus » et désigne un défilé dans les montagnes (où il est concurrencé par « col ») Il peut aussi désigner un abri pour recevoir les navires. Dans le premier sens , on retrouve le mot « passeport » et des toponymes (comme St Jean Pied de Port, dans les Pyrénées-Atlantiques, au pied du col (ou port) de Roncevaux, célèbre par la chanson de Roland).
St Jean Pied de Port

00:07 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : etymologie
17/09/2013
Etymologie
Je voudrais revenir, encore une fois, sur le Charroi de Nîmes, ou plus exactement sur les notes de Claude Lachet, le professeur de Lyon III qui a traduit le texte. On trouve dans ces notes de nombreuses remarques étymologiques et certaines ont attiré mon attention.
Ainsi en va-t-il du mot « Bachelier ». Dans les chansons de geste, ce terme désigne toujours une personne jeune, quelle que soit sa condition sociale. On peut donc traduire ce terme par « adolescent ». Souvent, le mot est accompagné par un adjectif qui souligne les qualités propres à la jeunesse (audace, enthousiasme, générosité). A partir du XIV° siècle, « bachelier » désigne le premier grade universitaire.
« Payer en monnaie de singe ». Le pont reliant l’île de la Cité à la rive gauche de la Seine s’appelait le « Petit Pont » et c’était le plus ancien pont de Paris. Construit en pierre en 1185, il a souvent été détruit par les crues du fleuve (ou même par les incendies qui embrasaient les maisons de bois dont il était bordé). Pour le traverser, il fallait payer. Seuls les jongleurs étaient dispensés du péage. Pour prouver leur état de jongleurs, ils faisaient exécuter des tours à leur singe, d’où l’expression « payer en monnaie de singe ».
« Oïr » : du latin « audire », le verbe oïr est le terme usuel au Moyen-Age pour désigner le fait de percevoir des sons. Les formes trop brèves de ce verbe et les homophonies gênantes avec celles du verbe avoir ont entraîné son abandon au profit du verbe « entendre ». Comme chacun sait, oïr a survécu à l’impératif (« oyez », formule qu’employaient les hérauts), dans l’expression « par ouï-dire » et dans l’adjectif « inouï ».
« Repaire ». Ce terme provient indirectement du mot latin « patria », ce qui ne saute pas aux yeux. En effet, à côté de « patria » existait le verbe « repatriare » ( rentrer dans sa patrie, rentrer chez soi), lequel avait donné repairier en ancien français, avec le sens premier de revenir dans un endroit familier. Ensuite, par extension, il a signifié demeurer, séjourner. Du coup, le déverbal « repaire » a pris le sens de ‘retour », « endroit où l’on séjourne », mais aussi de « gîte des animaux sauvages ». A partir du XVII°, on distingue « repaire » (lieu de refuge pour les animaux ou les individus dangereux) et « repère » (retour à un point déterminé, la marque servant à retrouver un emplacement). Notons pour ce dernier terme un rapprochement inconscient avec le latin « reperire » (retrouver).
« Femme ». Le terme latin « uxor » (femme mariée) avait donné en ancien français « oissour », bientôt remplacé par « moillier » (du latin « mulier » lequel désignait d’abord et plus généralement toute personne de sexe féminin), toujours avec le même sens. Le même étymon a bien entendu donné « mujer » en espagnol. C’est au XV° siècle que « moillier » disparaît à son tour au profit de « femme ». Ce mot est en fait un participe présent passif qui signifiait « qui est sucée, qui allaite » et s’appliquait dans un premier temps exclusivement aux animaux femelles. On rapprochera le terme du verbe « fellare », sucer, lequel a donné « fellation » en français. Comme quoi l’étymologie réserve bien des surprises…
00:05 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : étymologie
12/03/2013
Expression "à fond de cale" (sept centième note de Marche romane)
Au début de cette année, on avait pu lire ici une petite nouvelle que j’avais intitulée « A fond de cale ». Un lecteur attentif m’avait fait remarquer que cette expression, qui au départ désignait bien la punition d’un marin (lequel restait au secret, enfermé dans la cale), pouvait également signifier pour une voiture le fait d’aller très vite : « Il roulait à fond de cale » Il ne voyait pas bien et moi non plus, à vrai dire, comment on avait bien pu passer d’un sens à l’autre. Depuis, j’ai entrepris quelques recherches et j’ai trouvé ce qui suit.
« Fond » est issu du latin classique « fundus-i » (le fond d’un objet), qui a donné « fundus-oris » en latin populaire, puis « funz » (1080) et « fonz » ou « fons ». Ensuite, on a accolé à ce mot un « d » étymologique, histoire de rappeler d’où venait le mot (et peut-être aussi, me dis-je, pour le distinguer de « fons », fontaine).
Désignant le fond d’un objet, notre substantif signifiait donc aussi la limite, le point extrême de cet objet, d’où des expressions comme « le fond de la misère », « le fond des choses »
Le « fond » est donc l’élément véritable d‘un objet, celui qui est caché à la vue mais qui en constitue la réalité essentielle (voir « le fond des choses », révéler « le fond de sa pensée »).
De cet emploi, viendraient les expressions « au fond » (en réalité) et « dans le fond »
« A fond » reprendrait quant à lui l’idée d’extrémité, mais on serait passé de l’idée de profondeur maximale à celle de grande intensité. D’où « à fond de train » (à toute vitesse).
D’où l’expression récente « à fond la caisse » pour parler d’une voiture (une « caisse ») qui roule non seulement à vive allure, mais même au maximum de sa vitesse.
Notez qu’il ne faut pas confondre « fond » et « fonds ». Ce dernier terme correspond à un emploi particulier de « fond », à savoir la terre cultivée ou sur laquelle on bâtit. De Là, il a désigné les immeubles ou les meubles incorporels (« fonds de commerce ») et par extension le capital dont on dispose (« être en fonds », « à fonds perdus », « fonds publics », etc.)
Mais revenons à notre « fond ». Si on comprend l’expression « à fond la caisse », on comprend moins d’où peut venir « à fond de cale ».
Penchons-nous un peu sur ce mot.
Il faut savoir tout d’abord qu’au même mot « cale » en français, correspondent des étymons différents :
Un étymon germanique
- « Cale » viendrait du germanique « keil ». L’idée serait de germer, de pousser et donc de fendre (comme la graine qui fend la terre). Le mot désigne un morceau de bois (préalablement fendu) qu’on place sous un objet pour le mettre d’aplomb.
- Par extension, on a l’idée d’être installé confortablement (« se caler les joues», « avoir l’estomac bien calé »)
- L’idée de rendre fixe est réalisée dans le domaine technique avec un objet désignant une pièce ou une machine. (« caler le moteur »)
- Quand on parle d’une personne, le sens renvoie plutôt à une défaillance (« elle a calé sur ses maths »).
Un étymon grec
- Le verbe « caler » viendrait du grec khalan (détendre, se relâcher et plus spécifiquement abaisser le mât d’un navire), via l’ancien provençal « calar » (tendre les filets de pêche). Appliqué à la langue nautique, il désignait bien le fait d’abaisser la voile d’une embarcation.
- Le verbe a désigné aussi en moyen français le fait pour un bateau de couler (mais ce sens a été perdu)
- Dès le XIII° siècle, on trouve le mot « cale », formé sur « caler » (descendre, abaisser). Il désigne l’endroit où les marchandises sont descendues. Le syntagme « à fond de cale » renvoie donc à la partie la plus basse de la partie immergée d’un navire.
- Le supplice de la cale consistait à suspendre un marin à bout de vergue et de le plonger (caler, descendre) plusieurs fois dans l’eau, où il se retrouvait immergé.
- Le mot « cale » a désigné aussi la partie en pente d’un quai (qui permettait de descendre le navire dans la mer). D’où l’expression figée « en cale sèche».
- Le « calage », quant à lui, a d’abord désigné le fait de baisser les voiles d’un navire, puis, assez logiquement, le fait pour ce navire de rester immobile. On retrouve ce sens dans « caler le moteur d’une voiture », mais dans ce cas il y a confusion avec le premier étymon de cale (enfoncer, ficher une cale comme un coin).
Le participe passé « calé » qui avait le sens de « dans une bonne position » a fini par prendre le sens de doué (« il est calé en histoire »). « Recalé », par contre, désigne le fait d’avoir échoué à un examen.
Bref, tout cela, c’est très bien, mais nous ne savons toujours pas d’où vient l’expression « à fond de cale » pour désigner la vitesse excessive d’une voiture.
« A fond », on l’a compris, désigne l’intensité, en l’occurrence ici la vitesse maximale que peut atteindre la voiture (de l’endroit le plus profond, on est passé à l’idée d’intensité). Mais pourquoi « cale » ? Je me demande si l’idée ne serait pas que le moteur serait « calé » à fond, au maximum de son régime, le pied restant en permanence sur l’accélérateur enfoncé au maximum. A moins qu’il ne faille passer par les cale-pieds des vélos de course, le pied étant solidement rivé (et pour ainsi dire attaché) sur les pédales afin que toute la force du cycliste puisse être utilisée pour donner de la vitesse au vélo.
Si quelqu’un a une autre idée, elle est la bienvenue.
00:05 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : a fond de cale
04/03/2013
Se mettre sur son trente et un
Voilà une expression qui semble toute simple et dont je ne parviens pourtant pas à trouver l’origine.
Que ce soit dans le dictionnaire des expressions et locutions de Rey et Chantreau ou bien dans le Dictionnaire historique du Robert (toujours par Alain Rey), on ne découvre rien de satisfaisant. On nous dit que le plus logique aurait été le chiffre 9 (= neuf). Puis on aurait multiplié ce chiffre pas deux par une sorte de calembour (se mettre sur son dix-huit, autrement dit mettre des habits deux fois neufs, vraiment neufs) ou par quatre (se mettre sur son trente-six). On trouve effectivement trente-six dans quelques textes, mais on peut lire aussi « se mettre sur son trente-deux » dans le journal des Goncourt et « se mettre sur ses cinquante et un » chez Balzac. Curieux. De là, on aurait ramené le chiffre à trente et un, soit parce que c’est le nombre de jours maximum que comporte un mois, soit parce que le nombre normal des jours serait trente et donc trente et un marquerait un jour un peu exceptionnel.
Honnêtement, toutes ces explications me semblent assez farfelues.
L’explication pour trente-six (« ils se voyaient tous les trente-six du mois », autrement dit pas souvent et même jamais) est plus convaincante. Au départ, trente-six, qui est un multiple de douze, avait la valeur d’un intensif (« voir trente-six chandelles », c’est en voir beaucoup, faire trente-six métiers, etc.). Evidemment, associée aux mois, l’expression a pris un sens opposé : comme il n’y a pas trente-six jours dans un mois, elle a signifié jamais (un peu comme les calendes grecques, qui n’existent pas, ou la semaine des quatre jeudis, qui n’existe pas davantage).
Remarquez qu’être « dans le trente-sixième dessous » (dans une mauvaise situation) indique également une idée d’intensité. La référence serait pourtant le chiffre trois si on en croit Alain Rey.
Trente, quant à lui, vient du latin « triginta » (trois fois dix) formé sur « tres » (trois). Ce « triginta » a donné « trinta » en latin populaire, par contraction et finalement « trenta » vers l’an mil.

00:05 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (10)
18/12/2012
Histoire de moules...
Une lectrice fidèle a employé récemment dans un commentaire le terme « bouchot » que je ne connaissais pas, n’étant pas né au bord de la mer (elle non plus à vrai dire) mais au milieu des bois. Il s’agit des pieux non écorcés (en chêne ou en châtaignier) d’environ 6 mètres de long qu’on enfonce dans le sable et qui servent à l’élevage des moules.
Selon le Robert historique, le mot serait originaire du Poitou. On trouve le mot « bouchaux » en ancien français, issu du latin médiéval « buccaudum ». Ce dernier serait apparenté à un autre mot du latin médiéval (dans la même région toujours), « buccale », lequel désignait l’endroit où l’eau s’échappait à la sortie d’un étang (latin classique « bucca », la bouche, lui-même d’origine celtique et qui avait supplanté le mot latin « os »)
Notre « bouchot » était donc employé dans le Poitou au sens de vanne d’écluse, puis il a désigné plus précisément la sortie d’un parc en clayonnage pour emprisonner le poisson, puis finalement un parc aménagé pour la culture des moules (les pieux étant souvent alignés de manière à former un V). On parla donc de « moules de bouchot » ou tout simplement de « bouchots ». Le terme « bouchot(t)eur » désigne quant à lui assez logiquement un mytiliculteur (terme savant formé à partir du grec mutilos/mytilos, coquillage)
Les peuples étant plus inventifs que les dictionnaires et plus portés vers le merveilleux, ont imaginé une légende. On dit qu’un Irlandais, un certain Patrice Waltonum (tous les Irlandais s’appellent Patrice ou Patrick, c’est bien connu) s’était échoué en 1235 dans la baie de l’Aiguillon (à la limite de la Vendée et de la Charente-Maritime, là où la Sèvre niortaise vient se jeter dans l’Atlantique, autrement dit dans le Pertuis breton, en face de l’île de Ré). Voulant s’établir là, il se mit en devoir d’attraper des oiseaux de mer pour se nourrir. Pour ce faire, il planta des pieux dans le sable, et tendit des filets entre eux. Cependant, comme ces pieux se trouvaient en partie submergés à marée haute, les moules et les coquillages vinrent s’y fixer et le brave Irlandais dut bien constater qu’il attrapait plus de moules que d’oiseaux de mer. Il aurait ensuite perfectionné sa technique en reliant ses piquets par des claies, sur lesquelles les moules vinrent elles aussi se fixer. Cette structure, dont le nom irlandais était « bout choat » aurait donné par déformation notre « bouchot ». C’est du moins ce que dit la légende et même si rien n’est vrai, cela reste une belle histoire.
Des linguistes voient plutôt l’origine du mot « bouchot » dans le nom patois d’une forme de piège immergé pour capturer l’anguille dans le marais poitevin (avec toujours cette idée que le piège est constitué de pieux et de filets et prend la forme d’un v). Le mot dériverait de « boucher » (obstruer le « bouchaux », terme qui désignait comme on l’a vu plus haut la sortie d’une retenue d’eau). C’est donc bien la volonté de boucher un orifice qui prédomine (soit ici le goulot étroit du piège dans lequel s’est faufilée l’anguille, soit dans d’autres cas la sortie de l’étang, afin d’empêcher l’eau de s’écouler). Notre mot « bouchon » comme notre verbe « boucher »viennent d’ailleurs de l’ancien français « bousche » (poignée de paille, faisceau de branchage), venant du latin populaire « bosca » (broussailles). Ce « bosca » est un neutre pluriel en latin, mais il existait aussi comme substantif masculin, lequel, au pluriel, donne évidemment « bosci », d’où notre terme de « bois ».
Je me demande jusqu’à quel point il n’y aurait pas eu confusion entre « bucca » (la bouche) cité plus haut et « bosca » (le bouchon de branchage servant à fermer cette bouche).
Certains pensent que la technique du piège à anguille aurait pu être utilisée sur le littoral. On aurait accroché des filets à des pieux alignés de manière à former un entonnoir en V. Les poissons qui cherchaient à gagner le large à marée basse auraient ainsi été conduits dans une nasse qui « bouchait » la sortie. Ces pieux se couvrant naturellement de moules, on aurait alors eu l’idée d’en planter pour l’élevage (en ensemençant les pieux à l’aide de cordes couvertes de larves et en enfermant les moules dans un filet). La forme en V (ou en W s’il y avait deux V) prise par les alignements de pieux est bien attestée autrefois, ce qui semble confirmer que l’origine de notre mytiliculture doit remonter à ces pièges à poissons.
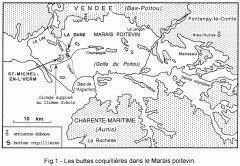
Laissons maintenant l’étymologie pour faire un peu d’histoire et de géographie et nous pencher sur l’évolution de la culture des moules. Pendant très longtemps, cette technique d’élevage sur bouchots ne s’est pratiquée que sur la côte atlantique, car il n’y a que là que les larves se fixent naturellement sur les pieux. En plus, elle semblait se limiter à l’embouchure de l’aiguillon. Rappelons à ce propos que c’est à cet endroit que se trouvait l’ancien golfe du Poitou, (encore attesté dans l’Antiquité). Composé de petites îles, il devint marécageux à cause des dépôts de l’océan et des alluvions des différents cours d’eau, comme la Sèvre Niortaise. Au VII° siècle, des moines entreprirent des travaux d’assèchement, en construisant des canaux. Au XIII° siècle, après la Guerre de Cent ans, les rois de France encouragèrent le travail des moines. Mais il ne suffisait pas de creuser des canaux, il fallait aussi élever des digues (contre les avancées de la mer et contre les débordements des rivières). Henri IV fit venir des ingénieurs hollandais, passés maîtres dans leur pays dans ce genre de travaux. Ils étaient par ailleurs huguenots, ce qui pour l’ancien protestant qu’était le roi (« Paris vaut bien une messe ») ne gâchait rien. Bref, on parvint tant bien que mal à assécher ce golfe, qui est devenu aujourd’hui le marais Poitevin, appelé aussi la « Venise verte ».
Mais revenons à nos moules. Il faut attendre le XIX° siècle pour que la culture des moules se développe de la Vendée jusqu’à l’île d’Oléron. Dans les années 1950, ce type de culture a été implanté dans la baie du Mont St Michel et dans le Cotentin, ce qui fait qu’aujourd’hui c’est la Normandie qui est devenue la première région productrice de moules de bouchot au monde. Comme les larves ne se fixent pas naturellement aux pieux dans cette région, on tend des cordes de captage sur la côte Atlantique (Noirmoutier, etc.). Les bébés moules viennent s’y déposer et on rapporte les cordes en Normandie afin de les fixer sur nos fameux bouchots.

00:05 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : moules, marais poitevin, bouchot, étymologie
21/09/2011
Automne
Automne,du latin « automnus ». Mot probablement d’origine étrusque, mais les Romains avaient fini par le confondre avec le verbe « augere », croître, augmenter. C’est que l’idée première était bien positive, celle d’une saison où l’on engrangeait les récoltes, où la terre donnait en abondance fruits et légumes et récompensait ainsi les hommes du mal qu’ils s’étaient donné au printemps pour labourer. Jusqu’au XII° siècle, on employait d’ailleurs le terme « gain » (temps de la récolte) et pas notre mot « automne », qui est en quelque sorte emprunté tel quel au latin au XIII° siècle, dans un premier temps toujours avec cette idée de récolte, puis progressivement avec celle de déclin.
« Gain » , déverbal de gagner (gaigner) désignait bien ce que l’on gagne et s’appliquait donc à la saison qui suit l’été (voir aussi le « regain » si cher à Jean Giono), caractérisée par son abondance.
Les dictionnaires ne nous disent pas pourquoi on est passé de ce sens positif à celui négatif de déclin, de mort annoncée. Là où les hommes de l’Antiquité et du Haut Moyen-âge ne voyaient que récompense ou don gratuit, ceux qui les ont suivis n’ont plus vu que l’idée de mort lente. Les mentalités avaient-elles changé ? Le Christianisme culpabilisateur avait-il fait son œuvre ? Le climat du Nord de la Gaule, si différent des hivers romains cléments explique-t-il cela ? C’est l’histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine en fait. Les Anciens regardaient derrière eux et voyaient dans l’automne le résultat concret de leurs efforts antérieurs tandis que leurs successeurs avaient déjà les yeux tournés vers l’hiver qui s’approchait inéluctablement.
Il est vrai que la chronologie antique était cyclique : de même que les saisons revenaient d’année en année, l’Histoire elle-même était circulaire, chaque civilisation passant régulièrement par un Age d’or suivi de périodes plus sombres. Dans le Moyen-âge chrétien, au contraire, le temps est devenu linéaire. Dieu a créé l’homme et celui-ci doit vivre sur terre un certain nombre de siècles avant la fin du monde et le grand jugement de l’Apocalypse. L’être humain n’est plus que de passage en quelque sorte et il a les yeux tournés vers sa mort prochaine. Il voit donc dans l’automne l’annonce de cette fin qui s’approche et il la souhaite autant qu’il la redoute. Comme Chrétien il espère en finir au plus vite avec cette vie terrestre et il aspire au Royaume de Dieu, mais comme être humain, évidemment, il voit avec angoisse approcher sa propre fin. Dans tous les cas, il ne voit plus dans l’automne que le commencement d’un déclin inéluctable et plus du tout cette saison belle, aux couleurs chatoyantes, qui remplit nos greniers et nous empêche de mourir de faim une fois l’hiver venu.

Photo personnelle
07:00 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : automne, étymologie
18/08/2011
De la route que l'on suit.
Nous nous sommes penchés, l’autre jour, sur l’étymologie des mots « chemins » et « marche ». Voyons maintenant quelle est l’origine du terme « route ».
La route (XVI° s.) ou « rote » (XII° s.) vient du latin populaire « rupta », substantif issu du participe passé de rumpere (briser, ouvrir) que l’on retrouvait dans l’expression « via rupta » autrement dit la voie ouverte. L’idée initiale était donc d’ouvrir un passage (à travers une forêt par exemple, ou une montagne). Par la suite, le mot a désigné une voie de communication de première importance (ce qui exclut les voies urbaines ou rues, qui elles sont locales). De là dérivent des expressions comme « barrer la route », « feuille de route » ou encore « faire de la route ».
Employé par métaphore pour désigner la voie que l’on suit, le mot « route » a pris le sens de moyen utilisé pour parvenir à son but : « la route du succès », « être sur la route de quelqu’un », « être sur la bonne route », etc. Notez que « faire fausse route » s’appliquait initialement au domaine maritime, mais dans son sens abstrait il est envisagé aujourd’hui dans un contexte purement terrestre.
Le mot route a fini par désigner les communications et les échanges entre certains points du globe : la route de la soie, la route du rhum.
Notons qu’il existait un verbe « router » (XIV° s.), qui était intransitif et qui voulait tout simplement dire « marcher ». On le retrouve toujours dans des dialectes comme le wallon. Dans l’Ouest, on retrouve aussi le dérivé « routin », pour désigner un petit chemin.
Notre mot « routine », vient bien évidemment de « route » (au sens figuré de moyen, ligne de conduite). Il a d’abord évoqué un savoir-faire acquis par une pratique prolongée mais il a fini par prendre le sens d’action accomplie par habitude. D’où le sens péjoratif contemporain : habitude d’agir, de penser toujours de la même manière.
Et les « routiers », me direz-vous ? Le terme est ancien et n’a pas toujours désigné les conducteurs de camions, ceux-là qui nous effraient sur les autoroutes avec leurs mastodontes. Non, ce mot, on le rencontre déjà au XII° s. avec le sens de « valet d’armée ». Un peu plus tard, on le retrouve (mais au pluriel cette fois) pour désigner des soldats irréguliers organisés en bandes qui pillaient les provinces. Le sens était donc plus ou moins celui de « voleur de grand chemin ». C’est de ce sens que viendrait l’expression « un vieux routier » (homme habile, expérimenté, qui a beaucoup voyagé).
Vous me suivez toujours ?
07:00 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : route, étymologie
09/08/2011
Sur les chemins...de la langue
« Partir sur les chemins » disais-je l’autre jour….
Ce qui nous renvoie à la première activité de l’homme. Dès la préhistoire, l’homme se déplaçait et marchait. Nos ancêtres étaient d’ailleurs des chasseurs-cueilleurs non sédentarisés et la marche était l’essence-même de leur vie. Ils devaient se déplacer pour survivre et tenter de trouver en d’autres endroits les aliments nécessaires à leur organisme.
Le chemin est aussi vieux que la marche et donc aussi vieux que l’homme.
Ce qu’on sait moins, c’est que le mot « chemin » est lui-même très ancien. Il provient du latin populaire « camminus », lequel trouve son origine dans un mot celtique qui a laissé des traces dans les langues romanes. (italien cammino, espagnol camino, portugais caminho). On peut supposer que le gaulois a survécu plus longtemps dans les campagnes, celles-ci étant habituellement moins ouvertes aux influences extérieures, par leur isolement-même. Il ne faut pas perdre de vue non plus le bon sens des gens qui y habitent, généralement peu enclins à suivre les modes nouvelles et préférant répéter inlassablement des gestes anciens qui ont fait leurs preuves. On peut donc imaginer que les citadins parlaient déjà le latin tandis que dans les campagnes le celtique était encore bien vivace (un peu comme les patois d’oc ou d’oïl, qui survivent toujours aujourd’hui dans les régions rurales).
Rien d’étonnant non plus à ce que ce soit le langage des paysans qui nous ait donné le mot « chemin », car si la ville est un lieu clos et exigu où on demeure immobile, en dehors des murs qui la circonscrivent, dans les terres sauvages et infinies qui la bordent, on se déplace et on marche.
On opposera donc le « chemin » (voie tracée dans la campagne) à la « rue », propre à la ville. Si cette dernière est bordée de maisons, le chemin au contraire n’est qu’un simple passage dans l’immensité de la nature. Le monde citadin est celui de la culture, tandis que le chemin appartient encore à la nature. C’est à peine s’il renvoie discrètement à une activité humaine. En terre, bordé de végétation, parfois difficilement praticable, il suggère simplement la présence des hommes qui sont passés là avant nous. Des hommes dont nous ne savons rien, que nous n’avons jamais rencontrés et que nous ne rencontrerons peut-être jamais. En ville, dans une rue, je suis avec les hommes. Sur un chemin, je suis seul dans la nature, mettant simplement mes pieds là où un de mes semblables, un jour, a déposé les siens.
Le mot chemin a donné différentes expressions : chemin de ronde, voleur de grand chemin, se mettre en chemin, à mi-chemin, chemin faisant, le chemin de la vie, faire son chemin, le droit chemin, etc. Personnellement, celle que je préfère, c’est « chemin de traverse », car là il s’agit de sortir des sentiers battus pour suivre une voie anormale, insolite, parallèle ou non à la voie principale.
Du chemin, passons à la marche. Le terme « marche » provient du francique « markhon » (marquer, limiter, mettre une marque, une borne). La « marche », c’est donc d’abord une frontière, une limite, comme dans l’intitulé de ce site « Marche romane » (une région de frontières, quelque part aux limites de la Romania). Quant à « marcher », lui, son sens premier en ancien français est celui de « fouler aux pieds », de « mettre le pied sur » Par exemple, dans l’expression « marcher sur les pas de ». De là, on passe à l’idée de se mouvoir, de se déplacer. Ensuite, au XVII° siècle, on appliquera ce verbe au fonctionnement d’un mécanisme (cette montre marche bien) ou d’une affaire (ses affaires marchent bien).
Le déverbal « marche » (d’un escalier) renvoie au sens premier puisque c’est la partie de l’escalier sur laquelle on pose le pied (le vieux mot « degré » s’en est du coup trouvé supplanté). Le sens actif (action de se déplacer) n’est attesté qu’à partir de 1508, nous dit le Robert historique (qui vaut décidemment tous les romans). Il s’applique d’abord aux déplacements des troupes (d’où l’expression « en ordre de marche » ou encore le terme « marche militaire » qui désigne un morceau de musique qui incite à la marche). Il faudra attendre le XVII° siècle pour que notre mot « marche » désigne le déplacement d’un groupe de personnes.
Eté 2011, photo personnelle

07:00 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : étymologie, marche, chemin
14/02/2011
De l'origine des mots (suite et fin)
Nagier : n’a pas le sens de « nager » comme on pourrait le croire naïvement. En effet, jusqu’au XVIe siècle ce verbe, qui vient du latin « navigare »signifiait « aller en bateau ».
Il nagierent tant qu’il ariverent desox le cite de Cartage, et quand Nicolete vit les murs del castel et le païs, ele se reconut, qu’ele y avoit esté norie et pree petis enfes ,mais ele ne fu mie si petis enfes que ne seust bien qu’ele avoit este fille au roi de Cartage et qu’ele avoit este norie en le cite. (« Aucassin et Nicolette, ch XXXVI »)
Ceci dit, je ne suis pas trop d’accord avec cette date du XVIe siècle que donne Dufournet car en cherchant chez Montaigne, je retrouve bien notre sens actuel de nager :
Il avoyt cette mesme opinion que la science de nager estoit tresutile à la guerre et en tira plusieurs commoditez : s’il avoyt à faire diligence, il franchissoit ordinairement à la nage les rivières qu’il rencontroit. (Livre II, chapitre XXXIV)
Le Robert historique, quant à lui, donne la date du XIIe pour la première apparition du sens moderne. Nager se met alors à concurrencer « noer » (nager) qui s’emploie, lui, effectivement jusqu’au XVIe siècle. Ce « noer » était issu du latin « notare », lui-même provenant du latin classique « natare » (cf. « natation » aujourd’hui). La proximité formelle avec « noyer » explique sans doute la disparition de ce verbe « noer » au profit de « nager ». Mais il y avait aussi une collision homonymique avec un autre verbe « noer », qui lui signifiait « nouer, faire un noeud » « Noer » ne pouvait donc survivre et « nagier » s’est imposé.
Mais du coup, cette nouvelle signification de nagier (se déplacer dans l’eau sans couler) a rendu difficile son emploi dans le sens premier (naviguer, voyager sur la mer). Pour ce faire, on a donc recréé un mot à partir de « navigare » et c’est notre « naviguer » (écrit « naviger » dans un premier temps).
Notons que « nager » au sens de naviguer demeure dans l’expression « nager entre deux eaux » qui signifiait en fait « refuser de s’engager ».
Notons aussi que Nagier (naviguer) a pu prendre, assez logiquement, le sens de « ramer », ce que l’on retrouve aujourd’hui dans l’expression « nager sec ».
Ce qui est sûr (et la Dufournet et el Robert historique tombent d’accord), c’est qu’au XVIe, en effet, « nager » s’est définitivement imposé définitivement dans son sens actuel. Petit à, petit, des expressions vont en élargir le sens, comme « nager dans son sang » (XVIIe) ou « nager dans un vêtement » (XVIIIe).
Travailler : ce verbe avait le sens de « torturer, tourmenter », sens qu’il a conservé jusqu’au XVIe siècle. Il a alors remplacé « ouvrer », que nous avons encore dans des expressions comme « du fer ouvré », « un jour ouvrable » (jour où l’on travaille) et bien entendu dans notre substantif « ouvrier ». Le vieux verbe « ouvrer » venait lui du latin « operare » qui avait donné dans un premier temps « obrer » après la chute de la voyelle avant de devenir « ovrer » (cf. œuvre, œuvrer, etc.), puis ouvrer. Mais une confusion était possible avec le verbe « ouvrir » et c’est pour cela qu’il a été remplacé par «travailler ».
Remarquons qu’une composition savante, à partir du latin « operare », a donné « opérer ».
Mais revenons à notre verbe « travailler. Il provient du latin populaire « tripaliare » autrement dit torturer avec un trepalium (instrument qui servait à ferrer les bœufs). L’idée était bien celle de souffrance infligée et on l’employait pour parler des condamnés qu’on torturait mais aussi pour les douleurs ressenties par une femme qui accouche (dont on dit aujourd’hui qu’elle est en plein travail). Mais dès l’ancien français le verbe travailler a pris la signification d’une transformation acquise par un effort. En moyen français, l’idée de transformation efficace l’emporte sur celle de fatigue ou de peine et petit à petit le sens actuel s’impose (accomplir une action, réaliser quelque chose pour gagner sa vie).
Ce qu’il y a de remarquable, dans tous les exemples que nous avons vus dans cette rubrique, c’est cette disparition des verbes qui possédaient une forme trop proche de verbes ayant un sens complètement différent. Petit à petit, la langue s’est adaptée en éliminant les « doublons » et les formes trop rapprochées qui prêtaient à confusion. Personnellement, j’en retiens la leçon suivante : la langue que nous connaissons aujourd’hui et qui, depuis le XVIIe siècle est bien équilibrée, n’a pas toujours été ainsi. Il est des époques beaucoup plus troubles. Certains auteurs hésitent sur les termes à employer et ils le disent parfois. La clarté et la précision que nous connaissons aujourd’hui signifie que la langue a atteint un équilibre. Mais tout équilibre est précaire et provisoire. L’ancien français avait mis du temps pour passer des déclinaisons latines au système à deux cas puis finalement au système prépositionnel. Cet équilibre était à peine atteint que l’évolution rapide de la langue orale a débouché sur le moyen français, lequel s’est encore transformé jusqu’à notre français d’aujourd’hui. Respectons donc notre langue, ne la maltraitons pas. Les périodes d’équilibre sont souvent le fruit de plusieurs siècles d’effort.
Crédit photo : Azurs point net http://www.azurs.net/
00:52 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (6)
11/02/2011
De l'origine des mots (encore et toujours)
Avaler : ce verbe désigne tout d’abord l’idée de descendre, d’aller vers le « val » (cf. l’expression « aller par monts et par vaux », donc des sommets vers la vallée, autrement dit un peu partout). De l’idée de « descendre », avaler est passé à celle de « faire descendre », puis, par restriction sémantique, on en est arrivé à notre sens actuel : « faire descendre un aliment dans le gosier ».
Par le cuerbé : ce juron n’a rien à voir avec le corbeau (latin « corvus »), comme on pourrait le croire. Le « bé » qui termine le mot est une déformation de « Dé » autrement dit de Dieu. Par le cuerbé, c’est donc « par le cœur de Dieu ». De la même manière nous avons « corbleu » (par le corps de Dieu), morbleu (par la mort de Dieu), palsambleu (par le sang de Dieu). Pour ceux qui aiment les gros mots, je les renvoie à la chanson de Brassens « La Ronde des jurons », où en en trouve de toutes les sortes :
Tous les morbleus, tous les ventrebleus,
Les sacrebleus et les cornegidouilles,
Ainsi, parbleu, que les jarnibleus
Et les palsambleus,
Tous les cristis, les ventres saint-gris,
Les par ma barbe et les noms d'une pipe,
Ainsi, pardi, que les sapristis
Et les sacristis,
Sans oublier les jarnicotons,
Les scrogneugneus et les bigree et les bougree,
Les saperlottes, les cré nom de nom,
Les peste, et pouah, diantre, fichtre et foutre,
Tous les Bon Dieu,
Tous les vertudieux,
Tonnerre de Brest et saperlipopette,
Ainsi, pardieu, que les jarnidieux
Et les pasquedieu
Ah Brassens… J’en profite pour signaler que chaque semaine, sur le site de Bertrand Redonnet, on peut lire des extraits du livre qu’il avait consacré autrefois à ce poète-troubadour. Mais qu’on ne vienne pas m’accuser ici de plagier son blogue, comme je l’ai ouï dire. Cornegidouille (juron inventé par Jary dans Ubu Roi), on ne pourrait donc plus parler d’étymologie sans se retrouver avec un procès d’intention sur le dos sous prétexte qu’ailleurs, autrement dit en Pologne (« La scène est en Pologne, c’est-à-dire nulle part » comme disait le même Jary), une connaissance s’amuse également à jouer avec les mots ? « Honni soit qui mal y pense » (comme disait un roi angloy, en parlant, lui, de la jarretière de la mariée).
Puisque nous évoquions plus haut le corbeau, parlons-en. Le mot vient de « corbiaus » et est issu du latin populaire corbellus. Celui-ci est un diminutif de corbus, lequel avait donné de son côté « corp » au singulier et cors au pluriel, mais ce terme a finalement disparu au profit de notre corbeau, sans doute pour éviter la confusion avec « corps » ou « cor ».
Corbus lui-même était issu du latin classique corvus.
Le sens a évolué. Ainsi, par analogie avec le bec de l’oiseau, le mot corbeau a désigné en architecture une grosse pierre en saillie et qui sert à soutenir une partie qui dépasse (« encorbellement»). Il faut attendre la XIXe siècle pour voir le mot corbeau prendre différents sens négatifs (liés à la couleur noire de l’oiseau) et désigner tantôt un prêtre, tantôt un croque-mort, tantôt un homme sans scrupule et finalement un auteur de lettres anonymes.
Gésir : en ancien français, ce verbe signifiait aussi bien « être couché » que « être en couches, accoucher ». On fait là plutôt allusion à la position couchée de la jeune mère, après ses couches, plutôt qu’à la position adoptée pendant l’accouchement proprement dit. En effet, si je me souviens bien de mes lectures, au Moyen Age les femmes accouchaient plutôt debout ou accroupies.
Es canbres la roine : dans la chambre de la reine. On remarquera la construction du complément du nom (ancien génitif) qui pouvait encore se faire sans préposition au début du XIIIe siècle. On disait donc « le cor le conte » et « le fix le conte ».
Oïl : adverbe d’affirmation qui provient de « o » et il (pronom personnel de la troisième personne du singulier). Mais on avait aussi oie (o + ie, c’est-à-dire « je »). En Occitanie, on avait évidemment la forme « oc » (du latin « hoc », cela. Le sens était donc « oui, c’est cela »).

07:00 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (14)
07/02/2011
De l'origine des mots (suite de la suite)
Errer : il existe deux verbes « errer » en ancien français. Un qui vient du latin « iterare » et qui signifie, aller, cheminer, marcher et un autre qui provient de « errare », se tromper, s’égarer (voir « erreur » et « erroné » en français moderne). De la famille du premier, il ne subsiste que des expressions souvent mal comprises comme « chevalier errant » (qui s’en va à l’aventure) ou Juif errant (condamné à marcher sans fin).
Cière ou chière : ce mot désignait le visage (latin « cara »). « Faire bonne chère », c’était donc accueillir les gens avec un visage souriant. De là, forcément, le mot a été employé pour désigner un accueil chaleureux, puis le bon repas que cela impliquait souvent.
La prime était une subdivision temporelle de la journée. Cette division, qui est restée dans le langage ecclésiastique, remonte en fait aux Romains, qui avaient divisé en 12 heures la durée qui va du lever au coucher du soleil. « Prime » est donc la première heure du jour (6 heures du matin). La haute prime, c’est quand l’aube est déjà bien passée, soit à 8 heures. La « tierce » ou troisième heure correspond donc à 9 heures du matin. La « none » ou neuvième heures correspond à 15 heures (6 + 9 = 15). Quant à la « sieste », ou 6° heures, elle désigne donc midi (6 + 6 =12). Le terme est resté pour désigner le petit somme que l’on fait à midi après le déjeuner.
Se partir : toujours utilisé à la forme réfléchie dans Aucassin et Nicolette, ce verbe signifiait « séparer, diviser, partager ». Il nous reste l’expression « avoir maille à partir », la « maille » étant une petite monnaie sans grande valeur. Il s’agissait donc de diviser entre plusieurs personnes une piécette qui ne valait déjà pas grand-chose en elle-même, ce qui ne manquait pas de provoquer des querelles. A la fin du Moyen Age, « se partir » a signifié « s’en aller, se séparer de quelqu’un » (le sens n’est donc plus un objet que l’on divise, mais une personne dont on se sépare), de là notre « partir » qui signifie s’en aller. On retrouve donc des mots comme « départ » et « en partance » qui véhiculent l’idée de départ et des mots comme « partage », « part », « partie », qui conserve l’idée de partager.
Souple (du latin supplex, supplicis, qui plie les genoux en suppliant les dieux) désignait au Moyen Age une personne humble puis finalement une personne triste, abattue. A partir de « humble », le sens à glisser à « qui se plie facilement », car celui qui demande et implore n’est pas en position de force et doit forcément faire des concessions. Aujourd’hui, souple désigne des objets qui plient avec facilité.
Notons que le terme « supplice » vient lui aussi de « supplex », ce qui peut se comprendre car celui qu’on torturait avait tendance à implorer sa grâce à genoux .
08:12 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (8)
05/02/2011
De l'origine des mots (suite)
Uis (ou huis), que l’on retrouve dans « huissier » et « juger à huis clos », désignait la porte de la demeure, tandis que le mot « porte » était réservé aux grandes portes des villes, qui s’ouvraient dans les remparts.
Noise : bruit, querelle. Du latin « nausea » (mal de mer, d’où « nausée »), le mot prend le sens de situation désagréable et pénible. De là, il dérive vers le sens de « querelle », celle-ci étant par définition bien peu agréable. En français moderne, on trouve l’expression « chercher noise à quelqu’un ».
Traire : le sens premier était « tirer, tirer vers, se diriger ». Le mot a connu une restriction sémantique évidente puisqu’il ne signifie plus que « tirer le lait d’une vache, d’une brebis ou d’une chèvre. Les linguistes expliquent cela par une collision homonymique entre « moudre » le grain (du latin molere) et un autre « moudre », qui signifiait traire (du latin mulgere). Pour éviter la confusion entre les deux « moudre » on a employé de préférence le verbe « traire » quand il s’agissait de tirer le lait des vaches et « tirer » a donc pris la place de ce dernier verbe dans le sens général qui était le sien initialement.
Destrier (cheval de combat). Le terme vient du mot « dextre » car l’écuyer le tenait à droite quand il n’était pas monté. N’oublions pas que le contraire de dextre était « senestre », (gauche – latin sinister-) qui a donné sinistre.
Sengler : sanglier. En fait, c’est le porc solitaire, le « porcum singularem »). Ici, c’est l’adjectif « singularem » qui a prit la place du substantif pour désigner l’animal, puis le suffixe en « er » a été remplacé par un autre en « ier ». Notons qu’en patois on retrouve « sainguié » (Meurthe-et-Moselle), « sanler » (Morvan), singlé (wallon) sanglire (Languedoc), singlar (Midi), singuié (Vosges), etc. Le féminin « sanglière » a existé en ancien et moyen français puis a disparu au profit de « laie ». C’était pourtant joli, la sanglière, non ? Personnellement, j’ai toujours un peu de nostalgie pour tous ces mots qui ont existé et qui n’existent plus, même si je ne les ai pas connus. On touche là du doigt la potentialité extraordinaire de la langue, qui, devant le foisonnement qui s’offrait à elle, a finalement taillé, découpé et réduit. La belle forêt vierge est devenue un parc policé.

01:42 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : ancien français
03/02/2011
De l'origine des mots
Parmi les lectures de ces dernières semaines, citons « Aucassin et Nicolette » , célèbre chantefable du Moyen Age. Voilà un livre qui ne relève pas vraiment de l’actualité éditoriale, me direz-vous, mais qui traite gentiment de la passion amoureuse, de manière guillerette et sans jamais être lourd ni pesant. La langue, celle du début du XIII° siècle, se comprend relativement facilement, en tout cas j’ai connu des textes plus ardus. Mais si je parle de tout ceci ici, c’est pour les notes de Jean Fourniret, qui complètent le livre dans la collection Garnier-Flammarion. Des notes axées sur la langue, évidemment, et qui nous font mieux comprendre le sens caché des mots que nous employons quotidiennement. Car la langue vient de loin, de très loin, même, et nous avons trop souvent perdu de vue le sens premier, que nous ne percevons plus que de manière intuitive ou inconsciente. Voici quelques exemples.
Valet : c’est un adolescent de famille noble qui sert à la cour d’un grand pour apprendre les armes. Il portera les armes du seigneur, l’aidera à revêtir sa cuirasse, se verra chargé d’un message important à aller transmettre, etc. C’est l’idée de jeunesse qui prime. Dès lors, le terme a pu s’employer pour désigner un adolescent non noble, puis, finalement, c’est le sens « d’être au service de » qui a prévalu. Notons qu’en patois wallon, valet désigne le fils (l’idée de jeunesse est donc restée par archaïsme). Dans le Poitou, on dit « drôle » et « drôlesse »… Comme quoi il n’y a rien de plus amusant que d’étudier la langue.
Caitive : autrement dit, captive, prisonnière. De là, le terme a pris le sens de « malheureuse, misérable », ce qui se comprend aisément. Ensuite, par restriction sémantique, la langue en a limité l’emploi à « de faible constitution », autrement dit chétive. Captif et chétif ont donc le même étymon.
Estrange : pouvait signifier en ancien français à la fois « étranger » et « étrange », (comme messager pouvait désigner le message ou la personne qui portait le message). Cette confusion n’était pas fort pratique, c’est pourquoi on a utilisé le suffixe « er » pour différencier les termes : étrange/étranger et message/messager.
France (= franche) : au départ le terme désigne l’ethnie des Francs, puis il a pris le sens de « libre » en désignant les nobles, puisque c’était l’aristocratie franque qui dirigeait le peuple gallo-romain (d’où des expressions comme « avoir les coudées franches » ou le « franc arbitre », le « franc parler », etc.). Ensuite, au sens social s’est ajoutée l’idée de noblesse morale.
Maleoite ou maldite (maudite) est l’antonyme de benoite (bénie ou bénite), lequel survit dans le prénom Benoît et dans les adjectifs benoît (bon, doux voire même doucereux) et benêt. Aujourd’hui, il n’est pas si évident que cela de se rendre compte que béni (idée de bien) est l’opposé de maudit (idée de mal), tant le sens religieux a prévalu dans le premier terme.
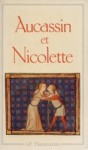
07:00 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (2)
31/05/2009
Maurice Grevisse
L'autre jour, Solko avait consacré une note à Maurice Grevisse, le trouvant trop laxiste. Il n'a pas tort, mais j'ai envie de lui faire remarquer que les grammairiens font de la linguistique synchronique, ce qui signifie qu'ils donnent un état de la langue à un certain moment (en l'occurrence le français qui se parle de leur vivant). Ils sont donc « coincés » entre des règles et une tradition d'un côté et une langue qu'ils voient évoluer sous leurs yeux de l'autre.
Tant que ce n'est que le peuple qui commet une faute en ne respectant pas les règles, le grammairien peut sanctionner. Le problème de Grevisse, c'est qu'il s'est appuyé sur les « bons auteurs » pour trouver une légitimité à ce qu'il disait. Ceci traduit d'ailleurs une certaine admiration pour les écrivains et relève encore d'une conception proche de celle du XIX° siècle où on attendait encore de quelqu'un comme Hugo qu'il puisse, mieux que le commun des mortels, s'exprimer correctement.
Mais à partir du moment où Grevisse s'appuie sur le corpus littéraire pour légitimer ses règles grammaticales, il doit lire les auteurs qui lui sont contemporains. Forcément. Son but n'est pas de donner un aperçu de la langue de Molière mais de celle qu'on parle de son temps à lui. Et voilà qu'il découvre qu'une série non négligeable d'auteurs célèbres et reconnus font des fautes. Il ne peut donc que rappeler la règle première et constater que celle-ci perd de son autorité puisque même de « bons auteurs » ne la respectent plus ou ne la connaissent plus.
Quelque part donc, Grevisse tente encore d'imposer une règle ancienne tout en signalant qu'il ne faut plus trop se faire d'illusion et que la langue évoluant naturellement, il suffira d'une génération encore pour que cette règle apparaisse comme désuète.
Que devait-il faire ? Dans la note qu'il lui consacre, Solko lui jetait la pierre. Je le comprends quelque part. Mais d'un autre côté, je me dis que si Grevisse avait refusé cette ouverture vers une évolution inéluctable de la langue et s'était contenté d'affirmer des règles avec autorité, il aurait peut-être commis une faute, professionnellement parlant. En effet, en agissant de la sorte, il aurait fait comme si la langue ne devait plus évoluer. Or, malheureusement (ou heureusement), elle évolue.
On sent bien, quand on étudie un peu l'ancien et le moyen français, qu'une langue n'a pas toujours atteint son point d'équilibre. Alors que le latin classique permettait d'exprimer des idées complexes avec aisance, on remarque chez les écrivains de ces périodes intermédiaires une sorte de flou donc ils sont eux-mêmes conscients. Ils disent souvent qu'ils essaient d'exprimer au mieux ce qu'ils ont à dire avec la langue imparfaite dont ils disposent, langue qui n'est encore régie par aucune règle. C'est qu'il a fallu un certain temps pour passer des déclinaisons à six cas du latin (nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif) à une déclinaison à deux cas en ancien français (cas sujet et cas régime-complément) :
Singulier :
li murs (cas sujet), d'après murus, muri, le mur. On remarquera la chute de la voyelle
le mur (cas régime), d'après l'accusatif murum
Pluriel :
li mur (cas sujet), d'après muri
les murs (cas régime) d'après muros
C'est donc à partir du cas régime que le français s'est formé puisqu c'est là qu'on trouve la distinction entre le singulier sans « s » et le pluriel avec « s ».
Mais à peine un équilibre était-il trouvé avec l'utilisation de ces deux cas que la langue a continué d'évoluer naturellement vers plus de simplification encore pour arriver à ne plus posséder qu'un seul cas. Il fallut alors remédier à cette lacune par l'utilisation généralisée des prépositions (afin d'indiquer tout de même la fonction des noms : il parle « à » son ami, il vient « de » Paris, il va « à » Paris, etc.), ce qui demanda de nouveau un certain temps.
Il faut attendre le XVI° siècle pour que la langue trouve enfin son vrai souffle. Polie ensuite par les grammairiens du XVII° siècle (qui reprenaient, eux, l'usage de la Cour), elle atteint alors sa plénitude. Depuis, malheureusement, elle a quitté ce fragile point d'équilibre pour se simplifier. Les subjonctifs imparfait et plus que parfait sont complètement sortis du langage parlé, ainsi que le passé simple. On pourrait donner des dizaines d'exemples où ce qui se disait avec nuance s'exprime maintenant plus pauvrement. Je suis le premier à le regretter car il y a là une perte. Mais je me dis aussi que si mes ancêtres avaient raisonné comme moi, on parlerait encore latin.
Avec la mondialisation galopante que nous connaissons, il est à craindre que l'anglais ne devienne la seule langue véhiculaire (et il prendra ainsi la place qu'occupait le latin autrefois). Mais quel anglais ? Pas celui de Shakespeare, évidemment, mais un sabir commercial fort approximatif. Cela me fait de la peine. Et d'un autre côté je me dis que notre belle langue française est issue du bas latin de la fin de l'Empire, une langue de marchands et de soldats, d'immigrés et de barbares. Alors tous les espoirs me semblent permis. Sauf qu'il faudra de nouveau mille ou deux mille ans pour retrouver une belle langue classique toute en finesse. N'est-ce pas le temps qu'il a fallu pour passer de Cicéron à Corneille et Racine ? C'est sans doute pour cela que Solko en veut à Grevisse. Mais le pauvre homme pouvait-il faire autre chose que ce qu'il a fait ? Pouvait-il, à lui tout seul, arrêter l'évolution du monde ?

00:19 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : langue française, grevisse
03/04/2009
Mes aïeux!
Quelques lecteurs hier se sont mis à rêver sur le mot espagnol «abuela», la grand-mère et c’est vrai que ce terme a quelque chose de calme et de doux qui enchante l’âme. Du coup, intrigué, je me suis demandé quel en était l’étymon et après quelques recherches googelesques (ou googeliennes si vous préférez) j’ai trouvé, à ma grande surprise, que ce mot est apparenté à notre terme français «aïeul», ce qui ne saute pas aux yeux.
Abuelo (le grand-père) vient du latin «avus » (l’adjectif «avitus» existe aussi). A ce mot, on a joint un diminutif, sans doute pour exprimer l’affectivité et «avus» est devenu «aviolus». Le mot a ensuite évolué différemment selon les langues romanes et est devenu dans le Berry, aïol, en provençal aviol, en espagnol abuelo et en italien avolo.
En français, c’est l’accusatif d’aviolus, autrement dit aviolum qui a donné aviol puis aiol (plus facile à prononcer) au XIII° siècle et puis finalement aïeul au XVI° siècle.
En outre, il y aurait eu un étymon indo-européen antérieur à cet «avus».
Le Robert historique nous enseigne que le mot originel latin, «avus» ne désignait pas un terme de parenté mais qu’il était plutôt une appellation familière à l’égard d’un ancien du groupe, ce qu’on retrouve peut-être encore dans notre terme «aïeux» qui désigne les ancêtres en général, par opposition à «aïeuls», qui désigne directement les grands-parents (comme nous le rappelle Grevisse cette fois, dans son incontournable «Bon usage»).
Le vrai pluriel, le pluriel étymologique, est «aïeux» (d’après l’accusatif pluriel devenu le cas régime en ancien français). Ce n’est qu’au XVII° siècle qu’on aurait reformé le pluriel «aïeuls» d’après la forme du singulier. Ce qui est amusant, c’est de voir l’alternance du sens au cours des âges. Alors que le «avus» latin désignait plutôt l’ancien du groupe, «aviolus», avec son diminutif affectif, faisait bien, lui, allusion au grand-père. Pourtant, au XIII° siècle, c’est de nouveaux le sens d’ancêtres qui prédomine. Ce n’est finalement qu’au XVIII° siècle que la distinction actuelle (aïeux = ancêtres/aïeuls = grands-parents) s’est établie. Elle est finalement logique : le mot au pluriel désignant un grand nombre de personnes, c’est évidemment à l’ensemble des ascendants, autrement dit les aïeux, que l’on pense. Le singulier aïeul, quant à lui, ne pouvait que désigner le grand-père tout proche. Puis, comme on a en principe deux grands-pères et deux grands-mères (mais ce ne fut pas mon cas), on a dit « les aieuls » pour les désigner.
Notons encore, pour être complet, que le dérivé «avunculus» a donné le mot français «oncle».
Mais revenons à notre «abuela» initiale. Le mot castillan désigne la grand-mère, mais aussi une vieille femme en général. L’expression «cuentaselo a la abuela», familière, signifie « à d’autres ! ». «Habersele muerto a uno su abuela» signifie «être vantard», de même que «no tener uno abuela», un peu sans doute comme si l’absence de la grand-mère, qui symbolise la raison et la mémoire de la famille, permettait de divaguer et d’inventer n’importe quoi.
A côté de «abuela» existe le terme «abuelita», encore plus mignon avec son diminutif affectif. Le dictionnaire ne le traduit pas par grand-mère, mais par bonne-maman, ce qui est en effet plus intime. Ce qui est amusant, c’est qu’en Amérique (du Sud, évidemment car notre monde roman s’étend jusque là, devant le grand Pacifique) où on sait que les mots espagnols prennent parfois un autre sens, éloignement oblige, cette «abuelita» peut désigner un berceau ou un bonnet d ‘enfant. De l’aïeule, on passe à la toute dernière génération, peut-être parce que ce sont souvent les grands-mères qui s’occupent des petits-enfants.
Enfin, nous sommes partis de l’Etat du Texas, aux Etats-Unis, avec Mac Carthy et ses si jolis chevaux et nous revoilà en Amérique du Sud après avoir traversé l’Espagne et avoir parlé du Moyen-Age français et du latin de Rome. Comme quoi le temps et l’espace sont devant nous dès qu’on ouvre un livre.

Source
00:07 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : langue française, abuela
19/02/2009
L'école buissonnière
En cette période de vacances scolaires (pour certains) ou de presque vacances (pour d’autres), les salles de classe étant vides, il serait intéressant de se pencher sur l’expression «faire l’école buissonnière ». Celle-ci signifie, comme chacun sait, « ne pas aller au cours » mais quelle en est l’origine ?
L’explication la plus logique, c’est évidemment la référence au mot « buisson » : les élèves qui ne se rendent pas à l’école vont se promener dans les champs et se cacher dans les buissons, où leur présence passerait inaperçue. Selon certains, l’expression remonterait au XV° siècle, époque où on en aurait donné la définition suivante : « promenade dans les chemins creux ou parmi les buissons qui cachent les fuyards. »
Le problème, c’est que certains philologues proposent une autre explication.
L’expression trouverait son origine dans le fait que les prélats qui devaient se rendre au Concile de Pavie, en 1423, refusèrent de s’y rendre parce que la peste sévissait dans cette ville. Ils seraient donc restés dans la campagne environnante. Comme argument, ceux qui proposent cette interprétation avancent cette phrase de Clément Marot.
«Vray est qu'elle fust buissonnière, l'escolle de ceux de Pavie ».
D’autres pensent au contraire que l’expression daterait plutôt du XVI° siècle, époque où les protestants auraient créé des écoles secrètes (nommées buissonnières parce qu’elles se situaient dans les campagnes) afin d’éviter les écoles de la ville de Paris, qui étaient toutes entre les mains du clergé catholique. Si cette interprétation est la bonne, l’école buissonnière impliquait donc qu’on aille aux cours, mais le fait d’être absent des écoles officielles de Paris où les élèves auraient dû se trouver, permettrait de comprendre le glissement de sens.
Une petite recherche sur Google m’a permis de trouver deux expressions espagnoles pour désigner le même phénomène.
1. Hacer novillos (hacer = faire ; novillo = jeune taureau) : en Andalousie les élèves qui ne suivaient pas les cours préféraient aller dans les prés afin de toréer les jeunes taureaux et tenter ainsi d’accomplir leur rêve de devenir un jour des toréadors professionnels lesquels, soit dit en passant, sont souvent issus des classes sociales les plus pauvres car il faut être pauvre pour risquer ainsi sa vie à chaque combat dans l’espoir de conquérir la gloire et de devenir riche.
2. Hacer campana (en catalan Fer campana), autrement dit, « faire la campagne». On ne confondra pas ce mot « campaña » (avec une tilde sur le n) avec le même terme (sans tilde sur le n) qui signifie « cloche » en castillan (campanella en latin). Ici, c’est un mot issu directement du latin campus- campi (campagne cultivée, champ) ou de l’adjectif campañeus, ea, eum (de la campagne, champêtre). Cet adjectif au neutre pluriel (campanea) est devenu un substantif et a pris le sens de « champs ».
On ne confondra pas non plus ce « campaneus » avec le nom propre Campania, qui a désigné d’abord la Campanie, en Italie, puis une province gauloise, aujourd’hui la Champagne.
08:02 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : langue française, expression, école buissonnière
05/12/2008
Le calumet de la paix
Ne quittons pas encore l’Amérique. Une fois qu’ils eurent débarqué sur ce nouveau continent, les Européens se mirent à observer les mœurs des Indiens (avant de les massacrer). C’est ainsi qu’est passée en français l’expression bien connue « fumer le calumet de la paix ». Elle désignait donc la coutume des Indiens d’Amérique du Nord qui consistait à fumer avec ses ennemis pendant qu’on négociait la paix. Ce qu’on sait moins, c’est qu’il existait également un calumet de la guerre, qu’on allumait lors des négociations de la dernière chance. Ce qu’on ne sait pas du tout, c’est que ce calumet pouvait aussi avoir un usage thérapeutique, selon la sorte d’herbe qu’on y faisait brûler.
D’une manière générale, de toute façon, ce rituel relevait de l’art de l’hospitalité. Dans notre civilisation, boire un verre ou manger avec quelqu’un, lui faire partager sa table, est un signe de bienvenue, d’échange, d’acceptation. Refuser de se joindre au repas proposé fait office d’affront. Lévi-Strauss (fort à l’honneur ces derniers temps et fort justement d’ailleurs) a beaucoup parlé des manières de table dans ses «Mythologiques ». Préparer un repas, c’est introduire la culture (par la cuisson et tout le cérémonial qui tourne autour) dans la nature, autrement dit c’est affirmer la singularité de l’homme par rapport à l’animal.
Avant, c’était facile : Nul ne doutait que Dieu eût créé l’homme à son image. Ce dernier était donc un demi-dieu. D’ailleurs il occupait le centre de l’univers, à savoir la terre, autour de laquelle tournait le soleil. Une fois que cette vérité fut battue en brèche (après quelques difficultés d’ailleurs, voir par exemple la rétractation de Galilée ou la mort sur le bûcher de Giordano Bruno), l’homme n’était plus qu’un être parmi d’autres qui errait sur une planète emportée dans un cosmos infini. Bref, il devenait un animal comme les autres, ni plus ni moins et perdait toute spécificité. Et voilà qu’à ce moment on découvre là-bas, en Amérique, des sauvages dont le mode de vie se rapproche fort dangereusement de celui des animaux. Reflet d’une période historique révolue, ils offrent cependant à l’Européen le reflet de sa propre image à travers les siècles. Si certains s’extasient devant la pureté de ces sauvages innocents qui semblent vivre au paradis terrestre, d’autres comprennent l’importance de l’enjeu : à trop vouloir se rapprocher de la nature, on redevient animal. Et de brandir les deux grandes lois qui sont les fondements mêmes de l’humanité et de la culture : la cuisson des aliments et la prohibition de l’inceste.
Manger un aliment cuit, c’est donc se rattacher à la culture. Inviter quelqu’un à partager ce repas avec vous, c’est réaffirmer que l’on forme ainsi une petite société, où règne la sympathie et l’échange.
Ces sauvages qu’étaient les Indiens de l’Amérique du Nord le savaient aussi pourtant. Ils cuisaient leurs aliments et fumaient ce fameux calumet (de la paix ou de la guerre) qui symbolisait et résumait les intentions que les protagonistes avaient les uns envers les autres.
Objet de culture par excellence, le calumet, fait de bois décoré, de verroteries et de plumes, comportait un fourneau en pierre (rouge pour la paix, blanche pour la guerre).
Notons que ce mot « calumet »n’est pas d’origine indienne (comme « sachem » ou « tipi ») mais qu’il vient du mot français chalumeau via sa forme normande (ou picarde) « calumet », d’après le latin « calamus », roseau (voir « chaume »)
Comme toujours et comme nous l’enseigne la linguistique diachronique, le « ka » latin initial devient « ch » en français d’île de France (ex : capra donne chèvre) tandis qu’il reste « ka » en langue d’oc (capra donne cabra). Dès lors, « calamus » donne logiquement « chalumeau » en français tandis qu’on retrouve une forme « calumo » en Provence. Pour ce qui est du picard et du normand, c’est évidemment sous l’influence des parlers germaniques que le « ka » s’est maintenu. C’est que les mots eux aussi sont le fruit de bien des voyages. Il aura fallu les migrations et les invasions germaniques d’une part (avec leurs guerres et leurs massacres) et la découverte de l’Amérique d’autre part (avec là aussi des guerres et des massacres) pour que ce calumet arrive jusqu’à nous, symbole d’une paix sans cesse remise en question, comme nous le montre encore l’histoire contemporaine.

00:37 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (23) | Tags : langue française, calumet
27/11/2008
Origine du nom des pays d'Amérique latine
Nous avons longuement parlé de Vespucci, qui a donné son prénom à l’Amérique. Est-ce à dire que Colomb fut complètement oublié ? Pas vraiment, puisque son patronyme a été donné à la Colombie. C’est l’occasion de donner l’origine du nom de quelques pays d’Amérique latine.
Colombie :
Ce pays porta d’abord le nom de Nouvelle Grenade (Nueva Granada) étant donné que Grenade venait d’être reconquise sur les Arabes en 1492, l'année même de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb.
C’est Simón Bolívar qui lui donne le nom de Colombie en hommage au « grand amiral de la mer océane ».
Au départ, il s’agissait de la grande Colombie, qui englobait aussi le Vénézuéla et l'Équateur.
En Amérique du nord on retrouve la Colombie britannique (British Columbia), province canadienne, ainsi que le district de Colombie (District of Columbia) qui correspond en fait à, Washington, la capitale des Etats-Unis, laquelle ne fait pas partie d'un état.
Notons encore que l’origine du nom de Christophe Colomb (Cristobal el Colon) est le mot « columbus » en latin (pigeon)
Vénézuela :
Découvert le 2 août 1498 par Christophe Colomb, lors de son troisième voyage, à l'embouchure du río Orinoco, qui forme un delta. C'est la première fois qu'il met le pied sur le continent américain (lors de ses précédents voyages, il a découvert les îles des Antilles). Il nomme le pays Tierra de Gracia (Terre de Grâce). Ensuite, en 1499, Alonso de Ojeda découvre un golfe avec des maisons sur pilotis qui lui fait penser à Venise. Il nomme donc cette région « golfe de la petite Venise », autrement dit Venezuela. C’est sur le bateau de Ojeda que se trouvait, comme marchand, notre ami Vespucci.
Paraguay :
Le Paraguay est le nom d'une rivière. La capitale est Asunción, parce qu’elle aurait été fondée le jour de l'Assomption, le 15 août 1537, par Juan de Salazar, un des lieutenants de Pedro de Mendoza. Les Espagnols remontèrent le rio Parana puis le rio Paraguay, pour tenter de rejoindre le Pérou, où on croyait découvrir de l’or.
Uruguay :
L'Uruguay est le nom du fleuve frontalier qui sépare l'Argentine et l'Uruguay.
Bolivie :
La Bolivie doit son nom au vénézuélien Simon Bolivar (El Libertador – Le Libérateur), le héros de l’indépendance de l’Amérique latine. On sait qu’il souhaitait ne faire qu’un seul pays de tout ce continent. Notons que Bolivar est, à l’origine, le nom d’un village du pays basque (Bolibar en Biscaye). C’est de là que serait originaire l’ancêtre de Simon Bolivar. Le terme désignerait en basque la vallée du moulin (ibar/bolu).
Soulignons qu’en 1999, Hugo Chavez, le président du Venezuela, adopta une nouvelle constitution qui donna à son pays le nom de République bolivarienne du Venezuela.
Argentine :
Comme on s’en doute, le nom de ce pays vient du mot latin argentum signifiant « argent ». Ce sont les premiers explorateurs espagnols du Rio de la Plata qui lui donnèrent ce nom parce que les indigènes leur avaient offert des objets en argent. Ils furent bien mal avisés d’avoir ce geste de bienvenue…
Brésil :
Le brésil est un bois exotique qui, séché et pulvérisé, donne une matière tinctoriale rouge. A la fin du Moyen-Age, le « bois de braise » provenait des Indes via la Perse et c’étaient les Vénitiens qui en faisaient commerce. Au Brésil, les Portugais découvrirent des arbres « couleur de braise » (brasa en portugais) en si grande quantité qu’ils donnèrent ce nom au pays tout entier.
Chili :
L’origine du nom est incertaine :
Les conquistadors installés au Pérou auraient appelé le Chili « valle de Chile " probablement du nom d’une rivière.
Le nom pourrait aussi venir du nom d’un oiseau ayant des taches jaunes sur ses ailes (trih o chi)
Selon certains historiens, ce terme viendrait d’un groupe d’Amérindiens (les Mitimaes). Ceux-ci, capturés par les Incas, provenaient d’une région du Pérou où coulait un fleuve portant ce nom.
Equateur :
L’Équateur fut nommé ainsi à la suite d’une mission scientifique dirigée par Louis Godin (il s’agissait de mesurer un degré du méridien près de l’équateur).
Guyane :
Le Guyana signifierait « terre d'eaux abondantes » en langue indienne. Il est vrai que dans cette région, de nombreux fleuves coulent à travers la forêt tropicale.
D’autres spécialistes font remonter le terme au dialecte guanao (delta de l’Orénoque) où guai signifiait « nom », « dénomination », tandis que yana serait une négation. « Guyane » voudrait donc dire « sans nom », et désignerait une terre « qu'on n'ose nommer ». Pour nous tous qui sommes passionnés par les mots, cela semble assez incroyable et mystérieux. En quoi cette terre est-elle si mystérieuse pour qu’on n’ose pas la nommer ? Sans doute faut-il y voir une connotation religieuse : ce serait une terre sacrée, celle où séjourne les dieux. Il est vrai que l’épaisse forêt qui recouvre le territoire avait de quoi inquiéter les hommes vivant dans la région. De là à y voir le séjour des dieux, il n’y a qu’un pas.

13:48 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : langue française, amérique latine
16/11/2008
Devinette
Quel est l’auteur (il faut bien l’appeler ainsi, puisqu’il a écrit) qui a en tout et pour tout rédigé trente-deux pages dans sa vie, qui n’était ni romancier ni inventeur, mais employé de banque et qui, avec ces trente-deux pages (et surtout grâce au titre qui leur a été donné) est devenu mondialement célèbre, non seulement de son vivant, mais encore aujourd’hui. La preuve, c’est que nous prononçons son nom (ou du moins le nom qui a été formé à partir du sien) couramment.
Personne, dans l’histoire de l’humanité, n’a connu un tel succès avec une œuvre aussi mince. Pourtant, il faut reconnaître que ce qu’il a dit (car il a dit, il n’a rien fait) a bouleversé bien des croyances. A sa manière (et malgré lui), ce fut donc un révolutionnaire.

00:15 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (71) | Tags : langue française
15/10/2008
Quand les Normands encerclaient Paris

C’est le 14 octobre 1066 que le duc de Normandie Guillaume le Bâtard remporte la victoire d’ Hastings. C’est par cette bataille que la langue française va se répandre en Angleterre et va donc influencer la langue anglaise, comme on l’a déjà dit ici.
Il est intéressant de souligner que Guillaume, de par ses ancêtres, n’était pas français à proprement parler puisqu’il descendait en fait de Rollon, un chef viking qui s'était établi 150 ans plus tôt à l'embouchure de la Seine. Belle ironie de l’Histoire, donc, qui a fait que ce soit à un «étranger » qu’incomba la tâche d’aller diffuser notre langue outre-manche. Voilà une leçon que certains feraient bien de retenir.
L’origine de cet ancêtre, Rollon, n’est pas très claire. Certains le disent danois, d’autres norvégien. Ce qui semble plus sûr, c’est qu’il s’est attaqué aux côtes de la Mer du Nord et de la Manche. Il aurait ainsi ravagé la Frise ainsi que l’embouchure du Rhin et de l’Escaut. On situe son arrivée dans la « Francia » vers 876. Il s’installe à l’embouchure de la Seine qu’il remonte en organisant des pillages. Ainsi, il aurait participé au fameux siège de Paris de 885-886.

Statue de Rollon à Falaise
Cela faisait cinquante ans que la région comprise entre Paris et la mer connaissait ces attaques des hommes venus du Nord. Les faubourgs de Paris avaient d’ailleurs déjà été attaqués plusieurs fois, mais jamais l’île fortifiée de la cité. Cette fois-ci, cependant, les Vikings demandent l’autorisation de remonter la Seine plus en amont. Si cette faveur leur est accordée, la ville ne subira aucun dommage. Gauzlin, l’évêque de Paris, refuse et c’est le début des affrontements. Les remparts tiennent bon et les assaillants subissent de lourdes pertes. Pour se venger, ils pillent la région et décident de faire le siège de la capitale du royaume franc, lequel durera un an. A la fin, ayant reçu une importante somme d’argent de la part de l’évêque, Les vikings s’en vont conquérir la région de Bayeux.
La faiblesse des rois carolingiens à s’opposer efficacement aux Vikings leur sera fatale. En effet, le roi Charles III le Gros, qui revient de Germanie avec son armée (un peu tard), préfère à son tour payer une grosse somme d’argent plutôt que d’affronter militairement les envahisseurs. Il aurait même consenti à ce qu’ils remontent la Seine, contribuant ainsi à la mise à sac de la Bourgogne. Conséquence : il sera destitué peu après et les seigneurs français élisent comme roi le comte Eudes (le fils de Robert le Fort), qui lui s’était fait remarquer par ses prouesses pendant le siège de Paris.
Mais revenons à Rollon, qui semble donc bien avoir participé à ce fameux siège. Ce qui est sûr, c’est qu’il a conquis Bayeux et qu’il a pillé la Bourgogne. On sait qu’il a épousé (de force, ce qui nous fait réfléchir sur la triste destinée des femmes en temps de guerre) une certaine Poppa, fille du comte Béranger de Bayeux, que Rollon tua de ses propres mains. Il s’installe et commence à développer des alliances avec les autorités franques en place. On peut donc estimer que vers 910, il n’est plus le simple chef d’une bande de pillards, mais un seigneur établi sur ses terres.
Cela ne l’empêche pas de continuer de guerroyer, mais vers 910 il échoue à prendre Chartres. C’est à ce moment que Charles le Simple (roi carolingien de la Francie occidentale) négocie avec lui le traité de Saint-Clair-sur-Epte (911), qui permet à Rollon de s’installer définitivement dans une partie de la Neustrie (autour de Rouen). La condition de la cession de ces terres (le futur duché de Normandie) était que Rollon empêche l’arrivée d’autres envahisseurs nordiques. Le roi carolingien agit donc comme avaient agi avant lui les derniers empereurs romains. Eux aussi avaient dû accepter l’installation de barbares à leurs frontières et même sur leurs territoires et eux aussi avaient demandé en échange que les nouveaux venus garantissent les frontières de l’empire, que les légions romaines ou gallo-romaines ne parvenaient plus à défendre.

Pour bien montrer qu’il a changé de camp, Rollon se fait baptiser en 912. Il rétablit même la vie monastique et les moines qui avaient fui la contrée reviennent avec leurs reliques. Maintenant, sur le plan politique, la question est de savoir s’il se comporte en prince chrétien ou en chef barbare. On pourrait aussi se demander quelle langue on parlait à cette époque dans le duché de Normandie et qui la parlait. On peut supposer que la population locale (gallo-romaine) n’avait pas disparu (ou était revenue à la fin des conflits) et qu’elle continuait à s’exprimer dans son patois local qui commençait à se distinguer du latin. L’aristocratie elle, devait être d’origine viking et parlait probablement une langue nordique. Tout ce que l’on sait, c’est que Rollon partage les terres entre « ses chevaliers et des étrangers » (faut-il comprendre entre les chefs Vikings et d’anciens nobles gallo-romains ?) Par ailleurs, la toponymie actuelle de la Normandie prouve bien une présence importante des peuples nordiques dans cette région. Il est clair aussi que le patois roman qui était parlé en Normandie a subi directement l’influence de ces parlers germaniques (voir plus tard, le français parlé par un écrivain comme Wace, qui cumule tout de même un certain nombre de traits spécifiques à sa région, tout comme les textes picards d’ailleurs, qui auront eux aussi leurs particularités propres, qui les distinguent du parler d’Ile de France.)
C’est donc ce patois roman teinté de germanismes que Guillaume, ce descendant des Vikings, va exporter vers l’Angleterre. Ce « français », qui sera parlé pendant quelques siècles par l’aristocratie anglaise, va à son tour influencer la langue anglaise parlée elle par le peuple. Comme quoi l’histoire est un éternel recommencement.
On sait par ailleurs que de nombreux anglicismes actuels réintroduisent dans notre langue des mots dont l’origine remonte en fait à cet ancien patois roman de Normandie alors qu’ils avaient disparu entre-temps en français de France.
Exemples :
- budget de l'ancien français « bougette » (petite bourse portée à la ceinture)
- caddie (de l'ancien français « cadet », chariot tiré à bras utilisé pour transporter de menus objets.
· challenge, de l'ancien français « chalenge ou chalonge » : contestation en justice ou par les armes, dispute.
· gentleman, partiellement de l'ancien français « gentil », homme d'ascendance noble
· humour (ancien français: « humeur », substance aqueuse.
· marketing ancien français: marchié, marchiet (accord, marché, lieu de marché)
· record (de l'ancien français: « record », souvenir; recorder: se rappeler, réciter par cœur.
· Etc. etc

00:26 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : langue française, normands, siège de paris
26/09/2008
Des lauzes, des laves et autres palis
Je m’étonnais dans la note précédente du fait que mon Grand Larousse de la langue française me donnait le terme « lave » comme synonyme de lauze, alors que celle-ci est habituellement en schiste ou en grès. Intrigué, j’ai poursuivi mes investigations et j’ai trouvé !
Le terme « lave» ne renvoie pas à une roche d’origine volcanique comme on pourrait le croire, mais à une pierre plate. Ce n’est pas de la nature de la roche dont il est ici question, mais de sa forme.
Le mot «lave » que nous employons habituellement pour désigner la pierre en fusion provenant des volcans vient de l’italien «lava » (d’après un mot sicilien provenant lui-même du latin « labes », « éboulement », d’après « labi », glisser) tandis que la lave dont nous parlons ici vient du latin médiéval lapida « pierre » provenant lui-même du latin lapis, lapidis. On sait que le «p» sourd et le «b» sonore sont en fait la même lettre et que ce « b » passe facilement au « v » (voir pays basque/pais Vasco). Lapida devient donc lapide puis labide, lavide et finalement lave, si on suit les enseignements de la linguistique diachronique.
De plus, pour les locuteurs, une certaine confusion a été possible entre le « v » de lave et le « u » de « lauze », ce qui tend encore à rapprocher les deux mots qui désignent tous deux une pierre (plate).
J’ai trouvé que dans les Vosges Saônoises, le terme lave désigne les pierres de grès utilisées en couverture. Plus épaisses, elles sont appelées dalles. Enfin, plus grosses encore et dressées pour faire des clôtures, elles portent le nom de palis.
Cette « lave » (au sens de pierre) a donné naissance à « lavière » (carrière dans laquelle on extrait le matériau) et «lavier » (personne qui l’extrait).
Mais revenons un instant à « palis ». Ce terme désignait au XII° siècle un « ensemble de pieux fichés dans le sol à des fins défensives» puis, par métonymie, chacun des pieux qui le constitue. Le mot vient de l’ancien français « pel » (avec un suffixe «is »), de la même famille que « pieu »
«Pieu », de son côté, vient du latin « palus » (poteau et même, par analogie, membre viril). Pal, palis, palissade sont bien de la même famille. « Pieu », nous dit le Robert historique, vient de l’ancien cas régime (accusatif en latin classique) au pluriel : « pels » (devenu « peus » puis « pius » et finalement « pieux ». Ce pluriel s’est imposé sur le cas régime singulier « pel » du fait que les pieux sont généralement utilisés en très grand nombre.
On ne confondra évidemment pas ce pieu (piquet) avec pieu (lit en langage populaire), lequel vient de peau (« piau »), le lit étant fait à l’origine de peaux de bêtes.
On ne le confondra pas non plus avec l’adjectif «pieux », du latin « pius » que l’on retrouve dans le domaine religieux.
Bref, la langue est un véritable roman. Je me souviens qu’enfant je passais des heures à feuilleter les illustrations du petit Larousse, passant sans fin d’une page à l’autre ou d’un thème à l’autre. Ce passe-temps constituait un véritable voyage dans l’espace (ah, ces pays tropicaux dont le nom déjà faisait rêver) ou dans le temps (Ramsès, Napoléon, Vercingétorix, etc.) Aujourd’hui, il me semble que la langue elle-même suffit déjà amplement à ce voyage sans fin. Ainsi nous sommes partis du lézard d’Angèle Paoli pour arriver aux palis en passant par les lauzes et les laves.
Mais je m’aperçois que j’ai été injuste envers ce sympathique animal en ne donnant pas l’étymologie de son nom (ne souriez pas). Lézard a remplacé le féminin « laisarde » plus fréquent en ancien français, lequel vient du latin « lacerta », le masculin « lacertus » désignant le muscle. Lequel « musculus » provient, comme chacun sait, de « mus », la souris (voir musaraigne), les Romains associant le mouvement du muscle sous la peau à celle d’une petite souris qui se déplacerait à cet endroit.
Mais j’arrête là mes recherches étymologiques, lesquelles pourraient se poursuivre indéfiniment si nous avions plus de temps (de « tempus, temporis ». Non, je blague, là).
00:01 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : lauzes, laves, palis
24/09/2008
Les lauzes
Dans un de ses billets, consacré à l’automne qui arrive, Angèle Paoli parle des lauzes.
« Je me chauffe au soleil, sur le fil du lézard. Qui file sa trajectoire sur les lauzes. »
Ce terme « lauze » ne m’était pas inconnu, mais je l’avais un peu perdu de vue. Évidemment, ici, il est surtout amené par sa sonorité, proche de celle de lézard, mais le sens aussi est respecté, puisque la lauze désigne la pierre plate que l’on utilisait dans le Sud de la France pour faire les toits.
Le terme a une orthographe incertaine (lauze, lause ou même lose) et, curieusement, il n’est repris sous aucune des trois formes dans mon Petit Robert et je ne l’ai trouvé que dans le Grand Larousse de la langue française en sept volumes.
Le mot provient de l’ancien provençal « lauza », lui-même issu du gaulois « lausa », qui signifiait dalle. Au XVI° siècle, on le retrouve dans l’expression « pierre lause » Il s’agit bien d’une pierre plate détachée par lits et utilisée comme dalle ou pour couvrir les bâtiments. Manifestement, la pierre en question doit être du schiste et pourtant le dictionnaire donne le terme « lave « comme synonyme. Il précise aussi que dans la région de Saint-Étienne, la lauze désigne un grès houiller micacé.
Le Robert historique, toujours aussi précieux, précise que l’usage de la lauze s’étendait de la Provence à la Lorraine et que le terme a été utilisé par Stendhal (il est vrai qu’il était originaire de Grenoble et qu’il n’a fait là que reprendre un régionalisme, peut-être à son insu). Ceci dit, pour ce qui est de l’origine du mot, Alain Rey nous renvoie, via le gaulois, à un mot inconnu d’origine préceltique et probablement non indo-européen. On ne peut être plus vague, mais finalement ces origines obscures, qui remontent à la nuit des temps, ont elles aussi leur charme.
Ce qui est étonnant, cependant, c’est que ce terme, qui a bien transité par le gaulois, n’ait finalement survécu que dans la partie méridionale du pays. Le massif armoricain et le massif ardennais connaissaient pourtant aussi ce genre de toiture faite de pierres entrecroisées. Quel nom leur donne-t-on dans ces régions ? J’avoue que je l’ignore.
En cherchant sur Internet, je trouve ceci sur un site professionnel d’ardoisiers :
Aussi appelée "ardoise de montagne",
la lauze est le produit rustique par excellence,
brut de clivage, épais, il résiste à tout.
Adaptée aux conditions extrêmes, la lauze fera merveille
l'hiver dans les zones très enneigées, ainsi que l'été
pour conserver la fraîcheur d'une maison en pierre.
Son aspect de pierre naturelle permet une intégration
harmonieuse dans le paysage.
L’explication réside peut-être dans le fait que le Midi est resté plus authentique par certains côtés que le Nord et que l’habitat traditionnel y a perduré d’autant plus facilement qu’il offrait des avantages (résistance au poids de la neige en montagne et fraîcheur pour les étés torrides des plaines).
Remarquons que notre mot losange vient lui aussi du gaulois « lausa », pierre plate, dalle. Par la suite, c’est la forme géométrique de ces pierres qui a prévalu et le mot est d’ailleurs devenu masculin au XVIII° siècle sous l’influence du genre des autres noms désignant des formes géométriques (carré, rectangle, etc.).
Quand je consulte le Robert historique pour le mot losange, je m’aperçois qu’il se montre aussi perplexe que moi. Il dit en effet que le terme viendrait du gaulois « lausa » , ce qui, sémantiquement, semble satisfaisant comme explication, mais il signale le problème géographique, le mot étant surtout limité à l’aire provençale et franco-provençale. Du coup, certains linguistes ont émis l’hypothèse d’une origine orientale avec l’arabe « lawzinag », mot désignant un gâteau (d’après lawz, amende). En réalité rien ne permet de retracer l’évolution du mot et le sens de gâteau, attesté en français au XIV° siècle, pourrait n’être qu’une analogie de forme avec le losange. Des spécialistes, cependant, veulent voir une origine arabe commune pour les mots « losange » (au sens de gâteau), «lasagne » et son synonyme provençal « lauzan. »
Nous voilà bien loin des toitures en pierre et plus loin encore du lézard du poème qui paressait au soleil.
12:19 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : lauze
14/06/2008
Nouveau petit dictionnaire de la France sarkozienne.
Suite à la sortie du nouveau Petit Robert (voir une note antérieure), plutôt que de vous donner la liste de tous les néologismes qui sont désormais acceptés, ce qui serait fastidieux et sans grand intérêt, je vous propose un petit exercice calqué sur le Dictionnaire des idées reçues de Flaubert. Il s’agit d’imaginer, dans la France sarkozienne d’aujourd’hui, ce que pourrait donner un dictionnaire qui serait à la solde du pouvoir (après tout les grands médias le sont bien, non ?). Voici ce que je propose, libres à vous de continuer le jeu.
Nouveau dictionnaire de la langue française, sous la direction d’un collèges de linguistes proches de l’UMP (et avec une introduction de Carla Bruni)
Introduction : notions de grammaire dégénérative :
• Tous les verbes doivent être transitifs afin de faciliter le passage des idées et des concepts libéraux.
• Les verbes copules sont réservés à l’usage exclusif du président et de son épouse.
• Les adjectifs ne peuvent être attributs que d’un seul sujet.
• L’épithète détachée sera désormais enchaînée.
• La conjonction de coordination « mais » est désormais interdite, car elle introduit un début de réfutation par rapport à l’idée qui précède, ce qu’on ne pourrait tolérer dans une France qui va de l’avant.
• Les conjonctions de subordination seront au nombre de 64,5 millions (une par citoyen)
• Les néologismes seront du seul ressort du président de la République.
• Les anglicismes seront noyés dans la Manche.
• Les adverbes en « ment » seront interdits sauf dans le monde politique
• Chaque phrase devra comporter au moins un complément circonstanciel de but.
• Les compléments circonstanciels de cause ne sont pas interdits mais ils sont à déconseiller (car il vaut mieux regarder devant soi que derrière soi)
• Les compléments d’opposition seront embastillés durant toute la présidence sarkozienne.
• Le groupe sujet s’appellera groupe du président.
• La proposition relative sera doublement relative, afin de lui enlever toute valeur intrinsèque.
• Le mode impératif sera réservé aux agents de la force publique, qui seront les seuls à pouvoir en faire usage.
• Les modes futur et conditionnel seront réservés aux citoyens, tandis que le gouvernement emploiera toujours le présent.
• Le passé composé sera décomposé.
• Le plus que parfait deviendra l’arrière-passé.
• L’imparfait sera purement et simplement aboli, tout étant devenu parfait (du moins convient-il de le faire croire).
• Les pronoms personnels réfléchis seront réservés aux ministres de la majorité.
• Le pronom sans fonction logique se fêtera le six décembre, jour de la Saint Nicolas, en l’honneur de notre bon président laïc.
• Les superlatifs absolus seront réservés au domaine de la finance.
• Les comparatifs d’infériorité seront de mise chez les seuls chômeurs.
• Les accords du pluriel sont abolis car il n’y a qu’un président et que ce n’est pas le nombre qui doit l’emporter.
• Les majuscules seront interdites lorsque le gouvernement est en vacances.
• Afin de résoudre les problèmes d’accord, les participes passés seront remplacés par des participes présents.
Dictionnaire de la langue (lettres A à V)
Remarque : Les lettres W, X , Y et Z sont supprimées, vu leur connotation étrange et même étrangère.
Nouveautés :
• Le verbe « libreéchanger » passe dans le dictionnaire.
• Le verbe « libéraliser » s’emploie de préférence après « il faut ».
• L’usage du mot « sécurité » est à éviter. Il est à proscrire dans l’expression « sécurité sociale ».
Définitions :
• Albeniz : musicien espagnol connu par sa petite fille.
• Alpes : montagnes remplies de vaches en été et de touristes en hiver.
• Banlieue : zone située en dehors des grandes villes où vivent principalement des immigrés. Il y fait très chaud en décembre.
• Bruni : famille d’immigrés italiens régularisée suite au mariage d’un de ses membres avec un Français.
• Capital : à faire fructifier (voir évangile selon saint Max) .
• Capitale : ville où vit le président.
• Carla : prénom féminin (se dit en chantant).
• Cecilia : il est interdit de donner ce prénom à un enfant, sauf en Bulgarie et en Lybie.
• Césaire (Aimé): noir que l’on n’aime pas mais à l’enterrement de qui il faut aller.
• Chine : pays qui tremble au moment des jeux olympiques.
• Chirac : ancien chef qui a été supplanté. Est maintenant corrompu.
• Clochard : chômeur qui a perdu son droit aux allocations.
• Chômage : aumône accordée à celui qui ne veut pas travailler
• Constitution européenne : l’adopter même si le peuple n’en veut pas/ ne se rejette qu’en Irlande.
• Corrèze : région reculée qui compte beaucoup de vaches et un ex-président.
• Douane : entrave au commerce mondial. A été supprimée.
• Education nationale : les compétences semblant innées chez les individus (puisque ce sont toujours les mêmes familles qui détiennent les richesses), l’Education nationale peut disparaître. En attendant, elle assumera un rôle de rééducation.
• Elysée : maison dans laquelle vit celui qui a été élu par le peuple
• Enseignants : corps professionnel acquis à la gauche. En réduire les effectifs au maximum.
• Etats-Unis : pays ami qui nous a annexés en 1945.
• Expulser : ne se dit qu’en parlant des immigrés.
• Facteur : seul homme de lettres.
• Fonctionnaire : personne qui coûte très cher à l’Etat. Supprimer un tiers de l’effectif et voir les conséquences.
• Hongrois : se dit des chevaux hongres.
• Immigré : résident expulsable.
• Irak : pays où on trouve du pétrole et des terroristes mais pas d’armes de destruction massive.
• Iran : a disparu ou va disparaître.
• Italie : pays ami où règne Berlusconi.
• Jet : s’emploie surtout dans l’expression « jet privé ».
• Justice : département indépendant tenu par une amie du président de la République.
• Libre-échange : politique qui vise à favoriser l’échange des femmes.
• Mai : se disait en 68.
• Manifestation : émeute à réprimer.
• Mariage : se rompt sur un air d’Albeniz et se célèbre avec une chanson de Carla.
• Marin pêcheur : breton irascible.
• Martin pêcheur : ours mal léché.
• Neuilly : centre du monde.
• Otan : club sportif auquel il est de bon ton d’appartenir.
• Peuple : est supposé soutenir le président, mais le fait rarement.
• Poitou-Charentes : région reculée encore royaliste.
• Police : sert à courir après les incendiaires et à arrêter les terroristes. Il convient de calculer ses effectifs de manière inversement proportionnelle à la côte de popularité présidentielle.
• Pouvoir d’achat : permet d’acheter le pouvoir quand on en dispose.
• Prix (de l’alimentation) : monte toujours.
• Prix (de l’essence) : monte toujours.
• Salaire : entrave au profit/ monte seulement s’il est présidentiel.
• Salon agricole : endroit où on peut dire des gros mots, même si on est président.
• Sarkozy : famille d’origine hongroise fuyant le communisme.
• Sondage : courbe descendante
• Sondé : citoyen souvent déçu.
• Suisse : gigantesque coffre-fort.
• Syndicat : groupe terroriste.
• Télévision : moyen technique qui permet de grandir l’image du président.
• TGV : train qui, quand il roule, permet d’aller plus vite pour arriver nulle part
• Tibet : région montagneuse de la Chine méridionale. Manifester pour son indépendance est la première discipline olympique, qui fait rire jaune les Chinois.
• Yacht : bateau qu’on prête à un ami.
.

02:10 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : langue française, dictionnaire
12/06/2008
Du français et de ceux qui le parlent.
Le Petit Robert 2009 vient de sortir. On sait que chaque année de nouveaux mots font ainsi une apparition officielle, leur présence soudaine dans ce dictionnaire de référence leur conférant une légitimité qu’ils n’avaient pas encore.
On pourrait épiloguer longuement sur ce qui préside au choix de certains termes, tandis que d’autres sont irrémédiablement refusés.
Nous, qui sommes les locuteurs du français, nous avons souvent l’idée fausse que les mots n’existent que parce qu’ils sont repris dans les dictionnaires. C’est évidemment l’inverse qui se passe, les dictionnaires ne faisant qu’admettre à un certain moment (après un laps de temps plus ou moins long) des termes déjà bien ancrés dans l’usage.
Le choix des rédacteurs du Robert n’est pas facile à faire. S’ils vont trop vite pour accepter un mot et que celui-ci disparaît de lui-même dans les années qui suivent, ils se couvrent de ridicule. Inversement, s’ils s’obstinent à refuser des termes qui manifestement sont passés dans l’usage, ils se montrent alors particulièrement réactionnaires.
De tout ceci il faut retenir que ce ne sont pas les grammairiens qui font la langue, mais bien nous, modestes locuteurs. Autrefois, le système scolaire et des ouvrages de référence comme le Bon usage de Grevisse (que j’adore par ailleurs et auquel je me réfère tout le temps) ont fait de la langue leur chasse gardée. Ils détenaient la vérité et nous, pauvres citoyens, nous tentions tant bien que mal de ne pas commettre trop de fautes. Maintenant, la tendance s’est inversée. Les linguistes ont pris le pouvoir face aux grammairiens et pour eux, tout se vaut. Une langue, par définition, évolue tout le temps et dès lors le fait d’employer une tournure plutôt qu’une autre témoigne d’une étape historique et non de la supériorité de cette tournure sur celles qui ont été évincées. Plus de bon usage donc. Au lieu d’imposer une norme, les linguistes se promènent avec leur micro pour tenter de capter la langue telle qu’elle se parle aujourd’hui. Plus de hiérarchie des valeurs non plus : l’argot ou le parler adolescent valent la langue de Proust ou de Mauriac. J’en ai même entendu un (de linguiste) qui disait que le parler des jeunes des banlieues était bien plus innovant et partant beaucoup plus riche et créatif que la langue littéraire, faite finalement de conventions (utilisation de l’acceptation ancienne de certains mots, tournures désuètes, langue figée, emploi du passé simple, du subjonctif imparfait, etc.). Bref, selon lui, la vraie littérature se fait dans la rue par des jeunes à peine scolarisés et pas par des académiciens qui ont un pied dans la tombe et qui écrivent comme au XIX° siècle.
Il y a du vrai dans tout cela, évidemment. Ceci dit, j’ai déjà entendu des discours similaires à propos de l’enseignement autrefois : le jeune était riche de toute la potentialité qui était en lui tandis que l’enseignant venait contrer son imagination par un savoir aussi figé que ridicule. Depuis, beaucoup d’eau est passée sous les ponts et on est revenu, par une sorte de logique dialectique propre semble-t-il à la pensée humaine (comme quoi Hegel n’avait rien inventé), à plus de modération. L’idéal est finalement de transmettre un savoir sans brimer la spontanéité propre à la jeunesse mais en lui permettant au contraire, par ce savoir, de faire fructifier au mieux ses possibilités innées.
Il en va donc de même en matière de langue française. Si le Bon usage a pu parfois nous paralyser par la crainte que nous avions de commettre des fautes, il est certain que le laisser-faire généralisé n’apporte rien non plus. Une langue n’est finalement qu’une norme. Celle-ci est certes arbitraire mais il importe que chaque locuteur la respecte au même moment, sinon, c‘est la compréhension même du message qui se trouve en danger.
Tout cela pour dire que nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes les utilisateurs de notre langue. Je ne peux pas faire avec elle tout ce que je veux (puisqu’elle appartient aux autres aussi) mais je ne dois pas non plus me laisser paralyser par ce qui n’est finalement qu’un outil. Le principal, c’est que je parvienne à m’exprimer et à me faire comprendre (sciemment, je n’emploie pas le terme à la mode « communiquer », qui ne veut plus rien dire) et si parfois je prends quelques libertés avec la langue, ce n’est tout de même pas si grave que cela.
Le danger, en fait, c’est de vouloir à tout prix s’exprimer dans une langue parfaite car à partir de ce moment-là celle-ci se sclérose et devient hermétique à toute innovation. L’emploi des anglicismes s’explique à mon avis en partie à cause de ce phénomène. D’abord il convient de les relativiser : ils n’affectent que le vocabulaire (et encore, dans des domaines bien spécifiques) et non la grammaire et ils sont dus en partie à la suprématie économique de l’Amérique et à son avance en matière en matière scientifique et technologique. Ensuite, leur introduction est facilitée par la peur des locuteurs francophones de créer des néologismes. Si nous étions moins timorés et si nous osions proposer des termes nouveaux au lieu d’attendre que l’Académie en suggère un avec vingt années de retard, il se pourrait bien que notre langue se montrerait beaucoup plus vivante.
Bref, en matière de langue, il faut se montrer exigeant (et refuser les facilités et les compromissions) mais ne pas fermer la porte aux innovations, lesquelles sont nécessaires pour que cette langue demeure dynamique.
15:50 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : langue française, le petit robert
04/06/2008
A vau-l’eau
Nous avons commencé l’autre jour à nous pencher sur l’origine des expressions et nous avions parlé de « trempé comme une soupe ». Une autre expression dont on ne perçoit plus tout le sens, c’est « à vau-l’eau ». Ce mot « vau » sera mieux compris si on le remet au pluriel : vaux, que l’on retrouve dans la tournure «par monts et par vaux ». Vaux, c’est donc le pluriel de val (voir « Le dormeur du val » de Rimbaud). Dans la langue courante, on lui préfère habituellement le terme « vallée », sauf dans des dénominations comme le Val de Loire ou le Val-d’Oise. Notons aussi le mot « aval » qui désigne le côté vers lequel descend un cours d’eau (par opposition à amont). D’amont en aval, c’est donc partir d’une position élevée pour se diriger vers la vallée.
Cet « aval » n’a évidemment rien à voir avec le terme aval (de l’arabe hawâla en passant par l’italien avallo) qui désigne l’engagement par lequel une personne s’engage à payer un effet de commerce en cas de défaillance du débiteur principal. Cette personne sera donc appelée donneur d’aval.
Mais revenons à notre val (au sens premier). Aller à vau-l’eau signifie donc qu’on suit un cours d’eau vers son aval, qu’on est emporté par celui-ci et donc entraîné vers l’embouchure. C’est encore dans ce sens que Rabelais employait l’expression. De là, on est passé assez logiquement au sens figuré pour signifier qu’un projet échappe au contrôle de celui qui l’a conçu.
La tournure « Par monts et par vaux » signifie quant à elle « de tous côtés ». Elle suppose une idée de mouvement dans tous les sens, à la fois vertical (montée/descente) et horizontal (par les verbes aller ou voyager qui accompagnent généralement l’expression).
Notons encore qu’autrefois « monts et vaux » était synonyme de « monts et merveilles ». Promettre monts et merveilles, c’est promettre des avantages considérables, des choses merveilleuses. Chez Froissart, « des monts » signifiait d’ailleurs « une grande quantité, beaucoup de » (cf. des tas de). On aurait pu se contenter de dire « promettre des merveilles », mais par un procédé rhétorique d’intensification, on a préféré insister en employant deux termes plutôt qu’un (comme dans « bel et bien », « peu ou prou », « sains et sauf », etc.)

17:57 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : expressions, à vau-l’eau
27/05/2008
Trempé comme une soupe
Il est des expressions qu’on utilise tous les jours, dont on comprend parfaitement le sens, mais pour lesquelles il est parfois difficile de déterminer l’origine.
Si « prendre des mesures draconiennes » renvoie manifestement à Dracon, archonte éponyme en 621 avant JC (éponyme parce qu’il donnait son nom à l’année en cours) qui établit un code certes équitable mais particulièrement rigoureux (tout délit, même un simple vol était puni de la peine de mort), si « la fin des haricots » fait allusion aux familles pauvres pour qui la privation de ce légume, base de leur alimentation, représentait vraiment la fin de tout, une expression telle que « trempé comme une soupe » peut sembler par contre bien mystérieuse.
Pourquoi, en effet, une soupe peut-elle être qualifiée de trempée ? Tout simplement parce que « soupe », à l’origine, désignait des tranches de pain qu’on trempait dans du bouillon., du lait ou du potage. L’étymon est le bas latin « suppa », lui-même dérivé du germanique « suppa » (tranche de pain sur laquelle on verse le bouillon) ». C’est ce sens que l’on retrouve dans la chanson de geste de Renaut de Montauban, au XII° siècle déjà. On disait aussi « tailler des soupes » (Ménestrel Reims).
Par la suite, le mot soupe a désigné le potage lui-même, mais un potage auquel on ajoutait des morceaux de pain ou de légumes non passés. L’idée était donc bien celle d’un liquide contenant quelque chose de consistant. Plus tard encore, on est arrivé à l’idée d’un potage épais.
Comme on pouvait aussi remplacer le bouillon par du lait (et que celui-ci monte vite quand on le chauffe), est apparue l’expression « soupe au lait », qui désigne une personne prompte à se mettre en colère mais qui se calme tout aussi vite.
14:11 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : expression, trempé comme une soupe
08/05/2008
Ecrire comme un chat
Autrement dit d’une manière illisible et en caractères très petits. Cette expression est à rapprocher de « pattes de mouche », d’où la formule que l’on rencontre parfois : « pattes de chat ».
Mais si la trace des pattes de mouche peut en effet évoquer certaines écritures, on comprend mal en quoi les chats auraient l’apanage de l’illisibilité.
Certains pensent qu’il faut en rechercher la cause dans l’homonymie entre « griffer » et « greffer » (écrire). Autrement dit, griffonner aurait à a fois le sens de « donner des coups de griffes » et de « donner des coups de greffes» (stylet pour écrire)
On retrouve ce terme « greffe » dans le mot greffier, qui désigne le fonctionnaire chargé des écritures dans un tribunal.
Notons que le mot greffe vient du latin graphium qui désignait le stylet, lui-même provenant du grec grrafeion). Il avait anciennement le sens de stylet et maintenant celui de bureau où l’on garde les minutes des actes du tribunal.
On ne confondra pas ce terme avec le mot greffe (pousse d’une plante que l’on incère dans une autre plante pour que celle-ci produise les fruits de la première) dont l’étymon est pourtant le même puisqu’il s’agit d’une dérivation métaphorique (comparaison entre la forme du stylet et celle de la branche que l’on incère).
Enfin, cela nous éloigne des chats. Pauvres bêtes. Il est vrai qu’avec l’arrivée de l’ordinateur et du traitement de texte, les problèmes de calligraphie semblent définitivement résolus et on peut espérer pour ces nobles félins que l’expression désobligeante ici relevée va tomber en désuétude.
Ne vaut-il pas mieux, à leur sujet, se souvenir du poème de Baudelaire ?
Les amoureux fervents et les savants austères
Aiment également, dans leur mûre saison,
Les chats puissants et doux, orgueil de la maison,
Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires.
Amis de la science et de la volupté,
Ils cherchent le silence et l’horreur des ténèbres ;
L’Erèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres,
S’ils pouvaient au servage incliner leur fierté.
Ils prennent en songeant les nobles attitudes
Des grands sphinx allongés au fond des solitudes,
Qui semblent s’endormir dans un rêve sans fin ;
Leurs reins féconds sont pleins d’étincelles magiques,
Et des parcelles d’or, ainsi qu’un sable fin,
Etoilent vaguement leurs prunelles mystiques

00:57 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : ecrire comme un chat