21/09/2011
Automne
Automne,du latin « automnus ». Mot probablement d’origine étrusque, mais les Romains avaient fini par le confondre avec le verbe « augere », croître, augmenter. C’est que l’idée première était bien positive, celle d’une saison où l’on engrangeait les récoltes, où la terre donnait en abondance fruits et légumes et récompensait ainsi les hommes du mal qu’ils s’étaient donné au printemps pour labourer. Jusqu’au XII° siècle, on employait d’ailleurs le terme « gain » (temps de la récolte) et pas notre mot « automne », qui est en quelque sorte emprunté tel quel au latin au XIII° siècle, dans un premier temps toujours avec cette idée de récolte, puis progressivement avec celle de déclin.
« Gain » , déverbal de gagner (gaigner) désignait bien ce que l’on gagne et s’appliquait donc à la saison qui suit l’été (voir aussi le « regain » si cher à Jean Giono), caractérisée par son abondance.
Les dictionnaires ne nous disent pas pourquoi on est passé de ce sens positif à celui négatif de déclin, de mort annoncée. Là où les hommes de l’Antiquité et du Haut Moyen-âge ne voyaient que récompense ou don gratuit, ceux qui les ont suivis n’ont plus vu que l’idée de mort lente. Les mentalités avaient-elles changé ? Le Christianisme culpabilisateur avait-il fait son œuvre ? Le climat du Nord de la Gaule, si différent des hivers romains cléments explique-t-il cela ? C’est l’histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine en fait. Les Anciens regardaient derrière eux et voyaient dans l’automne le résultat concret de leurs efforts antérieurs tandis que leurs successeurs avaient déjà les yeux tournés vers l’hiver qui s’approchait inéluctablement.
Il est vrai que la chronologie antique était cyclique : de même que les saisons revenaient d’année en année, l’Histoire elle-même était circulaire, chaque civilisation passant régulièrement par un Age d’or suivi de périodes plus sombres. Dans le Moyen-âge chrétien, au contraire, le temps est devenu linéaire. Dieu a créé l’homme et celui-ci doit vivre sur terre un certain nombre de siècles avant la fin du monde et le grand jugement de l’Apocalypse. L’être humain n’est plus que de passage en quelque sorte et il a les yeux tournés vers sa mort prochaine. Il voit donc dans l’automne l’annonce de cette fin qui s’approche et il la souhaite autant qu’il la redoute. Comme Chrétien il espère en finir au plus vite avec cette vie terrestre et il aspire au Royaume de Dieu, mais comme être humain, évidemment, il voit avec angoisse approcher sa propre fin. Dans tous les cas, il ne voit plus dans l’automne que le commencement d’un déclin inéluctable et plus du tout cette saison belle, aux couleurs chatoyantes, qui remplit nos greniers et nous empêche de mourir de faim une fois l’hiver venu.

Photo personnelle
07:00 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : automne, étymologie


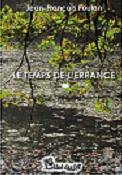



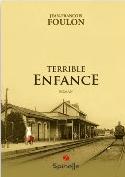
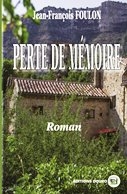
Commentaires
Et l'abondance de L’Automne est signifiée par les fruits rebondis et puis les raisins et le tonneau sont les attributs du dieu Bacchus...
Merci de ce billet passionnant. Comment en effet passe-t-on de l'idée d'augmenter à celle de péricliter ? Vos hypothèses sont alléchantes.
Écrit par : Dominique | 22/09/2011
Écrit par : Feuilly | 22/09/2011
Écrit par : solko | 23/09/2011
Écrit par : Feuilly | 23/09/2011
Quand j'étais petit je prenais toujours mon petit déjeuner avec un dico dont je consultais patiemment et méthodiquement les pages en même temps que j'avalais mes tartines. Je ne fais pas autrement aujourd'hui.
L'histoire des mots me passionne toujours autant et vous la racontez très bien :)
Écrit par : Jean | 24/09/2011
Écrit par : Feuilly | 24/09/2011
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Arcimboldovertemnus.jpeg
Wikipédia nous dit que Vertumne, dont le nom signifie "tourner", "changer", était sans doute un roi d'Étrurie qui, à cause du soin qu'il avait pris des fruits et de la culture des jardins, obtint, après sa mort, les honneurs de la divinité. Son culte passa de l’Étrurie à Rome où on le considérait comme le dieu des jardins et des vergers.
Il avait le privilège de changer de forme à son gré - à l'instar de Protée -, et il eut recours à cet artifice pour se faire aimer de la nymphe Pomone qu'il choisit pour épouse. Ce couple heureux et immortel vieillit et se rajeunit périodiquement sans jamais mourir. Vertumne donna sa foi à la nymphe et lui garda une inviolable fidélité.
Wikipédia dit que l'allégorie est transparente, qu'il s'agit de l'année et de la succession ininterrompue des saisons. Ovide semble appuyer cette conception de Vertumne, puisqu'il dit que ce dieu prit successivement la figure d'un laboureur, d'un moissonneur, d'un vigneron, et d'une vieille femme, désignant ainsi le printemps, l'été, l'automne et l'hiver.
Il me semble que Sylvie Germain parle du "Vertumne" dans "Céphalophores". Je le vérifierai.
Un céphalophore, en botanique, est une plante qui porte une fleur en forme de tête.
Selon l'étymologie, "céphalophore" vient du grec “tête, qui porte”.
Pour Sylvie Germain, les céphalophores sont tous « ceux et celles que l'amour a saisis, et qui s'en vont transis par la pensée de l'autre, ardés par le regard de l'autre ; ils marchent ainsi en somnambules, ils ont la tête ailleurs comme on dit. Leur front est resté lové dans la chaleur et dans l'odeur du cou de l'autre, appuyé contre son épaule. Ils, elles, portent leur tête en offrande à l'aimée, à l'élu, à moins que ce ne soit la tête de l'autre qu'ils, elles, portent ainsi en très secrète et tendre procession. »
Il est donc question d'amour et de têtes… souvent perdues :), "céphalophore" désignant une catégorie de personnages qui, ayant été décapités, se relèvent, prennent leur tête entre leurs mains, et se mettent en chemin pour rejoindre le lieu où ils désirent être inhumés...
Écrit par : Michèle | 25/09/2011
Ah la la :)
Écrit par : Michèle | 25/09/2011
Les "éléments" et les "saisons" sont bien des allégories, que "L’Encyclopédie" de Diderot et D'Alembert définit comme un "moyen ingénieux qu'emploie l'Artiste pour faire naître et pour communiquer des pensées spirituelles, des idées abstraites, à l'aide de figures symboliques, de personnages tirés des mythologies."
Écrit par : Dominique | 25/09/2011
Écrit par : Feuilly | 26/09/2011
Personnellement, je déteste Arcimboldo ! Je trouve cela effrayant, il y a d'autres peintres dont j'aime mieux les natures mortes (un belge d'ailleurs, mais je ne reviens plus sur son nom!)
Vertumne, quelle belle symbolique par contre dans ce nom. Par-ci, par-là, on voit un commentaire ou l'autre d'un blogueur (canalblog) qui signe Vertumne. Je l'apprécie beaucoup. (Lui aussi !)
Écrit par : Pivoine | 28/09/2011
Je me rappelle mon émotion en exhumant d'un vieux secrétaire le Petit Larousse de 1923 de mon grand-père, et en trouvant le mot zinzolin.
Écrit par : issey | 09/10/2012
Écrit par : Feuilly | 09/10/2012
Les commentaires sont fermés.