07/10/2009
La maison (petite nouvelle)
C’est le jour où maman est morte que je suis retourné dans notre maison. Je n’y avais pas remis les pieds depuis plus de vingt ans ! Il faut dire que je n’avais pas vraiment le temps pour aller me promener là-bas. Mon métier d’abord, ma famille ensuite, vous voyez ce que c’est. Et puis franchement, la distance entre Paris et cette région reculée de province aurait découragé n’importe qui. Un pareil trajet pour ne rester qu’un week-end ? Que dis-je un week-end ! Arriver le samedi à seize heure pour repartir le dimanche après le déjeuner, cela ne valait guère la peine. Alors c’est ma mère qui venait nous rendre visite une fois de temps en temps. Elle avait des loisirs, elle, et un trajet en train ne l’effrayait pas. Elle restait souvent quelques jours, enfin pas trop longtemps non plus, parce que Martine, ça l’agaçait une belle-mère qui tournait en rond dans l’appartement… Alors on ne se voyait pas beaucoup c’est vrai, mais c’était suffisant. Quand elle était chez nous, c’était comme si une étrangère avait subitement fait irruption. Ce qu’elle disait appartenait à un autre univers tout en ne m’étant pas complètement inconnu. Elle parlait de sa campagne, du temps qu’il avait fait cet hiver, d’une voisine qui était décédée, du fils de la ferme d’à côté qui avait tout vendu pour devenir facteur (« Un vrai malheur, une si belle ferme ! »), des moissons qui, cette année, étaient vraiment en retard… Toutes ces nouvelles me semblaient concerner une autre planète, même si, au fond de ma mémoire, elles évoquaient des visages, des sourires, des paysages. Martine, elle, faisait semblant d’écouter tout en levant les yeux au ciel de temps à autre et quant aux enfants, le MP3 fixé sur les oreilles, ils se moquaient pas mal de l’ancêtre et de ses histoires du siècle passé.
On avait bien essayé une ou deux fois de l’entraîner dans Paris, mais du Louvre elle n’avait retenu que la fatigue de la foule et pour ce qui était de la promenade en bateau mouche, elle avait plus regardé, incrédule, les touristes étrangers (« Il y en a tellement, on se croirait au japon ou en Chine ! ») que les tours de Notre-Dame.
C’était avec un réel soulagement qu’elle retournait dans sa campagne et, ma foi, c’était avec le même soulagement que je la reconduisais à la gare. Mais elle revenait l’année suivante, avec d’autres nouvelles des moissons et tout cela finissait par faire une sorte de petit train-train rassurant, au point qu’on n’a pas vu le temps passer. Et puis une fois, par un beau mois de juin caniculaire, le téléphone a sonné en pleine nuit. C’était l’hôpital, là-bas et une infirmière, avec son bel accent chantant, qui disait qu’il fallait se dépêcher si on voulait la revoir vivante. Ce fut un choc, car personne n’avait jamais pensé qu’une telle chose pourrait arriver un jour. Je suis parti aussitôt, seul bien entendu, Martine ayant une conférence à donner et les enfants des examens à présenter.
Sur l’autoroute, pendant que je roulais, il me semblait entendre sa voix, la mélancolie de sa voix, quand elle parlait de son époque révolue. Subitement il m’apparut que derrière toutes ces nouvelles qu’elle nous donnait et qui nous semblaient si futiles, se cachait une sorte de désespoir, celui d’assister, impuissante, à la fin d’un monde, de son monde. Ces fermes que l’on vendait, ces jeunes qui partaient vivre à la ville, ces campagnes qui devenaient des déserts, tout cela, c’était bien connu, cela figurait même dans les livres, mais pour elle, c’était sa vie qui s’en allait ainsi, lentement et inexorablement. A force de voir disparaître tout ce en quoi elle avait cru, elle avait dû pressentir sa propre fin. Soudain, mon indifférence me parut non seulement coupable mais presque inhumaine. Moi qui n’arrêtais pas de lire des ouvrages de philosophie qui tournaient tous autour du thème de l’existence et de la mort, voilà que je laissais un être humain seul avec la conscience de sa fin prochaine et cet être c’était ma propre mère. Aussitôt, je me suis mis à accélérer, mais j’avais beau rouler à du cent cinquante dans la nuit noire, la distance ne diminuait guère.

Quand je suis enfin arrivé sur le coup de midi, exténué, ce fut pour apprendre qu’elle était décédée quelques heures plus tôt. Ce fut un deuxième choc. Trop tard, il était irrémédiablement trop tard pour pouvoir enfin prêter une oreille attentive à ce qu’elle disait. Non pas que j’eusse pu la consoler en quoi que ce soit, mais au moins elle aurait eu conscience que moi, son fils, je l’écoutais et que je la comprenais. Il n’y avait malheureusement plus rien à faire. Sauf des formalités à n’en plus finir. La commune, les pompes funèbres, le curé, puis Martine, qui n’arrêtait pas de râler au téléphone parce que le jour de l’enterrement allait tomber un samedi et qu’elle avait son cours de yoga. Bref, quand tout cela fut plus ou moins terminé, le soir allait tomber et il ne me restait plus d’autre solution que de m’acheminer vers la maison pour y passer la nuit. J’ai fait un détour par l’hôpital pour prendre les clefs qui se trouvaient dans le sac à main de ma mère. Par ce geste, j’eus l’impression de commettre un délit, comme si je violais son intimité. Sentiment ridicule, me dis-je, car finalement cette maison était celle où j’avais passé toute mon enfance et demain j’allais, par héritage, en devenir l’unique propriétaire. Pourtant, quand je me suis retrouvé devant la lourde porte de chêne massif, mes clefs à la main, j’ai encore hésité. Après tout, il suffisait de faire demi-tour et d’aller chercher refuge dans un hôtel « Formule un » le long de l’autoroute… C’est finalement le désir de renouer avec mon enfance et ma vie passée qui m’a fait tourner la clef dans la serrure.
Dès le corridor, où pendait, bien en évidence, le compteur électrique avec tous ses fils, j’ai compris que dans cette maison, rien n’avait changé et surtout qu’il n’y avait rien à cacher. Tout était apparent et s’affichait sans aucun complexe. Dans le salon se trouvait toujours le vieux piano noir qui n’avait jamais servi à personne. Nul ne savait comment il était arrivé là, au détour de quelle guerre ou de quel héritage compliqué, mais il était là, complètement incongru dans cette pièce où avaient vécu des gens modestes, symbole d’une culture et d’une richesse qui n’avaient jamais été les leurs. En le regardant, je me suis demandé si ce n’était pas sa présence qui m’avait poussé à faire des études et à quitter ce monde rural si simple. Si simple mais si riche aussi et déjà j’en étais à réfléchir sur ce que j’avais gagné en rompant avec les miens et en rentrant dans le monde des intellectuels, comme on disait par ici. Pas grand chose finalement. Certes, je maniais les idées et les concepts comme pas un des paysans de la région ne savait le faire, mais en bout de course, quand je prenais une décision, n’était-ce pas précisément ce gros bon sens paysan qui me guidait et qui l’emportait ? Moi qui me prenais pour un fin lettré, avais-je vraiment changé de camp ? N’étais-je pas aussi étranger dans le monde universitaire que ma mère l’avait été en visitant le Louvre ? C’est ce que je me demandais en contemplant ce gros piano qui nous avait toujours appartenu mais qui en même temps avait été le symbole d’un univers qui n’était pas le nôtre.
Au mur, il y avait toujours les photos du père, ces fameuses photos en noir et blanc que je contemplais, enfant, pour tenter de me faire une idée de celui qu’on disait avoir été mon géniteur. J’avais quel âge encore quand il était mort accidentellement ? Trois ans ? Quatre ans ? Aucun souvenir en tout cas dans ma mémoire. Maman nous avait élevés seuls, ma sœur et moi. Et voilà qu’aujourd’hui, quasiment un demi-siècle plus tard, la page était irrémédiablement tournée. Il n’y avait plus personne pour se souvenir de cet homme qui n’avait jamais été pour moi qu’une photographie jaunie.
Dans la cuisine, je me suis fait une soupe. J’avais trouvé des sachets Royco dans une armoire, un peu étonné quand même devant la modernité de ma mère. Ainsi, elle avait renoncé aux bons potages qu’elle préparait autrefois avec les légumes du potager. L’âge et la fatigue, sans doute, l’avaient obligée à modifier ses habitudes. Pourtant, au fond de moi une voix criait qu’en agissant de la sorte elle avait voulu se rapprocher de nous et de notre mode de vie parisien. Une vague de douleur m’envahit. Je l’imaginais là, dans cette pièce, irrémédiablement seule devant son bol de soupe, tentant désespérément de nous ressembler un peu dans l’espoir inavoué de rétablir un contact. Et nous n’avions rien vu, nous n’avions même jamais rien su. Quelle étrange aventure que la vie, tout de même. On se marie avec un inconnu qui bientôt disparaît, on élève deux enfants, un seul arrive à l’âge adulte, puis à son tour il se marie et devient pour vous comme un étranger. Il reste alors à disparaître dans l’indifférence générale. Tout cela n’a assurément aucun sens.
(à suivre)
00:53 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature
05/10/2009
Le conte du Chaperon rouge (encore)
Si nous voulons lire le conte du Chaperon rouge selon les principes de l’anthropologie culturelle chère à Lévi Strauss, il est clair qu’on peut d’emblée établir une dichotomie entre la nature et la culture.
Du côté de la nature, nous avons le loup, bien sûr, mais aussi la forêt qu’il faut traverser, puis, dans la version orale, la viande crue ainsi que l’anthropophagie (dans la version orale, le loup invite le Chaperon à manger des morceaux de sa grand-mère et à boire son sang. Seule la chatte, cet animal domestique, qui semble incarner l’âme de la maison et être une métaphore de la grand-mère elle-même, tente de l’en dissuader).
Du côté de la culture nous avons d’abord la nourriture qu’apporte le Chaperon (des galettes cuites ou une bouteille de vin ou encore une bouteille de lait, autrement dit des éléments qui ont dû plus ou moins être préparés par l’homme soit par la cuisson, soit par la fermentation. Quant au lait, il suppose l’élevage des bovins et n’est donc pas une boisson qui relève de la nature, du moins au sens symbolique. Dans certaines versions on parle d’ailleurs de beurre, donc de produit travaillé). Il y a aussi le chemin (ou les chemins car il y en a deux, celui des aiguilles ou celui des épingles, mais nous y reviendrons), qui permet justement de traverser la forêt sans encombre (d’ailleurs dans une des versions la petite fille, inconsciente, quitte ce chemin et entre dans le sous-bois pour aller cueillir des fleurs – sauvages- pour sa mère-grand).
La maison, quant à elle, est la meilleure protection de l’humanité contre la nature menaçante. Construite patiemment par les mains de l’homme, symbole de la culture, hermétiquement close, elle garantit des bêtes sauvages ceux qui l’occupent. Ce n’est sans doute pas un hasard si le conte insiste tant sur la fameuse formule « tire la chevillette et la bobinette cherra. ». Il s’agit donc bien de mettre en avant le fait que la porte est close et donc que les habitants (ici la grand-mère qui est malade et donc particulièrement vulnérable) sont à l’abri de tout danger extérieur, surtout ceux provenant de la forêt toute proche (car on aura compris que la demeure de la mère-grand est isolée et en pleine nature). Le problème, c’est que cette porte, si elle est close, ne l’est pas hermétiquement. En effet, on peut en actionner le mécanisme de l’extérieur, comme la grand-mère demande au Chaperon de le faire. Elle a donc commis une belle imprudence en ne s’enfermant pas à double tour. Certes, un animal ordinaire n’aurait pu actionner le mécanisme, mais le loup, qui est rusé, y est bien parvenu, lui. On peut supposer que la grand-mère attendait la visite de sa petite-fille et comme elle était malade et alitée, elle a trouvé ce moyen pour ne pas devoir se lever. On remarquera que la maladie de l’aïeule est donc déterminante pour la logique du récit. En effet, c’est cette maladie qui justifie le fait que le Chaperon se soit mis en route (afin de lui apporter de la nourriture pour qu’elle retrouve force et santé) et c’est encore elle, par la porte mal barricadée, qui permet l’intrusion du loup. Il y a donc eu, de la part de la grand-mère, une grave erreur, comme il y en a peut-être eu une de la part de la mère du Chaperon en envoyant sa fille sur les chemins.
Mais il s’agit avant tout d’un conte initiatique et il est donc normal que l’héroïne soit confrontée à certains dangers. Dans les versions policées de Perrault et Grimm, la fillette ne respecte pas vraiment les règles qu’elle aurait dû observer. Après avoir accepté de dialoguer avec un loup, soit elle s’écarte du chemin, soit elle prend le chemin le plus long. A ce sujet, notons qu’il convient d’opposer le chemin des épingles (lesquelles symbolisent, selon certains, le passage à l’âge adulte, car les demoiselles en mettaient dans leurs cheveux pour être plus belles et plaire aux garçons, en respectant, dirons-nous, les règles sociales : bals, rencontres, fiançailles puis mariage) à celui des aiguilles (lesquelles servent plutôt à réparer ce qui existe déjà. Au lieu de s’acheminer vers sa vie de jeune fille, en respectant les règles sociales, le Chaperon tenterait donc plutôt de prolonger son enfance, d’où le caractère naïf qu’on lui prête. Mais l’aiguille, par son chas, peut-être vue aussi comme une métaphore du sexe féminin, ce qui veut dire que notre héroïne opterait d’emblée pour des relations sexuelles immédiates –avec le loup qui la convoite- sans passer par tout le jeu social du mariage et en n’écoutant que sa nature physique qui la pousse dans cette direction. Là est donc sa désobéissance fondamentale et c’est pour cela qu’elle sera punie (les contes sont moralisateurs, ne l’oublions pas) en étant dévorée par le loup. Ce dernier épisode peut être compris, évidemment, comme une métaphore d’un viol dont il reprend les caractéristiques essentielles (non-consentement de la victime, sang, mort symbolique, etc.).
Le fait que loup se retrouve avec un gros ventre une fois qu’il a avalé ses deux victimes (la grand-mère, elle, a été punie pour avoir mal barricadé sa porte et avoir laissé une ouverture à la nature sauvage extérieure) permet d’ailleurs un parallélisme avec le ventre d’une femme enceinte. Le chasseur (qui domine la nature en tuant des animaux sauvages) ou le bûcheron (qui domine la même nature en coupant des arbres) ouvriront le ventre du loup pour libérer les victimes. Dans certaines versions celui-ci sera cruellement puni : on lui met des pierres (élément naturel) dans l’estomac et on recoud son ventre, ce qui occasionnera sa mort.
Notons encore –tant les contes sont polysémiques- qu’on peut voir la maison (fermée mais pas hermétiquement) comme une métaphore du corps féminin. L’héroïne ne se donne pas au loup (symbole de virilité qui donc renvoie aux dangers que représentent les hommes pour les jeunes filles), certes, mais elle laisse une porte ouverte en l’écoutant et en suivant ses conseils (cueillir des fleurs, etc.). D’ailleurs c’est elle qui indique l’adresse de la maison de la mère-grand, ce qui est vraiment « se jeter dans la gueule du loup » si on me passe l’expression. En donnant l’adresse d’une maison par ailleurs mal fermée, c’est un peu comme si elle permettait au loup de la conquérir, elle, de conquérir son corps.
Nature et culture, disions-nous, s’opposent à chaque instant : aliments cuits et aliments crus, forêt et maison, enfant et loup, vêtements et nudité. Nudité naturelle du loup, certes (qu’on opposera à la petite fille vêtue elle d’une cape rouge bien voyante) mais demi-déshabillé de la grand-mère qui est en robe de nuit (toujours ce rôle en demi-teinte, comme la porte certes fermée mais qui s’ouvre trop facilement). Notons qu’à la fin c’est le loup qui est habillé (ruse suprême puisqu’il prend alors les attributs de la culture) et la petite fille qui se déshabille, du moins dans la version orale du conte. Petite fille qui n’est pas si petite que cela puisque le loup la désire (cf. le lit où il l’attend). On pourrait d’ailleurs se demander si le rouge de ses vêtements n’est pas de nouveau un symbole sexuel (les règles et la puberté) à moins que cette couleur ne préfigure sa fin tragique et le sang (mais aussi le viol et la perte de la virginité).
Tous les éléments semblent donc aller par deux, comme c’est aussi le cas pour les oppositions femme et homme ou enfant et aïeule. Notons à ce propos que l’élément intermédiaire, la femme adulte en âge de procréer (la mère du Chaperon), est cité mais n’est pas vraiment présent dans le conte, sans doute pour mieux insister sur les extrêmes (l’enfance, la vieillesse), soit en-deça ou au-delà de la période consacrée à la vie sexuelle. Le chemin qu’emprunte le Chaperon et qui lui fait quitter la maison de son enfance pour celle de sa grand-mère représente donc aussi le chemin de la vie et la fuite du temps. Quittant l’enfance, elle devient adulte par les épreuves qu’elle traverse. Malheureusement elle n’a pas respecté la voie toute tracée par le discours culturel des hommes et a préféré quitter ce chemin pour s’aventurer dans des voies de traverses, des voies trop proches de la nature.
Bref, on le voit, ce n’est pas demain qu’on aura fait le tour de ce conte, qui n’en finit pas de livrer des interprétations.
Je voudrais revenir un instant sur la version que j’en ai donnée en inversant toutes les valeurs ici exposées.
Loin d’être fier et conquérant, le loup, au début du conte, est fourbu et fatigué. C’est la petite fille qui l’aborde et non l’inverse, mais déjà, elle est présentée comme n’étant plus si petite que cela, se situant donc dans une zone ambiguë de par son âge (comme la grand-mère, dans le vrai conte, pouvait l’être avec sa porte qui s’ouvrait tout en étant fermée). C’est le Chaperon qui donne à manger au loup et non lui qui désire le manger. C’est lui qui insiste pour que le loup l’accompagne et c’est lui encore qui fait entrer le loup dans la maison après avoir éliminé la mère-grand. Au lieu de devenir anthropophage comme dans la version orale et de boire le sang de son aïeule, c’est elle qui offre un repas cuit au loup, repas qui étai celui de la grand-mère. Au lieu d’être désirée par le loup, c’est l’inverse et c’est elle qui se déshabille de sa propre initiative. A la fin, le rôle du chasseur est inversé aussi puisque au lieu d’aider à tuer le loup il s’en prend à la jeune fille. C’est donc lui qui périra sous les crocs de l’animal, grâce auquel le conte reste moral. La fin, au lieu d’être joyeuse est triste et le loup s’en va seul, accusé injustement d’un crime qu’il n’a commis que pour protéger le Chaperon.

Image Internet
00:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature, chaperon rouge
02/10/2009
Ecriture
Combien de monstres l’homme d’à présent expédie-t-il dans son écrire ? Combien délègue-t-il de peurs et d’envies dans le maquis de ses romans ? Comment organise-t-il sa survie dans ces personnages qu’il dépêche au traitement de ses propres préoccupations et par la mise en mots desquelles il parvient parfois à se connaître un peu ?
Toute écriture est nécessité presque organique de clarifier en lui un indicible chaos, un mal-être qui réclame une voie d’équilibre et que lui tente d’inventer dans quelques pages organisées, toujours nécessaires, toujours ratées, et qui toujours l’apaisent faussement.
Patrick Chamoiseau, A bout d’enfance (Une enfance créole III), Folio, page 79.
09:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, chamoiseau
30/09/2009
Regrets
L’homme, qui se croit intelligent (et qui l’est peut-être, par ailleurs, je ne dis pas le contraire), oublie trop souvent qu’il n’est finalement qu’un animal. Ainsi, bien des émotions de notre vie sont à relier non pas à notre aptitude à résoudre des problèmes, mais tout simplement à nos cinq sens. Tout ce que nous percevons de la réalité extérieure, nous nous imaginons que c’est grâce aux capacités de notre cerveau, mais celui-ci, en fait, ne fait que centraliser toutes les impressions qu’il a reçues. Or, les indications que nous donnent les sens s’imprègnent en nous de manière beaucoup plus profondes que les raisonnements intellectuels. Si on y regarde d’un peu plus près, on s’apercevra que la mémoire vivace que nous avons de certains événements précis est en fait reliée directement à notre perception physique des événements. Marcel Proust le savait bien quand il a raconté la saveur de sa petite madeleine et comment cette saveur lui permettait de retourner dans son passé et de revivre un moment privilégié enfoui au plus profond de sa mémoire.
Je crois qu’on peut affirmer sans trop se tromper qu’une bonne part de ce qui nous constitue est fait ainsi d’impressions passées qui nous ont bouleversés à un moment donné de notre vie. La chaleur d’un rayon de soleil sur notre peau, la saveur de tel plat, l’harmonie enivrante et transcendante d’un morceau de musique, le bruit de la mer sur les galets, un jour, quelque part en Bretagne, l’odeur des pins dans la forêt des Landes, le chant des cigales dans la plaine languedocienne, les exemples ne manquent pas. Chacun a ainsi en lui une réserve d’émotions qui peuvent resurgir à n’importe quel moment. Il suffit d’un élément déclencheur pour que des souvenirs très précis, qui évoquent tout un pan de notre vie, refassent surface.
Evidemment, la période la plus propice pour engranger toutes ces émotions, c’est l’enfance puisqu’à cet âge le petit homme se comporte comme l’animal qu’il est vraiment et qu’il n’a pas encore subi le dressage ultérieur qui lui imposera de tenir un rôle dans la société et de ne rien exprimer de ce qu’il ressent. Petit à petit, il se fermera comme malgré lui aux impressions directes du monde extérieur, qu’il captait pourtant si bien et qui le rendaient si heureux, pour rationaliser tout et refuser d’écouter le langage si direct de ses sens. Du coup, tout ce qui est plaisir immédiat lié à ce contact du corps avec le monde sera définitivement banni.
Heureusement, les impressions premières sont restées bien gravées en nous et, comme je l’ai dit, il n’est pas rare qu’un rayon de soleil, une odeur, la subtilité d’un parfum ou une note de musique éveillent en nous des sensations oubliées et avec elles c’est toute l’époque où nous les avons connues qui refait surface, nous bouleversant d’autant plus.
Et quand on parle des sens, on pense immédiatement à la vue et à l’ouïe, mais l’odorat peut lui aussi jouer un rôle essentiel. Ainsi, quand je suis rentré en première primaire pour apprendre à lire, nous occupions des bâtiments en bois qui venaient d’être construits à la sortie de la ville et qui étaient situés au milieu des champs. Ces bâtiments avaient été traités à la lasure (ou au carbonil, je ne sais pas trop) et les jours de forte chaleur l’odeur acre qui s’en dégageait m’enivrait complètement au point que j’ai fini par associer cette école avec cette odeur. Plus tard, je suis parti, j’ai quitté ma campagne pour la grande ville et j’ai connu pas mal de lieux d’enseignement, si bien que petit à petit le souvenir de cette première école s’est estompé. Pourtant, il suffit qu’au hasard d’une promenade je repasse devant un bâtiment fraîchement repeint ou dont les volets, tout simplement, ont été repassés à la lasure, pour qu’immédiatement cette première école refasse surface et avec elle toutes les impressions que j’ai connues ces années-là, comme le plaisir de la lecture, l’odeur de l’encre dans les encriers, le touché doux des feuilles de buvard, la beauté mystérieuse des grandes cartes géographiques qui ornaient le mur ou la chaleur de juin, quand nous attendions en rang dans la cour pour rentrer en classe.
Le jour où j’ai quitté cette école, deux ans plus tard, je l’ai englobée d’un seul regard, sachant que je la quittais pour toujours et qu’un pan entier de ma vie s’arrêtait là. En juillet de cette année, je suis repassé dans cette région pour la première fois depuis toutes ces années. J’ai voulu aller revoir l’école au milieu des champs et la montrer aux personnes qui m’accompagnaient. J’ai retrouvé le chemin, j’ai reconnu les maisons qui bordaient la route, la grande prairie qui servait d’espace de jeux lors des beaux jours était toujours là, mais l’école avait disparu ! Rasée, anéantie, volatilisée, il n’en restait plus rien, comme si elle n’avait jamais existé. Elle demeurera donc à jamais dans mes souvenirs, il n’y a plus que là qu’elle subsiste ou dans la mémoire de quelque condisciple de l’époque, mais que sont-ils tous devenus ? Et les années passeront et chaque fois que me pénétrera l’odeur de lasure, la petite école en bois survivra encore un peu, du moins pour moi. Jusqu’au jour où, évidemment, elle disparaîtra vraiment à jamais.
Je voudrais citer un autre exemple de l’importance de l’odorat dans la structuration de nos impressions et de nos souvenirs. Il m’est déjà arrivé de croiser une inconnue qui portait un parfum que je suis capable de reconnaître entre tous et qui me renvoie aussitôt à une histoire d’amour vécue lorsque j’avais vingt ans. Alors, tous ces souvenirs que je croyais oubliés et auxquels je ne pensais plus se mettent à resurgir en vagues successives et avec une précision dans les détails que je n’aurais pas crue possible. Des scènes de ma vie d’alors refont surface et je me revois en train d’attendre une certaine jeune fille sur la place de la cathédrale ou bien en train de discuter avec elle dans un café, à quatre heures du matin ; je revois sa main posée sur la mienne ou les larmes qui un soir coulaient sur son visage… Je revois même l’impasse où elle habitait, étudiante ou, plus tard, cette rue en pente, à flanc de colline, que je gravissais, alerte, heureux parce que j’allais la retrouver. Et tout cela parce que j’ai croisé une inconnue que je n’ai même pas regardée et qui avait le même parfum que le sien. Alors, quand j’arrive à mon bureau, je suis tout étonné de me retrouver là car il me semble être encore des années en arrière. Il faut pourtant se mettre à travailler, malgré les regrets qui commencent à m’envahir et malgré la nostalgie que je peux avoir de ces temps irrémédiablement perdus.

Photo Internet
00:36 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : littérature
27/09/2009
Tempête dans un encrier
Aujourd’hui, comme c’est dimanche, j’invite tous les lecteurs à faire une petite balade. En effet, « Marche romane » est l’invitée du site « « Tempête dans un encrier », qui poursuit l’expérience commencée par les « Sept mains ». Le principe en est simple : six écrivains se relaient pour proposer chaque jour un texte (le lundi Emmanuelle Urien, le mardi Bertrand Redonnet, le mercredi Aglaé Vadet, le jeudi Stéphane Beau, le vendredi Manu Causse, le samedi Thomas Vinau). Et le dimanche, me direz-vous ? Et bien, ce jour-là, c’est à un invité surprise que l’on donne la plume. Il vous faudra donc vous déplacer pour lire mon texte du jour, texte qui est à la fois une balade dans le temps puisque je vous propose une relecture d’un conte que vous lisiez quand vous étiez enfant, mais aussi une balade dans l’espace puisque les protagonistes se promènent le long d’un chemin.
Notez aussi que nous avions déjà abordé ce thème autrefois ici, mais d’une manière disons plus sérieuse.
10:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, tempête dans un encrier
25/09/2009
La remise
J’ouvre la porte de la remise, tout au fond du jardin et je suis immédiatement envahi par l’odeur du bois de chauffage, qu’on a entreposé là, en belles piles régulières. C’est pour cette odeur, que je suis venu jusqu’ici. Je ferme les yeux et je respire, sans plus penser à rien. L’odeur chaude et tendre m’envahit complètement et des images de forêts profondes s’imposent à mon esprit. Puis je revois les stères de bois, tels qu’ils étaient alignés le long du petit chemin forestier, les myrtilliers épars, l’étendue des fougères… Il me semble presque percevoir sur mon visage la chaude brise du dernier mois d’août et entendre les feuillages qui s’agitent légèrement. Leur bruit me parvient par vagues successives, comme la houle d’une mer intérieure. Un geai a crié, cri d’alarme dans la quiétude du lieu. Un promeneur se serait-il aventuré jusqu’ici ? Non, dans la clairière, c’est un renard qui s’avance, l’œil aux aguets, concentré sur sa tâche de chasseur. Il s’arrête et renifle un petit tas de sciure fraîche au pied d’une souche. On le voit bien, dans cette mise à blanc : son pelage roux, ses yeux vifs… Puis il s’en va, trottinant, et disparaît dans le sous-bois.
Dans la remise, j’ouvre un instant les yeux, puis je les referme et respire de nouveau la bonne odeur du bois. Cette fois, c’est le bruit de la circulaire hurlante qui s’impose à moi. Il me semble voir les grosses bûches que l’on coupe une à une et les rondins plus petits qui s’amoncellent à terre, en un tas irrégulier. L’homme, devant la machine, est méconnaissable, car il porte un foulard sur le visage et de grosses lunettes protectrices. Mon rôle consiste à ramasser les rondins et à les empiler sur la brouette. Puis il y aura le rangement proprement dit. Les rondins que je prends un à un et que j’empile comme je peux, en tentant de ne pas perdre de place, de ne pas laisser le moindre espace vide. Parfois il faut tout recommencer, enlever deux trois morceaux de bois et les agencer autrement. Le tout doit former un mur bien droit, bien stable. Sur ma peau nue, sans gants, je sens la rugosité de l’écorce, les petites échancrures pointues laissées par la lame sur les bords de la bûche, les nœuds du bois, ces protubérances aux formes variées. Parfois, il me semble reconnaître un des rondins que je viens de charger sur la brouette. Puissance de la mémoire affective, puissance des choses, qui s’imposent à nous, malgré nous.
Plus tard, ce sera l’hiver et il aura neigé. Il faut mettre de grosses bottines pour traverser le potager et atteindre la remise. Je revois le grand panier d’osier, tressé à la main à partir d’écorce de noisetier. On le remplit de rondins, comme on peut. Ce n’est pas facile à cause de l’anse qui gêne les mouvements. Il fait froid, très froid et par la petite fenêtre un timide rayon de soleil donne un peu de clarté, juste ce qu’il faut pour que l’enfant puisse voir les volutes de vapeur qui s’échappent de sa bouche. L’odeur du bois a disparu, figée par la froidure, sans doute. Il faudra déposer le panier dans la cuisine près du gros poële pour qu’elle réapparaisse, plus discrète qu’à l’origine, mais bien présente quand même. Avec elle, c’est un peu de nature sauvage qui est entrée dans la maison. Le feu crépite doucement dans le foyer et il fait bon, tandis que dehors, la neige n’en finit plus de tomber. Déjà, dans le sentier, les traces de mes pas sont en train de disparaître.
Photo personnelle
00:02 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature
22/09/2009
La chambre
Maison-poème (fin)
De la chambre, il n’y a pas grand chose à dire, si ce n’est que c’était un endroit où on s’ennuyait profondément. L’enfant se souvient de ces réveils de grand matin (lui qu’on avait couché tôt au lit) où il se retrouvait dans un lit cage qui ressemblait à une prison. Du haut de ses deux ans, il se dressait comme il pouvait pour contempler le monde qui s’étendait au-delà de ces barreaux que les adultes lui avaient imposés avec un sens inné de l’autorité qui le laissait complètement pantois. Ainsi donc, à peine né, il se retrouvait incarcéré, entravé dans ses mouvements et cela sans avoir commis le moindre délit. Dans sa petite tête où les idées commençaient à se mettre en place, les concepts de liberté, de libre-arbitre et d’injustice se faisaient tout doucement un chemin. Pourquoi, en effet les parents, ces dieux omniscients au pouvoir absolu, pouvaient-ils aller dormir quand ils en avaient envie alors que lui devait aller au lit quand il n’avait pas sommeil ? Et pourquoi ces mêmes parents pouvaient-ils maintenant paresser dans leur chambre alors qu’il faisait déjà presque clair ? Soupir.
Il n’y avait donc rien d’autre à faire qu’à contempler pendant un temps indéfini qui semblait une éternité le petit canard en relief qui ornait la tête du lit et dont l’enfant suivait les contours avec ses doigts fragiles. Il regardait donc ce canard, le caressait, lui parlait, lui racontait des histoires et allait même parfois jusqu’à se disputer avec lui quand le stupide volatile semblait ne rien comprendre à ce qu’on lui disait.
Il fallait alors se tourner vers une autre activité et à vrai dire, dans cette prison, il n’y en avait qu’une. Elle consistait à regarder attentivement la tenture sur laquelle le soleil donnait déjà et à essayer d’imaginer ce que représentaient les formes géométriques qui y étaient dessinées. Objectivement, ces formes n’avaient rien d’extraordinaires en elles-mêmes et il suffisait de la présence d’un adulte dans la pièce pour qu’elles ne sortent pas de leur rôle. Mais là, quand l’enfant était seul, elles prenaient subitement des contours étranges, en partie probablement à cause des rayons du soleil qui traversaient le tissu. Alors, ce qui n’était pourtant la veille qu’un carré ou un losange devenait subitement une tête de lion rugissant ou quelque horrible monstre baveux et à la langue fourchue. Certes, on pouvait se raisonner et le petit homme ne s’en privait pas. Il savait pertinemment que tout cela n’était que le fruit de son imagination, il n’empêche qu’à un certain moment la peur l’emportait sur la raison et c’est véritablement pris de panique qu’il se réfugiait au fond du lit, sous les couches de couvertures.

Il faut dire qu’il faisait froid, dans la chambre. A cette époque, le chauffage central n’existait pas ou alors seulement chez les riches (lesquels, vous l’aurez remarqué aussi, possèdent toujours tout avant tout le monde). La maison n’était chauffée que par le gros poële de la cuisine et évidemment, la nuit, en hiver, quand le gel sévissait et que la neige avait imposé sa loi implacable, il ne faisait pas bon rester dans la chambre. Plonger sous la couette était donc une nécessité qui relevait du simple bon sens de survie. L’enfant, effrayé par les monstres qui s’agitaient sur la tenture, retrouvait donc une certaine quiétude une fois réfugié sous l’amas de couvertures et de coussins qui lui sauvaient ainsi deux fois la vie. Là, dans la douce tiédeur du lit, il retrouvait peu à peu ses esprits et sentait les palpitations de son cœur se calmer. Alors, timidement d’abord, puis avec de plus en plus d’audace, il repartait affronter les fameux monstres. Souvent, ceux-ci avaient disparu entre-temps et leurs gueules grimaçantes n’ornaient plus le haut de la tenture. Le soleil avait sans doute été caché par un nuage et la lumière s’étant affaiblie, elle n’avait plus la force suffisante pour animer ce bestiaire infernal qui semblait rappeler à l’enfant l’époque où il n’était pas encore né. Car il lui semblait avoir connu dans un autre monde ces créatures diaboliques et pour lui il ne faisait pas de doute qu’il existait quelque part un pays étrange où il avait séjourné avant de naître. Car peut-on concevoir qu’on soit ici aujourd’hui et qu’hier on n’ait pas été ? Non, cela ne se pouvait et l’enfant tentait désespérément de se souvenir de cet univers d’avant la vie, univers qui était encore bien proche, pour lui qui n’avait que deux ans.
Mais la mère arrivait, interrompant ces réflexions angoissantes sur l’origine de l’être et l’existence des présences infernales. D’un geste sûr, elle ouvrait les tentures et, si on était en été, le bon soleil entrait dans la pièce, reléguant définitivement les monstres aux oubliettes. Par contre, si on était en hiver, c’est une autre découverte qui attendait l’enfant. Ce n’était pas la rue et ses maisons familières qui apparaissaient à travers le rideau, mais une vitre opaque, aux mille dessins géométriques stylisés. Dans le froid matinal, l’enfant qu’on avait enfin fait sortir de son lit courait vers la fenêtre et de son petit doigt il suivait les contours de ces roses de glace que le froid avait dessinées dans le givre.
Mais il fallait vite descendre en bas, et s’habiller près du gros poële de fonte, qui déjà ronronnait en emplissant la maison d’une bonne chaleur douillette, tandis que dehors il neigeait sans arrêt.
00:17 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature
07/09/2009
Le propriétaire
Préambule :
Puisque nous avons parlé, dans un texte précédent, de ce propriétaire qui ne déliait pas facilement le cordon de sa bourse, même pour des travaux de première nécessité, il serait intéressant d’en donner une description plus détaillée, tant il ressemblait, comme je l’ai dit, au Père Grandet de Balzac. On sait que le héros de ce livre est devenu (avec l’avare de Molière, bien entendu), le prototype de l’homme avare, radin et près de ses sous, mais le mien n’avait rien à lui envier. Evidemment j’étais très jeune quand je l’ai croisé et forcément les faits que je raconte ici sont déformés par mes yeux d’enfant. Je ne dis pas que c’est la réalité, mais plutôt la réalité telle que j’ai pu la percevoir à cet âge. De plus, une partie de la description provient de ce que la rumeur publique pouvait colporter sur le personnage et on sait ce qu’il en est de la rumeur publique. Enfin, c’est bien connu, l’acte d’écriture transforme inévitablement ce que l‘on a vécu, en l’amplifiant, en le déformant, en le faisant rentrer dans la grille de lecture de notre subjectivité, ce qui fait qu’entre la situation de départ et ce que l’on retrouve couché sur le papier il y souvent un abîme. Mais cet abîme est aussi la trace du regard spécifique qui est le nôtre et je crois que c’est finalement ce que l’on cherche dans la littérature. Ni des faits réels, ni des histoires destinées à nous amuser, mais plutôt la manière unique dont un de nos semblables peut voir le monde. Parfois il le voit comme nous (et nous nous sentons confortés dans la pertinence de notre être), mais souvent il le voit différemment (ce qui nous ouvre alors d’autres horizons et nous fait percevoir ce que nous n’avions jamais perçu). Et comme la littérature n’est pas un jeu (comme les surréalistes ont pu parfois le croire) mais une réponse à nos angoisses existentielles (ou plus exactement une tentative de réponse car la littérature ne résout rien et ne fait que poser encore plus de questions), elle participe pleinement à nous rendre plus humains, par le fait qu’elle provoque en nous une prise de conscience de notre destinée.
= = = = = = = = = = = = = = =
Ce vieux monsieur, qui dépassait les quatre-vingts ans, tenait à avec sa fille (une demoiselle restée célibataire qui flirtait avec la soixantaine), une petite épicerie dans le haut de la ville. Il avait économisé toute sa vie, ce qui fait qu’il possédait au moins une vingtaine de maisons, peut-être une trentaine, je ne sais pas exactement. Son avarice était légendaire. On disait qu’en hiver, par exemple, il ne chauffait pas sa maison, à part le magasin qui accueillait ses clients, sinon évidemment tout le monde aurait déserté son établissement et son chiffre d‘affaire s’en serait ressenti. Alors, quand la froidure se faisait par trop sentir et que ses mains commençaient à s’engourdir, il venait se réchauffer dans la boutique. Je le revois encore, pendant que sa fille servait derrière le comptoir, assis sur une vielle chaise pliante récupérée je ne sais où, tendant ses doigts transis devant le petit poële de fer blanc qui diffusait une chaleur timide. Il était enveloppé dans une couverture rapiécée et contemplait la petite casserole de soupe qu’on avait mise à réchauffer là, afin sans doute d’épargner la cuisinière à gaz qui devait se trouver quelque part dans le logement.
Il restait là sans rien dire, répondant d’un simple signe de tête aux nouveaux arrivants qui le saluaient et s’enquéraient de sa santé. Il semblait éteint, moribond et avait des gestes d’une lenteur de tortue. Pourtant, quand la caisse enregistreuse faisait son déclic caractéristique et qu’elle s’ouvrait pour engloutir les petits sous, il fallait voir alors comme son œil pétillait. On aurait dit que toute la vie qui lui restait s’était concentrée dans ce regard, dont la vivacité offrait alors un contraste étonnant avec sa vieille carcasse décatie. En attendant, les hivers passaient les uns après les autres et il était toujours là, tandis que certains clients avaient déjà rejoint l’autre rive, terrassés par l’une ou l’autre de ces maladies étranges et terribles qui faisaient chuchoter les ménagères à mi-voix quand elles attendaient dans la boutique leur tour pour être servies.
- Et vous savez Un Tel, il est mort en trois jours sans que le médecin ait pu faire quoi que ce soit. Pourtant il fallait voir la force qu’il avait !
- Non ? C’est pas vrai ! Remarquez qu’au moins il n’aura pas souffert longtemps. Ce n’est pas comme le grand Joseph de ma rue, qui est resté alité pendant cinq longues années et qui ne se souvenait même plus qui il était. Même que sa femme n’en pouvait plus de toujours le soigner au point qu’elle est partie avant lui, d’épuisement probablement .
Le gamin que j’étais écoutait tous ces malheurs dont se délectaient littéralement les commères, lesquelles, leur cabas à la main, semblaient intarissables. On aurait dit qu’elles se complaisaient dans ces drames et plus c’était horrible, plus elles semblaient contentes. Je jetais un œil discret vers le vieillard en me disant que tout de même elles auraient pu lui épargner la description de toutes ces agonies, lui qui avait déjà un pied dans la tombe… Mais il ne semblait rien entendre, comme si tout cela ne devait jamais le concerner et il se contentait de tourner de temps à autre dans son potage avec une vieille cuillère en bois, sans jamais perdre de vue ce qui se passait au comptoir. Pendant que cela discutait ferme des malheurs du monde, lui il calculait mentalement le bénéfice que lui rapportait chaque salade que sa fille sortait d’un cageot ou chaque paquet de café qu’elle allait chercher en haut d’un rayonnage, montée sur une échelle branlante à laquelle il manquait un échelon.
Evidemment, les temps étaient durs, même pour lui, car il devait avoir en tête d’acheter d’autres maisons et on sait bien que pour cela il faut de l’argent, beaucoup d’argent. Alors, comme il n’avait que son petit magasin pour vivre (en plus de tous ses loyers, évidemment), il avait trouvé un moyen très simple pour faire fructifier ses affaires. L’art du commerce, c’est bien connu, consiste à vendre très cher au détail ce que l’on a acheté bon marché en gros, cela il l’avait toujours su. Mais là où il dépassait tous ses collègues et concurrents en ingéniosité, c’est qu’il avait imaginé de rogner sur les quantités des produits qu’il vendait. Ainsi, tous les paquets d’une demi-livre de beurre étaient délicatement ouverts et il en retirait une fine lamelle avant de refermer le tout. Après avoir répété la même opération une bonne dizaine de fois, il parvenait ainsi à vendre un onzième paquet qu’il n’avait pas dû acheter. Il procédait de même avec les paquets de café en grains ou encore avec le sucre fin.
Cette pratique un peu scandaleuse, il faut l’avouer, était connue de tous, mais en ces temps où les voitures étaient encore rares et où il n’était pas facile de se déplacer, chacun trouvait son compte dans ce petit magasin de proximité. Si on désapprouvait cette manière de faire, on le chuchotait en rue, mais jamais dans la boutique, par une sorte d’accord tacite entre tous. Pourtant, certaines clientes étaient plus difficiles et il y en avait parfois une qui se montrait récalcitrante au point de rompre le pacte. Je me souviens ainsi d’avoir vu une brave dame refuser une bouteille de limonade qui avait été ouverte et dans laquelle il manquait manifestement un peu trop de liquide. Mais bon, ces incidents regrettables étaient rares et d’une manière générale le vieux monsieur parvenait tout de même à arrondir subtilement ses fins de mois.
L’argent qu’il gagnait, on s’en doute, ne servait pas à améliorer son existence quotidienne, mais prenait tout droit le chemin de la banque. On avait l’impression qu’il craignait pour ses vieux jours et qu’il se constituait pour plus tard un petit magot rassurant, à l’abri des regards. Le problème, c’est qu’il avait déjà plus de quatre-vingt ans, ce qui fait que tout le monde se demandait à quel âge il envisageait de mourir. A ceux qui lui disaient qu’il serait temps qu’il profitât un peu de la vie, il répondait par le silence, se contentant de lever une main dans un geste dubitatif, comme pour signifier qu’on ne savait jamais ce que le hasard pouvait bien réserver et qu’il valait mieux être prudent. On ne pouvait pas dire qu’il travaillait pour ses petits-enfants, puisqu’il n’en avait pas, sa fille unique ne s’étant jamais mariée, par crainte sans doute des maris dilapidateurs de fortune. Quant à elle, seule héritière du patrimoine immobilier que constituaient les trente maisons, elle semblait à l’abri du besoin, d’autant plus qu’elle n’était déjà plus si jeune.
Pourtant, la rumeur disait que dans cette maison on ne mangeait pas à sa faim. Les visites chez le boucher étaient rares et se limitaient aux grandes fêtes du calendrier, encore parvenait-on à se contenter de bien peu, comme cent grammes de saucisses ou quelques pieds de porc (lesquels allaient cuire interminablement dans une marmite sur le poële de la boutique, ce qui, ces jours-là, écourtait considérablement la conversation des ménagères, avides pourtant de mille ragots à colporter). Parfois, on voyait le vieux monsieur se lever de sa chaise comme à contrecœur et d’un pas lent et résigné aller prendre une boîte de petits pois sur un rayonnage avant de disparaître dans sa cuisine. Manifestement, cette boîte constituait tout le repas de cet étrange couple, le père et la fille, si bien assortis qu’on finissait par les confondre. Il était même à craindre que ce ne fût là le seul repas de la journée car on n’avait jamais vu le moindre boulanger s’arrêter devant la boutique et quant à aller chercher eux-même leur pain, ils n’en avaient pas le temps, évidemment. Quand on tient soi-même un commerce, il faut savoir se consacrer aux clients, c’est bien connu, n’est-ce pas ?
Bon, j’arrête là la description de mon père Grandet local, n’ayant pas beaucoup d’autres éléments à rapporter. Quand il eut repris la maison que nous occupions (avec la nouvelle serre), j’ai déménagé puis un peu après j’ai changé de région, ce qui fait que j’ai perdu de vue tout ce petit monde. J’ai appris plus tard que le vieux monsieur était mort à cent trois ans, fort étonné, probablement, que la vie ne lui ait pas laissé le temps de profiter de son petit capital.

Le Père Grandet (dessin de Henri Monnier)
23:03 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature
03/09/2009
Les cercles magiques.
Sur la plage, l’enfant trace un cercle avec un bâton, puis un autre et encore un autre. Trois cercles concentriques qui délimitent un disque d’un mètre de diamètre environ, dont il aplanit maintenant délicatement la surface avec les mains. Puis il va chercher quelques branches de pins odorants qu’il dispose religieusement le long du premier cercle. Ensuite, il parcourt le rivage et revient avec des galets blancs, qu’il place uns à uns sur le périmètre du deuxième cercle. Le voilà maintenant parti tout la-bas, à la limite de plage et des grandes dunes qui circonscrivent l’espace marin. Je le distingue à peine, silhouette minuscule au pied d’un grand arbre. Puis le voilà qui revient en courant, rayonnant, car il a trouvé ce qu’il cherchait. Tout autour du troisième cercle il dispose alors des feuilles d’eucalyptus, dont l’odeur entêtante envahit tout l’espace. Ensuite, très sérieusement, l’enfant se tient debout devant son chef d’œuvre et marmonne quelque chose, cela pourrait être une chanson ou une prière, on ne sait pas bien, mais ce sont des paroles qui pour lui prennent la tournure d’une formule magique, c’est évident. Puis, d’un bond, il saute à pieds joints au centre du cercle et reste là, tout penaud, étonné qu’il ne se passe rien.
Je souris de sa naïveté et replonge dans mon livre. Quelques instants plus tard, intrigué par le grand silence qui règne autour de moi, je lève les yeux et à ma grande surprise je constate que l’enfant a bel et bien disparu.
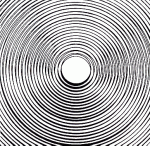
00:37 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature
02/09/2009
La mer (suite)
Derrière la dune que je gravis pieds nus, des cris se font entendre, sorte de gémissements plaintifs tels ceux d’une fille en pleurs. Mais je suis loin, si loin.
Derrière la dune que je gravis aussi vite que je peux, je perçois la plainte du vent et le claquement des câbles contre le mat des navires. C’est du moins ce qu’il me semble.
Derrière la dune, tandis que mes pieds n’en finissent plus de s’enfoncer dans le sable, j’imagine des départs vers des ailleurs ultramarins, des tropiques incroyables, des caps Horn mystiques. Trois grands bateaux prennent le large, tandis qu’une femme, sur la plage, pleure l’absence de son capitaine, seule, irrémédiablement seule. C’est que c’est un voyage sans retour et elle le sait.
Quand j’arrive au sommet, quand je franchis la ligne, quand je laisse enfin derrière moi la dune et son sable, je découvre la mer et la plage immense, déserte comme au premier jour. Il n’y a personne ici. Dans le ciel, seule plane une mouette, dont le cri strident, tel un long sanglot, se répercute à l’infini dans ce lieu solitaire.
A l’horizon, trois petits points, comme trois voiles mystérieuses, semblent voguer de concert avant de disparaître dans l’immensité bleue.
C’est du moins ce qu’il m’a semblé.

Photo Internet : Bruno Monginoux /
Photo-Paysage.com (cc-by-nc-nd)
00:56 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature
26/08/2009
La serre
Maison poème
J'intitule ce texte « la serre » car je ne trouve pas d'autre mot pour désigner cette espèce de verrière qui prolongeait la cave, par une sorte d'aberration architecturale à laquelle personne n'avait jamais pu trouver le moindre sens. En effet, en principe, une serre renvoie aux concepts de clarté, de chaleur et de plantes quasi tropicales. Rien de semblable ici, évidemment. Les vieux carreaux consolidés avec du papier goudronné ne laissaient passer qu'une lumière diffuse, ce qui donnait à la cave adjacente des airs d'aquarium et pour un peu on se serait cru au fond de la mer. Sans compter que ladite verrière laissait abondamment passer l'eau les jours de pluie, ce qui renforçait encore la certitude que ce lieu entretenait avec l'élément aquatique des liens aussi profonds que secrets.
Pour mieux comprendre la topographie des lieux, il faut imaginer que l'excavation qui avait été faite pour construire la maison était exagérée par rapports à la surface de celle-ci. Les ouvriers s'étaient visiblement retrouvés avec un trou à devoir combler une fois l'habitation terminée et il me plait de penser que c'est par paresse qu'ils ont imaginé cette sorte de verrière qui venait donc prolonger la cave dans le sous-sol, mais qui en surface offrait l'énorme inconvénient de se situer au même niveau que la cour. Point de jeux de ballons pour l'enfant que j'étais, évidemment, car les carreaux auraient été immédiatement cassés. Je peux avouer aujourd'hui que cette situation m'arrangeait bien, car j'ai toujours eu pour les ballons une aversion viscérale et à vrai dire si profonde qu'elle doit être d'origine génétique, il n'y a pas d'autre explication. Il n'en restait pas moins que cette serre qui, à l'extérieur, se retrouvait de plain-pied avec le sol, constituait un véritable danger car quelqu'un d'un peu distrait ou qui aurait été victime d'un soudain étourdissement, se serait immédiatement retrouvé dans la cave après avoir été déchiqueté par la verrière.
Celle-ci représentait donc un danger potentiel et tout le monde s'en méfiait. Il nous fallait pourtant bien vivre avec elle, ce qui revenait à se comporter comme on le fait avec un animal qu'on nous dit être gentil mais dont on sait qu'il appartient à une race agressive. Bref, la serre, par son emplacement, constituait une menace permanente pour notre intégrité physique, ce qui n'était pas rien. Malheureusement, c'était loin d'être tout. Son état de vétusté était tel qu'on se demandait bien comment la vieille structure métallique toute rouillée parvenait encore à supporter le poids des carreaux, alourdis encore par le papier goudronné dont j'ai déjà parlé. A l'extérieur, on avait donc peur de passer par inadvertance à travers la verrière, de par sa position au niveau du sol, et à l'intérieur on redoutait de tout recevoir sur la tête, ce qui semblait de plus en plus probable au fur et à mesure que les années s'écoulaient. Ajoutez à cela le manque de clarté et les infiltrations de pluie et vous aurez compris que cette serre était devenue pour tous un véritable cauchemar et qu'elle alimentait souvent les conversations.
En tout cas, je lui dois mon premier cours d'économie domestique et la conscience que la lutte des classes n'est pas un vain mot. Je m'explique.
Chaque fois qu'il avait l'occasion de croiser le propriétaire (c'est-à-dire au moins une fois par mois), le père ne manquait pas de souligner la dangerosité de la situation. A chaque fois, évidemment, on lui répondait que ce n'était pas la saison, que les moyens manquaient, qu'il faisait trop chaud ou trop froid, bref, que cela pouvait bien attendre encore un peu, par exemple jusqu'à l'année prochaine. Allons, disons même jusqu'à la fin de l'année prochaine, ce sera plus sûr. Mais une fois la période prévue arrivée, le terme reculait aussitôt du même nombre de mois que l'année en comportait, ce qui fait que les travaux étaient reportés de douze mois et en réalité ne se faisaient jamais. Pourtant, sur le terrain, la situation empirait, ce qui fait que le père en vint à proposer un compromis. Pour autant qu'on lui payât les matériaux, il s'engageait à construire lui-même une nouvelle serre, ce qui en outre donnerait une plus value à cette maison qui ne lui appartenait pas. Le propriétaire écouta un peu plus attentivement ses propos, mais finalement il dit que non, que ce n'était pas possible dans l'immédiat : il ne disposait pas des liquidités suffisantes pour acheter les trois cornières de métal et la grande plaque de plastique ondulé qui seraient nécessaires. C'est qu'il avait à entretenir une bonne vingtaine de maisons et on n'imaginait pas tous les frais que cela occasionnait et qu'il devait assumer. Bref, au mieux, on verrait l'année prochaine, mais il ne promettait rien. Tenace, le père renouvela pourtant son offre plusieurs fois si bien qu'un jour, à la surprise générale, l'accord oral fut donné. Ce fut une surprise, assurément et on mit sur les qualités de persuasion du paternel d'avoir remporté la bataille. Certes, il fallut encore attendre quelques mois avant que Crésus ne se décidât à ouvrir son portefeuille, mais après tout, on pouvait comprendre, ce n'était pas la saison, n'est-ce pas ?
Puis vint enfin le jour où les travaux débutèrent. Le père acheta donc lui-même ce dont il avait besoin et transporta comme il put tout ce matériel dans sa petite voiture (une quatre chevaux Renault), ce qui en soi constituait déjà un exploit. A la réflexion, ce fut même un miracle s'il y parvint et il faut croire que les dieux, touchés par notre obstination, avaient décidé de prendre notre parti.
C'est comme cela que la famille se retrouva avec une serre convenable, sur laquelle on avait moins peur de faire une chute fatale (puisque le panneau de plastique était solidement fixé à des chevrons de qualité), qui ne risquait plus de s'effondrer à la cave et qui, ô merveille, non seulement ne laissait plus passer l'eau mais qui en plus diffusait une lumière douce et agréable.
Nous en profitâmes pleinement deux mois entiers, jusqu'au moment où le propriétaire signifia qu'il rompait le bail pour occuper lui-même la maison. Le vieux grigou, âgé de près de quatre-vingt ans, venait de décider de prendre sa pension et de ne plus s'occuper de l'épicerie qu'il tenait dans le haut de la ville. Il loua donc son commerce au plus offrant et vint occuper notre maison, qui était la plus petite de toutes celles qu'il possédait et donc celle qui lui rapportait le moins. Mais vous comprenez, pour une personne seule, c'était bien suffisant, n'est-ce pas ?
Epilogue :
Avec le recul, je me dis que ce vieux monsieur, qui avait tout du père Grandet de Balzac, m'a donné une bonne leçon de vie. Malgré mes six ans, j'avais en effet compris qu'il existe des possédants et des possédés et que le sens moral qu'on essayait de m'inculquer ne concernait évidemment pas certaines catégories de la population. Leur argent les mettait au-dessus de tout cela puisque, de toute façon, il leur permettait d'obtenir le respect des autres.
15:34 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, la serre
12/08/2009
La mer
Je marche pieds nus sur le chemin sablonneux. Devant, ce seront bientôt les dunes et leurs herbes folles, indomptées, un peu coupantes aussi (il va falloir faire attention). Et puis ce sera la mer, celle qu'on ne voit jamais, celle dont on ne fait que rêver. Enfin, d'habitude. Derrière, se dressent les montagnes, je le sais, inutile de me retourner. Hier encore je gravissais leurs pentes, avec de solides bottines et un sac à dos. C'est de là-haut, tout là haut, que j'avais vu la mer, véritable toile de fond dans un tableau de la Renaissance. Malgré la chaleur, elle était d'un bleu intense et semblait éternelle. Les Grecs déjà, l'avaient parcourue, puis les Romains et tous ces autres venus du Nord, issus de ces pays sans soleil où la neige et le froid tiennent lieu de paysage.
La mer était donc là, comme dans le poème de Valéry, sorte de « toit tranquille où marchent des colombes », et soudain l'envie m'était venue d'aller la voir de plus près, de sentir son odeur, de la toucher du bout des doigts et de goûter la saveur du sel sur ma peau.
Je suis redescendu des sommets dans la nuit qui tombait déjà et qui n'en finissait plus d'effacer les contours et les distances. Ce n'est qu'en franchissant le pont de la petite rivière que j'ai su que j'étais tout en bas. La chaleur était intense, obsédante, enveloppante aussi, comme dans ces rêves qu'on fait parfois et dont on sort au réveil trempé de sueur. Dans le lointain des forêts, un hibou solitaire hululait.
Aujourd'hui, je marche pieds nus sur le chemin sablonneux.
Au-dessus de moi le ciel est bleu, immense, d'encre profonde et de désir.
La lumière est aveuglante.
Je marche et dans ma tête défilent toutes les attentes et tous les espoirs. Une légère brise, déjà, se fait sentir. Voici les dunes et leurs herbes coupantes. Qu'y aura-t-il derrière ?

15:41 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, poésie, la mer
07/07/2009
La cave
La cave... Impossible de descendre dans une cave sans avoir l'impression de transgresser une limite et de pénétrer dans un autre monde. La cave est un lieu souterrain, un lieu de mystère, plongé dans le noir, dans la grande nuit de la mort.
C'était, je m'en souviens bien, un endroit interdit, probablement à cause de la présence d'un escalier assez dangereux, mais pour moi cette interdiction était la preuve que la cave recelait des mystères inquiétants. Et en effet, à peine avait-on descendu les marches qu'on se retrouvait devant la porte toujours close de ce qu'on appelait « la petite cave ». Je ne passais devant cette porte qu'avec la plus grande vigilance et ce n'est que de loin que j'osais l'observer. Je savais, pour l'avoir vue un jour entrouverte, ce qui se cachait derrière : une sorte de boyau étroit, mais long, si long qu'on en devinait à peine le bout dans la quasi-obscurité que ne parvenait pas à vaincre une ampoule rachitique. Ce qui m'avait frappé, c'était l'absence totale de fenêtre. Pas le moindre soupirail, pas le plus petit interstice par lequel la lumière du jour aurait pu pénétrer. Un endroit de cauchemar, assurément. Et comme il n'y avait rien dans cette cave, j'en déduisais qu'elle était en fait un corridor souterrain qui devait mener Dieu seul savait où, quelque part dans les entrailles de la terre. Plus loin, incontestablement, devait se trouver une prison moyenâgeuse, une sorte d'oubliette où on jetait les enfants dont on avait pu se saisir.
Le fait que même mes parents ne pénétraient jamais dans ce lieu renforçait mes craintes tout en les confirmant. C'était un lieu maudit, vous dis-je, et pour rien au monde je n'aurais franchi le seuil de cette tombe, où j'aurais été contraint d'errer dans le noir absolu, tâtonnant maladroitement le long des murs humides, m'écorchant les doigts à leurs pierres rugueuses. Tout au bout, des soldats en armures m'auraient saisi et emporté plus loin encore, dans un endroit de terreur dont je ne serais jamais revenu. Rien qu'à regarder la porte pourtant soigneusement close de cette « petite cave », il me semblait entendre dans le lointain le cliquetis de leurs épées et le bruit métallique de leurs armures. Après m'être raconté deux ou trois histoires absolument terrifiantes, je remontais l'escalier en courant, affolé pour de bon et c'est le cœur battant que j'arrivais à la lumière du jour, en plein solstice d'été, dans la chaleur de midi. On me regardait avec étonnement, mais mes yeux exorbités disaient assez d'où je venais et on ne me posait donc aucune question. Je vivais ce silence comme une preuve supplémentaire de la réalité des horreurs qui se déroulaient immanquablement dans cette cave et qui étaient si terribles que personne n'osait même en parler.
Mais reprenons notre visite. Sous l'escalier, se trouvait un renfoncement où on mettait au frais la réserve de pommes de terre, en provenance directe du potager. Au printemps, l'appel de la belle saison était tel qu'elles se mettaient toutes à faire des germes incroyables, sortes d'excroissances blanches ou bleutées qui témoignaient que la vie, toujours, était là, palpitante, au cœur de la nuit souterraine. Mais je m'attardais peu à contempler ces tubercules et leurs mystères, à cause de la proximité de la « petite cave ». Je préférais passer en courant et aller directement dans la « grande cave », qui était le règne de ma mère. A l'entrée se trouvait le garde-manger (j'ai parlé, déjà, de l'absence de frigo), où on tentait de conserver tant bien que mal les restes de repas en profitant de la fraîcheur du lieu. C'était souvent peine perdue, surtout lorsque le temps était à l'orage et il fallait alors jeter cette nourriture pourtant si précieuse. Comme le rayonnage de la cuisine, ce garde-manger était une fabrication artisanale du père, faite de bois et de treillis métallique, lequel avait pour fonction de protéger des insectes et de laisser passer l'air. J'avoue que c'est le seul garde-manger que j'ai vu dans ma vie, aussi quand à l'école, beaucoup plus tard, j'ai étudié le pluriel des noms composés, ce n'est pas sans fierté que j'ai retrouvé ce mot dans la liste des substantifs comportant le mot « garde » (garde-chasse, garde-meuble, etc.). Tandis que me petits condisciples se demandaient à voix basse ce que pouvait bien être un garde-manger, moi je souriais intérieurement et il me semblait que l'instituteur ne l'avait glissé là qu'à mon intention.
Un peu plus loin dans la cave se trouvait la machine à laver. Progrès technologique incroyable que cette machine, surtout pour ma mère qui avait encore connu le lavoir public dans son village et la glace qu'il fallait casser en hiver pour rincer le linge. Pourtant cette machine était constituée d'une simple cuve avec une hélice. Cela veut dire qu'il fallait préalablement chauffer de l'eau dans une lessiveuse aussi grande que l'enfant que j'étais. Je revois encore les flammes bleues du brûleur à gaz qui léchaient le fond de cette lessiveuse et qui constituaient, pour peu qu'on éteignît la lumière, autant feux follets bleutés qui dansaient dans l'obscurité. Une fois l'eau bien chaude, il fallait la transvaser dans la machine à laver, opération délicate et dangereuse à laquelle je n'ai jamais été autorisé à participer, ce qui fait que j'ignore toujours comment on s'y prenait pour mener cette opération à bien. Ensuite, il fallait actionner l'interrupteur de la machine et faire tourner le linge un temps qui me semblait une éternité.
C'est que j'avais hâte d'arriver à l'étape suivante, qui m'était confiée. Une fois le linge ressorti de la cuve, il fallait l'essorer en le faisant passer entre deux rouleaux fixés à la machine et qu'on actionnait à l'aide d'une manivelle. C'était un plaisir que de voir les linges gorgés d'eau se faire happer par ces rouleaux, s'aplatir autant qu'il était possible et rendre, dans un bruit de cascade, toute l'eau dont ils étaient gorgés. Ils ressortaient à l'autre bout complètement aplatis, complètement ridicules aussi, pauvres petites choses insignifiantes et plates dans lesquelles il était bien difficile de reconnaître une taie d'oreiller ou un pyjama. Quand tout cela était terminé, comme si leur sort n'était pas encore assez cruel, ils passaient à l'essoreuse, machine incroyable qui à l'époque représentait la pointe de la technologie (surtout si on la comparait à la machine à laver) et qui à ce titre faisait la fierté de toute la famille. Pourtant, quand je voyais ma mère la maintenir tant bien que mal quand elle prenait de la vitesse dans un bruit de sirène, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui arriverait si jamais elle la lâchait. Emportée dans sa course tourbillonnante, l'essoreuse aurait fait toute seule le tour de la cave avant d'aller s'encastrer contre un mur dans un grand bruit de ferraille, ce qui, heureusement, n'arriva jamais.
00:01 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature
01/07/2009
La cuisine
Maison poème
Chez nous, en ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Chez les autres non plus, à vrai dire, mais chez nous il y en avait encore moins que chez les autres. Alors, si je devais vous décrire les meubles de la cuisine, je serais bien embêté parce qu'il n'y en avait pas.
Heureusement, la pièce était très petite, comme toute la maison d'ailleurs, ce qui fait que le visiteur qui entrait n'était pas frappé par cette absence de meubles, pourtant bien réelle. Dans le prolongement de la porte, contre le mur de gauche, trônait une desserte à roulettes. On n'a jamais su pourquoi ma mère l'avait achetée car elle n'a jamais servi à rien, si ce n'est à déposer la cage du canari. Celui-ci, par contre, on savait bien à quoi il servait : son rôle était d'égayer la maison et de faire oublier sans doute que nous étions un peu démunis. Alors, éternel prisonnier dans sa cage, le pauvre s'acquittait du rôle qui lui avait été assigné en chantant du matin au soir. Il chantait bien en plus et très juste. Je l'écoutais pendant des heures, étonné quand même qu'il prît tant à cœur son travail de forçat. Je me disais en le contemplant qu'il y avait plus mal loti que nous. Condamné à la prison à vie, il chantait quand même et exultait sa joie de vivre en petit philosophe qu'il était. Parfois je me demande s'il ne m'a pas appris davantage de choses sur la vie que les frères des écoles chrétiennes, mais bon, ce n'est pas là notre sujet et nous en parlerons une autre fois.
A part la desserte et son canari, donc, il n'y avait rien contre le mur de gauche. Au bout, dans le coin, on trouvait l'évier (d'origine). Un rideau à fleurs habilement passé dans une tringle cachait les ustensiles qu'on déposait en dessous, comme le savon et les éponges.
Le mur du fond, en prolongement de l'évier, ne comportait qu'une fenêtre ainsi que la porte donnant sur le jardin. Au printemps on enlevait les grands rideaux blancs supposés nous protéger du froid hivernal (ce qu'ils faisaient bien mal, à vrai dire) et on les remplaçait par de petits rideaux avec des motifs représentant des cerises rouges. Cette couleur égayait aussitôt la pièce, que la lumière envahissait soudainement grâce à la partie de la vitre désormais laissée libre. C'était une joie, quand je revenais de l'école, de découvrir que les petits rideaux à cerises rouges avaient refait leur apparition. Ils annonçaient déjà l'été et le retour des grandes vacances.
Durant ces étés caniculaires (avez-vous remarqué comme les étés étaient toujours beaux et chauds dans nos enfances ?), la porte restait grande ouverte et un rideau en plastique composé de lanières de différentes couleurs retenait la chaleur à l'extérieur tout en empêchant les insectes d'entrer. C'était un plaisir délicieux, avec ma petite voisine, de passer et de repasser sans arrêt entre ces rubans qui sentaient bons la matière synthétique, jusqu'au moment évidemment où un adulte s'apercevait de notre manège. On se faisait alors réprimander vertement sous prétexte que nous allions abîmer le précieux rideau, qui n'était pas un jouet. Pourtant, étant donné la chaleur étouffante qui régnait à l'intérieur de la cuisine, complètement privée d'air, et le nombre de mouches qui volaient dans tous les sens, je me disais que ce rideau si inefficace n'avait d'autre but que d'agrémenter mes journées, notamment en me permettant de frôler délicieusement les membres ou le dos dénudés de ma compagne de jeu, qui, si elle avait déjà franchi les rubans multicolores et était ainsi devenue invisible à mes yeux, ne semblait jamais assez rapide pour s'esquiver, sans qu'on sût jamais si elle le faisait exprès ou pas.
Mais je m'égare, revenons à notre description. Au milieu du troisième mur de la cuisine, trônait le grand poêle de fonte, sorte de gros crapaud énorme qui occupait un cinquième de la pièce à lui tout seul et qui, en hiver, était capable d'ingurgiter une quantité astronomique de bois de chauffage. Ce bois que mon père allait couper lui-même en pleine en forêt durant les mois d'été, ce bois qu'il avait dû transporter jusqu'à la maison, puis qu'il avait dû refendre, scier et finalement empiler dans la remise du jardin, ce bois, dis-je, voilà que ce gros bêta de poêle l'avalait sans aucune retenue, en demandant et en redemandant sans cesse. Il était semi-circulaire, avec une taque noire où s'engouffraient les bûches et, sur les côtés, des garnitures chromées qui déformaient le visage de l'imprudent qui osait se regarder dedans. Je me souviens des matins d'hiver, avant l'école, quand je grignotais une gaufre (ces grosses gaufres nourrissantes faites dans un moule en fonte qu'on disposait directement au-dessus de la flamme), les pieds dans le four latéral du poêle qu'on venait juste d'allumer. C'est qu'il avait bien du mal à combattre la froidure de la nuit qui continuait à s'éterniser dans la pièce et qui avait laissé aux vitres ces roses magnifiques que je contemplais avec émerveillement dans mon demi-sommeil, quand je ne me mirais pas dans les garnitures en chrome qui me renvoyaient l'image d'un bien étrange personnage qui n'était autre que moi-même.
Quant au quatrième et dernier mur, il était un peu la honte de la maison, aussi s'arrangeait-on souvent pour que les visiteurs, si d'aventure il s'en trouvait, lui tournassent d'office le dos. C'est que contre ce mur, là où aurait dû se dresser un beau meuble en chêne, un vaisselier de style ou un de ces mastodontes tout d'une pièce qui font l'orgueil des familles de génération en génération, se cachait, derrière son rideau, une ridicule petite étagère. Et encore, quelle étagère ! Elle n'était même pas faite de ce bois stratifié et lisse qu'on trouve dans les magasins et qui, s'il n'est d'aucune beauté, offre au moins l'avantage d'être facile à nettoyer. Non, ce qui misérablement était adossé au mur, c'était un simple rayonnage de bois brut à peine raboté, dont beaucoup n'auraient même peut-être pas voulu pour leur cave. On y rangeait toute la vaisselle et surtout ces casseroles émaillées pleines de coups dont je me demandais toujours de quelle guerre elles étaient les rescapées. Pour cacher tout cela (quand même!), un rideau monté sur sa tringle, le même rideau, ô luxe inouï, que celui qui dissimulait le dessous de l'évier, preuve que la maîtresse de maison avait du goût et qu'elle aurait accompli des merveilles si les moyens lui avaient été donnés. Comme ce n'était pas le cas, elle se rabattait, avec cette dignité qu'ont les gens démunis, sur ces petites coquetteries qui rendent agréables des maisons qui sans cela ne le seraient vraiment pas.
Car en ce lieu, même si c'était une cuisine, il ne fallait pas chercher de frigo, sans qu'on sache bien si c'était le manque de liquidités du ménage ou l'exiguïté de la pièce qui en avait rendu la présence impensable. Il ne fallait pas chercher non plus de poste de télévision, ni dans cette pièce-ci ni dans aucune autre d'ailleurs. Le luxe et la modernité, ce n'était pas pour nous et ma foi c'était peut-être mieux ainsi. Pour l'enfant solitaire que j'étais (quand la petite voisine n'était pas là, ce qui arrivait souvent, soit qu'elle eût trouvé des filles de son âge pour s'amuser, soit que, déjà, elle me fût infidèle) il ne me restait plus qu'à apprivoiser mes rêves et à contempler les formes étranges que prenaient les nuages quand le vent les poussait en troupeaux indisciplinés vers l'horizon inconnu.
09:45 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : littérature, la cuisine
28/06/2009
Cercles concentriques
L'homme, de par son regard, a une vision circulaire du monde, contrairement à ce que pourraient nous faire croire les rues bien rectilignes de nos villes.
La terre est ronde et ce que je peux observer du paysage quand je me place sur une hauteur, c'est un grand cercle dont j'occupe le centre. Du coup, dans la préhistoire déjà, l'homme s'est cru le centre de tout. Il l'a dit dans ses mythes et la religion l'a conforté dans ses convictions.
Pourtant, cet homme, qui par ailleurs est intelligent, s'est vite rendu compte que ce centre changeait d'endroit en même temps que lui lorsqu'il se déplaçait. Lui-même restait au milieu de tout, mais ce milieu pouvait se trouver n'importe où. C'est pourquoi le fait de se sédentariser le rassura. Non seulement il trouvait là un genre de vie plus commode et moins tributaire du hasard, mais aussi il se redonnait du même coup une place précise et unique dans l'univers : il était et pour toujours au centre de son monde à lui.
Il lui fallut alors, comme un animal, marquer son territoire. Faute de pouvoir dire qui il était, il pouvait au moins dire ce qui était à lui. Les premiers fossés furent creusés (qu'on se souvienne du sillon sacré que Romulus aurait tracé lors de la fondation de Rome, ce qui l'amènera aussitôt à tuer son frère Remus qui avait osé franchir cette limite symbolique) et les premières palissades dressées afin de se protéger des ennemis mais aussi afin de clôturer l'espace et de définir un cercle plus restreint qui ne serait qu'à soi. En effet, si le grand cercle de l'horizon englobe tous les hommes et tous les animaux, la clôture de mon jardin permet de distinguer le tien du mien.
L'homme imagina donc toute une série de cercles concentriques qui, dans l'immensité du monde, allaient délimiter son intimité.
Imaginez la scène. Elle est là, sous vos yeux.
Partout c'est la forêt, immense, infinie, primitive. Elle est le règne des animaux sauvages et symbolise tous les dangers.
Puis, à un endroit, la forêt laisse la place à une clairière. Ce sera d'abord un emplacement où la foudre a frappé. Les arbres calcinés n'ont pas repoussé et l'herbe a envahi le terrain. Plus tard, ce seront les moines qui auront, par petits morceaux, défriché cette forêt primitive, tentant d'imposer la loi des hommes (de Dieu ?) à la nature.
On a donc un premier cercle, constitué par la ligne des arbres à l'orée du bois.
Il y en aura bientôt un deuxième, car l'homme a décidé de vivre dans cette prairie riante, en retrait de la forêt sauvage, dont il dépend encore en grande partie pour se nourrir et se chauffer.
Il labourera la prairie ou une partie d'icelle et cultivera de l'orge et du froment, ce blé des terres pauvres et encore un peu sauvages. La nuit, quand tout est aboli, que plus rien n'existe et que le monde a cessé d'être, les animaux sauvages viendront piétiner les jeunes pousses de leurs sabots fendus ou même fouiner à même le sol de leur groin redoutable.
Au petit jour, l'homme contemplera, consterné, le massacre du blé tendre. Il lui faudra bien dresser une palissade pour protéger les semis futurs. Car aussi tenace qu'un insecte, il recommencera à ensemencer son champ, non sans l'avoir cette fois clôturé au préalable d'une ligne de pieux pointus. Ce sera le deuxième cercle dont je parlais plus haut.
Voilà donc le champ protégé, mais aussi définitivement délimité. La frontière est là, entre la nature et la culture, entre ce qui est public et ce qui est privé.
L'orée de la forêt, la palissade. Un premier cercle, puis un autre. La nature s'arrête au premier, le règne de l'homme commence en deçà du deuxième. Entre les deux, la clairière, la prairie, qui n'appartient à aucun des deux mondes et qui du coup appartient à tous.
Si le blé, maintenant bien protégé, se met à pousser à la chaleur de l'été, en hiver il faut se chauffer. La forêt n'est pas loin, on y fait des incursions, on abat quelques arbres, qu'on découpe et qu'on ramène chez soi, c'est-à-dire derrière la palissade. Car au centre du champ de céréales se dresse le repère de l'homme, son antre, sa tanière, autrement dit, sa maison. C'est là qu'il se réfugiera à la mauvaise saison, c'est là, déjà, qu'il se cache, une fois la nuit venue. Bien protégé des bêtes sauvages, il peut s'assoupir et écouter ses rêves.
Le matin, dans l'air frisquet du petit jour, il coupera le bois ramené la veille et en fera un tas bien ordonné. Une sorte de mur d'un mètre de haut qui va aller en s'allongeant (car l'hiver est rude dans ces contrées et il faut se montrer prévoyant cette fois, plus prévoyant qu'il ne l'avait été quand il avait ensemencé une première fois son champ). Bientôt, c'est un rempart de trente stères de bois qui entourera la maison.
Voilà le troisième cercle.
C'est un cercle plus fragile celui-là : un monceau de bois de chauffage, qui délimite la propriété. C'est toujours du bois, mais il est le fruit du travail de l'homme. Coupé, scié, mis en tas bien ordonné, il devient à son tour palissade, marquant une autre limite, celle entre l'intimité domestique et la sphère agricole, entre l'endroit où on vit et l'endroit qui permet de vivre.
Dans cette « clairière » privée, en son centre, la maison. C'est une cabane en bois, évidemment. Autre cercle (même s'il est carré), qui cette fois offre un abri, un espace fermé et couvert, où s'abriter des intempéries et des froidures de l'hiver.
A l'intérieur de tout cela, il y a l'homme. Il vit là avec sa famille.
Le temps a passé depuis le début de cette histoire, les générations aussi. Ce n'est pas lui qui a trouvé le premier cercle, l'orée autour de la clairière. Ce n'est pas lui non plus qui a défiché puis créé le deuxième cercle, la palissade protectrice. Ce sont ses ancêtres et les ancêtres de ses ancêtres. Et même ceux encore avant tous ceux-là. Bref, entre le néolithique et notre homme, beaucoup de blé a été fauché et beaucoup de bois a été coupé.
Et lui, il est là, l'héritier de tous, le garant de leur mémoire, en quelque sorte. Il ne se souvient pas vraiment, mais c'est inscrit dans ses gènes, c'est le principal.
Il y a plusieurs pièces, dans la maison, mais celle qu'il préfère, c'est ce petit coin qui n'est qu'à lui, un bureau et tout autour, le long des murs, couvrant ces murs, des livres et encore des livres. Une muraille de livres, en réalité.
Et dans sa tête à lui, on trouve toutes sortes d'idées, qui grouillent dans tous les sens et qu'il met par écrit, parfois, quand il y en a trop, afin de les ordonner. Les ordonner comme il a fait du tas de bois à l'extérieur et tenter par-là de donner un sens à l'incohérence du monde.
Et quand finalement arrive l'hiver, rigoureux, quand la neige vient de la forêt et recouvre tout, il faut chauffer la maison. Alors l'homme prend du bois de chauffage, fragilisant du même coup la palissade extérieure. Plus l'hiver dure et plus la pile de bois diminue. A la fin elle disparaît presque, abolissant les limites entre le troisième et le deuxième cercle. Entre les pourtours de la cabane et ce qui était le champ de blé, mais qui n'est plus qu'un champ de neige, comme la clairière, comme la forêt, comme le monde entier. La neige recouvre tout, abolissant les limites.
C'est alors que du bois sortent les premiers loups, tenaillés par la faim.
Post scriptum : pour ceux qui voudraient contempler cette cabane et ses cercles concentriques, c'est par ici.

00:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (22) | Tags : littérature, cercles concentriques
24/06/2009
Le grenier
Maison poème...
Dans le grenier des rêves j'ai retrouvé mon enfance.
Dans une grande malle, sont rangés les jouets et des puzzles incomplets. Sous la tabatière, le cheval à bascule contemple les étoiles.
En hiver, on faisait sécher en ce lieu la lessive des lundis et c'était comme de grands fantômes blancs immobiles qui semblaient dormir là, énigmatiques et muets. Je me faufilais entre eux, respirant à pleins poumons, les yeux fermés, la bonne odeur du large que le savon avait laissée. Dans mon cœur, des tempêtes faisaient rage et les vagues de l'Atlantique déferlaient sous le vent des équinoxes. Contre ma joue, les draps humides et froids mouillaient ma peau. Frisson délicieux. Envoûtement...
Du bout des doigts je touchais ces êtres mouvants, mais ceux-ci, rebelles, se dérobaient sans fin.
Dans les coins reculés trottinaient les souris. Leurs yeux interrogateurs parfois luisaient dans l'ombre et c'était ensuite des courses éperdues dans l'épaisseur du plancher. Monde mystérieux, inaccessible. Quelle vie palpitait là, sous mes pieds ?
Sur une boîte en carton, une trappe tendue attendait, inutile, son fromage ayant été dévoré au siècle passé.
Dans une housse transparente pendaient des vêtements d'un autre âge. Portés par qui ? Mystère.
Sur un journal de l'année passée sèchent des oignons. Le bruit de papier quand on effrite la pelure dans les mains... Elle retombe en poussière d'or emportée au moindre courant d'air.
Près de la cheminée (celle du père Noël ?) un vieux lustre gît à terre. Quelles fêtes d'un autre âge a-t-il dû éclairer ? Quelles jeunes filles en fleur ont dansé dans sa clarté ? Elles doivent être mortes, maintenant. Qui étaient-elles ? Une de ces mères-grands entr'aperçues un jour sur de vieilles photos en noir et blanc ? Bien droites, raides et dignes dans leurs habits du dimanche, figées pour l'éternité, avec sur les lèvres un sourire si las... Suis-je leur descendant, moi qui suis maintenant à genoux, cherchant entre les lattes du plancher une épingle à cheveux inaccessible ?
Dans la vielle armoire dont la porte grince, il y a, je le sais, des lettres du temps jadis, venues tout droit des tropiques. Zanzibar, Tananarive et les îles sous le vent surgissent dans le grenier. Sur les timbres dentelés, des négresses aux dents blanches sourient devant les mers du Sud. Qui a envoyé ces lettres ? Quel oncle disparu, jamais croisé ? A-t-il acheté des esclaves le long du fleuve Zaïre ou vendu des armes à Tombouctou ? De quel désert du Hogar a-t-il écrit ? De quel village abyssin ? Je ne le saurai jamais, un cadenas maintenant condamne la porte. Il me reste à rêver et à imaginer des voiliers remplis de pirates ou des îles enchantées.
Craquement dans l'escalier. On vient me chercher car on sait que c'est ici que je me réfugie souvent, pour contempler dans la lumière de la tabatière les mille grains de poussière d'or qui volent au moindre souffle, formant comme des nuages énigmatiques dont nul n'a le secret.
12:13 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, poésie, le grenier
16/06/2009
Patrick Chamoiseau
On se dit que le roman français qui s'était un peu assoupi pendant quelques décennies pourrait peut-être retrouver une certaine vigueur dans le cadre plus large de la francophonie. Ainsi il est indéniable que les départements d'Outre-mer possèdent leur propre spécificité, spécificité qui cherche à s'exprimer dans une langue pour le moins originale. Je termine le livre de Chamoiseau, « Autan d'enfance » (qui est le tome I d'une « Enfance créole ») et il me semble y trouver plusieurs éléments intéressants.
Certes, il s'agit finalement d'une autobiographie et on me dira qu'il n'y a rien de plus narcissique, justement, qu'une autobiographie. Bien sûr, mais au-delà des souvenirs personnels, l'auteur nous fait découvrir tout un monde haut en couleur, celui de la vie quotidienne à Fort-de-France, ce qui pour nous, qui habitons le vieux continent, comporte tout de même pas mal d'éléments exotiques assez dépaysants. Donc, de même que l'Europe a pu s'extasier devant les romans Sud américains (Garcia Marquez, etc.) en grande partie à cause de leur touche exotique et de leur part d'étrangeté, de même ici nous découvrons des réalités qui ne nous sont pas forcément familières, ce qui nous oblige, précisément, à sortir de notre coquille et de notre ronron quotidien.
A côté de cela, Chamoiseau raconte la pauvreté et la débrouillardise de sa mère pour parvenir à élever sa famille, ce qui peut aussi renvoyer beaucoup d'entre nous à leur propre enfance. Je veux dire par-là que la réalité qu'il décrit nous est aussi très familière, en dehors de son caractère exotique et antillais et que c'est donc un discours très humain qu'il nous tient en fait. Par-là, il nous touche directement, car il sait sortir de la relation de sa propre enfance pour généraliser son propos et décrire l'âme humaine.
Quoi de plus émouvant, en effet, que de découvrir le monde par les yeux de cet enfant qui est le narrateur. Son regard innocent, parfois naïf, mais toujours intelligent, nous charme. Quant au portrait qu'il dresse de sa mère, cette maîtresse femme qui ne possédait rien mais qui par son bagout et sa ténacité parvenait toujours à ce que sa famille ne manque de rien, il restera gravé dans la mémoire du lecteur une fois qu'il aura refermé le livre.
Pas de réflexions philosophiques profondes ici, par d'interrogations sur la nécessité d'écrire ou le but de l'existence, mais une description de la vie des gens simples, qui tentent simplement de survivre et de s'en sortir.
Donc, en résumé, on trouve chez Chamoiseau un côté exotique et dépaysant mais aussi une peinture de l'universel humain. A cela il faut ajouter tous les mots créoles dont il parsème son ouvrage, juste assez pour nous faire sentir une réalité autre, mais tout en sachant rester modéré, afin de ne pas entraver la bonne compréhension du discours. Et à côté de cela, il y a sa manière imagée de s'exprimer, cette petite touche qui fait qu'on sait qu'on a à faire à un écrivain (et pas à un écrivant ?)
« Le dimanche après-midi, Fort-de-France devenait un silence. On ne voyait passer qu'un vent marin, dénoncé par les poussières, et les miettes de la vie. »
Ce silence du dimanche après-midi, lorsque toute activité est interrompue, est rendu en deux petites phrases, avec notamment ce vent qui « passe », invisible et à peine dénoncé par les poussières qu'il transporte (ce qui renvoie à la pauvreté et à la saleté ambiante, à la chaleur et à la sécheresse aussi). Quant aux « miettes de vie » elles rappellent que les hommes sont bien là, ancrés dans ce paysage, même si on ne les voit pas et que leur existence s'écoule irrémédiablement, avec ses petits bonheurs et ses grands malheurs.
Ou bien, on trouve des phrases comme la suivante :
« La messe du soir aimantait l'existant. Des négresses à chapelets, porteuses d'âges sous des voiles noirs et des bijoux d'or massif, clopinaient sur le trottoir en une lente transhumance. »
Au calme de l'après-midi, succède donc la messe du soir, qui vient redonner un peu d'animation à la ville assoupie dans la chaleur de l'été des tropiques. On notera le terme « l'existant » qui est pour le moins inhabituel. Quant à ces négresses (mot que Chamoiseau peut employer en tant que mulâtre, ce qui est pour lui une manière de revendiquer une sorte de négritude à la Senghor), leur description est assurément comique. Les mots « négresses à chapelets » les figent dans leur rôle religieux, les désignant déjà comme bigotes respectueuses des règles extérieures de la religion, s'enfermant dans des litanies de prières aussi stériles que ridicules. « Porteuses d'âges » (notez le pluriel, qui renvoie les négresses dans une éternelle vieillesse), elles sont forcément veuves. Mais l'auteur juxtapose les « voiles noirs » et les « bijoux d'or », dans une sorte d'oxymore redoutable qui finalement nie l'authenticité de leur veuvage. Certes, elles portent un deuil éternel, mais en même temps elles s'affichent avec des bijoux luxueux et voyants, ce qui ne cadre pas avec leur condition première. Et ne parlons pas de l'adjectif « massif », qui insiste sur le prix exorbitant de ces bijoux (ce qui est contradictoire avec le statut de veuves pieuses qu'elles veulent se donner), et en même temps constitue une touche ironique à l'encontre de leur désir de paraître et de se faire voir. Le fait qu'elles « clopinent » n'est certes pas valorisant à leur égard, mais le mot « lente transhumance » l'est encore moins. Assimilées à des brebis idiotes qu'en emmène où on veut, elles semblent réduites à un troupeau stupide, mot qui donne à son tour une idée sur leur nombre qui doit être important. Voilà donc comment en deux petites phrases on peut faire passer toute une réalité sociale et présenter avec humour ce qui est en fait une critique virulente.
Rien que pour des phrases comme celles-là, le livre de Chamoiseau vaut le détour et comme je le disais au début, il se pourrait bien que ces territoires d'Outre-mer aient quelque chose à nous apporter en littérature. Un peu de sang neuf ne ferait pas de tort, non ?

00:54 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : littérature, patrick chamoiseau, fort-de-france
14/06/2009
Pierre Leroux (4 et fin)
Discours de Pierre Leroux devant l'Assemblée nationale constituante le 30 août 1848. Où l'on verra que ce discours, sur le fond, pourrait être tenu de nos jours. Où l'on se dira cependant qu'il n'y a plus personne pour oser parler de la sorte.
"Citoyens représentants [...] vous êtes ici de par les besoins de l'humanité, de par la volonté du peuple, pour garantir à tous la liberté, non pas la liberté tendant à l'anarchie et au néant, mais la liberté tendant à la reconstitution de l'humanité, à l'association. De là il suit que votre devoir, ainsi déterminé, est en même temps nettement tracé. D'un côté, défendre et protéger la vieille société en faisant des lois qui, sans blesser la liberté, aussi nécessaire à elle qu'à la société nouvelle qui aspire à sortir de son sein, l'empêchent pourtant d'arriver à cet excès de mal et de souffrance au-delà duquel il n'y a plus que ce dernier combat de la mort qu'on appelle l'agonie. De l'autre, par ces lois mêmes, préparer avec un esprit de tolérance ou plutôt d'amour, semblable à cet amour paternel qui s'étend de nous sur nos descendants, l'avènement de la société nouvelle, de la société où seront véritablement réalisés les augustes termes de l'immortelle devise de nos pères : Liberté, fraternité, égalité. Voilà notre devoir, à nous tous élus du peuple, après dix-huit siècles et demi de christianisme, après la révolution de 1789, après celle de 1830, après celle de 1848. Il ne s'agit donc pas de faire intervenir l'État dans les relations sociales ; mais entre l'intervention de l'État dans les relations sociales et la négation de toute médiation et de tout droit tutélaire de sa part, il y a un vaste champ où l'État peut marcher et doit marcher, sans quoi il n'y a plus d'État, il n'y a plus de société collective et nous retombons dans le chaos. L'État doit intervenir pour protéger ce qu'on appelle la liberté des contrats, la liberté des transactions ; mais il doit intervenir aussi pour empêcher le despotisme et la licence, qui, sous prétexte de liberté des contrats, détruirait toute liberté et la société tout entière. [...]
Si, en essence, l'État ne peut pas être autre chose qu'un juge du camp et un gendarme, il faut au moins qu'il soit un juge du camp équitable et un gendarme intelligent (Rires.)
(...)
La seule question que l'on puisse faire, c'est de demander si l'État a le devoir et le droit de veiller sur la santé des travailleurs et d'empêcher que l'on porte atteinte en leur personne à la dignité humaine. Je réponds à cela que l'État a assurément ce droit, et que même les lois, en général, n'ont pas d'autre but que de veiller sur la conservation de la vie des hommes et d'empêcher que l'on porte atteinte à leur dignité d'hommes. La liberté de faire le mal, en effet, n'est pas liberté, mais crime et licence ; et comme le mal que nous faisons à nos semblables se résume toujours dans une atteinte portée directement ou indirectement à leur existence, il s'ensuit que l'État n'est véritablement institué que pour veiller sur la conservation de la vie des citoyens.
(...)
Forcer des hommes à travailler quatorze heures par jour est un délit, un crime ; c'est un homicide. Il est évident que la nature humaine, ne peut, sans se détériorer, sans s'abrutir, et sans se détruire rapidement, endurer quatorze heures d'un travail malsain dans un air souvent vicié. Ignore-t-on que les probabilités de vie, qui sont pour les enfants du riche de vingt-neuf ans environ, au moment de la naissance, ne sont que de deux ans pour les enfants de l'industrie cotonnière ? Mais, l'homicide étant constaté, où sont les délinquants, demandent les adversaires du décret. Je réponds : ils sont partout où des hommes prêtent assistance au délit. Partout où des chefs d'industrie encouragent ou tolèrent un travail évidemment homicide, il y a des délinquants.
(...)
Et vous auriez le droit de livrer des hommes à un travail mortel sans aucune intervention de l'État, abusant ainsi de l'ignorance et du malheur des hommes ! Non, mille fois non, à moins que vous ne fassiez déclarer par cette Assemblée, nommée par le peuple tout entier, et chargée de ses destinées et de son bonheur, que les travailleurs dont il s'agit ne sont pas des hommes, ou du moins ne sont pas des citoyens, qu'ils sont encore exclus de la cité et que l'État abdique à leur égard son droit tutélaire. (Très bien !)
(...)
La loi actuelle de la production est telle, qu'un certain nombre de capitalistes actifs jouissent d'un moyen assuré d'attirer à eux toute la fortune publique ; d'où résulte en même temps la baisse continuelle des salaires pour la multitude des travailleurs, condamnés à vivre du moindre salaire possible, et à mourir lorsque ce salaire vient à leur manquer. Citoyens, vous le voyez, la cause que je défends, la cause des pauvres ouvriers, est la cause de tous ; elle est la vôtre, propriétaires fonciers qui empruntez de l'argent à gros intérêts, tandis que vos domaines cultivés si péniblement par vos métayers et vos fermiers, vous rendent si peu ; elle est la vôtre aussi, chefs d'industrie et négociants, qui voyez continuellement la faillite planer sur vos têtes.
Moniteur Universel,
n° 244 du 31 août 1848, pages 2232-2236.
Source : Assemblée nationale

00:57 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, pierre leroux
12/06/2009
Pierre Leroux (3)
En 1843, Leroux crée une imprimerie à Boussac, dans la Creuse. Il n'est pas très éloigné de son amie Georges Sand, qui elle vit principalement à Nohant, dans l'Indre (entre Châteauroux et La Châtre). Leroux fait d'abord venir sa famille (notamment son frère) et quelques proches. Il veut instaurer un phalanstère sur le modèle conçu par Fourier. Le phalanstère idéal est une sorte d'hôtel coopératif situé au milieu de 400 hectares de terrain agricole et où vivraient plus ou moins deux mille personnes. Il comporterait des couloirs chauffés et de grands réfectoires. Le but est de faire vivre et de faire travailler les hommes en communauté, un peu sur le modèle qui sera réalisé dans les kibboutz.
Le projet de Leroux est plus modeste et se développe, lui, autour d'une imprimerie (ce qui lui permet par ailleurs de publier ses écrits et de les répandre, notamment via les revues L'Eclaireur et La Revue sociale ). Petit à petit, des disciples séduits par ses idées vont venir se joindre à la communauté initiale, qui comportera en tout plus ou moins 80 personnes. Devenu franc-maçon, Leroux essaie de trouver de nouveaux adeptes. Comme il s'agit d'auto financer son institution, on dit qu'il recrute surtout ceux qui ont de la fortune. On sait par ailleurs que Georges Sand l'aida beaucoup financièrement et qu'à la fin elle fut lassée de le voir toujours tenter de soutirer de l'argent à ses amis aisés. Certains verront Leroux comme un idéaliste qui tente désespérément de réaliser ses idées par tous les moyens. D'autres diront au contraire que c'est un opportuniste qui ne pense qu'à quémander de l'argent pour des projets farfelus. Question de point de vue, évidemment, qui ouvre cependant un vaste débat. Quelle perception avons-nous des grands hommes du passé ? Nous ne les connaissons que par leurs écrits ou par les témoignages de leurs contemporains. L'Histoire officielle, souvent, s'est emparée de leur légende, les glorifiant sans cesse et déformant finalement leur vraie personnalité. Il nous aurait fallu les connaître personnellement pour nous faire une idée, mais là aussi notre point de vue n'aurait pu être que subjectif. Difficile donc, d'atteindre la « vérité » des êtres, surtout s'ils appartiennent au passé.
00:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, pierre leroux
11/06/2009
Pierre Leroux (2)
Puisque nous parlions de Pierre Leroux (1797- 1871), voici quelques citations de ce philosophe qui semble injustement méconnu. Même s'il est un peu utopique dans ses désirs les plus fous (notamment en rêvant d'une justice sociale), la passion qui l'anime mérite le respect, d'autant plus qu'elle ne vise jamais ses intérêts personnels, mais la collectivité tout entière.
Si ses contemporains l'avaient un peu plus écouté, le système capitaliste tel que nous le connaissons aujourd'hui (avec ses crises financières à répétition, son désir de production aveugle, son mépris des classes laborieuses qu'on licencie pour des raisons douteuses) n'existerait peut-être pas. Pas plus que n'aurait existé la dictature stalinienne de sinistre mémoire, laquelle a clairement corrompu l'idée généreuse initiale du communisme.
Vivre, ce n'est pas seulement changer, c'est continuer
La vie est une aspiration vers l'avenir
Les vrais poètes sont toujours prophètes
L'homme ne supportera donc jamais deux vérités à la fois ?
Serai-je sur a terre quand la justice et l'égalité régneront parmi les hommes ?
L'art, c'est l'artiste. L'artiste, c'est Dieu
Vous voulez vous aimer. Aimez-vous donc dans les autres car votre vie est dans les autres et sans les autres votre vie n'est rien.
Mais que faire de cette force permanente en nous, de cette force qui aspire et qui aspire toujours ?

00:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, pierre leroux
08/06/2009
Pierre Leroux
Je termine le livre que Bruno Viard, professeur de littérature à l’Université d’Aix en Provence, a consacré à Pierre Leroux. (« Pierre Leroux, penseur de l’humanité", éditions Sulliver, février 2009).
Leroux est un penseur et un philosophe du XIX° siècle qui aura eu l’originalité de percevoir avant tout le monde le danger des systèmes de pensée. Adepte dans un premier temps du libéralisme, il aura vite compris comment cette doctrine, qui voulait faire progresser la société en développant les initiatives personnelles et en réduisant le rôle de l’Etat, pouvait déboucher sur un égoïsme effréné et ne viser qu’à l’enrichissement personnel. Après avoir fréquenté un temps St Simon, il s’en écarte quand il pressent que pour imposer la fraternité, il faut réduite la liberté. En d’autres mots il devine qu’un régime socialiste fort sera par définition obligé de lutter contre l’individualisme, ce qui l’amènera à limiter la liberté individuelle au profit d’une fraternité collective imposée. En bon dialecticien, il tentera donc une synthèse de ces deux courants de pensée que sont le capitalisme et le socialisme et cela avant même que chacune de ces doctrine ne fasse les ravages que l’on connaît (crise de 1929, dictature stalinienne).
Toute la vie de Pierre Leroux est dans cette synthèse. C’est lui qui a créé le mot « socialisme» et lui encore qui a œuvré pour imposer la devise "Liberté, égalité, fraternité". On peut dire qu’il a pressenti avant d’autres les grands dangers des deux courants de pensée politiques qui sont les nôtres depuis 1789. Il est assez rare de rencontrer un penseur qui ne s’enferme pas dans un système de réflexion mais qui au contraire ose un regard critique sur ses propres conceptions. C’est à son refus des idéologies préétablies que Pierre Leroux doit manifestement sa capacité à percevoir les limites des mouvements de pensée auxquels il adhère. Saluons un homme qui à chaque étape de sa vie a su se remettre en question et qui a toujours tenu compte de son expérience antérieure pour tenter une nouvelle synthèse. Saluons ce penseur qui a consacré son existence à réfléchir à la meilleure manière d’organiser la société des hommes.

10:02 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, philosophie, pierre leroux, editions sulliver
28/05/2009
"Zozo, chômeur éperdu" de Bertrand Redonnet
C'est un conte drôle que nous offre Bertrand Redonnet avec son « Zozo, chômeur éperdu ». Drôle parce que tout est dit avec humour et même parfois avec une verve rabelaisienne. Son héros, « gros mangeur, grand buveur et paresseux par nature » comme dit l'éditeur en quatrième de couverture, est un chômeur professionnel. L'action se passe dans les années soixante, autrement dit à une époque où il allait de soi de trouver du travail. C'est donc bien par pur goût de l'oisiveté que Zozo se complait dans sa condition et qu'il met tout en œuvre pour que celle-ci perdure. Pourtant, derrière cet humour qui sous-tend tout le livre, on perçoit une contestation sociale et politique manifeste. Zozo vit comme bon lui semble, à contre-courant de ses contemporains, ce qui n'est peut-être pas aussi facile qu'on le croit et qui dénote finalement d'une certaine force de caractère. Et puis cette critique du monde du travail, par définition humiliant et aliénant, nous parle à tous, nous qui vivons en pleine ère de néo-libéralisme triomphant. Certes Zozo fait rire quand on le voit se battre avec les autorités pour tenter de refuser les emplois qu'on lui propose. Certes, c'est plus par maladresse que par intelligence qu'il parvient à ses fins (par exemple il se blesse en tombant d'un échafaudage et est donc dispensé de travail). Mais dans le fond, on finirait par l'envier et on voudrait l'accompagner quand il passe ses journées à flâner dans la campagne, son fusil sous le bras (il ne fait pas grand mal au gibier car il rate toujours sa cible). Cette vie n'est-elle pas plus agréable que celle que nous menons tous, soumis aux horaires et aux obligations de résultat imposées par l'OMC et la mondialisation de l'économie ?
Derrière la farce drôle se dessine donc une contestation manifeste et Bertrand Redonnet semble bien revendiquer le droit de l'individu à disposer de lui-même et de son emploi du temps.
Le style, quant à lui est truculent puisque les dialogues sont rapportés tels quels, en langage populaire :
« C'était le garde-champêtre qu'était venu. Le garde-champêtre ? Nom de dieu d'bon dieu, et qu'est-ce qu'il voulait de feignant, plus feignant encore que l'curé, à venir faire chier les autres avec son vélomoteur que c'était nous qu'on payait l'essence, les pneus et les réparations ? Hein, qu'est-ce qu'il voulait ce gros crétin ? »
Remarquons qu'il s'agit ici d'un discours indirect libre plutôt que d'un simple dialogue. Ce procédé est courant dans le livre et permet de raconter rapidement ce qui s'est dit sans couper le récit par des dialogues intempestifs, mais tout en conservant la verdeur du langage.
Les termes du patois local sont à l'honneur : « I m'auront la peau » pour « ils auront ma peau », « I sais pas » pour « je ne sais pas ». On rencontra aussi des mots inhabituels en français comme « lumas » (« fouiner dans toutes les vieilles murailles à la recherche de lumas ») ou « métive » (« les autres louaient la limpidité des cieux pour la métive, la fenaison ou l'arrachage des pommes de terre »). Je note qu'en dehors même des dialogues, des termes sont employés qui doivent eux aussi relever de la langue régionale, comme « carnassier » pour «carnassière ».
S'il n'aime ni le garde-champêtre ni le curé, Zozo, en marge de la société des hommes, ne manque pas d'ironie pour ridiculiser toutes les conventions. C'est ainsi que c'est toujours le deux novembre, jour des morts, qu'il tue son cochon pour en faire du boudin ou de la saucisse. Chasseur par vocation, il rate toujours sa cible, tant il semble incompétent en tout, sauf dans l'art de la flânerie. Ne lisant pas et sachant d'ailleurs à peine lire, il sera bien étonné le jour où son ancien instituteur lui offrira trois livres (Raboliot, La Dernière Harde et les Contes de la Bécasse). Ce seront les seuls qu'il possédera jamais dans sa vie, encore ne les parcourt-il qu'en hiver « car enfin on ne lit pas à moins d'être malade ou blessé ou quand il fait bon à courir les chemins ». Mais s'il ne lit pas, Zozo est un conteur né et il sait inventer des histoires truculentes à partir de ses expéditions de chasse manquées, en les déformant à son avantage bien entendu, comme celle de ce héron qu'il a tiré par inadvertance et qu'il finira par empailler et par surnommer De Gaulle.
Par son côté truculent, Zozo aurait pu figurer dans une chanson de Brassens et ce n'est pas étonnant que ce soit notre ami Bertrand qui l'ait inventé, lui qui justement consacra autrefois un livre à ce chanteur-poète (Brassens, poète érudit). Je retrouve aussi dans « Zozo » des caractéristiques déjà rencontrées dans Chez Bonclou et autres toponymes (édité chez Publie.net) comme par exemple les diverses interprétations données d'un même fait par différents protagonistes. Ainsi, pour tenter de comprendre le décès d'un menuisier qui s'est pendu, certains avancent l'hypothèse d'une infidélité conjugale, d'autres disent que le pauvre homme était endetté jusqu'au cou à cause de toutes les machines qu'il avait dû acheter (on retrouve ici la critique acerbe du monde du travail et du système capitaliste), d'autres encore affirment qu'il avait perdu la raison tellement il avait bu. Par cette manière de raconter les faits, l'auteur laisse au lecteur le soin de choisir la version qui lui convient, tout en décortiquant l'art de raconter, démontrant par-là que tout est possible à celui qui écrit un livre. Miroir braqué sur le monde, la littérature se donne comme le reflet de tout ce qui se dit dans les villes et les villages. Elle n'est qu'un amplificateur de l'immense brouhaha de la société des hommes.
On ne racontera pas ici la fin de l'histoire de Zozo, disons seulement qu'il est la victime de plus rusé que lui. Alors qu'il ne voulait qu'un peu de tranquillité, la fourberie des hommes le rattrape. Conte « sans morale apparente » disait l'éditeur. Pas sûr. Zozo est puni non pas de sa fainéantise mais de sa naïveté. C'est ce que je disais en commençant : derrière l'humour de ce livre, se dessine le drame de tout individu qui doit vivre au milieu de ses semblables.

16:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, "zozo, chômeur éperdu", bertrand redonnet
19/05/2009
Le retour au pays natal (2)
En fait c'est une servante, la vieille nourrice d'Ulysse, qui le reconnaît à une ancienne blessure alors qu'elle lui lave les pieds dans un bassin. Elle est tellement étonnée que le bassin se renverse à terre (symbole pour dire que l'élément liquide, qui avait été un ennemi pour notre héros, perd maintenant tout pouvoir ?) Elle veut révéler la nouvelle du retour du maître, mais Ulysse lui demande de conserver le secret. On notera que cette nourrice symbolise par excellence l'élément maternel. C'est elle qui a allaité Ulysse quand il n'était qu'un bébé. Elle incarne donc bien pour lui la terre d'Ithaque. Le fait que ce soit elle qui le reconnaisse n'est donc pas anodin. C'est une manière de légitimer son retour dans la terre natale.
Il se fait ensuite reconnaître de son fils Télémaque et de quelques fidèles serviteurs. Sa femme, Pénélope, elle, ne l'a pas reconnu. Or c'et le moment qu'elle choisit pour donner sa main à celui de ses prétendants qui parviendra à bander l'arc de son époux. Lassée d'attendre celui-ci, fatiguée de repousser l'assiduité de tous ces hommes qui veulent s'emparer du royaume en montant dans la couche nuptiale, elle cède donc au moment même où Ulysse arrive. Cette coïncidence permet à l'intrigue de se poursuivre sous nos yeux, mais elle accentue encore le désespoir d'Ulysse qui risque même de perdre son épouse adorée.
On connaît la suite. Aucun des prétendants ne parviendra à tendre l'arc. Alors Ulysse, qui avait eu soin de faire fermer toutes les portes du palais, s'avance et demande l'autorisation d'essayer lui aussi l'arc du divin Ulysse. Tout le monde s'esclaffe et Pénélope elle-même, si elle l'autorise à tenter sa chance, précise tout de même qu'il n'est pas question qu'elle l'épouse si jamais il parvient à réussir. Là-dessus, elle quitte la pièce et se retire dans ses appartements. Ulysse commence alors à massacrer tous les prétendants à l'insu de la reine qui ne se rend compte de rien.

Notons qu'Ulysse n'épargne que deux personnes. Le héraut qui s'était occupé de son fis quand celui-ci était petit et un aède qui promet qu'il va chanter ses exploits. Les « littéraires » chargés de conserver la mémoire des événements sont donc épargnés. Outre qu'il s'agit là d'une belle mise en abyme (puisque ce que le poète promet d'écrire et de chanter, c'est l'Odyssée en fait, ce grand poème que nous sommes justement occupés à lire - ou à écouter pour ce qui était des Grecs de l'Antiquité), il convient de souligner le rôle exceptionnel qu'Ulysse accorde à la poésie narrative.
Enfin Ulysse paraît devant Pénélope, qui a du mal à reconnaître son mari dans ce héros qui se présente devant elle (il n'a plus alors l'apparence d'un vieux mendiant mais il est comme il est vraiment, c'est à dire avec vingt ans de plus que le jour de son départ).
Pénélope, en femme rusée, soumet Ulysse à une dernière épreuve.
« Si cet homme est bien le seul et unique Ulysse, nous nous retrouverons car entre nous il y a un signe secret et sûr, un signe irréfutable que nous sommes, lui et moi, seuls à connaître. »
Alors elle demande à ses servantes d'apporter la couche nuptiale, mais à ces mots Ulysse s'écrie que c'est impossible, car un des pieds du lit a été construit à partir du tronc d'un olivier vivant (ou si on préfère un des quatre pieds est en fait enraciné dans le sol puisque le lit a été construit autour de l'olivier vivant). A ces mots, la pauvre Pénélope tombe dans les bras d'Ulysse. Notons en passant la particularité de ce lit nuptial (c'est là sans doute que l'enfant du couple, Télémaque, a été conçu), qui est fait en partie d'un tronc d'olivier, lequel symbolise la vie par excellence (et l'olivier, toujours vert, plus qu'aucun autre arbre encore). De plus, par ses racines, il puise ses forces dans la terre d'Ithaque. La couche du couple royal semble donc l'aboutissement légitime et vital de cette terre, ce qui donne à leurs ébats amoureux un caractère pour le moins particulier, comme si la force de la terre natale se transmettait, via la sève de l'arbre, au lit nuptial et donc aux amants royaux chargés d'assurer une descendance légitime.
Quand elle est bien certaine que c'est Ulysse qui est revenu, Pénélope défaille presque :
« ...le cher cœur et les genoux de Pènélopéia défaillirent tandis qu'elle reconnaissait les signes certains que lui révélait Odysseus. Et elle pleura quand il eut décrit les choses comme elles étaient ; et jetant ses bras au cou d'Odysseus, elle baisa sa tête. »
Ulysse, lui aussi est presque en larmes. Ils s'acheminent vers le lit et Athéna retarde le lever du soleil pour que la nuit dure plus longtemps et que le couple enfin reconstitué puisse se raconter tout ce qu'il a à se dire.

L'ordre est rétabli. Ulysse est rentré chez lui, il a reconquis son sceptre, il a retrouvé sa femme. Sa descendance est déjà assurée dans la personne de son fils Télémaque. La grande aventure s'achève dans le bonheur domestique. Le temps des exploits est terminé. C'est chez lui, dans sa terre natale, qu'Ulysse va poursuivre calmement sa vie, comme s'il n'y avait qu'elle qui avait pu apaiser l'éternel voyageur, comme si l'unique sens de l'existence se trouvait là, sur ce rocher d'Ithaque, sur cette île perdue elle aussi au milieu de la mer (comme autrefois le navire d'Ulysse), mais sur laquelle il avait vu le jour.
La morale de l'histoire est donc qu'il faut partir pour accomplir des exploits et grandir, afin de devenir un homme. Mais il faut aussi savoir revenir car seul l'endroit où on est né et où on a passé sa jeunesse peut apporter l'apaisement.

00:28 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, homère, odyssée, ulysse
17/05/2009
Le retour au pays natal
Chacun a ainsi un lieu où il a vécu enfant et où il lui semble que les choses ont plus de sens qu'ailleurs, comme si l'ordre qui y règne n'était pas arbitraire mais relevait de la nécessité. Sans doute parce que tout ce que l'enfant voit avec ses yeux, il l'enregistre. La structure du monde qui l'entoure, il se l'approprie et la fait sienne. C'est par ce pays où il a vécu qu'il est devenu ce qu'il est. Plus tard, bien plus tard, quand il y reviendra, il lui semblera toujours retrouver un aspect immuable, même si les changements sont manifestes, comme partout ailleurs. Mais c'est là qu'il a fait la découverte du monde, c'est là qu'il a grandi et cela, personne ne pourra jamais le lui enlever. Cela fait partie de sa mémoire profonde.
La littérature n'est pas sans avoir fait allusion à ce pays des origines. On pourrait même dire que dès ses tous premiers textes elle s'est concentrée sur cette quête du pays natal, sur cet Eden perdu que l'adulte, emporté par les événements de la vie, essaie de retrouver malgré tous les obstacles qui s'opposent à son retour. Cette recherche désespérée et toujours différée et inaccomplie, on l'aura compris, c'est le vieil Homère qui nous en livre les secrets avec le périple d'Ulysse qui tente désespérément de rentrer chez lui à Ithaque.
Dix ans durant il a guerroyé devant les murs de Troie. Dix autres années lui seront encore nécessaires pour retrouver son chemin. Errant sans fin sur l'élément liquide, victime de la colère des dieux, il cherche désespérément le pays où il est né et où l'attendent sa femme et son fils.
Expie-t-il ainsi la ruse qu'il a imaginée en inventant le cheval de bois qui a permis aux Grecs de prendre par traîtrise la ville qu'ils assiégeaient en vain ? Ce voyage qui n'en finit plus et qui le prive de ses foyers est-il une sorte de punition pour sa fourberie ? C'est bien possible. Mais peut-être aussi se complait-il dans cette errance qui lui permet de découvrir des contrées enchantées, de jouir de l'amour de femmes exceptionnelles et de tester sa capacité à vaincre les obstacles qui se présentent. Qui dira si Ulysse est victime de son sort ou si au contraire ce cheminement lui plaît bien, même s'il ne l'avoue pas ?
A la fin, cependant, il semble se fatiguer de son périple et quand enfin il voit devant lui se dresser les rochers d'Ithaque, c'est un grand soulagement pour lui.
Vingt ans se sont donc écoulés depuis son départ et personne ne le reconnaît. Il s'enquiert des nouvelles et se rend vite compte que son royaume tombe en ruines. Sa femme est courtisée par une série de prétendants qui ne pensent qu'à manger et à boire sur son compte. Il va lui falloir rétablir son autorité sur son propre royaume dans une sorte d'ultime épreuve. Redevenir Ulysse en quelque sorte car c'est comme un mendiant qu'il a débarqué dans la cité où personne ne fait attention à lui.
"Donc, tout lui semblait changé, les chemins, le port, les hautes roches et les arbres verdoyants. Et, se levant, et debout, il regarda la terre de la patrie. Et il pleura, et, se frappant les cuisses de ses deux mains, il dit en gémissant :
- O malheureux ! Dans quelle terre des hommes suis-je venu ? Ceux-ci sont-ils injurieux, cruels et iniques ? sont-ils hospitaliers, et leur esprit est-il pieux ? où porter toutes ces richesses ? où aller moi-même ?"
Personne ne le reconnaît, sauf son chien fidèle :
"Et ils se parlaient ainsi, et un chien, qui était couché là, leva la tête et dressa les oreilles. C'était Argos, le chien du malheureux Odysseus qui l'avait nourri lui-même autrefois, et qui n'en jouit pas, étant parti pour la sainte Ilios. Les jeunes hommes l'avaient autrefois conduit à la chasse des chèvres sauvages, des cerfs et des lièvres ; et, maintenant, en l'absence de son maître, il gisait, délaissé, sur l'amas de fumier de mulets et de boeufs qui était devant les portes, et y restait jusqu'à ce que les serviteurs d'Odysseus l'eussent emporté pour engraisser son grand verger. Et le chien Argos gisait là, rongé de vermine. Et, aussitôt, il reconnut Odysseus qui approchait, et il remua la queue et dressa les oreilles ; mais il ne put pas aller au-devant de son maître, qui, l'ayant vu, essuya une larme, en se cachant aisément d'Eumaios. Et, aussitôt, il demanda à celui-ci :
- Eumaios, voici une chose prodigieuse. Ce chien gisant sur ce fumier a un beau corps. Je ne sais si, avec cette beauté, il a été rapide à la course, ou si c'est un de ces chiens que les hommes nourrissent à leur table et que les Rois élèvent à cause de leur beauté.
Et le porcher Eumaios lui répondit :
- C'est le chien d'un homme mort au loin. S'il était encore, par les formes et les qualités, tel qu'Odysseus le laissa en allant à Troie, tu admirerais sa rapidité et sa force. Aucune bête fauve qu'il avait aperçue ne lui échappait dans les profondeurs des bois, et il était doué d'un flair excellent. Maintenant les maux l'accablent. Son maître est mort loin de sa patrie, et les servantes négligentes ne le soignent point. Les serviteurs, auxquels leurs maîtres ne commandent plus, ne veulent plus agir avec justice, car le retentissant Zeus ôte à l'homme la moitié de sa vertu, quand il le soumet à la servitude.
Ayant ainsi parlé, il entra dans la riche demeure, qu'il traversa pour se rendre au milieu des illustres Prétendants. Et, aussitôt, la Kèr de la noire mort saisit Argos comme il venait de revoir Odysseus après la vingtième année."
Ulysse, qui ne veut pas encore se faire reconnaître, ne peut donc aller caresser son fidèle compagnon et après avoir essuyé une larme que personne n'a remarquée, il passe son chemin sans un regard pour le pauvre chien, qui meurt aussitôt, de désespoir sans aucun doute, lui qui avait attendu son maître pendant vingt ans ! A ce moment le vieux chien pouilleux et malade est un peu le double d'Ulysse, fatigué de son long périple de vingt ans, déguisé en mendiant et ayant quasi perdu son royaume, lequel est aux mains des prétendants de sa femme. Ce pays natal auquel il rêvait, voilà qu'il lui est refusé quand enfin il le retrouve. Tout est à refaire, donc, tout est à reconquérir.
(à suivre)

01:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, homère, odyssée, ulysse
13/05/2009
Communiqué
Pour ceux qui habiteraient dans le Sud-Ouest ou qui seraient de passage par-là, je signale que la Fédération des Œuvres Laïques des Hautes-Pyrénées organise son 31° Mai du Livre du jeudi 14 mai au vendredi 29 mai 2009 sur le thème « décolonisation et émancipation ». Tout cela se passe à Tarbes, bien entendu et la personne qui coordonne tout cela n'est autre que Michèle Pambrun, une des fidèles lectrices de Marche romane dont on a souvent pu lire ici les commentaires avisés. Bon courage à elle et qu'elle soit remerciée pour le fait de mettre ainsi sa passion des livres au service de tous.
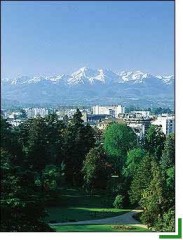
14:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, mai du livre, tarbes
12/05/2009
Du cercle et du concept d'insularité dans la Grèce antique (2)
Notons que la cité est urbaine (activité humaine, culture) mais qu'elle se situe au milieu des terres agricoles (nature, mais nature domestiquée pour le besoin des hommes). Comme en Grèce elle se situe souvent sur un promontoire, son territoire est souvent encerclé par la mer (la vraie nature), qui l'englobe et l'isole. Elément liquide et empire du vent, la mer est donc le contraire de la cité, laquelle se caractérise par la terre (agricole) et le soleil (la chaleur).
Il semblerait donc que ce ne soit pas vraiment un hasard si le concept d'insularité a été représenté chez les anciens Grecs par le cercle et donc par le bouclier (ou la coupe), dont le centre renvoie aussi au nombril.
Mais nous n'avons jusqu'à présent parlé que de la description du bouclier d'Achille dans l'Iliade. Pourtant, il est difficile de parler d'insularité sans évoquer l'Odyssée et le voyage d'Ulysse, qui va d'île en île à la recherche de sa terre natale (de sa cité). Dans chaque île, celui-ci vit une aventure différente (preuve du caractère spécifique de chaque île, de son isolement dans la mer). Mais la multitude des îles qu'il visite (comme le héros de la « Fontaine pétrifiante » de Priest) finit par faire une longue description d'événements différents (comme le bouclier, qui représentait lui aussi une multitude de scènes). Si chaque île est singulière, leur nombre en fait une image du monde. De même que l'artiste, qui ne pouvait pas représenter le monde dans son entièreté, le résumait sur le bouclier par quelques scènes représentatives, de même Homère résume l'ensemble des possibles par quelques aventures qui se déroulent dans des îles (ou du moins le long du littoral). La mer qui isole les îles sert aussi et paradoxalement de moyen pour atteindre ces îles (cf. aussi les voyages en bateaux dans la « Fontaine pétrifiante »)
Il serait intéressant de se demander pourquoi Homère a imaginé ce périple entre des îles pour raconter le voyage d'Ulysse. Après tout, celui-ci aurait pu voyager sur la terre ferme, comme les chevaliers qui partaient à la recherche du Graal, dans la littérature moyenâgeuse.
A mon avis, c'est que l'île représente un monde à part et qu'elle est le lieu géographique idéal pour incarner l'utopie.
L'utopie est souvent un pays imaginaire dans lequel parvient un voyageur après avoir traversé différentes épreuves. Ulysse avait connu la guerre de Troie, un long périple en mer, et il avait même dû affronter le chant des sirènes. Dans « la fontaine pétrifiante » le héros a tout perdu (emploi, parents, épouse) et il s'isole pour écrire, retournant à un état primitif qui débouchera sur une nouvelle naissance : la découverte des îles (mais celles-ci ne sont que le fruit de son imagination). Sur ces îles, on trouve souvent une société idéale (l'amour pour Ulysse, l'amour et l'immortalité pour le héros de Priest). Considérée comme le terme suprême de l'Histoire (le but vers lequel elle devrait tendre), la contrée d'utopie fait l'objet d'une description qui s'apparente à la philosophie de l'histoire.
Dans cette île utopique, l'âge d'or est de retour. On remonte aux origines pour retrouver le bonheur perdu. Véritable Eden d'avant la faute, cette île entourée d'eau fait penser au fœtus qui baigne dans le liquide amniotique maternel. Régression vers un état premier, l'utopie est supposée retrouver le bien-être perdu. La seule manière d'y arriver, c'est de nier le réel.
Notons qu'il convient d'opposer l'utopie à l'idéologie. Cette dernière est conservatrice et vise à assurer la cohésion du groupe. En s'appuyant sur la tradition et le passé, elle conforte le pouvoir en place.
L'utopie, au contraire, met la réalité en question et va jusqu'à la nier. Elle représente le rêve et en cela elle peut être vue comme le complément nécessaire de l'idéologie. Pour le dire autrement, l'idéologie ne parvient à maintenir ses positions que parce que l'utopie existe avec son rôle de soupape de sécurité. Mais si l'idéologie vise la conservation et la cohésion, l'utopie vise elle la contestation puisqu'elle nie les valeurs de la société pour en proposer d'autres. En fait, elle veut surtout le bonheur de l'individu, tandis que l'idéologie veut le maintient du groupe.
Chez Priest, l'immortalité n'est accordée qu'à quelques individus. Ce bonheur individuel implique donc une grande injustice sur le plan social. L'égalité entre les citoyens est contestée.
Lieu de rêve qu'on atteint au terme d'un voyage, l'utopie reconstruit un endroit connu, mais en le modifiant. Ne visant qu'un individu ou un groupe restreint, elle est toujours un lieu isolé. L'île est donc l'endroit idéal pour que puisse s'épanouir l'utopie, laquelle suppose en effet l'isolement (voir le héros de Priest qui écrit seul dans sa chambre blanche ou Ulysse qui finit par revenir à peu près seul à Ithaque). Lieu clos, entouré d'enceintes (ou de la mer), l'utopie suppose par définition un repli sur soi et le retour à une pureté perdue.
L'amour n'est jamais loin, au pays d'utopie, mais paradoxalement la femme idéale qu'on y rencontre est aussi une mère (l'île est d'ailleurs entourée par la mer). Chez Priest c'est la femme aimée qui va permettre au héros (qui a perdu la mémoire en acquérant l'immortalité) de se reconstituer une personnalité, laquelle est assimilée à une nouvelle naissance. La famille, avec ce qu'elle comporte de rigide et de pesant, disparaît (le héros de Priest est divorcé), tandis que l'amour, même physique, devient possible avec une partenaire idéale.
L'utopie est souvent maritime (isolement, insularité). Désir de régression vers un lieu idéal entouré d'eau, elle est aussi un refus de grandir (ce que j'avais dit, finalement, dans la note de 2007 en me demandant si le fait d'écrire n'est pas non plus une manière de renoncer à affronter le monde en préférant créer des espaces imaginaires). Lieu en dehors du monde connu, l'utopie se situe aussi en dehors du temps. Rien d'étonnant, donc, à ce que le héros de Priest devienne immortel. Lieu où sont abolies les règles habituelles, l'image du père en est forcément absente (le père vient de mourir chez Priest). Tout repose sur l'affectif et donc la femme y tient le premier rôle. Comme tout est parfait, il n'y a rien à contester (dans « la fontaine pétrifiante », le héros qui avait hésité à accepter l'immortalité finit par se soumettre assez facilement à ce bonheur imposé).
Bon, j'ai longuement parlé de l'utopie et de l'insularité, mais Aristote, finalement, qu'est-ce qu'il en disait? Nous ne sommes pas plus avancés.

00:06 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, cercle, insularité, grèce antique
11/05/2009
Du cercle et du concept d'insularité dans la Grèce antique
Je voudrais revenir un instant encore sur la notion d'île, évoquée dans la note précédente. L'artiste en général et l'écrivain en particulier sont souvent « en marge » par rapport à la communauté des hommes, non pas qu'ils vivent forcément en ermites (encore que le travail de création suppose bien souvent une certaine solitude), mais disons que le regard critique qu'ils portent sur la société, et le monde imaginaire qu'ils élaborent dans leur œuvre, impliquent en soi un certain recul, une certaine distance.
On connaît les idées de Platon sur l'art. Pour lui, l'artiste représente un danger pour l'équilibre de la République dans la mesure où il crée un monde fictif, qui ne correspond pas à la réalité. En d'autres mots, c'est un illusionniste qui présente comme vrai ce qui est faux. A ce titre, il est condamnable.
Aristote, quant à lui, a tenu un discours diamétralement opposé à celui de Platon. Loin d'exclure les artistes de la cité, il les trouve au contraire nécessaires. L'art est avant tout une imitation. Le plaisir esthétique viendrait donc de l'émotion que provoque l'œuvre, cette copie de la réalité, qui d'une part touche nos passions et qui d'autre part permet une sorte d'exutoire. Voir une scène horrible sur scène, par exemple, permettrait d'évacuer en nous toutes les tensions et loin de nous inciter à mal agir, nous permettrait plutôt de condamner ce type d'action.
C'est que l'objet représenté n'est pas la réalité mais sa représentation. Il est le fruit du travail de l'artiste et c'est en cela qu'il est beau. Un objet qui serait laid en soi peut devenir beau par la manière dont l'artiste l'a représenté. L'émotion et la passion du spectateur peuvent donc s'exprimer en dehors de la réalité. Ce qu'on ne pourrait tolérer dans cette même réalité (crimes, incestes, etc.) est au contraire accepté sur scène. Cela produit une sorte de "catharsis" qui ferait sortir du cœur des hommes tout ce qu'ils ont de mauvais (et qui aurait finalement pu se traduire par des actes répréhensibles dans la réalité concrète). A ce titre, pour Aristote, l'art est bénéfique pour l'ordre de la cité.
Ceci étant posé, j'ai beau parcourir la « Poétique », je ne retrouve pas cette notion d'île qui a été évoquée dans les commentaires de la note précédente. Platon, lui, parle du concept d'insularité avec le mythe de l'Atlantide et Aristote en parle aussi, mais dans le « Politique » (la cité située au centre de son territoire et à égale distance de toutes ses frontières pour mieux en assurer la défense et pour mieux assurer son propre ravitaillement. En outre, entourée et protégée par ses remparts, la cité parfaite vit en autarcie et se suffit à elle-même).
Ceci dit, cela nous amène à réfléchir sur la notion de cercle et donc sur la perfection de celui-ci. Et de l'image du cercle à celle de l'île, il n'y a qu'un pas, que je vous propose donc de franchir.
L'image du cercle, sa représentation artistique, on la retrouve chez les Grecs au chant XVIII de l'Iliade, avec la description du bouclier d'Achille :
" Et (Ephaistos) jeta dans le feu le dur airain et l'étain, et l'or précieux et l'argent. Il posa sur un tronc une vaste enclume, et il saisit d'une main le lourd marteau et de l'autre la tenaille. Et il fit d'abord un bouclier grand et solide, aux ornements variés, avec un contour triple et resplendissant et une attache d'argent. Et il mit cinq bandes au bouclier, et il y traça, dans son intelligence, une multitude d'images. Il y représenta la terre et l'Ouranos, et la mer, et l'infatigable Hélios, et l'orbe entier de Séléné, et tous les astres dont l'Ouranos est couronné : les Pléiades, les Hyades, la force d'Orion, et l'Ourse, qu'on nomme aussi le Chariot, qui se tourne sans cesse vers Orion, et qui, seule, ne tombe point dans les eaux de l'Okéanos.
Et il fit deux belles cités des hommes. Dans l'une on voyait des noces et des festins solennels. Et les épouses, hors des chambres nuptiales, étaient conduites par la ville, et de toutes parts montait le chant d'hyménée, et les jeunes hommes dansaient en rond, et les flûtes et les cithares résonnaient, et les femmes, debout sous les portiques, admiraient ces choses.
Ensuite, le forgeron représente deux armées, deux sentinelles, un « champ de hauts épis que des moissonneurs coupaient avec des faux tranchantes », « une belle vigne d'or chargée de raisins, avec des rameaux d'or sombre et des pieds d'argent », « un troupeau de bœufs aux grandes cornes », « un grand pacage de brebis blanches, dans une grande vallée », un chœur de danses où « les adolescents et les belles vierges dansaient avec ardeur en se tenant par la main. Et celles-ci portaient des robes légères, et ceux-là des tuniques finement tissées qui brillaient comme de l'huile. Elles portaient de belles couronnes, et ils avaient des épées d'or suspendues à des baudriers d'argent. Et, habilement, ils dansaient en rond avec rapidité, comme la roue que le potier, assis au travail, sent courir sous sa main. Et ils tournaient ainsi en s'enlaçant par dessins variés ; et la foule charmée se pressait autour »
Véritable œuvre d'art, ce bouclier est d'ailleurs réalisé par un dieu et non un homme. Circulaire, il est symbole de perfection et en tant qu'arme, il permet de défendre la cité, à laquelle il renvoie donc par sa forme ronde (la cité entourée de remparts, close sur elle-même). Cité qui est elle-même un tout, une somme d'éléments divers rassemblés en une unité politique. Métaphore de la cité, le bouclier circulaire décrit lui aussi toute une série de scènes (les armées, les danses, les moissons, etc.), qu'il globalise en un tout. Perfection esthétique, il est à la fois la cité parfaite et le monde, qu'il tente de figurer par l'énumération de toutes ses caractéristiques (du moins celles qui ont un rapport avec les hommes).
Mais ce n'est pas le bouclier lui-même, qu'Homère nous met sous les yeux, mais sa description littéraire, son évocation poétique. Nous avons donc un texte écrit (enfin, récité, car les chants homériques relèvent de la poésie orale, comme les chansons de geste) qui renvoie à une oeuvre d'art, laquelle est un bouclier imaginaire supposé représenter lui-même la perfection de la cité. Belle mise en abyme donc, où tout renvoie à tout et où tout inclut tout.
Par sa dimension et son côté circulaire, le bouclier évoque le concept de l'île. En résumant une multitude de scènes dans un espace réduit (un peu comme tous les animaux qui rentraient dans l'arche de Noé), l'artiste donne donc un sens à ce qui était infini et donc peu compréhensible. En peignant et en gravant toutes ces scènes sur le bouclier, l'artiste divin leur donne un sens. De plus, par leur côté artistique, il nous les fait aimer. Véritable résumé du grand Tout, le bouclier, de taille réduite et d'aspect circulaire, renvoie au monde comme à la cité. Comme on ne sait pas dire le monde en le décrivant entièrement, on se contente d'en faire un résumé sur une surface réduite, mais cette surface réduite est supposée renvoyer au tout.
Or, pour les Grecs, l'île est bien elle aussi un tout. Véritable résumé du monde (elle est à elle seule un monde en petit), elle renvoie par son côté circulaire et par l'autarcie qu'elle suppose, à la cité (qui, elle aussi, est circulaire et qui vit en autarcie à l'intérieur de ses remparts). Entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, la cité résume le monde (comme le faisait le bouclier) et elle en représente la perfection (cf. l'image du cercle).
(à suivre)

00:58 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, cercle, insularité, grèce antique
07/05/2009
"La fontaine pétrifiante" de Christopher Priest
Nous avions parlé, il y a bien longtemps (le 26.10.07), de la lecture et de l’écriture considérées comme un refuge intérieur et j’avais posé cette question : « Cette activité intellectuelle qui nous apparaît à nous comme une échappatoire, une percée décisive contre la bêtise ambiante, ne peut-elle être qualifiée de fuite en avant, de refuge, voire de régression ? »
En effet, alors que les hommes, habituellement, agissent pour s’imposer dans le monde, le lecteur (ou celui qui écrit), en se complaisant dans l’imaginaire, semble rester en retrait et donc demeurer fondamentalement passif. A moins qu’on ne considère qu’il agite des idées subversives, allant à l’encontre de la société de ses semblables et de leurs pensées communes…
J’avais alors avancé la notion « d’île » pour illustrer l’isolement bien réel de cet écrivain/lecteur, que celui-ci soit passif ou subversif, finalement, car dans tous les cas il vit dans un autre monde.
Visiblement, c'est cette idée d’île qui avait amené Ellisa (une commentatrice aussi discrète que fidèle) à me conseiller par la suite le livre de Christopher Priest, « La fontaine pétrifiante » (voir les commentaires de la note en question). Pris par mes autres lectures, il me fallut encore six mois pour aborder ce volume, mais je dois dire que je ne regrette pas de l’avoir enfin ouvert.
Le héros, en plein divorce, se réfugie à la campagne et il cherche dans l’écriture un moyen de retrouver son équilibre. Il s’enferme dans une pièce toute blanche (blanche comme les pages qu’il va remplir) et décide de raconter sa vie pour comprendre qui il est vraiment. Mais, assez vite, il se rend compte qu’il ne peut pas citer les personnages réels qu’il a connus, par discrétion principalement. Il prend donc l’initiative de modifier leurs noms. Mais il se sent encore limité. En effet, ce qu’il dévoile de ces personnages, c’est son point de vue à lui et par forcément ce qu’ils sont vraiment. Du coup, il décide de passer par l’intermédiaire d’une fiction pour mieux raconter ce qu’il a vraiment vécu (belle réflexion sur l’écriture, donc et sur la nécessité de recourir à l’imaginaire pour atteindre la vérité).
Il imagine donc un monde irréel, composé essentiellement d’îles enchantées, où les protagonistes ont envie d’oublier le continent où ils vivent habituellement (et on devine que pour cet auteur anglais, ce continent, c’est l’Angleterre, en fait). L’écrivain narrateur (pas Priest, mais le héros qui divorce et qui écrit pour survivre) se retrouve dans cette histoire et il rencontre une jeune femme à laquelle il donne les qualités qu’il aurait voulu trouver chez son ex-épouse. Mais, petit à petit, on ne sait plus si on est dans la réalité ou dans l’histoire inventée. Les faits se croisent, s’interpénètrent, etc. Lui-même finit tellement par croire à l’histoire de son roman qu’il ne sait plus trop qui, de son épouse réelle ou de l’héroïne imaginée, est la femme dont il est amoureux.
Le lecteur s’y perd aussi car dans l’histoire écrite par le héros, on ne retrouve pas seulement les personnages de sa vie sous un autre nom et vus sous une autre optique, mais le héros lui-même avec son manuscrit (celui qu’il est en train d’écrire dans sa maison isolée à la campagne, donc).
Finalement, il y a Priest qui nous raconte l’histoire de quelqu’un (lequel parle à la première personne) et qui écrit un livre pour survivre (premier niveau), il y a ce même personnage qui nous donne de larges extraits de son roman en chantier (deuxième niveau) et dans cette histoire racontée (avec le cheminement entre les îles) on retrouve le manuscrit en question et cela constitue donc un peu comme un troisième niveau (puisque le manuscrit dont il est question au premier niveau se retrouve dans le deuxième). Vous suivez ? Rassurez-vous, chez Priest, c’est plus limpide qu’ici.
Au premier niveau, le héros-narrateur est donc divorcé tandis que dans son manuscrit, comme je l’ai déjà dit, il est amoureux d’une femme qui a les qualités qu’il aurait voulu que sa vraie femme possède. Le problème devient complexe quand sa vraie femme revient et qu’il ne sait plus qui il préfère, du personnage réel ou du personnage inventé. Car finalement les qualités rêvées chez son héroïne, son ex-épouse les possède aussi mais il semblerait qu’il ne les avait pas suffisamment remarquées.
Ce livre est donc une véritable mise en abyme. Centré sur l’écriture, il parle aussi, comme tous les grands livres, de l’existence et de la mort. Ainsi, dans les îles, le héros du manuscrit a la possibilité de suivre un traitement médical qui le rendra immortel. Ces îles entre lesquelles sa compagne (la fictive, celle du manuscrit) désire voyager éternellement vers des ailleurs enchanteurs (on retrouve le thème de bateau cher à Rimbaud) symbolisent les rêves et donc l’imaginaire. Ecrire est donc bien une fuite vers un monde meilleur, un monde où tout serait possible (l’immortalité, une femme adorable à aimer, des paysages enchanteurs).
Le problème (car il y en a un), c’est que pour devenir immortel, le héros doit perdre la mémoire de son passé et donc de lui-même. Pour ne pas oublier son identité, on lui demande donc de raconter préalablement sa vie afin qu’il puisse se reconstituer une personnalité à partir du récit de son passé. Mais ce récit, notre héros l’a déjà fait, c’est le fameux manuscrit dont nous parlons. Malheureusement, on se souvient que ce n’est pas une autobiographie au sens strict, mais avant tout une fiction. C’est donc à partir de cette fiction qu’il va se reconstruire. A la fin, il finit par croire qu’il est le personnage inventé dans son manuscrit et plus celui qui a divorcé. C’est la réalité qui fait alors figure de fiction (manière de dire que les réalités inventées par l’écriture ont une existence propre et qu’elles sont finalement plus réelles que notre morne existence).
« Mon imagination m’avait installé dans l’existence. J’écrivais sous l’empire d’une nécessité intérieure, et cette nécessité me commandait de créer une vision plus claire de moi-même. Ecrire, c’était devenir ce que j’écrivais », explique le héros au début. Il ne croyait pas si bien dire. L’imaginaire a si bien remplacé la réalité qu’il en arrive à noter : « Je fis comme si elle était Gracia, même si elle l’était en réalité. »
A la fin, on se demande si le héros n’a pas perdu l’esprit puisque dans la vraie vie du premier niveau (à Londres et non dans les îles imaginaires) il finit par rechercher la femme qu’il a créée dans son roman. Il croit la voir, lui parle, tandis que les gens se retournent sur lui, intrigués par son délire. Pourtant il décide de la quitter et de tenter de revenir vers son ex-femme (laquelle le prend pour un fou car elle a remarqué que le fameux manuscrit qu’il transporte toujours avec lui ne contient que des pages blanches). Dramatiquement, le livre s’achève sur une phrase inachevée, phrase inachevée que nous avions déjà rencontrée dans le premier niveau, ce qui fait que tout se rejoint et que le lecteur ne sait plus du tout où il se trouve et qu’il finit par douter de tout.
Si la réalité inventée par mon imaginaire est préférable à la vraie réalité, on peut dire qu’écrire est fabuleux mais aussi que c’est une sorte de fuite en avant pour ne pas accepter cette réalité. Cela s’apparente donc à un refuge sur une île, comme je disais au début et comme veut le signifier Priest lui-même avec ses îles où on vit éternellement. Mais si ce monde que j’ai imaginé finit par devenir réel pour moi, c’est alors la réalité qui est imaginaire (et du coup elle devient digne de mes aspirations). « La vie est un songe » (la vida es sueño) disait Calderone de la Barca. Il ne croyait pas si bien dire.
Fabuleux livre, que nous a conseillé là Ellisa. Qu’elle en soit remerciée !

00:26 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : littérature, priest, la fontaine pétrifiante
04/05/2009
La femme et la louve
Toi, la louve aux yeux en amandes
où se réfléchissent tous les lointains,
tu désires un ailleurs où tu n’iras jamais :
l’étendue de la plaine éclairée par la lune,
le firmament des étoiles, les rumeurs de la forêt
et les steppes infinies de toute l’Eurasie.
La vie sauvage est là et la proie qui palpite
entre tes blanches canines
agonise sans comprendre le pourquoi de sa mort.
Hurlement de la meute au cœur de la nuit sacrée,
cauchemar qui devient rêve, puis songe…
La louve est là, sa toison, son regard.
L’amande de tes yeux
et ta tresse que tu défais d’un geste ample et souple
au cœur de la nuit ténébreuse.
Dans le rayon de la grande lune, dévêtue,
tu t’offres comme une proie
et ton cœur sauvage palpite
comme si c’était la mort qui s’avançait dans la profondeur de la forêt,
tandis que les loups n’en finissent plus de hurler.
Par la fenêtre ouverte tu contemples le firmament étoilé
Tu cherches un ailleurs,
un au-delà de toi-même.
Etendue dans la nuit sacrée,
Tu attends dans ta nudité, dans l’aura de ta chevelure d’or
et ton désir n’a d’égal que la peur de la mort qui approche
à pas de loups.
Tu as des yeux en amandes,
de beaux yeux qui pleurent, parfois,
quand l’aube pointe derrière la vitre
et que toute la meute a disparu
dans l’immense plaine de la vie.
Et tu restes là, seule,
à contempler les lointains inaccessibles
comme une louve
qui n’aurait pas trouvé sa raison d’être.
Tu es une louve, perdue dans le firmament des étoiles.
00:22 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature, poésie
29/04/2009
Des romans de Mac Carthy
D’un livre à l’autre, on retrouve toujours les mêmes thèmes chez Mac Carthy. Dans « La trilogie des confins », le héros est jeune : ce n’est même pas un adulte, plutôt un grand adolescent (16-17 ans), mais son comportement dénote une grande maturité. A chaque fois, il quitte le milieu familial, moins à la suite d’un conflit que par une décision bien réfléchie, celle de prendre sa vie en main. Ainsi, dans « Le grand passage », après avoir aidé son père à poser des pièges, afin de capturer le loup qui s’en prend au bétail, il finit par reconduire la louve prise au piège dans son pays d’origine (le Mexique) plutôt que de la tuer. Il part donc seul (sans avertir ses parents) avec cette louve, véritable fauve dont il s’agit de se protéger mais avec lequel un certain respect mutuel s’établit.
Dans « De si jolis chevaux », c’est vers le même Mexique que deux adolescents chevauchent, dans une sorte de fugue à caractère initiatique. Ces « marginaux » ne sont pas des bandits, bien au contraire. On est même étonné de la politesse qui les caractérise quand ils s’adressent à des adultes (« Oui Monsieur, bien sûr Madame », etc.), ce qui ne les empêche pas de se retrouver en prison (pour s’être promené avec une louve ou pour avoir soi-disant volé un cheval alors qu’en réalité ils n’ont fait que tenter de récupérer celui qu’on leur avait pris). Innocents par nature, ils paient ainsi le prix de leur désir de liberté et de leur transgression des règles sociales (la soumission au groupe dans une vie bien réglée).
On notera l’ambiguïté que représente le Mexique. D’un côté, c’est un pays tout différent : on y parle l’espagnol et non l’anglais, les gens y sont plus pauvres, on y fait souvent la révolution (ce qui ne doit pas déplaire au héros, avide de liberté), la nature y est plus sauvage encore et une frontière bien réelle en marque la limite (c’est soit une clôture pour le bétail qu’il faut franchir, soit un fleuve qu’il faut traverser). Cependant, il est clair que de chaque côté de cette frontière on retrouve de grands espaces ou le bétail vit en semi-liberté et la situation n’est donc pas fondamentalement différente, finalement.
Il en va de même pour la langue. Né à la frontière, le héros anglophone s’exprime parfaitement en espagnol (ne pas oublier que ces régions du Sud des Etats-Unis ont été conquises sur le Mexique au milieu du XIX° siècle). Ce bilinguisme fait donc de lui un individu privilégié et le rend capable de s’adapter au-delà de cette frontière qu’il vient de franchir. Une fois de l’autre côté, ce pays qui est un peu le même est pourtant plus beau, plus grand, plus vaste. Il représente surtout l’inconnu et à ce titre il fascine le héros qui va pouvoir y exercer ses talents d’aventurier et y affirmer sa personnalité. Cette marche (ou cette chevauchée) le long du chemin renvoie évidemment à une démarche existentielle (voir aussi le dernier roman de Mac Carthy, qui s’intitule précisément « La Route » et où un homme d’âge mûr et son fils tentent de survivre et de conserver leur humanité dans le monde en ruine qui a succédé à l’Apocalypse).
Le lecteur est surpris par la description qui est donnée de ces régions du Nord du Mexique. On s’attend à y trouver une chaleur écrasante mais même si celle-ci existe durant la journée, on parle beaucoup de la froideur de la nuit dans les montagnes, des cols enneigés qu’il faut franchir ou des éclairs qui illuminent l’horizon (et cela dans les trois recueils de la trilogie).
En effet, il y a toujours un orage qui menace quelque part, comme si l’imminence d’un danger donnait une dimension supplémentaire aux actions du héros.
La solitude est l’essence même de ce dernier et ce n’est pas un hasard s’il évite les villes (qu’il ne fait souvent que traverser) et préfère chevaucher au milieu d’une nature restée sauvage. Il campe à l’extérieur, auprès d’un feu de bivouac qu’il a allumé et contemple dans le lointain de la plaine les lumières des villes qui sont là sans faire partie de son univers.
Cette errance, véritable quête existentielle, lui permet d’aller jusqu’au bout de lui-même. Dépassant sa peur, misant sur son courage, (ici : côtoyer un loup), il se distingue des autres hommes par cette errance perpétuelle. Pourtant, par ses actions (ne pas tuer le loup qu’il a capturé, aider un jeune adolescent, tenter de délivrer une jeune fille innocente, devenue prostituée bien malgré elle, de l’emprise de son souteneur) il fait preuve d’une culture humaniste. Car s’il vit dans la nature, ce n’est pas pour redevenir sauvage. D’ailleurs il impose sa loi humaine à cette nature (dompter un cheval, obliger un loup à le suivre), ce qui le classe bien du côté de la culture (au sens large que donne Lévi-Strauss à ce terme). Il s’agit surtout d’imposer sa volonté personnelle au monde extérieur et là on retrouve, me semble-t-il, une des grandes caractéristiques des romanciers nord-américains. Alors que la littérature française a pu parfois sombrer dans un nombrilisme regrettable ou des considérations théoriques et un peu stériles sur l’écriture, Mac Carthy oppose bien les aspirations intérieures et le monde extérieur, étant entendu qu’il s’agit toujours pour l’individu, autant que faire se peut, de tenter d’imposer sa volonté au monde dans lequel il vit. Il n’y arrive jamais tout à fait, bien entendu et il lui faut faire des concessions.
Ainsi de la jeune fille riche dont il tombe éperdument amoureux dans « De si jolis chevaux ». Mexicaine (pour le héros, elle est donc déjà revêtue de l’aura mystérieuse qu’il prête à ce pays mythique qu’est pour lui le Mexique), elle est inaccessible à la fois géographiquement (elle réside souvent loin de l’exploitation où il travaille) et socialement (il est pauvre et elle est riche et en plus c’est la fille de son patron). Arrêté sur les conseils de ce dernier pour un acte qu’il n’a pas commis (dans le but d’éviter le mariage), il ne devra sa sortie de prison qu’à l’intervention d’une tante de la jeune fille. Malheureusement, si la tante a accordé son aide, c’est contre la promesse qu’a faite la jeune fille de se séparer de son amoureux. Devant respecter tous les deux la parole donnée, les deux amants doivent se séparer la mort dans l’âme (et leur dernière rencontre est d’une force rarement atteinte dans la littérature amoureuse). Dans ce cas, le milieu extérieur (et ici le monde social de l’argent et de la famille) l’a donc emporté sur le désir amoureux de l’individu.
Cette manière de tenter de s’imposer au monde, tout en essuyant des revers qui font grandir et qui font mûrir, me semble être un des traits caractéristiques des romans de Mac Carthy. Livres initiatiques, ses héros aux idées généreuses nous attirent et nous émeuvent. N’est-ce pas le but ultime de la littérature ? Nous faire vivre par procuration en mettant le doigt sur ce qui, dans notre propre existence, compte vraiment ?

Désert du Mexique, image Internet
16:46 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, mac carthy









