26/10/2007
De la littérature comme moyen de survie.
Toujours dans le contexte de l’île (voir textes précédents) on pourrait se demander si ce lieu mythique n’est pas avant tout intérieur. Certes, on peut s’isoler à la campagne et refuser la compagnie des hommes afin de ne pas compromettre son « moi » avec ce monde mercantile qui est devenu le nôtre. Mais on peut tout aussi bien opérer un repli intérieur et s’adonner par exemple à la lecture et à l’écriture, sans pour autant rompre tout à fait avec la société. Une question cependant se pose. Cette activité intellectuelle qui nous apparaît à nous comme une échappatoire, une percée décisive contre la bêtise ambiante, ne peut-elle être qualifiée de fuite en avant, de refuge, voire de régression ?
Pour le dire autrement, est-il normal de lire (ou d’écrire) ? Un être normalement constitué a-t-il besoin de ce jeu qui consiste à vivre ou à créer des mondes imaginaires ? Un homme (une femme) adulte, en pleine maturité, est supposé(e) agir sur le monde qui l’entoure et non pas se complaire dans la fiction ou la poésie. Sommes-nous donc des anormaux, nous qui lisons et écrivons ? Pourtant cette activité nous semble primordiale et elle ouvre assurément notre esprit à des considérations plus hautes que ne peuvent le faire la plupart de nos actions quotidiennes.
D’un autre côté l’écriture peut se révéler être une arme redoutable, par les idées qu’elle véhicule et par la critique de la société qu’elle implique. La lecture aussi, forcément. Alors, sommes-nous en retard, attardés en quelque sorte dans l’enfance, avec nos contes et nos chimères ou bien au contraire sommes-nous en avance, dénonçant déjà avant la majorité de nos contemporains les travers d’une société qui nous convient peu ?
Ceci dit l’écriture n’est pas seulement critique du monde ambiant. Elle est avant tout retour dans le fort intérieur, recherche de la vérité qui sommeille au fond de chacun de nous. Il nous appartient d’être ce que nous sommes (comme un chat est chat jusqu’au bout des griffes) et cela en dépit du contexte dans lequel nous vivons. L’idéal étant sans doute de trouver une adéquation entre nos aspirations intimes et le monde extérieur. Il faut alors passer par des compromis (c’est sans doute ce qui distingue l’âge adulte du temps de l’adolescence, plus intransigeant et surtout soucieux de trouver la pureté absolue). Les problèmes commencent quand ces compromis deviennent trop nombreux. Notre « moi » alors s’évanouit devant le « ça » (pour parler comme les philosophes, lesquels n’ont jamais rien fait d’autre que de tenter d’endiguer l’absurdité de la vie par des échafaudages théoriques bien illusoires). C’est à ce moment-là, en fait, que nous recherchons la fameuse île, afin de nous ressourcer et de redevenir nous-mêmes.
23:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : Littérature, lecture, écriture
18/10/2007
Ecriture

La chambre mystérieuse
Elle n’avait pas connu sa mère, morte en lui donnant le jour et avait toujours vécu dans cette grande maison déserte au bord du fleuve. Une maison immense, d’un autre temps, en partie délabrée et qui ne comportait pas moins de quarante pièces. Son père en était le gardien et tentait de la maintenir en état. Le propriétaire, lui, on ne l‘avait même jamais vu. Tous les mois, le salaire tombait et c’était tout. Pour le reste, personne ne venait jamais ici.
Enfant, elle passait son temps à rêvasser le long du fleuve, au pied du grand escalier de pierres. Elle s’inventait des amies afin de pouvoir jouer à la marelle ou bien elle se perdait dans le labyrinthe de la maison. A chaque fois, elle venait buter sur une porte hermétiquement close, celle de la chambre secrète. On ne l’ouvrait jamais et elle ignorait ce qu’elle contenait. Son père en gardait la clef sur lui, solidement attachée par un cordon autour du cou. Quand elle lui posait des questions, il refusait de répondre, disant simplement qu’il y a des choses qu’il vaut mieux ne pas savoir.
Quand elle eut vingt ans, elle vint plus souvent encore s’asseoir au bord du fleuve, où aucun bateau ne passait. Elle regardait les eaux grises qui disparaissaient à l’horizon, se dirigeant vers un monde qu’elle ne connaissait pas. Alors elle imaginait qu’un jour un grand voilier viendrait, avec un beau capitaine. Et qu’il l’emporterait vers les grands ports de l’Atlantique ou peut-être même jusqu’en Amérique.
Mais personne ne venait jamais, personne. Il n’y avait que le fleuve impassible et la grande maison avec sa chambre secrète toujours fermée sur son mystère. Le temps passa et son père devint si vieux qu’il décida d’aller dans un hospice. Ce jour-là, un petit canot vint accoster le long du quai, au pied des escaliers de pierres, dans un grand silence. Sans rien dire, son père monta dedans, ensuite il dévisagea sa fille une dernière fois. « Fais bien attention à toi », murmura-t-il. Puis, retirant le cordon qu’il avait autour du cou, il lui donna solennellement les clefs de la maison.
Pour "paroles plurielles"
14:53 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Littérature
17/10/2007
De l'édition
Sur son blogue, « La Lettrine », Anne-Sophie Demonchy nous propose un résumé de l’entretien qu’elle avait eu avec Dominique Gaultier, le directeur du Dilettante.
A un certain moment, celui-ci nous livre une réflexion pour le moins étrange :
« Si un auteur ne s’adresse pas au bon éditeur, c’est qu'il est mauvais. Il ne lit pas, donc il envoie son manuscrit comme une bouteille à la mer. Je ne crois pas qu’on écrive un chef d’œuvre sans avoir une idée de l’éditeur chez qui l’envoyer. »
Outre le fait qu’on imagine mal quelqu’un qui écrirait et qui ne serait pas, par ailleurs, passionné par la lecture, une telle phrase part du présupposé qu’il convient de lire tout ce qui s’écrit aujourd’hui (sinon comment connaître les tendances des différents éditeurs ?). Cela signifie donc qu’il vaut mieux s’imprégner des 720 romans de la rentrée que de lire les classiques, ce qui me dérange déjà quelque peu.
Il est certain qu’il est un peu vain d’envoyer son manuscrit au hasard, mais d’un autre côté le premier devoir d’un écrivain est d’écrire. Sonder les tendances éditoriales du moment fait partie d’une autre stratégie, nécessaire certes, mais qui n’a rien à voir avec les qualités littéraires dudit romancier. On pourrait plutôt parler ici d’une opération qui s’apparente à celle du marketing : savoir trouver un débouché pour son produit. Bien sûr, celui qui ne saura pas réaliser cette démarche ou qui n’aura pas les qualités pour la mener à bien pourra laisser son manuscrit moisir dans ses tiroirs. Mais est-ce pour cela qu’il faut le qualifier d’emblée de mauvais auteur ? On pourrait d’ailleurs retourner l’argument et dire que celui qui se fait éditer est peut-être justement celui qui est assez perspicace pour se rendre compte de ce qui plaira. En d’autres termes, son texte aurait pu être écrit en tenant compte d’une certaine attente. Si tout le monde agit de la sorte, on risque bien de se retrouver devant une production fort monotone. Au fait, qui a dit que les 720 romans de la rentrée se ressemblaient un peu tous et qu’ils étaient interchangeables?
De plus, si on veut bien y réfléchir, il est parfois difficile de déterminer quelle est la tendance d’un éditeur. C’est peut-être assez aisé à repérer pour les petits, qui ne proposent que quelques auteurs, mais pour les grandes maisons possédant plusieurs collections, tous les genres et toutes les tendances peuvent être représentés.
D’un autre côté, il y a lieu de considérer les propos de notre éditeur comme dénués de sens dans la mesure où (ce n’est un secret pour personne) aucun manuscrit n’est publié en arrivant anonymement par la poste. Il faut donc être introduit dans une maison d’édition pour espérer un tel honneur. Dans un tel contexte, évidemment, on comprend que la moindre des choses est de se plier à la « tendance » de la maison.
21:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Littérature, édition.
16/10/2007
Auto promotion

"Camus est devenu l’auteur classique par excellence, celui qu’on étudie dans toutes les classes de lycée. Même les non-littéraires donneront spontanément et sans aucune hésitation le titre d’un ou deux de ses livres si on les interroge à son sujet. Ils seront même capables d’aller plus loin et définiront Camus comme l’écrivain de l’absurde, sans oublier de faire référence à sa fin tragique, dans un accident de voiture. Tout le monde croit donc bien le connaître. Et pourtant, il ne serait peut-être pas inutile de rafraîchir nos souvenirs scolaires, surtout si ceux-ci commencent à s’estomper quelque peu tant ils remontent dans le temps…"
Lire la suite dans La Presse littéraire n°11 ( en vente actuellement dans les kiosques parisiens), sous le titre "Albert Camus ou l’ambiguïté d’une révolte".
Dans le même numéro, on trouvera un autre de mes articles, intitulé « La littérature en Belgique francophone est-elle belge, française ou wallonne ?, " où il est question à la fois de la crise identitaire que traverse actuellement ce petit royaume et des rapports des pays francophones en général (Belgique, Suisse, Canada) avec la France « métropolitaine ». L’accent est mis notamment sur les rapports éditoriaux.
Enfin, notons encore un troisième article, plus modeste, intitulé lui « Littératures sur la Toile », où je donne quelques adresses qui m’ont paru intéressantes.
12:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Littérature, La Presse littéraire, Camus, littérature de Belgique francophone
15/10/2007
Alina Reyes.

Alina Reyes, dont j’avais un peu fréquenté le blogue du temps où elle en tenait un, revient sur le devant de la scène, victime de ce qui semble bien être une affaire de plagiat.
Mais d’abord, qui est Alina Reyes ? Ce nom est en fait un pseudonyme emprunté à une nouvelle de Cortazar, ce qui est déjà tout un programme. Elle s’appelle en réalité Aline Nardone et est née en 1956 en Gironde. De cette enfance devant l’océan, elle a manifestement conservé le goût de la nature et des impressions à fleur de peau. En 1988 parait son premier livre, Le Boucher, alors qu’elle est toujours étudiante en lettres. Je me souviens lui avoir demandé comment, avec le recul, elle expliquait cette publication, car on sait qu’il n’est pas facile de se faire remarquer par les éditeurs quand on est un(e) illustre inconnu(e). Sa réponse a été claire : elle était jeune, était une femme et proposait un roman érotique. Cela passait donc beaucoup mieux auprès des éditeurs (qui sont toujours habiles à flairer la bonne affaire) que les manuscrits sérieux et rébarbatifs de quinquagénaires universitaires. Donc acte.
Le problème, c’est que ce qualificatif d’érotique va lui coller à la peau. Ses autres livres ne peuvent pourtant pas tous être qualifiés de tel, loin de là. Disons plutôt qu’ils sont sensuels (ce qui est différent), sensuels dans la mesure où Alina semble décrire son corps et écrire avec ce corps. C’est qu’elle ressent intensément les expériences que la vie lui apporte, que ce soit les rapports avec les gens ou les contacts directs avec la nature. Visiblement, on a voulu la ranger une fois pour toute dans une catégorie, mais elle est trop vraie pour que cela lui convienne. D’elle, je n’ai lu que Moha m’aime , un beau récit sur un voyage au Maroc. L’héroïne, qui est en fait elle-même, y rencontre un jeune pêcheur marocain, Mohamed, avec qui elle se lie d’amitié. Mohamed est un peu son double et il vit en fusion avec la nature (il plonge dans l’océan pour pêcher des poissons qui semblent être sa seule nourriture). Insensiblement elle se rapproche de lui, fascinée par sa douceur et sa générosité. Mais leur aventure ne va pas plus loin que cette reconnaissance de soi dans l’autre (ou l’inverse). C’est donc bien d’un voyage intérieur qu’il s’agit et nous sommes à mille lieues, dans ce petit roman sensible, de l’érotisme au sens habituel. Notons que le livre se termine par un retour en France un peu désabusé. La dernière page, cependant, s’ouvre sur l’espoir. L’héroïne se retrouve dans sa petite maison au sommet des Pyrénées. De ces hauteurs enneigées, en harmonie avec la nature sauvage, elle domine le monde et la folie des hommes.
Notons que la vraie Alina possède une vieille bergerie qu’elle a restaurée, quelque part sur les hauteurs d’Argelès-Gazost. Quand elle n’est pas à Paris, elle va se ressourcer là-bas, commençant sa journée d’écriture par de longues promenades en forêt. Voilà une existence qui fait rêver : partager son temps entre l’écriture et la nature, que désirer de plus ? C’est de tout cela qu’elle parlait autrefois sur son blogue et on se dit que quelqu’un qui vit ainsi ne doit pas être bien méchant et qu’en tout cas ce ne doit pas être le genre à se complaire dans la chicane.
Pourtant, l’autre jour, il lui a bien fallu montrer les dents. Durant l’été était sorti son dernier roman, Forêt profonde, que je n’ai pas encore lu mais que je comptais de toute façon lire dans la mesure où il faisait suite à la tenue et à la fermeture de son blogue. Visiblement déçue par Internet, lieu où elle se disperse en tant qu’écrivain, elle met ses confrères en garde : « Ne vous perdez pas dans ce bourbier » et de conclure : « La blogosphère, c’est l’infini à la portée des rats. ». Nous voilà prévenus. D’après ce que je sais de ce livre, il est avant tout une sorte de mise au point avec elle-même. Elle y raconte « ses amours, ses fantasmes, son désespoir, son mysticisme, sa sensualité, sa soif de liberté, d'absolu, de solitude, de fraternité, sa révolte… ». Bref, il s’agit de quelque chose de fort personnel, une entrée au plus profond de soi-même, en quelque sorte.
Or, voilà qu’elle remarque, en lisant un roman, en l’occurrence Cercle d’un certain Yannick Haenel (par ailleurs totalement inconnu de moi, qui suis plutôt du genre à lire les classiques), l’existence de ressemblances étranges avec son propre imaginaire. Pour faire bref, disons que plus elle poursuit la lecture de ce roman et plus elle y retrouve les thèmes du sien, « Forêt profonde ». Que dis-je, non seulement des thèmes, mais aussi des détails ou même des tournures de phrases. Gênant. Gênant et révoltant, surtout qu’on l’a dit, le sujet de « Forêt profonde », c’est elle-même, Alina. On ne peut donc pas simplement supposer que les deux écrivains ont des imaginaires fort proches, ce qui peut arriver, et expliquerait qu’ils soient amenés à traiter des thèmes semblables.
Alina Reyes envoie donc quelques courriels bien sentis à Yannick Haenel, qui ne répond pas. Devant ce silence, elle passe à l’offensive sur Agoravox, déplorant moins les emprunts que le fait que, selon elle, « on » occulte délibérément son livre au profit de celui de Haenel. Ce « on » renverrait à Philippe Sollers lui-même, qui, en tant que Dieu de l’édition, fait la pluie et le beau temps dans ce petit monde :
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_...
Puis c’est Pierre Assouline, sur son blogue, qui en parle, disqualifiant d’office l’auteur de « Forêt profonde » en laissant sous-entendre qu’elle vit mal le fait qu’on ne la met plus en avant comme du temps où elle publiait « Le Boucher ». Ceci dit, il doit savoir de quoi il parle et il est certain que la célébrité d’un écrivain tient plus à la publicité qu’on fait de son livre qu’à ses qualités d’écriture. Autrement dit, on fait apparaître ou disparaître les écrivains au gré des goûts du moment. Si nous voulons être objectifs, il se pourrait bien, en effet, qu’Alina Reyes ne réponde plus aux attentes que le monde de l’édition avait mises en elle. En voulant sortir de la zone strictement érotique où on l’a confinée, elle commet peut-être un impair (compréhensible et justifié sur le plan de la littérature, mais suicidaire sur la plan éditorial).
En attendant, il n’en reste pas moins que les procédés employés semblent scandaleux. Assouline, par exemple, donne la réponse (bien tardive) de Haenel mais refuse les commentaires postés par Alina Reyes. On voudrait couler quelqu’un qu’on ne s’y prendrait pas autrement.
Pour ceux que l’affaire intéresse, je me permets de les renvoyer au blogue d’Igor Yanka, lequel en propose un bon résumé. De plus, il a établi un historique de tous les rebondissements successifs.

15:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Littérature, Alina Reyes
04/10/2007
Cendrillon, une jeune fille en pantoufle
Après avoir parlé l’autre jour du Petit Chaperon rouge, venons-en à Cendrillon (tant il est vrai que les contes de notre enfance, quand on les revisite à l’âge adulte, nous apparaissent d’une grande richesse, ce que nous n’avions pas toujours soupçonné). Sur le blogue « Langue sauce piquante », toujours intéressant, on s’interroge sur le fait de savoir si Cendrillon portait des chaussures de vair ou de verre.
http://correcteurs.blog.lemonde.fr/2007/10/04/la-belle-au...
Voici ma réponse à la question.
J’ai cru longtemps que la bonne version était « vair » et que c’est par une erreur d’impression que « verre » s’était répandu. En fait, il n’en est rien. C’est Balzac et après lui Littré qui ont cru rétablir la version première alors qu’en fait ils s’en éloignaient. Car dans le conte écossais cité, comme dans des contes catalans, c’est bien de chaussures de verre dont il est question.
Cela peut se comprendre si on veut décortiquer les structures de l’imaginaire qui sont à l’œuvre dans ce conte. Outre le fait qu’il serait difficile de danser avec des chaussures (car pantoufle avait bien le sens de chaussure d’intérieur à l’époque de Perrault) en fourrure (lesquelles s’useraient très vite), la nature du verre, par sa transparence, nous permet d’admirer le pied de Cendrillon, lequel est tout de même au centre de l’histoire. En effet, à la pauvre fille qui marchait pieds nus, on propose cette chaussure magique qui va permettre de mettre en valeur ses petits pieds. Le Prince ne s’y trompera pas et c’est bien par l’intermédiaire de la chaussure qu’il va retrouver l’élue de son cœur. La transparence du verre, qui dévoile la nudité du pied peut être comprise comme une synecdoque (la partie pour le tout). C’est tout le corps de Cendrillon qui est désirable, mais la pudeur du récit ne nous parle que du pied. Ce pied que personne ne remarquait quand il était sans chaussure et qui peut maintenant dévoiler tout son charme. Pour cela, il faut bien une chaussure transparente. Le pied est donc à l’image de Cendrillon elle-même que personne n’admirait et qui devient maintenant l’objet de l’attention du prince.
Evidemment, si la logique narrative et la symbolique y trouvent leur compte, ce n’est pas le cas du bon sens. Une chaussure en verre casserait. Mais outre le fait que cette fragilité renvoie elle aussi à la fragilité de la jeune fille (et au côté éphémère, provisoire de cette scène du bal, qui va irrémédiablement s’achever à minuit) il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans un conte et que dès lors des choses merveilleuses et incompréhensibles doivent être acceptées.
Par ailleurs, pour faire maintenant un peu d’étymologie, rappelons que « vair » vient du latin « varius », moucheté, tacheté, bigarré. Au sens moral, il a même pu signifier « inconstant, irrésolu ».
Dans l’ancienne langue, « vair » s’est employé pour qualifier des yeux d'une couleur indécise (ni bleus ni marrons). Cette idée de « varié », « non fixé », on la retrouve pour qualifier une fourrure (« bigarré, multicolore »). C’est ce sens qui a perduré jusqu’à nous.
Notons encore que c’est du même étymon que vient l’adjectif « vairon » (qui désigne des yeux qui n’ont pas la même couleur) ou le substantif « vairon » (poisson moucheté).

13:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Cendrillon, littérature
28/09/2007
Soleil noir
Nous parlions l’autre jour ici-même, à propos de l’oxymore, de l’expression « soleil noir », employée par Nerval dans El Desdichado. Sur son blogue, Angèle Paoli cite justement un poème étrange et angoissant de Théophile de Viau reprenant précisément cette expression. Nerval n’est donc pas l’inventeur.
http://terresdefemmes.blogs.com/mon_weblog/2007/09/25-sep...
UN CORBEAU DEVANT MOI CROASSE
Un corbeau devant moi croasse,
Une ombre offusque mes regards,
Deux belettes et deux renards
Traversent l'endroit où je passe :
Les pieds faillent à mon cheval,
Mon laquais tombe du haut mal,
J'entends craqueter le tonnerre,
Un esprit se présente à moi,
J'ois Charon qui m'appelle à soi,
Je vois le centre de la terre.
Ce ruisseau remonte en sa source,
Un boeuf gravit sur un clocher,
Le sang coule de ce rocher,
Un aspic s'accouple d'une ourse,
Sur le haut d'une vieille tour
Un serpent déchire un vautour,
Le feu brûle dedans la glace,
Le Soleil est devenu noir,
Je vois la Lune qui va choir,
Cet arbre est sorti de sa place.
Théophile de Viau, Œuvres poétiques, 1621
16:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Littérature, soleil noir
24/09/2007
Le Premier homme

Lorsque Camus décède dans un accident de voiture, en 1960, on retrouve à ses côtés une serviette contenant le manuscrit du livre qu’il est en train d’écrire. Il s’agit du Premier homme, qui ne sera publié qu’en 1994 par les soins de sa fille, Catherine Camus.
Ce live est bien différent des autres livres de l’écrivain, puisqu’il est en fait une remontée aux origines, autrement dit un voyage au pays de l’enfance. Cherchant désespérément à savoir qui il est, Camus part à la recherche de son père, qu’il n’a pas connu (ce dernier est mort à la guerre de 1914 alors qu’Albert avant un an). Cette recherche se fait dans le cadre des événements d’Algérie, ce qui fait que cette remontée vers l’enfance est aussi sans doute inconsciemment une recherche de la légitimité de la présence française dans ce pays qui est le sien.
Le style en est fort différent des autres livres de Camus. On y trouve de grandes phrases amples et souples, à l’opposé de ce à quoi il nous avait habitué dans l’Etranger par exemple. Il y a du lyrisme dans ce livre-ci, et les évocations des jeux de l’enfance fait penser à Pagnol. Un Pagnol philosophe, cependant, car derrière chaque émotion la réflexion pointe son nez. Ainsi quand le héros (qui est en fait Camus) part se recueillir sur la tombe de son père (tombe qu’il n’a jamais vue) dans le cimetière de Saint-Brieuc. Il réalise qu’il a quarante ans et qu’il est donc plus âgé que son père n’était au moment de son décès (il est mort à 29 ans). Il s’ensuit une prise de conscience à la fois existentielle et affective (le père devient un peu l’enfant de son fils). Du coup, cet être qui n’était rien pour lui se met à vivre dans sa mémoire. Il imagine ce qu’il a vécu, sa pauvreté, ses joies, ses souffrances… Par delà la mort, c’est tout un réseau de correspondances qui se tisse.
Ironie du sort, à la fin du livre (là où le manuscrit est resté inachevé), Camus espère qu’il conservera longtemps encore la force vitale qui a été la sienne et qui lui a permis de s’affirmer face au malheur. Arrivé à l’âge mûr, il prend conscience, cependant, que le temps s’écoule inexorablement et qu’il lui faudra bien accepter l’idée du vieillissement et de la mort. C’est sur cette notion d’acception que le livre reste en suspens. Quelques jours plus tard, Camus décédait dans l’accident que l’on sait, ce qui rend la dernière page du manuscrit particulièrement bouleversante.
14:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, Camus
14/09/2007
Oxymore
Sur son blogue, (http://www.josephetorban.canalblog.com/)
Joseph Orban, poète très mal connu comme il se définit lui-même, fait allusion à « un important responsable culturel socialiste », précisant que cette formulation relève d’une figure de rhétorique, en l’occurrence l’oxymore. Nous laisserons de côté l’analyse politique car il serait vain de savoir qui, des socialistes ou des sarkoziens, est le plus proche de la culture et nous profiterons plutôt de l’occasion qui nous est donnée pour rappeler que le terme oxymore (ou oxymoron) vient du grec « oxumoros » (de « oxus », aigu et « moros », émoussé) et qu’il désigne une figure de rhétorique où deux mots désignant « des réalités contradictoires ou fortement contrastées sont étroitement liés par la syntaxe. » Exemple : « un merveilleux malheur ».
On parle parfois d’antilogie, mais ce terme renvoie surtout à quelque chose d’illogique. Dans ce cas, on pousse tellement loin l’antithèse qu’on se retrouve dans une situation absurde.
Le grammairien français Pierre Fontanier, qui avait consacré sa vie à étudier les tropes, parle lui de paradoxisme. Il est dans le vrai car c’est pour le moins un paradoxe d’accoler ensemble des termes contradictoires.
Certains oxymores servent à désigner des réalités qui ne possèdent pas encore de nom, comme par exemple « aigre-doux » (pour les amateurs de cuisine chinoise) ou « clair-obscur » (pour les amateurs de la peinture de Rembrandt).
Généralement, cependant, les écrivains qui emploient l’oxymore cherchent à attirer l’attention de leur lecteur. L’encyclopédie en ligne Wikipédia (dont il faut certes se méfier mais qui est parfois bien utile) nous propose quelques exemples :
- Les azurs verts (Rimbaud)
- Les splendeurs invisibles (id.)
- La clarté sombre des réverbères (Baudelaire)
- Cette obscure clarté qui tombe des étoiles (Corneille)
- Un jeune vieillard (Molière)
- Hâtez-vous lentement (Boileau)
- Je la comparerais à un soleil noir si l’on pouvait concevoir un astre noir versant la lumière et le bonheur (Baudelaire)
- Un affreux soleil noir d’où rayonne la nuit (Hugo)
Alors là, je fais appel à l’équipe. Si je connaissais la phrase de Baudelaire, c’est surtout à Nerval que je pense quand je rencontre l’expression « soleil noir », Nerval qui avait écrit ce beau poème « El desdichado » :
EL DESDICHADO
Je suis le ténébreux, -le veuf, -l'inconsolé,
Le prince d'Aquitaine à la tour abolie:
Ma seule étoile est morte, -et mon luth constellé
Porte le soleil noir de la Mélancolie.
Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé,
Rends-moi le Pausilippe et la mer d'Italie,
La fleur qui plaisait tant à mon coeur désolé,
Et la treille où le pampre à la rose s'allie.
Suis-je Amour ou Phébus, Lusignan ou Biron?
Mon front est rouge encor du baiser de la reine;
J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène...
Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron,
Modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée
Les soupirs de la sainte et les cris de la fée
Nerval aurait pu prendre cette expression « soleil noir » chez Baudelaire, mais plus vraisemblablement il la tient des livres d’occultisme dont il était friand, notamment ceux de Don Pernety. Certains ont parlé aussi de la gravure « Melancolia » de Dürer

Mais j’ignorais totalement qu’Hugo avait aussi employé cet oxymore. Quelqu’un pourrait-il me dire dans quel livre ?
15:45 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : oxymore, Nerval, littérature
13/09/2007
Goncourt
Voici la liste de la sélection du Goncourt 2007. Qu’en dire ? Qu’on s’éloigne à chaque fois davantage de l’esprit initial des frères Goncourt, qui voulaient encourager un écrivain débutant et méritant. En effet, on retrouve des archi-connus comme Assouline, Nothomb ou Poivre d’Arvor (lequel n’écrit par seul mais avec son frère). A côté de cela, on a le livre de Darrieusecq, qui a surtout fait parler de lui devant les tribunaux (ce qui est une publicité comme une autre). On notera la présence des éditeurs traditionnels et on se réjouira pour Gallimard qui présente quatre poulains, ce qui multiplie ses chances de succès commercial. Pour le reste, retournons à nos affaires et laissons les loups se manger entre eux. Réjouissons-nous, cependant, de l’absence, dans cette sélection, de Yasmina Reza. Il n’aurait plus manqué que cela : voir la photo de Sarkozy s’étaler dans toutes les librairies de France et de Navarre.
Olivier Adam : "A l'abri de rien" (L'Olivier)
Pierre Assouline : "Le portrait" (Gallimard)
Philippe Claudel : "Le rapport de Brodeck" (Stock)
Marie Darrieussecq : "Tom est mort" (P.O.L.)
Vincent Delecroix : "La chaussure sur le toit" (Gallimard)
Delphine De Vigan : "No et moi" (J.C. Lattès)
Michèle Lesbre : "Le canapé rouge" (Sabine Wespieser)
Clara Dupont-Monod : "La passion selon Juette" (Grasset)
Yannick Haenel : "Cercle" (Gallimard)
Gilles Leroy : "Alabama Song" (Mercure de France)
Amélie Nothomb : "Ni d'Eve ni d'Adam" (Albin Michel)
Olivier et Patrick Poivre d'Arvor : "J'ai tant rêvé de toi" (Albin Michel)
Grégoire Polet : "Leurs vies éclatantes" (Gallimard)
Lydie Salvayre : "Portrait de l'écrivain en animal domestique" (Seuil)
Olivia Rosenthal : "On n'est pas là pour disparaître" (Verticales)
Enfin, si vous étiez découragés par la vague déferlante des 740 (?) romans de l'automne, réjouissez-vous puisque les dieux de l'édition, qui sont cléments, vous permettent de restreindre votre choix. Les plus fainéants peuvent même attendre le nom du lauréat pour commencer leur lecture. Evidemment, vous n'aurez pas le meilleur des livres mais celui que tout le monde aura acheté. C'est déjà cela, non? Dans nos républiques moutonnières où la consommation est de mise, que rêver d'autre?

11:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, Goncourt
07/09/2007
Voyage au pays de l'enfance

Il existe de nombreuses versions de Chaperon rouge. Celles qui nous sont les plus familières sont dues respectivement à Charles Perrault et aux frères Grimm. Chez Perrault, le loup mange le chaperon, tandis que les Grimm nous offrent une fin plus adaptée aux oreilles enfantines : un chasseur providentiel vient éventrer le loup et délivre ainsi la petite fille et sa grand-mère.
Il existe d’autres différences. Ainsi chez Perrault, c’est une galette et un pot de beurre, qu’il faut aller porter à l’aïeule. Chez les Grimm, le beurre est remplacé par une bouteille de vin. Notons que dans la tradition orale, on parle surtout d’un morceau de pain encore chaud et d’une bouteille de lait. Dans cette même tradition orale, on retrouve le choix qui est demandé à l’enfant : choisira-t-elle le chemin des aiguilles ou celui des épingles ? Ailleurs, le chaperon n’a pas à choisir. Le loup, d’autorité, emprunte le chemin le plus court tandis que la belle étourdie s’attarde à cueillir des fleurs le long du chemin le plus long (Perrault). Ou bien encore elle quitte carrément le chemin et s’aventure dans le sous-bois (Grimm).
La fameuse réplique « tire sur la chevillette et la bobinette cherra » se trouve chez Perrault. Elle reflète manifestement des versions antérieures. Il est étrange que cette formule ait été reprise telle quelle car elle est devenue pour ainsi dire incompréhensible. Pourtant, quand on nous parle aujourd’hui du Chaperon rouge, c’est invariablement à cette phrase que l’on songe. Manifestement, on se la répète de génération en génération comme une formule magique.
Est-ce les sonorités qui plaisent? Sans doute. A moins que la formule ne soit un résumé de toute l'histoire. Tirer la chevillette suppose une décision à prendre (comme le petit Chaperon qui a décidé de s'écarter du droit chemin afin de folâtrer dans les bois), décision qui a des conséquences: la bobinette choit irrémédiablement (de même que le Chaperon ne manquera pas, en principe, de se faire dévorer par le loup).Et puis il y a aussi la survivance du verbe choir, qui est le seul terme de la formule a encore être compris et qui renvoie, nostalgiquement, à un état ancien de la langue que nous désirerions encore comprendre. Il est vrai que l’histoire du chaperon renvoie elle aussi à notre petite enfance et donc à un monde primitif qui est pour nous sacré. On ne touche pas aux souvenirs.
Mais revenons à nos différentes versions. Chez les Grimm on ne parle ni de bobinette ni de chevillette, mais plus simplement de loquet. Dans les deux cas le loup mange la grand-mère et prend sa place dans le lit (car l’aïeule, étant malade, était alitée). Dans la tradition orale, le loup (le bzou) ne mange pas la grand-mère, mais il met « de sa viande dans l'arche et une bouteille de sang sur la bassie (« petite pièce où on fait la vaisselle, évier »). On remarquera comment l’épisode du sang dans la bouteille a été transformé en bouteille de lait, puis en beurre dans les versions policées du conte.
Il conviendrait donc de faire de ce conte une analyse anthropologique, en mettant en évidence les oppositions entre la nature (le bois, le loup) et la culture (habits rouges de la fillette, bon chemin, maison à la porte bien fermée, etc.). De même le thème alimentaire est prédominant. C’est du pain ou une galette que l’on apporte à la mère-grand (pas des fruits sauvages mais un aliment cuit et travaillé par l’homme), tandis que c’est de la chair crue qui est exposée par le loup. Ou bien on apporte du vin (symbole également de la domination des hommes sur la nature) qu’on opposera au sang de l’aïeule. S’il était entendu que celle-ci devait manger les mets préparés à son intention, elle se retrouve en fait mangée par le loup, cet animal sauvage par excellence. Quant au Chaperon, elle devient elle-même une proie pour le loup, non seulement sur le plan alimentaire, mais aussi sexuel. La version orale est on ne peut plus explicite à ce sujet. La fillette se déshabille entièrement sur les conseils du bzou, afin d’aller le rejoindre dans le lit, tout en remarquant l’étrange virilité de sa prétendue grand-mère : « Oh, que vous êtes poilouse ! ». Entre-temps, elle aura consommer les morceaux de viande humaine (cannibalisme et anthopophagie) malgré les avertissement de la chatte de la maison (un animal, pourtant). Manger et être mangé, désirer et être désirée constituent donc bien deux des axes importants de ce conte qui ne semble plus tout à fait convenir aux enfants quand on l’analyse sous cet angle.
Dans la version orale, le loup ne dévore pas le Chaperon (c’est elle qui a mangé des morceaux de sa grand-mère), qui réussit à s’enfuir par ruse (ne poussant pas la régression à l’état naturel au point de coucher avec le loup). Chez Grimm et Perrault, on sait ce qu’il en est. De plus, un chasseur (tueur d’animaux) ou un bûcheron (coupeur d’arbres) tue le loup et ouvre son ventre où on retrouve l’aïeule et sa petite-fille. Tout finit bien. L’homme domine de nouveau la nature, la jeune fille devra rester prudente à l’avenir (se méfier de la nature, des loups, des hommes et de leur désir et obéir à sa mère) et il semble légitime de tuer des animaux cruels. L’ordre est rétabli. Par contre, on conviendra que le sens premier, tel qu’il apparaît dans la tradition orale, est beaucoup plus inquiétant. La fille est maîtresse de sa destinée, elle choisit le chemin qu’elle veut, se déshabille sans honte, mange sa grand-mère, etc. C’est par son intelligence et sa ruse qu’elle parvient à s’échapper quand elle trouve que le jeu ne lui plait plus (alors que chez Grimm et Perrault, c’est le loup qui est rusé et intelligent, tandis que le Chaperon est naïve et étourdie). On voit donc comment les versions policées ont complètement dénaturer le sens premier et ont inversé toutes les valeurs.

22:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : chaperon rouge, littérature, anthropologie
31/08/2007
Qu'est-ce que la littérature?
Joseph Vebret, pour son ancien site, m’avait autrefois demandé de mettre par écrit quelques réflexions sur la nature de la littérature. Ce site ayant disparu au profit d’un nouveau (http://www.vebret.com/) mon texte a été perdu. Je le remets donc ici, imitant en cela Jean-Jacques Nuel, qui remet lui aussi sur son blogue le texte qu’il avait donné à l’époque. (http://nuel.hautetfort.com/archive/2006/06/12/la-litterat...)
Pourquoi la littérature ? Question à laquelle il est difficile de répondre dans la mesure où pour beaucoup de personnes la littérature est comme une seconde nature et qu’elle fait partie intégrante de leur être et de leur personnalité.
Et d’abord, est-elle du domaine de l’inné ou de l’acquis (pour remettre au goût du jour cette vieille querelle à laquelle les psychologues ne sont jamais parvenus à répondre) ? Il vaut mieux rester prudent avant d’affirmer quoi que ce soit dans ce domaine, mais c’est un fait qu’on observe souvent, parmi ceux qui deviendront de futurs grands lecteurs ou de futurs auteurs, un goût manifeste pour les histoires racontées, et ce dès la petite enfance. Ainsi, Gabriel Garcia Marquez a toujours expliqué que sa vocation d’écrivain trouvait son origine dans les contes que lui lisait sa grand-mère. Il s’en serait même inspiré pour créer son univers romanesque, connu sous le nom de réalisme magique. A cette passion pour la littérature orale, succède naturellement chez ces enfants la passion de la chose écrite. Ils dévorent tout, depuis les BD de Tintin jusqu’à l’entièreté de la collection verte, en passant par la Comtesse de Ségur ou les livres de Jules Vernes. Plus tard, bien entendu, on les retrouvera dans les couloirs des bibliothèques ou dans les allées des librairies. Mais quand on a dit cela on n’a encore rien dit, car on ne sait toujours pas d’où leur vient vraiment cet engouement. Est-il inné, et faut-il voir dans ce travers un atavisme familial ou une quelconque déviation génétique ? Est-il au contraire acquis et cette passion précoce traduirait-elle quelque part un manquement, comme par exemple la nécessité de découvrir dans les livres une réalité plus belle que celle de la vie ? Est-ce l’exploration de l’imaginaire, mise ainsi à leur portée, qui enchante ces enfants ? La lecture précoce ouvre-t-elle la porte d’un monde privilégié, qui restera à jamais inaccessible pour les autres ? Le besoin de lire était-il préexistant ou est-ce la lecture qui a alimenté et développé ce besoin? Bien malin qui pourrait répondre à ces questions. Il semble pourtant qu’il y ait quelque part une faille, une déchirure, que viendrait combler l’exploration du monde de l’imaginaire. Comme il n’est pas douteux que cette exploration vous entraîne de plus en plus loin au point que parfois le lecteur devient lui-même écrivain.
Evidemment, à force de s’imprégner de la vision du monde offerte par d’autres, le lecteur invétéré finit par vouloir proposer sa propre vision. Car tout est là. Devant le monde imparfait dans lequel nous vivons, nous pouvons être tentés d’élaborer une version plus parfaite, qui soit de notre cru et qui corresponde mieux à nos aspirations. Puisque la vie est un rêve et même un mauvais rêve, c’est que la réalité, la vraie, se trouve dans l’imaginaire (concept qui englobe à la fois le roman et la poésie). D’ailleurs, s’ils parlent du monde tel qu’il est, les livres ont d’abord tendance à le dénoncer. C’est que la littérature n’est pas un simple jeu, évidemment. Elle prend sa source au cœur même de la personnalité de l’auteur et sa démarche a un caractère ontique. Ecrire, c’est d’abord dire le mal qui nous entoure, le dénoncer, et par-là le condamner. Ainsi, on peut écrire sur la politique, sur l’inconstance de la nature humaine (en amour comme en amitié), sur les choix culturels de notre société, sur la présence de Dieu ou son absence. Bref, on peut dénoncer ce qui ne correspond pas à notre moi intime. Ecrire, c’est donc rejeter le monde réel pour tenter d’imposer sa propre vision des choses. Parfois, plus modestement, c’est tenter de concilier ces deux contraires et faire en sorte que l’individu, malgré toutes ses blessures et toute sa révolte, puisse trouver une place plus ou moins acceptable dans ce monde injuste qui n’était pas fait pour lui. La littérature dépasse alors la critique pour essayer de trouver l’équilibre et l’harmonie. Elle est donc quelque part une recherche du bonheur, mais cette recherche, par définition, est illusoire, puisqu’elle repose sur la fiction. A peine un roman est-il achevé, à peine un poème est-il terminé, que l’auteur doit reprendre sa tâche pour créer de nouvelles fictions, de nouveaux personnages de papier, de nouveaux rêves. Tel Sisyphe, il est condamné à toujours écrire et à repousser autant qu’il peut les limites des possibles, sans parvenir jamais à trouver un terme à sa recherche.
Pourquoi lire, donc ? Et bien pour trouver chez les héros de romans un sens à la vie, tant il est vrai que ceux-ci sont représentés selon cette seule optique. Le héros amoureux est uniquement préoccupé par son amour, l’aventurier par ses explorations, le révolté par son combat. Nous, au contraire, dans notre vie de tous les jours, nous cumulons les rôles. A la fois père, mari, fils, parent d’élève, employé d’une société, consommateur, conducteur, vacancier, spectateur, mélomane, citoyen, usager des transports en commun (et bien d’autres choses encore), nous ne parvenons pas toujours à concilier tous ces aspects et donc à trouver un sens cohérent à notre existence. Les personnages littéraires, au contraire, nous offrent cette possibilité puisque, même s’ils sont complexes, ils ne jouent généralement qu’un rôle à la fois.
Mais pourquoi écrire alors, puisqu’il y a déjà la lecture ? Sans doute pour ne pas mourir. Alors que toutes nos actions, si elles ont un sens à court terme, ne signifient souvent pas grand chose sur un plan existentiel, le fait pour un individu de s’asseoir devant une feuille de papier et de commencer à la remplir de signes intelligibles donne souvent l’impression (et peut-être l’illusion) de réaliser enfin quelque chose d’important. Pourquoi ? Et bien précisément parce que cet individu, qui n’est pas encore écrivain mais qui est déjà « écrivant », peut enfin proposer clairement, noir sur blanc, sa propre vision du monde. L’être humain est sans doute programmé génétiquement pour s’imposer et survivre. Les animaux aussi, d’ailleurs. Observez un chat qui marche dans la rue et vous verrez qu’il est chat jusqu’au bout des griffes. Il se déplace avec fierté, conscient de sa propre perfection et ne doute pas de lui-même. Au contraire, il est indéniablement convaincu de la supériorité de la gent féline. L’homme, par sa complexité, n’a pas toujours cette fierté et cette assurance naturelle. C’est que la vie en société l’a obligé à beaucoup de compromis. En se tournant vers l’écriture, l’individu peut enfin exprimer ce qui restait caché au plus profond de lui et qui n’avait jamais pu s’exprimer à cause des conventions sociales.
L’écrivain espère-t-il la gloire ou l’éternité en couchant ainsi des mots sur le papier ? Sans doute en rêve-t-il et les exemples ne manquent pas, de Sénèque à Montaigne ou de Voltaire à Flaubert, pour lui donner l’illusion qu’il pourrait atteindre ainsi l’éternité. Mais il est trop sage et trop lucide pour se laisser attraper par de telles illusions. S’il écrit, c’est pour être lui-même ici et maintenant (enfin lui-même, pourrait-on dire) et dire à ses « frères humains » ce qu’il pense et ce qu’il ressent, autrement dit exprimer ce qu’il est.
Il y a donc un plaisir, dans l’acte d’écrire. Les idées s’enchaînent les unes aux autres, les impressions aussi, et de toutes ces pages naît un équilibre et donc finalement un contentement certain. Mais pour parvenir à ces sommets, combien d’heures passées à douter, à raturer, à recommencer. Rien de plus décevant qu’un texte que l’on croyait terminé et qui, à la relecture, vous semble bien éloigné de ce que l’on avait voulu lui faire dire. Ecrire est donc un acte solitaire, profondément solitaire. Non seulement parce qu’il suppose un repli passager sur soi, un isolement géographique au sens propre (afin de tenter de capter les rumeurs du monde sans être dérangé par elles), mais surtout parce personne ne peut venir vous souffler les mots à employer ou les idées à exprimer. L’auteur est seul avec lui-même et il sait qu’il sera jugé sur sa production. Dans la vie courante, ce qui fait la valeur d’un individu ne correspond pas forcément avec ses actes. Vous pouvez être un mauvais chauffeur de camion ou une dactylo distraite, intrinsèquement, cela ne change rien. Votre valeur en tant qu’individu n’en est pas affectée. Par contre, un écrivain a mis tellement de lui-même dans ses écrits que son texte reflète vraiment (ou en tout cas devrait refléter, s’il n’a pas triché) ce qu’il est. C’est son moi le plus profond qui se trouve ainsi exprimé et le regard des autres, du coup, devient une menace.
Mais le besoin d’écrire est le plus fort et, malgré les critiques, l’écrivain, le vrai (je ne parle évidemment pas des marionnettes qui occupent souvent le devant de la scène et dont les préoccupations semblent surtout mondaines ou pécuniaires) poursuivra sa tâche, inlassablement. Même s’il a conscience que ses textes sont imparfaits, il continuera son travail malgré tout, tant c’est un besoin chez lui d’exprimer ce qu’il a à dire. Sûr de son bon droit et de la valeur, non pas de ses écrits mais de son message, il ne s’arrêtera jamais d’écrire. C’est qu’une petite voix lui siffle à l’oreille d’être persévérant. Sans doute, cette petite voix, est-il le seul à l’entendre, mais cela ne fait rien. Un jour, sans doute, ses écrits atteindront l’harmonie des grandes symphonies et ce qu’il avait à dire deviendra enfin intelligible pour les autres. En tant qu’être de culture, il aura, par la littérature, transcender sa condition première, qui le rapprochait de l’animalité, pour accéder au divin ou du moins au paradis artificiel qu’il se sera créé lui-même. Et même si tout cela n’est qu’illusion, son action sera d’autant plus belle qu’elle sera inutile. Devenu démiurge, il régnera en maître sur son univers imaginaire et croira, un instant seulement, être semblable aux dieux.
10:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Littérature
23/08/2007
Ecriture

Certains distinguent à juste titre l’écrivain de l’écrivant. L’écrivain est reconnu, publié et lu. L’écrivant, lui, se contente de griffonner chez lui. Entre les deux, il y a la barrière qui sépare le professionnalisme de l’amateurisme. Si tout le monde ne peut être écrivain, tout un chacun a le droit d’écrire à ses heures perdues, même si ce n’est qu’un journal. Généralement, le premier vise un large public à qui il propose des œuvres de fiction. Le second se contente souvent de mettre sur papier un ensemble de réflexions qui vont l’aider à voir clair en lui et donc à survivre.
Le problème, pourtant, n’est pas aussi simple. D’abord parce qu’on publie n’importe quoi. Parmi les 740 livres annoncés pour cet automne, on peut raisonnablement supposer que certains ne seront pas bons (c’est un euphémisme). Ces écrivains-là auraient mieux fait de rester « écrivants ». D’un autre côté, on peut tout aussi raisonnablement supposer que chez les écrivants, on rencontrerait des textes de qualité. Certains en effet dépassent la simple rédaction d’un journal et écrivent de la fiction ou de la poésie. S’ils ne sont pas publiés, c’est soit qu’ils n’ont entrepris aucune démarche dans ce sens, soit que les éditeurs ont refusé leurs textes.
Dans ce dernier cas, me direz-vous, ce ne sont donc pas des écrivains puisqu’ils n’ont pas passé le cap de la barrière éditoriale. En effet. Mais cependant, on se rend de plus en plus compte que les éditeurs cherchent avant tout le profit (ce n’est pas leur faute, leur maison ayant été rachetée par de grands groupes, ils sont eux-mêmes à la merci des décisions des actionnaires). Il y aura donc des textes de qualité qui auront été rejetés parce que leur diffusion serait restée confidentielle. Ces écrivants-là auraient dû être écrivains. Ils ne le sont pas devenus. Ils le sont d’autant moins devenus qu’ils ont en fait un autre métier, l’écriture chez eux n’étant finalement qu’un passe-temps. Oui, mais attention. Il ne faut pas s’imaginer que les écrivains, les vrais (ceux qui sont publiés donc) vivent de leur plume. Quelques-uns en sont capables, mais ils sont rares et à la limite ce ne sont pas forcément les meilleurs. Disons que ce sont les plus vendus. A la limite, on pourrait donc vivre de son écriture tout en étant un mauvais écrivain. A l’inverse, de bons écrivains perdent leur temps à exécuter du travail alimentaire (presse, nègre, etc.), ce qui leur laisse peu de loisir pour accomplir une vraie œuvre. On pourrait tenir le même raisonnement pour certains écrivants. S’ils avaient plus de temps et s’ils étaient publiés…
Donc, ni l’autonomie financière procurée par l’écriture ni le choix de l’éditeur ne semblent être un critère suffisant. Qu’est-ce donc alors qu’un écrivain ?
Si on n’a pas de lecteurs, on ne peut raisonnablement se dire écrivain. Si j’écris chez moi et que personne ne me lit, je ne suis manifestement pas un écrivain. D’un autre côté, certains écrivains sont si peu lus (même s’ils sont bons) qu’on pourrait se demander si on a encore le droit de les appeler ainsi.
Ou donc est la barrière ? Suffit-il d’être publié ? On a vu que non. Il faut encore être lu. Mais si le livre que je serais parvenu à faire éditer est mal diffusé, si on ne lui fait pas un peu de publicité, il va rapidement se retrouver au pilon. Serai-je alors un écrivain ? Oui, mais un écrivain malheureux.
D’un autre côté, on se rend bien compte que mon nombre de lecteurs, au début du moins, va dépendre de cette publicité faite autour du lancement du livre. Ce n’est donc plus le contenu de celui-ci qui serait primordial, mais le tapage médiatique fait autour. Voilà qui est troublant. Ne serait écrivain (et non simple écrivant) que celui que le système a choisi. On retombe dans la théorie de Roland Barthes. Tel texte est littéraire parce que j’ai décrété qu’il le serait (d’une manière unilatérale et arbitraire). Tel individu serait donc écrivain parce que la société en a ainsi décidé, indépendamment de la qualité du texte (fond et forme). Voilà qui est inquiétant.
Un autre critère parfois avancé, est le temps consacré à l’écriture. Pas le temps envisagé dans sa durée, mais le fait de ne rien faire d’autre qu’écrire. J’ai ainsi rencontré quelqu’un qui possédait une fortune familiale. Dispensé de travailler, il s’était retiré à la campagne et écrivait. Il avait publié un roman qui n’avait pas eu beaucoup de succès et ensuite avait collaboré avec un photographe pour réaliser un ou deux livres sur la nature. C’est peu pour toute une vie. Il se disait pourtant écrivain puisqu’il ne faisait rien d’autre. Il n’avait pas tort. A l’inverse, j’ai croisé sur Internet des gens qui refusaient de travailler et qui dépendaient de la collectivité pour survivre. Ils n’étaient pas édités, mais comme ils n’avaient jamais rien fait d’autre qu’écrire, ils se qualifiaient d’écrivains. Ils n’avaient pas tort non plus, évidemment. Mais si la même personne avait travaillé tout en écrivant la même chose, on l’aurait qualifiée d’écrivant. Comme quoi tout est complexe.
Le dictionnaire ne nous aide pas beaucoup dans la recherche de notre définition.
Ecrivain : personne qui compose des ouvrages littéraires, scientifiques etc.
Ainsi donc, si j’écris un livre sur la description d’une presse hydraulique ou sur un nouveau procédé de construction, je suis déjà un écrivain ? Je ne l’aurais pas cru.

10:16 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : Littérature, écriture, écrivain
17/08/2007
Histoire, légende et littérature

Commémorons, avec quelques jours de retard, la mort de Roland, survenue comme chacun sait à Roncevaux le 15 août 778. Trois siècles plus tard, cet épisode tragique (l’arrière-garde de l’armée de Charlemagne avait été massacrée par les Basques, lesquels, soit dit en passant, ne faisaient que se venger de la destruction de Pampelune, tout en ruinant les prétentions franques dans la région du grand Sud-Ouest) allait donner lieu à la Chanson de Roland, un de nos premiers grands textes littéraires.
On sait que Charlemagne (qui n’était pas encore empereur puisqu’il n’allait le devenir qu’en l’an 800) était parti assiéger Saragosse (Zaragoza) afin de lutter contre les musulmans et faire progresser la foi chrétienne. Ce que l’on sait moins, c’est qu’en 777, le gouverneur musulman de Saragosse, le wali Sulayman ibn al-Arabi était allé trouver Charlemagne pour se plaindre de l’émir de Cordoue (Abd er-Rahman 1er), lequel venait de rejeter l'autorité du calife de Bagdad (Al-Mansour) . Or, Charlemagne avait tout intérêt à soutenir le calife dans la mesure où celui-ci avait comme ennemi naturel l'empereur chrétien de Byzance (qui risquait de faire de l’ombre à Charlemagne). En luttant contre l'émir de Cordoue, l’aspirant empereur se faisait bien voir du Calife de Bagdad en qui il espérait sans doute trouver un allié futur. De plus, cette guerre serait l’occasion de s’imposer dans le Sud et de défendre le monde chrétien contre la pression musulmane.
En 778, il traverse donc les Pyrénées et prend Pampelune, Barcelone et Gérone. Mais pendant que l’émir de Cordoue monte à sa rencontre avec son armée, Charlemagne apprend que sa frontière sur le Rhin est menacée par les Saxons. Il lui faut donc remonter au plus vite. D’autant plus que les Chrétiens qui vivaient sous occupation musulmane ne se plaignent pas vraiment de leur sort (ils devaient juste payer une taxe à l’occupant) dans la mesure où les musulmans, minoritaires, les laissaient relativement libres. Difficile, pour Charles, d’apparaître en libérateur dans ces conditions. Il préfère donc faire demi-tour et, après avoir détruit les murs de Pampelune, il repasse les Pyrénées. C’est là que survient l’épisode de Roland, lequel est raconté par le moine Eginhard dans la Vita Caroli Magni.
Il faudra trois siècles pour que cet incident finalement mineur (Roland n’est qu’un obscur préfet de la Marche de Bretagne) devienne la chanson épique que nous connaissons. Ce n’est d’ailleurs que dans ce texte qu’on présente Roland comme le neveu de Charlemagne (voir manuscrit d’Oxford). Eginhard ne dit rien de tel. Nous touchons donc du doigt le génie de la création littéraire qui déforme et amplifie un fait (par ailleurs déjà très ancien) pour en faire une œuvre nationale. Car il est évident que les Chansons de geste, outre leur qualité artistique, répondent à des besoins précis : glorifier les ancêtres afin de poser les bases de la nouvelle société en train de se créer, lui donnant ainsi une sorte de légitimité. Tous les peuples ont agi de la sorte, que ce soit les Grecs (Iliade et Odyssée) ou les peuples nordiques (Veda). Plus tard, ces chansons de geste deviendront ce que nous appelons le roman.
15:45 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Histoire, littérature, Chanson de Roland, Roncevaux
11/08/2007
Eloge de la lecture

Fragonard, La lectrice, 1772
Avez-vous remarqué comment le fait de lire isole celui qui s’adonne à cette activité ? Dans un train ou sur un banc public, le lecteur plongé dans son livre ne voit rien du monde qui l’entoure. Impossible d’entrer en contact avec lui. Les yeux baissés, il vit en apnée dans un autre univers, il est ailleurs, à mille kilomètres de vous.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la lecture ne facilite pas les contacts sociaux. Et pour cause. Le lecteur ignore superbement ceux qui l’entourent. C’est que ce qu’il recherche dans un livre, c’est avant tout une coupure avec son quotidien. La lecture, quelque part, est donc une fuite. Une fuite dans l’imaginaire, enrichissante, certes, mais une fuite tout de même. S’isoler et partir ailleurs, tel est finalement le moteur de cette démarche. Rechercher d’autres univers, d’autres mondes, où la vie serait enfin supportable. Ou au contraire plonger dans l’horreur de l’existence, toucher du doigt son non-sens et cela par la découverte de la vie fictive de personnages de papier.
Car le paradoxe est là : celui qui vous regarde lire a l’impression que vous ne faites rien, que vous êtes inactif. Yeux baissés, vous semblez endormi. Refusant de vous engager dans la vie ordinaire, vous êtes perpétuellement en retrait. Pourtant, vous qui dévorez les lignes qui défilent devant votre rétine, vous avez au contraire l’impression inverse : celle d’une activité primordiale. C’est que dans les livres, on va à l’essentiel, sans se perdre dans la grisaille insignifiante du quotidien. Don Juan voudra essentiellement conquérir les belles et Rodrigue épouser Chimène. Madame Bovary courra droit au suicide tandis que Rimbaud plongera pour une saison dans l’enfer qu’il s’est créé. Beckett dira l’absurde, Camus le dénoncera et Malraux tentera d’y échapper comme il pourra. Ce qui fait que vous en apprenez plus sur la vie et sur vous-même en un seul livre qu’en une année d’existence. Ce qui ne semblait qu’un loisir, un passe-temps, se révèle être un catalyseur. C’est pour cela que les yeux baissés, plongé dans votre lecture, vous vous coupez du monde et ignorez celui (ou celle) qui vous observe.
On pourrait faire la même remarque au sujet de l’écriture. Est-elle fuite en avant, refus d’avoir un comportement normal ou bien au contraire une activité essentielle, vous permettant d’exister enfin par le processus de la création ? Autrefois je me suis souvent posé cette question. Les gens « normaux » n’écrivent pas, ils vivent, tout simplement. Ils ont un travail, des enfants, des loisirs. Ils sont engagés dans la société qu’ils tentent de modifier dans le sens qui leur convient par leurs actions (actions humanitaires, engagement politique ou syndical, etc.). L’écrivain, lui, s’isole devant sa feuille blanche comme le lecteur le faisait devant la page écrite. Il est ailleurs. Le fait d’écrire est-il donc condamnable ? Participe-t-il à un refus de vivre la vraie vie en le remplaçant par la création d’un monde imaginaire qui serait meilleur ? Autrement dit, écrire serait-il une démarche puérile, proche du jeu, qui éviterait les engagements réels ? Je l’ai cru autrefois, mais ayant pourtant un travail, des enfants et étant engagé dans différentes actions, il m’apparaît aujourd’hui que c’est l’écriture, comme la lecture, qui va à l’essentiel. Coupée du monde en apparence, elle peut, non seulement donner un certain sens à votre existence (puisqu’elle vous incite à mettre clairement, noir sur blanc, ce que vous ne faisiez que pressentir confusément) mais aussi, par la force des mots, agir indirectement sur le monde extérieur.
Mais dans tous les cas, l’écriture comme la lecture sont des activités qui relèvent d’une même vocation et qui sont finalement liées à une certaine ascèse. C’est sans doute pour cela que l’attitude du lecteur, les yeux baissés, non par modestie mais par concentration intérieure, le fait ressembler à un religieux plongé dans la méditation. Sorte d’ermite contemporain, il vit en marge de ses frères humains, ne communiquant vraiment qu’avec les autres lecteurs, avec lesquels il a des affinités et avec lesquels il partage une pensée commune. Semblable à un ordre monacal, la secte des lecteurs ne comporte que des initiés, sensibles aux choses intemporelles et intangibles. Ils se comprennent entre eux, mais s’ils aiment les échanges, il faut surtout leur accorder le temps de s’isoler car c’est de la rencontre entre leur regard et la chose écrite que naît leur plaisir.
Après le portrait d’une lectrice par Fragonard, représenté ci-dessus, on pourrait proposer d'autres peintures abordant le même thème (ce qui, soit dit en passant, est une manière de concilier deux arts: la peinture et la littérature, la première parlant de la seconde). On aura bien entendu le tableau de Van Gogh:

Mais aussi celui-ci, intitulé jeune femme en bleu, de JohannesVermeer (Vermeer de Delft):

Ou bien encore, la liseuse, toujours de Vermeer:

Sans oublier, de Friedrich Heinrich Füger, une Marie-Madeleine sortant de sa lecture et méditant:

Chez les modernes, citons la liseuse de Monet:

Celle de Matisse:

Ou encore celle de Renoir:

Bref, on n'en finirait plus de répertorier les peintres qui ont représenté le phénomène de la lecture. Remarquons en passant que pour ce faire ils se sont surtout intéressés aux jeunes femmes plutôt qu’aux hommes. Ces femmes ont toujours les yeux baissés ce qui renforce leur inaccessibilité. Un parallèle se dessine donc entre la lectrice qu’on ne peut déranger dans sa lecture et la femme dont on ne peut attirer l’attention. Inabordable par définition, fermée à l’amour de l’homme qui la désire, elle reste isolée, perdue dans son fort intérieur, telle qu’en elle-même l’éternité la change.
C’est sans doute de cela que Dominique Autié voulait parler sur son blogue
(http://blog-dominique.autie.intexte.net/blogs/index.php/2...), quand il a établi un parallèle entre l’obscénité qu’il y a à contempler la lectrice et celle qu’il y aurait à imaginer la scène primitive telle que Freud la définissait. Il ne nous appartient pas de déranger cette lectrice, isolée dans sa lecture comme la femme l’est dans sa perfection.
01:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, lecture
13/07/2007
De l'ordre des livres
Les livres, dans ma bibliothèque, sont rangés, ce qui est déjà bien. Le problème, c’est que le classement peut parfois sembler arbitraire, seul le maître des lieux s’y retrouvant plus ou moins. Doit-on classer par genre, par pays, par thème ? J’ai opté finalement pour le classement par genre (essais, romans, poésie, livres de critiques, peinture, histoire, dictionnaires et encyclopédies, histoires de la littérature, divers), doublé d’un classement alphabétique. Il y a, bien entendu, quelques petites entorses, comme le fait qu’un rayonnage spécial soit réservé à la littérature d’Espagne et d’Amérique du Sud, ce qui crée quelques confusions : où placer Neruda : dans ce rayon ou dans la poésie ? C’est curieux d’ailleurs. Un roman de Péruvien Vargas Llosa sera rangé d’office dans ce rayon hispanique, tandis que pour la poésie, j’hésite. Est-ce dû à l’essence même de la poésie, qui semble mériter sa rubrique à part, quelle que soit la nationalité de l’auteur ou bien tout simplement mon choix est-il guidé par le fait que souvent ces livres de poésie appartiennent à la collection Poésie de chez Gallimard et qu’il est donc logique de les regrouper tous ? Il serait intéressant de savoir ce qui se passe dans notre subconscient quand nous classons nos livres et notre choix définitif, s’il était analysé, révélerait peut-être beaucoup plus de choses que nous ne l’imaginons sur nos goûts et nos priorités en matière de littérature.
Finalement, avec mon classement, il ne subsiste qu’un inconvénient majeur : celui de savoir comment intégrer les nouveaux livres qu’on vient de lire. Il est difficile, en effet, de déplacer des rangées entières chaque fois qu’il faut venir intercaler un ou deux volumes dans l’ordre alphabétique préexistant. La solution trouvée consiste à consacrer un rayonnage provisoire à ces nouvelles acquisitions. Idéalement, une fois le rayonnage rempli, il faudrait alors incorporer l’entièreté des volumes présents dans le classement alphabétique général de la bibliothèque (tout en respectant toujours les subdivisions par genres : romans, essais, etc.), ce que je fais bien rarement, il faut bien l’avouer. Moralité : je me retrouve avec plusieurs classements alphabétiques parallèles, ce qui ruine d’un coup l’intérêt d’un tel classement.
Il faudrait aussi parler des volumes non-lus, qui représentent tout de même une pile importante, que mes flâneries dans les librairies viennent alimenter en permanence. Ces non-lus, eux, sont sur un rayonnage à part, sans classement aucun, ce qui permet de choisir le livre que l’on désire selon les affinités du moment, sans devoir se plier à une quelconque logique. (Cela signifie que l’ordre de lecture ne respectera pas la date d’achat). D’une manière générale, j’ai tendance à alterner les genres. Après un roman très long, j’éprouve le besoin de lire de la poésie. Après la poésie, je passerai à de l’histoire ou à un essai, avant de revenir à quelques romans courts, etc. L’avantage, c’est que j’aborde toujours un nouveau livre dans un bon état d’esprit. Je ne me dis jamais : « il faudrait tout de même bien que je me décide à lire cette brique ». Non, chaque livre arrive au stade de la lecture quand il est attendu. Cela ne m’empêche pas, d’ailleurs, de l’avoir déjà feuilleté une ou deux fois au préalable, histoire d’en deviner le contenu et de jouir à l’avance du moment où je pourrai enfin le lire.
Bon, j’avais dit plus haut que le seul problème non solutionné était l’intégration des livres lus dans le classement alphabétique général. A bien y réfléchir, il en subsiste également un autre, qui est le critère esthétique. En effet, il peut paraître souhaitable de regrouper ensemble tous les Gallimard, tous les Stock, tous les Seuils, etc. Un alignement de livres de la même couleur et de la même taille peut sembler plus harmonieux au regard que d’alterner un grand volume bleu avec un petit volume rouge. Sur un plan purement intellectuel, un tel souci esthétique n’a aucun sens, j’en ai bien conscience. Néanmoins, j’ai eu tendance à regrouper tous les NRF ensemble, comme tous les Pléiades, sans doute à cause du prestige dont jouissent ces deux collections. Pour les Pléiades, tout le monde agit comme moi, je crois, mais pour les NRF, pas forcément. Pourtant, il y a un plaisir certain à pouvoir passer la main sur la tranche de ces livres au ton chaud et discret. La couverture cartonnée mais non plastifiée offre une jouissance qu’on n’a pas forcément l’occasion d’éprouver avec d’autres collections. Il me semble toujours qu’il émane de ces Gallimard comme une « aura littéraire », qui ne tient pas seulement au prestige de la NRF, mais peut-être aussi au fait que ces volumes renvoient à l’Histoire littéraire de la France. Ils SONT la littérature française et leur côté un peu vieillot (uniquement cartonnés et de couleurs discrètes) permet de faire rêver de temps plus reculés encore, temps dont ils semblent avoir conservés l’âme pour nous la restituer à notre époque de l’électronique.
Du coup, si les Gallimard sont à part (sauf ceux qui ne sont pas encore lus et sauf ceux qui viennent juste d’être lus et qui sont donc sur le rayonnage provisoire, vous me suivez toujours ?), il m’a paru logique de regrouper également les livres de poche et tant que faire de se donner ce mal, de les regrouper par collections : Folio, Livre de poche et Livre de poche classique (ceux avec une couverture rouge cartonnée, qu’on ne trouve plus qu’en occasion). Cela nous donne donc un classement alphabétique pour les Folio, un pour les Livres de Poche, un pour les Gallimard, un pour les autres collections originales, un pour la poésie Gallimard et un pour les auteurs hispaniques. Quand je vous disais qu’il n’y avait que moi pour m’y retrouver !
En fait, je m’en rends compte, le problème vient du fait de croiser plusieurs critères : critère alphabétique, critère esthétique, critère du genre (roman, poésie…), critère de langue (les Hispaniques). Mais bon, le principal n’est-il pas que je puisse toujours aller chercher le bon volume quand j’en ai besoin ? Les soirs d’hiver, quand il me prend l’envie, à deux heures du matin, de relire quelques pages de mon Montaigne, je sais où aller le trouver. De mémoire je me souviens que c’est une édition de poche et qui plus est chez Garnier-Flammarion. Tiens, je ne l’avais pas encore citée, cette collection... Commencerais-je tout de même à m’y perdre un peu ?

Sur cette photo, découverte sur Internet et qui n’est donc pas une photo de ma bibliothèque, on remarquera que l’ensemble reste harmonieux, la taille des livres étant plus ou moins identique.
11:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Littérature, livres
12/07/2007
Autopromotion

http://www.vebret.com/actualite/
Dans "La Presse littéraire", actuellement en vente dans les kiosques parisiens, on trouvera:
1. Mon article sur Oriana Fallaci (rapport entre écriture journalistique et écriture littéraire). Ce thème avait d’abord été abordé ici-même
(http://feuilly.hautetfort.com/archive/2007/04/11/roman-et...l) et puis finalement il a donné lieu à cet article.
2. Ma nouvelle « Un écrivain plein d’avenir ». C’est la première fois qu’une de mes nouvelles paraît ainsi dans une revue, c’est pourquoi je me permets de le signaler. Sur un ton mi-ironique, mi-amusé, on découvrira les déboires d’un aspirant écrivain qui recherche un éditeur. Allez savoir d’où cette idée m’est venue…
15:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, La Presse littéraire
07/07/2007
Qu'est-ce que l'utopie?
Quelle est l’origine du mot Utopie ? Il vient de l’Utopia de Thomas More, bien entendu. Au moins voilà un écrivain qui non seulement osait rêver mais qui en plus n’avait pas peur de créer des néologismes. Formé de toute pièce à partir d’étymons grecs (« υ », prononcé « ou » pour la négation, « τοπος » pour le lieu et un suffixe « ia »), ce mot désignait donc un lieu qui ne se trouve nulle part. Notons que More a aussi employé le mot « eutopia » (d’après « ευ », bon), qui voulait dire alors le bon lieu, le lieu agréable, l’endroit où il est bon de se trouver. La langue française n’a retenu qu’utopie, lequel est devenu un nom commun. Pourtant, dans l’esprit de l’auteur, les deux termes sont complémentaires. L’utopie est un lieu fictif (utopie) dans lequel il souhaite réfléchir sur l’établissement d’une société idéale (voir la note sur Rousseau, son bon sauvage et ses projets de constitution corse). Alors qu’aujourd’hui le terme renvoie à quelque chose qui n’existe pas, qui est du domaine de l’impossible, pour More, au contraire, il ne s’agissait que d’un lieu fictif, imaginaire, mais qu’il aurait voulu voir exister et dans lequel une société plus juste aurait pu s’épanouir.
Sur le plan littéraire, les auteurs qui ont imaginé des lieux dans lequel se développent des sociétés idéales sont nombreux, à commencer par Platon dans sa République. On pourrait aussi citer Rabelais avec son abbaye de Thélème mais aussi Voltaire avec Candide ou Sébastien Mercier dans L’an 2440 . Avec le Télémaque de Fénelon, nous avons un genre un peu particulier puisqu’on y décrit des pays existants (l’Orient) pour en vanter les mérites (en partie imaginés et fictifs) afin de mieux faire ressentir les travers de la société française. L’idéal est donc toujours ailleurs. D’où cette dérivation du mot utopie, qui finit par désigner un conte romanesque qui décrit des choses impossibles.
Mais revenons à Thomas More. Manifestement celui-ci connaissait Platon. On peut supposer aussi qu’il a été influencé par les récits des voyageurs qui venaient de découvrir le nouveau monde. Quand vous vivez dons une société qui ne vous satisfait pas, vous allez voir ailleurs et si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous faites preuve d’imagination. N’est-ce pas là le propre de la littérature, inventer des rêves qu’on souhaite réalisables, même si on sait qu’ils sont du domaine de la fiction ? Enfin, comme dans tout le courant de la Renaissance, on retrouve chez More ce besoin de s’intéresser à l’homme (et beaucoup moins à Dieu). Au lieu d’attendre la fin du monde et la parousie pour découvrir un monde meilleur, autant s’atteler à le construire ici-bas.
Pauvre Thomas More, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il avait raison de vouloir fuir le lieu et l’époque où il vivait. Le 6 juillet 1535, il quitte la Tour de Londres où il a été emprisonné pendant quinze mois pour être décapité sur ordre du roi Henri VIII Tudor. (il aurait déclaré au bourreau : «Ayez l'obligeance de me donner la main pour monter, car pour descendre, je me débrouillerai bien tout seul !»)
Quelle faute avait-il donc commise ? Et bien aucune. Disons simplement qu’il avait déplu au prince. Celui-ci voulait rompre son mariage avec Catherine d’Aragon, qui ne lui avait pas donné de successeur mâle (on imagine en passant la douleur de ces femmes, mariées souvent contre leur gré pour des raisons politiques et qui se voyaient ainsi répudiées parce qu’elles ne parvenaient pas à avoir de garçons, alors qu’on sait aujourd’hui que c’est l’époux qui détermine ce genre de chose). Comme le pape tarde à donner son accord pour le divorce et que les choses pressent (la maîtresse, Anne Boleyn est enceinte et pourrait précisément offrir au trône cet héritier qui lui manque), le roi décide de se passer de son avis. L’archevêque de Canterbury déclare donc le premier mariage nul et marie Henri VIII et Anne Boleyn. Aussitôt, la pape, furieux qu’on ait passé outre à ses décisions, excommunie le roi. Celui-ci réplique en rompant avec le Saint Siège. Il reste donc catholique mais considère le pape comme l’évêque de Rome, sans plus. C’est le début du schisme anglican, qui trouve finalement son origine dans une affaire privée, même s’il ne faut pas perdre de vue que c’est l’époque où Luther va commencer, en Allemagne, à s’opposer lui aussi aux excès du catholicisme. Notre pauvre Thomas More refuse de prêter serment entre les mains du chef de l’église anglicane et c’est ce qui lui vaut sa condamnation à mort. Triste fin, on en conviendra pour celui qui rêvait d’un monde meilleur, mais d’un autre côté on se dit que c’est avec une intuition incroyable de son destin qu’il avait auparavant imaginé une société où les hommes vivraient enfin en harmonie.
Cet ailleurs est finalement celui de tous les poètes, c’est un monde perdu ou à venir, un monde parallèle au nôtre et que l’on souhaiterait parfois voir vraiment arriver.

02:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, Thomas More, utopie
05/07/2007
Le mythe du bon sauvage
 Revenons au mythe du bon sauvage, cher à Rousseau. Il faut se rendre compte qu’en développant une telle théorie, le pauvre Jean-Jacques ne s’est pas fait que des amis. C’est qu’à l’époque, l’avenir de l’humanité semblait tout tracé, à savoir que la science et la technique allaient dominer la nature et rendre tout le monde heureux. N’oublions pas que l’ouvrage fondamental du XVIII° siècle, c’est avant tout l’Encyclopédie. Or, si l’Encyclopédie comporte pas mal de sujets philosophiques et si elle a pu faire preuve d’esprit critique à l’encontre du système politique de l’Ancien Régime, elle est d’abord un ouvrage technique, comportant de nombreuses planches et croquis. Cette confiance dans la science débouchera au siècle suivant sur le scientisme (dont le pharmacien Homais, admirablement décrit dans Madame Bovary, offre une caricature désopilante). De leur côté, les Idéologues (avec Destutt de Tracy), voulurent établir une science des idées afin de lutter contre l’obscurantisme ambiant.
Revenons au mythe du bon sauvage, cher à Rousseau. Il faut se rendre compte qu’en développant une telle théorie, le pauvre Jean-Jacques ne s’est pas fait que des amis. C’est qu’à l’époque, l’avenir de l’humanité semblait tout tracé, à savoir que la science et la technique allaient dominer la nature et rendre tout le monde heureux. N’oublions pas que l’ouvrage fondamental du XVIII° siècle, c’est avant tout l’Encyclopédie. Or, si l’Encyclopédie comporte pas mal de sujets philosophiques et si elle a pu faire preuve d’esprit critique à l’encontre du système politique de l’Ancien Régime, elle est d’abord un ouvrage technique, comportant de nombreuses planches et croquis. Cette confiance dans la science débouchera au siècle suivant sur le scientisme (dont le pharmacien Homais, admirablement décrit dans Madame Bovary, offre une caricature désopilante). De leur côté, les Idéologues (avec Destutt de Tracy), voulurent établir une science des idées afin de lutter contre l’obscurantisme ambiant.
 Dès lors, venir vanter les mérites de mère Nature dans un tel contexte avait de quoi déplaire. Quand Rousseau dit qu’il est persécuté et que des complots se trament contre lui, il exagère sans doute, mais il est certain qu’il a dû percevoir de la désapprobation dans le regard de beaucoup de ses contemporains. Cette idée du bon sauvage remonte finalement à la Bible et à la création du paradis telle qu’on peut la lire dans le livre de la Genèse. L’homme et la femme vivaient au milieu de la nature et des animaux sans se soucier de rien, dans un état de bonheur indescriptible et sans devoir travailler. Pendant que d’autres voyaient dans la civilisation le seul moyen de dominer cette nature et donc de distinguer l’homme de l’animal, Rousseau, lui, rapproche l’humain de l’animalité et c’est ce que ses contemporains ne peuvent admettre. Tant qu’on s’en tenait à la version biblique, il n’y avait pas de problème : Dieu ayant créé l’homme à son image, celui-ci se voyait distingué du reste de la création par son essence-même. A partir du moment où cette théorie n’est plus crédible, tout s’effondre et l’homme redevient un animal parmi les autres. C’est bien pour cela que l’Eglise avait déjà fait brûler Giordano Bruno et qu’elle avait obligé Galilée à se rétracter. Dire que la terre tournait autour du soleil, s’était avouer que cette terre n’était plus qu’une planète parmi des millions d’autres, tournant au hasard dans l’espace et qu’elle n’était plus le centre d’univers. Dès lors, l’homme non plus n’était plus le centre du monde. Ramené ipso facto à son animalité, fruit du hasard, il se devait, s’il ne voulait pas perdre la face à ses propres yeux, se distinguer par la culture. D’où l’importance de la science qui va dominer la nature. D’où l’hérésie de Rousseau, qui vient donner une version laïque du mythe de la Genèse. Agir ainsi, pour ses contemporains, c’est faire preuve d’un anachronisme coupable.
Dès lors, venir vanter les mérites de mère Nature dans un tel contexte avait de quoi déplaire. Quand Rousseau dit qu’il est persécuté et que des complots se trament contre lui, il exagère sans doute, mais il est certain qu’il a dû percevoir de la désapprobation dans le regard de beaucoup de ses contemporains. Cette idée du bon sauvage remonte finalement à la Bible et à la création du paradis telle qu’on peut la lire dans le livre de la Genèse. L’homme et la femme vivaient au milieu de la nature et des animaux sans se soucier de rien, dans un état de bonheur indescriptible et sans devoir travailler. Pendant que d’autres voyaient dans la civilisation le seul moyen de dominer cette nature et donc de distinguer l’homme de l’animal, Rousseau, lui, rapproche l’humain de l’animalité et c’est ce que ses contemporains ne peuvent admettre. Tant qu’on s’en tenait à la version biblique, il n’y avait pas de problème : Dieu ayant créé l’homme à son image, celui-ci se voyait distingué du reste de la création par son essence-même. A partir du moment où cette théorie n’est plus crédible, tout s’effondre et l’homme redevient un animal parmi les autres. C’est bien pour cela que l’Eglise avait déjà fait brûler Giordano Bruno et qu’elle avait obligé Galilée à se rétracter. Dire que la terre tournait autour du soleil, s’était avouer que cette terre n’était plus qu’une planète parmi des millions d’autres, tournant au hasard dans l’espace et qu’elle n’était plus le centre d’univers. Dès lors, l’homme non plus n’était plus le centre du monde. Ramené ipso facto à son animalité, fruit du hasard, il se devait, s’il ne voulait pas perdre la face à ses propres yeux, se distinguer par la culture. D’où l’importance de la science qui va dominer la nature. D’où l’hérésie de Rousseau, qui vient donner une version laïque du mythe de la Genèse. Agir ainsi, pour ses contemporains, c’est faire preuve d’un anachronisme coupable.
Remarquons que les théories écologiques modernes ne sont pas si éloignées, finalement, des thèses rousseauistes. Le retour à la nature que nous avons connu dans les années soixante-dix (élever des moutons dans le Larzac, etc.) s’en rapprochait. Conscients de la faillite de la science et de la technique (pollution, déforestation, changement climatique), nous aspirons tous inconsciemment à retrouver un peu de verdure autour de nous ainsi qu’une vie plus simple, plus en harmonie avec la nature. Cette démarche, par ailleurs légitime, semble pourtant se fonder sur une réalité qui appartient déjà au passé et donc au rêve. Pour le moment, aucun retour en arrière ne se dessine très clairement. On commence seulement à prendre conscience qu’il serait temps de faire machine arrière et à réaliser que les réserves de la planète ne sont pas illimitées, pas plus d’ailleurs que sa capacité à se régénérer perpétuellement.
Le nouveau paradoxe, c’est que nous, qui avons contribué gravement à polluer la terre, sommes en train de demander au tiers-monde de limiter son expansion économique sous le prétexte que la planète est en danger. Autrement dit, nous nous tournons vers les contrées qui ne sont pas encore industrialisées ni fortement urbanisées pour leur suggérer de ne pas se développer et de rester finalement proches de ce monde sauvage que nous voudrions préserver pour notre plus grand profit. Le mythe du bon sauvage de Rousseau est donc devenu une réalité. Seul l’homme sauvage peut sauver la planète pour autant qu’il reste sauvage et sous-développé.

14:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, JJ Rousseau, mythe du bon sauvage
04/07/2007
Le mur
Quelques petites citations extraites du Contrat social
«Les esclaves perdent tout dans leurs fers, jusqu'au désir d'en sortir.»
«Les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n’ont rien.»
«Renoncer à sa liberté c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs.»
«Ou le luxe est l'effet des richesses, ou il les rend nécessaires ; il corrompt à la fois le riche et le pauvre, l'un par la possession, l'autre par la convoitise.»
«S'il faut obéir par la force on n'a pas besoin d'obéir par devoir et si l'on n'est plus forcé d'obéir on n'y est plus obligé.»
«L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit maître des autres, qui ne laisse pas d’être plus esclave qu’eux.»
«Souvenez-vous que les murs des villes ne se forment que du débris des maisons des champs. »
A propos de murs, Rousseau n’aurait sans doute jamais imaginé qu’on pût construire un mur dans une ville comme Berlin. La chute de ce mur a été saluée comme elle se devait. Le problème, c’est que depuis on en a construit d’autres, avec un but sensiblement différent. Celui de Berlin voulait empêcher les habitants de l’Est de fuir le régime dictatorial communiste. Celui que l’on érige en ce moment en Palestine ou celui que l’on va ériger entre les Etats-Unis et le Mexique, visent au contraire à protéger ceux qui sont à « l’intérieur ». Il ne s’agit plus d’empêcher de sortir, mais bien d’empêcher d’entrer. Symbole d’une société où l’argent domine tout, ces murs permettent de rester entre soi, entre bourgeois bien pensants, tout en laissant à l’extérieur ceux que l’on ne désire surtout pas voir entrer. Il fut un temps, pourtant, où le Texas appartenait encore au Mexique. Il fut un temps, pourtant, où la Palestine appartenait d’abord aux Palestiniens.

09:42 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, Rousseau
02/07/2007
Rousseau
Le 02 juillet 1778, Jean-Jacques Rousseau s’éteignait. Autodidacte, il côtoiera cependant les plus grands écrivains de son temps, comme Fontenelle, Diderot, Marivaux, Voltaire, Grimm ou encore Rameau. Vivant petitement en composant des morceaux de musique, c’est en vain qu’il proposera à l’Académie un nouveau système de notation musicale. Il faudra attendre qu’il remporte le premier prix d’un concours organisé par l'Académie de Dijon (dont le thème portait sur le fait de savoir si le progrès des arts avait ou non contribué à corrompre et à épurer les mœurs) pour qu’il devienne célèbre. Son opéra Le devin du village est remarqué du public. Mais c’est comme philosophe qu’il va évidemment s’affirmer, donnant au XVIII° siècle un de ses penseurs les plus importants. Il s’opposera à Voltaire sur le raffinement de la société et les excès de la civilisation. Fasciné par l’état de nature, il nous donnera le mythe du « bon sauvage », théorie qui sera reprises par certains, décriée par d’autres. Si c’est la société qui corrompt l’homme, il faut redonner à ce dernier un contrat social digne de ce nom, c’est-à-dire fondé exclusivement sur la souveraineté du peuple. Il fut d’ailleurs sollicité par Pasquale Paoli afin de rédiger un projet de Constitution pour la Corse, alors en opposition avec le pouvoir génois (sur ce sujet, voir le beau blogue d’Angèle Paoli :http://terresdefemmes.blogs.com/mon_weblog/2007/06/pasqua...)
Loin d’être démodées, les idées de Rousseau sont particulièrement d’actualité alors que nous sombrons dans une crise de la démocratie et du système parlementaire (pouvoir absolu des partis politiques, prééminence du gouvernement sur les députés, présence de la haute finance dans les décisions, démantèlement programmés du droit du travail et de la sécurité sociale, etc.)
Sur le plan strictement littéraire, notons encore ses Rêveries du Promeneur solitaire et ses Confessions, qui ouvrent la voie à l’autobiographie en France. :
«Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature; et cet homme ce sera moi (…) Etre éternel, rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables; qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères. Que chacun d'eux découvre à son tour son cœur aux pieds de ton trône avec la même sincérité; et puis qu'un seul te dise, s'il l'ose: "Je fus meilleur que cet homme-là"...».
Tourné vers la sentimentalité, osant afficher ses sentiments, il ouvrira les portes au romantisme.
16:43 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, JJ Rousseau
28/06/2007
Ecrire pour survivre
Cherchant à s’exprimer, désirant faire du « neuf », l’écrivain veut avant tout atteindre à l’immortalité. C’est que l’acte d’écrire semble en effet indissociable de cet ancrage temporel dans un futur par ailleurs fort improbable. On écrit pour échapper à la mort et à l’oubli, espérant trouver dans le regard des générations futures (regard qu’on n’aura pourtant jamais l’occasion de croiser) une justification de sa vie d’aujourd’hui. Démarche illusoire s’il en est, car combien, en fait, parviendront à produire une œuvre assez importante pour marquer les générations futures ? Combien de Cervantès, de Rabelais, de Molière notre siècle comptera-t-il ? Très peu, sans doute. Encore faut-il se rendre compte que parmi les écrivains du passé qui ont eu la chance d’arriver jusqu’à nous, beaucoup sont appréciés pour des raisons différentes de celles qui avaient justifié leur succès auprès de leurs contemporains. Ainsi en va-t-il de Voltaire, qui se croyait un grand dramaturge. S’il est connu aujourd’hui, ce n’est certes pas en tant que dramaturge, mais plutôt par le rôle éminent qu’il a joué comme contestataire de l’Ancien Régime. De plus, si on prend son œuvre littéraire proprement dite, ce sont assurément ses contes qui nous enchantent le plus, situation qui le surprendrait probablement beaucoup. De son côté, Rabelais était avant tout un grand médecin et les aventures de Gargantua qu’il nous a laissées devaient sans doute relever pour lui du simple délassement. Théophile Gautier, quant à lui, s’est sans doute cru un poète de génie avec ses Emaux et Camées (voir sa théorie de l’art pour l’art : « C’est encore plus beau quand c’est inutile »), mais nous sommes plutôt sensibles aujourd’hui à ses écrits fantastiques.
Inversement, beaucoup de ceux qui ont eu du succès de leur vivant et qu’on croyait précisément immortels ne sont pas passés à la postérité. Il n’y a qu’à feuilleter la liste des membres de l’Académie pour ce rendre compte que bien des noms nous sont inconnus. D’autres, tels Lamartine, se sont imposés par le biais des anthologies scolaires, mais honnêtement, qui lit encore Lamartine aujourd’hui ?
Notons que cette recherche systématique de l’immortalité comme justification de l’acte d’écrire semble être liée au rôle primordial joué par l’individu dans notre civilisation contemporaine. Dans des sociétés plus primitives, telles notre Moyen-Age occidental (j’ai dit plus primitives, pas moins complexes), on voit que les chansons de geste sont anonymes. Les poèmes épiques sont faits pour être transmis oralement et chaque récitant y va de sa version personnelle. Les manuscrits que nous avons conservés ne sont finalement que de vastes compilations de chants préexistants, une magnifique synthèse, en quelque sorte, superbement rédigée. Celui qui l’a faite n’a pas trouvé utile d’y apposer son nom, tout simplement parce que seuls les exploits racontés avaient de l’importance et non la personnalité de l’écrivain. Il en a été de même dans la Grèce antique (certes on cite Homère comme auteur possible de l’Iliade et de l’Odyssée, mais que sait-on de lui, finalement ?), dans la civilisation nordique (Eddas) ou encore en Inde avec le Rig-Veda. C’est plus tard, quand le rôle du « clan » a été moins déterminant, que l’individu a pu s’affirmer pleinement, au point de vouloir s’imposer par son oeuvre personnelle. Dans cette optique, rien de plus logique que de vouloir écrire quelque chose d’inédit. Au lieu de perpétuer une tradition et d’imiter les anciens, il faut faire du neuf et de l’original, en exprimant sa propre spécificité.

16:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Littérature
26/06/2007
Apologie de l’antique
C’est devenu un fait évident et que plus personne ne conteste : en art, il faut faire du neuf. En littérature aussi, apparemment. A quoi bon, en effet, réécrire ce que d’autres ont déjà mieux exprimé que vous ? Inutile de donner une nouvelle Madame Bovary, que tout le monde connaît déjà, on en conviendra. On ne va pas non plus proposer une version personnelle d’Une saison en enfer ni imiter Philippe Jaccottet. Non, il n’y a que ce qui n’a jamais été dit qui peut être exprimé. Fiers de leur ego, les littérateurs s’en donnent donc à cœur joie. Chacun y va de sa rengaine propre, de ses souvenirs personnels ou de sa vision du monde forcément originale puisque c’est la sienne propre.
Tout cela est bien beau, sauf que cela nous donne sept cents romans à la rentrée d’automne, sept cents romans qui se ressemblent à peu près tous, tous les auteurs ayant misé sur la même modernité.
Pourtant, si on conçoit facilement qu’il ne sert à rien de réécrire les chefs-d’œuvre antérieurs, s’il semble évident que seule une vision personnelle et originale mérite d’être mise en avant, il n’en reste pas moins que cette course à la modernité comporte quelques dangers, parmi lesquels le refus des grands classiques n’est pas le moindre. A force de vouloir être modernes et résolument tournés vers l’avenir certains en ont oublié de regarder derrière eux. Privés du terreau originel, ils n’ont plus d’assises et leurs écrits semblent s’étioler comme des plantes poussant sur un sol caillouteux. Négligeant la richesses inouïe de leurs devanciers, ils préfèrent puiser en eux la source de l’inspiration, ce qui nous donne souvent des œuvres introspectives, tournées vers le dedans, où le nombril de l’auteur semble être devenu le centre du monde. Ces écrits-là manquent de souffle et sentent la philosophie en chambre. Seules les œuvres ouvertes sur le monde, reflétant la complexité de la société, cherchant à donner à l’individu une place dans l’univers, méritent en fait d’être publiées.
Or, s’il y a bien des livres qui ont fait leurs preuves, ce sont bien ceux du passé. S’ils sont parvenus jusqu’à nous et s’ils nous parlent toujours, c’est qu’ils possèdent en eux-mêmes un « je ne sais quoi » qu’on ne peut certes pas assimiler à un phénomène de mode. Et parmi ces livres anciens, il me semble que ceux de l’Antiquité sont particulièrement méconnus. Qui lit encore Virgile, Plaute ou Sénèque ? Sans parler des historiens comme Tite-Live, Tacite et quelques autres ? Les Humanités classiques ont quasi disparu de nos collèges et lycées. Il est vrai que dans notre société mercantile, mieux vaut un bon diplôme en « marketing » qui vous permettra non seulement de trouver un emploi mais aussi de vendre à un tas de gens (et pour votre plus grand profit) des produits dont ils ignoraient jusqu’à l’existence avant votre intervention, mieux vaut un tel diplôme, disais-je, plutôt que d’écouter le chant des sirènes avec Ulysse ou de vous pâmer sur les amours de Didon.
Et pourtant… Et pourtant, je plaiderai toujours, avec Jacqueline de Romilly, pour les études classiques, qui ouvrent des portes insoupçonnées. Outre la rigueur de l’analyse grammaticale (ah ! ces aoristes et ces verbes en « Mi » de la conjugaison grecque !), elles permettaient de se familiariser avec de grands textes littéraires à un âge où l’esprit était encore suffisamment malléable pour pouvoir en être imprégné. Les élèves parcouraient en imagination les plaines d’Asie mineure en suivant avec Xénophon la retraite des dix mille, ils s’initiaient à la démocratie en lisant les discours de Démosthène ou découvraient les horreurs du pouvoir en méditant sur les descriptions que Tacite nous donne de Néron.
Mais qui se souvient encore de tout cela aujourd’hui ? Quelques-uns, qui disparaissent les uns après les autres. N’ayant pas été initiés, les jeunes d’aujourd’hui ne se donneront même pas la peine d’ouvrir une traduction, tant il est vrai que pour eux tout ce qui précède le XIX° siècle leur semble inabordable et complètement révolu. Et je parle de ceux qui lisent, bien entendu, c’est-à-dire finalement d’une minorité, tant les jeux vidéo et autres joyeusetés ont supplanté l’écrit. Parlant de la sorte, je me fais l’effet de tenir le discours d’un vieillard décati, plein d’amertume et de rancune. Et pourtant ma propre jeunesse ne remonte pas encore si loin, même si elle commence, il est vrai, à prendre le large dangereusement. « Ύνωθι σεαύτον », nous disait Socrate. Connais-toi toi-même. Connais les autres, aussi, avec qui tu as la chance de vivre. Et cette connaissance, à mon sens, doit passer par les auteurs classiques, qui l’emportent, et de loin, sur certains de nos auteurs contemporains. Quant à tous ceux qui demanderaient quelle est l’utilité de se frotter ainsi aux textes antiques et quel profit ils pourraient bien retirer de l’apprentissage du latin, je répondrais, comme un certain professeur : « Cela sert à ce que vous ne me posiez plus la question. »

09:01 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Littérature, Antiquité
14/06/2007
Grandes surfaces du livre
Lors de ma dernière visite à la FNAC, j’ai été surpris, une fois de plus, par la place occupée par la littérature, laquelle semble se réduire à chaque fois comme une peau de chagrin. J’en suis arrivé au point où j’aurai bientôt peur de mettre un pied dans ce magasin, tant j’en ressors à chaque fois déconfit et désespéré.
Il n’y avait pourtant pas si longtemps que les spécialistes en rayonnages et les diplômés en marketing avaient complètement restructuré l’ensemble. Dans la bataille, on avait déjà perdu pas mal de mètres de rayonnages, sans compter que les parties biographie, critique et poésie s’étaient retrouvées décalées par rapport à l’ensemble de la production littéraire, reléguées qu’elles étaient dans une allée à grand passage.
L’autre jour, donc, qu’elle ne fut pas ma surprise de constater que ce rayon poésie avait complètement disparu. En cherchant bien, j’ai retrouvé, coincé entre les nouvelles sorties romanesques et la rubrique théâtre (comprenez : les pièces de théâtre qu’on fait lire aux lycéens), un présentoir qui offrait royalement dix titres de poètes contemporains. Pour le reste, rien. N’en croyant pas mes yeux, j’ai poursuivi mes investigations au milieu de la foule toujours abondante durant la pause de midi Finalement, c’est pour ainsi dire à quatre pattes que j’ai fini par découvrir la collection de poche Poésie Gallimard, laquelle devait se limiter à une bonne soixantaine de titres (parmi les plus célèbres, bien entendu). En dehors de cette collection de poche, que j’aime bien par ailleurs, le vide absolu. Encore faut-il parvenir à la découvrir au ras du sol, tout en se faufilant entre les jambes des jeunes clientes qui viennent en ces lieux passer un moment au sec en ce printemps pluvieux (opération périlleuse par ailleurs et qui vous distrait vite de votre investigation première).
Donc, des poètes qui sortent un peu de l’ordinaire, disais-je, vous n’en trouverez pas ou fort peu. Et quand je dis qui « sortent de l’ordinaire », je ne demande rien d’extraordinaire, bien entendu…
Tout ceci nous amène à un autre débat, celui des librairies de qualité, lesquelles me semblent se faire de plus en plus rares. Elles disparaissent les unes après les autres, nous laissant la nostalgie de temps révolus qui pourtant ne sont pas encore si lointains. Est-ce cela, vieillir ? Commencer à regretter un monde qui meurt et se réfugier dans les souvenirs ? Ou bien est-ce l’époque elle-même qui devient boutiquière au point de ne plus proposer que ce qui se vend bien ? Un peu les deux, sans doute.
Demain, peut-être, on ira à la FNAC pour faire ses emplettes. Entre les plats surgelés et les boîtes de Coca on pourra peut-être encore découvrir le dernier Goncourt. Un livre écrit sur commande et signé par une célébrité ? A moins que vous ne préféreriez un CD reprenant les meilleurs discours de Sarkozy ?
En attendant j’achète et je stocke chez moi des livres pour les années à venir. On n’est jamais assez prudent.
19:38 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature, Fnac
08/06/2007
De la consécration littéraire
Dans ses Carnets du grand chemin, déjà cités, Julien Gracq fait remarquer que la seule consécration littéraire qui ait quelque valeur à ses yeux, doit être le fait d’un écrivain réputé. Les critiques comme les lecteurs avisés ne le convainquent pas. Pourtant il reconnaît que les propos tenus par ceux-ci comme par ceux-là sont souvent profonds et non dénués d’intérêt. Mais il n’y a rien à faire, rien ne vaut l’approbation et l’encouragement d’une sommité littéraire.
On sait que son Château d’Argol avait reçu les éloges de Breton avant même sa publication. Pour le jeune Gracq, le fait d’être ainsi reconnu par une personnalité aussi importante, qui faisait figure de « pape » des lettres, constituait une sorte de laissez-passer qui l’autorisait à entreprendre une carrière littéraire.
Il regrette d’ailleurs dans les Carnets (soit en 1986) qu’il n’y ait plus personne dont l’opinion lui importe encore. Breton, Malraux, Gide et Valéry s’en sont allés depuis longtemps. Les quelques écrivaillons contemporains le laissent indifférent, concentrés qu’ils sont sur leurs propres sillons. Quant aux critiques et aux lecteurs, leurs éloges ne font pas autorité pour l’assurer de la valeur de sa production récente. Il compare en fait cette reconnaissance par des gens du métier qui ont fait leur preuve à une sorte d’adoubement moyenâgeux. Tels les Compagnons, qui devaient produire une pièce maîtresse et recevoir l’avis positif des maîtres de la corporation, il estime qu’il n’y a que les vieux routiers de l’écriture, ceux qui ont vécu le fait littéraire de l’intérieur, qui peuvent avoir un avis pertinent.
Tout ceci est évidemment un peu frustrant pour les lecteurs et les critiques que nous sommes tous un petit peu. Quelque part, cependant, il doit avoir raison. Il faut avoir écrit soi-même une œuvre pour mieux cerner la difficulté qu’il y a à en agencer tous les rouages. D’un autre côté, il me semble que cette recherche systématique d’approbation de la part d’un aîné (ce qui est difficile à trouver quand on a plus de quatre-vingt-dix ans) repose davantage sur la réputation de ce donneur d’avis que sur sa capacité réelle à juger de l’œuvre d’autrui. De plus, n’y a-t-il pas là une attitude quelque peu puérile de vouloir à tout prix être reconnu par ses aînés ? Rimbaud attendait-il les éloges du Parnasse pour écrire Une Saison en enfer ? Il est vrai qu’il eut les encouragements chaleureux de Verlaine, ce qui n’était pas rien.
00:42 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Littérature, Gracq, critique littéraire
06/06/2007
Littérature et peinture
Si on s’interroge sur les différences qui existent entre un écrivain et un peintre, on en trouvera plusieurs.
D’abord, le peintre, s’il est artiste, est avant tout un artisan. Il lui faut savoir manier le pinceau avec une certaine dextérité, ce qui est la condition première à la réalisation de tout tableau de qualité, on en conviendra. Quelque part le peintre est donc un « manuel ». L’écrivain, lui, n’a besoin d’aucune disposition particulière, si ce n’est d’avoir appris à écrire à six ans et de savoir utiliser le clavier et la souris de son ordinateur. S’il n’est vraiment pas doué, un simple stylo fera l’affaire.
Ensuite, le peintre (qui ne peut, comme un romancier, décrire le paysage et les personnages avant de raconter finalement une histoire, laquelle comporte habituellement de nombreux rebondissements) doit choisir un moment « in medias res » pour illustrer au mieux l’action représentée. Si on reprend le célèbre tableau « Le radeau de la Méduse » de Géricault, on se rend compte que la scène choisie se trouve à la fin du drame. Par le radeau on comprend qu’il y a eu un naufrage et par l’air hagard des personnages, on devine que leur calvaire dure depuis plusieurs jours. Les gestes désespérés qu’ils font en direction de l’horizon indiquent qu’un bateau vient d’apparaître mais que celui-ci ne les voit pas, ce qui les renvoie à leur désespoir et à leur sauvagerie. Un romancier, lui, aurait d’abord raconté pourquoi tel personnage avait décidé de prendre le bateau, aurait décrit l’embarquement, aurait imaginé une histoire à bord (intrigue entre les soldats par exemple), nous aurait fait frémir sur le naufrage proprement dit avant de nous angoisser davantage encore en décrivant la situation de plus en plus scabreuse de tous ces hommes. Les rapports psychologiques entre les survivants auraient été analysés méticuleusement, avant d’arriver aux scènes d’horreur de cannibalisme. Enfin, quand un bateau serait apparu à l’horizon, il nous aurait fait vibrer d’espoir avant de nous replonger, avec les naufragés, dans l’abandon le plus absolu. Bref, tout cela, qui aurait pu compter quatre cents pages bien serrées, Géricault, parce qu’il est peintre, nous le révèle en un instant, dans une scène statique qui résume le tout. Il existe donc en peinture une économie de moyens qui oppose cet art à la littérature, laquelle demande finalement un esprit analytique.
Enfin, il existe encore une autre différence entre le peintre et le romancier. Elle est de taille et pourtant on ne l’envisage pratiquement jamais. C’est ce qu’il advient de leur production respective. Ainsi un tableau, à la différence d’un livre, se caractérise par son unicité. Il peut être endommagé ou détruit, ce qui ne doit pas manquer d’angoisser l’artiste. Une fois vendu, il disparaît à jamais et physiquement de son univers. A peine s’il parvient à se souvenir de la technique qu’il a employée ou des effets de couleurs qu’il est parvenu à rendre. En cas de doute, il lui sera bien difficile de procéder à des vérifications si le tableau a été acquis par un particulier. D’ailleurs ce particulier unique, qui est-il ? Mystère. Pourquoi a-t-il acheté précisément ce tableau-là ? Le peintre ne le saura jamais. L’auteur de littérature, lui, peut à loisir contempler ses œuvres sur les rayonnages des librairies ou des bibliothèques (y compris dans la sienne propre). Son livre, par la magie de l’imprimerie, s’est multiplié à des milliers d’exemplaires, ce qui lui assure une certaine pérennité. Veut-il en relire un passage qu’il n’y a rien de plus facile, il n’a qu’à tendre le bras.
Pourtant, d’un autre côté, l’œuvre écrite et éditée lui échappe autant que la toile du peintre. Elle n’est plus vraiment sienne. Dans son travail d’écriture, il en avait amélioré la forme et le fond à plusieurs reprises avant de se décider d’arrêter à un certain moment cette recherche de perfection. Imprimé, le livre devient immuable, « tel qu’en lui-même, l’éternité le change». S’il le relit, l’auteur pourra le trouver imparfait. Il souhaitera peut-être le modifier, faire des retouches, améliorer certains passages. Trop tard, le livre appartient désormais aux lecteurs, qui pourront lui reprocher de l’avoir laissé en cet état d’imperfection alors que déjà lui-même pense le récrire autrement. Jamais fini, imparfait à ses yeux, il doit bien pourtant le laisser vivre sa propre vie. Si par hasard, à l’occasion d’une seconde édition, il décide d’y apporter des corrections importantes, il écrit en fait une nouvelle œuvre.
Le livre écrit, bon ou mauvais, reste donc physiquement dans l’entourage de l’écrivain, à la différence d’une toile. Ecrivain qui ne pourra pas faire comme s’il ne l’avait jamais écrit. Quelque part, cette « présence » des livres (en tant qu’objets, mais aussi en tant que symboles occupant un espace dans l’imaginaire personnel de l’auteur) définissent l’écrivain. Jamais il ne pourra plus être comme s’il ne les avait pas écrits.

00:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Littérature
01/06/2007
L'académicien immortel
Max Gallo a été élu à l’Académie française. Il est vrai qu’il y a beaucoup de fauteuils vides, en ce moment, parmi les immortels. Les places de Bertrand Poirot-Delpech, Jean-François Deniau, Henri Troyat, Pierre Moinot et René Rémond sont d’ailleurs encore à vendre.
Max Gallo, manifestement, est un homme qui se lève tôt, car il a écrit une centaine de livres (romans, biographies et études historiques). Voilà qui ne devait pas déplaire à Monsieur Sarkozy. Né en 1932 dans une famille d’immigrés italiens, il incarne donc à suffisance les « bons étrangers » parfaitement intégrés qui ont su se faire une place à la force du poignet. D’historien, il s’est transformé en romancier, et nous a donné des biographies historiques à succès. Rien de tel pour se faire connaître du grand public. De plus ces biographies ont un accent franco-français, ce qui est encore mieux (Napoléon, De Gaulle, etc.).
Bien sûr, nul n’étant parfait, il avait commencé comme militant communiste, mais qui s’en souvient encore ? Porte-parole du gouvernement socialiste au début des années quatre-vingts, il avait rallié récemment les troupes du petit Nicolas. Le hasard fait bien les choses.

16:41 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, Académie française, Max Gallo
30/05/2007
Paysage (2)
Moi qui avais visité les Pyrénées durant mon adolescence, j’aspirais à voir l’endroit où cette chaîne de montagnes se jette dans la mer. Cette rencontre contrastée entre le géant rocheux et l’élément liquide, méditerranéen de surcroît, ne devait pas manquer d’intérêt. La nature, en effet, semble parfois, par son spectacle, éveiller en nous tout un réseau de correspondances symboliques. Bachelard a bien décrit cela dans ses différents livres, montrant comment certains individus sont fascinés par le feu, d’autres par l’eau et ainsi de suite. Personnellement, je déteste l’eau (et encore plus les marécages) et il n’y a que les rochers écrasés de chaleur, dans la sécheresse de l’été, qui me parlent. Les masses montagneuses, par leur assise et par leurs sommets vertigineux me rassurent, sans doute parce qu’elles évoquent la stabilité, à l’inverse des zones marécageuses, qui elles me semblent renvoyer à un monde de l’entre-deux, à un univers du mensonge et de la fourberie. Rien de plus angoissant que ces terrains humides où naît une source et dans lesquels vous vous enfoncez irrémédiablement sans savoir comment vous en sortir. Avec les humains, il en va de même. Je préférerai toujours quelqu’un qui dit clairement ce qu’il pense (pour autant bien entendu qu’il fasse dans la nuance et qu’il ne réduise pas sa pensée à des idées toutes faites et inébranlables) à ces personnes qui vous captent dans leurs filets et qui vous mentent avec d’autant plus de conviction qu’elles finissent par ne plus savoir elles-mêmes ce qu’elles pensent vraiment.
On comprendra, dès lors, que les politiciens, quelle que soit leur couleur, n’ont pas vraiment ma sympathie, surtout quand ils arrivent au pouvoir et qu’on voit par leurs actions qu’ils n’ont fait que nous tromper.
Mais revenons à nos Pyrénées, lesquelles devaient, quelque part, imposer leur présence à l’élément liquide. Cette rencontre tant attendue, il ne me fallut attendre pas mal d’années avant de pouvoir l’observer. Ayant pris un jour d’été le train à Cahors en direction de Barcelone, je me suis retrouvé dans la plaine languedocienne, aride et étouffante de chaleur. Un enchantement pour qui vit habituellement dans un pays de pluie. Puis soudain, après Sète, surgirent les étangs et notamment le bassin de Thau.

A cet endroit (ou était-ce plus loin, près de l’étang de Leucate ?), le train circule entre mer et marais dans un paysage improbable, la terre ferme étant réduite à une bande étroite à peine suffisante pour les rails. Cette omniprésence de l’eau, après quelques jours passés dans le Lot, avait de quoi surprendre et je n’ai jamais connu ailleurs cette impression de rouler au milieu de l’élément liquide. Que l’on portât le regard à gauche ou à droite, l’œil ne rencontrait qu’une même étendue uniformément bleue, conférant au voyage une portée onirique encore renforcée par la fatigue qui commençait à se faire sentir.
Mais bientôt, à l’horizon, dans une brume de chaleur, apparurent enfin les Pyrénées. Seul élément solide de tout le paysage, leur masse si caractéristique en imposa aussitôt. Il est vrai qu’après tous ces marécages dans lesquels je pataugeais depuis une heure, la présence de ces roches dures et stables offrait un côté rassurant, comme quelque chose de connu à quoi enfin se raccrocher. Mes Pyrénées se rapprochèrent à la vitesse du train et bientôt les détails des contreforts furent visibles. A la gare d’Argelès, perdue au milieu de la végétation, les derniers voyageurs descendirent. Deux couples avec enfants, qui restaient là, sur le quai unique, se demandant à quelle extrémité du monde ils avaient atteint et comment ils allaient bien pouvoir gagner le lieu de leur villégiature avec tous ces bagages qui les encombraient.
Les laissant à leur désarroi, je repartis seul, dans un compartiment déserté, pour la rencontre tant attendue. Après avoir roulé quelques minutes encore sans se presser, comme s’il redoutait un obstacle, le train butta soudain contre le rocher, dans lequel il se fraya tant bien que mal un passage. La mer avait disparu et nous étions maintenant au cœur même de la montagne, tels les héros de Jules Verne de mon enfance. Après Cerbère (dont le nom, pour tout amateur d’Antiquité grecque, n’est pas sans symboliser l’entrée dans un autre monde), apparut enfin la gare de Port-Bou (qui, étymologiquement signifie « port de pêcheurs »), terme provisoire du voyage, la SNCF renonçant à explorer les terres plus méridionales. Port-Bou, avec sa gare internationale, donne donc l’impression d’être un cul de sac, un lieu au-delà duquel il n’y aurait plus rien, sauf si on accepte de changer de registre et de passer de la langue de Voltaire à celle de Cervantès, auquel cas le voyage peut continuer.
Cette impression de cul de sac est encore renforcée par la géographie de la ville, coincée entre la mer et la montagne ou plus exactement, poussée dans la mer par la montagne. J’eus tout le loisir d’observer ce phénomène, car les correspondances ne semblaient pas assurées entre la France et l’Espagne (du moins en ce temps-là) et il me fallut patienter quelques heures avant de poursuivre mon voyage. Je les passai donc à visiter cette ville minuscule, composée dans mon souvenir d’une seule rue commerçante à forte déclivité. Ayant peu de goût pour le lèche-vitrines, je me retrouvai assez vite assis sur un parapet devant la mer, laquelle est coincée entre les masses de la montagne qui occultent pratiquement tout l’horizon. Alors que partout ailleurs, des falaises de Bretagne aux grandes plages de l’Atlantique, le regard, dans ces zones côtières, embrasse l’immensité de l’espace, ici, la vue est réduite à gauche comme à droite par des pans de montagne qui font ressembler ce qu’on voit de la mer à un fleuve se faufilant entre une rangée de HLM. Sur une étendue de galets (car même le sable jaune avait été refusé à ce qu’il fallait pourtant bien se résoudre à appeler une plage) se trouvait une jeune dame avec sa petite fille, uniques vacancières insolites en ce lieu de nulle part, où la montagne semblait avoir annihilé tout ce qui nous était familier. Aurait-on voulu les aborder, qu’on n’aurait même pas su en quelle langue il aurait fallu le faire.

10:54 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, voyages
29/05/2007
Carnets du grand chemin
Dans ses Carnets du grand chemin, Julien Gracq nous invite à un voyage à travers les paysages qu’il a traversés. En une page, il parvient chaque fois à révéler l’âme d’une région, avec un sens aigu de l’intuition. Négligeant les habitations et les hommes qui les occupent, il s‘attarde essentiellement sur l’aspect géographique, passant de la sécheresse des Causses à la baie de Somme avec une facilité déconcertante. Soulevant un pan du voile, c’est en poète qu’il parvient à toucher du doigt le mystère de ces lieux. Pas en poète bucolique, certes, mais en connaisseur des réalités du terrain, auxquelles il est sensible et avec lesquelles il tente d’entrer en symbiose, nous révélant des réalités insoupçonnées.
Ce « grand chemin », dit-il, est « aussi, quelquefois, celui du rêve, et souvent celui de la mémoire, la mienne et aussi la mémoire collective, parfois la plus lointaine : l’histoire, et par-là il est aussi celui de la lecture et de l’art. »
Qu’il nous soit permis, à son exemple, de parcourir ainsi quelques lieux qui sont restés présents dans nos souvenirs.
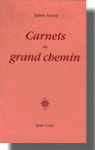
12:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, gracq
17/05/2007
Résistance
La première sortie de notre nouveau président aura donc été un devoir de mémoire envers la Résistance. Curieux. On savait déjà qu’il avait incorporé dans ses troupes les centristes de Bayrou et qu’il était en tain de grignoter un à un les élus du PS. On ignorait par contre qu’il lorgnait aussi sur les communistes, au point d’aller se recueillir sur les lieux de leur exécution par les fascistes.
Trêve de plaisanterie. Quel symbole peut bien cacher ce geste, si ce n’est celui de vouloir s’inscrire lui-même, Sarkozy, dans l’Histoire de France. Après avoir déposé une gerbe en souvenir de Clemenceau et de De Gaulle, le voilà qui verse une larme sur ces jeunes gens qui sont morts pour notre liberté. Manière habile de se réconcilier une partie de la gauche, toute prête à entrer précisément en résistance ? Peut-être. Ou bien s’agit-il de souligner l’importance de ces immigrés juifs qui ont fait la France au point de mourir pour elle ? De bons immigrés, donc, pas comme cette racaille qui brûle les voitures parce qu’elle conteste le vote démocratique… C’est que Nicolas a besoin de montrer qu’il aime la France lui aussi, peut-être pas au point de lui sacrifier sa vie, mais au moins tout son temps libre. D’origine hongroise par son père (un petit noble qui dut fuir la Hongrie devant l’avancée soviétique. On se demanderait bien en passant quelle avait été sa réaction quand les Allemands envahirent sa belle terre de Bohème), juif français par sa mère, ayant épousé une jeune fille corse en premières noces, notre bon Nicolas ne semble pas à priori incarner le « Français de souche » qu’il a promis de défendre pendant sa campagne. Il lui faut donc en rajouter en usant de la symbolique. Jeanne d’Arc était déjà prise. Il s’écarte donc de la pucelle pour se tourner vers ces jeunes gens virils qui ont combattu contre les nazis. Rien à redire.
Rien à redire si ce n’est précisément qu’il en fait trop. Personne ne lui conteste le droit de représenter la France, pays d’ailleurs où il est né. La France de 1789 est trop démocratique pour venir lui reprocher ses origines hongroises ou juives. Là où le bât blesse, c’est que cette terre qui a accueilli son père, il ne veut plus qu’elle en accueille d’autres. Dehors tous ces étrangers qui ne travaillent pas et qui viennent épuiser la mère patrie. Seuls les méritants (comme lui) pourront rester. Et c’est vrai qu’il est méritant, le petit Nicolas. Toujours le premier (enfin, sauf à l’école, mais passons), il a dépassé tout le monde, ayant bien travaillé et surtout pour lui. D’où sans doute sa théorie sur le capital et sur les gens qui se lèvent tôt. Soyez méritants comme moi, nous dit-il et l’avenir vous sourira. En attendant, il nous invite à verser une larme sur ceux qui ont fait l’Histoire de France. Il se fait même professeur en proposant de faire lire dans toutes les écoles la dernière lettre de Guy Môquet, poignante à souhait, il est vrai. Sur le site de Champignac (http://champignac.hautetfort.com/), Dominique nous fait remarquer qu’il eût été plus subtil de proposer la lettre de Manoukian, tout aussi émouvante, mais beaucoup plus profonde.
Rappelons que tout cela déboucha sur l’Affiche rouge, de laquelle s’est inspiré Aragon pour son célèbre poème. Qu’il nous soit permis de redonner ici ce beau texte, puisque nous aussi, en quelque sorte, nous entrons en résistance.
« Vous n’avez réclamé la gloire ni les larmes
Ni l’orgue ni la prière aux agonisants
Onze ans déjà que cela passe vite onze ans
Vous vous étiez servis simplement de vos armes
La mort n’éblouit pas les yeux des Partisans.
Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes
Noirs de barbes et de nuit hirsutes menaçants
L’affiche qui semblait une tache de sang
Parce qu’à prononcer vos noms sont difficiles
Y cherchait un effet de peur sur les passants.
Nul ne semblait vous voir Français de préférence
Les gens allaient sans yeux pour voir le jour durant
Mais à l’heure de couvre-feu des doigts errants
Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA FRANCE
Et les mornes matins en étaient différents.
Tout avait la couleur uniforme du givre
A la fin février pour vos derniers moments
Et c’est alors que l’un de vous dit calmement
Bonheur à tous bonheur à ceux qui vont survivre
Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand.
Adieu la peine et le plaisir Adieu les roses
Adieu la vie Adieu la lumière et le vent
Marie-toi sois heureuse et pense à moi souvent
Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses
Quand tout sera fini plus tard en Erivan.
Un grand soleil d’hiver éclaire la colline
Que la nature est belle et que le cœur me fend
La justice viendra sur nos pas triomphants
Ma Mélinée O mon amour mon orpheline
Et je te dis de vivre et d’avoir un enfant.
Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent
Vingt et trois qui donnaient leur cœur avant le temps
Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir
Vingt et trois qui criaient la France en s’abattant. »
01:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, politique, Sarkozy







