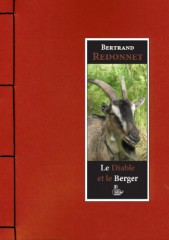20/10/2014
Un enterrement pas ordinaire
Voir l'opuscule paru chez Lamiroy en mai 2019
21:13 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature
11/10/2014
Automne pluvieux
Il pleut.
Sur la vitre, coulent les larmes de l’automne.
Je regarde, indécis, une tasse de café à la main.
Dehors, un oiseau tente de s’abriter sous une branche de sapin.
Il pleut.
Des pensées m’assaillent, des rêveries inconsistantes.
Devant mes yeux défilent des paysages autrefois parcourus,
Des montagnes, des collines, des plaines,
La forêt en plein été, l’océan au cœur de l’hiver…
Ma pensée vagabonde et un visage aimé apparaît.
C’est le tien, comme toujours, surgi du passé,
Surgi de cette époque lointaine où nos corps s’enlaçaient.
Les gouttes d’eau glissent toujours sur la vitre,
Dehors, l’oiseau est parti.

13:45 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
03/10/2014
Automne nostalgique
Je marche sur les sentiers de l’automne
Comme je marche dans ma vie
Sans trop savoir où je vais.
Je regarde les couleurs, qui lentement se fanent,
Le ciel qui pâlit et le jour qui tarde à naître en des matins de brume.
J’écoute le chant de rares oiseaux
Tandis qu’un vent encore tiède
Me parle de pays lointains que je ne connais pas.
Devant moi détale un lièvre, effarouché déjà par tout ce qu’il pressent.
Une feuille d’un profond vert sombre frémit sur sa branche.
Bientôt elle s’envolera, paillette d’or dans le ciel pur,
Pour retomber sur le chemin que la pluie détrempera.
C’en sera alors fini de toute cette beauté éphémère,
Il ne restera que la boue des chemins
Où n’apparaîtra même plus la trace de mes pas.

15:38 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature
25/09/2014
Souvenir tenace
Il te faut quitter les alcôves d’où l’amour s’est enfui,
Emprunter le grand escalier
Et descendre une à une les marches du temps.
Une fois en bas, tu ouvriras d’un coup la porte de chêne
Puis tu te laisseras submerger par le vent aux senteurs océanes.
Dans le jardin, tu délaisseras les roses
Mais tu t’attarderas devant le vieux mur couvert de mousse.
Contre ta peau, tu sentiras la chaleur de ses pierres
Et d’un doigt délicat tu en parcourras les aspérités.
Dans ce matin du monde où tout est à refaire
Tu te souviendras du parfum d’une femme
Et c’est encore son ombre que tu croiras voir derrière les pommiers.
Alors, pour oublier, tu fermeras les yeux
Et respireras une nouvelle fois le grand vent marin
Celui qui vient de loin et qui emporte avec lui toute la senteur des vagues.
Pourtant, tandis que distraitement
Ton doigt caressera la fente d’une pierre,
S’imposera encore et toujours l’odeur de l’aimée,
Quand ta main se perdait dans sa bruyère.

01:11 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature
18/09/2014
Retour
Coule la rivière, passe le temps.
Le vieux pont de pierre est toujours là
Ainsi que les maisons de schiste aux toits d’ardoise.
Seuls les gens ont disparu et l’enfant que j’étais.
Ca et là un muret s’est écroulé, obstruant le petit chemin tant de fois parcouru.
Marie n’est plus là, emportée par la vie.
Dans le cimetière, derrière l’église, des noms connus sont gravés dans le marbre éternel.
Coule la rivière, passe le temps.
Seule la forêt, dans les lointains bleus, dresse toujours sa silhouette frémissante.
Je sais que là est le dernier refuge, l’ultime repaire.
Un jour j’y chercherai le grand silence, au milieu des senteurs sauvages.
Photo personnelle
00:05 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature
11/09/2014
Heureux ceux qui partent
Heureux ceux qui partent.
Heureux les marins qui partent en mer.
Sur le quai, je regarde les grands navires affrétés pour nulle part, leurs voiles blanches immaculées et leur proue audacieuse où se dresse la sirène nue qui depuis toujours hante mes rêves.
Heureux ceux qui partent sans savoir s’ils reviendront jamais.
Là-bas il est des îles étranges aux montagnes colorées et des continents gigantesques aux fleuves impétueux.
Les forêts y sentent la cannelle, le poivre et les bougainvillées. On dit qu’elles sont peuplées d’animaux étranges dont les yeux bleus parfois versent des larmes. Les Indiens écoutent leurs pleurs, la nuit, quand la lune est pleine et que les vents alizés agitent le pagne des femmes.
Là-bas, il est des plages immenses où le sable est d’or fin. La mer vient s’y briser inlassablement et quand on regarde l’écume des vagues on sait que le temps n’a jamais existé.
Dans les cases aux toits de paille, des soupirs disent que l’amour est là, tout simple, et qu’un corps nu s’abandonne aux caresses.
Le vent est tiède et doux. Dans le ciel brille la Croix du Sud.
Heureux les marins qui partent en mer, même s’ils ne doivent jamais revenir.

00:05 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature
04/09/2014
Je suis
Je suis le vent sur les champs de blé
Je suis l’automne dans la forêt profonde
Je suis la mer et ses vagues
Je suis la montagne au clair de lune
Je suis la lune sur une plage de juillet
Je suis la rivière qui tressaute et bondit
Je suis l’amour dans les yeux d’une fille
Je suis la neige un soir de décembre
Je suis le lilas qui fleurit au printemps
Je suis tout cela et je suis moi
Je suis le vent qui annonce le printemps
Je suis la forêt sous la neige
Je suis les vagues qui déferlent sur la plage
Je suis l’été dont rêvent les filles
Je suis la rivière qui bondit sous la lune

01:36 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature
27/08/2014
Enfance du désir
L’eau descend, claire et pure,
Cascadant sur les rochers noirs.
Dans le ciel, un nuage passe, nonchalant,
Chargé de tous les rêves d’enfance.
Au cœur de la forêt courent les loups,
Aux longues foulées inquiétantes.
Quelque part, un chien aboie
Dans le silence du soir.
Derrière l’église, Marie m’attend
Dans sa petite robe bleue.
Ses yeux de louve me fixent,
Quand je caresse sa joue
Dans le silence du soir.

00:45 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature
10/08/2014
Enfance (1)
J’avais cinq ans et je venais d’arriver chez un oncle que je ne connaissais pas. Tout ce qui m’entourait m’étonnait. D’abord il faisait chaud, incroyablement chaud, malgré l’heure déjà tardive. J’étais dans le Sud et pour la première fois j’avais franchi la ligne symbolique de la Loire. Il faisait si chaud qu’on avait sorti de la cuisine la table et les chaises et c’est dans la cour que le dîner a été servi, à une heure incroyable pour l’enfant que j’étais : vingt-et-une heures. Sur un guéridon à roulettes, on avait même sorti la télévision. C’était la première fois de ma vie que j’en voyais une ou en tout cas c’est la première dont je me souviens. Elle était en noir et blanc évidemment et le journal parlé proposait la rétrospective du défilé du 14 juillet sur les Champs Elysées, qui avait eu lieu le matin-même. Paris, la fête nationale… Je n’en revenais pas ! Pendant que je restais fasciné devant le petit écran, mes nombreuses cousines s’affairaient à mettre la table. Ca grouillait dans tous les sens et toutes ces grandes filles de 10 ou 12 ans que je n’avais jamais vues auparavant m’intimidaient un peu.
Pendant ce temps-là, ma mère parlait avec son frère, celui dont on m’avait dit qu’il était mon oncle, et qu’elle n’avait revu qu’une fois depuis la fin de la guerre. Comme tout le monde, il avait fui les combats en 1940 et il s’était retrouvé là, à l’autre bout de la France, avec ses frères et soeurs. La différence, c’est qu’il n’était jamais revenu dans son village natal du Nord-Est et était resté là. L’amour, visiblement, avait été la cause de tout. Il faut dire qu’il venait d’avoir vingt ans et très vite il avait épousé une fille du coin. Mais quelques mois après son mariage, comme c ‘était quand même la guerre, il s’était retrouvé en Allemagne, comme travailleur soi-disant volontaire (tous les garçons qui auraient dû faire leur service militaire en 1941 ou 1942 étaient envoyés en Allemagne, l’occupant ne souhaitant pas qu’on leur apprenne le maniement des armes et préférant de loin voir ses usines tourner à plein rendement). Six mois après son départ, la jeune mariée était morte d’une étrange maladie. Alors il était revenu, la rage au ventre et les larmes au bord des yeux. Il était allé se recueillir sur la tombe de celle avec qui il n’avait vécu que quelques semaines, puis il avait pris le maquis, plein de haine contre les injustices de l’Histoire. C’est plus tard, bien entendu, que j’ai appris tout cela. Il était pudique et discret et il n’a jamais beaucoup parlé de cet engagement dans la Résistance. Je sais juste qu’il a fait sauter des ponts du côté de Bordeaux et que le jour de son enterrement, en 1983, les anciens combattants étaient là, avec le drapeau français et tout.
Une fois la guerre terminée, il s’était remarié et était resté là, dans ce village de l’Ouest, tout près du marais poitevin, pas très loin de l’océan. Il était resté où la vie l’avait mené, où il avait aimé et trouvé la force de combattre et de résister. Et voilà pourquoi à cinq ans, un soir de quatorze juillet, je me retrouvais moi aussi dans ce village, vingt-cinq ans après que les hasards de la guerre y avaient amené mon oncle.

20:52 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature
26/07/2014
Eté
En été, le temps est nu.
Sur le sable de la plage où jouent les enfants,
Les heures avancent inexorablement.
Marée après marée, le grand cadran solaire
Indique la fin des vacances, la fin de l’enfance, la fin de tout espoir.
A l’intérieur des terres, coulent des fleuves larges et majestueux.
Je regarde l’eau qui passe et qui jamais ne repassera.
Le fleuve est éternel, mais son eau est éphémère,
Moins que moi, pourtant, qui la contemple en rêvant.
A l’horizon, les montagnes dressent leur barrière
De schiste, de grès ou de calcaire.
Nées autrefois des premiers cataclysmes,
Elles marquent la fin de notre monde.
Derrière, on dit qu’il y a d’autres fleuves et d’autres plages,
Mais nous ne les connaîtrons jamais
Car nous serons morts avant de les atteindre.
La Meuse dans les Ardennes

00:24 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature
21/07/2014
In memoriam
Me voilà de retour, mais ce premier billet sera bien triste puisqu’il vise à rendre hommage à Joseph Orban (voir lien ci-contre), dont j’ai appris le décès durant mes vacances, par un SMS sur mon téléphone portable. Que dire devant cette fatalité qu’est la mort ? Rien. Toujours, c’est la même incompréhension : ce qui a été n’est plus. Tous ces jours de joie, de souffrance, d’expérience, de révolte, de lectures, de pensées, d’écriture, tout cela disparaît en une seconde. Pourquoi ? Je n’en sais strictement rien, sauf que cette fin inéluctable donne a posteriori un sens tout relatif à notre existence. Pourquoi avoir rêvé et lutté pour en arriver là ? Pourquoi avoir vécu ? Pour rien, visiblement. Non seulement personne n’est parvenu à changer le monde où il vivait, mais notre propre existence, quelle que soit la manière dont nous la gérons, n’est finalement qu’un éclair qui disparaît bien vite dans la nuit des temps.
Reste en nous le souvenir de ceux qui ont vécu et dont les mots nous ont parfois touchés. Ce sera pour moi le cas de Joseph Orban, que j’avais croisé dans ma jeunesse sans oser l’aborder (car malgré son jeune âge, il était déjà revêtu du prestige de l’écrivain) mais que j’ai retrouvé des années plus tard, par hasard, sur Internet. Je me souviendrai longtemps de ses billets amers, volontiers provocateurs, où il dénonçait toutes les injustices du monde. Derrière des mots parfois durs, il cachait une sensibilité à fleur de peau, celle du poète qui n’est pas fait pour vivre sur terre. Comme l’albatros de Baudelaire, il s’est envolé vers d’autres cieux.
20:17 Publié dans Blogue, Errance, Littérature | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature
26/06/2014
De la grotte de l'hermite.
Lassé par l’agitation du monde, consterné par toutes ces guerres qu’on fait soi-disant pour imposer la démocratie (mais guerres qui curieusement profitent toujours aux plus riches), écoeuré par les mensonges de la presse qui s’est définitivement rangée du côté des puissants, je parlais l’autre jour de mon envie de silence.
On pourrait qualifier ce repli de fuite, mais on pourrait tout aussi bien lui donner le nom de sagesse. A quoi bon, en effet, se rendre malade à cause de la manière dont le monde évolue, on n’y changera quand même rien du tout. A notre petit niveau, il nous reste à ne pas gâcher complètement notre vie et à essayer de trouver un sens à notre existence propre. Chacun d’entre nous étant particulier et unique, il appartient à chaque homme (ou à chaque femme) de trouver ce sens dans ce qu’il aime et dans ce qui l’épanouit. Par ces mots, je n’entends pas une vision hédoniste ou quasi épicurienne de la vie. Non, ce que je veux dire, c’est que ce sens ne peut être trouvé que dans ce qui nous parle. Il s’agit donc plutôt d’une démarche fondamentale et existentielle, qu’on pourrait même finalement qualifier de quête.
En retrait par rapport au monde, éloigné de son agitation perpétuelle et ô combien futile, il me semble, en ce qui me concerne, que l’écriture et la lecture constituent deux pôles essentiels à travers lesquels je parviens à découvrir mon « moi » profond. L’animal n’a pas besoin de ces subterfuges. Un chat est un chat jusqu’au bout des griffes, quoi qu’il fasse. L’homme au contraire, submergé par tous les rôles que la société lui a imposés, ne parvient plus spontanément à être lui-même. Il lui faut donc ces moments de recul et de silence pour se retrouver et la lecture comme l’écriture sont précisément deux moyens pour tenter de rapprocher le moi intime du monde extérieur, pour tenter de comprendre ce que vient faire ce « moi » dans cet univers si hostile et si étranger à ses préoccupations personnelles. Le but est de dire ce « moi », non dans une sorte de narcissisme pathologique, mais dans une affirmation naturelle et spontanée.
Le recul permet aussi de prendre une certaine distance par rapport aux événements et donc de ne pas sombrer dans « l’instant » et dans son côté éphémère. C’est la force des grands écrivains classiques (et on retrouve le thème de la lecture) de traverser les siècles car ils sont parvenus à se détacher de leur époque (tout en puisant en elle leur expérience) pour atteindre une sorte d’universalité de l’humain. Ils sont au-delà de l’éphémère et c’est pour cela qu’ils nous parlent, parce qu’ils viennent combler en nous ce manque fondamental, parce qu’ils apportent un début de réponse aux questions existentielles que nous nous posons.
La lecture est donc un voyage dans le monde de l’esprit et l’écriture est un moyen d’exprimer ce qui était en nous et que nous ignorions. A l’abri dans sa grotte, l’homme préhistorique a lui aussi fait appel à l’art pour « dire » qui il était et pour tenter de trouver une réponse à ses questions. D’abord il a posé sa main sur la paroi rocheuse après l’avoir enduite de cendres et la trace qui a subsisté fut la première représentation de l’humain, une sorte de métaphore ou même de métonymie. L’homme pouvait partir chasser, le dessin de sa main continuait à dire qu’il avait existé et qu’il était passé par cette caverne. L’art, déjà, visait à l’immortalité.
Les siècles passant, le dessin de la main a fait place à des représentations plus complexes, et c’est la grotte de Lascaux et ses merveilleux animaux. A ce stade déjà, l’homme se situe par rapport à ce qui l’entoure et il tente de comprendre le sens de sa présence au monde.
Plus tard viendront les religions (mais peut-être que le cheval de Lascaux est déjà un dieu cheval, doué de pouvoirs extraordinaires et dont le chasseur devenu chaman tente de capter la force immatérielle. Qui sait, en effet, ce qu’on vraiment voulu dire nos lointains ancêtres ?), les religions, disais-je, qui fourvoieront les hommes vers des paradis imaginaires, tout en les contraignant sur terre à respecter une morale de fer au service des rois et des puissants. Loin d’épanouir l‘individu et de l’aider à se trouver, elles l’ont poussé vers des chemins de traverse qui l’ont conduit aux notions de péché, de punition, de peur et de refus des plaisirs de la vie.
Pour sortir de ce bourbier, il nous reste donc à réinventer la grotte primitive, celle de nos lointains ancêtres, et d’y dessiner, par exemple, une main tenant une plume. Peut-être parviendrons-nous enfin à dire ce que nous sommes, à défaut de pouvoir dire pourquoi nous sommes là.

22:37 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
12/06/2014
Sortie du lycée
Assis dans la voiture, j’étais venu chercher mon fils qui avait un examen au lycée. N’ayant rien d’autre à faire et n’ayant pas emporté de livre avec moi puisque le temps d’attente aurait dû être très court, je regardais distraitement toute cette jeunesse qui sortait de l’école : jeunes filles en fleur, le sourire aux lèvres et un sac en bandoulière, garçons potaches et décontractés papotant par groupes ou au contraire premiers de classe solitaires et sérieux, ayant déjà sur leur visage les traces des préoccupations que leurs responsabilités futures ne manqueraient pas d’amplifier encore.
Il faisait beau, je me sentais en paix avec moi-même et les souvenirs de mes propres années de lycée commençaient à remonter à la surface, abolissant du même coup des décennies entières, comme si le temps était resté immobile et ne s’était jamais écoulé.
C’est à ce moment-là que je l’ai vue, surgie de nulle part, fantôme énigmatique qui tranchait au milieu de la jeunesse ambiante. Une petite vieille, maigre et voutée, toute de noir vêtue et qui trottait à pas menus vers le cimetière tout proche. Sa frêle silhouette se détacha un instant contre le vert éblouissant d’un conifère, ombre incertaine qui déjà n’appartenait plus à la vie. Pendant quelques secondes, il m’a semblé qu’elle se dirigeait vers sa propre tombe, comme si elle était à elle seule son unique cortège funèbre.
Puis je me suis dit que selon toute vraisemblance elle allait rendre visite à son mari décédé avant elle. Elle avait les mains vides et cette absence de fleurs me faisait pressentir que ses visites au cimetière devaient être quotidiennes. Elle remplaçait ainsi tristement l’ancienne vie commune, se donnant l’illusion de former encore un couple. A quoi avait ressemblé son existence auprès de cet homme ? Je n’en avais aucune idée, mais je pressentais que malheur ou bonheur, cela ne changeait strictement rien pour la vieille dame. Maintenant qu’elle était seule, elle se devait de venir ici se recueillir un instant, même si ce mari avait été le pire des tyrans. Que lui restait-il à vivre ? Quelques mois ? Un an ? Deux tout au plus, si on en jugeait par la maigreur de sa noire silhouette qui semblait déjà appartenir à l’autre monde. Alors, n’ayant plus rien d’autre à faire, elle venait en ce lieu se préparer au grand saut qui ne devrait plus beaucoup tarder. En saluant les défunts, elle s’habituait, en quelque sorte, à son destin futur. Un instant, je l’imaginai en train de tenir quelques discrets conciliabules avec les habitants du cimetière. Cela aurait fait un beau thème pour une nouvelle, digne du roman de la momie de Théophile Gauthier.
Quand elle eut disparu derrière la grille ouvragée, je suis resté rêveur, entouré de cette jeunesse insouciante qui continuait de sortir du lycée, confiante en son avenir.

13:49 Publié dans Errance, Littérature | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature
06/06/2014
Cheminement
16:27 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature
31/05/2014
Plage
Vous alliez souvent, petite fille, jouer sur la plage grande et belle.
Vous fîtes là moult châteaux de sable
Que la marée montante submergeait toujours
Sous vos cris faussement indignés,
Car dans le fond, fort ravie vous étiez de cette force sauvage
Qui piétinait vos constructions éphémères…
Adolescente, sur la même plage, vous vous mîtes à rêver
Au prince charmant qui habitait le château.
Beau, preux et courageux, il vous semblait le voir
Galoper dans les flots, sur son cheval fougueux.
Un jour, il prit les traits d’un vacancier de passage
Et là, sur le sable de la grande plage d’abord, puis dans les dunes discrètes
Vous avez goûté de sa force sauvage et de ses baisers tendres.
Submergée sous les vagues du désir, ravie,
Vous avez crié votre joie à chaque marée haute.
Mais quand prit fin l’été et que le prince fougueux regagna son port,
Indignée, vous comprîtes que tout château n’était fait que de sable.
Aujourd’hui, vous marchez seule sur la plage grande et belle
Et dans le ciel vide passent de grands oiseaux blancs.
Tout en regardant les enfants qui construisent des châteaux éphémères,
Vous écoutez les flots fougueux qui déferlent sur le sable.
Ce sont les chevaux de la mer, qui galopent, écumants.
00:20 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : littérature
19/05/2014
La beauté
Qu’y a-t-il de plus beau qu’un cheval qui galope dans une prairie
Et qui soudain se dresse, ivre d'être lui-même ?
Qu’y a-t-il de plus beau que des vagues qui déferlent sur une plage
Et qui mugissent sourdement en bouillonnante écume ?
Qu'y a-t-il de plus beau qu’un merle qui chante au sommet d’un arbre
Et qui exprime tous les matins du monde ?
Qu'y a-t-il de plus beau qu’une femme qui lit un livre en silence
Et qui rêve qu’elle pourrait être aimée ?
La lectrice
00:12 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature
12/05/2014
"Le Diable et le berger" de Bertrand Redonnet
Je lisais l’autre jour le dernier livre de notre ami Bertrand Redonnet et je me faisais la réflexion suivante : il est quand même curieux que cet auteur, qui revendique son exil volontaire en Pologne, à la frontière biélorusse, ancre généralement ses livres dans le terroir qui l’a vu naître, à savoir la campagne profonde du Poitou. C’était déjà le cas dans son précédent livre, Zozo, et c’est toujours le cas ici, dans « Le Diable et le berger ». Forcément, me direz-vous, puisque le héros (ou anti-héros) dont on raconte l’histoire est un protagoniste que le lecteur avait déjà rencontré dans le premier livre. Certes, certes. Il n’empêche, pourquoi toujours situer l’action dans cette région précise du Poitou ? Parce que Bertrand n’en connaitrait pas d’autres ? Bien sûr que si, car tel un marin sans amarres (lui qui n’aime pas l’océan), il a bourlingué un peu partout. Il aurait donc très bien pu situer l’action dans une autre région de France ou faire voyager son personnage ailleurs en Europe. En Espagne, par exemple (pays que le vieil anarchiste qu’il est doit apprécier par sa guerre civile de 1936 et par la lutte clandestine contre le franquisme qui a perduré dans l’ombre pendant des décennies) ou en Pologne, où il habite.
Mais non, il revient toujours dans ses romans à cette région aux confins de la Vienne et des Deux-Sèvres, probablement parce que c’est le pays de l’enfance, cette terre où il a grandi, mûri, où il est devenu homme et d’où finalement il est parti pour découvrir le monde. Cette terre restera à jamais l’endroit qui est le sien. Les paysages, les vents, les tempêtes d’hiver, les lignes des grands peupliers, la rivière, le petit village (ce microcosme qui dit à lui seul l’univers tout entier) c’est tout cela qui a fait de Bertrand ce qu’il est et c’est pour cela qu’il y retourne par l’écriture, pour remonter à la source et essayer de comprendre le sens de la vie. Et nous, lecteurs, qui sommes d’un autre région, d’un autre univers, nous comprenons parfaitement ce qu’il nous dit, car nous avons également au fond de nous une rivière, un village ou un petit bois où nous avons vécu enfants. C’est la force de la littérature de réveiller ce qui fut et qui a fait un peu de ce que nous sommes.
Mais si le paysage est toujours sous-jacent chez Bertrand, c’est surtout les hommes (et les femmes) qu’il raconte ici, avec leurs désirs, leurs faiblesses et leurs actions qui ne sont pas toujours louables. Ce n’est pas un roman moral. On ne juge pas ici, on décrit. On décrit comment les idées et les passions de chacun vont se confronter avec celles des autres, qui sont différentes. Mais cela provoque des frictions et on frôle souvent le drame avant d’y tomber tout à fait. Stéphane Beau, dans son introduction, parle de véritable tragédie, presque au sens grec du terme. Il n’a pas tort, il y a de cela, en effet. Sauf peut-être que les héros ne sont pas des nobles comme chez Corneille ou des rois et des princes comme chez Sophocle. Ce sont de petites gens, mais par ce côté simple et ordinaire, ils sont plus proches de nous encore car les choses qu’ils vivent au quotidien sont aussi les nôtres : la vie en couple, les disputes, le désir parfois d’aller voir ailleurs si l’herbe n’est pas plus verte.
Le héros principal, Guste Bertin, est en marge de la société. D’abord il n’a pas de père officiel et cela a marqué son enfance. Ensuite, adolescent, il a quitté le village pour aller au collège, ce qui l’a rendu différent aux yeux des autochtones. Enfin, comme membre du Conseil communal, il représente évidemment l’opposition et il est toujours contre tous les projets que propose le maire. C’est l’occasion pour l’auteur de nous décrire quelques scènes épiques, où la truculence du langage est savoureuse. Cependant, derrière ces intrigues de village, c’est une nouvelle fois toute l’âme humaine qui est mise à nu, l’ensemble des conseillers municipaux préférant peureusement et servilement se rallier à l’avis de la majorité plutôt que de défendre les idées généreuses de cet anarchiste campagnard.
Dans ce village, il y a bien entendu un curé et quand on sait tout le mal que pense Bertrand de la religion, il ne fallait pas s’attendre à ce qu’il donne à celui-ci un rôle conventionnel, bien au contraire. C’est qu’il a beau être curé, le prêtre est aussi un homme à l’âme tourmentée, comme tout un chacun, et pour lui comme pour le héros la limite entre le bien et le mal n’est pas toujours bien tracée.
Dans ce roman, il y a des femmes, aussi. La femme de Bertin en a assez de la vie quotidienne qu’elle mène avec son homme grognon et, voyant son couple se déchirer, elle essaie de trouver ailleurs ce qu’elle ne trouve plus chez elle. Je n’en dirai pas plus, mais le noeud de l’intrigue est là, intrigue rondement menée à la lecture de laquelle on ne s’ennuie jamais. Mais je le répète, derrière toutes ces scènes truculentes, il y a toujours une réflexion sur la vie et les passions qui nous animent. Jamais l’auteur ne juge ses personnages. Il décrit leurs faiblesses, il les voit s’écarter du droit chemin, mais quelque part il les comprend et ne les blâme pas. Et si quelqu’un est puni à la fin, c’est finalement pour un meurtre dont il n’était pas directement responsable. Le destin, une nouvelle fois, est impénétrable, ce qui nous renvoie décidément à la tragédie grecque déjà évoquée.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, bertrand redonnet
08/05/2014
Souvenirs
Dans le miroir des souvenirs
J’ai croisé le regard de l’enfant que je fus.
Il se promenait le long de la rivière
Qui coule depuis toujours
Sous ses arches de pierre bleue.
Il y avait là-bas des forêts infinies
Qui frémissaient sous les tempêtes d’automne
Tandis que des hordes de nuages
Déchiraient l’immensité des cieux
Sous des équinoxes pluvieux.
Dans le miroir des souvenirs
Se dressa soudain une adolescente de quinze ans.
Elle baissa pudiquement les yeux
Quand elle se sentit désirée
Par un condisciple amoureux.
Il y avait sur les murs pourpres du lycée
Des vignes vierges et sauvages
Qui montaient à l’assaut des nuages
Tandis que penchés sur nos vieux bancs tachés d’encre
Nous traduisions Horace, Virgile ou Tacite.
Dans le miroir des souvenirs
J’ai revu ton ombre exquise et délicieuse
Frêle silhouette amoureuse
Qui se dévêtait lentement
Dans des hôtels improbables.
Il y avait dans la chambre aux rideaux fermés
Tout ton amour qui se donnait
Dans l’odeur poivrée et chaude
De ton corps aux mille senteurs de vanille
Quand se brisa le miroir des souvenirs
Il ne resta que des éclats étincelants
Sur la surface changeante de la rivière
Et dans mon cœur le regret infini
De toutes ces amours perdues.

00:05 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature
30/04/2014
Le jardinier
C’est un Jardin où vient battre la mer,
Un havre de paix où l’on peut contempler l ‘infini.
Des roses rouges s’épanouissent sous le ciel bleu,
Tandis que des voiles blanches déchirent l’horizon.
Il se souvient, le jardinier, du parfum des îles lointaines,
Dont il est revenu seul, il y a bien longtemps.
Il se souvient de ces saveurs épicées au goût de cannelle
Et surtout de cette femme dont les cheveux embaumaient la vanille.
Il n’a rien oublié et quand il cueille une rose,
C’est à elle qu’il pense, à celle qui vit dans les îles
Et qu’il n’a jamais revue.
Peut-être l’attend-elle, assise sur une falaise
Ou couchée dans le sable fin.
Peut-être rêve-t-elle d’une rose
En contemplant les vagues blanches qui se brisent en cascades infinies…

15:18 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature
16/04/2014
Echouement
Je contemple seul les draps blancs qui ondulent
Comme une mer infiniment triste et sans horizon.
Tu es partie vers un ailleurs inaccessible,
Vers des forêts de songes où je n’ai pas accès.
Tu as emprunté des chemins de moi inconnus
Et je t’ai perdue au premier embranchement.
Ces draps où tu ne dors plus
Ne servent qu’à transformer en blancs fantômes
Mes rêves et mes désirs évanouis.

15:19 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature
26/03/2014
Printemps
Il est étrange ce beau printemps.
Dans la pelouse, quelques fleurs blanches émergent
Sorties du néant de l’hiver.
Le grand saule pleureur a revêtu son feuillage vert tendre
Et les forsythias sont plus jaunes que jamais.
Le ciel, lui, est bleu, immensément bleu,
Comme il l’a rarement été.
Un nuage blanc le traverse,
Petite touche tendre qu’un peintre inconnu aurait déposée là.
De ma fenêtre, je regarde tout cela,
Ce beau tableau de la nature renaissante.
Un oiseau noir sautille sur l’herbe verte
Et une brise légère agite les branches du saule.
C’est beau, c’est très beau.
Mais quel sens a tout cela depuis que tu es partie ?
Il manque ta silhouette sur la terrasse,
Il manque ton sourire et ta tendresse.
Il est étrange ce beau printemps,
Depuis que tu n’habites plus que mes souvenirs.
12:01 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature
15/03/2014
Souvenir
Je ne me souviens plus où nous nous sommes rencontrés,
Ni de quel pays tu venais.
Je n’ai jamais rien su ni de ton enfance ni de ta famille.
J’ai même oublié ton nom.
Mais j’ai gardé au fond de moi la tendresse de tes caresses,
L’odeur de ta peau et la douceur de ton regard.
Je te reconnaîtrais entre toutes.
00:05 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature
11/03/2014
Le puits mystérieux
Près de ma maison, il y avait un puits sans fond.
Qu’est-ce que j’ai pu rêver, enfant,
Assis sur ses pierres de schiste,
Froides et bleutées comme la nuit.
J’imaginais dans l’obscurité humide
Une vie primitive et rampante,
Quelque bête d’un autre âge,
Ou un dragon sorti de la préhistoire.
Mais j’avais beau me pencher, je ne voyais jamais rien.
Rien qu’un gouffre profond au-dessus duquel je criais
Ma peur de tomber, ma peur de mourir.
Et l’écho répercutait ma voix à l’infini,
La déformant au point de la faire ressembler
A ces cris étranges des bêtes d’autrefois.
S’engageait alors un dialogue insensé où à mes questions
On répondait gravement des choses étranges et belles.
Une nuit, n’y tenant plus, j’ai quitté ma chambre
Et me suis approché, pieds nus, du puits mystérieux.
La lune était enfouie derrière les arbres de la grande forêt,
L’obscurité était totale et ma peur à son comble.
Je me suis penché, le ventre nu, sur la pierre froide et coupante.
En bas, tout en bas, les voix poursuivaient, seules, leur dialogue d’outre-tombe.

00:05 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
27/02/2014
Fin de parcours
Cinéma muet sur le mur blanc.
C’est mon ombre qui s’agite et s’incline,
Noire comme la nuit,
Apeurée comme jamais.
Elle dessine en tremblant l’énigme de ma vie,
Equation silencieuse
Au rebours de mon âge.
Quand elle atteindra le sol en rampant
J’en aurai terminé de chercher des réponses.
Nous fusionnerons enfin pour la première fois,
Et chercherons dans l’oubli
A apaiser nos peurs.
00:05 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature
22/02/2014
Souvenirs
La vie n’est pas tendre avec nous. Elle nous tend cent pièges et mille chausse-trappes, dans lesquels nous tombons généralement. On n’y peut rien, c’est comme cela. Notre vigilance n’empêchera que très rarement note chute. Alors, faut-il pour cela détester la vie ? Non, il faut en retirer tout ce que nous pouvons, c’est-à-dire généralement pas grand-chose. Mais ce « pas grand-chose », ce « presque rien » comme disait Jankélévitch, est tout ce qui nous est donné, alors profitons-en au maximum. Conservons au fond de nous tous ces petits bonheurs éphémères, ne les négligeons pas, ils sont souvent plus importants qu’on ne le croit. Ainsi, quand on vieillit et qu’on regarde derrière soi ce que l’on a vécu, on s’aperçoit que les souvenirs que nous conservons du passé sont rarement des faits importants, mais plutôt des impressions fugaces que notre esprit et nos sens ont enregistrées : le son de la cloche d’un village, l’odeur des fleurs au printemps, le bruit de la pluie sur un toit, le souffle du vent en haut d’une falaise, le bruit éternel des vagues, le goût du gâteau que l’on mangeait enfant, etc. Notre vie est faite de ces instants fugaces, qui nous ont marqués puisque nous croyions les avoir oubliés alors qu’ils reviennent toujours au moment où on ne les attend pas.
Conservons toutes ces impressions au fond de nous. Recueillons-les précieusement au fond d’un vase, comme un parfum précieux et quand l’existence n’est pas tendre avec nous, reprenons ce flacon et ouvrons-le précautionneusement pour en respirer les effluves, ils sont la quintessence de notre vie.
(A toi, dont l’odeur de la peau est restée sur mes lèvres).
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature
10/02/2014
De l'opinion du plus grand nombre.
Un petit extrait de Schopenhauer :
Ce que l'on appelle l'opinion commune est, à y bien regarder, l'opinion de deux ou trois personnes ; et nous pourrions nous en convaincre si seulement nous observions comment naît une telle opinion. Nous verrions alors que ce sont deux ou trois personnes qui l'ont admise ou avancée ou affirmée, et qu'on a eu la bienveillance de croire qu'elles l'avaient examinée à fond ; préjugeant de la compétence suffisante de celles-ci, quelques autres se sont mises également à adopter cette opinion ; à leur tour, un grand nombre de personnes se sont fiées à ces dernières, leur paresse les incitant à croire d'emblée les choses plutôt que de se donner le mal de les examiner.
Ainsi s'est accru de jour en jour le nombre de ces adeptes paresseux et crédules ; car une fois que l'opinion eut pour elle un bon nombre de voix, les suivants ont pensé qu'elle n'avait pu les obtenir que grâce à la justesse de ses fondements.
Les autres sont alors contraints de reconnaître ce qui était communément admis pour ne pas être considérés comme des esprits inquiets s'insurgeant contre des opinions universellement admises ou comme des impertinents se croyant plus malins que tout le monde. Adhérer devint alors un devoir.
Désormais, le petit nombre de ceux qui sont capables de juger est obligé de se taire ; et ceux qui ont le droit de parler sont ceux qui sont absolument incapables de se forger une opinion et un jugement à eux, et qui ne sont donc que l'écho de l'opinion d'autrui. Ils en sont cependant des défenseurs d'autant plus ardents et plus intolérants. Car ce qu'ils détestent chez celui qui pense autrement, ce n'est pas tant l'opinion différente qu'il prône que l'outrecuidance qu'il y a à vouloir juger par soi-même — ce qu'ils ne font bien sûr jamais eux-mêmes, et dont ils ont conscience dans leur for intérieur.
Bref, très peu de gens savent réfléchir, mais tous veulent avoir des opinions ; que leur reste-t-il d'autre que de les adopter telles que les autres les leur proposent au lieu de se les forger eux-mêmes?
Puisqu'il en est ainsi, que vaut l'opinion de cent millions d'hommes? Autant que, par exemple, un fait historique attesté par cent historiens quand on prouve ensuite qu'ils ont tous copié les uns sur les autres et qu'il apparaît ainsi que tout repose sur les dires d'une seule personne.
"De l'art d'avoir toujours raison"

22:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (29) | Tags : littérature
06/02/2014
Dernière promenade
Il y avait la mer, qui n’en finissait pas de se briser.
Il y avait les nuages, qui n’arrêtaient plus de s’accumuler.
Il y avait le vent, qui soufflait en tempête.
Il y avait nous deux, qui marchions en silence
Et nos pas derrière nous, qui déjà s’effaçaient.
Il y avait ton visage et tes lèvres fermées.
Il y avait ces mots, que je redoutais et qui ne venaient pas.
Il y avait mon cœur qui déjà battait la chamade
Et qui se brisait, silencieux, au milieu des tempêtes.
Il y avait la mer et le vent.
Il y avait surtout tes lèvres,
Que jamais plus je n’embrasserais.
23:02 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature
25/01/2014
Une carte de Provence
Cela faisait longtemps qu’il aimait Fabienne en secret, mais il n’osait pas lui avouer les sentiments qu’il éprouvait pour elle. Ils se voyaient souvent, pourtant. Très souvent, même. Ils se retrouvaient autour d’un verre avec des amis ou allaient au cinéma. C’était gai, ils se parlaient, riaient des mêmes choses ou refaisaient le monde à coup d’idées grandioses, des idées comme on n’en a qu’à vingt ans. Ils étaient toujours d’accord sur tout et au plus fort des discussions, quand les autres, criant et vociférant, en venaient presqu’aux mains, ils échangeaient entre eux des regards amusés qui en disaient long sur leur complicité. Le problème, c’est qu’il n’était pas possible de parler un peu intimement au milieu d’un groupe si agité, même s’il s’agissait de bons amis. Il aurait fallu s’isoler un peu. Pourtant de tels moments arrivaient parfois, notamment quand ils restaient seuls dans le café, vers une ou deux heures du matin, lorsque tous les autres étaient partis. Lors de ces tête-à-tête, la complicité déjà évoquée était plus grande encore, même s’ils restaient là sans rien dire. En effet, ils n’avaient même pas besoin de parler pour se comprendre. Ils se sentaient bien comme cela, l’un avec l’autre, et c’était suffisant.
Pourtant, quand il rentrait chez lui dans la nuit noire, le long de la voie du chemin de fer, il s’en voulait de n’avoir pas osé. Une autre fois, c’était juré, il lui parlerait et lui dirait tout ce qu’il avait dans le cœur. Oui, mais c’était risqué quand même ! Si elle prenait peur et si elle mettait un terme à leur amitié ? Bon, c’était vrai qu’elle le regardait parfois à la dérobée, il l’avait bien remarqué et c’était vrai qu’à ces moments-là elle baissait vite le regard, comme si elle avait été prise en faute, mais cela ne voulait encore rien dire. Ou au contraire cela voulait dire qu’elle avait peur, justement, qu’il ne prît pour un intérêt trop appuyé ce qui n’était finalement que de l’amitié. Bref, plus il se mettait à réfléchir de la sorte et moins il trouvait le courage nécessaire pour avouer cet amour qui pourtant le rongeait intérieurement. Quand enfin il arrivait chez lui, à une heure avancée de la nuit, il se mettait au lit et s’endormait aussitôt, n’ayant pris aucune décision.
Les semaines passaient cependant et bientôt ce seraient les vacances scolaires. Elle partirait un long mois en Provence avec sa famille et Dieu seul sait qui elle pourrait rencontrer là-bas. Il fallait faire vite. Mais plus l’échéance approchait et moins il osait prendre son amie à part et lui dire simplement : « Je t’aime ».
Un matin, pourtant, il lui sembla avoir trouvé la solution. Il lui écrirait ! Une belle et longue lettre où il dirait enfin ce qu’il éprouvait, sans rien cacher. Par écrit, ce serait quand même plus facile. Les mots viendraient les uns après les autres, s’assembleraient, et finiraient par prendre un sens. Il ne sentirait pas son regard de fille posé sur lui, ce regard qui le paralyserait à coup sûr s’il se lançait dans une déclaration amoureuse. Bien au contraire il pourrait s’expliquer en toute quiétude, trouver des arguments, tenter de convaincre…
Evidemment, ce ne fut pas aussi facile qu’il le pensait d’écrire cette lettre, et il dut s’y prendre à trois ou quatre fois, barrant les mots, déchirant le papier, en reprenant un autre, pour le déchirer de nouveau, mais enfin il y parvint. Il ne restait plus qu’à glisser la précieuse missive dans une enveloppe, mais cela aussi prit du temps. Car écrire, c’était bien, mais rencontrer le lendemain la personne dans le café habituel, au milieu des amis, c’en était une autre. Alors il prit la décision d’attendre un petit peu que sa tendre amie soit partie en vacances pour lui envoyer sa déclaration d’amour en Provence, sur son lieu de villégiature. Cela lui laisserait trois semaines à la fois merveilleuses et angoissantes pour attendre sa réponse. Cela lui laisserait surtout un petit répit avant de savoir si elle répondrait favorablement ou non à son amour.
La lettre était partie depuis trois jours et Fabienne depuis une semaine quand la nouvelle tomba, abrupte, incroyable : lors d’une excursion dans le massif des Maures, la voiture de ses parents, en voulant éviter un sanglier, était tombée dans un ravin. Il n’y avait pas eu de survivants.
Le jour de l’enterrement, il pleuvait. C’était une petite bruine fine et tenace qui vous faisait frissonner bien qu’on fût en plein juillet. Tout le monde était là, atterré et silencieux. Sa famille à elle, les oncles, les tantes, les cousins, tous ceux qu’on ne connaissait pas et qu’on n’avait même jamais vus. Mais surtout tous les amis étaient là aussi, ceux de l’école et du café, revenus en train express pour la circonstance, qui de Quiberon, qui de Marbella, qui de Florence.
En rentrant chez lui, tout en marchant le long de la voie ferrée, il entendait encore les pelletées de terre qui tombaient sur son cercueil et il avait bien du mal pour ne pas pleurer, là, devant tout le monde. Un train passa, emportant des vacanciers pour des destinations lointaines. Plus rien n’avait de sens. Plus rien n’aurait jamais plus de sens. La vie venait de s’arrêter pour toujours.
Il ouvrit la porte de sa maison et machinalement regarda dans la boîte aux lettres. Il y avait une carte du Lavandou. De sa belle écriture ronde, Fabienne disait : « il y a si longtemps que j’attendais ce moment ! Moi aussi je t’aime ! Je pense tout le temps à toi. A très bientôt mon ange. »

Massif des Maures
22:47 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature
15/01/2014
Les îles
Tous les jours il regardait la mer et les vagues infinies.
Tous les jours il contemplait l’horizon et les bateaux qui voguaient vers des îles inconnues, des îles dont personne, jamais, ne revenait.
Tous les jours, du haut des falaises, il respirait les vents du large, chargés d’embruns salés et de saveurs épicées.
Alors il croyait voir d’immenses plages dorées où des enfants nus jouaient sous les soleils des tropiques. Derrière les grandes dunes blondes s’étendaient des forêts incroyables, où, depuis mille ans, des arbres exotiques embaumaient l’air de parfums troublants et poivrés. Parfois, il lui semblait apercevoir, couchées dans des pirogues noires, des femmes dolentes et lascives qui évoquaient Gauguin. Plus loin, dans des cases de palmes, leurs sœurs donnaient de l’amour à des guerriers féroces venus oublier, sous leurs caresses tendres, les blessures des combats.
Et lui restait là, sur la falaise, contemplant les nuages en déroute qui traversaient le ciel, s’imaginant parfois que c’étaient là les voiles d’un immense bateau en partance pour ces îles dont personne jamais ne revenait.

01:19 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
13/01/2014
De la manière de conserver le pouvoir
Je poursuis mes lectures et je tombe sur cet extrait, qui me semble dans la suite logique du texte précédent, qui traitait des moyens employés par certains hommes pour arriver au pouvoir. Il s’agit ici de réfléchir à la manière dont ils s’y prennent pour conserver ce pouvoir une fois qu’ils s’en sont emparés. L’auteur n’est plus Platon, cette fois, mais Etienne de la Boétie, l’ami de Montaigne. Voici ce qu’il écrit dans le « Discours de la servitude volontaire » :
Pauvres gens misérables, peuples insensés, nations opiniâtres à votre mal et aveugles à votre bien ! Vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu, vous laissez piller vos champs, voler et dépouiller vos maisons des vieux meubles de vos ancêtres !
Vous vivez de telle sorte que rien n’est plus à vous. Il semble que vous regarderiez désormais comme un grand bonheur qu’on vous laissât seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine, ne vous viennent pas des ennemis, mais certes bien de l’ennemi, de celui-là même que vous avez fait ce qu’il est, de celui pour qui vous allez si courageusement à la guerre, et pour la grandeur duquel vous ne refusez pas de vous offrir vous-mêmes à la mort. Ce maître n’a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps, et rien de plus que n’a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu’il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D’où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n’est de vous ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s’il ne vous les emprunte ?
Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres ? A-t-il pouvoir sur vous, qui ne soit de vous-mêmes ? Comment oserait-il vous assaillir, s’il n’était d’intelligence avec vous ? Quel mal pourrait-il vous faire, si vous n’étiez les receleurs du larron qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue et les traîtres de vous-mêmes ? Vous semez vos champs pour qu’il les dévaste, vous meublez et remplissez vos maisons pour fournir ses pilleries, vous élevez vos filles afin qu’il puisse assouvir sa luxure, vous nourrissez vos enfants pour qu’il en fasse des soldats dans le meilleur des cas, pour qu’il les mène à la guerre, à la boucherie, qu’il les rende ministres de ses convoitises et exécuteurs de ses vengeances. Vous vous usez à la peine afin qu’il puisse se mignarder dans ses délices et se vautrer dans ses sales plaisirs. Vous vous affaiblissez afin qu’il soit plus fort, et qu’il vous tienne plus rudement la bride plus courte. Et de tant d’indignités que les bêtes elles-mêmes ne supporteraient pas si elles les sentaient, vous pourriez vous délivrer si vous essayiez, même pas de vous délivrer, seulement de le vouloir.
Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. Je ne vous demande pas de le pousser, de l’ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir, et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre.
Sarlat, maison natale de La Boétie

00:06 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature