23/02/2010
Obscurité (8)
08:39 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature
20/02/2010
Obscurité (7)
09:12 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature
16/02/2010
Obscurité (6)
A la fin, n’y tenant plus, il sentit la nécessité de sortir de la voiture et de faire quelques pas, dans l’espoir qu’il trouverait ensuite le sommeil. C’était étrange ce besoin inexpliqué, c’était comme si le fait de rester là, étendu, lui était devenu insupportable. Il devait partir, bouger, marcher, éliminer toute cette énergie qu’il percevait en lui, toute cette angoisse qui l’avait imperceptiblement envahi et qui avait atteint une telle intensité qu’il devait absolument faire quelque chose. Il fallait vraiment qu’il y fût contraint par une force intérieure, car d’un autre côté l’idée de s’extraire de la chaleur de son sac de couchage pour affronter les ténèbres n’avait rien de réjouissant en soi, comme on peut s’en douter. L’être humain n’est pas à une contradiction près et les enfants n’y échappent pas plus que les adultes.
Voir le livre paru aux éditions Chloé des Lys

13:12 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature
09/02/2010
Obscurité (5)
09:00 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (27) | Tags : littérature
05/02/2010
Obscurité (4)
Quand il se réveilla, la voiture était arrêtée sur un parking d’autoroute et sa mère dormait, la tête appuyée sur le volant. Pauline aussi dormait et en voyant comme elle était belle, il repensa à son rêve troublant de la veille et surtout à sa fin horrible. Dehors, le soleil se levait et ce qu’il vit l’étonna au plus haut point.
La suite est à lire dans le livre paru aux éditions Chloé des Lys

08:23 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature
30/01/2010
Obscurité (3)
A la fin sa propre mère se décidait à intervenir et il se retrouvait enfermé dans sa chambre sans dîner et puni jusqu'au lendemain. Ainsi il aurait le temps de réfléchir, lui lançait-on à travers la porte. Mais lui, la seule chose qui le tracassait, c’était de savoir pourquoi sa mère avait finalement demandé à son compagnon de se calmer.
La suite est à lire dans le livre paru aux éditions Chloé des Lys

11:55 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : littérature
25/01/2010
Obscurité (suite)
Terrorisé, l’enfant ferme les yeux. En une seconde, il revoit tout ce qui s’est déjà passé autrefois, tout ce qui se passe, depuis toujours : les coups de ceinture, les coups de poings, les coups de pieds. La douleur dans le ventre, quand la bottine ferrée arrive dans le creux de l’estomac, la douleur dans le dos, quand on le frappe avec un cintre et qu’il entend celui-ci voler en éclats. mposé une attitude de mépris, une manière de dire « Cogne toujours, tu ne m’atteindras pas ».
La suite est à lire dans le livre paru aux éditions Chloé des Lys sous le titre Obscurité.

12:15 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, enfant, écurie
19/01/2010
Obscurité
Dans l’écurie, l’enfant attend. Il attend, roulé en boule dans un coin, le regard hébété, mais l’oreille attentive cependant. C’est qu’il est important de ne pas être découvert et le moindre bruit annonçant des pas qui s’approcheraient le ferait se recroqueviller encore plus, si c’était possible. Il est assis là, dans ce coin obscur, à même le sol de terre battue. Il sent le froid le gagner petit à petit et pourtant il ne bouge pas. Au contraire, il reste là, immobile, comme prostré dans sa douleur.
Il faut attendre, attendre que cela se passe. Cela se passe toujours, il suffit d’avoir de la patience, c’est son expérience qui le lui dit. Cette fois-ci, pourtant, ce n’est pas comme d’habitude, c’est beaucoup plus grave et il le sait. C’est d’ailleurs pour cela qu’il s’est réfugié ici, dans la vielle écurie désaffectée. Comme il n’a rien à faire, il regarde autour de lui, dans la pénombre. C’est une manière comme une autre de tromper son angoisse, d’oublier. Les mangeoires taillées dans la pierre brute sont toujours là, ainsi que les râteliers. Fixés au mur par des crochets gigantesques, couverts de rouille, ils laissent pendre des chaînes qui semblent sorties d’une salle de torture du Moyen-Age. Plus loin, à même le sol, s’entassent des outils étranges. Une herse, des râteaux, un fléau, quelques faux. Il regarde toutes ces tiges métalliques qui dépassent, ces barres de fer pointues, ces lames qui furent acérées un jour mais qui doivent encore couper suffisamment si jamais on venait s’empaler dessus… Son instinct de survie lui fait tendre l’oreille… Non, personne ne vient. Ouf ! C’est qu’une fuite dans la pénombre pourrait très mal se terminer avec tous ces outils qui traînent… Heureusement qu’il a barricadé la porte comme il a pu avec de vieux cageots !
A droite de cette porte se trouve une espèce de meurtrière, bien trop petite pour qu’une personne puisse y passer. Seule une lumière tamisée s’infiltre comme elle peut par l’ouverture étroite, après avoir traversé le vieux mur de schiste d’un mètre d’épaisseur. C’est le seul éclairage de l’écurie, autant donc dire qu’on ne voit quasi-rien à l’intérieur. C’est une chance aussi : quiconque entrerait ici venant de l’extérieur ne distinguerait absolument rien dans un premier temps. L’enfant calcule le nombre de secondes dont il disposerait alors pour se terrer encore plus, disparaître dans le sol, se volatiliser, devenir poussière. Puis il se dit que ses calculs sont faux, car une fois la porte grande ouverte il est évident que la lumière entrerait à flots. Le tout est de savoir si elle arriverait jusqu’à sa cachette, dans ce coin reculé… Bien malin qui pourrait le dire. La vie est ainsi faite, remplie d’incertitudes.
Au-dessus de lui, il reste du foin qui pend entre les poutres du grenier. C’est que la maison est construite à flanc de colline, directement sur le rocher. Alors autrefois (et il s’est quand même trouvé quelqu’un pour le lui expliquer un jour), les chariots s’arrêtaient du côté de la route, à ras du toit et de plain-pied avec le grenier. C’était facile pour décharger et ensuite le foin tombait tout seul en contrebas, dans l’écurie. Il suffisait de le tirer à soi avec une fourche. L’enfant regarde cette herbe sèche qui n’en finit plus de s’échapper entre les planches disjointes depuis une bonne soixantaine d’années. Il se dit que son père, quand il avait son âge, a dû voir les mêmes choses que lui. Reste à savoir s’il venait aussi se réfugier dans la pénombre de l’écurie, ça c’est un mystère qu’il ne pourra jamais percer. Il regarde donc le foin bien sec et il se dit qu’il suffirait d’une petite allumette pour que tout soit fini : l’obscurité, la peur, les coups et même la vie. Ce serait si simple : rien qu’une petite allumette…
Mais ses poches sont vides et de toute façon ce n’est pas trop dans son tempérament de se révolter ainsi. Lui, il a plutôt appris à biaiser, à se sauver, à esquiver. Alors il est là, dans le noir, au fond de cette écurie désaffectée. Du sol humide s’échappe une odeur pénétrante qu’il identifie mal, mais qui doit provenir de toutes les bêtes qui ont vécu là, pendant un siècle ou deux. Les deux chevaux de labour à l’entrée, avec leur croupe et leurs pattes énormes, puis quelques vaches maigres, une chèvre aussi, sans doute et dans le coin là-bas, un cochon qu’on essaie d’engraisser avec le peu de nourriture qui sort de la cuisine. Car on a toujours été pauvre dans la famille, l’enfant le sait, comme il sait qu’il ne pourra jamais en être autrement. Pour passer le temps, il essaie de se mettre à la place du bétail qui a occupé ce lieu autrefois. Ca pense à quoi, une vache, quand ce n’est pas dans une prairie et que cela doit rester là, tout un hiver, attachée et immobile, à regarder un mur passé à la chaux ? C’est difficile à imaginer et d’ailleurs est-ce que cela pense, seulement, une vache ? L’enfant se dit qu’il aurait mieux valu que cela ne pensât point (enfin, il le dit dans son langage à lui, sans employer le subjonctif imparfait qu’on ne lui a pas appris à l’école), c’est toujours moins pénible quand on ne se rend compte de rien. Lui, par contre, ses méninges fonctionnent bien et cela cogite ferme dans sa petite tête. De tout ce qu’il a vu, de tout ce qu’il a entendu et surtout de tout ce qu’il a déjà enduré, il a retenu qu’il vaut mieux se terrer ici et attendre. En espérant cependant qu’on ne le découvre pas trop tôt, car alors ce serait pis encore. De la vie, il a retenu deux choses essentielles : la première, c’est qu’il vaut mieux disparaître quand les adultes sont énervés, la deuxième, c’est qu’il ne faut surtout pas se faire prendre quand on essaie de se cacher.
Il regarde autour de lui et s’aperçoit que les vieux murs sont recouverts de toiles d’araignées. Les pierres de schiste ont été assemblées avec de l’argile car on ne connaissait pas le mortier autrefois. Avec les années, les joints creux se sont vidés petit à petit et, dans toutes ces anfractuosités, des générations entières d’araignées ont tissé leur toile. Cela fait comme de grandes draperies poussiéreuses qui pendent le long des parois. L’enfant a même l’impression que tout cela ne constitue qu’une énorme toile, tissée par une araignée monstrueuse. Craintif, il regarde aussitôt dans le coin derrière lui. On ne sait jamais… Ouf, il n’y a rien. Mais il conserve tout de même l’impression d’être lui-même englué dans une toile immense, gigantesque. Pourra-t-il jamais s’en dépêtrer ?
C’est à ce moment qu’il entend un bruit de pas et que la porte s’ouvre brutalement, dans un grand fracas de cageots brisés. Ebloui par la lumière, il ne voit rien, mais il sait que c’est fini, qu’il n’y a plus rien à espérer. Sa dernière heure est venue.

00:33 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : littérature, enfant, écurie
31/12/2009
Un conte de Noël (fin)
Alors, les mois et les années passant, sa réputation ne fit que croître, comme on le pense bien. Quand il revenait dans un village déjà visité précédemment, tout le monde sortait des maisons et on lui faisait fête. Ce n’est pas la nourriture qui lui manquait, ni le vin et s’il n’avait plus la moindre pièce de monnaie en poche, il n’avait jamais aussi bien vécu. Tout en mangeant et en engloutissant le pain et les pâtés qu’on lui offrait à profusion, il caressait la joue d’une fillette et expliquait que Dieu aimait les enfants et leur innocence. On le laissait faire car c’était un honneur de voir sa propre fille caressée par un tel mage, qui disait de si belles choses et même si on ne les comprenait pas toutes, on devinait que celui qui les proférait avait sa place à la droite de Dieu, ce qui n’était tout de même pas rien.
Sa popularité prenait chaque jour de l’ampleur et parfois à son insu. Ainsi, une fois qu’il était invité à un repas de noce, un des villageois, pour lui être agréable, fit apporter une barrique de vin, pour qu’il puisse offrir à boire à l’assemblée. C’était une attention délicate : il remercierait ainsi les jeunes mariés de leur invitation et ne se ferait pas passer pour un vulgaire pique-assiette. Mais les convives, qui avaient déjà bien bu, ne comprirent pas d’où sortait ce tonneau et il s’imaginèrent que leur mage avait transformé l’eau insipide du puits en un vin délicieux et capiteux. Lui, tout en riant dans sa barbe, s’est contenté de lever son verre, car il savait qu’en s’entourant de mystère, son crédit ne ferait que croître.
Parfois, il organisait lui-même ses tours de magie, comme la fois où il mit un puissant soporifique dans la boisson d’un pauvre diable. Ce somnifère, mélangé au vin, eut un effet insoupçonné. Le villageois tomba dans une espèce de coma éthylique qui le laissa sans connaissance et sans souffle pendant plus de vingt-quatre heures. On s’apprêtait déjà à l’enterrer quand notre mage réapparut, un peu surpris lui-même des conséquences inattendues de son breuvage. Décontenancé, mais ne pouvant avouer la vérité, il conseilla cependant d’attendre encore un peu avant de laisser faire les fossoyeurs. Bien lui en prit car quelques heures après le mort ouvrait un œil, à la stupéfaction de tous. Il n’en fallut pas plus pour que de simple devin notre héros ne fût déclaré d’essence divine. Proclamé malgré lui fils de Dieu, il continua donc à parcourir le pays, acclamé par tous. Des foules immenses l’attendaient le long des chemins, on se prosternait devant lui, les jeunes filles tombaient en pâmoison, quand elles ne tentaient pas carrément de l’embrasser. Lui, imperturbable et prenant son rôle très au sérieux, parlait des temps futurs et de ce Royaume de Dieu où la vie serait enfin supportable et bien différente de celle que l’on connaissait aujourd’hui (c’était à espérer). Il n’y aurait plus de percepteurs d’impôts, plus de policiers zélés, plus de marchands avides ni même de prêteurs sur gage pour plonger les pauvres gens dans la misère. Non, il n’y aurait plus rien de tout cela, rien que des plaines verdoyantes où couleraient le vin et le miel.
Evidemment, tous ces attroupements qui se formaient sans arrêt, cela commençait par faire un peu désordre et les autorités se mirent à surveiller discrètement les moindres déplacements de l’homme de Dieu. Ses histoires de paradis et de monde meilleur, on s’en moquait bien. Après tout, cela faisait rêver le peuple et pendant qu’il rêvait celui-ci ne pensait pas à se révolter. Mais venir contester les autorités religieuses en place, c’était beaucoup plus délicat car, on le sait bien, le pouvoir politique s’appuie toujours sur la religion officielle et réciproquement. Et puis venir critiquer les notables, leur reprocher leur richesse et venir sous-entendre que demain, dans ce merveilleux paradis, ils pourraient bien ne plus être les premiers, voilà une chose qu’on ne pouvait guère tolérer. Alors, un jour que notre vagabond mystique, sûr de son succès, s’était aventuré jusque dans la capitale (où il avait d’ailleurs reçu un accueil triomphal), on décida tout bonnement de l’arrêter. On n’avait d’abord pensé qu’à l’enfermer dans une prison quelconque, afin que l’engouement des foules retombât un peu, mais les prêtres, qui étaient plus hargneux que les juges et les policiers réunis et qui craignaient surtout pour leur petit commerce (car ce fils de Dieu, devenu complètement fou, avait osé affirmer qu’il valait mieux aimer son prochain que d’apporter des présents au temple), ne l’entendirent pas de cette oreille. Ils manœuvrèrent si bien auprès des autorités (lesquelles avaient sans doute quelques dettes à leur égard, car on sait que la religion est parfois fort utile pour inciter les gens à se résigner et à renoncer aux revendications les plus légitimes) qu’on décida purement et simplement d’éliminer ce fils de Dieu si encombrant. Après un jugement sommaire, l’exécution fut donc décidée. La foule, retournée par quelques sermons bien ajustés, applaudit des deux mains, ce qui laisse quand même rêveur si on réfléchit à son inconstance et sa versatilité. Le plus surprenant, ce fut en fait l’attitude de notre mage lui-même. Alors qu’il n’était jamais à court d’arguments et qu’il était passé maître dans l’art de manier la parole devant un public, là il resta complètement muet devant ses juges. Avait-il compris que l’issue de cette affaire était déjà décidée et qu’il ne servait plus à rien de se défendre ? S’était-il imaginé que le peuple allait se soulever et venir le libérer, ce qui aurait encore accru son prestige ? Ou bien avait-il fini par croire lui-même à toutes les histoires qu’il avait racontées et considérait-il qu’il était temps d’en finir et de rejoindre celui qu’il appelait son père et qui n’était autre que Dieu lui-même (lequel, après tout, le sauverait peut-être à la dernière minute) ? Ou bien encore avait-il pensé que ses parents, une dernière fois, allaient surgir au bon moment pour le ramener à la maison ? Difficile à dire. Tout ce que l’on sait c’est qu’il fut exécuté avec quelques brigands qui comme lui avaient l’habitude de traîner sur les chemins.
On n’aurait plus jamais entendu parler de lui si ses compagnons n’avaient tenté de conserver sa mémoire. Qu’auraient-ils pu faire d’autre, les pauvres ? Subitement privés de ressources, ils continuèrent d’aller de village en village, expliquant que la disparition physique de leur maître n’enlevait rien à la pertinence de son message : plutôt que de se calfeutrer chez soi et de vivre sur un tas d’or, il valait mieux ouvrir sa porte et partager ses richesses avec les plus démunis. Et tout en rappelant ces belles paroles, ils tendaient humblement la main. On dit qu’il se trouvait toujours quelqu’un pour y glisser une petite pièce.

Palestine
09:05 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, un conte de noël
29/12/2009
Un conte de Noël (suite)
Mais revenons à cet enfant, car c’est lui le sujet de notre histoire. Des parents souvent absents, un soupçon d’illégitimité sur les épaules, il ne pouvait que tourner mal, par réaction. Et puis avec tout ce qu’il entendait comme rumeur sur sa génitrice, il n’y avait pas de raison qu’il la respecte. Alors il faisait les quatre cents coups, un peu par malice, un peu pour attirer l’attention. Ses copains le méprisaient car ils savaient qu’il n’y avait pas beaucoup d’argent chez lui et ils ne se privaient pas de lui dire comment sa mère arrondissait les fins de mois. Le lieu de sa naissance avait même donné lieu à une légende. On prétendait qu’il était né dans une ferme à l’abandon. Et tout le monde de rire en imaginant le bébé coincé entre les ânes et les bœufs, tout nu sur la paille et maculé de bouse de vaches. Lui, à la longue d’entendre toutes ces méchancetés, s’était endurci et il avait même fait de sa pauvreté légendaire la base de sa réputation. D’accord, il n’était qu’un bâtard, mais un bâtard qui savait ce qu’il voulait. A douze ans il était ainsi devenu un chef de bande respecté, qui avait su asseoir son autorité sur sa seule valeur et non sur un quelconque prestige familial.
Il organisait de petits vols dans les magasins et revendait sa marchandise en douce. Pour l’aider dans cette entreprise, il avait donc constitué une petite équipe de quatre garnements lesquels lui vouaient une admiration sans borne. Il faut dire qu’il savait s’y prendre pour imposer son point de vue et même devant les autorités il ne baissait pas la tête. Ainsi, une fois qu’un commerçant, le soupçonnant de quelque larcin, l’avait conduit devant un prêtre, afin qu’il lui fasse la morale, il était parvenu à détourner la conversation et à orienter le débat sur des questions religieuses. A la fin, ils étaient au moins dix prêtres à discuter, le livre sacré ouvert devant eux, mais lui n’était pas du tout impressionné. Au contraire, il argumentait à partir des extraits qu’on lui lisait et il aurait fini par convaincre tout le monde que le vol était légal car Dieu voulait que tous les hommes, ses enfants, soient traités sur un pied d’égalité. Or certains sont riches, disait-il et d’autres sont pauvres et cela par la faute de la société. Jamais l’Etre suprême n’a pu vouloir une telle situation. En volant, concluait-il, je ne fais que rétablir l’équilibre au profit des plus pauvres, autrement dit des gens comme moi. Les prêtres, bien entendu, étaient offusqués en entendant de tels propos et ils cherchaient dans leurs écrits un passage qui prouvait que Dieu non seulement autorisait la richesse mais même qu’il préférait les personnes riches et honnêtes aux misérables pauvres et chapardeurs. Le problème, c’est qu’un tel passage, ils avaient du mal à en trouver un dans le livre de la Loi et lui, pendant ce temps-là, il continuait à argumenter et à tenter de prouver que Dieu ne pouvait pas approuver une richesse acquise malhonnêtement, sur le dos des plus pauvres, même si cela s’était fait légalement. A la fin, quand ses parents, qui une fois de plus étaient à sa recherche, le retrouvèrent, il était assis tranquillement au milieu des grands prêtres, pendant que ceux-ci se disputaient méchamment sur la manière dont il fallait interpréter le texte sacré. Rien d’étonnant, après de tels exploits, qu’il suscitât l’admiration chez les petits voyous de son espèce.
Plus tard, comme on s’en doute, il a assez mal tourné. Comme il n’aimait pas trop le travail et qu’il avait été habitué à obtenir de l’argent facilement, il a continué dans cette voie. Au lieu de se trouver un métier honnête comme son père, il a préféré courir les chemins et vivre d’expédients. En fait, adulte, il a reproduit ce qu’il avait déjà fait enfant, c’est-à-dire qu’il a débauché quelques pêcheurs illettrés et un peu naïfs pour se constituer une petite cour de fidèles qui l’aidaient dans ses entreprises louches. Dans un premier temps, ils avaient vécu de rapine, mais très vite il comprit qu’ils finiraient tous par avoir des ennuis avec les autorités s’ils persistaient dans cette voie. Alors, plus subtilement, il s’est fait passer pour une sorte de mage, qui savait prédire l’avenir. Il rentrait dans les villages avec toute sa troupe et il se mettait à haranguer les foules, parlant de Dieu et de ses bienfaits qui tardaient un peu, en effet, à se manifester, puis il rassurait tout le monde en expliquant que tout cela n’était qu’une question de temps et que bientôt les pauvres n’auraient plus faim tandis que les riches tireraient le diable par la queue. Les gens l’écoutaient, mi-amusés, mi-intrigués, mais finalement, au fond d’eux-mêmes, tout ce qu’il disait là leur plaisait bien. Cela signifiait que sans s’en rendre bien compte lui-même, notre brigand se transformait en agitateur politique et qu’après son départ les villageois se mettaient à rêver d’un monde meilleur, où la vie serait plus facile et surtout plus juste.
(à suivre)
08:49 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : littérature, un conte de noël
26/12/2009
Un conte de Noël
Ce n’était pas un mauvais garçon, on ne peut pas dire cela, mais il avait quand même passé toute son enfance dans les rues, à traîner et à chaparder ici ou là. C’est vrai que ses parents n’étaient pas bien riches, mais enfin ce n’est pas une raison suffisante et nous connaissons tous des personnes peu argentées qui s’occupent admirablement de leurs enfants. Ils les éduquent, les poussent à aller à l’école et tentent de les mettre sur le droit chemin. Ici, ce n’était pas vraiment le cas. Le père était menuisier-ébéniste et ma foi il avait peu de temps à consacrer à son fils. Toujours à travailler dans son atelier, jusqu’à des dix heures du soir en été, il faisait visiblement ce qu’il pouvait pour nourrir sa petite famille. Il faut croire cependant qu’il n’y arrivait pas vraiment car son épouse louait ses services comme femme d’ouvrage un peu partout dans la ville, manifestement pour arrondir les fins de mois. Elle était courageuse, la brave dame, mais du coup elle n’était pas souvent à la maison non plus et on sait ce que cela veut dire. Quand le gamin rentrait de l’école et qu’il ne trouvait personne pour lui offrir un biscuit ou un verre de lait, il ressortait aussitôt, laissant là les devoirs et les leçons. Souvent quand la mère rentrait après ses ménages, vers les huit heures du soir, elle devait encore se mettre à arpenter les rues à sa recherche. Elle le retrouvait habituellement sur la place, en train de s’encanailler avec une bande de vauriens. Elle le réprimandait un peu, pour la forme, puis le ramenait toute contente à la maison, heureuse de l’avoir récupéré aussi vite.
Malheureusement, il n’en allait pas comme cela tous les soirs et il arrivait (les voisins pourraient encore en témoigner) qu’on voyait les deux parents, la mère et son menuisier de mari, en train d’arpenter les rues et les champs des alentours à la recherche de leur fils et cela jusqu’à une heure avancée de la nuit. Parfois ils le retrouvaient juché au sommet d’un arbre ou bien dissimulé dans une grotte. Dans ces cas-là le chenapan ne faisait aucun bruit dans l’obscurité et laissait d’abord ses parents passer plusieurs fois à deux mètres de lui avant de se décider à manifester sa présence. Il y avait donc bien longtemps que la nuit était tombée quand ces pauvres gens retrouvaient enfin leur rejeton. C’est à coups de bâton que le père ramenait alors le fils « prodigue » à la maison et tout le monde savait qu’ils l’avaient retrouvé rien qu’en entendant les cris du petit, qui hurlait comme un cochon qu’on égorge. Personne ne disait rien et tout le monde laissait faire car enfin ce n’était tout de même pas normal de faire enrager ainsi ses parents tos les soirs. A la limite, chacun était content d’entendre les fameux cris, cela voulait dire que le vaurien avait été retrouvé et que le voisinage n’avait plus à s’inquiéter. C’est qu’à cette époque et dans une petite ville comme celle-là, tout le monde s’occupait de vos affaires en permanence et la vie privée était quasi publique. Qu’une femme soit enceinte et tout le quartier était au courant avant même que le mari ne le soit. Et si une autre trompait son époux, cela se savait aussi bien entendu, cela se disait, se répétait et à la fin cela prenait des proportions gigantesques.
Que n’avait-on pas dit, d’ailleurs, sur la femme du menuisier. Les pires horreurs, vous n’imaginez pas ! Certains assuraient qu’elle ne faisait pas que des ménages dans ces familles riches où elle allait nettoyer. Les uns pensaient qu’elle monnayait ses charmes (car elle était particulièrement mignonne, la petite) mais d’autres, plus piquants, soutenaient carrément qu’elle faisait cela par vice. Dans le fond, personne ne savait rien de précis, mais la rumeur avait fini par prendre une telle ampleur que chacun restait convaincu que la petite dame du menuisier menait une mauvaise vie. On avait même été jusqu’à dire que son chenapan d’enfant n’était pas le fils de son père. Et c’est vrai qu’il ressemblait bien peu au menuisier, tant par le physique que par son manque de goût pour le travail, mais bon, ce sont des choses qui arrivent souvent sans que pour autant on puisse en conclure grand chose. Dans notre histoire, pourtant, il s’était trouvé des voisines pour se souvenir que l’accouchement n’avait pas eu lieu ici, dans la ville, mais bien loin, à l’autre extrémité du pays. Or, on ne fait pas un tel mystère quand il n’y a rien à cacher, non ? Il n’en avait pas fallu davantage pour décréter que cet enfant était illégitime et qu’en un mot le pauvre artisan ébéniste était carrément cocu. Tout le canton le savait, sauf lui, bien entendu, qui continuait à s’acharner sur son travail jusqu’à des dix heures du soir, comme je l’ai déjà dit. Cela faisait mal au cœur quand on passait devant l’atelier et qu’on l’entendait raboter ou scier sans relâche. « A quoi bon » disaient les gens, « si c’est pour nourrir une femme infidèle, une traînée quoi et un enfant qui n’est même pas le sien ? »
(à suivre)
00:31 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, un conte de noël
23/12/2009
Revenir
Ainsi donc, il passait le plus clair de son temps à déambuler dans les lieux où il avait vécu. Déçu par ce fameux paradis dont on lui avait tant vanté les merveilles depuis sa plus tendre enfance, il préférait se promener dans les endroits qu’il avait aimés autrefois. C’est qu’il avait du temps pour flâner, maintenant, il n’y avait pas à dire ! C’est carrément l’éternité qu’il avait devant lui ! Mais jouir de l’éternité, c’est bien, certes, mais encore faut-il être vigilant et ne pas se laisser gagner par l’ennui… Il convient donc de s’occuper, sinon on risque de sombrer dans la mélancolie et pour longtemps encore. Se laissant guider par sa mémoire, il retournait donc dans les lieux qu’il avait connus, tentant de faire revivre en lui les impressions qu’il y avait éprouvées.
Parfois, rien n’avait changé et il lui arrivait même de croiser quelques protagonistes du temps de sa jeunesse. Bien sûr ils avaient vieilli et on comprenait, rien qu’à les regarder, qu’ils se rapprochaient eux aussi de l’issue fatale, mais le fait de les voir là, en chair et en os, en train de vaquer à leurs occupations, renforçait l’illusion que lui-même était encore en vie. Certes, il passait inaperçu au milieu d’eux, mais il lui semblait toujours qu’il aurait pu s’arrêter, leur mettre une main sur l’épaule et leur parler. « Comment vas-tu Jacques ? » « Et toi, Henri, toujours passionné par l’océan et ses lointains inaccessibles ? » «Tiens, Jean, c’est bien toi ? Et la petite Myriam, tu as fini par l’épouser, hein, sacré coquin ? » Certes, de telles conversations étaient impossibles, il le savait bien, mais à chaque fois il avait l’impression qu’il s’en serait fallu d’un rien pour que tout recommence comme avant. Ce n’était qu’une illusion, mais une illusion qui le rendait heureux et ma foi cela valait mieux que de s’ennuyer ferme dans le triste paradis du Bon Dieu.
D’autres jours, par contre, ses pas l’amenaient dans des endroits qu’il ne reconnaissait plus et c’était alors un choc car il se rendait compte qu’il avait beau être immortel, une partie de lui n’en avait pas moins irrémédiablement disparu. C’était alors comme s’il était mort une seconde fois. Comme ce jour où il se retrouva dans la prairie où avait été construite son école primaire. Il n’y avait plus rien, rien que des herbes même pas fauchées. C’était devenu un lieu sauvage, rendu à la nature. Les petits baraquements en bois où il avait appris à lire et à écrire s’étaient littéralement volatilisés, comme s’ils n’avaient jamais existé. Pourtant, que de souvenirs conservait-il en lui et comme tous les moments qu’il avait passés là lui étaient chers !
Il se revoit, suçotant son crayon tout en regardant, admiratif, ces étranges hiéroglyphes que le maître traçait au tableau noir. Et il se souvient parfaitement de son émerveillement quand, plus tard, il put commencer à déchiffrer ces étranges signes, qui se mirent subitement à former des phrases et, ô miracle, à prendre un sens. Et voilà que tout cela avait disparu, comme si cela n’avait jamais existé. Et le vieux maître, où était-il maintenant ? Mort aussi, évidemment. Pourtant, il lui semblait encore le voir faire la lecture devant la classe et raconter l’histoire de la chèvre de Monsieur Seguin, qui se battait  courageusement toute la nuit pour échapper à son destin et aux crocs du loup affamé. Mais à la fin elle se couchait, la pauvre Blanquette et le loup la dévorait. C’est sans doute la même chose qui était finalement arrivée au cher instituteur. Un soir, fatigué de tous ces cours qu’il avait donnés pendant autant d’années, il s’était couché dans son lit et ne s’était plus jamais relevé. Il avait attendu là, sans rien dire, que la nature fasse son travail et que la vie se retire discrètement. Il l’avait sentie qui s’en allait, lentement mais sûrement ; ce froid qui montait dans les jambes, ce pouls qui semblait ralentir… A certains moments, il se révoltait encore et tentait de prendre un livre déposé sur la table de nuit, afin de continuer à lire l’histoire qu’il avait commencée quelques semaines plus tôt, au début de sa maladie. Lire, c’était encore vivre, aller de l’avant, progresser avec des personnages, découvrir ces pays merveilleux où il n’était jamais allé, si ce n’est en rêve. Et puis un matin, à l’aube, fatigué par une longue nuit d’insomnie, il n’avait plus résisté et la mort l’avait pris là, épuisé d’avoir mené autant de luttes, résigné pour la première fois.
courageusement toute la nuit pour échapper à son destin et aux crocs du loup affamé. Mais à la fin elle se couchait, la pauvre Blanquette et le loup la dévorait. C’est sans doute la même chose qui était finalement arrivée au cher instituteur. Un soir, fatigué de tous ces cours qu’il avait donnés pendant autant d’années, il s’était couché dans son lit et ne s’était plus jamais relevé. Il avait attendu là, sans rien dire, que la nature fasse son travail et que la vie se retire discrètement. Il l’avait sentie qui s’en allait, lentement mais sûrement ; ce froid qui montait dans les jambes, ce pouls qui semblait ralentir… A certains moments, il se révoltait encore et tentait de prendre un livre déposé sur la table de nuit, afin de continuer à lire l’histoire qu’il avait commencée quelques semaines plus tôt, au début de sa maladie. Lire, c’était encore vivre, aller de l’avant, progresser avec des personnages, découvrir ces pays merveilleux où il n’était jamais allé, si ce n’est en rêve. Et puis un matin, à l’aube, fatigué par une longue nuit d’insomnie, il n’avait plus résisté et la mort l’avait pris là, épuisé d’avoir mené autant de luttes, résigné pour la première fois.
Avait-il seulement existé ? La disparition de l’école laissait planer un doute… En réalité, il ne survivait plus que dans la mémoire de son élève mais le fait que celui-ci fût déjà mort réduisait la consistance de ce souvenir à pas grand chose. Quant à cet enseignement auquel le vieux maître avait consacré toute son existence, qu’en restait-il, finalement ? Un cahier d’écolier oublié dans un grenier, peut-être, et puis ces regrets du temps passé, exprimés par un fantôme. Autant dire rien du tout. C’était pourtant sur cette transmission du savoir qu’il avait bâti toute sa vie, y puisant non seulement la force de continuer mais même y cherchant la seule justification de son passage sur terre. Tout cela en pure perte, puisque tout avait disparu, le maître, l’élève et même la petite école en bois.
00:36 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
05/12/2009
Instant d'éternité
Finalement, ce n’était pas si terrible d’être mort. Sa vie (si l’on peut dire), s’écoulait calme et tranquille. Certes, il ne parvenait pas à lire, ne sachant plus tourner les pages, mais il pouvait par contre jouir du soleil et se promener le long du fleuve sans se faire remarquer, ce qui était tout de même appréciable. Parfois, durant les longues après-midi d’été, il s’asseyait sur un banc et restait là à contempler l’écoulement régulier de l’eau. C’était une manière comme une autre de comptabiliser le temps qui passe et de mieux apprécier l’éternité dont il jouissait maintenant. Il regardait aussi les femmes qui marchaient sur le chemin et qui étaient loin de soupçonner sa présence. Il les trouvait belles, terriblement belles et ne pas pouvoir le leur dire gâchait tout de même son plaisir. Mais le plus dur, c’était le matin, au réveil, quand il voulait se contempler dans un miroir et qu’il n’apercevait plus son image. Cela lui faisait un choc à chaque fois, il n’y a pas à dire. Même chose le soir, quand le soleil rasait l’horizon et qu’il cherchait en vain son ombre devant lui, là où elle aurait dû se trouver et là où elle n’était plus.

01:12 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature
30/11/2009
Réflexions posthumes
Certes, il était mort, mais qu’est-ce que cela changeait, finalement ? Il retrouvait ici les mêmes injustices que celles contre lesquelles il avait lutté toute sa vie et la seule différence, en fait, c’est qu’il n’y avait plus aucun espoir de changement. En ce lieu, la corruption et le passe-droit étaient institutionnalisés pour l’éternité. Comment conserver le moral dans de pareilles conditions ?
Il repensait à toutes ces belles pages de la bible qu’on lui faisait lire quand il était enfant et qui revenaient toutes à dire que les premiers seraient les derniers et inversement. Une belle foutaise, oui ! Il suffisait de les voir arriver, les nouveaux trépassés… Un peu perdus le premier jour, comme tout le monde, certes, et pas trop à l’aise dans leur nouvel habit. Mais après une semaine les jeux étaient faits. Ceux qui avaient laissé des richesses sur terre les faisaient valoir pour obtenir de menus avantages tandis que les autres, les roublards, les sophistes, les arrivistes, se débrouillaient déjà pour être les premiers dans les files d’attente. Après un mois, on les retrouvait tous à des postes enviables. Les uns étaient devenus de grands chefs, autrement dit de parfaits petits tyrans, d’autres jouissaient en toute impunité des biens immobiliers que le Très-Haut leur avait confiés, d’autres encore étaient devenus célèbres d’une manière ou d’une autre et les foules, toujours aussi stupides, leur portaient une admiration sans borne.
Les politiciens continuaient à faire de la politique, ce qui revenait à gérer bien peu les affaires publiques et à parler beaucoup pour se faire remarquer, tandis que les écrivains les plus en vue s’étaient tous transformés en historiographes officiels. Leur rôle consistait à transcrire sur l’ordinateur central tous les faits et gestes de ce petit monde, ce qui devait être un peu fastidieux, il faut bien le reconnaître, mais la récompense était sans commune mesure avec le peu d’efforts qu’ils avaient dû fournir. Lors des dîners officiels, ils se retrouvaient assis à la droite de Dieu, ce qui déjà n’était pas rien, mais en plus ils continuaient à gérer leurs affaires terrestres. Leurs livres continuaient à se vendre dans les grandes surfaces de France et de Navarre, leur rapportant de substantiels bénéfices et ils s’arrangeaient bien pour faire éditer leurs œuvres posthumes, histoire d’entretenir dans la mémoire des hommes le souvenir qu’on avait d’eux.
Respectés de tous, au ciel comme sur la terre, ils passaient leur temps à se quereller entre eux, imaginant, pour se départager, des prix littéraires aussi futiles que prestigieux. Le jeu consistait à composer des jurys sur mesure et à acheter les électeurs, ce qui est particulièrement facile quand on a de l’argent et qu’on se sait soutenu par le pouvoir en place. Evidemment, il y avait toujours un zozo ou l’autre pour croire que ces prix étaient honnêtes et qu’ils récompensaient le talent. On voyait donc des écrivains dits de seconde zone passer des nuits entières dans le froid de leur mansarde à essayer de composer des poèmes épiques. Ils alignaient ainsi dix mille vers octosyllabiques assonancés dans lesquels ils dépeignaient les souffrances qu’ils avaient endurées durant leur vie terrestre. D’autres, aussi fous qu’eux, parlaient du pays de leur enfance, là-bas, au bord de l’océan ou bien ils décrivaient dans des nouvelles sublimes leur apprentissage de la vie le long d’une Dordogne de rêves. Evidemment, aucun de ceux-là ne remportait le prix et ce dernier était décerné, comme il se doit, à celui qui en avait été l’instigateur, le mécène et le grand argentier.
Bref, ce fameux paradis dont on avait tant parlé était franchement décevant car il ne faisait que fixer pour l’éternité tous les travers contre lesquels le héros de cette histoire s’était battu de son vivant. En réalité, il avait eu beau s’insurger contre l’injustice, il n’avait pas obtenu beaucoup de succès. Pour être franc, il n’en avait même obtenu aucun, de succès. Et puis dans le fond il ne s’était pas vraiment battu non plus. Disons plutôt qu’il avait beaucoup réfléchi, beaucoup écrit, qu’il s’était emporté souvent contre l’iniquité ambiante, qu’il avait souffert de l’état déplorable du monde, mais finalement tout cela n’avait servi strictement à rien. Ce même monde avait continué à tourner et à être dirigé par quelques cyniques sans foi ni loi. Certes, il ne s’était jamais fait aucune illusion sur la situation et s’était plutôt réfugié dans une sorte d’espoir, attendant un changement futur, toujours possible. Et voilà que non seulement il était mort sans qu’aucun de ses rêves ne se fût réalisé, mais en plus il devait bien constater maintenant que tout cela avait été vain. Pourquoi avait-il vécu en fait ? Pour rien, strictement pour rien. Il avait cru pouvoir modifier la société, mais c’était impossible et c’était la petite lumière qui brillait en lui qui était finalement incongrue. Dans la dichotomie qui séparait sa vision personnelle des choses du monde ambiant, force était de reconnaître maintenant que c’est lui qui avait eu tort puisque même Dieu en son paradis donnait raison à ses ennemis.
Le plus dur, en fait, ce n’était ni cette déception, ni la conscience d’avoir eu tort, mais l’impossibilité où il se retrouvait de conserver le moindre rêve. Tant qu’il avait été sur terre, en effet, il avait pu croire en un ailleurs, mais il devait bien reconnaître maintenant que cet ailleurs était le fruit de son imagination. Le monde idéal auquel il aspirait dans son cœur, ce monde où la beauté et l’amour auraient été présents, n’existait tout simplement pas. Il avait bâti sa vie sur une illusion et l’attitude de Dieu, maintenant qu’il le voyait bien à l’œuvre, était là pour lui rappeler jusqu’à quel point il s’était fourvoyé.
Comment vivre sans rêves ? C’était la question qu’il se posait désormais et pour un peu, devenu mélancolique, il aurait voulu trouver refuge dans le suicide. Mais comment se suicider quand on est déjà mort ? C’était impossible ! Et comment être pour l’éternité un fantôme sans espoir ? C’était tout aussi impossible. C’est alors qu’il comprit ce qu’était l’enfer et comme ce terme n’était pas un vain mot. L’enfer, c’était l’absence de rêve et la soumission aux lois iniques des autres. L’enfer, c’était comprendre que la petite flamme qui l’habitait n’avait pas de raison d’être et qu’il devrait ressasser cette idée jusqu’à la fin des temps. Alors il sut qu’il était vraiment mort.

00:30 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (30) | Tags : littérature
28/10/2009
Le coffre magique (suite et fin)
Nous nous approchions tous pour contempler le trésor. Rangés en piles régulières, sagement alignés, les livres étaient là. Il y en avait de tous les formats et de toutes les dimensions : des grands, des petits, des épais, des très fins… Certains avaient une couverture austère, faite de cuir brun usé où le nom de l’auteur et même le titre étaient illisibles. Il fallait alors aller les découvrir sur la tranche, quand les vieilles lettres d’or ne s’étaient pas effacées. D’autres au contraire, plus modernes, étalaient mille couleurs chatoyantes et offraient même des images ravissantes représentant des îles tropicales couvertes de forêts vierges ou de splendides voiliers en route pour de mystérieuses découvertes.

Nos préférés étaient ceux de la Bibliothèque verte, où nous retrouvions nos auteurs favoris, comme ce Jules Verne à l’imagination débordante. C’était un réel plaisir que de parvenir à s’emparer de « Vingt mille lieues sous les mers », de « L’île mystérieuse » ou « Des enfants du capitaine Grant ». Pour cela, il fallait être rapides, car les plus âgés, s’aidant de la force que la nature leur avait octroyée, n’hésitaient pas à nous bousculer un peu pour s’emparer de ces merveilles. Complètement vaincus et désabusés, n’ayant même pas eu le temps de tendre la main vers un de ces Jules Verne tant convoités, nous nous rabattions vite sur « Les lettres de mon moulin » de Daudet ou sur « La gloire de mon père » de Pagnol. A notre tour nous poussions les plus petits, allant jusqu’à leur reprendre des mains le précieux livre qu’ils tenaient déjà. Pris de remords et voulant pouvoir nous adonner à notre lecture sans arrière-pensées, nous leur trouvions au fond du coffre une de ces bandes dessinées que nous connaissions par cœur pour les avoir lues mille fois, comme « Le trésor de Rackham le rouge » ou « L’étoile mystérieuse » d’Hergé. Certes, ces livres n’étaient plus dignes de nous, mais ils avaient fait notre bonheur les années précédentes et après tout ils conviendraient très bien pour ces cousins qui étaient encore dans la prime enfance.
Parfois une dispute éclatait, alors c’était le rôle du capitaine de s’intercaler entre les belligérants et de tenter d’apaiser le conflit. Un bon capitaine se reconnaissait à cette capacité de trancher directement dans le vif du sujet, allant parfois jusqu’à priver les deux adversaires du livre convoité. Son âge ne faisait rien à l’affaire car en fait il semblait tenir son autorité de l’ensemble du groupe. C’est que nous étions venus pour lire en silence et il n’était pas question que des trouble-fête viennent gâcher notre plaisir. Le capitaine du jour le savait et, sûr de notre soutien si les choses tournaient mal, il n’hésitait pas à se montrer plus viril qu’il ne l’était en réalité, grossissant sa voix ou levant un doigt réprobateur. Souvent, un simple regard suffisait à calmer les esprits les plus enflammés et bientôt nous étions tous plongés dans la lecture, assis tranquillement en tailleur sur nos tapis élimés.
La grand-mère ayant des siestes assez longues, nous disposions en moyenne de deux bonnes heures pour vivre des aventures fabuleuses en compagnie de nos héros préférés. A la fin, nous étions tellement pris par l’histoire, que nous nous identifions complètement aux personnages. C’est ainsi que lorsqu’une pirogue chavirait au milieu des crocodiles, nous devions étouffer un cri de terreur et il nous semblait presque sentir le contact d’une peau rugueuse et froide contre notre propre épiderme. Ou bien, quand l’hélice du soumarin restait malencontreusement coincée dans une touffe d’algues géantes, nous manquions aussitôt d’oxygène, évidemment, et nous comptions les minutes qui nous restaient à vire…

Les plus beaux livres étaient assurément ceux qui nous entraînaient au bout du monde et qui nous faisaient découvrir des îles enchantées, couvertes d’une végétation luxuriante, où ne vivaient que des bêtes sauvages et des Indiens inconnus. Des dessins représentaient ces derniers devant la mer, courant quasi-nus sur des plages infinies et notre regard s’attardait parfois sur une belle Indienne dont la robe mal attachée laissait apercevoir la face latérale d’un sein. Notre imagination n’avait alors plus de bornes et nous sortions de l’histoire proprement dite pour la réinventer à notre manière. Un pirate renégat surgissait de nulle part et s’en prenait à la pauvre jeune fille, dont la robe se détachait presque dans la bagarre. Nous nous interposions aussitôt, par l’intermédiaire de notre héros, pour défendre la malheureuse et tuer d’une flèche empoisonnée le perfide agresseur, non sans jeter un coup d’œil langoureux sur cette poitrine subitement dénudée même si elle ne l’était que dans notre imagination.
Nous affrontions tous les naufrages et mille fois nous nous sommes retrouvés à bord de navires à la dérive, secoués par les flots et sombrant finalement dans une mer déchaînée. Nous échouions alors sur une plage inconnue, désespérément seuls et ne sachant comment affronter une nature certes merveilleuse et foisonnante mais aussi particulièrement dangereuse. Car la mort était partout et la moindre promenade dans la forêt profonde vous mettait en présence d’un tigre affamé ou d’un anaconda gigantesque aux anneaux implacables. Les précipices étaient nombreux, les plantes vénéneuses aussi et c’était un véritable miracle, finalement, d’être encore vivants au bout de nos deux heures de lecture.
Traditionnellement, le dernier quart d’heure consistait à lire un extrait à voix haute. C’est ainsi que nous fîmes connaissance avec l’implacable Javert, (qui, dans les Misérables, n’en finissait plus de pourchasser le pauvre Jean Valjean) et que découvrîmes la belle Esméralda (comme elle nous enivrait, quand elle dansait devant les tours de Notre-Dame !). Un autre jour, c’est D’Artagnan qui faisait irruption dans le grenier, à la recherche des bijoux de la reine. Les descriptions de Dumas étaient si vivantes qu’on croyait entendre son pas alerte sur le vieux plancher, tandis que sa rapière traînait par terre. Puis les trois mousquetaires, Athos, Portos et Aramis, entraient avec fracas et cela faisait de grands éclats de rires à vous couper le souffle. Les jours de pluie, c’est le comte de Monte Christo qui s’invitait, méditant une vengeance implacable, tout en se dissimulant derrière les gros troncs d’arbre à peine équarris qui servaient de piliers à la toiture. On vit aussi le Bossu, le capitaine Nemo, Shéhérazade, les quatre fils Aymon, le chevalier Lancelot ou encore Morange, à la recherche de l’Atlantide et même le preux Roland, comte de la Marche de Bretagne et neveu de Charlemagne. Cela faisait du monde, tout cela, mais le grenier était vaste et notre désir de découvertes encore plus grand. C’est que chacun de ces personnages amenait avec lui le pays où il vivait et c’est ainsi que nous connûmes la cour des miracles et tout le Moyen-Age, la Gascogne chantante de Louis XIII, le Paris misérable du XIX°, les sables brûlants d’Afrique du Nord, la Meuse légendaire et les ports basques des Pyrénées.
Petit à petit, l’univers que nous ouvraient les livres fit partie de notre être intime au point que manquer à la séance du grenier aurait été le pire malheur qui soit. Nous lisions ou nous écoutions avec une attention incroyable, cherchant à deviner la suite de ces histoires toutes aussi captivantes les unes que les autres. Nous ne savions pas encore que tout cela s’appelait de la littérature, comme nous ne savions pas que derrière les histoires racontées se cachait un message autre, mais déjà les livres étaient devenus pour nous tous comme un besoin vital et c’est bien à ce coffre magique que nous devons d’avoir eu une enfance merveilleuse sans jamais quitter notre village.
Quand les deux heures fatidiques étaient écoulées, nous rangions les précieux volumes à leur place, chacun tentant de dissimuler le sien en dessous d’une pile, dans l’espoir de pouvoir le récupérer une autre fois et d’en poursuivre ainsi la lecture. Quand tout était en ordre, le capitaine refermait précautionneusement le couvercle du fameux coffre et nous reprenions en silence le chemin du rez-de-chaussée. En repassant par la chambre où les pommes continuaient d’embaumer, nous jetions un regard discret par la fenêtre, pour voir si tout était calme. Il suffisait ensuite de redescendre l’escalier et de reprendre notre place devant nos dessins inachevés. Quand enfin la grand-mère se réveillait, elle nous trouvait en train de terminer sagement un croquis de Notre-Dame de Paris ou une île tropicale à la plage infinie. Si elle avait mieux regardé, elle aurait vu que sur cette plage marchait, rêveuse, une belle Indienne, avec son regard triste tourné vers l’océan infini.

16:13 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature
25/10/2009
Le coffre magique (suite)
Nous continuions donc notre progression en rangs serrés. Arrivés à l’extrémité Sud du grenier, nous nous retrouvions devant une petite porte basse, à côté de laquelle se dressait un miroir poussiéreux qui nous renvoyait une étrange image de nous-mêmes, comme si nous avions surgi d’un passé éloigné ou comme si nous avions été notre propre fantôme. Nous avions alors l’impression d’avoir déjà vécu ailleurs, en d’autres lieux, à une époque indéterminée. Cette rencontre avec le reflet de notre propre mort n’avait rien de réjouissant et c’est bien vite que nous ouvrions la petite porte pour pénétrer dans le deuxième grenier, tout différent du premier. On se trouvait ici directement au-dessus de la boulangerie et une fenêtre à croisillons donnait sur la cour intérieure de la maison. Cette pièce ressemblait donc plus à une chambre désaffectée qu’à un véritable grenier. A terre, sur de vieux journaux, s’étalaient des pommes de toutes les couleurs, entreposées là pour l’hiver. Leur odeur acide emplissait les lieux d’un parfum étrange, quelque peu troublant, qui nous enivrait et nous faisait rêver aux mystères de la terre, à la jeune sève qui montait dans les branches, aux abeilles fécondantes et aux fruits qui bientôt allaient mûrir sous les soleils d’un été infini.
Un rapide coup d’œil en contre-bas, dans la cour intérieure, nous rassurait : l’alerte n’avait pas été donnée, signe que notre disparition n’avait pas encore été remarquée. Nous pouvions donc continuer notre progression, aussi fiers de notre tactique militaire que des guerriers iroquois sur le sentier de la guerre.
Une autre porte s’ouvrait dans un des murs blancs, peints à la chaux. Il suffisait de descendre trois petites marches et nous nous retrouvions enfin dans le saint des saints, le grenier secret où jamais personne ne venait, à part nous bien entendu. Nous refermions donc la porte avec précaution et tirions le verrou que nous avions installé lors des grandes vacances précédentes. Isolés du monde, aussi introuvables que des fourmis dans un tas de feuilles mortes, nous pouvions alors jouir de ce lieu qui n’était qu’à nous. En fait, à part quelques vieux tapis qui nous permettaient de nous asseoir, il n’y avait rien ici, rien qu’un très vieux coffre en chêne qui occupait le centre de la pièce. Si des adultes étaient parvenus à pénétrer en ce lieu (chose absolument impossible donc), ils n’auraient certainement rien compris à notre enthousiasme. C’est que le secret de l’énigme se trouvait dans le coffre-même et c’est bien pour son merveilleux contenu que nous avions fait tout ce chemin et pris tous ces risques.
Certains prétendaient qu’on l’avait retrouvé sur une plage, un jour de tempête d’équinoxe, et qu’il avait dû appartenir au capitaine d’une bande de corsaires. D’autres étaient d’accord avec cette histoire de corsaires, mais ils pensaient plutôt que le coffre était arrivé jusqu’à nous par le biais d’un héritage, ce qui conférait à notre famille une origine certes douteuse mais ô combien glorieuse et merveilleuse. Cette version était fort séduisante, mais d’autres encore, plus réalistes et un peu rabat-joie, affirmaient prosaïquement que le coffre avait tout bonnement été acheté dans une brocante par le grand-père dont on pouvait encore admirer la photographie dans le salon. C’est probablement cette version qui était la bonne, mais c’est aussi celle qui rencontrait le moins d’adhésion. Comme on le pense bien, cette idée d’avoir pour ancêtres de véritables pirates plaisait à beaucoup d’ente nous. Nous imaginions des courses sur l’écume au cœur des Caraïbes, des abordages sanguinaires, des combats au couteau et finalement la mise à sac de quelque cargaison d’or et d’épices. Les marchands, à genoux, imploraient grâce devant ces marins sans foi ni loi, au regard fier et au cœur ténébreux. D’un geste débonnaire et un peu méprisant, ils accordaient la vie à ces sous-hommes qui avaient misé sur le négoce pour faire fortune et qui, sans prendre de risques exagérés, revendaient bien cher à de pauvres gens les denrées qu’ils avaient achetées à vil prix auprès de plus pauvres encore. Pour l’exemple, avant de quitter le navire, les pirates en trucidaient tout de même un ou deux, histoire de montrer que la vie est remplie d’imprévus et que ce n’est pas avec de l’or qu’il convient de l’affronter, mais avec du courage et de la fierté. Alors, devant les yeux médusés et remplis de frayeur des survivants, ils regagnaient leur bateau et hissaient la grande voile, qui se mettait à flotter avec des claquements secs. Bientôt, emportés par les alizés, ils n’étaient plus qu’un songe qui s’efface sur la mer et seule une chanson de marins ivres parvenait encore par intermittence, signe improbable de leur présence dans le monde.
Voilà ce que nous nous racontions, assis en cercle sur nos tapis usés jusqu’à la corde, et il nous semblait parfois entendre comme le souffle d’un vent tropical quand ce n’était pas carrément les craquements de la boiserie de notre navire sous la poussée de la houle. Mais non, ce n’était qu’un courant d’air qui s’infiltrait par la lucarne ou une poutrelle qui gémissait sous le poids de la toiture centenaire. En attendant, tous ces chevrons qui s’entrecroisaient sous nos yeux et qui se rassemblaient près de la poutre faîtière nous donnaient l’impression de vivre dans la cale d’une fière caravelle en partance pour la lointaine Amérique et il ne manquait plus que le roulis pour que l’impression fût complète.
Mais non, notre plancher était bien stable et la maison immobile. A travers les tuiles, nous parvenaient les aboiements d’un chien, quelque part dans le village et nous reprenions alors conscience du lieu où nous nous trouvions et de ce que nous étions venus y faire. Le capitaine du jour se levait soudain et un grand silence se faisait. Il s’approchait du coffre et posait une main dessus, comme pour bien sentir sa présence et s’imprégner de son mystère. Il caressait un peu les grosses moulures de fer qui ornaient ses pourtours, parcourait les veines du bois, s’arrêtait sur un nœud, puis s’acheminait vers le trou qui avait contenu la serrure. Enfin, d’un geste lent et sacré, il soulevait le couvercle dans le silence général.
(à suivre)

00:45 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : littérature
21/10/2009
Le coffre magique
C’est toujours après le déjeuner que nous montions au grenier. Forcément, il fallait pour cela profiter de la sieste de grand-mère. Nous la regardions ranger ses casseroles et faire sa vaisselle et il nous était bien difficile de ne pas nous montrer trop impatients. Il le fallait cependant, sinon nous courions le risque d’attirer son attention et d’éveiller ses soupçons. Nous nous installions donc tranquillement à la table de la cuisine avec nos crayons et quelques feuilles et nous commencions de beaux dessins représentant des couchers de soleil ou des îles tropicales. Quand elle avait fini de tout ranger, elle s’essuyait les mains et venait contempler nos chefs-d’œuvre. Ravie de nous trouver aussi calmes, elle s’asseyait ensuite dans son vieux fauteuil, celui qui avait échappé à toutes les guerres et elle ne tardait pas à s’endormir. Alors, il fallait bien écouter ses ronflements, ce qui était tout un art dans lequel seul mon cousin était passé maître. Si les ronflements étaient trop bruyants, il fallait se méfier car l’ancêtre finissait par ouvrir un oeil, réveillée elle-même par la cacophonie qu’elle déclenchait. Par contre, si sa respiration était régulière et que seul un petit sifflement sortait de ses lèvres, nous pouvions y aller. On se regardait sans rien dire et au signal du plus âgé nous quittions sans bruit notre place, laissant épars sur la table les crayons de couleur et nos dessins inachevés. Une fois dans le corridor, c’était le signal de la débandade. Il s’agissait d’arriver le premier au grenier afin de s’emparer de la grosse clef cachée dans une anfractuosité, derrière une plinthe du palier. Celui qui parvenait à la saisir et à la brandir aux yeux de tous devenait le chef de l’expédition, le capitaine des pirates, le général en chef d’une armée pourtant bien hétéroclite mais dont l’enthousiasme suffisait à assurer la cohésion.
Quel plaisir d’entendre la lourde clef métallique s’introduire dans la serrure, puis déclencher des bruits et des grincements stridents ! C’était une vraie lutte la-dedans, on sentait que cela résistait, que cela ne voulait pas céder, qu’il y avait mille obstacles et mille empêchements. Angoissés, nous attendions tous avec impatience le « crac » final, sec comme un coup de tonnerre, qui allait signifier que la serrure avait finalement capitulé et qu’une fois de plus nous avions remporté une grande victoire. Quand cela arrivait, une salve d’applaudissements saluait cet exploit, vite contenu cependant par le souvenir de la grand-mère qui, au rez-de-chaussée, risquait de percevoir dans son sommeil notre joie bruyante et plus qu’exubérante.
Alors, un grand silence se faisait, comme à l’église quand le prêtre levait l’hostie. Tous les regards étaient tournés vers le capitaine du jour qui, conscient de son importance, faisait un peu durer le plaisir. Puis, précautionneusement, quasi religieusement, il tournait la poignée de la porte, qui grinçait juste un peu avant de s’ouvrir sur le paradis. Tassés sur le seuil, nous étions à la limite de deux mondes et nous savions qu’en avançant d’un pas nous allions pénétrer dans un autre univers, une autre galaxie, un autre temps. Fascination de la limite à franchir, de l’interdit à transgresser.
Une fois donc passé ce seuil, nous pénétrions dans le grenier en file indienne, l’œil aux aguets, comme si nous nous étions aventurés en terre étrangère. Nous passions sans nous attarder devant de vieux meubles jamais ouverts, des chaises dépareillées, des boîtes en carton éventrées qui laissaient s’échapper des vêtements d’un autre âge. Plus loin, s’alignaient un vieux fauteuil et un canapé troué aux ressorts apparents, un massacre de cerf, une garde-robe en pièces détachées, des cadres représentant un coucher de soleil sur la mer ou des automnes flamboyants. Il y avait aussi, dans un des coins, un landau poussiéreux et sans roues, deux lits d’enfant (lequel d’entre nous avait bien pu y dormir ? Aucun sans doute, tout cela devait remonter à des âges reculés), une roue de vélo rouillée où il manquait des rayons, et un vieux matelas qui avait dû servir de repaire à plusieurs familles de souris.
Mais rien de tout cela ne nous intéressait et nous poursuivions notre progression en faisant attention de ne pas nous cogner la tête aux poutres trop basses. Parfois, un cri contenu était le signe que l’un d’entre nous venait, bien malgré lui, de se prendre le visage dans une toile d’araignée. La règle était de minimiser son émotion au maximum afin de ne pas provoquer les moqueries du reste de la troupe. Pourtant, au fond de nous, chacun plaignait l’innocente victime car les araignées, ici, avaient une taille inhabituelle, due sans doute à leur âge canonique. Personne n’avait donc envie de se retrouver avec un de ces monstres velus dans les cheveux ou pire encore sur le nez ou les lèvres. Certaines de ces bestioles, mortes et desséchées comme des momies, flottaient d’ailleurs depuis des siècles dans des toiles poussiéreuses que des vents inconnus agitaient doucement devant nos regards incrédules. Il n’y avait qu’à voir la taille de ces cadavres presque réduits en poussières pour imaginer facilement la vigueur que devaient avoir leurs descendants dans la force de l’âge. Mieux valait ne pas trop y songer.
(à suivre)

16:35 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature
09/10/2009
La maison (suite)
Je me suis levé et j’ai commencé à parcourir la maison. La petite véranda était toujours là, remplie de plantes et sans même y penser j’ai repris l’arrosoir de métal dissimulé derrière la vieille armoire et je me suis mis à verser de l’eau dans les pots, en ayant bien soin de ne renverser aucune goutte à terre. Au-delà, s’étendaient le potager et le verger, dont je ne distinguais quasi-rien dans l’obscurité. Il me semblait pourtant apercevoir un enfant qui n’était autre que moi-même, perché sur une grosse branche maîtresse et mordant à belles dents dans une pomme sûre et à peine mûre. Saveurs d’autrefois, faites de choses simples et éternelles…
A la cave, je fus surpris et même presque déçu de trouver un congélateur. Il était fini le temps des bocaux de haricots qu’on ébouillantait pendant une heure pour leur assurer une bonne conservation. Je me revois vers quinze ans, revenant du potager, deux grands seaux de légumes à la main et ma sœur qui me regarde avec son beau rire. Elle est installée dehors, devant une table, en train de couper en morceaux les fameux haricots et moi, pour la première fois, je remarque ses jambes nues, si belles et si brunes, qui dépassent d’une jupe que le vent a négligemment retroussée. Ma sœur ! Ma grande sœur, pourquoi es-tu partie ? Pourquoi nous as-tu quittés comme cela ? Je revois ta chambre où je me faufilais parfois en cachette, quand tu n’étais pas là. Les armoires que j’ouvrais, les robes, l’odeur de lavande et puis tes sous-vêtements, bien rangés dans un tiroir, que j’effleurais d’un doigt tremblant. La féminité, le grand mystère…

J’ai gravi en hésitant le vieil escalier. Il grince toujours comme autrefois, surtout la troisième marche, qui plie comme si elle allait se rompre. La chambre de ma sœur est là. J’ouvre délicatement la porte. J’allume. Rien n’a changé. Le petit bureau dans un coin, les livres bien rangés sur le rayonnage, la fameuse garde-robe ainsi que la commode aux tiroirs. Je sais que si j’en ouvre un, l’odeur de lavande va envahir la pièce. Ma mère a tout conservé intact, comme si rien ne s’était passé, comme si tu allais revenir demain. Je ferme les yeux et la scène recommence, toujours la même, insoutenable malgré les années.
Une voiture s’arrête devant la maison et on sonne à la porte. C’est le commandant des pompiers. Déjà, de la camionnette, on sort une civière, sur laquelle repose un corps, recouvert d’une couverture. Personne n’a encore parlé et déjà j’ai tout compris. Je tremble. C’est alors que ma mère arrive. Le commandant des pompiers, lui, tient sa casquette à la main et ne sait que dire ! Puis d’un geste las il montre la civière. Ils n’ont rien pu faire. Cela faisait bien dix minutes qu’elle était dans l’eau, peut-être plus. Elle avait dû se jeter du haut du pont-barrage… Puis ma mère qui court, qui soulève la couverture et qui tombe évanouie. Pendant qu’on s’affaire autour d’elle, moi je regarde tes beaux cheveux mouillés qui pendent et qui font comme une couronne autour de ton visage, pâle, si pâle. Sous le chemisier mouillé, on devine tes seins qui pointent… Toute ma vie je me sentirai coupable pour ce regard que j’ai alors porté sur toi. Toute ma vie je me serai demandé si tu avais compris comment je te voyais et si c’est pour cela que tu…
Je referme délicatement la porte. Dans le corridor il y a toute une série de photos. On me voit tout petit dans un parc, sous un grand tilleul dans la cour de l’école primaire, en classes de neige dans les Alpes, lors de mon mariage avec Martine. Pas une photo de ma sœur ! Cela ne m’avait jamais frappé. Visiblement, j’avais dû être le petit préféré. C’est donc avec un certain malaise que j’ouvre la porte de la chambre de ma mère. Ce lieu interdit, ce saint des saints où personne, jamais, n’a pénétré.
C’est un lieu austère. Un lit, une armoire, une commode avec de vieilles photos en noir et blanc (encore). Je ne reconnais personne. Des personnes d’un autre âge, habillées d’étranges vêtements, me regardent avec un sourire figé. Ces jeunes mariées, ces jeunes mères, ces premières communiantes doivent être toutes mortes maintenant. Leur jeunesse s’en est allée depuis longtemps, ne survivant que sur ces clichés jaunis. Qui sont-elles ? La famille de ma mère, sans doute, celle que l’on a jamais vue parce qu’on habitait loin, si loin… C’est ce qu’elle disait, en tout cas, pour ne pas s’avouer qu’on l’avait abandonnée quand elle s’était retrouvée dans le besoin avec ses deux enfants.
J’ouvre un tiroir. Il ne contient que des lettres, une centaine en tout au moins. Intrigué, ma mère n’étant pas du genre à entretenir une relation épistolaire, je déplie la première qui me tombe sous la main. C’est plus un billet qu’une lettre, en fait, car elle ne contient que quelques mots :
Ma bien aimée,
Nous nous retrouverons chez moi lundi après-midi, si tu veux bien, c’est plus prudent. Je ne voudrais pas que ta fille nous aperçoive. Mets ton petit corsage sexy, mon désir de toi n’en sera que plus grand.
Pierre
Je reste stupéfait après cette lecture. J’ai beau lire et relire le petit mot, il faut me rendre à l’évidence : ma mère avait une relation. S’il y a bien une chose que je n’aurais jamais imaginée, c’est bien celle-là. C’est normal, finalement, les enfants ne pensent pas que leurs parents sont des adultes comme les autres et qu’ils ont droit à une vie affective. Et ma mère a été veuve très jeune… Mais enfin j’en reste tout abasourdi quand même. Ma mère, vous vous rendez compte ? Il faut l’avoir connue pour comprendre toute l’incongruité de cette nouvelle. Elle si raisonnable…
Mes yeux tombent alors sur la date : 16 juillet 1975. Mais alors, c’est le jour où ma sœur… Qui est cet homme, qui fut la cause de tout ? L’adresse, au verso de l’enveloppe, me l’apprend aussitôt : Pierre Lavisse. Le garçon avec qui ma sœur sortait au moment de son suicide ! Il avait dix ans de plus qu’elle.
Je remets tout en place, referme la porte derrière moi, descends l’escalier qui grince toujours, surtout la troisième marche et je sors chercher un hôtel pour tenter de dormir un peu. Que pourrais-je faire d’autre ?
08:04 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : littérature
07/10/2009
La maison (petite nouvelle)
C’est le jour où maman est morte que je suis retourné dans notre maison. Je n’y avais pas remis les pieds depuis plus de vingt ans ! Il faut dire que je n’avais pas vraiment le temps pour aller me promener là-bas. Mon métier d’abord, ma famille ensuite, vous voyez ce que c’est. Et puis franchement, la distance entre Paris et cette région reculée de province aurait découragé n’importe qui. Un pareil trajet pour ne rester qu’un week-end ? Que dis-je un week-end ! Arriver le samedi à seize heure pour repartir le dimanche après le déjeuner, cela ne valait guère la peine. Alors c’est ma mère qui venait nous rendre visite une fois de temps en temps. Elle avait des loisirs, elle, et un trajet en train ne l’effrayait pas. Elle restait souvent quelques jours, enfin pas trop longtemps non plus, parce que Martine, ça l’agaçait une belle-mère qui tournait en rond dans l’appartement… Alors on ne se voyait pas beaucoup c’est vrai, mais c’était suffisant. Quand elle était chez nous, c’était comme si une étrangère avait subitement fait irruption. Ce qu’elle disait appartenait à un autre univers tout en ne m’étant pas complètement inconnu. Elle parlait de sa campagne, du temps qu’il avait fait cet hiver, d’une voisine qui était décédée, du fils de la ferme d’à côté qui avait tout vendu pour devenir facteur (« Un vrai malheur, une si belle ferme ! »), des moissons qui, cette année, étaient vraiment en retard… Toutes ces nouvelles me semblaient concerner une autre planète, même si, au fond de ma mémoire, elles évoquaient des visages, des sourires, des paysages. Martine, elle, faisait semblant d’écouter tout en levant les yeux au ciel de temps à autre et quant aux enfants, le MP3 fixé sur les oreilles, ils se moquaient pas mal de l’ancêtre et de ses histoires du siècle passé.
On avait bien essayé une ou deux fois de l’entraîner dans Paris, mais du Louvre elle n’avait retenu que la fatigue de la foule et pour ce qui était de la promenade en bateau mouche, elle avait plus regardé, incrédule, les touristes étrangers (« Il y en a tellement, on se croirait au japon ou en Chine ! ») que les tours de Notre-Dame.
C’était avec un réel soulagement qu’elle retournait dans sa campagne et, ma foi, c’était avec le même soulagement que je la reconduisais à la gare. Mais elle revenait l’année suivante, avec d’autres nouvelles des moissons et tout cela finissait par faire une sorte de petit train-train rassurant, au point qu’on n’a pas vu le temps passer. Et puis une fois, par un beau mois de juin caniculaire, le téléphone a sonné en pleine nuit. C’était l’hôpital, là-bas et une infirmière, avec son bel accent chantant, qui disait qu’il fallait se dépêcher si on voulait la revoir vivante. Ce fut un choc, car personne n’avait jamais pensé qu’une telle chose pourrait arriver un jour. Je suis parti aussitôt, seul bien entendu, Martine ayant une conférence à donner et les enfants des examens à présenter.
Sur l’autoroute, pendant que je roulais, il me semblait entendre sa voix, la mélancolie de sa voix, quand elle parlait de son époque révolue. Subitement il m’apparut que derrière toutes ces nouvelles qu’elle nous donnait et qui nous semblaient si futiles, se cachait une sorte de désespoir, celui d’assister, impuissante, à la fin d’un monde, de son monde. Ces fermes que l’on vendait, ces jeunes qui partaient vivre à la ville, ces campagnes qui devenaient des déserts, tout cela, c’était bien connu, cela figurait même dans les livres, mais pour elle, c’était sa vie qui s’en allait ainsi, lentement et inexorablement. A force de voir disparaître tout ce en quoi elle avait cru, elle avait dû pressentir sa propre fin. Soudain, mon indifférence me parut non seulement coupable mais presque inhumaine. Moi qui n’arrêtais pas de lire des ouvrages de philosophie qui tournaient tous autour du thème de l’existence et de la mort, voilà que je laissais un être humain seul avec la conscience de sa fin prochaine et cet être c’était ma propre mère. Aussitôt, je me suis mis à accélérer, mais j’avais beau rouler à du cent cinquante dans la nuit noire, la distance ne diminuait guère.

Quand je suis enfin arrivé sur le coup de midi, exténué, ce fut pour apprendre qu’elle était décédée quelques heures plus tôt. Ce fut un deuxième choc. Trop tard, il était irrémédiablement trop tard pour pouvoir enfin prêter une oreille attentive à ce qu’elle disait. Non pas que j’eusse pu la consoler en quoi que ce soit, mais au moins elle aurait eu conscience que moi, son fils, je l’écoutais et que je la comprenais. Il n’y avait malheureusement plus rien à faire. Sauf des formalités à n’en plus finir. La commune, les pompes funèbres, le curé, puis Martine, qui n’arrêtait pas de râler au téléphone parce que le jour de l’enterrement allait tomber un samedi et qu’elle avait son cours de yoga. Bref, quand tout cela fut plus ou moins terminé, le soir allait tomber et il ne me restait plus d’autre solution que de m’acheminer vers la maison pour y passer la nuit. J’ai fait un détour par l’hôpital pour prendre les clefs qui se trouvaient dans le sac à main de ma mère. Par ce geste, j’eus l’impression de commettre un délit, comme si je violais son intimité. Sentiment ridicule, me dis-je, car finalement cette maison était celle où j’avais passé toute mon enfance et demain j’allais, par héritage, en devenir l’unique propriétaire. Pourtant, quand je me suis retrouvé devant la lourde porte de chêne massif, mes clefs à la main, j’ai encore hésité. Après tout, il suffisait de faire demi-tour et d’aller chercher refuge dans un hôtel « Formule un » le long de l’autoroute… C’est finalement le désir de renouer avec mon enfance et ma vie passée qui m’a fait tourner la clef dans la serrure.
Dès le corridor, où pendait, bien en évidence, le compteur électrique avec tous ses fils, j’ai compris que dans cette maison, rien n’avait changé et surtout qu’il n’y avait rien à cacher. Tout était apparent et s’affichait sans aucun complexe. Dans le salon se trouvait toujours le vieux piano noir qui n’avait jamais servi à personne. Nul ne savait comment il était arrivé là, au détour de quelle guerre ou de quel héritage compliqué, mais il était là, complètement incongru dans cette pièce où avaient vécu des gens modestes, symbole d’une culture et d’une richesse qui n’avaient jamais été les leurs. En le regardant, je me suis demandé si ce n’était pas sa présence qui m’avait poussé à faire des études et à quitter ce monde rural si simple. Si simple mais si riche aussi et déjà j’en étais à réfléchir sur ce que j’avais gagné en rompant avec les miens et en rentrant dans le monde des intellectuels, comme on disait par ici. Pas grand chose finalement. Certes, je maniais les idées et les concepts comme pas un des paysans de la région ne savait le faire, mais en bout de course, quand je prenais une décision, n’était-ce pas précisément ce gros bon sens paysan qui me guidait et qui l’emportait ? Moi qui me prenais pour un fin lettré, avais-je vraiment changé de camp ? N’étais-je pas aussi étranger dans le monde universitaire que ma mère l’avait été en visitant le Louvre ? C’est ce que je me demandais en contemplant ce gros piano qui nous avait toujours appartenu mais qui en même temps avait été le symbole d’un univers qui n’était pas le nôtre.
Au mur, il y avait toujours les photos du père, ces fameuses photos en noir et blanc que je contemplais, enfant, pour tenter de me faire une idée de celui qu’on disait avoir été mon géniteur. J’avais quel âge encore quand il était mort accidentellement ? Trois ans ? Quatre ans ? Aucun souvenir en tout cas dans ma mémoire. Maman nous avait élevés seuls, ma sœur et moi. Et voilà qu’aujourd’hui, quasiment un demi-siècle plus tard, la page était irrémédiablement tournée. Il n’y avait plus personne pour se souvenir de cet homme qui n’avait jamais été pour moi qu’une photographie jaunie.
Dans la cuisine, je me suis fait une soupe. J’avais trouvé des sachets Royco dans une armoire, un peu étonné quand même devant la modernité de ma mère. Ainsi, elle avait renoncé aux bons potages qu’elle préparait autrefois avec les légumes du potager. L’âge et la fatigue, sans doute, l’avaient obligée à modifier ses habitudes. Pourtant, au fond de moi une voix criait qu’en agissant de la sorte elle avait voulu se rapprocher de nous et de notre mode de vie parisien. Une vague de douleur m’envahit. Je l’imaginais là, dans cette pièce, irrémédiablement seule devant son bol de soupe, tentant désespérément de nous ressembler un peu dans l’espoir inavoué de rétablir un contact. Et nous n’avions rien vu, nous n’avions même jamais rien su. Quelle étrange aventure que la vie, tout de même. On se marie avec un inconnu qui bientôt disparaît, on élève deux enfants, un seul arrive à l’âge adulte, puis à son tour il se marie et devient pour vous comme un étranger. Il reste alors à disparaître dans l’indifférence générale. Tout cela n’a assurément aucun sens.
(à suivre)
00:53 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature
25/09/2009
La remise
J’ouvre la porte de la remise, tout au fond du jardin et je suis immédiatement envahi par l’odeur du bois de chauffage, qu’on a entreposé là, en belles piles régulières. C’est pour cette odeur, que je suis venu jusqu’ici. Je ferme les yeux et je respire, sans plus penser à rien. L’odeur chaude et tendre m’envahit complètement et des images de forêts profondes s’imposent à mon esprit. Puis je revois les stères de bois, tels qu’ils étaient alignés le long du petit chemin forestier, les myrtilliers épars, l’étendue des fougères… Il me semble presque percevoir sur mon visage la chaude brise du dernier mois d’août et entendre les feuillages qui s’agitent légèrement. Leur bruit me parvient par vagues successives, comme la houle d’une mer intérieure. Un geai a crié, cri d’alarme dans la quiétude du lieu. Un promeneur se serait-il aventuré jusqu’ici ? Non, dans la clairière, c’est un renard qui s’avance, l’œil aux aguets, concentré sur sa tâche de chasseur. Il s’arrête et renifle un petit tas de sciure fraîche au pied d’une souche. On le voit bien, dans cette mise à blanc : son pelage roux, ses yeux vifs… Puis il s’en va, trottinant, et disparaît dans le sous-bois.
Dans la remise, j’ouvre un instant les yeux, puis je les referme et respire de nouveau la bonne odeur du bois. Cette fois, c’est le bruit de la circulaire hurlante qui s’impose à moi. Il me semble voir les grosses bûches que l’on coupe une à une et les rondins plus petits qui s’amoncellent à terre, en un tas irrégulier. L’homme, devant la machine, est méconnaissable, car il porte un foulard sur le visage et de grosses lunettes protectrices. Mon rôle consiste à ramasser les rondins et à les empiler sur la brouette. Puis il y aura le rangement proprement dit. Les rondins que je prends un à un et que j’empile comme je peux, en tentant de ne pas perdre de place, de ne pas laisser le moindre espace vide. Parfois il faut tout recommencer, enlever deux trois morceaux de bois et les agencer autrement. Le tout doit former un mur bien droit, bien stable. Sur ma peau nue, sans gants, je sens la rugosité de l’écorce, les petites échancrures pointues laissées par la lame sur les bords de la bûche, les nœuds du bois, ces protubérances aux formes variées. Parfois, il me semble reconnaître un des rondins que je viens de charger sur la brouette. Puissance de la mémoire affective, puissance des choses, qui s’imposent à nous, malgré nous.
Plus tard, ce sera l’hiver et il aura neigé. Il faut mettre de grosses bottines pour traverser le potager et atteindre la remise. Je revois le grand panier d’osier, tressé à la main à partir d’écorce de noisetier. On le remplit de rondins, comme on peut. Ce n’est pas facile à cause de l’anse qui gêne les mouvements. Il fait froid, très froid et par la petite fenêtre un timide rayon de soleil donne un peu de clarté, juste ce qu’il faut pour que l’enfant puisse voir les volutes de vapeur qui s’échappent de sa bouche. L’odeur du bois a disparu, figée par la froidure, sans doute. Il faudra déposer le panier dans la cuisine près du gros poële pour qu’elle réapparaisse, plus discrète qu’à l’origine, mais bien présente quand même. Avec elle, c’est un peu de nature sauvage qui est entrée dans la maison. Le feu crépite doucement dans le foyer et il fait bon, tandis que dehors, la neige n’en finit plus de tomber. Déjà, dans le sentier, les traces de mes pas sont en train de disparaître.
Photo personnelle
00:02 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature
22/09/2009
La chambre
Maison-poème (fin)
De la chambre, il n’y a pas grand chose à dire, si ce n’est que c’était un endroit où on s’ennuyait profondément. L’enfant se souvient de ces réveils de grand matin (lui qu’on avait couché tôt au lit) où il se retrouvait dans un lit cage qui ressemblait à une prison. Du haut de ses deux ans, il se dressait comme il pouvait pour contempler le monde qui s’étendait au-delà de ces barreaux que les adultes lui avaient imposés avec un sens inné de l’autorité qui le laissait complètement pantois. Ainsi donc, à peine né, il se retrouvait incarcéré, entravé dans ses mouvements et cela sans avoir commis le moindre délit. Dans sa petite tête où les idées commençaient à se mettre en place, les concepts de liberté, de libre-arbitre et d’injustice se faisaient tout doucement un chemin. Pourquoi, en effet les parents, ces dieux omniscients au pouvoir absolu, pouvaient-ils aller dormir quand ils en avaient envie alors que lui devait aller au lit quand il n’avait pas sommeil ? Et pourquoi ces mêmes parents pouvaient-ils maintenant paresser dans leur chambre alors qu’il faisait déjà presque clair ? Soupir.
Il n’y avait donc rien d’autre à faire qu’à contempler pendant un temps indéfini qui semblait une éternité le petit canard en relief qui ornait la tête du lit et dont l’enfant suivait les contours avec ses doigts fragiles. Il regardait donc ce canard, le caressait, lui parlait, lui racontait des histoires et allait même parfois jusqu’à se disputer avec lui quand le stupide volatile semblait ne rien comprendre à ce qu’on lui disait.
Il fallait alors se tourner vers une autre activité et à vrai dire, dans cette prison, il n’y en avait qu’une. Elle consistait à regarder attentivement la tenture sur laquelle le soleil donnait déjà et à essayer d’imaginer ce que représentaient les formes géométriques qui y étaient dessinées. Objectivement, ces formes n’avaient rien d’extraordinaires en elles-mêmes et il suffisait de la présence d’un adulte dans la pièce pour qu’elles ne sortent pas de leur rôle. Mais là, quand l’enfant était seul, elles prenaient subitement des contours étranges, en partie probablement à cause des rayons du soleil qui traversaient le tissu. Alors, ce qui n’était pourtant la veille qu’un carré ou un losange devenait subitement une tête de lion rugissant ou quelque horrible monstre baveux et à la langue fourchue. Certes, on pouvait se raisonner et le petit homme ne s’en privait pas. Il savait pertinemment que tout cela n’était que le fruit de son imagination, il n’empêche qu’à un certain moment la peur l’emportait sur la raison et c’est véritablement pris de panique qu’il se réfugiait au fond du lit, sous les couches de couvertures.

Il faut dire qu’il faisait froid, dans la chambre. A cette époque, le chauffage central n’existait pas ou alors seulement chez les riches (lesquels, vous l’aurez remarqué aussi, possèdent toujours tout avant tout le monde). La maison n’était chauffée que par le gros poële de la cuisine et évidemment, la nuit, en hiver, quand le gel sévissait et que la neige avait imposé sa loi implacable, il ne faisait pas bon rester dans la chambre. Plonger sous la couette était donc une nécessité qui relevait du simple bon sens de survie. L’enfant, effrayé par les monstres qui s’agitaient sur la tenture, retrouvait donc une certaine quiétude une fois réfugié sous l’amas de couvertures et de coussins qui lui sauvaient ainsi deux fois la vie. Là, dans la douce tiédeur du lit, il retrouvait peu à peu ses esprits et sentait les palpitations de son cœur se calmer. Alors, timidement d’abord, puis avec de plus en plus d’audace, il repartait affronter les fameux monstres. Souvent, ceux-ci avaient disparu entre-temps et leurs gueules grimaçantes n’ornaient plus le haut de la tenture. Le soleil avait sans doute été caché par un nuage et la lumière s’étant affaiblie, elle n’avait plus la force suffisante pour animer ce bestiaire infernal qui semblait rappeler à l’enfant l’époque où il n’était pas encore né. Car il lui semblait avoir connu dans un autre monde ces créatures diaboliques et pour lui il ne faisait pas de doute qu’il existait quelque part un pays étrange où il avait séjourné avant de naître. Car peut-on concevoir qu’on soit ici aujourd’hui et qu’hier on n’ait pas été ? Non, cela ne se pouvait et l’enfant tentait désespérément de se souvenir de cet univers d’avant la vie, univers qui était encore bien proche, pour lui qui n’avait que deux ans.
Mais la mère arrivait, interrompant ces réflexions angoissantes sur l’origine de l’être et l’existence des présences infernales. D’un geste sûr, elle ouvrait les tentures et, si on était en été, le bon soleil entrait dans la pièce, reléguant définitivement les monstres aux oubliettes. Par contre, si on était en hiver, c’est une autre découverte qui attendait l’enfant. Ce n’était pas la rue et ses maisons familières qui apparaissaient à travers le rideau, mais une vitre opaque, aux mille dessins géométriques stylisés. Dans le froid matinal, l’enfant qu’on avait enfin fait sortir de son lit courait vers la fenêtre et de son petit doigt il suivait les contours de ces roses de glace que le froid avait dessinées dans le givre.
Mais il fallait vite descendre en bas, et s’habiller près du gros poële de fonte, qui déjà ronronnait en emplissant la maison d’une bonne chaleur douillette, tandis que dehors il neigeait sans arrêt.
00:17 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature
07/09/2009
Le propriétaire
Préambule :
Puisque nous avons parlé, dans un texte précédent, de ce propriétaire qui ne déliait pas facilement le cordon de sa bourse, même pour des travaux de première nécessité, il serait intéressant d’en donner une description plus détaillée, tant il ressemblait, comme je l’ai dit, au Père Grandet de Balzac. On sait que le héros de ce livre est devenu (avec l’avare de Molière, bien entendu), le prototype de l’homme avare, radin et près de ses sous, mais le mien n’avait rien à lui envier. Evidemment j’étais très jeune quand je l’ai croisé et forcément les faits que je raconte ici sont déformés par mes yeux d’enfant. Je ne dis pas que c’est la réalité, mais plutôt la réalité telle que j’ai pu la percevoir à cet âge. De plus, une partie de la description provient de ce que la rumeur publique pouvait colporter sur le personnage et on sait ce qu’il en est de la rumeur publique. Enfin, c’est bien connu, l’acte d’écriture transforme inévitablement ce que l‘on a vécu, en l’amplifiant, en le déformant, en le faisant rentrer dans la grille de lecture de notre subjectivité, ce qui fait qu’entre la situation de départ et ce que l’on retrouve couché sur le papier il y souvent un abîme. Mais cet abîme est aussi la trace du regard spécifique qui est le nôtre et je crois que c’est finalement ce que l’on cherche dans la littérature. Ni des faits réels, ni des histoires destinées à nous amuser, mais plutôt la manière unique dont un de nos semblables peut voir le monde. Parfois il le voit comme nous (et nous nous sentons confortés dans la pertinence de notre être), mais souvent il le voit différemment (ce qui nous ouvre alors d’autres horizons et nous fait percevoir ce que nous n’avions jamais perçu). Et comme la littérature n’est pas un jeu (comme les surréalistes ont pu parfois le croire) mais une réponse à nos angoisses existentielles (ou plus exactement une tentative de réponse car la littérature ne résout rien et ne fait que poser encore plus de questions), elle participe pleinement à nous rendre plus humains, par le fait qu’elle provoque en nous une prise de conscience de notre destinée.
= = = = = = = = = = = = = = =
Ce vieux monsieur, qui dépassait les quatre-vingts ans, tenait à avec sa fille (une demoiselle restée célibataire qui flirtait avec la soixantaine), une petite épicerie dans le haut de la ville. Il avait économisé toute sa vie, ce qui fait qu’il possédait au moins une vingtaine de maisons, peut-être une trentaine, je ne sais pas exactement. Son avarice était légendaire. On disait qu’en hiver, par exemple, il ne chauffait pas sa maison, à part le magasin qui accueillait ses clients, sinon évidemment tout le monde aurait déserté son établissement et son chiffre d‘affaire s’en serait ressenti. Alors, quand la froidure se faisait par trop sentir et que ses mains commençaient à s’engourdir, il venait se réchauffer dans la boutique. Je le revois encore, pendant que sa fille servait derrière le comptoir, assis sur une vielle chaise pliante récupérée je ne sais où, tendant ses doigts transis devant le petit poële de fer blanc qui diffusait une chaleur timide. Il était enveloppé dans une couverture rapiécée et contemplait la petite casserole de soupe qu’on avait mise à réchauffer là, afin sans doute d’épargner la cuisinière à gaz qui devait se trouver quelque part dans le logement.
Il restait là sans rien dire, répondant d’un simple signe de tête aux nouveaux arrivants qui le saluaient et s’enquéraient de sa santé. Il semblait éteint, moribond et avait des gestes d’une lenteur de tortue. Pourtant, quand la caisse enregistreuse faisait son déclic caractéristique et qu’elle s’ouvrait pour engloutir les petits sous, il fallait voir alors comme son œil pétillait. On aurait dit que toute la vie qui lui restait s’était concentrée dans ce regard, dont la vivacité offrait alors un contraste étonnant avec sa vieille carcasse décatie. En attendant, les hivers passaient les uns après les autres et il était toujours là, tandis que certains clients avaient déjà rejoint l’autre rive, terrassés par l’une ou l’autre de ces maladies étranges et terribles qui faisaient chuchoter les ménagères à mi-voix quand elles attendaient dans la boutique leur tour pour être servies.
- Et vous savez Un Tel, il est mort en trois jours sans que le médecin ait pu faire quoi que ce soit. Pourtant il fallait voir la force qu’il avait !
- Non ? C’est pas vrai ! Remarquez qu’au moins il n’aura pas souffert longtemps. Ce n’est pas comme le grand Joseph de ma rue, qui est resté alité pendant cinq longues années et qui ne se souvenait même plus qui il était. Même que sa femme n’en pouvait plus de toujours le soigner au point qu’elle est partie avant lui, d’épuisement probablement .
Le gamin que j’étais écoutait tous ces malheurs dont se délectaient littéralement les commères, lesquelles, leur cabas à la main, semblaient intarissables. On aurait dit qu’elles se complaisaient dans ces drames et plus c’était horrible, plus elles semblaient contentes. Je jetais un œil discret vers le vieillard en me disant que tout de même elles auraient pu lui épargner la description de toutes ces agonies, lui qui avait déjà un pied dans la tombe… Mais il ne semblait rien entendre, comme si tout cela ne devait jamais le concerner et il se contentait de tourner de temps à autre dans son potage avec une vieille cuillère en bois, sans jamais perdre de vue ce qui se passait au comptoir. Pendant que cela discutait ferme des malheurs du monde, lui il calculait mentalement le bénéfice que lui rapportait chaque salade que sa fille sortait d’un cageot ou chaque paquet de café qu’elle allait chercher en haut d’un rayonnage, montée sur une échelle branlante à laquelle il manquait un échelon.
Evidemment, les temps étaient durs, même pour lui, car il devait avoir en tête d’acheter d’autres maisons et on sait bien que pour cela il faut de l’argent, beaucoup d’argent. Alors, comme il n’avait que son petit magasin pour vivre (en plus de tous ses loyers, évidemment), il avait trouvé un moyen très simple pour faire fructifier ses affaires. L’art du commerce, c’est bien connu, consiste à vendre très cher au détail ce que l’on a acheté bon marché en gros, cela il l’avait toujours su. Mais là où il dépassait tous ses collègues et concurrents en ingéniosité, c’est qu’il avait imaginé de rogner sur les quantités des produits qu’il vendait. Ainsi, tous les paquets d’une demi-livre de beurre étaient délicatement ouverts et il en retirait une fine lamelle avant de refermer le tout. Après avoir répété la même opération une bonne dizaine de fois, il parvenait ainsi à vendre un onzième paquet qu’il n’avait pas dû acheter. Il procédait de même avec les paquets de café en grains ou encore avec le sucre fin.
Cette pratique un peu scandaleuse, il faut l’avouer, était connue de tous, mais en ces temps où les voitures étaient encore rares et où il n’était pas facile de se déplacer, chacun trouvait son compte dans ce petit magasin de proximité. Si on désapprouvait cette manière de faire, on le chuchotait en rue, mais jamais dans la boutique, par une sorte d’accord tacite entre tous. Pourtant, certaines clientes étaient plus difficiles et il y en avait parfois une qui se montrait récalcitrante au point de rompre le pacte. Je me souviens ainsi d’avoir vu une brave dame refuser une bouteille de limonade qui avait été ouverte et dans laquelle il manquait manifestement un peu trop de liquide. Mais bon, ces incidents regrettables étaient rares et d’une manière générale le vieux monsieur parvenait tout de même à arrondir subtilement ses fins de mois.
L’argent qu’il gagnait, on s’en doute, ne servait pas à améliorer son existence quotidienne, mais prenait tout droit le chemin de la banque. On avait l’impression qu’il craignait pour ses vieux jours et qu’il se constituait pour plus tard un petit magot rassurant, à l’abri des regards. Le problème, c’est qu’il avait déjà plus de quatre-vingt ans, ce qui fait que tout le monde se demandait à quel âge il envisageait de mourir. A ceux qui lui disaient qu’il serait temps qu’il profitât un peu de la vie, il répondait par le silence, se contentant de lever une main dans un geste dubitatif, comme pour signifier qu’on ne savait jamais ce que le hasard pouvait bien réserver et qu’il valait mieux être prudent. On ne pouvait pas dire qu’il travaillait pour ses petits-enfants, puisqu’il n’en avait pas, sa fille unique ne s’étant jamais mariée, par crainte sans doute des maris dilapidateurs de fortune. Quant à elle, seule héritière du patrimoine immobilier que constituaient les trente maisons, elle semblait à l’abri du besoin, d’autant plus qu’elle n’était déjà plus si jeune.
Pourtant, la rumeur disait que dans cette maison on ne mangeait pas à sa faim. Les visites chez le boucher étaient rares et se limitaient aux grandes fêtes du calendrier, encore parvenait-on à se contenter de bien peu, comme cent grammes de saucisses ou quelques pieds de porc (lesquels allaient cuire interminablement dans une marmite sur le poële de la boutique, ce qui, ces jours-là, écourtait considérablement la conversation des ménagères, avides pourtant de mille ragots à colporter). Parfois, on voyait le vieux monsieur se lever de sa chaise comme à contrecœur et d’un pas lent et résigné aller prendre une boîte de petits pois sur un rayonnage avant de disparaître dans sa cuisine. Manifestement, cette boîte constituait tout le repas de cet étrange couple, le père et la fille, si bien assortis qu’on finissait par les confondre. Il était même à craindre que ce ne fût là le seul repas de la journée car on n’avait jamais vu le moindre boulanger s’arrêter devant la boutique et quant à aller chercher eux-même leur pain, ils n’en avaient pas le temps, évidemment. Quand on tient soi-même un commerce, il faut savoir se consacrer aux clients, c’est bien connu, n’est-ce pas ?
Bon, j’arrête là la description de mon père Grandet local, n’ayant pas beaucoup d’autres éléments à rapporter. Quand il eut repris la maison que nous occupions (avec la nouvelle serre), j’ai déménagé puis un peu après j’ai changé de région, ce qui fait que j’ai perdu de vue tout ce petit monde. J’ai appris plus tard que le vieux monsieur était mort à cent trois ans, fort étonné, probablement, que la vie ne lui ait pas laissé le temps de profiter de son petit capital.

Le Père Grandet (dessin de Henri Monnier)
23:03 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature
03/09/2009
Les cercles magiques.
Sur la plage, l’enfant trace un cercle avec un bâton, puis un autre et encore un autre. Trois cercles concentriques qui délimitent un disque d’un mètre de diamètre environ, dont il aplanit maintenant délicatement la surface avec les mains. Puis il va chercher quelques branches de pins odorants qu’il dispose religieusement le long du premier cercle. Ensuite, il parcourt le rivage et revient avec des galets blancs, qu’il place uns à uns sur le périmètre du deuxième cercle. Le voilà maintenant parti tout la-bas, à la limite de plage et des grandes dunes qui circonscrivent l’espace marin. Je le distingue à peine, silhouette minuscule au pied d’un grand arbre. Puis le voilà qui revient en courant, rayonnant, car il a trouvé ce qu’il cherchait. Tout autour du troisième cercle il dispose alors des feuilles d’eucalyptus, dont l’odeur entêtante envahit tout l’espace. Ensuite, très sérieusement, l’enfant se tient debout devant son chef d’œuvre et marmonne quelque chose, cela pourrait être une chanson ou une prière, on ne sait pas bien, mais ce sont des paroles qui pour lui prennent la tournure d’une formule magique, c’est évident. Puis, d’un bond, il saute à pieds joints au centre du cercle et reste là, tout penaud, étonné qu’il ne se passe rien.
Je souris de sa naïveté et replonge dans mon livre. Quelques instants plus tard, intrigué par le grand silence qui règne autour de moi, je lève les yeux et à ma grande surprise je constate que l’enfant a bel et bien disparu.
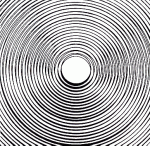
00:37 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature
26/08/2009
La serre
Maison poème
J'intitule ce texte « la serre » car je ne trouve pas d'autre mot pour désigner cette espèce de verrière qui prolongeait la cave, par une sorte d'aberration architecturale à laquelle personne n'avait jamais pu trouver le moindre sens. En effet, en principe, une serre renvoie aux concepts de clarté, de chaleur et de plantes quasi tropicales. Rien de semblable ici, évidemment. Les vieux carreaux consolidés avec du papier goudronné ne laissaient passer qu'une lumière diffuse, ce qui donnait à la cave adjacente des airs d'aquarium et pour un peu on se serait cru au fond de la mer. Sans compter que ladite verrière laissait abondamment passer l'eau les jours de pluie, ce qui renforçait encore la certitude que ce lieu entretenait avec l'élément aquatique des liens aussi profonds que secrets.
Pour mieux comprendre la topographie des lieux, il faut imaginer que l'excavation qui avait été faite pour construire la maison était exagérée par rapports à la surface de celle-ci. Les ouvriers s'étaient visiblement retrouvés avec un trou à devoir combler une fois l'habitation terminée et il me plait de penser que c'est par paresse qu'ils ont imaginé cette sorte de verrière qui venait donc prolonger la cave dans le sous-sol, mais qui en surface offrait l'énorme inconvénient de se situer au même niveau que la cour. Point de jeux de ballons pour l'enfant que j'étais, évidemment, car les carreaux auraient été immédiatement cassés. Je peux avouer aujourd'hui que cette situation m'arrangeait bien, car j'ai toujours eu pour les ballons une aversion viscérale et à vrai dire si profonde qu'elle doit être d'origine génétique, il n'y a pas d'autre explication. Il n'en restait pas moins que cette serre qui, à l'extérieur, se retrouvait de plain-pied avec le sol, constituait un véritable danger car quelqu'un d'un peu distrait ou qui aurait été victime d'un soudain étourdissement, se serait immédiatement retrouvé dans la cave après avoir été déchiqueté par la verrière.
Celle-ci représentait donc un danger potentiel et tout le monde s'en méfiait. Il nous fallait pourtant bien vivre avec elle, ce qui revenait à se comporter comme on le fait avec un animal qu'on nous dit être gentil mais dont on sait qu'il appartient à une race agressive. Bref, la serre, par son emplacement, constituait une menace permanente pour notre intégrité physique, ce qui n'était pas rien. Malheureusement, c'était loin d'être tout. Son état de vétusté était tel qu'on se demandait bien comment la vieille structure métallique toute rouillée parvenait encore à supporter le poids des carreaux, alourdis encore par le papier goudronné dont j'ai déjà parlé. A l'extérieur, on avait donc peur de passer par inadvertance à travers la verrière, de par sa position au niveau du sol, et à l'intérieur on redoutait de tout recevoir sur la tête, ce qui semblait de plus en plus probable au fur et à mesure que les années s'écoulaient. Ajoutez à cela le manque de clarté et les infiltrations de pluie et vous aurez compris que cette serre était devenue pour tous un véritable cauchemar et qu'elle alimentait souvent les conversations.
En tout cas, je lui dois mon premier cours d'économie domestique et la conscience que la lutte des classes n'est pas un vain mot. Je m'explique.
Chaque fois qu'il avait l'occasion de croiser le propriétaire (c'est-à-dire au moins une fois par mois), le père ne manquait pas de souligner la dangerosité de la situation. A chaque fois, évidemment, on lui répondait que ce n'était pas la saison, que les moyens manquaient, qu'il faisait trop chaud ou trop froid, bref, que cela pouvait bien attendre encore un peu, par exemple jusqu'à l'année prochaine. Allons, disons même jusqu'à la fin de l'année prochaine, ce sera plus sûr. Mais une fois la période prévue arrivée, le terme reculait aussitôt du même nombre de mois que l'année en comportait, ce qui fait que les travaux étaient reportés de douze mois et en réalité ne se faisaient jamais. Pourtant, sur le terrain, la situation empirait, ce qui fait que le père en vint à proposer un compromis. Pour autant qu'on lui payât les matériaux, il s'engageait à construire lui-même une nouvelle serre, ce qui en outre donnerait une plus value à cette maison qui ne lui appartenait pas. Le propriétaire écouta un peu plus attentivement ses propos, mais finalement il dit que non, que ce n'était pas possible dans l'immédiat : il ne disposait pas des liquidités suffisantes pour acheter les trois cornières de métal et la grande plaque de plastique ondulé qui seraient nécessaires. C'est qu'il avait à entretenir une bonne vingtaine de maisons et on n'imaginait pas tous les frais que cela occasionnait et qu'il devait assumer. Bref, au mieux, on verrait l'année prochaine, mais il ne promettait rien. Tenace, le père renouvela pourtant son offre plusieurs fois si bien qu'un jour, à la surprise générale, l'accord oral fut donné. Ce fut une surprise, assurément et on mit sur les qualités de persuasion du paternel d'avoir remporté la bataille. Certes, il fallut encore attendre quelques mois avant que Crésus ne se décidât à ouvrir son portefeuille, mais après tout, on pouvait comprendre, ce n'était pas la saison, n'est-ce pas ?
Puis vint enfin le jour où les travaux débutèrent. Le père acheta donc lui-même ce dont il avait besoin et transporta comme il put tout ce matériel dans sa petite voiture (une quatre chevaux Renault), ce qui en soi constituait déjà un exploit. A la réflexion, ce fut même un miracle s'il y parvint et il faut croire que les dieux, touchés par notre obstination, avaient décidé de prendre notre parti.
C'est comme cela que la famille se retrouva avec une serre convenable, sur laquelle on avait moins peur de faire une chute fatale (puisque le panneau de plastique était solidement fixé à des chevrons de qualité), qui ne risquait plus de s'effondrer à la cave et qui, ô merveille, non seulement ne laissait plus passer l'eau mais qui en plus diffusait une lumière douce et agréable.
Nous en profitâmes pleinement deux mois entiers, jusqu'au moment où le propriétaire signifia qu'il rompait le bail pour occuper lui-même la maison. Le vieux grigou, âgé de près de quatre-vingt ans, venait de décider de prendre sa pension et de ne plus s'occuper de l'épicerie qu'il tenait dans le haut de la ville. Il loua donc son commerce au plus offrant et vint occuper notre maison, qui était la plus petite de toutes celles qu'il possédait et donc celle qui lui rapportait le moins. Mais vous comprenez, pour une personne seule, c'était bien suffisant, n'est-ce pas ?
Epilogue :
Avec le recul, je me dis que ce vieux monsieur, qui avait tout du père Grandet de Balzac, m'a donné une bonne leçon de vie. Malgré mes six ans, j'avais en effet compris qu'il existe des possédants et des possédés et que le sens moral qu'on essayait de m'inculquer ne concernait évidemment pas certaines catégories de la population. Leur argent les mettait au-dessus de tout cela puisque, de toute façon, il leur permettait d'obtenir le respect des autres.
15:34 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, la serre
07/07/2009
La cave
La cave... Impossible de descendre dans une cave sans avoir l'impression de transgresser une limite et de pénétrer dans un autre monde. La cave est un lieu souterrain, un lieu de mystère, plongé dans le noir, dans la grande nuit de la mort.
C'était, je m'en souviens bien, un endroit interdit, probablement à cause de la présence d'un escalier assez dangereux, mais pour moi cette interdiction était la preuve que la cave recelait des mystères inquiétants. Et en effet, à peine avait-on descendu les marches qu'on se retrouvait devant la porte toujours close de ce qu'on appelait « la petite cave ». Je ne passais devant cette porte qu'avec la plus grande vigilance et ce n'est que de loin que j'osais l'observer. Je savais, pour l'avoir vue un jour entrouverte, ce qui se cachait derrière : une sorte de boyau étroit, mais long, si long qu'on en devinait à peine le bout dans la quasi-obscurité que ne parvenait pas à vaincre une ampoule rachitique. Ce qui m'avait frappé, c'était l'absence totale de fenêtre. Pas le moindre soupirail, pas le plus petit interstice par lequel la lumière du jour aurait pu pénétrer. Un endroit de cauchemar, assurément. Et comme il n'y avait rien dans cette cave, j'en déduisais qu'elle était en fait un corridor souterrain qui devait mener Dieu seul savait où, quelque part dans les entrailles de la terre. Plus loin, incontestablement, devait se trouver une prison moyenâgeuse, une sorte d'oubliette où on jetait les enfants dont on avait pu se saisir.
Le fait que même mes parents ne pénétraient jamais dans ce lieu renforçait mes craintes tout en les confirmant. C'était un lieu maudit, vous dis-je, et pour rien au monde je n'aurais franchi le seuil de cette tombe, où j'aurais été contraint d'errer dans le noir absolu, tâtonnant maladroitement le long des murs humides, m'écorchant les doigts à leurs pierres rugueuses. Tout au bout, des soldats en armures m'auraient saisi et emporté plus loin encore, dans un endroit de terreur dont je ne serais jamais revenu. Rien qu'à regarder la porte pourtant soigneusement close de cette « petite cave », il me semblait entendre dans le lointain le cliquetis de leurs épées et le bruit métallique de leurs armures. Après m'être raconté deux ou trois histoires absolument terrifiantes, je remontais l'escalier en courant, affolé pour de bon et c'est le cœur battant que j'arrivais à la lumière du jour, en plein solstice d'été, dans la chaleur de midi. On me regardait avec étonnement, mais mes yeux exorbités disaient assez d'où je venais et on ne me posait donc aucune question. Je vivais ce silence comme une preuve supplémentaire de la réalité des horreurs qui se déroulaient immanquablement dans cette cave et qui étaient si terribles que personne n'osait même en parler.
Mais reprenons notre visite. Sous l'escalier, se trouvait un renfoncement où on mettait au frais la réserve de pommes de terre, en provenance directe du potager. Au printemps, l'appel de la belle saison était tel qu'elles se mettaient toutes à faire des germes incroyables, sortes d'excroissances blanches ou bleutées qui témoignaient que la vie, toujours, était là, palpitante, au cœur de la nuit souterraine. Mais je m'attardais peu à contempler ces tubercules et leurs mystères, à cause de la proximité de la « petite cave ». Je préférais passer en courant et aller directement dans la « grande cave », qui était le règne de ma mère. A l'entrée se trouvait le garde-manger (j'ai parlé, déjà, de l'absence de frigo), où on tentait de conserver tant bien que mal les restes de repas en profitant de la fraîcheur du lieu. C'était souvent peine perdue, surtout lorsque le temps était à l'orage et il fallait alors jeter cette nourriture pourtant si précieuse. Comme le rayonnage de la cuisine, ce garde-manger était une fabrication artisanale du père, faite de bois et de treillis métallique, lequel avait pour fonction de protéger des insectes et de laisser passer l'air. J'avoue que c'est le seul garde-manger que j'ai vu dans ma vie, aussi quand à l'école, beaucoup plus tard, j'ai étudié le pluriel des noms composés, ce n'est pas sans fierté que j'ai retrouvé ce mot dans la liste des substantifs comportant le mot « garde » (garde-chasse, garde-meuble, etc.). Tandis que me petits condisciples se demandaient à voix basse ce que pouvait bien être un garde-manger, moi je souriais intérieurement et il me semblait que l'instituteur ne l'avait glissé là qu'à mon intention.
Un peu plus loin dans la cave se trouvait la machine à laver. Progrès technologique incroyable que cette machine, surtout pour ma mère qui avait encore connu le lavoir public dans son village et la glace qu'il fallait casser en hiver pour rincer le linge. Pourtant cette machine était constituée d'une simple cuve avec une hélice. Cela veut dire qu'il fallait préalablement chauffer de l'eau dans une lessiveuse aussi grande que l'enfant que j'étais. Je revois encore les flammes bleues du brûleur à gaz qui léchaient le fond de cette lessiveuse et qui constituaient, pour peu qu'on éteignît la lumière, autant feux follets bleutés qui dansaient dans l'obscurité. Une fois l'eau bien chaude, il fallait la transvaser dans la machine à laver, opération délicate et dangereuse à laquelle je n'ai jamais été autorisé à participer, ce qui fait que j'ignore toujours comment on s'y prenait pour mener cette opération à bien. Ensuite, il fallait actionner l'interrupteur de la machine et faire tourner le linge un temps qui me semblait une éternité.
C'est que j'avais hâte d'arriver à l'étape suivante, qui m'était confiée. Une fois le linge ressorti de la cuve, il fallait l'essorer en le faisant passer entre deux rouleaux fixés à la machine et qu'on actionnait à l'aide d'une manivelle. C'était un plaisir que de voir les linges gorgés d'eau se faire happer par ces rouleaux, s'aplatir autant qu'il était possible et rendre, dans un bruit de cascade, toute l'eau dont ils étaient gorgés. Ils ressortaient à l'autre bout complètement aplatis, complètement ridicules aussi, pauvres petites choses insignifiantes et plates dans lesquelles il était bien difficile de reconnaître une taie d'oreiller ou un pyjama. Quand tout cela était terminé, comme si leur sort n'était pas encore assez cruel, ils passaient à l'essoreuse, machine incroyable qui à l'époque représentait la pointe de la technologie (surtout si on la comparait à la machine à laver) et qui à ce titre faisait la fierté de toute la famille. Pourtant, quand je voyais ma mère la maintenir tant bien que mal quand elle prenait de la vitesse dans un bruit de sirène, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui arriverait si jamais elle la lâchait. Emportée dans sa course tourbillonnante, l'essoreuse aurait fait toute seule le tour de la cave avant d'aller s'encastrer contre un mur dans un grand bruit de ferraille, ce qui, heureusement, n'arriva jamais.
00:01 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature
01/07/2009
La cuisine
Maison poème
Chez nous, en ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Chez les autres non plus, à vrai dire, mais chez nous il y en avait encore moins que chez les autres. Alors, si je devais vous décrire les meubles de la cuisine, je serais bien embêté parce qu'il n'y en avait pas.
Heureusement, la pièce était très petite, comme toute la maison d'ailleurs, ce qui fait que le visiteur qui entrait n'était pas frappé par cette absence de meubles, pourtant bien réelle. Dans le prolongement de la porte, contre le mur de gauche, trônait une desserte à roulettes. On n'a jamais su pourquoi ma mère l'avait achetée car elle n'a jamais servi à rien, si ce n'est à déposer la cage du canari. Celui-ci, par contre, on savait bien à quoi il servait : son rôle était d'égayer la maison et de faire oublier sans doute que nous étions un peu démunis. Alors, éternel prisonnier dans sa cage, le pauvre s'acquittait du rôle qui lui avait été assigné en chantant du matin au soir. Il chantait bien en plus et très juste. Je l'écoutais pendant des heures, étonné quand même qu'il prît tant à cœur son travail de forçat. Je me disais en le contemplant qu'il y avait plus mal loti que nous. Condamné à la prison à vie, il chantait quand même et exultait sa joie de vivre en petit philosophe qu'il était. Parfois je me demande s'il ne m'a pas appris davantage de choses sur la vie que les frères des écoles chrétiennes, mais bon, ce n'est pas là notre sujet et nous en parlerons une autre fois.
A part la desserte et son canari, donc, il n'y avait rien contre le mur de gauche. Au bout, dans le coin, on trouvait l'évier (d'origine). Un rideau à fleurs habilement passé dans une tringle cachait les ustensiles qu'on déposait en dessous, comme le savon et les éponges.
Le mur du fond, en prolongement de l'évier, ne comportait qu'une fenêtre ainsi que la porte donnant sur le jardin. Au printemps on enlevait les grands rideaux blancs supposés nous protéger du froid hivernal (ce qu'ils faisaient bien mal, à vrai dire) et on les remplaçait par de petits rideaux avec des motifs représentant des cerises rouges. Cette couleur égayait aussitôt la pièce, que la lumière envahissait soudainement grâce à la partie de la vitre désormais laissée libre. C'était une joie, quand je revenais de l'école, de découvrir que les petits rideaux à cerises rouges avaient refait leur apparition. Ils annonçaient déjà l'été et le retour des grandes vacances.
Durant ces étés caniculaires (avez-vous remarqué comme les étés étaient toujours beaux et chauds dans nos enfances ?), la porte restait grande ouverte et un rideau en plastique composé de lanières de différentes couleurs retenait la chaleur à l'extérieur tout en empêchant les insectes d'entrer. C'était un plaisir délicieux, avec ma petite voisine, de passer et de repasser sans arrêt entre ces rubans qui sentaient bons la matière synthétique, jusqu'au moment évidemment où un adulte s'apercevait de notre manège. On se faisait alors réprimander vertement sous prétexte que nous allions abîmer le précieux rideau, qui n'était pas un jouet. Pourtant, étant donné la chaleur étouffante qui régnait à l'intérieur de la cuisine, complètement privée d'air, et le nombre de mouches qui volaient dans tous les sens, je me disais que ce rideau si inefficace n'avait d'autre but que d'agrémenter mes journées, notamment en me permettant de frôler délicieusement les membres ou le dos dénudés de ma compagne de jeu, qui, si elle avait déjà franchi les rubans multicolores et était ainsi devenue invisible à mes yeux, ne semblait jamais assez rapide pour s'esquiver, sans qu'on sût jamais si elle le faisait exprès ou pas.
Mais je m'égare, revenons à notre description. Au milieu du troisième mur de la cuisine, trônait le grand poêle de fonte, sorte de gros crapaud énorme qui occupait un cinquième de la pièce à lui tout seul et qui, en hiver, était capable d'ingurgiter une quantité astronomique de bois de chauffage. Ce bois que mon père allait couper lui-même en pleine en forêt durant les mois d'été, ce bois qu'il avait dû transporter jusqu'à la maison, puis qu'il avait dû refendre, scier et finalement empiler dans la remise du jardin, ce bois, dis-je, voilà que ce gros bêta de poêle l'avalait sans aucune retenue, en demandant et en redemandant sans cesse. Il était semi-circulaire, avec une taque noire où s'engouffraient les bûches et, sur les côtés, des garnitures chromées qui déformaient le visage de l'imprudent qui osait se regarder dedans. Je me souviens des matins d'hiver, avant l'école, quand je grignotais une gaufre (ces grosses gaufres nourrissantes faites dans un moule en fonte qu'on disposait directement au-dessus de la flamme), les pieds dans le four latéral du poêle qu'on venait juste d'allumer. C'est qu'il avait bien du mal à combattre la froidure de la nuit qui continuait à s'éterniser dans la pièce et qui avait laissé aux vitres ces roses magnifiques que je contemplais avec émerveillement dans mon demi-sommeil, quand je ne me mirais pas dans les garnitures en chrome qui me renvoyaient l'image d'un bien étrange personnage qui n'était autre que moi-même.
Quant au quatrième et dernier mur, il était un peu la honte de la maison, aussi s'arrangeait-on souvent pour que les visiteurs, si d'aventure il s'en trouvait, lui tournassent d'office le dos. C'est que contre ce mur, là où aurait dû se dresser un beau meuble en chêne, un vaisselier de style ou un de ces mastodontes tout d'une pièce qui font l'orgueil des familles de génération en génération, se cachait, derrière son rideau, une ridicule petite étagère. Et encore, quelle étagère ! Elle n'était même pas faite de ce bois stratifié et lisse qu'on trouve dans les magasins et qui, s'il n'est d'aucune beauté, offre au moins l'avantage d'être facile à nettoyer. Non, ce qui misérablement était adossé au mur, c'était un simple rayonnage de bois brut à peine raboté, dont beaucoup n'auraient même peut-être pas voulu pour leur cave. On y rangeait toute la vaisselle et surtout ces casseroles émaillées pleines de coups dont je me demandais toujours de quelle guerre elles étaient les rescapées. Pour cacher tout cela (quand même!), un rideau monté sur sa tringle, le même rideau, ô luxe inouï, que celui qui dissimulait le dessous de l'évier, preuve que la maîtresse de maison avait du goût et qu'elle aurait accompli des merveilles si les moyens lui avaient été donnés. Comme ce n'était pas le cas, elle se rabattait, avec cette dignité qu'ont les gens démunis, sur ces petites coquetteries qui rendent agréables des maisons qui sans cela ne le seraient vraiment pas.
Car en ce lieu, même si c'était une cuisine, il ne fallait pas chercher de frigo, sans qu'on sache bien si c'était le manque de liquidités du ménage ou l'exiguïté de la pièce qui en avait rendu la présence impensable. Il ne fallait pas chercher non plus de poste de télévision, ni dans cette pièce-ci ni dans aucune autre d'ailleurs. Le luxe et la modernité, ce n'était pas pour nous et ma foi c'était peut-être mieux ainsi. Pour l'enfant solitaire que j'étais (quand la petite voisine n'était pas là, ce qui arrivait souvent, soit qu'elle eût trouvé des filles de son âge pour s'amuser, soit que, déjà, elle me fût infidèle) il ne me restait plus qu'à apprivoiser mes rêves et à contempler les formes étranges que prenaient les nuages quand le vent les poussait en troupeaux indisciplinés vers l'horizon inconnu.
09:45 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : littérature, la cuisine
17/02/2009
La cabane dans les bois (9)
En sortant de l’hôtel pour prendre l’air, je suis tombé en arrêt devant la statue de Cristobal el Colon qui se trouve à l’entrée du vieux port. J’ai souri en voyant l’explorateur fixer l’horizon et tendre le doigt vers la mer, dans un geste qui résume bien tout son désir d’aller conquérir des terres nouvelles, malgré la difficulté qu’il y a à les atteindre. Je me suis dit qu’entre lui et moi il y avait comme un air de famille car finalement j’avais poursuivi mon rêve jusqu’au bout du continent et si je ne ramenais pas d’or, au moins avais-je accompli ce pour quoi j’étais parti. En plus, je revenais avec une richesse autrement plus importante puisqu’elle était tout intérieure. Alors, complètement rassuré, j’ai parcouru les Ramblas dans tous les sens puis j’ai visité la cité, avide de tout connaître. Tard dans la nuit, j’arpentais encore les ruelles louches de la vieille ville, passant d’un bar à tapas à un autre, sentant l’ambiance, percevant l’atmosphère, m’en imprégnant jusqu’à plus soif. Il était bien quatre heures du matin quand j’ai regagné mon hôtel et que je me suis endormi du sommeil du juste.

Après, tout a été très vite. A midi j’étais dans le train pour la frontière. Un vent brûlant s’engouffrait par les fenêtres ouvertes et on voyait la Méditerranée, la mare nostrum des Romains, qui resplendissait dans son éternité. C’est sur cette mer que le fier Ulysse avait accompli tous ses voyages, devenus désormais mythiques et c’est sur ces rivages qu’il avait aimé tant de femmes et de déesses. Il suffisait de fermer les yeux et de se laisser porter par le balancement du train, tout en respirant l’odeur acre des genets ainsi que celle des oliviers et des pins, pour l’imaginer aux commandes de son navire, parcourant la mer bleue et longeant les côtes à la recherche de sa patrie pour finir par découvrir l’amour dans des ports improbables. Mais au bout du voyage, il retrouve le chemin de sa maison et rentre dans son foyer, accueilli en premier par son chien fidèle, qui est le seul à le reconnaître.

Quand j’ai rouvert les yeux, le train se frayait un passage entre des masses de rocher. Il venait d’atteindre les Pyrénées. Il fallut franchir la frontière puis changer de convoi, l’écartement des rails étant différent d’un pays à l’autre. Ensuite, nous avons roulé sur une étroite bande de terre entre la mer et des étangs, dans un paysage irréel, un peu fantastique, tandis que dans le lointain les montagnes barraient l’horizon. Le train prit de la vitesse. Je laissais l’Espagne derrière moi, une étape était franchie. Puis nous avons continué encore et encore, pour ainsi dire sans aucun arrêt. Les villes défilaient, écrasées de soleil, avec leurs toits rouges et leurs murs ocres. Perpignan, Carcassonne, Toulouse, Montauban… C’est ainsi qu’à six heures du matin, je débarquais à Paris. Un sandwich, un métro, un TGV cette fois et j’étais déjà reparti. On a roulé longtemps puis en début d’après–midi je me suis retrouvé dans le vieux car brinquebalant que j’avais pris au départ. J’en suis descendu sur la place du village où régnait toujours le même calme impressionnant. J’ai mis mon sac sur mes épaules et j’ai continué à pied. En passant non loin du cimetière, j’ai vu que tous les habitants étaient rassemblés là. Je ne sais pas pourquoi j’ai pensé que c’était la petite vieille qui était décédée, celle qui autrefois m’avait jeté un regard noir en sortant du car. On entendait le curé qui psalmodiait un chant en latin. Toutes les têtes qui étaient penchées vers la tombe se sont relevées pour me voir passer sur la route. Moi j’ai continué. Il me restait seize kilomètres à faire et je voulais arriver avant la nuit.
La cabane était toujours là et la porte a à peine grincé quand je l’ai poussée doucement. J’ai allumé un feu et je me suis fait un thé bien chaud, que j’ai bu en tenant la tasse dans le creux des mains, pour me réchauffer car il faisait un peu froid. Des volutes de vapeurs s’échappaient du breuvage, formant des spirales aux formes étranges. Je les contemplais distraitement, regardant bien au-delà. Ce que je voyais, c’étaient tous ces paysages que j’avais traversés, ces routes que j’avais empruntées, ces trains qui m’avaient entraîné au bout du monde. Dans ces nuages de vapeur apparaissaient comme des flashes l’océan déchaîné sur la côte Atlantique, les rues en pente d’Almeria, un grand bateau blanc qui quittait le quai et enfin une fille extrêmement belle qui me souriait. La boucle était bouclée et j’étais revenu à mon point de départ. Epuisé, je me suis jeté sur le lit, tandis que les flammes crépitaient dans l’âtre et qu’une bonne chaleur accueillante se répandait dans la pièce. Je me suis endormi comme cela, tout d’un bloc et ce fut un long sommeil réparateur et sans rêves. Juste avant de sombrer, il m’a semblé entendre au loin les loups qui hurlaient, mais je n’en suis même pas sûr.

FIN
"Feuilly"
08:02 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature
16/02/2009
La cabane dans les bois (8)
Je suis resté sur mon banc pendant des heures. A un certain moment un bruit strident de sirène a retenti. C’était le « Ciudad de Sevilla » qui appareillait pour le Maroc. Peut-être était-elle à bord, mais cela n’avait plus aucune importance. Elle avait sa vie, son univers et j’avais les miens. Le plus extraordinaire avait été notre rencontre, finalement, à laquelle tout aurait dû s’opposer. Mais elle avait eu lieu et c’était le principal. J’avais parcouru plus de deux mille kilomètres pour que nos destins puissent se croiser un instant. J’avais obtenu ce que je cherchais, j’avais connu l’amour, même s’il avait été bref, j’avais connu son corps et aussi étrange que cela puisse paraître, je me sentais apaisé. Elle, je l’avais cherchée dans mes rêves et je l’avais trouvée, connue, aimée. Tout cela me semblait bien. C’était une belle expérience de vie, comme une initiation. Maintenant j’étais vraiment moi-même et je savais que quoi qu’il puisse m’arriver j’aurais cette force en moi qui ne me quitterait plus, cette force née du fait de l’avoir rencontrée et d’avoir vécu cette expérience unique. Plus tard, sans doute, j’expliquerais tout cela par écrit et j’y trouverais comme l’aboutissement d’une quête existentielle, mais pour le moment je ne sentais qu’un grand apaisement. J’étais bien c’est tout et je crois que je me suis assoupi à moitié, là, sur ce banc, alors que tombait le crépuscule. Quand j’ai ouvert les yeux un instant, le « Ciudad de Sevilla » n’était plus qu’un point à l’horizon. Je me souviens encore confusément que ce point devint de plus en plus petit et qu’à la fin il disparut complètement. Il ne restait que l’étendue de la mer, aussitôt remplacée dans mon rêve par une grande plaine enneigée, éclatante de blancheur et incroyablement belle.

Quand je me suis réveillé, il faisait nuit noire. Je me suis acheminé lentement vers la gare de la Renfe. Quand il fut six heures, j’ai pris un ticket pour Paris. L’employé derrière son guichet me regardait d’un air goguenard. Il devait me prendre pour un drogué ou un alcoolique.
Le train démarra dans l’air frisquet du matin, cet air propre à tous les ports de mer, chargé d’humidité, de sel et de saveurs étranges. Puis il prit de la vitesse, au milieu d’une campagne désertique, faite de rochers et de figuiers de barbarie. Encore quelques heures et cet endroit se transformerait en une fournaise impitoyable, mais moi je n’y serais plus.
Ce fut ainsi que je remontai vers le Nord, vers mes terres à moi, mon univers. Le convoi était désespérément lent. Il s’arrêtait on ne savait pourquoi dans des bourgades minuscules, si petites qu’on se demandait ce qu’elles faisaient là, toutes seules en pleine montagne aride. Ce n’était partout que caillasses et rochers, sans la moindre végétation. Pourquoi avait-on eu l’idée de construire là des habitations et pourquoi le train s’y arrêtait-il ? Sans doute par pitié, pour que ces habitants ne se sentent pas trop seuls, coupés du monde comme ils étaient. Je me disais qu’on leur devait bien cela. Après tout j’avais bien eu ma chance, moi, en rencontrant mon amour, ils méritaient bien eux aussi d’avoir la leur. Ce train qui s’arrêtait chez eux était une invitation au voyage, une possibilité qui s’offrait à eux de partir, de quitter ce désert et d’aller trouver un sens à leur vie ailleurs, dans des contrées inconnues.

Mais personne ne montait et le train repartait. Un peu plus loin il s’arrêtait en rase campagne sans que l’on sache pourquoi. Cela pouvait durer d’une demi-heure à une heure puis il repartait. Les noms de villes succédaient aux noms de villes. Il faisait nuit quand nous arrivâmes à Madrid Chamartin. Je me retrouvai dans le train de Barcelone et le trajet continua. On roulait dans la nuit noire, toutes fenêtres ouvertes tant il faisait chaud et on entendait le cri désespéré du klaxon qui se répercutait dans l’immensité du plateau de vieille Castille.
Dans la glace des WC je ne me suis pas reconnu. Je ressemblais à un bandit évadé de prison et j’ai essayé de remettre un peu d’ordre dans ma tenue. Puis je me suis étendu sur une banquette vide et je me suis endormi. Ce sont les haut-parleurs qui m’ont réveillé bien plus tard. Le train était arrêté en gare de Barcelone et le jour se levait.
Malgré cette nuit passée à dormir, j’étais trop fatigué pour continuer, aussi j’ai décidé de faire une pause dans cette ville qui était tout de même la capitale de la Catalogne. Je me suis mis à la recherche d’un petit hôtel et j’en ai trouvé un pas trop cher derrière la Grand Poste. Je suis resté une demi-heure sous ma douche, heureux de sentir l’eau claire et tiède parcourir mon corps, me purifiant de toute cette poussière accumulée au cours du voyage. Quand enfin j’ai fermé le robinet, il m’a semblé que j’étais devenu un autre, comme si une page avait été tournée et qu’une partie de mon passé, avec ses incertitudes, était maintenant derrière moi. J’ai dormi quelques heures d’un sommeil réparateur et sans rêves et à mon réveil je me suis senti fort et content de moi.

00:25 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
14/02/2009
La cabane dans les bois (7)

Puis, un beau matin, elle ne fut plus là. Le vide, l’horreur, l’inconcevable. Où était-elle ? Je voulais me rassurer et je me disais qu’elle était sans doute partie se promener seule, mais une telle initiative, qui n’avait pourtant rien d’inquiétant, aurait déjà marqué un changement radical dans son comportement. De plus je savais au fond de moi que cette hypothèse était fausse et que la vérité était bien plus grave. Néanmoins, je me mis à chercher comme un fou, inspectant chaque crique, arpentant toutes les plages, contournant tous les rochers. Rien. Pas la moindre trace de sa présence. Je me suis même éloigné du rivage et pour la première fois j’ai pénétré dans le désert de roches et de poussière qui nous entourait. Mais où chercher ? Et puis de toute façon il n’y avait rien. La journée s’est passée comme cela et je me suis retrouvé devant la mer quand le soir commençait à tomber. Ma chère inconnue avait disparu. C’est alors que je me rendis compte que je ne connaissais même pas son prénom. Quand nous nous appelions, nous utilisions ces petits mots tendres qu’inventent les amoureux. Il n’y avait rien de plus normal. En attendant, je me retrouvais seul et je me rendais compte qu’elle avait totalement disparu, non seulement physiquement et affectivement, mais même sur le plan symbolique, puisque que je ne pouvais même pas la nommer en lui donnant un nom. Il ne restait que le vide, un vide pascalien et au-dessus de moi ces milliards d’étoiles inconnues et indifférentes.

Je crois que j’avais de la fièvre d’avoir autant pensé. Le désespoir peut-il rendre malade ? En tout cas je me souviens que je tremblais de tous mes membres et que mes dents s’entrechoquaient. A la fin j’ai dû m’assoupir (on ne peut pas appeler cela dormir). Je me suis réveillé aux premiers rayons du soleil. C’était le deuxième jour sans elle qui commençait. Alors je me mis en route en direction d’Almeria. Le chemin était long, long et épuisant par cette chaleur. Pas un arbre, pas un rocher, pas la moindre ombre, rien que cette route qui n’en finissait pas et au-dessus de moi un soleil immense que je n’osais même pas regarder tant il faisait mal aux yeux. Après bien des kilomètres, je me suis assis devant une maison isolée, qui se trouvait là, allez savoir pourquoi, perdue dans ce désert. A ma grande surprise, elle était habitée. En effet, au moment où je m’apprêtais à partir, la porte s’ouvrit doucement et une petite vieille toute de noir vêtue montra le bout de son nez. Elle ne semblait pas plus étonnée que cela de me voir là, devant sa demeure. Je lui demandai si elle n’avait pas rencontré une jeune fille aux grands yeux noirs et à la chevelure d’ébène. Elle fit non de la tête puis, sans doute alertée par mon accent étranger, elle me montra la route qui continuait vers Almeria et rentra précipitamment chez elle. La porte claqua avec un bruit sec. On aurait dit que la petite vieille venait de refermer le couvercle de son propre cercueil, tant le silence qui suivit fut impressionnant. Quelque part, pourtant, c’était moi qui étais mort, complètement désespéré et incroyablement amoureux.
Alors, pour oublier, j’ai marché et j’ai marché. Des kilomètres et des kilomètres. J’avais soif. Faim aussi, bien entendu, mais surtout soif. Forcément, avec une telle chaleur (il devait faire plus de quarante degrés), il fallait être fou pour entreprendre un tel voyage. Et pourtant je continuais, car il me semblait qu’au bout du chemin je trouverais la réponse à ma question. Plus je marchais et plus je me rendais compte que je n’espérais même plus retrouver ma compagne, mais seulement comprendre où elle était partie et surtout pourquoi elle était partie. J’avançais comme un somnambule sur ce chemin poussiéreux, au milieu des cactus, des figuiers de barbarie et des cailloux. L’horizon était désespérément barré par des collines désertiques et au-dessus de moi le soleil continuait de darder ses rayons implacables.

Puis ce fut la nuit et la température s’est enfin mise à baisser. Moi, je continuais de marcher, fixant le mètre de route qui était devant moi. La nuit s’est passée ainsi, à avancer dans le noir. Sur ma droite, un croissant de lune éclairait faiblement les montagnes tandis que sur ma gauche je devinais une lueur opalescente qui devait être la mer. A six heures du matin, j’entrais enfin dans Almeria. Je me suis d’abord rendu à la station d’autobus et pendant des heures j’ai questionné les employés et les voyageurs. Evidemment personne n’avait vu une personne ressemblant à mon amour. De là je suis parti pour la gare des chemins de fer de la Renfe, où je n’obtins pas plus de résultats. Il était déjà midi et j’errais à travers les rues écrasées de chaleur, complètement désorienté et perdu, épuisé par le manque de sommeil. Pas rasé, trempé de sueur, je devais tout doucement ressembler à un clochard, c’est du moins ce que je me suis dit en remarquant le regard étonné des passants, qui me fixaient d’un air ahuri.

Almeria est une ville dont les rues dévalent vers la mer, ce qui fait que je me suis retrouvé sur le port sans même m’en rendre compte. Je me suis assis sur un banc et j’ai contemplé les deux grands navires qui étaient à quai. L’un, je m’en souviens bien, s’appelait le « Ciudad de Sevilla ». Derrière moi, dans une sorte de parking couvert, des centaines de voitures venant de l’Europe entière attendaient pour embarquer. Il y avait des Espagnols, forcément, mais aussi des Français, des Allemands, des Danois et même des Suédois. C’étaient tous les travailleurs immigrés du continent qui profitaient des vacances pour retourner au pays. Ils s’entassaient là, cinq ou six par voiture, dormant et cuisinant par terre, dans la chaleur étouffante, espérant faire partie du prochain voyage pour le Maroc. C’est là que subitement j’ai tout compris. Ma belle compagne au teint basané devait elle aussi être retournée dans son pays. Elle était probablement venue en Espagne comme travailleuse clandestine et était repartie comme elle était venue. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais j’avais l’intime conviction de détenir la vérité. Ce n’était même plus la peine d’aller interroger les employés du port.

00:27 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature
13/02/2009
La cabane dans les bois (6)
Nous sommes restés au Cabo de Gata une quinzaine de jours peut-être, vingt tout au plus. Nous vivions en pleine nature, absolument seuls, dormant à la belle étoile et nous réveillant le matin devant la mer immensément bleue. Je ne retournais au village (si on peut appeler cela un village) qu’une fois tous les deux jours pour les provisions. Elle, elle ne m’accompagnait jamais, je ne sais pas pourquoi. On aurait dit qu’elle craignait de se faire remarquer, comme si elle avait commis quelque acte répréhensible. De plus, elle était farouche de nature, méfiante et perpétuellement sur ses gardes. Avec moi, cependant, toutes les barrières étaient tombées rapidement dès le premier regard échangé. On aurait dit qu’elle savait que je la cherchais depuis des mois, on aurait dit qu’elle n’était venue là que pour m’attendre. Cependant, quand elle ne se savait pas observée, je décelais dans son regard comme une grande tristesse qui me faisait craquer encore plus.
Nous parlions peu (elle s’exprimait bien en français, pourtant, ce qui, vu l’endroit où nous nous trouvions aurait dû attirer mon attention ). La journée se passait comme dans un rêve, à marcher le long de la mer ou à se laisser flotter sur l’eau. Il faisait si chaud que nous n’avions pas le courage d’explorer l’intérieur des terres et le seul fait de savoir que derrière nous se trouvait un quasi désert suffisait amplement à nous contenter. De plus, ces kilomètres de terres arides qui nous séparaient d’Almeria et de la civilisation renforçaient notre délicieux sentiment d’isolement. Etre ensemble au bout du monde, rien qu’à deux et complètement isolés de tous me procurait une joie que je n’avais jamais connue. Il faut dire qu’il aurait fallu être difficile pour ne pas être comblé, ma compagne se montrant de plus en plus entreprenante au fur et à mesure que les jours passaient.
Là, tout n’était que luxe, calme et volupté, disait le poète. Si nous n’avions pas le luxe, nous avions assurément le calme et la volupté. Je me souviens de ces nuits étoilées, face à la mer. Nos corps enlacés n’arrêtaient pas de se chercher et nous finissions par rouler dans le sable jusqu’à glisser dans la mer. Alors l’eau salée excitait encore plus notre désir et nous entamions des courses poursuites au milieu des gerbes d’eau écumantes. Quand je parvenais à la rattraper (mais je me dis aujourd’hui qu’elle s’arrangeait bien pour que ce fût possible) elle poussait un cri strident et c’est dans l’eau qu’elle se donnait comme jamais je n’ai vu une femme se donner. Alors elle devenait loquace et tout en m’embrassant elle me disait qu’elle m’aimait vertigineusement. Je trouvais curieux cette expression « aimer vertigineusement », mais au fond c’étaient exactement les mots qui convenaient. Dans la pénombre, mes mains caressaient sa peau sombre de fille du Sud et quand un rayon de lune éclairait son visage, je voyais deux braises au fond de ses yeux, deux braises qui n’en finissaient plus de me contempler et de dire le désir qu’ils avaient de moi. Je redoublais alors de caresses. Quand elle jouissait, elle criait sans retenue dans la nuit noire, sachant qu’ici il n’y avait personne et que le monde nous appartenait. Je n’ai jamais rien entendu de plus beau que ces cris qui manifestaient tout le contentement d’exister et d’être au monde. Jamais je n’ai été aussi heureux, jamais la vie ne m’a semblé aussi pleine de sens que quand nous étions nus sur cette plage, seuls dans l’éternité des galaxies, fragiles sans doute, mais puissants en même temps car c’est nous qui commandions aux forces de l’univers. Nous étions devenus des dieux dans la chaleur andalouse, au bord du monde, face à la mer.

00:37 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : littérature












