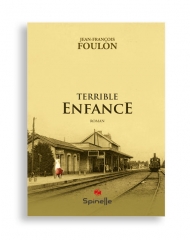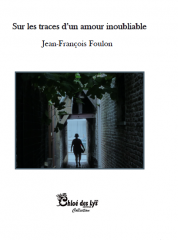23/05/2020
Nouveau roman
22:10 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, roman, parution, editions spinelle
24/06/2019
Train de nuit (suite et fin)
Je me sentais proche d’elle et pas seulement à cause de ses propos révolutionnaires. Ce qu’elle m’avait dit de Rimbaud m’avait aussi beaucoup étonné. On sentait qu’elle maîtrisait les textes du poète à la perfection et qu’elle savait en extraire toutes les pépites, depuis les rêves impossibles jusqu’à la révolte. Décidément, c’était là une fille étonnante et je me promis de faire plus ample connaissance avec elle dès le lendemain.
Mais quand je me suis réveillé au petit matin, le train était à l’arrêt en gare d’Hendaye et les premiers voyageurs commençaient à se diriger vers le terminal ferroviaire espagnol. Sur la couchette en face de la mienne, il n’y avait plus personne ! Mon Dieu, elle était partie sans rien dire ! Peut-être, pleine de sollicitude, avait-elle eu peur de me réveiller ? Mais cela n’avait pas de sens puisque le train était arrivé à destination. Sans doute avait-elle plutôt voulu disparaître avant que je l’interroge de nouveau sur la Colombie. Du coup, je m’en suis voulu de m’être montré par trop indiscret la veille. Sans ma stupide curiosité, ma compagne serait encore là, et c’est ensemble que nous aurions continué le voyage. Mais si elle allait à Salamanca, comme elle l’avait prétendu, elle devait prendre le premier train pour l’Espagne ! Et moi qui restais là comme un idiot à me poser des questions, alors qu’il fallait courir et essayer de prendre le même convoi qu’elle ! Je sautai en bas de ma couchette et rassemblai mes affaires le plus vite possible. C’est alors que je remarquai un foulard qui traînait à terre et qu’elle avait manifestement oublié. Je me souvenais qu’elle le portait autour du cou la veille, quand elle était entrée dans le compartiment. Je le respirai et tout son parfum, toute son odeur à elle, me pénétra aussitôt. J’en restai abasourdi, quasi en extase. Il me semblait entrer ainsi dans son intimité et j’en étais tout troublé. Se pourrait-il qu’elle eût fait exprès de perdre ce foulard ou l’avait-elle vraiment égaré ? Peu importait finalement, puisqu’il me restait ainsi un petit quelque chose d’elle. Un « presque rien » comme disent les philosophes, mais qui néanmoins importait beaucoup pour moi. Il me semblait enfouir mon visage dans son cou parfumé et je m’imaginais déjà en train de lui mordiller tendrement l’oreille avant de chercher ses lèvres et de finir par un baiser envoûtant.
Il n’y avait plus une minute à perdre ! Je rassemblai mes affaires en un tournemain et, le foulard à la main, je me précipitai dans le couloir du train. Une fois à l’extérieur, je courus le plus vite possible vers les barrières qui séparaient la France de l’Espagne. Enfin arrivé aux guichets, je parvins à me faufiler et à grappiller quelques places. Mon billet en poche, je me suis précipité vers le train qui attendait le long du quai. Je suis monté dans le premier wagon et j’ai parcouru toute la rame en espérant retrouver ma fascinante amie. Mais j’eu beau refaire le trajet plusieurs fois, je dus me rendre à l’évidence : elle n’était pas là. Pourtant c’était bien le premier train en partance pour Salamanca ! Je n’y comprenais plus rien. Quand le convoi s’ébranla et prit de la vitesse, j’ai fini par m’asseoir. Mon sac à dos sur les genoux, je continuais à respirer l’odeur du foulard, sous l’œil réprobateur d’une vieille douairière, coincée dans son tailleur rose, qui me dévisageait d’un œil morne et méprisant. Qu’elle ne m’adresse surtout pas la parole, la vieille chouette ! Je n’en avais rien à foutre de ses considérations morales, j’étais amoureux et me moquais bien du reste.
Après un bon moment, je repris mes esprits et contemplai le paysage qui défilait à grande vitesse. Déjà nous avions quitté le Pays basque et nous parcourions le plateau monotone et aride de la Vieille Castille. Etais-je une sorte de Dom Quichotte à la recherche de rêves impossibles ? C’était à craindre. C’est alors que mon regard tomba sur la page d’un journal du matin qui traînait sur la tablette. En gros plan il y avait une photo de la fille que je recherchais ! Je n’en revenais pas ! Je lus le titre et en restai abasourdi : « Una Francesa asesinada en Colombia por un grupo de extrema derecha. » Une jeune fille française assassinée en Colombie par un groupe d’extrême-droite. Le journal était daté de ce matin et le meurtre avait été découvert la veille au soir, vers vingt-deux heures, heure espagnole. Pourtant cette même jeune fille avait bien pénétré dans mon compartiment ! Je ne savais plus que penser. Etais-je devenu fou ? Avais-je eu une hallucination ? Mystère. J’étais incapable de me prononcer. Les yeux dans le vague, j’ai regardé les champs de Vieille Castille défiler avec monotonie, tandis que je continuais à serrer compulsivement le foulard au parfum enivrant.

23:51 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature
19/06/2019
Train de nuit
J’étais monté dans ce train de nuit à Angoulême, sans billet, et après avoir erré un bon moment dans le couloir, j’étais parvenu à trouver un compartiment vide. Une chance inespérée ! Six couchettes avaient été disposées et je n’avais que l’embarras du choix. J’optai immédiatement pour celle du dessus, histoire de rester le plus discret possible si par malheur un contrôleur zélé se mettait en tête de vérifier les billets. Mais bon, à cette heure, on pouvait quand même espérer qu’il dormirait comme tous les autres voyageurs.
Bien installé dans mes hauteurs, je sortis de mon sac à dos un exemplaire chiffonné des Classiques Garnier et je me replongeai dans la poésie toujours aussi étonnante et ensorcelante des Illuminations de Rimbaud. Ce sont des villes! C'est un peuple pour qui se sont montés ces Alleghanys et ces Libans de rêve ! Des chalets de cristal et de bois qui se meuvent sur des rails et des poulies invisibles. Il y avait de quoi en avoir le souffle coupé ! Je me mis à rêvasser tandis que mon train filait à toute vitesse vers une Espagne improbable. A la fin, je crois que je me suis endormi, bercé par le bruit monotone des roues. A un certain moment, je me suis réveillé en sursaut : le train était à l’arrêt. Que se passait-il ? Un rapide coup d’œil derrière le rideau de la vitre me rassura : on faisait une halte en gare de Bordeaux- St-Jean. Un coup de sifflet strident m’apprit que le train allait bientôt redémarrer. Et en effet, un peu plus tard, nous roulions à toute vitesse dans les Landes, dont les pins maritimes se dressaient face à l’océan, énigmatiques fantômes dans le clair de lune. C’est à ce moment que la porte du compartiment s’est ouverte et qu’elle est entrée. Elle m’a dit bonsoir avec un merveilleux accent du midi et m’a souri, pas farouche pour un sou, et plutôt enchantée de trouver quelqu’un d’éveillé avec qui faire la conversation.
Etudiante en lettres modernes à la Fac de Bordeaux, elle s’en allait à Salamanca pour apprendre l’espagnol. Moi qui me rendais en Andalousie officiellement pour essayer de trouver un boulot saisonnier, mais surtout pour entrer en contact avec des camarades anarchistes, je me dis que ses intentions valaient bien les miennes. Nous discutâmes un moment de Rimbaud, dont elle avait repéré tout de suite la couverture fatiguée des Classiques Garnier. Puis ce fut le tour de Verlaine, de Baudelaire et de Léo Ferré. Décidemment cette petite, par ailleurs bien appétissante, semblait loin d’être une idiote, et elle commençait à me plaire. Après la poésie, on aborda les sujets politiques et là également je dois dire que nous étions sur la même longueur d’onde. Il y avait chez elle une sincérité profonde quand elle appelait de tous ses vœux à vaincre la droite capitaliste et à installer une société basée sur des valeurs humaines. On évoqua les guerres coloniales d’Irak, de Libye et de Syrie. On parla de la France de Sarkozy et de celle de Macron, puis de la mainmise de la haute finance sur toute l’économie mondiale. Elle me raconta un voyage qu’elle avait fait l’an passé à Cuba et au Venezuela, voyage qui s’était finalement assez mal terminé en Colombie, d’après ce que je pus comprendre, mais sur cet épisode trouble elle ne voulut rien me dire. Au contraire, elle se braqua quand je lui posai quelques questions plus précises et décréta subitement qu’il était temps d’aller dormir. Alors, elle se mit à se déshabiller sans la moindre gêne. J’avoue, moi qui en ai pourtant vu d’autres, que j’en suis resté tout pantois. Une fois le chemisier et le pantalon ôtés, ce fut le tour du soutien-gorge, qu’elle enleva d’un geste précis et gracieux, comme si c’était là l’acte le plus naturel du monde. En petite culotte, elle grimpa dans la couchette en face de la mienne, sous le toit, puis elle me souhaita une bonne nuit avec un petit sourire charmant.
Il faisait si chaud que je ne suis pas parvenu à m’endormir. Discrètement, je regardais parfois ma voisine qui, elle, semblait bien assoupie et dont la respiration régulière soulevait la poitrine dénudée d’une troublante façon. Le train filait à toute vitesse vers cette Espagne exotique où il me plaisait de construire des châteaux imaginaires absolument merveilleux. Puis j’ai repensé à l’histoire étonnante de cette fille sortie de nulle part et qui m’avait confié sans hésiter ses convictions politiques intimes. Oui, mais d’un autre côté, il y avait cet incident en Colombie, où il s’était manifestement passé quelque chose de tragique et dont elle n’avait absolument pas voulu parler. J’étais intrigué. Qu’avait-elle bien pu faire là-bas ? Avait-elle pactisé avec les FARC et avait-elle commis un attentat ? Avait-elle été emprisonnée et torturée ? A cette idée, je sentais une sorte de révolte monter en moi, tout en regardant les longs cheveux noirs qui se répandaient autour de son beau visage.
(à suivre)
21:52 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
14/02/2019
Promenade champêtre
La vie est une promenade, que l’on fait dans des champs d’amertume. On suit un chemin, sans savoir où il mène, ni pourquoi on a choisi celui-là. Généralement, d’ailleurs, on n’a rien choisi du tout, on s’est retrouvé là par hasard, par habitude, ou par nécessité, parfois suite au conseil d’un ami.
On marche, on suit le chemin, qui s’avance entre les blés blonds. Quelque part, on ne sait pas où, des oiseaux chantent, heureux d’exister. Alors on s’arrête un instant et on les écoute. Quelle mélodie ! Quel hymne à la création ! Allons, la vie semble belle… On reprend sa route, rassuré pour quelques instants. Mais soudain, vous voilà à un carrefour. Aller à gauche ou aller à droite ? Il va falloir choisir. Mais comment trancher, puisqu’on ignore où mènent ces deux chemins. La décision sera forcément arbitraire, autant jouer à pile ou face.
Vous voilà engagé dans une voie qui bientôt se rétrécit. Sans doute vous êtes-vous fourvoyé et aurait-il fallu être plus clairvoyant. Mais vous ne connaîtrez jamais ce qu’aurait été votre vie si vous aviez choisi l’autre chemin. Il vous aurait mené ailleurs, mais où ? C’est là que réside tout le mystère. Vous auriez rencontré d’autres lieux, d’autres personnes… Peut-être même auriez-vous connu un grand amour, qui sait ? C’est tellement agréable, un grand amour… En attendant, vous êtes ici, sur ce chemin de plus en plus étroit et qui se rétrécit encore, finissant par ressembler à un sentier, voire même à une simple piste laissée par des animaux sauvages.
Vous voilà à la lisière d’une forêt. Allez-vous poursuivre votre route et continuer ? De toute façon, il est trop tard pour faire demi-tour. A l’horizon, déjà, le soleil se couche, embrasant l’univers d’une trainée de sang. Il faut y aller, l’heure n’est plus à faire des choix.
Dans les sous-bois, il fait déjà sombre et la nuit ne tardera pas. Où aller ? Il n’y a plus de sentier ou ce qu’il en restait s’est perdu dans l’obscurité. Vous tâtonnez, de peur de vous blesser aux branches sournoises et basses. Parfois, votre pied heurte une racine traitresse. Allons, la belle journée est bien terminée, voilà déjà la fin du voyage. Dans les lointains, hurlent les premiers loups. L’heure est arrivée où il va falloir livrer le dernier combat.

15:36 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : litterature
23/01/2019
Dernière parution
La nouvelle vient de tomber : mon dernier livre est référencé. Après "Obscurité" (roman), "Le temps de l'errance" (poésie) et "Ici et ailleurs" (nouvelles), voici "Sur les traces d'un amour inoubliable".
Il s'agit d'un roman qui, comme son titre l'indique, parle d'amour, mais pas seulement. Et puis cet amour est un peu particulier. D'abord, il s'agit d'une liaison extra-conjugale (madame est célibataire, monsieur est marié) mais surtout un des deux protagonistes est déjà décédé quand on commence la lecture. On l'aura compris, l’héroïne, blessée, va revenir sur les lieux qu’ils ont fréquentés ensemble. Puis, petit à petit, au-delà de la nostalgie qui l’envahit, elle va découvrir des aspects qu’elle ne connaissait pas chez cet être qui était pourtant si proche d’elle. Altermondialiste actif, se pourrait-il que sa mort n’ait pas été naturelle ? Troublée par ces révélations, elle va parcourir l’Ardenne, la région natale de celui qui fut l’homme de sa vie, pour tenter de comprendre qui il était vraiment.
Au-delà de l’histoire racontée, c’est un livre où j’ai glissé de nombreux souvenirs personnels et si l’imaginaire les a parfois transformés, ils constituent cependant le terreau où ce livre a puisé ses racines.
14:38 Publié dans Littérature, Prose | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature
14/08/2018
Le faucheur et sa faux
Il faisait chaud, terriblement chaud. Ils avaient travaillé toute la journée dans les champs, à couper le blé blond et à le lier en gerbes plus ou moins égales. Puis le soleil, enfin, s’était couché derrière l’horizon, ensanglantant la campagne et jetant sur les meules une couleur rouge sang. Alors, ils avaient repris leurs outils tranchants à la lame maintenant un peu élimée, et s’étaient dirigés vers le village, par groupes de quatre ou cinq. Ils devisaient en chemin et parlaient de la cambrure de reins des juments et de la beauté des femmes. Ils disaient la soif qu’ils avaient et à quel point leur gosier était sec, après ce dur labeur. Ils racontaient des blagues un peu salaces, par lesquelles ils exprimaient leur envie de finir le nuit près d’une fille brune au regard de feu, une belle fille qui les aurait attendus depuis toujours, et dont la langueur lascive ne pouvait laisser personne indifférent. Ils imaginaient sa peau douce et la manière dont elle gémirait quand ils l’embrasseraient dans le cou. Alors, doucement, ils déboutonneraient son chemisier et moissonneraient à pleines mains les tendres fruits de la passion.
Devisant de la sorte, ils étaient arrivés devant le premier cabaret, où ils firent une halte bien méritée. Le vin rosé coula à flot, ainsi que la bière blonde aux saveurs de houblon. Ils burent plus que de raison, mais on pouvait les comprendre. La journée avait été rude, sous la canicule, et là-bas, les gerbes bien alignées témoignaient de leur dur labeur. Ils parlèrent de nouveau de la qualité des juments et de la courbure des reins des femmes, puis s’en allèrent dans un autre établissement, manger une omelette au lard copieusement arrosée de vin.
Il faisait chaud, très chaud. La nuit était parfois déchirée par un éclair lointain. Un orage était possible et on l’espérait presque, tant la chaleur était étouffante et pour ainsi dire accablante. Après le repas, quelques-uns s’endormirent dans un coin de l’établissement, tandis que la plupart sortirent pour aller s’étendre dans le fenil, où ils s’assoupirent bientôt, écrasés de fatigue. Trois rudes gaillards, cependant, restèrent encore un moment à fumer et à deviser de tout et de rien. Ils commandèrent une nouvelle cruche de vin, tant leur soif semblait inextinguible. Ils parlèrent, comme c’est normal, de leur paie, qui était bien maigre, et de la radinerie des patrons. De fil en aiguille, ils se mirent à comparer les différentes fermes où ils avaient travaillé. Hector, le plus âgé, avait roulé sa bosse aux quatre coins du pays et il avait de l’expérience, aussi l’écoutait-on avec attention. Chaque année, après la moisson dans le Nord, il descendait faire les vendanges dans les Pyrénées Orientales, puis quand l’hiver arrivait, il remontait en Provence pour la cueillette des olives. Il se déplaçait à pied, mais trouvait souvent un attelage charitable qui lui permettait d’épargner ses vieilles chaussures. Une fois, il s’était même aventuré jusqu’en Espagne, où on disait qu’il y avait beaucoup de travail. Il s’était ainsi retrouvé dans les grandes haciendas au fin fond de l’Andalousie. Ah du travail, il y en avait, ça c’était sûr ! Et de la chaleur aussi ! Mais pour ce qui était de la paie, c’était encore pire que partout ailleurs. Là-bas, les patrons, qui possédaient des centaines d’hectares, embauchaient à la journée. Chaque matin il fallait faire la file et c’était le contremaître qui choisissait qui il voulait parmi la centaine de pauvres villageois qui attendaient là, certains presque en guenilles. Chacun espérait être pris, mais il y avait forcément des déçus. Et si on avait la chance d’être accepté, il y avait intérêt à se montrer plein d’ardeur au travail si on voulait avoir la possibilité de travailler de nouveau le lendemain. Bref, c’était de l’exploitation pure et simple et le salaire était une vraie misère. Face à cette injustice, Hector n’avait pas réagi. Qu’aurait-il pu faire face à ces puissants propriétaires ? Rien du tout. Mais il en avait gardé un sentiment de haine et une volonté farouche de vengeance. Il s’était mis à fréquenter des gens proches des syndicats et finalement il était devenu une sorte d’anarchiste. Quand il parlait, tout le monde l’écoutait, tant il s’exprimait avec fougue, mais il fallait bien reconnaître que ses interlocuteurs avaient toujours un petit sourire aux lèvres. Sans doute ne comprenaient-ils pas vraiment le sens profond de ses propos et n’étaient-ils frappés que par sa véhémence outrancière, qui en effet avait un côté comique. Plus il parlait en essayant de convaincre son auditoire, plus celui-ci se montrait ironique à son égard, ce qui avait le don de l’exaspérer.
Ce soir-là, cependant, il ne parla pas de politique ni de lutte des classes. Non, il raconta une belle histoire d’amour. Il expliqua comment lui, l’éternel voyageur sans attaches, l’anarchiste contestataire de l’ordre établi, avait finalement craqué pour une fille qui l’avait ensorcelé au point qu’il avait voulu se marier avec elle. Oui, il aurait été prêt à mener une existence des plus rangées et même à passer devant le curé pour faire bénir les anneaux, c’était tout dire. Elle était belle, délicieusement belle, avec une longue chevelure noire qui descendait en cascades jusqu’au milieu du dos. Elle avait des yeux de braise et quand elle vous regardait, on se sentait transpercé jusqu’au plus profond de son être. N’allez pas croire pour autant qu’elle était provocante. Non, au contraire, elle avait un petit côté timide et réservé qui était tout à fait charmant et qui faisait qu’on avait envie de la protéger.
Il l’avait connue l’année dernière, au moment de la fenaison. C’était la fille du fermier pour lequel il travaillait et c’était elle qui venait vers midi apporter le déjeuner, généralement de grandes tartines de pain gris avec une omelette et du vin rosé qui vous chatouillait la gorge quand vous le buviez. Peut-être d’ailleurs était-ce ce vin qui lui avait tourné la tête et qui lui avait donné le courage de parler à la belle. Oh, avec les autres femmes, il n’avait jamais eu peur, et il n’était pas le dernier à leur faire des sourires ou à leur pincer la taille derrière une meule de foin, mais avec celle-là, c’était différent. Il la trouvait tellement belle et tellement « comme il faut » qu’il n’aurait jamais rien entrepris sans la douce ivresse du vin. Certes, il avait bien remarqué qu’elle le regardait à la dérobée quand elle arrivait avec ses paniers chargés de victuailles, mais il l’idéalisait tellement qu’il la considérait comme inaccessible. Pourtant, un jour de grande chaleur, après avoir mangé, pendant que les autres ouvriers faisaient une sieste à l’ombre des haies, il l’aida à tout remettre en place dans ses paniers et là, par hasard, leurs mains se frôlèrent. Ce simple geste suffit et le regard qu’ils échangèrent alors contenait en germe tout ce qui allait suivre. Le lendemain, ils eurent une longue conversation, ponctuée de sourires complices, et le surlendemain fut le jour du premier baiser. La suite, il n’est pas besoin de la raconter. Pendant que tout le monde faisait la sieste, eux deux allaient s’isoler dans un champ voisin, où une petite cabane servant à ranger les outils leur offrait un lieu idéal pour s’aimer tout à loisir. Il se souviendrait toute sa vie du trouble qui fut le sien en déboutonnant pour la première fois le beau chemisier bleu qu’elle portait avec élégance et qui l’avait tant fait rêver. Il se perdit dans la douceur de ses bras et en ressortit tout hébété, amoureux comme il ne l’avait jamais été.
Les jours passèrent les uns après les autres, et arriva le moment fatal de la fin de la moisson. Il allait falloir partir, trouver un autre travail, et abandonner ce paradis terrestre, où l’Eve éternelle s’était donnée sans retenue. L’idée d’une séparation était intolérable, aussi décidèrent-ils de se voir durant les trois nuits qui restaient à leur disposition. Pour elle, ce n’était pas là une chose facile, car elle devait quitter discrètement le logis paternel sans se faire remarquer et le réintégrer à l’aube, ce qui était encore plus compliqué. Elle le fit pourtant sans hésiter, tant sa passion était forte. Ils dormirent dans les meules de foin ou plutôt dormirent bien peu, car chacun voulait faire le plein d’émotions et conserver de l’autre le plus de souvenirs possible. Ils n’en finirent plus de s’aimer, alliant caresses tendres et fougue érotique.
Mais vint le moment, après la troisième nuit, où le soleil pointa irrémédiablement derrière l’horizon, illuminant de ses rayons les champs remplis de gerbes fraîchement fauchées. L’heure du départ avait sonné et elle fut douloureuse. Ils n’en finissaient plus de se dire adieu, de se quitter pour aussitôt revenir s’embrasser dans des étreintes qu’ils auraient voulu voir durer toujours. Mais c’était la dure réalité, il fallait partir, abandonner ces lieux enchanteurs et cet être fragile qui vous regardait avec désespoir, des larmes plein les yeux.
Il fut le plus fort et finit par s’en aller, non sans avoir assuré qu’il reviendrait dès qu’il le pourrait. Oui, mais quand ? Cela, c’était impossible à dire. Il avait beau promettre, il ne pouvait fixer aucune date avec certitude et quand il se retourna une dernière fois, il vit que les larmes coulaient sur le beau visage de celle qu’il aimait. Alors, pour ne pas pleurer à son tour (ce qui assurément ne lui était jamais arrivé), il fonça vers la forêt, où il disparut bientôt. Une page de sa vie venait de se tourner, mais il ne le savait pas encore.
Le lendemain, il était déjà loin, ayant marché toute la journée et toute la nuit pour tenter d’oublier son chagrin. Il marcha ainsi une semaine entière et finit par trouver du travail dans une petite exploitation assez pauvre dont les champs remplis de pierres ne semblaient pas fort propices à la culture du blé. Il y resta dix jours, le temps de faucher le peu qu’il y avait à récolter, puis il revint d’où il était parti, afin de faire une surprise à sa bienaimée (et surtout afin de pouvoir la tenir une nouvelle fois dans ses bras). C’est en arrivant au village qu’il apprit la nouvelle. De désespoir, la jeune fille s’était jetée dans un étang et on venait de l’enterrer la veille. On disait (mais les gens sont tellement médisants…) on disait que la pauvrette était enceinte et qu’elle avait commis cet acte de désespoir après avoir été chassée du domicile familial par ses parents.
De tels propos étaient évidemment une pure calomnie. Si elle était morte, c’était de désespoir parce qu’elle s’était imaginé ne jamais revoir celui qu’elle aimait. Il le savait bien, lui. Sans rien dire, il se dirigea vers la maison des parents. Il frappa à la porte, mais il n’y avait personne. Alors, il entra discrètement et déposa sur la table de la cuisine l’argent de ses deux dernières paies. Sur l’enveloppe froissée, il écrivit ces simples mots : « Pour Marie », puis il s’en alla.
Quand il eut terminé son histoire, les deux autres se turent, ne sachant que dire. Lui se leva sans un mot et décida d’aller dormir, mais avant de disparaître dans la nuit, il ajouta encore ceci : « Ca s’est passé ici et elle repose au cimetière du village. Si vous allez voir, vous reconnaîtrez sa tombe, j’y ai dessiné un champ de blé avec un faucheur tenant sa faux. Tout le monde croit que ça représente la mort, mais non. C’est une allusion à notre amour au milieu des moissons.»
12:59 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (0)
07/05/2018
Une librairie fantastique (fin)
Le temps passait et il était déjà deux heures du matin. Il devenait urgent d’aller explorer la deuxième salle, celle que les cartons non déballés avaient transformée en un véritable labyrinthe. Il n’y avait plus de bandes dessinées, ici, mais plutôt des livres étranges, sur la magie noire, la sorcellerie, les mondes disparus comme l’Atlantide, les forêts ténébreuses remplies d’esprits, ou encore le monde légendaire du Moyen-Age (la quête du Graal, le château des quatre fils Aymon, le cycle de Charlemagne ou celui de Bretagne). J’ai retrouvé là le « Lancelot du Lac » de Chrétien de Troyes et j’en ai relu quelques pages avec plaisir. Sur le radiateur, traînait une édition bilingue (ancien français–français contemporain) de la « Chanson de Roland », que j’avais étudiée dans ses moindres détails lors de mes lointaines études :
CARLES li reis, nostre emperere magnes,
Set anz tuz pleins ad estet en Espaigne :
Tresqu’en la mer cunquist la tere altaigne.
N’i ad castel ki devant lui remaigne ;
Mur ne citet n’i est remés a fraindre,
Fors Sarraguce, ki est en une muntaigne.
Il me semblait, en lisant ces lignes, que les mots venaient à moi, comme si je les connaissais de toute éternité. J’ai reposé le livre et en ai choisi un autre, consacré à la forêt de Brocéliande. Cette fois, la magie n’opéra pas. J’étais fatigué et mes yeux commençaient à se fermer bien malgré moi. Il était temps de songer à me reposer quelques instants sur le fameux lit de camp dont m’avait parlé le libraire. C’est à ce moment précis que j’ai entendu un bruit dans le fond de la pièce. Une image me traversa soudain l’esprit : la femme que j’avais saluée juste avant la fermeture, où était-elle passée ? Elle n’avait pas pu aller rejoindre le libraire dans son appartement, puisque je m’étais précipité le premier, en entendant le volet de l’entrée qui se fermait. Se pourrait-il qu’elle fût encore là ? Peut-être était-elle, elle aussi, une cliente, fascinée par le monde des livres ? Lisait-elle les aventures de Tristan et Iseult ou bien s’était-elle endormie sur le fameux lit de camp que je convoitais maintenant ? Sans que je sache pourquoi, l’image de la jeune fille dénudée de Thorgal refit subitement surface dans mon esprit, et c’est avec un trouble certain que je me suis avancé vers l’extrémité de la salle. Arrivé contre le mur du fond, je vis dans un coin une espèce de matelas posé sur une structure métallique sommaire. Il n’y avait personne d’autre que moi dans cette salle. Visiblement, mon imagination avait dû me jouer un tour. On ne côtoie pas le monde de l’imaginaire impunément ! Je me couchai sur le matelas et fermai les yeux. Immédiatement, le sommeil s’empara de moi et m’emporta vers les contrées, plus étranges encore, des rêves.
J’étais sur un grand voilier, une sorte de caravelle de l’ancien temps, et je voguais sur une mer d’un bleu intense. Des requins suivaient le navire, menace évidente pour qui serait tombé à l’eau. Pourtant, c’était plus fort que moi, je me penchais très fort, désirant contempler une sirène qui nageait entre deux eaux. Parfois elle folâtrait à ras des flots et je pouvais voir sa longue chevelure ondoyante, ainsi que ses épaules et son dos nus. Parfois, au contraire, elle plongeait plus profondément, semblant m’inviter à la suivre. Alors, attiré comme par une force irrésistible, je me penchais plus fort encore, presque dangereusement, pour tenter de l’apercevoir. Je repensais à Ulysse, qui avait été confronté au chant des sirènes du côté de la Sicile. La mienne ne chantait pas, mais elle me fascinait par son beau corps, qu’elle ne montrait en partie que pour mieux le cacher ensuite. J’étais devenu l’esclave de ce jeu de cache-cache et le dessinateur de Thorgal aurait souri s’il avait dû croquer cette scène en quelques coups de crayon.
A ma grande déconvenue, la sirène disparut soudain, ayant sans doute plongé définitivement dans les eaux bleues de l’océan. J’en étais tout dépité, quand j’entendis un chant qui semblait sortir tout droit de l’abîme. Je me suis réveillé et, ô stupeur, le même chant mélodieux continuait, comme s’il émanait de l’autre extrémité de la pièce. Je me suis levé précautionneusement, le cœur battant, et me suis approché des caisses de livres. Le chant s’arrêta aussitôt, comme celui des cigales quand on passe sous le pin où elles ont élu domicile. De quel sortilège étais-je la victime ? Tout se mélangeait dans ma tête, la sirène, l’esclave nue de la bande dessinée, la jeune femme entrevue ici même hier au soir… Se pourrait-il que celle-ci fût cachée quelque part entre ces caisses ? Je le redoutais et le désirais à la fois. Qui était-elle ? Un être fabuleux, sorti tout droit du monde imaginaire évoqué dans les milliers de livres qui m’entouraient, ou bien un être de chair, désirable comme la sirène de mon rêve ? Finalement, n’étais-je pas moi-même l’esclave de cette attirance pour le corps féminin, qui, par sa différence avec le mien, n’en finissait plus de me fasciner ? Je contournai les boîtes de carton, longeai le radiateur, revint sur mes pas. Personne ! C’est alors qu’il me sembla entendre les ressorts du lit de camp grincer et percevoir comme un petit rire étouffé. J’allais faire un pas dans cette direction, le cœur battant à tout rompre, la peau frémissante de désir, quand une voix virile retentit à l’autre extrémité du magasin.
— Alors, vous avez passé une bonne nuit ? Il est sept heures du matin et je vous apporte le petit déjeuner, vous l’avez bien mérité.
C’était le libraire qui venait de se lever. Il tenait d’une main une assiette remplie de croissants et de l’autre une cafetière fumante.
— Avez-vous pu dormir un peu ? J’espère que le bruit des souris, qui trottinent toute la nuit entre les caisses ne vous a pas trop dérangé ? Certains des visiteurs qui vous ont précédé m’ont dit avoir été importunés par leurs cris et leur sarabande. Il faudrait quand même bien qu’un de ces jours je me décide à poser quelques trappes.
Je le regardai, incrédule.
— Ben oui, poursuivit-il, en versant le café bouillant dans les tasses, il ne faudrait quand même pas qu’elles se mettent à grignoter les livres. Notez que je pourrais acheter un chat, comme on faisait autrefois sur les vieilles caravelles. J’aime les chats et j’adore par-dessus tout caresser leur fourrure soyeuse. Mais ce sont des animaux capricieux, comme les femmes, finalement.
— Comment cela ? Vous n’aimez pas les femmes ?
— Si, bien sûr. Elles sont fascinantes comme des sirènes, mais elles savent aussi nous rendre esclaves de leur beauté. Souvenez-vous d’Ulysse, qui est ainsi resté sept longues années dans l’île de la princesse Calypso, dont il ne parvenait plus à se séparer parce qu’il aimait un peu trop l’éclat de ses yeux et sa nudité de déesse.
— Oui, c’est vrai, vous avez raison. Au fait, croyez-vous qu’il y avait des chats, sur son bateau, pour combattre les souris ?
— Ca se pourrait, en effet. D’ailleurs j’adore l’expression « jouer au chat et à la souris », n’est-ce pas ce que nous faisons, nous les hommes, dans nos rapports avec les femmes ? On ne sait jamais qui attire l’autre, ni surtout qui va gagner à ce jeu de dupes.
Que répondre à cette vérité ? J’ai mangé mon croissant en silence, tout en méditant sur la capacité de la littérature à exprimer toutes ces relations complexes, qui sont au centre de notre vie. Vers huit heures, j’ai pris congé de mon hôte, tout en le remerciant avec un petit sourire pour son hospitalité. Je me suis retrouvé dans la rue et le temps était doux et ensoleillé. Il me fallait maintenant regagner ma voiture, qui devait toujours se trouver dans ce quartier éloigné et délabré où je l’avais laissée. Devant moi, sur la place de la mairie, une jeune femme se dirigeait vers les bâtiments administratifs. Elle portait une jupe courte, qui s’agitait dans la brise matinale, et qui laissait voir ses jambes nues. Je la suivis du regard, incapable de détacher les yeux du mouvement souple de ses hanches. Bientôt elle disparut derrière la porte d’entrée, me renvoyant inexorablement à ma solitude et à mon désir inassouvi.
Je me perdis un peu en recherchant mon véhicule. Quand je le retrouvai enfin, un PV pour stationnement interdit était apposé sur le pare-brise. Voilà une journée qui commençait bien mal !
Otto Greiner - Ulysse et les sirènes

23:38 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (4)
02/05/2018
Une librairie fantastique (2)
Je commençais à me demander pour de bon où je me trouvais, quand j’entendis le volet de l’entrée qui se fermait. Un coup d’œil à ma montre m’indiqua qu’il était dix-neuf heures. Il était plus que temps de sortir de ma rêverie et de m’en retourner chez moi. Mais une fois dans la première pièce, je m’aperçus qu’il n’y avait plus personne ! Des bruits de pas dans un escalier dissimulé derrière une porte attirèrent mon attention.
— Holà ! Monsieur le libraire ? Je suis un client et je voudrais sortir. Comment fait-on ?
Il se pencha par-dessus la rampe et me dit en riant :
— Mais à cette heure on ne sort plus, voyons. Je ferme tous les jours à dix-neuf heures, ce qui est beaucoup plus tard que mes confrères. Alors, tant pis pour les clients qui se font prendre au piège. Ils passent la nuit dans la librairie ! S’ils se sont attardés si tard et se sont laissé surprendre par la fermeture du volet, c’est qu’ils aiment les livres, non ? Alors ils peuvent bien passer une nuit en leur compagnie. Rassurez-vous, vous n’êtes ni le premier ni le dernier à qui cela est arrivé et personne ne s’est encore plaint.
– Quoi ? vous voulez dire que je vais passer la nuit ici ?
— Ben oui, une fois le volet fermé, il n’y a plus d’autre issue vers la rue. Est-ce que par hasard vous n‘aimeriez pas les livres ?
— Si, absolument, mais enfin…
— Eh bien alors, tout est pour le mieux ! Vous verrez, vous ne le regretterez pas. La lampe reste allumée toute la nuit et dans le pire des cas, il y a dans la salle du fond un lit de camp destiné aux visiteurs attardés. Si vous vous trouvez trop fatigué à un certain moment et que vous désirez faire un petit somme, ne vous gênez pas. Faites comme chez vous. Là-dessus, je vous laisse et à demain. Je vous souhaite une joyeuse nuit au milieu de tous les héros des bandes dessinées.
Le libraire se remit à gravir les marches et j’entendis bientôt la porte de son appartement qui se refermait derrière lui. Quelle affaire ! Je n’avais jamais vécu une telle aventure ! Mais après tout, pourquoi pas ? J’aimais les livres, je les adorais, et je n’arrêtais pas de le répéter. Je n’allais quand même pas rechigner devant le fait de passer une nuit en leur compagnie ! Certes, il s’agissait ici essentiellement de bandes dessinées, et le moins que l’on puisse dire c’est que je ne maitrisais pas la matière, mais pourquoi ne pas relever le défi ? Ce serait l’occasion de découvrir un monde pour moi quasi inconnu.
Je me mis donc à parcourir les rayonnages et à prendre une BD de temps à autre. J’ai commencé par celles que je connaissais, comme Tintin ou les Schtroumpfs. Assis par terre, j’ai relu intégralement « Tintin au Tibet » et j’ai retrouvé le sens de l’amitié en partant à la recherche de Tchang dans les neiges himalayennes. Puis ce fut « l’Etoile mystérieuse », avec ses savants fous et ses araignées géantes. Littéralement captivé, j’ai choisi ensuite « Le Trésor de Rackham le Rouge » et c’est avec la même émotion que lorsque j’avais dix ans que j’ai plongé au milieu des requins, revêtu d’un scaphandre, à la recherche du fameux trésor du chevalier de Haddock. Oui, à travers ces bandes dessinées, je retrouvais ma capacité enfantine à m’émerveiller. Car c’était bien grâce aux livres, qu’à peine âgé de six ans, j’avais quitté le monde réel pour celui de l’imagination. J’en avais vaguement conscience, mais là, en relisant tous ces récits, je me rendais bien compte que tout avait débuté à leur contact, un demi-siècle plus tôt.
Il était déjà presque minuit quand je me suis décidé à quitter l’univers de Tintin pour poursuivre mes découvertes. Mais ce fut d’abord pour rechercher une nouvelle fois les autres ouvrages qui avaient accompagné mon enfance : les Schtroumpfs, Michel Vaillant, Tanguy et Laverdure… Deux bonnes heures se passèrent encore en leur compagnie. Comment avais-je pu les oublier, eux qui m’avaient fait tellement rêver ? En parcourant les rayonnages, j’ai même retrouvé Alix, cet esclave gaulois qui vivait dans la Rome antique. Je ne possédais chez moi aucun livre d’Alix, mais je lisais ses aventures à la dérobée, de manière illicite, dans les rayons des grandes surfaces. J’étais fasciné, à l’époque, je m’en souviens très bien, par la semi-nudité des personnages. J’allais bientôt terminer mes primaires, et la pré-adolescence n’était pas loin, qui allait bientôt me laisser pantois devant le corps des filles. Un souvenir me revint. J’avais lu à l’époque dans Thorgal (toujours dans une grande surface) une scène qui m’avait à la fois bouleversé et indiscutablement attiré. Il s’agissait d’une vente aux esclaves et une jeune fille resplendissante était amenée sur une estrade pour être achetée. Pour faire monter le prix, le vendeur n’hésitait pas à la dévêtir complètement d’un geste autoritaire, la laissant complètement nue devant les regards du public. Je me souviens parfaitement d’avoir compati à sa gêne, qu’on devine terrible, mais je sais aussi qu’au même instant je n’en finissais pas d’être fasciné par son corps de déesse, et notamment par sa poitrine, qu’elle tentait de dissimuler d’une main, tandis que de l’autre elle essayait de cacher son sexe. Cette scène avait marqué assurément ma sortie de l’enfance et mon entrée dans l’arène sexuelle de l’adolescence. Il fallait absolument que je retrouve le volume concerné. Je passai une bonne heure à le chercher, mais quand je l’eus enfin en main, c’est avec une émotion indescriptible que je me suis mis à lire l’histoire. Arrivé à la scène décrite plus haut, la même émotion emplit tout mon être. Cette femme, j’avais d’abord envie de la revêtir de sa tunique, pour qu’elle oublie sa nudité forcée, puis de me jeter à ses genoux, pour lui demander pardon de la bestialité des hommes. Pourtant, en même temps, je n’arrêtais pas, malgré moi, d’admirer ses formes parfaites, qui me fascinaient. Rien n’avait donc changé depuis l’époque lointaine où j’avais fait sa « connaissance », car en l’occurrence, on peut bien parler de rencontre, les personnages de papier étant parfois plus présents dans notre imaginaire que les êtres que nous côtoyons tous les jours.

16:01 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (8)
30/04/2018
Une librairie fantastique
Je cherchais, depuis quelque temps déjà, une édition originale de Julien Gracq. Comme mes démarches n’aboutissaient à rien, une connaissance m’avait donné l’adresse d’un bouquiniste obscur qui passait pour collectionner quelques raretés.
— Va donc y jeter un coup d’œil, m’avait-il dit, si tu ne trouves pas là ce que tu recherches, tu ne le trouveras nulle part ailleurs.
Je n’avais rien à perdre, aussi avais-je donc décidé de suivre son conseil. La fameuse boutique se situait, paraît-il, près de la place de la mairie à La Louverie. Comme ce n’était pas trop loin de chez moi, je me suis donc mis en route. Trouver la mairie ne fut pas un problème, par contre trouver un emplacement de parking le fut bien davantage. Après avoir tourné pendant une bonne demi-heure, il fallut bien me résoudre à garer ma voiture dans un quartier passablement éloigné du centre névralgique et politique de cette cité au lourd passé industriel. Après avoir longé à pied quelques rues aux maisons basses et avoir traversé des friches et des terrains vagues où, je suppose, devaient être implantées autrefois les usines qui avaient fait la prospérité de la région, je me suis enfin retrouvé sur la place de la mairie. C’était une espèce de grand espace désert, entouré de bâtiments administratifs et d’une banque. En tout cas, rien dans ce paysage qui ressemblât à une échoppe de bouquiniste. J’ai fait deux fois le tour de la place, puis j’ai parcouru dans les rues adjacentes, rien. Je commençais sérieusement à me demander si mon ami ne m’avait pas fait une méchante blague aussi, pour en avoir le cœur net, ai-je abordé le premier passant rencontré. C’était un adolescent, plongé comme de bien entendu dans la lecture de son portable. Il parut passablement étonné que je lui adresse la parole et j’ai débord cru qu’il allait s’enfuir. Mais non, poliment, il a ôté le casque qui recouvrait ses oreilles et m’a écouté attentivement.
Une librairie dans le quartier de la mairie ? Non, ça ne lui disait pas grand-chose. Il faut dire qu’il n’était pas grand amateur de livres, mais quand même, il aurait dû la connaître, il était du coin. Non, franchement il ne voyait pas. Il interpella alors un de ses copains, qui lui aussi semblait plongé dans la lecture attentive de son Iphone. Celui-là ne lisait pas non plus et honnêtement, les librairies, ce n’était pas son truc, mais il croyait savoir que dans une des rues adjacentes, il y avait du côté droit une petite ruelle où pourrait bien se trouver ce que je cherchais. En tout cas, lui qui traînait sur la place à longueur de journée, il avait déjà vu des passants sortir de cette ruelle en tenant des bouquins sous le bras. Après avoir remercié les deux jeunes, je pris donc la direction indiquée et en effet, je trouvai la ruelle en question et tout au bout la librairie tant recherchée. J’en poussai la porte avec une joie non dissimulée, persuadé que j’allais enfin mettre la main sur le fameux original de Gracq que j’espérais trouver depuis si longtemps.
Une fois à l’intérieur, je compris immédiatement que je m’étais trompé d’enseigne, car on ne vendait ici que des bandes dessinées. Pourtant, loin d’être déçu, je suis immédiatement resté en admiration devant ce qui s’offrait à moi. J’étais entré dans une véritable caverne d’Alli Baba. Les étagères couvraient les murs jusqu’au plafond et il n’y avait pas un rayonnage qui ne fût entièrement rempli. Je ne sais pas combien de bandes dessinées devaient se trouver là, mais assurément je n’en avais jamais vu autant.
— Bonjour, me dit le libraire.
— Heu… Bonjour.
Je ne l’avais pas vu, celui-là ! A moitié caché derrière son comptoir sur lequel s’empilait un amoncellement de boîtes et de livres, je n’avais même pas remarqué sa présence, tout occupé que j’étais à admirer la somme prodigieuse de bouquins que renfermait cette boutique. Car c’était bien d’une boutique qu’il s’agissait. Rien de pompeux, ici, pas d’étagères en chêne ou de comptoir vernissé. Non, mais de vieux rayonnages qui ployaient sous le poids des volumes. Le tout avait une vague ressemblance avec les vieilles épiceries de village, que nous avons tous connues dans notre prime enfance. Aucun luxe en ces lieux, mais on y trouvait de tout.
— Vous cherchez quelque chose de précis ?
— Heu non, ou plutôt oui, mais je crois que je me suis trompé de librairie. Cependant, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, je vais quand même jeter un coup d’œil.
— Faites seulement, faites, les livres sont là pour être admirés et consultés.
Cette réponse me plut. J’avais affaire à un passionné, cela se sentait, et d’ailleurs l’atmosphère qui se dégageait de toute la boutique le prouvait à suffisance. Je m’avançai sur un vieux tapis tout usé, qui laissait voir par intermittence le carrelage qu’il avait dû recouvrir un siècle plus tôt, mais qu’il était bien incapable de dissimuler aujourd‘hui, tant il était troué. Curieusement, ce détail me plut au plus haut point. Manifestement le tenancier n’était pas là pour faire fortune ni pour épater le client. Non, s’il se tenait derrière son comptoir, ce n’était pas pour compter les billets de banque gagnés au cours de la journée, mais parce qu’il aimait les bandes dessinées et qu’il voulait faire partager sa passion. C’était son métier, cependant, et on se demandait bien comment il parvenait à boucler les fins de mois, car j’étais manifestement le seul curieux à flâner entre les rayonnages. Pourtant, la quantité de livres présents prouvait qu’on n’était pas à la fin d’une époque plus glorieuse ou à la veille d’une faillite. Il fallait croire que le bonhomme parvenait à s’y retrouver tout de même, même s’il ne devait pas rouler sur l’or.
Je continuai ma visite et passai dans la seconde salle. C’était un capharnaüm incroyable ! Non seulement les mêmes rayonnages continuaient à couvrir les murs jusqu’au plafond, mais en plus il fallait cheminer entre des caisses non déballées qui constituaient une sorte de labyrinthe au milieu de la pièce. Ajoutez à cela un radiateur volumineux et décentré qu’il fallait contourner, et une ou deux tables où s’amoncelaient pêle-mêle des jeux vidéo et des livres sur la forêt de Brocéliande ou les légendes galloises et irlandaises. Au sol, le même tapis miteux continuait d’avouer son âge et montrait à travers ses nombreux trous un carrelage d’une époque elle aussi révolue. Tout au bout, derrière une pile de bouquins, une jeune femme se tenait debout. Elle me sourit et me fit un petit signe de la main. Ce devait être l’épouse du libraire et je lui rendis son sourire.
(à suivre)

01:14 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (3)
21/09/2017
"Ici et ailleurs" (nouvel extrait de mon dernier livre)
EXTRAIT DE LA NOUVELLE « LE TEMPLE DU SOLEIL »
Le camion aborde le premier virage en lacet. Le moteur cogne, le changement de vitesses grince. Derrière, une épaisse fumée noire jaillit du pot d’échappement. Il n’y a rien à faire : la pente est trop forte. Il va falloir qu’il se déporte à l’extrême gauche ou il ne passera pas! Instinctivement, le chauffeur a réagi : il braque le volant autant qu’il peut. Le bahut se déplace, le voilà de l’autre côté de la route. Le pneu avant mord même la poussière du fossé ! Cela fait un de ces nuages ! Les branchages griffent la carrosserie. Pourvu qu’il ne vienne rien en face. Non, ouf, c’est fini ! Le premier virage est passé. Il n’y en a plus que deux mille cinq cents quatre-vingt-quatre.
C’est qu’elle les connaît, Isabel les virages qui mènent à l’Altiplano. Cela fait cinq ans, maintenant, qu’elle fait la route, toujours la même. Elle charge des marchandises en bas, dans la forêt, et elle les achemine là-haut, dans la capitale. Cela peut paraître simple, mais ce ne l’est pas. En bas, c’est l’équateur, la forêt vierge, la chaleur, les moustiques, la malaria. En haut, ce sont les montagnes et les deuxièmes du monde encore bien. La Paz culmine à 3.658 mètres d’altitude et le lac Titicaca n’est pas loin. D’un côté, c’est l‘été, de l’autre l’hiver. Et puis il y a les habitants. Tous des Indiens, certes, mais tellement différents. Les gens de la plaine ont une certaine mentalité, ceux des sommets une autre. Leur seul point commun, c’est d’être tous des Indiens. C’est déjà ça. Et elle, Isabel, elle est comme un trait d’union entre ces deux mondes. Indienne aussi, forcément, comme tout le monde en Bolivie. N’empêche que le fait d’être une femme a quelque chose de singulier. Tous les autres chauffeurs sont des hommes, elle doit être la seule femme de la profession et elle en est fière. Comme elle est fière d’amener dans la capitale andine toutes ces nourritures exotiques de la plaine. Originaire de la zone intermédiaire des collines, elle se sent partout chez elle. Ce qui signifie aussi qu’elle est étrangère des deux côtés. Elle n’est pas de l’Amazonie, mais elle n’est pas non plus des sommets andins. Qui est-elle finalement ? Elle serait bien en peine de le dire. Alors elle voyage et essaie de trouver son identité sur les routes, entre les chaleurs étouffantes de la forêt et les crêtes brumeuses des montagnes.
Mais voilà le deuxième virage. Il tourne dans l’autre sens, celui-là, de la gauche vers la droite. Ce sera donc plus facile, elle ne sera plus du côté du précipice et bénéficiera de la pente la moins raide. C’est déjà ça. Il faut dire que la route est à peine asphaltée. Pourtant elle l’a été autrefois, à certains endroits en tout cas... Mais il y a longtemps de cela et la nature a repris ses droits. Le macadam, petit à petit, s’est effrité et il ne faut pas croire que le gouvernement l’a remplacé. Non. D’ailleurs il ne faut jamais compter sur le gouvernement ! Les politiciens, là-haut, à La Paz, ont autre chose à faire. La révolution pour commencer ! Et puis, une fois qu’ils sont au pouvoir ils pensent un petit peu à eux. C’est normal après tout, ils ont tout de même risqué leur vie dans ces coups d’état. Alors, dès qu’ils sont installés derrière leur beau bureau de président ou de ministre, ils essaient de compenser, c’est-à-dire de s’enrichir par tous les moyens. Qui pourrait le leur reprocher ? S’ils sont d’origine modeste, on ne les pendra pas au sérieux tant qu’ils ne seront pas riches. Et s’ils proviennent d’une famille de notables, on ne trouverait pas normal qu’ils baissent de statut et qu’ils s’appauvrissent. Un député, un sénateur, un ministre, cela doit être riche pour être respectable, un point c’est tout. Ici, en Bolivie, vous ne rencontrerez jamais un être humain qui pensera le contraire.

16:13 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature
24/08/2017
Marie
Les années avaient passé, beaucoup d’années même, et voilà qu’il était revenu au village. Pourquoi ? Nul ne le savait et lui encore moins qu’un autre. Le hasard sans doute. Il ne passait pas loin de là et l’idée lui était venue de faire un détour. Pourtant chacun sait qu’il n’y a jamais vraiment de hasard.
Il était revenu et la première chose qu’il avait vue, c’était la fontaine sur la place. Elle n’avait pas changé et le doux murmure de l’eau qui s’écoulait lui sembla aussitôt familier. Son cœur à lui non plus, n’avait pas changé, car il se mit à battre plus vite. C’est que c’était là, assis sur le rebord de pierre, qu’il avait dit à Marie qu’il l’aimait. Quarante années s’était écoulées et il se rendait compte qu’il n’avait rien oublié et qu’il conservait en lui cette blessure.
Il se mit à parcourir le village, mais cette visite se transforma rapidement en pèlerinage. Était-ce encore le hasard qui lui avait fait prendre la petite ruelle sur la gauche, celle qui conduisait au fenil du père Mathieu ? Non, on aurait dit que quelqu’un guidait ses pas, c’était troublant. Il regarda attentivement le bâtiment, un peu délabré aujourd’hui. Qu’est-ce qu’il avait été heureux, ce jour-là, allongé dans le foin, quand Marie était venue s’allonger près de lui…
Plus loin, de l’autre côté de la rivière, il revit la maison de son amoureuse ou plutôt celle de ses parents. Il n’y était jamais entré car on le trouvait trop pauvre sans doute, pas assez bien pour fréquenter la fille du plus gros fermier de la région. Qu’est-ce qu’il y pouvait, lui, si on était pauvre chez lui et si son père était communiste et ne fréquentait pas l’église ? Il n’y pouvait rien du tout et d’ailleurs on n’entre jamais dans de telles considérations quand on aime. Non, l’amour vient comme cela, comme une grâce, sans qu’on sache pourquoi. Subitement, deux êtres se croisent et ils comprennent au premier regard qu’ils sont faits l’un pour l’autre, c’est tout.
Cela avait été difficile, cette période, il ne s’en souvient que trop bien. Il fallait se cacher, ne rien dire, conserver le secret. C’était l’époque des rendez-vous clandestins à l’orée de la forêt ou dans les carrières de schiste à la sortie du village, jusqu’au jour où on les avait vus. C’était inévitable, finalement, ils se rencontraient trop souvent, ne pouvant se passer l’un de l’autre.
Alors il avait fallu tout arrêter, ne plus se voir, ne plus se parler. Même s’écrire était impossible ! C’était à ce moment-là qu’il avait dû partir pour le service militaire et c’était là-bas, bien loin, dans les Aurès algériens, qu’il avait appris que Marie allait se marier. Telle était paraît-il la volonté de son père. Que devait-il faire ? Déserter ? Ce n’était pas l’envie qui lui en avait manqué, mais que faire quand on est perdu dans des montagnes, à l’entrée du grand désert de sable et que des rebelles vous attendent embusqués à chaque tournant du chemin ? Il fallait mieux attendre la première permission, dans un mois, en espérant que le mariage n’aurait pas lieu avant. Evidemment il avait écrit à Marie, pour lui dire de refuser ce qu’on lui imposait et lui demander de l’attendre lui, qui l’aimait plus que tout. Il évoquait aussi le fenil du père Mathieu, pour lui rappeler qu’en fait elle était déjà sa femme depuis longtemps. Il découvrirait plus tard qu’elle n’avait jamais reçu cette lettre ou en tout cas que son père ne la lui remit jamais.
Et c’est comme cela que le drame est arrivé. Marie n’a pas supporté d’être mariée de force à un homme qu’elle n’aimait pas. C’est le matin des noces qu’on l’a retrouvée, pendue dans sa chambre.
Il lui semble que tout cela vient d’arriver hier. Il marche et se retrouve devant l’église, celle-là où il n’a jamais mis les pieds. Le petit cimetière est juste à côté. Il ouvre la vieille grille de fer qui grince un peu et la première chose qu’il voit c’est la tombe toute blanche de Marie. Non, vraiment, il n’y a jamais de hasard.

01:08 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (11)
14/04/2017
Un conte japonais
On se souvient de Pénélope, qui défaisait la nuit le voile qu’elle confectionnait pendant la journée (lequel devait servir à envelopper le corps de son beau-père Laërte, lorsque celui- mourrait). Cette ruse habile lui permit de repousser les prétendants qui accouraient nombreux et qui souhaitaient l’épouser. Plus tard, elle eut une autre idée : celui qui arriverait à bander l’arc de son mari Ulysse pourrait prétendre à sa main. On connaît la suite : seul Ulysse, qui revenait enfin de son interminable périple, parvint à tendre l’arc et à décocher des flèches contre ses rivaux.
On trouve dans les contes d’autres stratagèmes du même genre. Souvent, la fille d’un roi sera donnée en récompense au héro valeureux. Dans quelques cas, la situation est inversée, comme dans Cendrillon, où ce sont les jeunes filles qui se précipitent en espérant que leur joli pied rentrera dans la fameuse pantoufle. Dans ce cas, c’est le roi qu’elles désirent épouser. Alors que dans l’Odyssée on avait une femme qui se refusait à de nombreux prétendants, on a ici de nombreuses femmes qui voudraient à tout prix épouser un homme remarquable.
Parfois, la situation est encore différente. On a une femme seule qui cherche l’amour mais qui ne consentira à se donner qu’à celui qui réalisera un exploit extraordinaire (Pénélope, elle, espérait bien que personne ne parviendrait à tendre l’arc).
Il en va ainsi dans un conte japonais. Une princesse avait fait confectionner un tambour dont la peau était faite d’une toile de soie. Autant dire qu’il était impossible d’émettre le moindre son avec un tel instrument. Tous les jeunes gens s’y essayèrent pourtant, mais ils avaient beau frapper le tambour, seul le silence répondait à leurs efforts. Pendant ce temps, la princesse se désespérait de rencontrer un jour le prince charmant.
Une nuit pourtant arriva de loin un jeune homme qu’on n’avait jamais vu. Il venait d’un pays lointain et s’il avait traversé de nombreux fleuves et de nombreuses montagnes, c’était dans le but d’essayer le fameux tambour dont il avait entendu parler. Dès qu’il fut arrivé au pied du château de la princesse, il s’enquit donc de l’endroit où se trouvait l’étrange instrument de musique. Un serviteur le lui montra : il était accroché à la branche d’un arbre surplombant un lac. Le jeune homme, éperdu d’amour, tenta sa chance, mais comme il fallait s’y attendre, aucun son ne sortit du tambour. Alors, de désespoir, il se jeta dans la lac où son corps disparut au milieu de cercles concentriques. Il venait à peine d’être englouti quand le tambour se mit à émettre un son doux et agréable. En l’entendant, la princesse quitta son château et se précipita. Folle d’amour, elle qui attendait depuis tant d’années, elle arracha ses vêtements tout en courant le long du chemin en pente qui menait au lac. Quand elle comprit ce qui s’était passé, elle resta là, nue et désespérée, à contempler l’onde noire dans la nuit. Elle eut beau geindre et pleurer, seul le silence répondit à ses cris.
On dit que depuis, tous les soirs, elle descend au bord du lac. Ensuite, elle fait vibrer le tambour dans l’espoir de faire revenir celui qu’elle n’a jamais vu, mais qui est mort d’amour pour elle.

00:05 Publié dans Littérature, Prose | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature
27/10/2016
Automne sanglant
Il fut le seul à se lever.
Il fut le seul à dire tout ce que tout le monde savait et que personne n’osait dire.
Il y eut bien dans la foule quelques murmures d’approbation, puis ce fut tout.
Quand les forces de l’ordre vinrent pour l’arrêter, tous se turent et il ne se trouva personne pour le défendre.
Jamais il n’avait été seul à ce point.
Il tenta de se sauver mais un coup de feu eut raison de son courage.
Le lendemain, sur le trottoir, il ne restait de l’incident qu’une trace rouge sombre, une tache couleur de l’automne.
Les passants pressaient le pas, sans rien dire, mais songeaient en eux-mêmes qu’il avait bien cherché ce qui lui était arrivé.
Une bourrasque se leva emportant les feuilles des arbres, rouges et jaunes, qui s’éparpillèrent dans le vent.

00:25 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
20/10/2016
Réflexion
Le temps manque. Il a dû se perdre quelque part. La page reste blanche, les mots se sont enfuis. Ils ont été emportés par les bourrasques d’automne, comme les feuilles qui s’en vont dans le vent. Bientôt la neige recouvrira la page et nul ne se souviendra des mots qu’on aurait pu écrire et qu’on n’a pas écrits.
00:52 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature
27/07/2016
Marie
Cela faisait trois jours qu’ils se retrouvaient sur un banc, dans le parc communal. Trois jours qu’il la découvrait petit à petit, lui posant mille questions sur sa vie. Et elle, elle répondait ingénument, le plus honnêtement du monde, ce qui la rendait encore plus attrayante. Car il n’y avait pas à dire, elle était belle à croquer et quand le soir tombait et qu’ils se séparaient, il mourait d’envie de l’embrasser. Mais bon, ce n’était encore qu’une connaissance, même pas encore une amie et il ne fallait pas brûler les étapes. Et puis tout ce jeu de l’approche et de la conquête était délicieux et il convenait de le faire durer. Pourtant, une fois seul sur le chemin qui le ramenait chez lui, il n’arrêtait pas de rêver au moment où il la prendrait enfin dans ses bras pour l’enlacer.
Aujourd’hui, il avait appris son nom : Daverdisse. Son prénom, Marie, il le connaissait déjà. Marie Daverdisse ! Il se répétait ces syllabes avec délectation et il lui semblait que plus il les prononçait, plus la jeune fille lui devenait proche et familière. C’était comme si en apprivoisant son nom, il devenait intime avec la personne elle-même.
Tout en marchant, il tentait de se remémorer l’histoire qu’elle venait de lui raconter, une histoire qui avait eu lieu il y a très longtemps, pendant la guerre de 14-18. Il ne savait pas très bien pourquoi elle lui avait parlé de cela, ni même comment elle avait eu connaissance de ces faits horribles. S’il avait bien compris, un officier allemand avait été tué par des résistants et en représailles les soldats avaient rassemblé toute la population du village sur la place de l’église. Ensuite, ils avaient tiré dix numéros au sort et avaient fait sortir des rangs ceux qui occupaient la place correspondant au numéro. Ils étaient donc dix, neuf hommes et une jeune fille, qu’on avait poussé sans ménagement vers le mur de l’église. Pour les hommes, ce fut vite réglé : il y eut quelques détonations et ce fut tout. Pour la fille, ce fut un peu plus long, mais quand elle ressortit de l’église, les vêtements déchirés, elle n’eut pas le temps de raconter ce qui lui était arrivé : une balle derrière la tête la fit taire à tout jamais.
Voilà l’histoire lugubre que Marie lui avait racontée, sans qu’il sache exactement pourquoi. Le lendemain, qui était un jeudi, elle ne vint pas s’asseoir comme d’habitude sur le petit banc, dans le parc communal. Le vendredi non plus, ni les jours qui suivirent. Redoutant un malheur, le pauvre amoureux se mit à sa recherche, mais il eut beau interroger les passants, personne ne semblait connaître son amie. Le village n’était pourtant pas si grand que cela ! Complètement désemparé, ne sachant où aller, il finit par se réfugier près de l’église. Assis, le dos appuyé contre le fameux mur où avaient été fusillés les habitants de 1914, il regardait distraitement les tombes qui s’alignaient devant lui. Soudain, mu par un pressentiment, il se leva d’un bond et se dirigea vers la tombe la plus proche. L’inscription gravée dans la pierre le laissa sans voix et le plongea dans une grande perplexité :
Marie Daverdisse
1898 -1914
Assassinée par l’occupant.

01:51 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature
19/06/2016
Premier amour
Il l’attendait chaque jour à la sortie de son lycée. Il l’observait de loin, sans rien dire et surtout sans oser l’approcher. Lui, il était d’une autre école, de l’enseignement laïque et son père était socialiste. Elle, cela se voyait, était d’un autre monde, plus beau, plus aisé, et chaque dimanche elle accompagnait ses parents à la grand-messe, cela il le savait. Deux mondes différents et entre eux un abîme qui interdisait toute tentative. Comment aurait-il seulement osé l’aborder ? Au fond de lui-même, pourtant, il savait que tout cela n’était que des prétextes qui lui permettaient de se complaire dans sa timidité. Eût-elle été du même niveau social que lui qu’il n’aurait pas fait un pas de plus. Mais comment aborder une jeune fille quand on a seize ans et qu’elle est belle comme l’amour ?
Alors il l’observait de loin. Une fois les cours terminés il plantait là tous ses copains et se ruait à travers les rues de la ville pour être là quand elle sortirait. Heureusement, dans ce lycée chic, on sortait dix minutes plus tard que dans les autres écoles, histoire sans doute de montrer une différence de classe. Le fait d’être élève dans cette institution prouvait qu’on n’était pas comme les autres. Elle, en tout cas, n’était pas comme les autres, ça c’était certain ! Fine, élancée, elle resplendissait dans son petit uniforme. Une jupe bleue avec de beaux plis et un chemisier blanc impeccable sur lequel on devinait de loin une chaîne en or avec un crucifix. Qu’est-ce qu’il aurait donné, lui le mécréant, pour être à la place de ce crucifix, bien positionné sur la poitrine de cette jeune fille. Parfois, chez lui, il imaginait non seulement qu’il lui parlait mais qu’il prenait dans sa main ce crucifix, pour lui prouver que tout agnostique qu'il fût, il n'en était pas moins disposé à faire un pas en direction des mystères qu’elle vénérait. Mais en fait de mystère, il songeait surtout à la chair blanche et tendre qui se trouvait sous le chemisier et qui s’élevait et s’abaissait à chaque respiration. A propos de respiration, quand de telles idées lui venaient en tête, il se retrouvait sans souffle, affolé et désemparé, ne sachant comment mettre un terme à ce trouble qui s’emparait de lui.
Il l’observait donc de loin, qui papotait avec ses copines, puis qui se dirigeait seule vers l’arrêt de l’autobus. Alors il se mettait à la suivre à une distance respectable, en ayant bien soin de ne pas attirer son attention. De toute façon, même si elle s’était retournée (ce qu’elle n’avait jamais fait) elle n’aurait pas été étonnée de sa présence à lui (pour autant qu’elle le remarquât) puisqu’il prenait le même bus qu’elle. Elle le connaissait donc de vue et n’avait jamais manifesté la moindre inquiétude quand il passait devant elle, l’air indifférent, pour aller s’appuyer au mur qui prolongeait l’abri de verre où elle se réfugiait, protégée du soleil comme de la pluie. C’était alors dix minutes de bonheur, dix minutes qui devenaient parfois quinze ou même vingt, quand la circulation du centre-ville retardait les transports en commun. Une nouvelle fois il l’observait à la dérobée. Assise sur un banc et plongée dans un livre, elle ne remarquait pas à quel point il la dévorait des yeux. Ah, ces boucles de cheveux noirs qui descendaient en cascade jusqu’aux oreilles ! Comme il aurait voulu les écarter et de sa lèvre effleurer la peau du cou, qui devait être douce et blanche…
Mais l’autobus finissait toujours par arriver, rompant le charme. Elle fermait son livre et d’un pas souple et nerveux pénétrait dans l’énorme véhicule. Il la suivait en retrait, se mêlant à la foule des autres élèves parmi lesquels il se noyait afin de rester invisible. On longeait le parc, puis le grand fleuve. Enfin, on pénétrait dans les quartiers aisés, là où des villas s’alignaient entre des bosquets de bouleaux ou de noisetiers. Elle descendait, son livre à la main, toujours de la même démarche souple et gracieuse. Une dernière fois, il essayait de la suivre du regard, mais déjà le bus virait à angle droit et amorçait la descente qui le ramenait vers les bas-quartiers, là où étaient les usines et les fabriques et où s’alignaient des rangées de maisons identiques aux briques noircies par les fumées.
Un jour, oui, un jour, il descendrait au même arrêt qu’elle et il l’aborderait. Il lui expliquerait que s’il avait laissé le bus continuer sans lui, c’était pour avoir l’occasion de lui parler. Alors, étonnée, elle l’écouterait et pour la première fois remarquerait sa présence. Il parlerait de tout, de rien, et elle sourirait en l’observant à la dérobée. Quand ils seraient arrivés devant sa maison, il prendrait un air détaché pour dire qu’il continuait sa route, mais elle, dans un mouvement spontané, viendrait gentiment l’embrasser sur la joue avec dans le regard un feu qu’elle n’avait jamais eu Elle lui dirait « A demain » et avant que la grande porte cochère ne se referme derrière elle, il verrait une dernière fois ses prunelles brillantes. Ce serait le bonheur absolu et c’est en sifflotant qu’il s’acheminerait vers la vile basse, tout simplement heureux et laissant ses seize ans déborder de joie.
Oui, voilà ce qu’il ferait. Mais pas aujourd’hui. Non, aujourd’hui il était trop tôt encore pour entreprendre une telle démarche. Et puis il risquait de pleuvoir et les gros nuages noirs qui s’amoncelaient dans le ciel étaient d’un mauvais présage. Non, il faudrait choisir un jour de printemps, quand l’air doux et les premiers bourgeons mettaient tout le monde en joie. Non, aujourd’hui, il se contenterait de l’observer en train de papoter avec ses copines devant l’entrée du lycée.
Allons, la voilà qui dit au revoir et qui prend la direction de l’arrêt de bus. D’où il se trouve, il voit une grosse voiture qui avance à vive allure sur la chaussée. Il voit aussi la jeune fille qui s’apprête à traverser. Distraite, elle n’a rien vu ! Alors, comme malgré lui et par réflexe, il crie son prénom de toutes ses forces : « Isabelle ! » Et la voilà qui s’immobilise au milieu de la route et qui regarde dans sa direction, étonnée. « Isabelle ! » crie-t-il encore. Pendant une seconde leurs regards se croisent puis la voiture arrive dans un hurlement de freins et percute la jeune fille.
C’est fini.
Pendant des années il repensera à cet événement. S’il avait pu, comme les autres jours, se taire et garder le silence, peut-être vivrait-elle encore. La première fois qu’il avait osé l’apostropher avait aussi été la dernière. La vie est vraiment cruelle parfois. Depuis il reste seul, sans rêve et la conscience remplie de remords.

00:05 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature
06/05/2016
Chaperon rouge sang
Au coin d’un bois j’ai rencontré le petit Chaperon rouge qui pleurait. Assise sur une souche, la pauvrette semblait désespérée.
– Qu’y a-t-il, petite, qui te bouleverse à ce point ?
– Un chasseur a tué le loup, le grand loup gris qui hantait ces parages.
– C’est peut-être une bonne chose, non ? Un loup, c’est méchant…
– Non, celui-là je le connaissais. On parlait souvent ensemble et je lui offrais des galettes de mon panier, celles que ma mère cuisait pour ma mère-grand.
– je vois, ce loup était ton ami. Peut-être au fond de toi l’aimais-tu ? Tu n’aurais pas été un peu amoureuse ?
– Non, mais je l’aimais bien. Parfois on se roulait sur l’herbe et j’aimais sentir ses poils contre la peau de mon visage.
– C’est ce que disais, tu étais un peu amoureuse.
– Mais non. Pourtant j’adorais quand il me léchait la figure et qu’il descendait dans le cou. J’avais des frissons partout.
– Bon, je ne vais pas insister, mais…
– J’aimais aussi quand il soulevait ma jupe et qu’il mettait sa tête sur mes cuisses nues.
– Tu vois ? Tu l’aimais, c’est tout.
– Mais non, je te dis. L’amour c’est autre chose. L’amour c’est un chevalier qui arrive sur son cheval blanc et qui t’emporte au paradis. Lui, c’était un loup. Mais quand il avait mangé deux ou trois galettes et qu’il m’embrassait, j’adorais.
– Parce qu’en plus il t’embrassait ?
– Bien sûr, qu’est-ce que tu crois ? Je suis une grande fille, déjà. Et bientôt je serai une femme.
– Certes. Mais quand même, un loup… Qu’aurait dit ta mère si elle avait su cela ?
– Elle m’aurait dit de prendre un autre chemin, celui des aiguilles, par exemple. Et d’éviter le loup
– Et toi, qu’aurais-tu fait ?
– Je ne l’aurais pas écoutée, bien sûr ! J’aurais pris l’autre chemin et j’aurais offert toutes les galettes à mon ami le loup.
– Je vois. Et que vas-tu faire, maintenant que le grand loup gris, ton ami, est mort ?
– Je ne sais pas. Je ne vois plus trop l’intérêt d’aller chez ma mère-grand. Elle est vieille et n’entend presque plus rien. Mon ami le loup, lui, avait de grandes oreilles et je pouvais lui confier tous mes chagrins.
– Tu as des chagrins à ton âge ? Quel genre de chagrins ?
– Bien sûr ! Pourquoi n’aurais-je pas le droit d’avoir des chagrins ?
– Je ne sais pas. Je croyais que c’était réservé aux grandes personnes.
– Bien sûr que non !
– Et quel genre de chagrin avais-tu ?
– J’aurais voulu passer toutes mes journées et toutes mes nuits avec mon ami le loup. J’aurais tellement aimé sa chaleur quand il se serait blotti contre moi.
– Oui, je comprends. Tu dois terriblement en vouloir à ce chasseur…
– Si je le croise, je le tue.
– Et comment t’y prendras –tu ?
– Je ne sais pas. Encore que… Tu sais, je suis une femme ou c’est tout comme. Il suffit de faire un peu de charme et il va déposer son fusil pour m’embrasser. A ce moment-là, je n’ai plus qu’à prendre le fusil.
– Diable ! Tu ferais cela ?
– Et pourquoi pas ? Il a bien tué mon ami le loup !
– Oui, c’est ce que je disais. Tu devais être amoureuse.

01:25 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature
07/03/2016
L'enterrement (fin)
Ils se remirent donc en route et atteignirent le sommet vers dix-huit heures, quand la nuit commençait à tomber. Il n’y avait rien, ici, tout était désert. On ne voyait que des montagnes enneigées et dénudées à perte de vue et il n’y avait aucun bois pour s’abriter du vent qui recommençait à souffler. Que faire ? Avec les branches de sapin qu’on avait emportées dans le chariot on fit un dernier feu et on mangea le reste du jambon. Il n’y avait plus de pain. Pour le cheval, il n’y avait plus d’avoine non plus et impossible de dégager une épaisseur de neige d’un mètre pour essayer de trouver une pauvre herbe rabougrie. Il allait falloir continuer si on ne voulait pas mourir de faim et de froid. Norbert s’inquiétait beaucoup pour la jument, mais Marie n’allait pas très bien non plus. Heureusement, on entamait la descente et sur ce versant la neige semblait moins dense. Vers minuit, cependant, ils se retrouvèrent devant une congère. Le chemin était encaissé à cet endroit et la neige s’y était amoncelée. Il fallut dégager à la pelle pour que le chariot pût passer. Norbert était épuisé et plus il était fatigué, plus il s’énervait et criait. Tout ça à cause de ce fichu beau-père qui aurait quand même bien pu mourir en été ! On n’arriverait jamais à temps ! Pour sûr que la messe serait à peine dite et le cercueil à peine déposé dans la tombe que les trois frères allaient se partager le magot. Fichue neige et fichu pays !
Une fois la congère franchie, ils continuèrent la descente, le cheval devant, tirant tant qu’il pouvait dans la neige, bien qu’il eût l’estomac vide, Nobert à ses côtés, qui l’injuriait copieusement, et Marie recroquevillée dans le chariot, qui claquait des dents et qui pleurait doucement. Au petit matin, ils arrivèrent près d’une habitation. Au moins ils étaient sauvés. Ils frappèrent à la porte de Théophile, qu’ils connaissaient bien, car il était du même village que Marie. Il les fit entrer tout de suite. Le problème, c’était le cheval. La pauvre bête n’en pouvait plus. Exténuée, mourant de faim, elle penchait la tête comme si elle allait elle aussi rendre l’âme. Impossible pourtant d’aller la conduire dans l’écurie. La couche de neige était si épaisse qu’il était impossible d’en ouvrir la porte. Alors on ne fit ni une ni deux (après tout, entre paysans on se comprend) : on la fit entrer dans la cuisine où on l’attacha à la grande pompe à eau qui était près de l’évier. On lui donna de l’avoine dont elle se régala, puis on alla se réchauffer auprès du feu qui crépitait dans la cheminée. Théophile offrit une eau de vie de prune qu’il avait confectionnée lui-même. Inutile de dire qu’après deux verres, nos deux voyageurs tombèrent endormis dans les fauteuils. Vers midi, ils se réveillèrent. Leur hôte leur avait préparé une omelette géante avec des lardons. Comment refuser une telle hospitalité ? De toute façon, il était trop tard pour l’enterrement, qui était certainement terminé maintenant. Ceux qui avaient assisté à la cérémonie devaient être eux aussi en train de manger et de déguster jambons et pâtés, tout cela prélevé sur l’héritage évidemment ! Tant qu’à faire d’arriver en retard, mieux valait se restaurer et reprendre des forces. On discuta, on trinqua avec le vin de la vigne, puis on reprit de l’omelette, qu’on dégustait avec de grandes tranches de pain blanc. Après le repas, Théophile offrit du café avec un morceau de gâteau. D’où est-ce qu’il sortait cela, c’était un grand mystère... Puis on but encore quelques verres d’alcool de prune, pour la route. Seule Marie resta sobre, assise dans son coin, pensive et triste. Vers quinze heures, on reprit le chemin. On tira la jument hors de la cuisine et on attela le chariot. Il ne restait à parcourir que dix kilomètres en terrain plat et la neige commençait à fondre. Il aurait pu mourir un jour ou deux plus tard, le beau-père, cela aurait été quand même plus simple ! Théophile embrassa Marie et la prit affectueusement dans ses bras, tout en lui souhaitant bon courage, puis Norbert héla la jument e ton se mit en route.
Quand ils arrivèrent enfin près de la ferme, tout était calme et on ne remarquait rien d’anormal. Pour tout dire, il n’y avait aucune activité. Curieux. L’enterrement ayant eu lieu à dix heures du matin, toute la parenté aurait-elle déjà quitté les lieux ? Ce n’était pas possible, certains avaient dû venir de loin, eux aussi, et ils ne devraient logiquement repartir que demain, après avoir logé sur place. A moins que la belle-mère n’eût organisé le déjeuner pour les invités dans la salle paroissiale… Oui, c’était sans doute cela, ils devaient tous être là-bas. Marie et Norbert regardèrent la maison. Comme tout semblait triste et vide, subitement. Dans l’étable, une vache beugla longuement. Sans doute n’avait-elle pas reçu sa ration de foin quotidienne ou peut-être même que personne n’était venu la traire ce matin. On peut comprendre, les jours d’enterrement, plus rien n’est respecté. Norbert détacha le cheval et le conduisit à l’écurie. Marie le suivit en se frottant les yeux avec son mouchoir. Elle attendit que son mari eût terminé de donner à manger à la jument car elle ne se sentait pas la force d’entrer seule dans le corps du logis. Elle savait que la première chose qu’elle verrait, en ouvrant la porte, ce serait le fauteuil vide de son père, près de la cheminée. Il ne serait plus là, comme autrefois, à l’accueillir avec son grand sourire, chaque fois qu’il la voyait. Elle se rendait compte subitement qu’elle avait été la préférée de ses enfants, sans doute parce qu’elle était la seule fille. Elle se rendait compte aussi à quel point ils avaient été complices dans le passé. Evidemment, depuis qu’elle était mariée et qu’elle habitait loin, ils ne se voyaient plus que deux ou trois fois par an. Pourquoi n’était-elle pas venue plus souvent le saluer ? Malgré elle, des larmes emplissaient ses yeux et elle avait beau les essuyer, elles revenaient sans cesse. Norbert, tout occupé avec le cheval, la regardait à la dérobée, un peu agacé par tant de sensiblerie. Ben oui, quoi, le beau-père était mort, mais il avait son âge aussi. Beaucoup n’arrivaient pas à soixante-quinze ans. Certes, il aurait encore pu vivre dix ans, vingt, même, mais c’était comme cela, la vie décidait pour nous.
Ils quittèrent l’écurie et se retrouvèrent dehors. Il faisait de nouveau froid et on sentait que la neige avait cessé de fondre. Elle allait tenir plusieurs jours, la garce, ce qui ne faciliterait pas le chemin du retour. En attendant, il fallait bien se décider à entrer. S’il n’y avait personne, ils iraient directement jusqu’à la salle paroissiale, derrière l’église. Norbert secoua ses grosses chaussures contre le seuil et ouvrit la porte, suivi par Marie, toute tremblante d’émotion. Incroyable ! Dans le fauteuil près de la cheminée, le père était là, tranquillement assis. En entendant le bruit de la porte, il ouvrit des yeux étonnés, puis, reconnaissant sa fille, il sourit largement et se leva lentement, en s‘appuyant sur l’accoudoir. Norbert eut à peine le temps de retenir Marie, qui venait de s’évanouir.
On la transporta dans le fauteuil où elle revint à elle après une minute. Puis il fallut bien s’expliquer et justifier cette visite inhabituelle. On avait appris pour l’accident, la chute sur le seuil, la commotion, alors oui, on était venus parce qu’on était inquiets. Par ce temps, oui… C’était Pierre, le fils de la ferme de l’Almoine, qui était passé à la maison et qui avait raconté que cela semblait grave. Non, on n’avait pas hésité malgré la neige. Après tout, en hiver, on n’avait pas grand-chose à faire dans une ferme. Et en été on n’avait jamais le temps, alors, voilà… On s’était dit qu’une petite visite ferait plaisir. Comment ? Est-ce qu’ils n’avaient pas eu froid en route ? Oh non, tout s’était bien passé. Ils avaient le chariot et Marie était bien emmitouflée sous les couvertures. Et le passage des cols ? Non, sans problème. Oh, il y avait bien eu un peu plus de neige au sommet, mais il leur en aurait fallu davantage pour les arrêter. La preuve, ils étaient ici.
Puis Mélanie, la mère de Marie entra, un peu crispée car elle ne savait pas ce qu’ils avaient bien pu dire à son vieillard de mari, mais quand elle comprit que celui-ci n’avait rien deviné sur le motif réel de leur visite, elle parut rassurée. Elle expliqua qu’elle se chargeait provisoirement de nourrir les bêtes et de traire les vaches, afin que le malade se reposât un peu. Mais celui-ci grogna et jura ses grands dieux que demain ou mercredi au plus tard il serait d’attaque. Il prit sa fille à témoin : c’était quand même un peu fort ! Pour une petite chute de rien du tout on le tenait cloitré au coin du feu. Un homme n’était pas fait pour cela, sacrebleu !
Le soir, lors du repas autour de la grande table, on parla beaucoup du temps passé, lorsque Marie était enfant. Celle-ci, assise à côté de son père, rayonnait d’une joie évidente. A minuit moins cinq, la grande horloge sonna douze coups. Il en avait toujours été ainsi : dans la famille, on était toujours un peu en avance. Pendant que les autres poursuivaient leur discussion, Norbert jeta sur l’horloge un regard noir, tout en se demandant comment il ferait le jour où il lui faudrait l’emporter sur son chariot.

00:05 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature
03/03/2016
L'enterrement (suite)
Ainsi en alla-t-il. A huit heures du matin, le couple était en route sur les petits chemins des Cévennes. Le trajet fut long, fort long. C’est que la jument était vieille et n’allait pas très vite. Elle peinait dans les côtes, qui étaient nombreuses, mais dans les descentes ce n’était pas mieux car elle avait tendance à freiner des quatre fers, sentant le poids du chariot derrière elle. Il faisait froid. Dans les vallées, c’était encore supportable, mais sur les plateaux dénudés, une bise glaciale venait transpercer les pauvres voyageurs. Le premier soir, ils firent halte dans une petite auberge, tant ils étaient transis de froid. Le lendemain, à six heures, ils étaient de nouveau sur les routes. L’obscurité était totale et c’était à se demander comment la jument parvenait à trouver son chemin. Il n’aurait plus manqué que de verser dans le fossé ! Norbert ne voulait même pas y songer, car il comptait bien être à temps pour l’enterrement, non seulement parce que cela ne se faisait pas d’arriver le lendemain à ce genre de cérémonie, mais surtout parce qu’il comptait bien se battre pour que sa femme obtienne une partie de l’héritage. «Heureusement que je suis là », lui disait-il, « sans cela tu te ferais plumer. Tes frères sont des vautours et ils prendront prétexte qu’ils sont fermiers pour emporter tout le matériel agricole : les charrues, les chevaux, les herses, tout y passera. Et s’ils vendent les vaches, tu n’auras rien du tout, pas un franc, car ils le feront en cachette. » Mais Marie se taisait. Elle se taisait et son regard portait au loin, vers l’horizon où là-bas le corps du père devait reposer dans son cercueil, installé sur des tréteaux au milieu de la cuisine. Rien que de penser aux grands rideaux noirs qu’on avait dû tendre partout, son cœur se serrait. Elle s’en moquait bien de ces histoires d’héritage dont Norbert lui rebattait les oreilles depuis qu’ils étaient partis. Tout ce qu’elle voyait, c’était que son père était mort, son père qu’elle avait tant aimé. Elle se revoyait petite fille, le suivant partout, et même adolescente, il y avait eu entre eux une complicité incroyable. Elle se souvenait encore du jour où il lui avait montré l’endroit secret où il cachait ses billets de banque. C’était dans la grande horloge en pied qui trônait près de l’âtre. Il avait ouvert la petite porte en bois qui abritait le mécanisme d’horlogerie et lui avait désigné l’enveloppe glissée dans un coin, gonflée de billets de banque. L’horloge qui était finalement le seul meuble convenable de la maison et dont on était si fier qu’on lui faisait sonner non seulement les heures, mais aussi les demies et les quarts, rien que pour le plaisir d’entendre son beau bruit sonore. Et puis aussi, il fallait bien le dire, pour que les visiteurs se rendent bien compte de la présence de ce meuble distingué, qu’on ne trouvait habituellement que dans les maisons des riches.
Distraitement, sans même y réfléchir, Marie laissa tomber ces mots : « C’est dans l’horloge que papa cachait tous ses sous. J’étais la seule à le savoir. » Norbert arrêta la jument d’un coup sec et regarda sa femme, éberlué.
– Tu es certaine de ce que tu dis ?
- Oui, il me faisait tellement confiance qu’il m’avait montré sa cachette. On était très proches, tu sais.
- Eh bien moi, elle me plaît bien ton horloge, tiens. Si tu ne reçois rien comme héritage, réclame au moins l’horloge, on n’aura pas tout perdu. Finalement, j’ai drôlement bien fait de prendre le chariot !
Il faisait presque nuit quand ils arrivèrent au col des trois pendus. En plein jour, la vue était superbe. D’’ici, on pouvait apercevoir derrière soi Saint-André de Lancize et devant, à une bonne vingtaine de kilomètres, Saint-Germain-de-Calberte. Mais bon, il faisait nuit et on ne voyait rien du tout. Ils se mirent à descendre lentement la pente qui menait dans la vallée. Ils avaient à peine fait un kilomètre quand la neige s’est mise à tomber. D’abord quelques flocons épars et puis bientôt une neige drue, faite de gros flocons humides qui collaient au visage et aux troncs des arbres. Satané pays. Et eux qui avaient décidé de ne pas s’arrêter, histoire de gagner du temps et aussi de ne pas trop dépenser en louant encore une fois une chambre chez l’habitant ! De toute façon, même s’ils l’avaient voulu, c’était impossible, il n’y avait pas la moindre demeure à vingt lieues à la ronde.
Ils marchèrent ainsi une bonne partie de la nuit. Marie était emmitouflée à l’arrière du chariot et on ne voyait même plus sa figure. Peut-être dormait-elle, mais ce n’était pas certain, car le froid était bien vif. Pour se réchauffer, Norbert marchait parfois à côté du cheval. Pauvre bête, de la neige durcie recouvrait toute sa tête et c’était à se demander si elle voyait encore le chemin. Plus le temps passait et plus on descendait vers le fond de la vallée, plus la couche de neige s’épaississait. Il faut dire que le flanc de la montagne était situé face au vent et exposé comme il l’était, c’est ici que la couche de poudreuse devait être la plus impressionnante. En moins d’une demi-heure, celle-ci avait déjà atteint vingt bons centimètres. C’était à ne pas y croire ! Même dans les Cévennes, on n’avait jamais vu ça ! Si ça continuait ainsi toute la nuit, il ne faudrait même pas espérer atteindre le deuxième col.
Et en effet, quand ils arrivèrent en bas dans la vallée, il fallut s’arrêter. Le cheval, qui avait de la neige jusqu’aux genoux, n’en pouvait plus et il refusa d’avancer. On se mit à l’abri comme on put derrière quelques sapins rabougris et il fallut bien attendre. Il devait être quatre heures du matin et le froid piquait comme une lame de rasoir. S’ils restaient là sans bouger, ils seraient morts avant d’arriver à l’enterrement, c’était certain. Norbert alla couper quelques branches de résineux et décida de faire un feu. Le comble, c’est qu’il y parvint ! On détela le cheval pour qu’il reprît des forces et qu’il pût s’abriter derrière les arbres. Quant à Marie à et son mari, assis devant le feu, emmitouflés dans l’unique couverture, ils se serrèrent l’un contre l’autre et finirent par s’endormir.
Quand ils se réveillèrent vers huit heures, le jour pointait à peine à l’horizon. Un calme impressionnant enveloppait la campagne. On n‘entendait aucun bruit et on se serait cru sur une autre planète. Le vent était tombé et il ne neigeait plus, c’était déjà ça. Norbert ralluma le feu et donna un peu d’avoine à la jument. Ensuite, lui et Marie mangèrent quelques tranches de pain à la confiture. Quand ils eurent terminé, le soleil se levait derrière les montagnes dans un ciel bleu d’une pureté incroyable. Tout était blanc autour d’eux et il était difficile de reconnaître le paysage. Il allait falloir bouger s’ils ne voulaient pas mourir de froid. Par précaution, on jeta quelques branches de sapin dans le chariot et on tenta de se remettre en route. On n’avait pas fait cent mètres, que déjà le cheval peinait dans la montée. Que faire ? Laisser tout là et continuer à pied ? Il n’y fallait même pas songer : vu la distance qu’il leur restait à parcourir, jamais ils n’arriveraient à temps pour l’enterrement. Il fallait juste espérer que l’autre versant serait moins enneigé et que le cheval retrouverait alors un rythme plus rapide. En attendant le pauvre n’en pouvait plus. De le neige plus haut que les genoux, il s’arc-que-boutait de toutes ses forces, mais n’avançait guère. On descendit du chariot, mais cela n’allait pas beaucoup mieux. Il fallut se résoudre à pousser. Quand on lui disait d’avancer, la pauvre jument faisait un effort et progressait d’un ou deux mètres. Derrière, les deux fermiers l’aidaient comme ils pouvaient, mais la hauteur de neige était telle et la pente était si forte, qu’après cinq mètres il leur fallait s’arrêter, épuisés. Comme trois bons kilomètres devaient les séparer du col, ils allaient y passer la journée. Norbert commençait à s’énerver. On était déjà le troisième jour et l’enterrement avait lieu le lendemain dans la matinée. L’héritage de Marie allait leur passer sous le nez ! Mais il eut beau s’énerver sur la pauvre jument, celle-ci ne pouvait pas donner davantage que ce qu’elle donnait. Vers midi, on fit une pause car Marie n’en pouvait plus non plus. Le visage rouge, buriné par le vent, les lèvres bleues, elle était méconnaissable. On fit une halte et on mangea un peu de jambon fumé avec le reste du pain. La ration d’avoine diminuait aussi. Ils n’avaient pas le choix : il fallait franchir ce col à tout prix et en tout cas avant la nuit.

00:05 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
29/02/2016
L'enterrement
Il était quatre heures du matin quand on frappa à la porte. C’étaient des coups violents et répétés, qui ne s’arrêtaient un instant que pour reprendre de plus belle. Manifestement, le bougre qui était là dehors avait l’air de s’impatienter. Qui est-ce qui pouvait bien venir réveiller les gens à une heure pareille ? Et en plein hiver, alors qu’il faisait nuit noire ! Il fallait que ce soit drôlement urgent… Le père alluma une bougie et sortit du lit en maugréant. Il enfila un pantalon au-dessus de son pyjama et descendit le vieil escalier dont les marches craquaient. Dans la cuisine, il faisait glacial. De l’autre côté de la porte, l’autre continuait à frapper sans arrêt. Norbert tenta de distinguer par la fenêtre qui cela pouvait bien être, mais les carreaux devaient être gelés car à la lueur de bougie il ne vit que de grandes fleurs de givre qui remplissaient toute la vitre. Il allait bien falloir ouvrir. Il se dirigea vers l’étable et s’empara d’une fourche. Brusquement tirées de leur sommeil, les vaches le contemplèrent de leurs yeux vides, avec un air d’incompréhension. A pas de loup, il se dirigea vers la petite porte latérale qu’il ouvrit sans faire de bruit. Qu’est-ce qu’il faisait froid ! Il aurait dû enfiler un vêtement chaud… Mais aussi quelle idée de venir réveiller les gens à une heure pareille alors qu’il gelait à pierre fendre ! Cet énergumène allait en prendre pour son grade, ça c’était certain ! Norbert longea le mur de l’étable et une fois au coin de la maison, il regarda prudemment. Il était maintenant à quatre mètres du visiteur, lequel continuait à frapper sans arrêt contre la porte principale du logis. Fourche en avant il avança, en prenant garde de ne pas glisser sur les plaques de neige gelées. Quand il fut à un mètre, il hurla : « Qu’est-ce que vous venez foutre ici à une heure pareille ?» L’autre sursauta et se retourna d’un bond. Il était emmitouflé jusqu’aux oreilles et un grand bonnet de laine lui descendait presque sur les yeux. Impossible de savoir qui ça pouvait bien être.
– Norbert, enfin, tu m’as entendu !
– Ca pour t’entendre, je t’ai entendu, c’est certain ! Avec tout le raffut que tu fais… Mais ça ne me dit pas qui tu es et ce que tu viens faire ici à pareille heure. Il n’y a que les voleurs pour se promener ainsi au milieu de la nuit. Les bons chrétiens, eux, dorment tranquillement dans leur lit.
– Norbert, tu ne me reconnais pas ? Je suis Pierre.
– Quel Pierre ? Personne ne s’appelle Pierre ici au village…
– Non, Pierre, de la ferme de l’Almoine. Suis le fils du grand Jules.
– Pierre ? De l’Almoine ? Mais qu’est-ce que tu fiches ici en pleine nuit ? Ta ferme est à trois jours d’ici.
– Je vais t’expliquer. Mais je meurs de froid, on ne pourrait pas entrer une minute ?
– Si da. Viens par ici, on va passer par l’écurie, car de ce côté, l’huis est barricadé.
Une fois à l’intérieur, Norbert prit la bougie qu’il avait déposée sur le rebord d’une fenêtre et la leva à hauteur des yeux de son visiteur. Celui-ci ôta son bonnet et ce n’est que quand il fut certain que c’était bien là le Pierre de l’Almoine, le fils de Jules, que Norbert déposa sa fourche contre le mur.
– Allez, passe à la cuisine, je vais réveiller Marie et elle nous fera du feu, puis tu me diras pourquoi t’es venu jusqu’ici.
Mais Marie était déjà en bas, l’air inquiet et interrogateur. Quand elle eut reconnu le visiteur, son visage se décomposa. On ne vient pas réveiller les gens à une heure pareille sans que quelque chose de grave ne se soit produit. Sans rien dire, elle alluma le feu, pendant que Norbert allait chercher deux verres et une bouteille d’eau de vie. Quand les flammes se mirent à crépiter dans l’âtre et qu’il eut rempli les deux verres, il invita Pierre à s’asseoir et à trinquer un coup pour se réchauffer. Marie, elle, resta debout au bout de la table, observant les deux hommes avec attention tout en serrant autour de sa poitrine le vieux châle qu’elle avait enroulé autour de ses épaules et qui cachait tant bien que mal sa robe de nuit rapiécée.
– Allez, m’fi, maintenant qu’on a bu un bon coup, dis-nous un peu ce qui t’amène à pareille heure. Ca doit être drôlement important pour que tu coures les routes en pleine nuit avec un froid pareil et avec la neige qui risque de tomber d’un moment à l’autre.
– Oui, c’est important, pour sûr. C’est la Mélanie qui m'envoie et c’est au sujet du vieil Alfred.
– Mon père ? s’enquit aussitôt Marie.
– Ben oui, n’y en a pas d’autre au village. Il était déjà pas bien costaud, ces derniers temps, mais vl’a qu’il a glissé et qu’il s’est fracassé le crâne sur la grosse pierre en schiste qui sert de seuil à la maison. Il se meurt. Autant dire qu’il est fichu. Le curé est même venu pour l’extrême-onction et du coup on en a profité pour fixer la date de l’enterrement pour ce lundi à dix heures. Maintenant, il doit déjà être mort le pauvre. Ne traînez pas, j’ai mis plus de deux jours pour arriver jusqu’ici et si jamais la neige se met à tomber, vous ne pourrez pas franchir les cols.
– Ben ça alors, si on s’attendait à une pareille nouvelle. Certes, il était vieux, le beau-père, mais quand même… Le problème, c’est qu’il y a les vaches, là, à côté, qu’il faut nourrir tous les jours.
– T’inquiète pas, j’y ai pensé. Je vais rester ici moi et je vais te les soigner, tes vaches. Marie, c’est son père, elle doit être à l’enterrement et ce n’est pas toute seule qu’elle va faire ces deux ou trois jours de marche, à travers forêts et montagnes.
Marie ne disait rien. Le regard fixe, elle serrait un peu plus son châle contre sa poitrine, déjà résignée à ce malheur qui s’abattait sur elle et en même temps parfaitement digne.
– T’a raison mon gars. Marie doit aller enterrer son vieux. Et puis, pour tout dire, ça me ferait enrager que ses frères empochent tout l’héritage. J’ai jamais pu les voir, ceux-là. C’est pas pour rien qu’on est parti habiter bien loin. Bon, Marie, va t’habiller. Prends ta robe noire et surtout quelque chose de chaud car on va geler sur ces routes. Surtout sur les hauts plateaux, c’est là que le vent souffle le plus. Prépare à manger aussi, qu’on ne doive pas aller quémander notre nourriture en chemin. On va prendre le petit chariot et la jument…
(à suivre)

00:05 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature
31/12/2015
Soirée de réveillon
En ce soir de réveillon, c’était décidé, il irait retrouver Agnès et lui dirait qu’il avait eu tort de partir, que la vie sans elle n’était pas possible et que l’amour qu’il avait éprouvé pour elle était toujours là. Il ne savait pas comment elle réagirait, mais ce qui était sûr, c’est qu’il n’y avait pas de meilleur moment pour tenter de se réconcilier que la Nouvelle Année. Bon, il avait beaucoup de tort à se faire pardonner, c’était certain, mais il ne pouvait pas continuer à vivre comme il le faisait, se contentant de petits boulots et passant d’une femme à l’autre sans jamais en aimer aucune. Il se rendait bien compte que depuis son départ il n’avait fait que décliner, dormant une semaine ici, deux semaines là-bas, errant sans cesse, n’ayant pas de domicile fixe, dépendant des amis, des copains, et surtout des filles de hasard rencontrées dans les cafés. Car en plus il s’était mis à boire et fréquentait maintenant assidument les cafés. Lui qui autrefois ne buvait que du thé, il était maintenant capable d’ingurgiter deux bouteilles de vin en une soirée, quand ce n’était pas une vingtaine de bières. Non, ce n’était plus possible, il devait sortir de cette déchéance !
Un jour, ou plutôt une nuit, il s’était mis à réfléchir et, tout en caressant le sexe de la fille couchée à ses côtés, il avait pris conscience qu’Agnès lui manquait, qu’il l’aimait toujours et qu’il n’avait jamais aimé qu’elle. Pourquoi était-il parti, finalement ? Il avait du mal à le comprendre. Sans doute l’habitude et la vie quotidienne trop routinière avaient-elles affadi petit à petit ses sentiments. Agnès, pourtant, débordait toujours d’amour à son égard, mais il y avait des jours où elle devenait morose et où on finissait par s’ennuyer en sa compagnie. Elle passait son temps à ranger la maison, à remplir le lave-vaisselle, à préparer les tartines pour le casse-croûte du lendemain, à s’occuper du lave-linge, à donner à manger aux chats, et à prendre les poussières sur la télévision. Bref, rien de très érotique, tout cela. Alors, insensiblement et sans qu’il s’en aperçoive lui-même, il avait cessé de la désirer. Quand, toutes ses tâches ménagères accomplies, elle venait enfin le rejoindre dans le grand lit de chêne, il dormait souvent depuis une demi-heure. Si elle le réveillait, câline et nue, il finissait par la repousser en grognant, car il savait que son désir à lui ne serait pas au rendez-vous. Mieux valait jouer l’indifférent que de risquer de voir son honneur viril en prendre un coup. Alors, dépitée, Agnès prenait un livre et lisait jusque tard dans la nuit. C’était encore une belle occasion de râler sous prétexte que la lampe était gênante et qu’il ne parvenait pas à dormir. Le ton montait de part et d’autre et Agnès finissait par sortir du lit et par rejoindre le salon en bas, non sans avoir caché sa nudité à l’aide d’un vieux peignoir mal attaché qui laissait entrevoir sa belle poitrine. Alors il restait là dans le noir, frustré, mécontent de lui et d’Agnès.
Ne parvenant pas à trouver le sommeil, il finissait par redescendre à son tour. Il va sans dire que sa compagne l’accueillait alors avec un rire sarcastique et moqueur. Quand il tentait de l’enlacer malgré tout pour essayer de désamorcer la dispute qui n’allait pas tarder à surgir, elle le repoussait violemment, refermant autant qu’elle pouvait les deux côtés du peignoir. De plus en plus frustré, il remontait et finissait par s’endormir la lampe allumée et plongeait alors dans un sommeil sans rêve et peu réparateur.
Bref, entre eux, cela n’allait plus et c’était pour cela qu’un jour il était parti. Mais voilà, il se rendait compte qu’il l’aimait toujours. Il aurait suffi de se parler et d’établir quelques règles de vie pour que tout fût parfait. D’accord pour remplir le lave-vaisselle chaque soir, mais les poussières sur la télévision auraient pu attendre un autre moment. Et lui, quand elle se montrait câline et désirante, il aurait quand même pu répondre à ses attentes. Ce n’était pourtant pas compliquer de prendre dans ses bras la femme qu’on aime, de lui donner quelques baisers dans le cou et de l’entendre déjà gémir de satisfaction.
Allons, c’était décidé, il irait retrouver Agnès le soir du réveillon. Il débarquerait avec un beau cadeau (il avait trouvé les œuvres complètes de Proust dans la Pléiade. Elle qui aimait passer ses nuits à lire, elle ne pourrait qu’apprécier) et ils feraient la paix. A dix-sept heures, il se mit donc en route pour parcourir les soixante kilomètres qui le séparaient de leur maison commune. Mais voilà qu’après un quart d’heure la voiture avait montré des signes de fatigue. Elle avait d’abord toussoté, renâclé, puis avait fini par s’immobiliser complètement. Idiot qu’il était ! Il avait oublié de remettre de l’essence ! Voilà ce que c’était que de passer ses soirées dans les cafés ! Il dut donc faire du stop jusqu’à une pompe à essence, remplir un bidon que le tenancier voulut bien lui prêter, puis encore revenir à la voiture. Il était près de vingt heures quand enfin il redémarra. Mais il fallait rendre le bidon si gentiment prêté par le pompiste. Il s’arrêta donc à la station-service où on le réveillon avait déjà commencé, du moins les apéritifs. On l’invita à trinquer, pour oublier ses déboires. Que faire d’autre un soir de réveillon ? Refuser aurait été impoli et il décida d’appliquer tout de suite les bonnes résolutions qu’il comptait bien adopter avec Agnès. Il devait se montrer plus souple avec les gens et ne pas les froisser. Il s’attabla donc avec la famille du pompiste et avec deux trois amis qui étaient là. Il but quelques verres, grignota quelques toasts et finit par repartir. Ce ne fut pas facile, car chaque fois qu’il se levait on remplissait son verre. Il le vidait donc dans la bonne humeur générale, écoutait une blague, en racontait une à son tour, et riait comme un fou avec ces gens si sympathiques qu’il ne connaissait pourtant ni d’Eve ni d’Adam.
Quand enfin il se retrouva dans sa voiture, il était près de vingt-deux heures. Ce n’était pas grave en soi, il ne restait plus que cinquante kilomètres à parcourir, mais il prit conscience que s’il voulait surprendre Agnès en plein réveillon, il ne fallait plus trainer. Il accéléra et prit quelques risques mais cette fois la chance était avec lui. En effet, près d’un rond-point, les gendarmes avaient installé un barrage, sans doute en vue de vérifier le taux d’alcoolémie des conducteurs. Si on l’avait arrêté, il était cuit, c’était certain, avec tout ce qu’il venait d’ingurgiter ! Mais heureusement ces fichus poulets étaient déjà occupés avec trois autres voitures et on le laissa passer. Ouf !
Un peu plus loin cependant, en traversant un petit village, voilà qu’il tombe sur une bande de fêtards qui marchaient au milieu de la chaussée. Il lui fallut bien s’arrêter pour les laisser passer. Mais qui était-ce, là, dans la foule ? Incroyable, c’était Jean ! Jean, un copain d’école qu’il n’avait plus revu depuis au moins vingt ans ! Au point où il en était, Agnès pourrait encore bien l’attendre une demi-heure de plus. Il gara la voiture et rejoignit la bande au café de la mairie, qui était tout illuminé pour la Saint Sylvestre. Jean lui offrit un verre, qu’il lui rendit. Puis les autres s’y mirent aussi et bientôt, tout en parlant du temps passé et des bons souvenirs d’école, il se retrouva avec trois verres devant lui, qu’il vida sans même s’en rendre compte.
Quand le cabaretier mit tout le monde dehors, à trois heures du matin, et que les lampions s’éteignirent, il regagna sa voiture en titubant. Il s’installa au volant et n’eut même plus la force de mettre la clef de contact. Il s’endormit comme un loir et rêva à la nouvelle vie qu’il allait mener avec Agnès.
Pendant ce temps-là, celle-ci venait de tout ranger au rez-de-chaussée et, toute souriante, elle regagnait sa chambre, où l’attendait son nouveau compagnon. Dès qu’elle apparut dans sa nouvelle robe de chambre rose, celui-ci lui sourit et l’enlaça affectueusement. Elle n’avait jamais rien connu de si bon.

13:08 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature
26/12/2015
La vengeance est un plat qui se mange froid
Mon pays, c’est l’Albanie, et à l’âge de vingt-cinq ans je n’avais encore jamais quitté mon petit village où je vivais parfaitement heureux. Il en a été ainsi jusqu’au jour où ma sœur Alasina a décidé d’épouser un chrétien. Vous vous rendez compte du scandale ? Non seulement ce gars n’était pas originaire de nos montagnes et il habitait à cinquante kilomètres d’ici, dans la plaine, mais en plus il était chrétien ! Si elle avait eu un peu de décence, ma sœur aurait renoncé d’elle-même à cet amour, mais elle s’est entêtée. Notre mère a bien fait une ou deux remarques, pour la forme, mais elle ne s’est pas vraiment opposée à ce mariage. Je la soupçonne au contraire d’avoir admiré Alasina pour son courage, comme si c’était un honneur pour une fille de braver l’opinion publique. De plus, en agissant ainsi, la mère semblait dire qu’elle n’avait pas été heureuse en se soumettant à nos traditions et en acceptant pour époux le garçon que ses parents avaient choisi pour elle. Ce n’était vraiment pas gentil pour mon père ! Lui, au contraire, il s’était montré beaucoup plus énergique et il avait crié et hurlé plusieurs fois, en frappant du poing sur la table. Il avait même crié si fort que dans sa colère il avait fini par gifler Alasina de toutes ses forces. Du coup, elle était partie sans se retourner, elle avait épousé son chrétien et on ne l’avait plus revue.
Pendant plus d’un an on n’a pas eu de nouvelles d’elle. La maison semblait morte maintenant, car Alasina était comme un petit oiseau plein de vie qui chantait tout le temps. La mère préparait seule les repas et je voyais de la tristesse dans ses yeux. Quant au père, du jour où sa fille était partie avec cet énergumène, il n’avait plus fréquenté le café où il aimait tant jouer aux dés ou aux échecs avec les autres hommes du village, après la prière à la mosquée. En été, il ne s’était plus assis sous le tilleul centenaire de la grande place, pour discuter tranquillement à l’ombre avec les voisins. Il n’osait plus se montrer, c’était clair. Moi-même, quand j’allais abattre les arbres dans la forêt et que je croisais les jeunes du village, ils me lançaient des méchancetés incroyables. Certains crachaient même par terre en me croisant. Fichue Alasina, elle avait bien gâché notre vie !
Puis un jour on a reçu une lettre d’elle. Elle annonçait qu’elle attendait un enfant et elle demandait la permission de nous rendre visite. La mère a regardé le père craintivement et lui, il lui a répondu qu’elle n’avait qu’à agir comme elle l’entendait puisqu’après tout c’était sa fille. Elle a vu dans cette réponse un accord tacite, alors que si elle avait analysé les paroles du père, elle aurait compris qu’il lui disait : « Fais ce que tu veux, c’est ta fille, ce n’est plus la mienne. »
Ils sont arrivés en calèche un dimanche, jour de repos des chrétiens. Alasina était enceinte de sept mois, ça ne pouvait pas se cacher, c’est sûr ! A table, (c’était un repas froid, avec des tranches de veau et de la salade au yoghourt, je m’en souviens très bien) tout le monde semblait heureux de se retrouver et de faire connaissance avec l’étranger, mais moi, à part quelques mots, je n’ai rien dit. Vers la fin de l’après-midi, comme tout cela me tapait sur les nerfs, j’ai attrapé mon fusil et j’ai dit que j’allais tirer quelques lapins, mais ce n’était qu’un prétexte pour pouvoir m’éclipser. J’en avais assez supporté ! La mère a semblé déçue à cause de mon attitude, mais le père m’a regardé longuement dans les yeux. J’en ai déduit que j’avais son accord.
J’ai manqué le premier lapin, car ma main tremblait, mais les deux autres, je les ai bien eus. Ensuite, je me suis assis sur une pierre au bord de la route, pour me reposer. C’est alors que la calèche est arrivée comme prévu. Aussitôt, j’ai bondi en brandissant les deux lapins par les oreilles. La calèche s’est arrêtée et le mari d’Alasina m’a souri : « Une belle prise, vraiment ! » « Oui, une belle prise, un coup double, même ! » ai-je répondu en riant aussi. Puis j’ai laissé tomber les lapins, j’ai saisi mon fusil qui était chargé et je lui ai tiré dessus en plein visage. Alasina a hurlé. Alors j’ai braqué le fusil sur son ventre de femme et j’ai tiré trois coups. Comme elle ouvrait la bouche de stupéfaction ou de douleur, je lui ai enfoncé le canon du fusil dans le gosier et j’ai encore tiré un coup. Ca lui apprendra à ne pas respecter les traditions et à se comporter comme une trainée ! Non, mais…
Depuis, je vis dans la montagne. On dit que les gendarmes me recherchent, c’est bien possible. Mais je les connais, ils ne vont pas faire beaucoup de zèle pour une histoire d’honneur vengé. Dans quelques mois l’affaire sera oubliée. En attendant, pour manger, je tire sur tous les lapins qui ont le malheur de croiser ma route.
Ce texte était paru en juin 2015 sur le blogue des éditions Chloé des Lys :

22:01 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature
10/10/2015
Retour final
Le ciel est gris, infiniment gris.
Par la fenêtre il regarde le jardin, où il ne se passe rien. Les dernières feuilles sont tombées et pourrissent dans les flaques des allées.
Derrière lui, la vieille horloge compte le temps, seconde après seconde, inexorablement. Toc-Toc-Toc… C’est ainsi depuis son enfance et jamais elle ne s’est arrêtée de compter.
Le château est vide, ils s’en sont tous allés. Les plus jeunes sont partis vers d’autres contrées et les plus vieux reposent désormais au cimetière, dans l’immense caveau de famille. Quant à l’unique femme, il y a bien longtemps qu’elle a abandonné la place, le laissant désemparé, lui l’époux légitime et le seul héritier de tout le domaine.
Maintenant il pleut et le jardin que plus personne n’entretient semble encore plus triste.
Il soupire.
Autrefois, pour rompre cet ennui qui le prenait toujours au début de l’automne, il avait voyagé. Oui, il avait parcouru le monde ! Il avait vu Bombay, la côte indienne et les forêts où se cache le tigre. Sur une pirogue, il avait descendu l’Amazone et en Afrique, il avait parcouru des déserts. Il avait erré dans les souks arabes, s’était perdu dans la forêt congolaise et avait chassé le lion dans les savanes herbeuses. Des femmes, il en avait connu des dizaines. Des asiatiques aux longs yeux en amandes et des persanes dont le corps était enduit d’huile au parfum envoutant. Il se souvient d’une fille du désert dont on ne voyait que les yeux et qui était si belle quand elle avait laissé tomber ses vêtements qu’il avait rêvé d’elle pendant des années. Oui, des femmes, il en avait aimé beaucoup et il avait été aimé d’elles. Une fois parti, elles lui écrivaient dans leur langue des lettres incroyablement longues auxquelles il ne comprenait jamais rien.
Certes, il avait voyagé et avait parcouru le monde. Mais il avait compris que l’homme est partout le même, la couleur de la peau ne faisant rien à l’affaire. Au Vietnam ou en Jamaïque, au Sahel ou dans l’Ethiopie profonde, ce sont les mêmes combines louches, les mêmes trahisons, les mêmes coups fourrés. Il s’agit toujours de tromper l’autre et de s’enrichir à ses dépens. Partout, le pauvre peuple est manipulé pour assouvir les désirs des plus grands. Partout, ce ne sont que crimes, guerres et sang répandu. Même de l’amour des femmes il avait fini par douter. Que cherchaient-elles, finalement, en donnant leur corps à cet étranger de passage ? Ne cherchaient-elles pas à oublier la médiocrité de leur vie quotidienne en se tournant vers un rêve d’autant plus beau qu’il était éphémère ? Lassé de tout, après avoir parcouru tout ce qu’on pouvait parcourir, il était retourné dans son château.
Et là, la vieille pendule l’attendait, qui n’avait pas arrêté de compter les secondes pendant son absence. Il se retrouvait donc seul et vieux, perdu dans l’immensité des pièces vides.
Il regarde par la fenêtre. Le ciel est toujours gris et triste. Dans les allées, les feuilles pourrissent lentement dans les flaques d’eau.
Toc-Toc-Toc. L’horloge n’en finit pas de compter, tandis qu’au cimetière il reste une place vide dans le grand caveau orné des armoiries de la famille.

23:05 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature
21/09/2015
Souvenir
Il y avait tout au bout de la rue Hors-Château, une petite ruelle. Je l’aimais cette ruelle et j’y pénétrais souvent. C’est que tout au bout se dressait une maison. Une maison modeste certes et assez ancienne, mais une maison qu’enlaçait une glycine. Souvent, un doux parfum se répandait discrètement alentour. Loin du bruit la ville, l’habitation était là, hors du temps. Un peu penchée, d’aspect fragile, elle avait traversé plusieurs siècles et il me semblait respirer en ce lieu une atmosphère quasi moyenâgeuse. Je prenais mon temps pour regarder autour de moi. Tout était calme. Un merle, parfois, poussait un cri ou se risquait à quelques notes. Le vent faisait frémir doucement les feuilles de la glycine et tout là-haut, dans le ciel bleu, passait un nuage blanc. Le silence était impressionnant et jamais je ne me serais cru au cœur d’une grande agglomération.
Après quelques minutes, m’étant bien imprégné de l’ambiance qui régnait en ce lieu, je frappais à la porte. Alors, tu venais m’ouvrir. C’est ton sourire, toujours, que je voyais en premier. Ton beau sourire de jeune fille. J’avais vingt ans.
Les années ont passé et l’autre jour je suis retourné dans la petite ruelle, au bout de la rue Hors-Château. La maison est toujours là, la glycine aussi. Un merle a crié dans le silence et dans le ciel d’automne passaient de sombres nuages. J’ai frappé à la porte, mais personne n’a ouvert.
Qu’es-tu devenue, toi que j’ai aimée lorsque j’avais vingt ans ?

12:49 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature
16/08/2015
Fuite en avant
La route est devant lui. Il roule. A chaque rond-point, deux ou trois possibilités s’offrent à lui. Il en choisit une au hasard. Il roule et le paysage défile : des champs, des bois, des villages. Encore un embranchement, encore un rond-point. Il roule toujours, sans réfléchir, sans savoir où il va.
Le décor change, les prés deviennent vallonnés, à l’horizon se dessinent des montagnes. Le voilà dans les premiers contreforts, mais il ne s’arrête pas, il roule. Les virages sont maintenant en épingle à cheveux mais il continue, sans savoir où il va, ni où il veut aller. Il fuit. Il fuit sa vie trop pesante et qui n’a plus de sens. Il roule. Le voilà au sommet d’un col. Au loin, sur les cimes, on aperçoit de la neige, que le grand soleil d’été n’est pas parvenu à faire fondre. Pourquoi s’arrêter là ? Cela n’a pas plus de sens ici qu’ailleurs. Alors il roule.
La route maintenant descend et la voiture est embarquée dans une suite vertigineuse de virages en épingle à cheveux. Dans le rétroviseur, il voit la montagne et les dernières neiges qui resplendissent au soleil couchant. Il continue. Le voilà dans la plaine. Il fait chaud. Les vitres sont ouvertes et on entend les cigales qui crient dans la chaleur de l’été. Ici est un autre pays, un pays qu’il ne connaît pas. Là-bas, sur sa droite, à l’horizon, le soleil disparaît lentement. Il fait toujours torride. Il roule.
Voici des vergers à l’infini, puis des oliviers et enfin des vignes. Des vignes à perte de vue qui s’enflamment dans le soleil couchant. Il roule encore. Le terrain est de plus en plus plat. A la lueur des phares, il distingue une sorte de maquis : des buissons, des broussailles, quelques chênes verts. Il roule. Sa vie est derrière lui, vide de sens et lui il est parti. Il est parti comme cela, sur un coup de tête. Il est parti chercher un ailleurs improbable, un ailleurs où il pourrait enfin respirer et se sentir bien. Se sentir bien ou tout simplement se sentir lui-même, ce serait déjà beaucoup. Alors il roule, laissant derrière lui vingt années monotones et espérant trouver quelque part un endroit où s’arrêter.
Mais voilà que la route se rétrécit. Elle n’est plus qu’un chemin cahoteux. La voiture crapahute entre des dunes et subitement elle débouche sur une plage. Tout au bout, dans le noir, on devine la mer, avec ses vagues moutonnantes. Il coupe le moteur et écoute. On entend le gémissement des flots, leur rumeur incomparable et à nulle autre pareille. Alors après avoir hésité quelques secondes il remet le moteur en marche et poursuit sa route, tout droit devant lui.
Photo David Merlin
00:56 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (27) | Tags : littérature
13/06/2015
Le puits du village.
Il y avait, sur la place du village, un puits où autrefois tout le monde venait puiser de l’eau. Les jours d’été, quand le soleil donnait toute son ardeur méridionale, cette place ne désemplissait pas. Par la force des choses, elle était devenue le cœur du village. C’est là qu’à l’ombre des platanes les femmes venaient discuter de leurs petites misères et que les hommes se rassemblaient le soir pour jouer à la pétanque (et pour regarder à la dérobée les hanches des jeunes filles qui venaient puiser de l’eau). Il en avait toujours été ainsi et nul n’aurait pu croire qu’il en serait un jour autrement.
Pourtant, après la guerre, celle de quarante, le maire du moment cru bien faire en faisant installer l’eau courante dans toutes les maisons. Tout le monde se réjouit de cette invention incroyable qui amenait l’eau directement dans votre cuisine. Il ne fallait plus se déplacer, ni se pencher pour puiser l’eau, ni revenir en portant deux grands seaux à bout de bras. Non, il suffisait de tourner le robinet et l’eau était là, qui jaillissait claire et belle au sein même de votre demeure. Inutile de dire que le maire fut réélu trois fois de suite, ce qui était sans doute ce qu’il cherchait en introduisant dans le village cette technologie diabolique.
J’emploie à dessein le terme «diabolique » car après quelque temps il fallut se rendre à l’évidence : les femmes n’allant plus puiser de l’eau au puits, la place perdit rapidement toute sa population féminine. Renfermées dans leur logis, les pauvresses ne communiquaient plus entre elle. Elles se désolaient toutes seules devant leurs fourneaux et plus d’une sombra dans un mal étrange qu’on n’appelait pas encore dépression. Quant aux hommes, ils désertèrent la place à leur tour, puisqu’il n’y avait plus aucune jeune fille à admirer ni aucune croupe ondulante qui se penchait au-dessus du puits. Petit à petit ils délaissèrent le jeu de pétanque et prirent leur quartier au bistrot des sports, où on vendait assez cher un vin infâme qui vous montait à la tête et qui fut la cause de bien des disputes et même de quelques bagarres.
Insensiblement, le village changeait, mais personne ne s’en apercevait encore. Les années passèrent et les enfants grandirent. Un à un ils revinrent du pensionnat avec des diplômes, mais aucun ne reprit la ferme de ses parents. Ils s’en allèrent à la ville et on ne les revit plus jamais. Les habitants vieillirent et un à un à leur tour ils s’en allèrent ailleurs, généralement derrière le mur du grand cimetière. A la fin, il n’y eu plus dans le village que trois vieillards, lesquels s’évitaient d’ailleurs soigneusement à cause d’anciennes disputes qui remontaient à l’époque du café des sports. Un jour, il n’y eut plus qu’un seul habitant, un nonagénaire voûté qui regardait le passé avec nostalgie et l’avenir avec terreur. Alors, un beau matin d’été, n’y tenant plus, il rassembla ses dernières forces et gagna comme il put la place du village. Et là, dans un effort surhumain, il grimpa tant bien que mal sur le petit muret circulaire et se jeta dans le puits.

00:55 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature
27/12/2014
Enfance (2)
Je suis revenu souvent chez cet oncle, pour ainsi dire une fois par an. Nous passions nos vacances en Bretagne et de là nous faisions un détour par les Deux-Sèvres avant de remonter vers nos contrées du Nord. Après avoir connu pendant trois semaines le climat agité des Côtes d’Armor (qui en ces temps anciens s’appelaient encore les Côtes du Nord), ce petit village du Poitou, à un jet de pierre de la Charente et de la Charente-Maritime, incarnait pour moi le Midi. Je me souviens des promenades dans les champs, des murets de pierres sèches si caractéristiques de la région et des rivières endormies qui coulaient si lentement qu’on se demandait si elles trouveraient un jour leur chemin. Il y avait aussi de vieux lavoirs et des villages blancs assoupis au milieu des vignes et des blés. Il faisait chaud, incroyablement chaud et les cultures étaient arrosées en permanence, ce que je n’avais certes jamais vu chez moi, où la pluie tombait en abondance. Point de forêts à cet endroit, mais des lignes de peupliers qui barraient l’horizon et qui le soir murmuraient doucement quand la lune se levait. Il y avait aussi « la prairie », sorte d’immense champ communal qui appartenait à tous et où tout un chacun pouvait se promener à son aise. J’ai su depuis que cette prairie avait servi pendant la guerre à la Résistance, qui y faisait atterrir de petits avions de tourisme au nez et à la barbe des Allemands.
La guerre, justement était toujours très présente dans les conversations. Pas seulement celle de quarante, mais aussi la guerre d’Algérie, qui venait à peine de se terminer. Mon oncle était boulanger et un de ses ouvriers revenait tout juste des djebels. Ca discutait donc ferme, à table, de l’Algérie française, du FLN, de De Gaulle et de toute cette politique à laquelle le gamin que j’étais ne comprenait rien du tout. Je n’avais d’ailleurs jamais vu autant de personnes rassemblées pour un repas. Outre mon oncle, ma tante et leurs cinq enfants, il y avait l’ouvrier de retour d’Algérie, un apprenti et un chauffeur (lequel faisait les tournées pour vendre le pain dans les fermes isolées). Ajoutez à cela mes parents et moi-même, nous étions donc treize à table.
Les plats servis étaient dignes des meilleurs restaurants. Je me souviens surtout du potage, qu’on appelait « mijo » et qui était un mélange d’eau et de vin dans lequel on avait fait tremper du pain. On le servait froid, au sortir du réfrigérateur. En écrivant ces lignes, j’ai encore en bouche sa saveur bien particulière. Il faut dire que j’adorais ce potage, qu’on me servait malgré mes dix ans, ce qui me classait immédiatement dans le clan des adultes, puisqu’il contenait du vin. Il y avait ensuite une entrée, suivie du plat principal et enfin venait le dessert. C’étaient de véritables festins gargantuesques et j’ai toujours admiré ma tante qui parvenait à préparer tout cela sans s’énerver le moins du monde et avec un calme olympien. Essayez, vous, de préparer chaque jour un repas pour treize personnes !
Pendant que les adultes continuaient à discuter, je m’éclipsais discrètement dehors. J’écartais légèrement les volets qui donnaient un peu de fraîcheur à l’intérieur de la maison (laquelle, du coup, était plongée dans une semi-obscurité permanente qui m’enchantait) et je me retrouvais dans la cour écrasée de lumière et de chaleur. De là, j’allais vers le fournil, qui était un lieu magique. On trouvait là un immense pétrin en bois, dans lequel on préparait la pâte à la main. Il y avait aussi un pétrin électrique. La farine tombait directement du grenier par une sorte de trémie. Et puis il y avait le four ! Le premier que j’ai connu fonctionnait au bois. D’immenses fagots qui servaient à le chauffer s’alignaient d’ailleurs dans la cour. On pouvait aussi le réchauffer avec une espèce de lance-flammes qui m’impressionnait beaucoup. Plus tard, l’oncle s’était modernisé et il avait installé un four qui devait fonctionner au fioul. Il y avait aussi une sorte de tapis roulant sur lequel on étalait les panetons avant d’enfourner le tout en quelques secondes. Pour retirer le pain, on utilisait des espèces de pelles en bois munies d’une longue perche. C’était un régal de déguster au petit-déjeuner une baguette qui venait juste d’être cuite et qui était encore toute chaude. Honnêtement, je n’ai plus jamais rien mangé d’aussi bon.
Durant la matinée, ça s’agitait beaucoup dans ce fournil et il valait mieux ne pas y mettre les pieds, mais après le déjeuner, il était désert et je pouvais m’y faufiler discrètement. J’aimais par-dessus tout l’odeur de farine, de pâte et de pain cuit. Il faisait chaud, forcément, le four attendant une dernière fournée. Mon plus grand plaisir était de me glisser entre celui-ci et le mur, où il y avait un passage d’environ cinquante centimètres. Là, je fermais les yeux et j’écoutais les grillons qui avaient élu domicile là, dans la chaleur permanente du fournil.
Je me souviens aussi être allé avec mon oncle faire les tournées des fermes. Il possédait une camionnette Citroën qui s’aventurait dans des chemins périlleux, cernés par deux murs de pierres sèches, et qui étaient si étroits qu’il fallait klaxonner à chaque tournant. On arrivait dans des maisons improbables, coupées du monde, où une petite vieille venait acheter sa baguette et un kilo de pâtes (car la boulangerie faisait un peu épicerie). Elle ne payait jamais, mais on inscrivait sur une feuille le nombre de pains achetés et on réglait le tout à la fin du mois. Autrefois, on se contentait même d’un bâton en bois sur lequel on faisait une entaille par baguette achetée, bâton qui restait près de la porte de la ferme. C’était manifestement une autre époque, où tout le monde faisait confiance à tout le monde.
Ce que j’aimais par-dessus tout chez mon oncle, c’est qu’il me considérait pour ainsi dire comme un adulte. Je veux dire par là qu’il ne s’adressait pas à moi comme à un enfant (ce que faisaient mes parents, qui me faisaient sentir que j’étais là pour écouter et obéir) mais comme si j’avais été son égal, ce qui évidemment me plaisait beaucoup.
Je me souviens que lorsque j’avais eu douze ans, j’avais dormi non plus dans le corps de logis proprement dit, mais de l’autre côté de la cour, dans une chambre qui venait d’être aménagée dans un ancien grenier. Je m’étais donc retrouvé là complètement seul et isolé de tous, ce qui avait enchanté le jeune adolescent que j’étais. J’avais pu lire jusque fort tard dans la nuit, tandis que l’horloge de l’église sonnait les heures et les demies. Avant de m’endormir, j’avais ouvert la porte pour contempler cette église, qui se trouvait juste en face, de l’autre côté de la route. C’était magnifique. J’étais là, seul, et je contemplais ce bâtiment de style roman éclairé dans la nuit. C’est une image qui ne m’a plus jamais quitté.
Une année, l’oncle était parti en vacances en même temps que mes parents et comme nous étions dans le massif central (la Creuse, la Corrèze, le Lot ? Je ne sais plus), nous étions allés le retrouver à Beynac, en Dordogne, où il campait. Il y avait un château perché sur une falaise. Il était magnifique, le matin, quand il émergeait de la brume. Le jour où nous sommes repartis, à cinq heures du matin, l’oncle s’était évidemment levé pour nous dire au revoir. Et là, je ne sais pas pourquoi, j’ai été subitement très ému car j’ai eu la certitude que c’était la dernière fois que je le voyais. C’était un pressentiment vraiment inexplicable mais qui s’est malheureusement confirmé. Il est mort deux ans après, sans que je l’aie revu, des suites d’un cancer de la gorge, contracté probablement par la cigarette et par la poussière de farine qu’il avait respirée toute sa vie. Il avait à peine plus de soixante ans.

02:16 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : littérature
22/12/2014
Tempête
Au creux de l’hiver, les vagues ont déferlé en des colères atlantiques, se fracassant contre les falaises, submergeant les rochers et se répandant au plus profond des terres. Elles ont déferlé avec fracas, coléreuses et vengeresses, furieuses d’avoir été trop longtemps contenues. Je les ai vues envahir mon jardin, pénétrer dans ma maison et ruiner le mobilier ancien qui avait survécu à toutes les guerres. Les livres, délaissant leurs rayons, se sont mis à flotter au gré de l’eau saumâtre, emportés par les flots aux quatre coins de la chambre, flottant comme des esquifs à la dérive.
J’ai repêché quelques volumes et je suis allé les porter à l’étage. Il y a avait là la Recherche et puis le Voyage. Ils dégoulinaient sur le plancher et c’était une pitié de les voir dans cet état, complètement trempés, ruisselants, avec de l’eau qui ressortait d’entre les pages quand j’appuyais sur la couverture. C’était une vraie désolation, j’en avais le cœur fendu.
De désespoir, j’ai abandonné la maison. J’ai enfilé mon manteau et suis parti vers le haut de la falaise pour contempler le spectacle de la nature en furie sans prendre le risque de me noyer.
La mer était enragée. Elle se précipitait contre les rochers à pic, qu’elle prenait littéralement d’assaut, terminant sa course en énormes gerbes d’écumes qui faisaient bien vingt mètres de haut. Je n’avais jamais rien vu de semblable et me sentais bien petit au milieu de ce déchaînement des éléments. Paradoxalement, à cause de cette démesure même, la vie me semblait prendre tout son sens. Comme si le fait de sortir de la routine quotidienne donnait une autre dimension à mon existence ou comme si le monde bien ordonné que j’avais toujours connu pouvait subitement être remis en cause par la sauvagerie de la nature.
Je suis resté là des heures, à contempler l’océan. Quand la nuit est venue, les phares de la côté ont tenté de trouer les ténèbres, tandis que les cornes de brumes criaient à l’envi leur désespoir.
Je suis redescendu et ai regagné ma maison. L’eau s’en était allée et il ne restait sur le parquet que les livres, épaves échouées et dispersées là par le hasard.
Une page de mon existence venait d'être tournée.

20:29 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature
16/12/2014
La maison des vacances (suite et fin)
Une salle immense s’ouvrait devant moi, qui devait bien faire trente ou quarante mètres de profondeur et même peut-être davantage. Mais ce qu’il y avait d’extraordinaire, c’étaient les murs, où étaient suspendus une bonne cinquantaine de portraits. Nous nous sommes avancés, Marie et moi, et je dois dire que c’était vraiment impressionnant ! On se serait cru au milieu d’une foule, tant tous ces personnages étaient nombreux. Les premiers portaient des habits d’un autre temps et une épée pendait à leur côté. D’autres avaient l’air de militaires du temps de Louis XIV ou de mousquetaires. Il y avait des capitaines de navires, dont les trois mats étaient peints en arrière-plan au milieu d’une mer agitée. Plus on avançait, plus l’habillement se rapprochait de celui de notre époque. Il y avait des notables habillés en grands bourgeois qui n’auraient pas déparé dans un roman de Balzac, des banquiers dressés derrière leur comptoir, des notaires au visage sévère et aux imposantes lunettes métalliques. Venaient ensuite des espèces d’industriels, des érudits, des politiciens haranguant une foule imaginaire. Plus nous progressions au milieu de cette galerie, plus nous nous sentions mal à l’aise car ces personnages au regard perçant semblaient tous nous fixer et nous examiner d’un air désapprobateur. Il nous a fallu un certain courage, observés comme nous semblions l’être, pour continuer notre visite jusqu’au bout. Là, sur le mur du fond, se trouvaient les derniers descendants de cette famille illustre : des chercheurs en blouse blanche, des écrivains, des professeurs de faculté, des médecins, quelques ingénieurs et même un informaticien. Au bas du portrait de celui-ci figurait une date de naissance, mais pas encore de date de décès, ce qui me troubla profondément.
Nous sentant de plus en plus mal à l’aise, nous avons retraversé cette grande galerie pour rejoindre la sortie, mais plus nous avancions, plus il me semblait une nouvelle fois que les yeux des portraits nous suivaient. Par exemple, si j’en observais un qui se trouvait devant moi, sur la droite, son buste était tourné dans ma direction et son regard était plongé dans le mien, comme si j’avais eu affaire à un individu vivant. Mais quand j’arrivais à sa hauteur, le personnage me regardait toujours et son buste curieusement semblait droit. Par contre, lorsque j’ai jeté un bref coup d’œil en arrière après l’avoir dépassé, j’ai été stupéfait de constater qu’il me fixait toujours et que son buste semblait à nouveau tourné dans ma direction.
Bref, c’est quasi en courant que nous avons atteint la sortie et là il s’est produit quelque chose de vraiment extraordinaire. Nous avions déjà quitté cette galerie, mais je me suis retourné encore une fois et là j’ai vu (ou en tout cas j’ai cru voir) tous les portraits qui étaient penchés dans ma direction, comme s’ils sortaient de la toile, et qui me fixaient. J’ai fermé les yeux un instant et quand je les ai rouverts, tout était normal, chaque personnage avait repris sa place initiale, celle que le peintre lui avait attribuée.
Nous avons regagné notre chambre et pour la première fois, je ne sais pourquoi, j’ai tourné la clef dans la serrure à double tour derrière nous. La réalité était que nous semblions aussi inquiets l’un que l’autre. Décidemment, la visite de cette maison nous avait plongés dans un drôle d’état. Pourtant, objectivement, il n’y avait rien de plus normal que de trouver les portraits des ancêtres dans une vieille demeure comme celle-ci. Marie s’est endormie une fois la lampe éteinte, mais son sommeil était agité et elle remuait sans cesse en gémissant sourdement. De mon côté, je ne parvenais pas à dormir et je gardais les yeux grand ouverts dans le noir, essayant de me souvenir à quelle famille illustre avait appartenu cette maison. A la fin, j’ai dû m’assoupir et j’ai fait un rêve étrange dans lequel apparaissaient plusieurs des personnages découverts dans la galerie des portraits. Ce rêve reste assez flou dans ma mémoire, mais j’en conserve le sentiment d’avoir été amené devant des juges et condamné irrémédiablement. C’est le notaire qui a lu le verdict final et devant les mousquetaires de Louis XIV qui riaient à gorge déployée, le capitaine au long cours m’emmena sur son bateau pour me conduire dans une île déserte où il devait m’abandonner.
Je me suis réveillé en sursaut et une sueur froide coulait sur mon front. J’avais au fond de moi un tel sentiment de solitude et d’abandon que j’en frémissais. J’ai allumé la lampe et à ma grande surprise j’ai vu que Marie était assise sur le bord du lit et ses yeux grand ouverts semblaient remplis de panique. « Ecoute » me dit-elle. Je prêtai l’oreille et j’entendis des voix qui provenaient du fond de la maison. On aurait dit que des dizaines de personnes s’étaient réunies là et qu’elles tenaient une assemblée politique ou un meeting. Ca parlait fort, ça criait, ça riait. Ce n’était pas possible ! Le propriétaire aurait-il loué une partie de la maison pour une fête ou un mariage et cela sans nous prévenir ? Cela n’avait aucun sens, d’autant plus qu’hier au soir, à part Marie et moi, cette maison était parfaitement déserte. Je me suis approché de la porte et précautionneusement j’ai tourné la clef. Une fois dans le corridor, les voix me parvinrent beaucoup plus distinctement. J’ai avancé lentement, sans faire de bruit, mais j’avoue que je n’en menais pas large. Marie, qui me suivait, est venue se blottir contre moi. Nous avons traversé le salon et la salle à manger découverts hier, mais ces pièces étaient vides. Les voix venaient de plus loin, probablement de la galerie des portraits. Nous avons donc pénétré dans les quatre salles vides, toujours sans faire le moindre bruit. Je sentais la main de Marie qui tremblait sur mon bras, ce qui ne me rassurait pas beaucoup. Les voix provenaient bien de la grande galerie aux portraits, dont la porte était fermée, mais un rai de lumière filtrait en-dessous. Nous nous sommes approchés et précautionneusement j’ai tourné la poignée. A la vue de ce qui s’offrit alors à moi, j’ai poussé un cri. Les personnages dont on avait peint autrefois les portraits semblaient être sortis de leur cadre en bois. Ils se penchaient à l’extérieur de celui-ci comme s’ils avaient été accoudés à une fenêtre Certains tenaient un verre en main, d’autres riaient, d’autres encore semblaient tenir entre eux une conversation animée. Quand ils nous virent, tous tournèrent la tête dans note direction. Cela ne dura qu’une seconde, puis la lumière s’éteignit brusquement. Je tâtonnai pour trouver l’interrupteur et quand la lumière réapparut, tout était normal : les portraits étaient immobiles dans leur cadre, comme ils avaient toujours été depuis des siècles.
Nous nous sommes regardés, Marie et moi, puis nous nous sommes mis à courir en direction de notre chambre où nous nous sommes enfermés. Nous avons immédiatement rassemblé nos affaires, fourré le tout dans les sacs à dos et trois minutes plus tard nous descendions comme nous pouvions la montagne en direction de notre voiture, dans le noir et sous la pluie battante qui continuait à tomber. En nous retournant, nous avons aperçu la maison. Elle était silencieuse et on la distinguait à peine dans l’obscurité. Pourtant, avant de mettre le moteur en marche, il m’a semblé entendre comme un grand éclat de rire, mais je ne saurai jamais si j’avais rêvé ou non.

00:05 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature
11/12/2014
La maison des vacances
C’était une grande maison.
Elle était beaucoup trop grande pour nous, mais nous l’avions louée comme cela, pas chère d’ailleurs, vu qu’il n’y avait ni eau ni électricité et qu’elle était loin de tout. C’est ça qui nous avait séduits, en fait. Pour l’atteindre, il fallait faire deux bons kilomètres à pied à partir d’une petite route communale où il ne passait jamais personne. Que rêver de plus pour passer des vacances tranquilles ? C’était l’idéal : pas de bruit, pas de voisins et une vue superbe sur les montagnes. Bon, le premier jour il avait fallu faire cinq allers-retours depuis la voiture pour acheminer dans des sacs à dos tout ce dont nous avions besoin. C’était un peu épuisant, je le reconnais, surtout après les mille deux cents kilomètres que nous avions derrière nous, mais il faut savoir ce que l’on veut dans la vie. En tout cas, ce soir-là, nous avons bien dormi, je peux vous le dire, sans savoir d’ailleurs si c’était à cause du silence environnant ou à cause de la fatigue, mais ce qui compte, c’est le résultat, non ?
Le lendemain, on s’est levé tard, mais dès qu’on a ouvert les volets, on s’est retrouvé au paradis. La montagne, la chaleur, le cri-cri des insectes, tout nous enchantait. On a pris le petit- déjeuner sur la terrasse (enfin sur une des trois terrasses) tout en admirant le paysage. Qu’est-ce que c’était beau ! Et qu’est-ce que cela nous changeait de la grande ville, avec tous ces passants qui vous bousculent sur les trottoirs, ces voitures bruyantes, ce stress permanent. Non, franchement, ni Marie ni moi ne regrettions d’avoir pris cette location. Puis nous avons mis une baguette et un saucisson dans un des sacs à dos et nous sommes allés faire une grande balade. Du haut des sommets, la vue était encore plus magnifique : derrière les montagnes, il y avait d’autres montagnes et tout derrière on apercevait la mer Méditerranée. Un véritable paradis, je vous dis. On est redescendu et quand on est arrivé à la maison, il faisait presque noir. On a mangé dans l’obscurité, sans lampe, pour épargner la bonbonne du Camping-gaz. Avec la lune qui s’était levée, on y voyait suffisamment. J’avais juste déposé une petite bougie sur la table et c’était romantique à souhait. La lumière tremblotante éclairait nos visages et Marie n’avait jamais été aussi belle. Cette nuit-là, nous avons fait l’amour comme nous ne l’avions plus fait depuis longtemps.
Puis le temps a commencé à défiler comme cela arrive toujours en vacances. Il faut dire que tous les trois jours il fallait redescendre au village pour faire les courses, puisqu’il n’y avait pas de réfrigérateur. A chaque fois, cela supposait plusieurs allers-retours entre la voiture et la maison. Autant dire que la nuit nous surprenait alors qu’on n’avait pas encore tout rangé dans les armoires. On s’endormait immédiatement et on ne se réveillait que vers dix heures du matin, tant on était épuisé par toutes ces marches. Il est vrai que les jours où nous étions libres (je veux dire quand il ne fallait pas faire les courses) nous n’arrêtions pas de gravir tous les sommets des alentours. Après deux semaines, nous avions escaladé les six pics qu’on voyait de la maison. Enfin, quand je parle de « pics » c’est un peu exagéré. Nous étions en moyenne montagne, avec des sommets qui ne dépassaient pas les mille huit cents mètres, mais cela nous faisait quand même des promenades avec des dénivellations de plus de mille mètres et avec cette chaleur, ce n’était pas toujours évident. L’eau était d’ailleurs notre principal problème. Pour faire notre toilette, il y avait la citerne d’eau de pluie (encore que nous l’utilisions avec parcimonie car j’avais constaté que le niveau d’eau était particulièrement bas à notre arrivée), mais pour boire, il fallait bien utiliser des bouteilles d’eau minérale. Evidemment, plus nous marchions en montagne, plus nous avions soif et plus nous buvions. Mais plus nous buvions, plus vite il nous fallait acheter des bouteilles et donc retourner au magasin, ce qui signifiait de nouveaux allers-retours entre la voiture et la maison, où nous arrivions de nouveau assoiffés.
Bref, après deux semaines à ce rythme-là, nous devions avoir perdu chacun trois kilos, ce qui s’expliquait par nos grandes randonnées, mais aussi par le fait que nous avions décidé de rationner la nourriture, afin de devoir faire les courses le moins souvent possible. Les sentiers environnants avaient été parcourus dans tous les sens et nous allions commencer à nous ennuyer quand le temps s’est gâté. Il y a eu un orage terrible, qui a rempli complètement la citerne et qui a fait tomber la température. Du coup, nous avions moins soif et c’était une bonne chose. Les jours qui ont suivi cet orage ont été franchement mauvais. De la maison, on ne distinguait plus les sommets, perdus dans la grisaille et les nuages. Impossible, donc, de faire la moindre balade sans risquer de se perdre. Alors on a sorti des placards les livres que nous avions eu la bonne idée d’emporter avec nous. J’adore lire, mais j’avoue qu’après être resté assis douze heures d’affilée, je n’en pouvais plus. C’était à peine si mes yeux parvenaient encore à lire les lettres. Visiblement, Marie n’en pouvait plus non plus, alors pour la première fois nous sommes partis à la découverte de la maison. Cela va peut-être vous sembler étrange, mais elle était si grande qu’à part quelques pièces que nous avions parcourues le premier jour, nous ne l’avions pas encore visitée.
Nous avons donc erré de salles en salles et avons arpenté des centaines de mètres de corridors. Nous nous sommes ainsi retrouvés dans de grandes salles à manger aux beaux meubles en chêne, dans des salons dont tous les fauteuils étaient camouflés sous des housses, dans des salles de bain immenses dont les murs, recouverts de miroirs, multipliaient à l’infini notre image étonnée dans une sorte de mise en abîme fantastique. Nous avons ainsi découvert une bibliothèque dont le rayonnage, qui montait jusqu’au plafond, recouvrait les quatre murs. Les livres qui s’entassaient là devaient dater d’un autre temps, si on s’en tenait à leur couverture en cuir ouvragé. L’œuvre la plus récente que j’ai pu découvrir était la correspondance de Voltaire. Par contre, tout le XVI° siècle était bien représenté, depuis les Dames galantes de Brantôme jusqu’au Don Quichotte de Cervantès, en passant par les poésies de Ronsard. Curieux quand même. On aurait dit que le temps s’était arrêté et que ce qui était postérieur au XVIII° siècle n’avait pas franchi les murs de cette maison. J’étais en train de me demander à quelle époque elle avait été construite quand Marie, qui avait pris de l’avance dans la visite pendant que je fouinais dans les livres, m’appela avec insistance. J’ai traversé en hâte quatre pièces vides qui communiquaient entre elles par des portes intérieures et quand je suis arrivé devant la cinquième, je suis resté bouche bée.
(à suivre)
14:53 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature