13/09/2009
Intermède musical: Léo Ferré et l'Italie
On ne le sait pas toujours, mais Léo Ferré, qui a tout de même conduit la chanson française à des sommets rarement atteints, a aussi chanté en italien. Si son père était directeur du personnel du Casino de Monte-Carlo, sa mère, Marie Scotto, était une couturière d'origine italienne. D’ailleurs, à neuf ans, il se retrouvera chez les Frères des Ecoles chrétiennes au collège St Charles de Bordighera, en Italie, où il sera en pension pendant huit ans (cf. son livre Benoît Misère).
Attention tout de même qu’il s’agit ici d’une école française des Frères de l’instruction chrétienne (le collège St Charles de Marseille, en fait), exilée en Italie, suite la suppression légale de l'ordre en France le 7 juillet 1904. Si les Frères avaient été appuyés du temps de Napoléon III, ils avaient commencé à perdre de leur influence sous Jules Ferry (lois laïques) avant de se voir interdits d'enseignement en 1904. Du coup, beaucoup d’écoles passèrent la frontière et s’établirent dans le Nord-Ouest de l’Italie, à une distance encore raisonnable du lieu de domicile des élèves.
Mais revenons à Ferré. Si celui-ci a toujours aimé l’Italie, c’est surtout après son mariage avec Marie-Christine Diaz qu’il s’installe près de Florence. En 1972, il enregistre d’ailleurs son premier disque en italien, ce qui n’est pas courant pour un poète français. Notons encore que c’est à Castelina qu’il se réfugiera quand il sera malade et que c’est là qu’il décédera en 1993, ce qui en dit long sur son amour pour la Toscane, où il se sentait chez lui.
Il n’est jamais facile de traduire un texte, surtout si ce texte est un poème. Il semblerait que Ferré, lorsqu’il chantait en italien, ait usé de sa voix pour faire passer tous les sentiments qu’il avait mis dans le texte initial en français, comme s’il voulait par-là compenser une éventuelle perte de sens. C’est ainsi que ce très beau texte qu’était « Tu ne dis jamais rien» est à mon avis chanté avec encore plus de force quand il devient «Tu non dici mai niente ». Le poète y exprime à vif tous ses regrets et sa sensibilité y est à fleur de peau.
Jugez vous-même :

http://www.youtube.com/watch?v=nLd1c7FTrEY
02:02 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : léo ferré
21/01/2009
La Montagne Sainte-Victoire

Il est des lieux, comme cela, qui appartiennent de plein droit à la culture. On les connaît sans les avoir jamais vus et le jour où on les voit, c’est moins leur réalité que l’on découvre que l’œuvre d’art qu’ils finissent par représenter à nos yeux. Un lieu comme Venise, par exemple, décrit par de nombreux écrivains, appartient assurément à notre imaginaire collectif. Difficile de s’y rendre sans penser à Goldoni, l’enfant du pays, à Georges Sand et à ses amours avec Musset, à Rilke, qui y séjourna souvent ou encore à Casanova qui se morfondit dans ses prisons avant de parvenir à s’en échapper.
En France, il y a Paris, bien entendu (comment visiter Notre-Dame sans penser à Hugo et à Esméralda ?), mais aussi des sites naturels. Maurice Barrès, dans sa « Colline inspirée » cherche le sacré dans de tels lieux et y voit comme l’essence même de la France :
"Il est des lieux qui tirent l'âme de sa léthargie, des lieux enveloppés, baignés de mystère, élus de toute éternité pour être le siège de l'émotion religieuse. L'étroite prairie de Lourdes, entre un rocher et son gave rapide; la plage mélancolique d'où les Saintes-Maries nous orientent vers la Sainte-Baume; l'abrupt rocher de la Sainte-Victoire tout baigné d'horreur dantesque, quand on l'aborde par le vallon aux terres sanglantes; l'héroïque Vézelay, en Bourgogne; le Puy de Dôme; les grottes des Eyzies, où l'on révère les premières traces de l'humanité; la lande de Carnac, qui parmi les bruyères et les ajoncs dresse ses pierres inexpliquées ; la forêt de Brocéliande, pleine de rumeur et de feux follets, où Merlin par les jours d'orage gémit encore dans sa fontaine ; Alise-Sainte-Reine et le mont Auxois, promontoire sous une pluie presque constante, autel où les Gaulois moururent aux pieds de leurs dieux ; le mont Saint-Michel qui surgit comme un miracle des sables mouvants; la noire forêt des Ardennes, toute inquiétude et mystère, d'où le génie tira, du milieu des bêtes et des fées, ses fictions les plus aériennes ; Domremy enfin, qui porte encore sur sa colline son Bois Chenu, ses trois fontaines, sa chapelle de Bermont, et près de l'église la maison de Jeanne. Ce sont les temples du plein air. Ici nous éprouvons soudain le besoin de briser de chétives entraves pour nous épanouir à plus de lumière."
Bon, Barrès, avec son patriotisme qui prépare la guerre de 14-18 et sa symbolique religieuse, nous semble un peu dépassé aujourd’hui. Ainsi, quand il parle de la montagne Sainte-Victoire, il n’y voit qu’une « horreur dantesque » alors que pour nous ce massif évoque d’abord la peinture et semble indissociable de l’histoire de l’impressionnisme. La première fois que je l’ai vue, à partir de l’autoroute, il m’a d’ailleurs semblé rouler dans un tableau de Cézanne. Difficile en effet de ne pas contempler ce massif sans penser aux nombreux tableaux que ce peintre en a faits.

Image Internet
Située à l’Est d’Aix-en-Provence, la montagne Sainte-Victoire s’appelle en réalité en occitan le Mont Venturi, autrement dit la montagne de la victoire. De quelle victoire parle-t-on ? Probablement de celle de 102 avant JC, que remporta Caïus Marius et ses légions romaines sur les Cimbres et les Teutons. Certains linguistes pensent cependant que l’origine du nom serait plus lointaine et que les Celto-Ligures qui occupaient le pays 1000 ans avant l’arrivée des Romains appelaient déjà cette montagne le « Vintour », en faisant allusion au vent que l’on rencontre à son sommet (voir aussi l’appellation « Ventoux »).
Ce qui est sûr, c’est que cette montagne a été sanctifiée au Moyen Age et qu’elle porta alors le nom de Sainte Venture. Une chapelle fut d’ailleurs construite à son sommet au XIII° siècle, m’apprend Google qui en sait plus que moi. Au XVII° siècle on a francisé le nom provençal et le massif s’est donc appelé Ste Victoire. Tout étant religieux au Moyen Age, citons encore, non loin de là, le massif de la Sainte Baume (d’après le provençal « baume », qui signifie grotte et qui remonte à une légende selon laquelle Marie-Madeleine, qui aurait débarqué aux Saintes-Maries-de-la-Mer et qui aurait ensuite évangélisé la Provence, se serait retirée dans une grotte de ce massif).
Mais revenons à notre Sainte Victoire. Ce massif de 6 525 ha est classé depuis 1983. Selon une étude par satellite, il serait toujours en train de grandir (7mm par an, ce qui n’est pas rien quand on est une montagne et qu’on a l’éternité devant soi). En outre, on y a découvert des œufs de dinosaures. En 1850, un barrage fut construit par… Zola, le père de l’écrivain. Ses eaux, malheureusement ne permirent pas d’éteindre l’incendie qui ravagea le versant Sud en 1989.
 Image Internet
Image Internet
Notons encore qu’au pied du versant Nord se trouve le village de Vauvenargues, célèbre pour son château, qui appartenait aux archevêques d' Aix, puis à la famille de Clapiers, dont le plus célèbre représentant est Luc de Clapiers, autrement dit l’écrivain Vauvenargues. Celui-ci était né à Aix mais il a séjourné dans ce château (que Louis XV avait élevé au marquisat pour services rendus pendant la grande peste de 1720 par Joseph de Clapiers, le père de Luc)
En 1958, ce château devint la propriété du peintre Pablo Picasso qui voulait se rapprocher des lieux peints pas Cézanne, qu’il admirait. Selon ses vœux, il a été enterré dans le parc du château. Pour les heureux et heureuses qui habitent la Provence, signalons qu’une exposition Picasso est prévue à Vauvenargues durant l’été 2009.
![Vauvenargues%2011-01-2003(3)%20[800x600].jpg](http://feuilly.hautetfort.com/media/02/00/2099090058.jpg)
Evidemment, parler de la Montagne Ste Victoire, c’est parler de Cézanne, l’enfant du pays (il était né à Aix). Il la peignit un très grand nombre de fois, dans un geste répétitif, comme pour tenter désespérément d’en atteindre l’essence. Cette manière de peindre cent fois le même sujet fait penser à Monet avec ses Nymphéas ou sa cathédrale de Rouen ou bien encore aux natures mortes de Picasso. On dirait que le peintre veut atteindre l’âme du sujet traité mais, en allant de plus en plus loin dans son étude, il semble perdre ce sujet lui-même car c’est chaque fois une autre Ste Victoire que Cézanne nous propose ou une autre cathédrale que Monet nous donne à voir. L’angle de vue a changé, les conditions météorologiques aussi, la lumière est différente, le regard du peintre lui-même n’est plus le même.
Bref, dans cette tentative désespérée de rendre le réel, l’artiste s’essouffle en rendant compte de détails qui sont à chaque fois autres. Il a beau s’acharner à reproduire ce qu’il voit, les tableaux sont toujours différents, ce qui l’amène à recommencer encore et encore, dans un travail sans fin qui s’annule lui-même puisque la dernière toile semble contester la précédente. Nous touchons là l’essence même de l’art et son impossibilité à dire quoi que ce soit. Tout n’est qu’approche imparfaite, approximation, vague rendu de ce qui existe et qui demeure insaisissable. On comprend dès lors qu’un peintre comme Van Gogh soit devenu à moitié fou, tant cette tentative obsessionnelle de saisir le réel reste finalement décevante. Cela me fait penser aussi au poète Jaccottet et à son malaise pour dire l’indicible.

En fait Cézanne comme Monet sont engagés dans une course au détail (rendre la lumière sur telle partie de la Montagne ou de la cathédrale) qui finit par leur faire négliger l’ensemble. L’objet peint finit par disparaître au profit d’un détail qui est à chaque fois changeant (la lumière ou le point de vue ont été modifiés). On pourrait encore dire qu’ils tentent de rendre leur sujet en se plaçant dans des conditions différentes pour l’aborder (angles de vue, etc.), croyant par ces approches variées parvenir finalement à l’exprimer pleinement. Hélas, Cézanne pourrait continuer à peindre ses Ste Victoire à l’infini, il ne parviendrait jamais à dire ce qu’est la Ste Victoire.
Nous-mêmes, quand nous visitons un lieu, nous ne sommes jamais dans les mêmes dispositions d’esprit. Prenez une forêt. Un jour vous êtes sensible à son calme, un autre jour au bruit des feuilles, puis à la masse noire ou bleue formée par l’ensemble, quand vous n’êtes pas attentif à la musique des frondaisons ou à la forme majestueuse des troncs centenaires. C’est qu’on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, les philosophes grecs de l’Antiquité le savaient bien.

Cézanne, en tentant de peindre cette Ste Victoire qui lui échappe sans cesse, essaie surtout de nous faire passer ses sentiments à lui. La montagne n’est finalement qu’un prétexte. Ce qu’il veut nous dire et nous communiquer en peignant, c’est l’émotion qu’il a ressentie devant elle et qu’il n’arrive jamais tout à fait à exprimer. C’est que l’artiste, comme tout être humain, est seul, enfermé dans cette solitude de son corps et de ses sentiments qui fait que chacun de nous est unique et que ce qu’il ressent au plus profond de lui, il a bien du mal à le communiquer aux autres, lesquels, à leur tout, ont bien du mal à le comprendre. La Ste Victoire pour Cézanne devient aussi complexe qu’une femme dont il serait amoureux et dont il tenterait en vain de nous révéler la perfection. Mais la Montagne reste inaccessible, grande et fière dans le beau ciel de Provence. Il n’empêche, quand nous la contemplons, nous ne pouvons pas la voir sans penser à Cézanne, dont elle est devenue le symbole. Quelque part, c’est tout de même avec ses yeux que nous la voyons. Elle n’est plus pour nous un simple amas rocheux, mais un paysage fait de courbes et de lumières, un paysage bien connu par les tableaux que l’on a contemplés (enfant dans les dictionnaires déjà, puis plus tard dans des expositions). La Sainte Victoire n’est plus une montagne, elle est devenue un personnage de culture et c’est à Cézanne que nous le devons, lui qui a su nous transmettre son amour pour cette belle dame de Provence.
Mais il n’y a pas que les peintres qui ont été séduits par la Ste Victoire. Jacqueline de Romilly, de l'Académie Française, possède une maison à proximité et je me souviens d’un article poignant du journal le Monde dans lequel elle expliquait son désespoir quand elle s’était rendu compte, arrivant en Provence après un long séjour à Paris, que de sa fenêtre elle ne pouvait plus apercevoir sa montagne préférée (ave l’âge elle devenue presque aveugle). Mais en se munissant de jumelles, elle était quand même parvenue à en saisir des bribes, alors elle avait su qu’elle était vraiment revenue en Provence.
Notons que l’historien Georges Duby, de l'Académie française et Edmonde Charles-Roux, de l'Académie Goncourt ont aussi habité dans les environs.

14:35 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : montagne sainte-victoire, cézanne
09/11/2008
Musique
C’est devenu la mode dans le monde des blogues de se lancer des défis les uns aux autres, un peu comme les joutes au Moyen-Age, où il fallait relever le gant. Heureusement, ici, le jeu est moins dangereux et il ne s’agit pas de participer à un tournoi mais simplement de répondre à des questions. Jusqu’ici, j’avais échappé à ce genre d’exercice périlleux mais comme il fallait s’y attendre ce qui devait arriver est arrivé. On me demande donc de donner cinq musiques qui me représentent. La demande ne pouvait venir que d’une personne qui affectionne la musique, en l’occurrence d’un insecte chanteur. J’ai cité Cigale. Comme elle est par ailleurs professeur de musique, la tâche n’est pas simple, vous en conviendrez. Néanmoins je vais essayer de faire abstraction de son métier qui est aussi sa passion et de rester honnête dans mes choix.
En premier lieu, honneur au poète qu’est Léo Ferré. On n’a que l’embarra du choix, évidemment, dans sa nombreuse production et j’aurais pu choisir les cinq titres chez lui, mais cela reviendrait à tricher (et Cigale m’en aurait voulu tout un été). Comme il fallait se limiter, voici La Mémoire et la mer, qui me semble être un sommet par la beauté du texte, difficile au demeurant et laissant la porte ouverte à de nombreuses interprétations:
Découvrez Léo Ferré!
En deuxième lieu, Jean Ferrat pour la puissance de sa voix et les sujets traités, souvent politiques. Une certaine manière de dire « non », un peu comme Brassens, mais dans un autre registre. Le sommet de sa carrière correspond à mes jeunes années aussi et j’ai parfois l’impression qu’on n’a pas retrouvé, depuis, cette force dans le milieu de la chanson.
Découvrez Jean Ferrat!
Mais j’aime beaucoup la musique classique aussi. Les plus connus, bien entendu (Mozart, Schubert, Schumann, Brahms, etc.) mais aussi Ravel, Sibelius, de Falla, Malher… Cependant, c’est Satie que je propose ici, avec ses gnossiennes. C'ets une musique calme mais qui n'est pas ennuyeuse et qui procure une sorte d'équilibre chez celui qui l'écoute :
Découvrez Eric Satie!
Ensuite, toujours dans le classique, je dois avouer une passion pour la musique sacrée, moi qui suis pourtant un athée convaincu. Ce n’est pas la religiosité que je recherche alors, mais l’aspect planant, poétique, qui semble donner un sens à la vie. En effet, cette sorte de construction théorique écrite par l’homme à partir du néant, ces notes ou ces chants (quoi de plus beau, finalement, à nos oreilles humaines, que ces voix d’hommes et de femmes qui se répondent dans un beau dialogue) qui s’élèvent, emplissent l’espace pour un instant d’éternité et retombent lentement pour disparaître dans le silence.
Voici donc Palestrina dans "Tu es petrus":
Découvrez Palestrina!
On a écouté Palestrina, j’aurais pu proposer Mouton, Josquin Desprez, Moulinié et bien sûr Hildegarde Von Bingen. Dans le même style, mais en plus sombre, pour les jours de désespoir, voici Couperin et ses leçons de ténèbres (ici la troisième leçon):
Découvrez Couperin!
La chaîne s’arrête là (sinon elle va continuer à tourner et finira bien par revenir). J’y ai répondu par amitié pour Cigale, laquelle a dû m’expliquer patiemment comment faire ces copiés/collés musicaux à partir d’un site que je ne connaissais pas. Mais cela va me permettre maintenant d’écouter de la musique sur mon PC tout en vous écrivant. Finalement, elle a eu une bonne idée.
00:30 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : errance, musique
27/08/2008
Destruction
Il est des lieux, dans notre enfance, qui nous ont émus nous ne savons trop pourquoi. Plus tard, une fois adultes, quand on y repense ou qu’on les revoit, cela ne se fait jamais sans une certaine nostalgie. Nous avons alors la certitude que l’essentiel était là, que tout était là, finalement, mais que nous ne le savions pas.
Malheureusement, j’ai l’impression que ces lieux, qui sont souvent des paysages (un saule pleureur en majesté au bord de la rivière, une grande plage face à l’océan, un marronnier dans la cour de l’école, un fleuve en crue dont la colère destructrice fascinait l’adolescent que je fus…) ont subi les outrages du temps. S’il m’arrive, à l’occasion, d’en avoir des nouvelles, c’est souvent pour apprendre leur destruction.
Le saule pleureur est toujours à sa place, mais à l’endroit où j’habite aujourd’hui il y avait un autre saule, en tout identique (la rivière en moins). La commune a décidé de le couper pour des raisons qui me restent incompréhensibles. Avec lui, c’est un peu de mon enfance qui s’en est allée, puisqu’il me permettait de rêver à l’autre arbre, là-bas, au bord de sa rivière. Il me semble que le petit garçon que j’étais alors et qui s’arrêtait, sur le chemin de l’école, pour le contempler, ne s’arrête plus maintenant, qu’il a définitivement disparu.
La grande plage des vacances, avec ses falaises de sable où les hirondelles de mer venaient nicher, a bien changé, si j’en crois les photos retrouvées sur Internet. Les touristes sont passés par là, piétinant le sable, faisant s’effondrer les dunes. Il n’y a plus d’hirondelles et même si j’y retourne un jour je n’entendrai plus leurs cris perçants et je ne verrai plus les zigzags fous qu’elles dessinaient dans le grand ciel bleu.
Aux dernières nouvelles, le marronnier de la cour est toujours là, mais l’école n’en est plus une et la porte est définitivement fermée. Qui pourrait dire qu’un jour j’ai gravi ces escaliers de pierre ? Une fois qu’on franchissait le seuil, on était surpris et pénétré par l’odeur âcre de la cuve à mazout (odeur étrange pour moi car chez moi on se chauffait au bois). Il fallait encore gravir une série de marches avant de pénétrer dans la classe. Des vieux bancs de bois s’alignaient, comportant deux trous dans lesquels on insérait l’encrier (ah, cette odeur envoûtante quand on versait l’encre !). Et cette difficulté à tremper la plume et à ne pas faire de tâches sur la feuille immaculée. Ecrire une ligne prenait des heures. Par la fenêtre, on apercevait les feuilles du marronnier, cet ami de toujours.
Le fleuve ? Immense et large, après tant de kilomètres parcourus. Les pluies sur le massif entraînaient immanquablement des crues en contrebas. J’attendais mon bus près d’un pont, au retour du lycée et j’étais véritablement fasciné par la force de ces eaux, qui venaient frapper les piliers du pont. Il me semblait qu’elles auraient pu emporter la ville entière, si elles avaient voulu. Il en aurait fallu d’un rien. J’y suis repassé l’an dernier. Sous l’arcade latérale, on a construit une passerelle pour faire une promenade pour les piétons et une piste cyclable. Ce n’est pas que ce n’est pas joli (encore que… des papiers et des plastiques étaient pris au piège, entre la berge et la passerelle) mais il me semble qu’on a domestiqué mon fleuve en empiétant sur son domaine. Lui, de son côté, a laissé faire, oublieux de ses anciennes colères. Etrange.
Enfin il y avait le barrage, dans la grande forêt. Je m’y étais rendu alors qu’il était encore en construction. C’était ma première grande randonnée en vélo (je devais avoir sept ans) et j’étais fier des 12 km aller-retour que j’avais dû parcourir en tenant un équilibre encore fort précaire. Je viens d’apprendre qu’une autoroute va traverser le bois, contournant la petite ville et facilitant « le transport des personnes et des biens .» Objectivement, cette autoroute est nécessaire, il n’y a pas à dire. Mais elle va détruire ce bois merveilleux et la petite route qui menait au barrage. Une nouvelle fois, ce qui était ne sera plus si ce n’est dans nos souvenirs. Bientôt, nous ne serons plus qu’une armoire à souvenirs.

23:53 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : enfance
09/08/2008
Eternel présent
Le mécanisme qui rattache nos contemporains aux générations passées semble s’être modifié. Je ne dis pas que c’est un bien ou un mal, je le constate, tout simplement. Il n’y a pas encore si longtemps que les gens vivaient dans des villages, toutes générations confondues et qu’une sorte de savoir impalpable se transmettait de la sorte, des aînés vers les cadets. Puis petit à petit, s’est imposé le mythe d’une éternelle jeunesse, largement véhiculé par la publicité d’ailleurs, laquelle nous a proposé une série de recettes pour ne pas prendre une ride. L’homme moderne est jeune et dynamique, cela va de soi et cette théorie est encore renforcée par l’idéologie libérale ambiante : un cadre supérieur se doit de travailler sans compter pour sa firme et en dessous de soixante heures semaines, il n’a pas droit à notre considération. Dans un tel contexte, tomber malade semble malséant. Du coup, voilà tous les souffreteux relégués à l’hôpital (le nouvel endroit où l’on meurt en toute discrétion et sans importuner son voisin)et les vieillards à l’hospice (d’habitude on dit maison de repos, c’est plus positif, mais dans les faits il s’agit bel et bien d’un simple mouroir dans lequel la société vous installe de force en espérant que vous n’abuserez pas trop longtemps de la petite pension qu’elle vous a chichement accordée).
La plupart des jeunes grandissent donc de nos jours dans une sorte de présent permanent. L’histoire, d’ailleurs, ne s’enseigne plus vraiment. Il est vrai qu’avant on n’en enseignait qu’une partie, celle qui intéressait la classe politique au pouvoir, mais enfin cela créait indéniablement des liens entre les gens. Tout le monde connaissait Vercingétorix, la guerre de cent ans ou la prise de la Bastille. Aujourd’hui, les jeux vidéo ont remplacé tout cela.
Pourtant, les noms de nos rues sont encore remplis de souvenirs pour qui conserve un peu de mémoire : hommes illustres, noms de batailles, etc. Mais la jeune génération préfère l’amnésie. Il est vrai que se souvenir des horreurs du XX° siècle, cela n’a rien de réjouissant : carnage de 14-18, horreurs de la barbarie nazie, guerre d’Algérie, d’Indochine, du Vietnam, génocides, goulag, on a le choix. Dans un tel contexte mieux veut peut-être en effet oublier et devenir fataliste : rien ne changera jamais.
Pourtant le XX° siècle a eu aussi ses faits positifs : décolonisation, disparition du travail des enfants, scolarité obligatoire, sécurité sociale, salaire minimum, émancipation des femmes, progrès médicaux sans précédents. Cela aussi, du coup, on finit par l’oublier.
Certes, il ne faut pas vivre dans le passé, mais il me semble qu’un minimum de mémoire permettrait tout de même, non pas d’empêcher que de nouvelles horreurs ne se reproduisent (il ne faut pas se faire d’illusions sur la nature humaine),mais tout au moins de pressentir leur arrivée.
Mais non, la jeune génération a été conditionnée pour vivre dans un présent éternel. Supposée immortelle, elle n’est là que pour acheter les produits de consommation parfaitement inutiles que la société leur propose et qui sont supposés faire son bonheur. A la limite, elle est plus tournée vers le futur (la sortie de la Playstation III, le dernier Harry Potter) que vers le passé, prenant pour un signe d’ouverture d’esprit ce qui n’est qu’une preuve d’asservissement aux lois du marché.
Je parle de la jeune génération, mais les autres ne valent pas beaucoup mieux. Tout le monde se complaît dans une sorte d’hédonisme jouissif (ou supposé tel, car ne je vois toujours pas en quoi le fait de posséder tel ou tel objet me rend plus heureux, surtout si je n’en ai pas besoin)qui permet de ne plus penser que le temps avance et qu’une tombe nous attend au bout du chemin. Consommant frénétiquement, notre société vit dans un présent éternel, sorte d’Eden fictif et artificiel qui enrichit quelques industriels au passage. Le passé n’a plus de sens et si on en parle, c’est pour en rire (tu te souviens ? A la fin des années soixante-dix on n’avait même pas de micro-ondes ! Comment ont-ils fait dans les années quatre-vingts pour se passer de MP3 ?)
Pourtant, peut-on ramener une vie humaine à ces simples considérations de confort domestique ? Notre destinée n’aurait-elle donc aucune autre portée ? J’ignore quel sens elle a ni même s’il y a un sens à trouver, mais ce qui est sûr c’est que l’Antiquité grecque, qui avait inventé la tragédie, avait une autre conception de notre existence. Certes les dieux étaient méchants et se moquaient des hommes, mais ceux-ci tentaient malgré tout de lutter pour survivre, acquérant ainsi une dignité que nous avons manifestement perdue. Quand je vois à quel degré d’avilissement la publicité peut conduire (ces cadres supérieurs qui se roulent par terre pour manger un yoghourt, ces femmes qui ne vivent que pour engloutir un fromage !), j’en viens à regretter le temps du vieux Montaigne (même s’il a failli mourir de la peste). Au moins il y avait encore des hommes pour tenter de réfléchir sur le pourquoi de leur présence sur terre. Mais qui se souvient encore de Montaigne ? Ce n’est même pas le nom d’une marque de fromage.
00:12 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (11)
14/07/2008
Pause estivale
01:48 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (2)
26/06/2008
Solstice
Pour revenir au solstice d’été, il y a dans cet apogée quelque chose qui me dérange et ce quelque chose, c’est le fait qu’il va bien nous falloir maintenant redescendre.
Pendant les mois d’hiver, courbés sous le vent et la pluie, nous avons attendu des jours meilleurs. Quand enfin ceux-ci arrivent officiellement (selon le calendrier cosmique, pour ce qui est de la météo, c’est encore une autre affaire), le plaisir est aussitôt gâché par le fait que les jours vont commencer, inexorablement, à raccourcir. Certes l’été est devant nous (car les beaux jours sont décalés par rapport au solstice : il faut laisser à la terre le temps de se réchauffer) mais le ver est dans le fruit. Cette promesse d’été est entachée de la certitude que le compte à rebours a déjà commencé et que nous sommes aussi proches du début de l’hiver suivant que nous ne le sommes du début de l’hiver passé.
Ainsi en va-t-il dans l’existence. « Le temps d’apprendre à vivre, il est déjà trop tard » comme dit le poète. A peine sommes-nous sortis de l‘enfance que tout est déjà consumé. Après quelques années gaspillées à assurer ses arrières sur le plan matériel, quand enfin on va pouvoir se consacrer à ses rêves, on se rend compte qu’ici aussi le compte à rebours a déjà commencé et qu’il est même déjà bien entamé. Qu’y faire ? Fixer le trou noir de l’hiver qui ne manquera pas d’arriver n’y changera rien. Refuser de le voir confinerait à la bêtise. S’en accommoder serait de la lâcheté. Alors ?
Alors je n’ai pas de solution, mais je sais que dans la vie, cet hiver qui approche ne sera pas suivi d’un nouveau printemps.
Car la vie est unique. On nous demande de faire le brouillon et d’écrire au net en même temps. Les ratures ne sont pas permises et toutes les fautes nous sont comptées. Le temps d’y voir un peu plus clair dans nos idées, au moment où nous reprenons le stylo pour écrire ce que nous avons à dire, les copies sont déjà ramassées.
Et en plus, elles ne seront lues par personne.
On se demanderait bien dans quel jeu nous jouons.
Ps. :certains disent que je suis parfois un tantinet pessimiste. Il se pourrait bien, finalement, qu’ils aient raison.

00:22 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : solstice d'été
18/03/2008
Philosophons
Question philosophique sans intérêt, sans doute, mais dont la réponse n’est cependant pas facile à trouver. Qu’est-ce qui fait que je suis moi ? Bien sûr vous allez répondre par toute une série de considérations d’ordre génétique ou psychologique. Je possède tel caractère parce que dans mes gènes se trouve tel ou tel élément qui me conditionne à agir d’une manière ou d’une autre. La combinaison de ces éléments fait que je suis plus ou moins patient, plus ou moins agressif, plus ou moins tolérant. L’ascendance explique aussi que je possède ou ne possède telle force physique, telle couleur des yeux ou telle prédisposition à certaines maladies.
D’autres répondront que tout ceci est bien beau, mais que l’acquis détermine pour le moins autant le caractère d’un individu que sa carte d’identité génétique. Dans cette hypothèse, je posséderais tel caractère parce que j’ai évolué dans un certain milieu, à une certaine époque et que les expériences vécues ont conditionné à mon insu mes comportements actuels. Ainsi, une attitude de fuite correspondrait à tel traumatisme remontant à la petite enfance ou au contraire un comportement agressif correspondrait à la répétition d’une attitude bénéfique adoptée une fois dans un contexte précis.
Fort bien. Remarquons que les deux théories peuvent se combiner. Devant une même situation, deux individus, neutres au départ, réagiront différemment en fonction de leur tempérament de départ. Puis, selon que ce comportement a entraîné un échec (développant à son tour un traumatisme) ou au contraire une réussite, chacun adaptera le tir et soit répétera à l’infini le même geste dans des circonstances analogues, soit évitera de se retrouver dans cette même situation (devant laquelle il ne pourrait que rester bloqué).
Notons en passant que tout ceci est exponentiel. Un enfant craintif évitera de faire certaines expériences. Devenu adulte, il sera devenu d’autant plus craintif qu’il n’aura jamais eu l’occasion de se prouver à lui-même qu’il pouvait dépasser sa peur et résoudre en fait le problème. Inversement, celui qui était déjà de nature téméraire multipliera les expériences lesquelles, à leur tour, vont lui permettre de renforcer cette confiance qu’il a en ses propres capacités.
Tout ceci explique donc pourquoi je suis comme ceci plutôt que comme cela. Mais ce n’est pas de cela que je voulais parler quand je disais « pourquoi suis-je moi ? »
Si j’observe un animal (un chien par exemple), je trouve normal, puisqu’il a un cœur, des membres, un cerveau, qu’il vive et se déplace. Autrement dit, dans la peu de ce chien, il y a « quelqu’un ». Si je prends trois chiens en bonne santé, il n’y a rien de plus normal que de les voir sauter et courir, comme il est tout aussi normal que chacun ait son caractère et son tempérament. Donc, à l’intérieur de ces trois chiens, il y a trois êtres distincts. Mais qu’est-ce qui fait qu’à l’intérieur du premier chien (supposons qu’il soit blanc, pour la clarté de l’exposé) il y ait une « âme » (les croyants me pardonneront, mais je ne trouve pas d’autre manière de m’exprimer) qui soit propre à ce chien-là et qui n’est pas celle du deuxième ou du troisième chien ?
Ne revenez pas avec des explications de l’ordre de l’inné ou de l’acquis, elles ne font que dire pourquoi le chien blanc est plus gentil ou moins peureux, elles ne disent pas pourquoi c’est cette « âme-là » qui se trouve dans la peau du chien blanc et pas dans celle du chien noir.
Donc, pour m’exprimer autrement, s’il est normal qu’un être animé ait sa personnalité propre, cela ne nous dit pas comment ce chien, en son fort intérieur, peut dire « je ». Qu’est-ce qui fait que dans la peau de ce chien blanc il y ait un être qui a conscience d’exister et qui n’est pas le même que celui qui est dans la peau du chien noir ? Etant entendu que tout ce qui vient d’être dit des chiens peut s’appliquer aux humains. Je comprends que mon voisin est différent de moi, je comprends éventuellement pourquoi il a tel ou tel trait de caractère qui lui est propre, je comprends que dans son corps se trouve un être doué de raison qui dit « je », mais je n’arrive pas à expliquer pourquoi c’est lui (spécifiquement lui) qui est dans ce corps-là et pas moi par exemple. Si je trouve normal qu’un corps soit habité par un individu qui a conscience de lui-même, si je trouve normal qu’il en soit ainsi pour tous les corps (y compris ceux des animaux), je n’arrive pas encore à dire ce qui a fait que je suis moi, dans le corps que j’occupe et pourquoi je parviens à dire « je » au moment où j’écris ces lignes. En effet, mon propre corps aurait pu être « occupé » par une autre conscience, qui aurait dit « je » à son tour et dont la présence dans ce corps n’aurait choqué personne.
Les croyants auront beau jeu de me resservir leur théorie sur l’âme et sur la création transcendante. Dieu aurait créé de toute pièce ce « je » que je suis en train de tenter de définir et l’aurait placé dans un corps (peu importe lequel, en fait) ou bien, selon d’autres théories, plus orientales, cette même âme immortelle ne ferait que passer d’un corps à un autre.
A partir du moment où on réfute la religion (belle croyance qui permet de vaincre la peur de la mort en s’accordant à bon compte l’immortalité), il nous faut cependant tenter de comprendre d’où vient ce « je ». Avoir la foi consiste souvent à croire sans comprendre, en déplaçant le problème. En effet, pas plus que moi le croyant ne peut expliquer l’origine du monde, mais il pallie à cette incompréhension en disant que c’est Dieu qui a créé le monde, oubliant au passage de nous expliquer qui est Dieu. De son point de vue à lui, il est vrai qu’il n’a pas à le faire, car c’est un postulat de sa foi : Dieu existe, point final. Il en va de même avec la théorie de l’âme. Ce « je » que je tente en vain de définir, le croyant lui donne un nom : c’est mon âme, dont l’existence est voulue par Dieu. Content avec cette explication qui ramène tout à la dimension humaine (et qui est, avouons-le, d’un anthropocentrisme étroit, l’univers s’étendant bien au-delà de la simple espèce humaine, apparue il y a peu et manifestement appelée à disparaître dans pas bien longtemps), le croyant est rassuré : Dieu a voulu son existence et l’aime, comme ses parents avaient voulu aussi son existence et en principe l’avaient aimé. On touche du doigt ici le côté puéril et rassurant de la foi, qui permet à l’individu de justifier son existence sur terre. Il « est » parce que d’autres l’ont voulu et il n’a pas à se demander pourquoi. Dès lors il peut se laisser vivre, se sentant en harmonie avec le monde (son moi intérieur, ce microcosme, rejoignant le grand tout, le macrocosme).
Pour nous, il n’en va pas de même et il nous faut bien tenter de comprendre pourquoi nous sommes là, qui nous sommes et ce que nous pourrions bien faire en ce lieu.
En attendant, rien ne nous dit comment ce « moi » qui m’habite a pu surgir du néant. C’est tout de même un miracle absolu que ce « moi » ait pu exister (et votre « moi » pour vous qui me lisez, car je ne veux pas ici me replier dans une démarche nombriliste, mais au contraire réfléchir pour tout un chacun d’un point de vue ontique). C’est bien pour cela que nous y tenons beaucoup. Nous le sentons fragile, nous le savons éphémère et nous savons qu’il sera appelé à disparaître. C’est là qu’est l’horreur. Je citais l’autre jour Montaigne qui disait qu’il n’avait pas peur de la mort mais bien de mourir. Sans doute. Il n’empêche que ce néant de l’être, cette dissolution du « je », cet évanouissement d’une conscience a de quoi inquiéter. Comment peut-on ne plus être ? Comment accepter cette absence de soi-même ? Pour un peu, on réinventerait Dieu pour lui demander des comptes.
12:40 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : conscience du moi, vie, religion
12/03/2008
Le temps qui passe
Vous l’aurez remarqué, j’ai eu peu de temps, ces jours-ci, pour venir déposer des articles sur ce blogue. Ce qui m’amène à une question hautement philosophique sur le temps qui s’écoule. De combien d’heures disposons-nous vraiment pour nous-mêmes dans une journée ? Si on retire les heures de sommeil, les déplacements vers le lieu de travail, le travail lui-même, les tâches domestiques, les occupations familiales et autres, la part qui nous est impartie pour nos loisirs est finalement assez restreinte. Cela ne veut pas dire que mon travail m’ennuie, mais c’est d’abord le travail, autrement dit une activité dont le but premier est avant tout alimentaire. Ensuite, bien entendu, on essaie de se réaliser au mieux dans son emploi, mais entre celui-ci et moi-même, il y a tout de même un hiatus. Pour le dire autrement, je ne suis pas (par essence) ce travail. Je suis autre chose que ce que je fais là. Heureusement, me direz-vous. Remarquez, cependant, qu’il existe des personnes qui ne vivent que pour leur travail ou pire, pour la société qui les emploie. Ils « sont » le groupe Fortis, ou IBM ou la chaîne Carrefour. De telles réactions m’ont toujours semblé louches. Est-ce moi qui ne parviens pas à m’identifier à certaines valeurs ou bien est-ce eux qui manquent de vie intérieure au point de devoir s’occuper l’esprit en permanence avec leur travail ? Je pencherais plutôt pour la deuxième solution..
Mais revenons au temps qui passe. On parle toujours de la civilisation des loisirs, mais personnellement j’ai toujours l’impression de manquer de temps. Je veux parler de ces heures que je pourrais consacrer à ce qui m’intéresse vraiment et qui font qu’en fin de journée j’aurais l’impression d’avoir vécu pour quelque chose. Notez que dans les loisirs eux-mêmes nous sommes souvent occupés à tenir un rôle car comme époux, père, voisin ou citoyen nous sommes souvent amenés à faire des choses qui nous plaisent certes et qui ne sont pas désagréables, mais qui ne correspondent pas encore à ce qu’il y a vraiment au fond de nous.
C’est pour cela, sans doute, que j’aime particulièrement la nuit. Quand tout est calme dans la maison et dans la ville, il est plus facile de se retrouver enfin avec soi-même. Ceci dit, il se pourrait bien que ce que je fais alors ne soit pas existentiellement fondamental. Est-ce plus important de lire tel livre ou d’écrire quelques lignes ici que de préparer le repas ou tondre la pelouse ? Il me semble qu’oui. Pourtant, si notre vie se résumait à cette activité liée à notre monde intérieur, on la trouverait bien vide aussi. Imaginons que devenu rentier (il faudrait pour cela se décider à jouer au loto) je n’aie plus rien d’autre à faire que de lire à longueurs de journées. Il est fort probable qu’après avoir ingurgité quelques centaines d’ouvrages ma vie m’apparaîtrait bien vide. Où donc se trouve ce qui la rend importante ? Enfin, je veux dire importante à mes propres yeux, car dans l’absolu, aucune vie n’est importante, bien entendu, Dieu étant mort depuis longtemps et les astres qui nous entourent semblant des masses inertes dépourvues de sens en elles-mêmes.
Donc, sans me placer face au néant pascalien, je suis tout de même en droit de me demander ce qu’il serait légitime d’accomplir afin que cette vie, déjà si courte (au mieux quatre-vingts ans) et ces journées plus courtes encore (voir plus haut) prennent un semblant se sens. Car ce qui me semble intéressant pour moi (et ce pour quoi je n’ai pas beaucoup de temps comme je l’ai déjà dit) n’est peut-être pas intéressant en soi (d’un point de vue existentiel). Pour m’exprimer autrement, il se pourrait bien que l’individu n’ait tendance à accomplir que ce qui l’intéresse. Si ses passions sont mesquines, il aura tout perdu. C’est le cas de l’alcoolique, par exemple, qui à ses propres yeux vit pleinement sa passion, mais qui à nous nous semble perdre son temps. Il en va de même des gens assoiffés de gloire et de pouvoir. Pour eux, rien n’est plus important que de devenir directeur de ceci ou président de cela. Pourtant, les efforts mis en œuvre pour parvenir à un but aussi futile sembleront étranges à un artiste qui, lui, vit pour autre chose. Tout cela pour dire que nous restons foncièrement prisonniers de notre caractère et de nos humeurs. C’est au point qu’on se demanderait bien comment on parvient encore à avoir un semblant de dialogue avec nos contemporains, chaque être humain semblant enfermé dans une prison mentale qui lui est propre.

19:13 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : fuite du temps, sens de la vie
07/02/2008
De la mort des étoiles
Certaines étoiles sont si éloignées, nous dit-on, que leur lumière nous parvient seulement aujourd’hui alors qu’elles ont disparu depuis une éternité déjà. Ce phénomène (au sens de phainomai, « apparaître ) fait dire à certains que l’homme est sans doute immortel. Semblable à l’étoile morte, son aura (son âme si on préfère), continuerait d’exister malgré la disparition du corps.
C’est une belle image, mais aussi un beau sophisme, car l’étoile dont je vois la lumière est irrémédiablement morte, disparue à jamais. Certes, elle conserve une certaine existence symbolique puisqu’elle continue de m’éclairer, mais cette illusion n’est que provisoire. Bientôt cette lumière elle-même s’évanouira à son tour et il ne restera que le néant et le vide de l’espace.
Ainsi en va-t-il de l’homme. Certains, parmi les plus chanceux, parviendront pendant un certain temps à maintenir vivace leur souvenir auprès des générations suivantes, puis, petit à petit et inexorablement, cette lumière s’effacera à son tour.
Si on pousse la logique jusqu’au bout, on pourrait même imaginer que l’ensemble des étoiles dont nous voyons les lumières sont déjà mortes. Le ciel nocturne serait alors une illusion absolue, le mirage d’une réalité à jamais révolue. C’est quand on réfléchit de la sorte qu’on se rend compte que le vide pascalien prend tout son sens.

12:25 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (30) | Tags : mort des étoiles
03/02/2008
Réflexion
Les psychologues disent que ceux qui ont peur de la mort ont en réalité peur de la vie. N’osant rien entreprendre, par timidité ou par crainte de l’échec, ils se contentent de ruminer sur leur fin dernière, trouvant dans ce néant inéluctable un prétexte de plus pour ne pas agir.
Si on en croit cette théorie, l’homme « normal » doit s’abandonner pleinement à la vie et agir sans trop réfléchir. Sans doute. Mais n’est-ce pas pourtant cette réflexion sur sa propre fin qui le différencie de l’animal ? Et à quoi bon agir si on ne se demande pas où on va ?
Comme je n’ai jamais encore trouvé la réponse à cette question et comme il m’arrive souvent de me réveiller avec une conscience particulièrement aigue et presque physique de cette fin ultime, il faut donc croire que je ne suis pas normal.
00:55 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : l'absurde, la mort
23/12/2007
Solstice d'hiver

En cette période de Noël, plutôt que de nous attendrir sur la symbolique de la crèche, je proposerai une réflexion sur nos origines païennes. A côté de Lascaux ou de la grotte de Gargas, si chère à Dominique Autié, il est des lieux préhistoriques qui nous interpellent car ils nous font réfléchir à la vie des hommes qui nous ont précédés. Le site de Stonehenge est incontestablement un de ces lieux privilégiés. Il représente une trace de notre passé, emprunte de mystère, et nous fait souvenir qu’avant nous des êtres ont eux aussi réfléchi au sens de leur présence sur cette terre.
Ce site était bien connu des druides celtiques, qui y pratiquaient des cérémonies, notamment aux périodes d’équinoxes et de solstices. Pourtant, on sait que les Celtes n’ont pas été les bâtisseurs de ce grand cercle de pierre, dont certains prétendent qu’il a été construit les Mycéniens.
Quant à savoir à quoi servait cette construction, tout le mystère demeure. Etait-ce un temple, un monument funéraire ou un observatoire? Ce qui est sûr, c’est que ces mégalithes mettent en valeur des phénomènes astronomiques. On parvient à y calculer le cycle des éclipses lunaires. D’un point de vue astronomique, les calculs et les résultats obtenus sont incontestables. Pourtant, les archéologues font remarquer que la construction s’est faite en trois ou quatre étapes, ce qui semble ruiner l’idée d’un but fonctionnel précis. Nos cathédrales, cependant, ont bien été construites sur plusieurs siècles, sans que la foi première qui a présidé à leur érection ait été modifiée. Combien d’églises n’ont pas une partie romane et une partie gothique ? Les techniques avaient évolué, mais la démarche religieuse était toujours la même. Alors il se pourrait bien qu’il en eût été de même à Stonehenge et que la démarche spirituelle des peuples primitifs qui bâtirent ce site fût restée la même. Mais comment des peuples primitifs, précisément, purent-ils avoir de telles connaissances en astronomie ? Cela semble improbable, ce qui renforce encore le mystère de ces mégalithes. D’un autre côté, quand on suit Lévi-Strauss dans son analyse structurale des mythes amérindiens, on se rend compte que ces mythes reposent souvent sur une base astronomique (position de la lune, constellations, etc.). C’est ainsi, par exemple qu’un même conte peut s’inverser selon qu’on se trouve dans l’hémisphère Nord ou dans l’hémisphère Sud. Il semble donc bien que ces peuples, habitués à vivre dehors et à se guider avec les étoiles avaient une meilleure connaissance des astres que nous.
En tout cas, pour ce qui est de Stonehenge, beaucoup de scientifiques s’accordent pour dire que la précision des emplacements des mégalithes est trop grande pour être le fruit du hasard. Ainsi, au solstice d'été, les premiers rayons de soleil traversent le cercle et viennent frapper la pierre centrale. Au solstice d'hiver (soit pour cette année le 22 décembre 2007 à 7H 07), les rayons passent entre les blocs de trois pierres placés aux extrémités. Cette précision a de quoi confondre et nous oblige à nous demander ce que furent et ce que pensèrent ces être qui nous ont précédés et dont nous descendons, incontestablement. S’ils ont inventé la science astronomique et la religion, on peut supposer aussi qu’ils inventèrent la littérature, même si elle était orale. Quels contes se racontèrent-ils, dans la nuit des temps, pour justifier leur existence sur cette terre ? Comment se persuadèrent-ils qu’ils étaient différents des animaux, nos frères ? Comment inventèrent-ils la culture en dressant vers le ciel ces énormes blocs de pierre ? Le mystère reste entier, ce qui rend leur existence encore plus fascinante à nos yeux.


02:25 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : stonehenge
16/12/2007
Le temps des fêtes
Le temps s’écoule inexorablement. La religion, cet opium du peuple, en nous proposant à date fixe de commémorer la naissance d’un Dieu, semble avoir intégré l’ancien mythe antique de l’éternel retour. Chaque année, en effet, on nous demande de nous réjouir devant cette nouvelle naissance, symbole d’éternité, finalement, puisque l’enfant Dieu, tel le Phénix, n’en finit pas de renaître de ses cendres. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’Eglise a choisi la date du 25 décembre, soit le solstice d’hiver, pour célébrer cet événement. De tout temps la victoire de la lumière sur la nuit a marqué les consciences. Il était donc facile d’intégrer les mythes anciens et d’en proposer une nouvelle version. Les populations, déjà habituées à fêter cet événement, n’y ont rien trouvé à redire. Au-delà de la foi proprement dite, de petits subterfuges de cette sorte ont largement contribué à asseoir l’autorité encore balbutiante de l’Eglise.
De nos jours, le monde de l’argent et du commerce qui est devenu le nôtre a, à son tour, exploité la vieille croyance chrétienne. En nous proposant d’acheter des cadeaux et de fêter dignement l’événement, les managers commerciaux espèrent bien remplir leur tiroir caisse. Pour cela, ils exploitent donc les dernières images naïves qui remontent à notre enfance et qui conservent encore, dans notre esprit blasé, une certaine valeur.
Achetez et dépensez. Mangez et buvez. Fêtez ce mythe d’une naissance sans cesse renouvelée qui vous fait oublier un instant que vous vieillissez inexorablement et que le temps qui vous est imparti n’est qu’un segment de droite, lequel possède bien un terme. Peu importe, en oubliant un instant la réalité vous aurez au moins contribué à faire tourner l’économie, ce nouveau Dieu particulièrement injuste qui ne favorise que quelques privilégiés. C’est déjà cela, non ?

12:36 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fêtes de fin d'année
27/11/2007
Jean VAN EYCK

Le blogue de Pivoine nous donne une leçon de peinture et nous propose d’admirer "La Vierge au chancelier Rolin" de VAN EYCK.
C’est vrai qu’il est remarquable, ce tableau. On en admirera particulièrement l’équilibre. Ainsi, dans le fond, nous avons trois croisées. Derrière chaque croisée, un paysage particulier (une campagne où prédomine le vert, le fleuve, une campagne où prédomine le jaune). La première colline se situe à gauche du fleuve, l’autre à sa droite. Le fait d’avoir deux tons pour ces collines rompt la monotonie. Le fleuve est l’élément central (il correspond d ‘ailleurs à la croisée centrale) et permet une perspective vers le lointain. Donc, dans l’imagination du spectateur, il est une invitation non seulement à dépasser la chambre, mais aussi le paysage proche, afin de rêver d’un ailleurs. Le bateau symbolise ce voyage de l’imaginaire. On remarquera la présence d’un pont, qui nous rappelle qu’à nos pieds se trouve une ville (nouvel équilibre, donc, cette fois entre la nature et la culture). Le pont marque aussi le passage d’une rive à l’autre et permet donc de relier les deux collines. Par son horizontalité, il rompt aussi la monotonie du paysage qui est surtout représenté dans sa verticalité. Celle-ci est atténuée par les méandres du fleuve (lesquelles, en elles-mêmes, sont aussi une invitation à la flânerie, ce qui contribue à donner à l’ensemble de la peinture une impression de calme et d’apaisement).
Les collines, du moins celle de gauche, sont cultivées, ce qui permet une transition douce entre le milieu urbain et les montagnes sauvages de l’horizon. La ville proprement dite (du moins des masses architecturales importantes, genre cathédrales, etc.) se trouve surtout à droite, peinte en jaune, comme la colline (plus sauvage) qui est derrière elle, tandis que pour la campagne cultivée (et donc moins sauvage) du côté gauche, c’est le vert qui prédomine. Nous avons donc une sorte de « chiasme» qui contribue à rompre la monotonie.
Revenons à la chambre où se déroule la scène. Aux trois croisées du fond (et à leurs trois paysages), correspondent trois autres croisées à gauche, perpendiculaires aux précédentes, ainsi qu’un mur à droite (lui aussi perpendiculaire). L’équilibre est donc parfait, géométrique. Pour mettre la pièce en valeur et ne pas donner une impression d’enfermement, un vitrail à gauche (discret, il est blanc et non en couleur; de plus il ne permet pas de voir le paysage qui est derrière lui; on est donc obligé de se concentrer sur la scène centrale) ouvre une perspective dans le prolongement des croisées du fond. Notre pièce centrale, non seulement s’en trouve agrandie, mais on comprend qu’elle fait partie d’un ensemble géométrique dont elle n’est qu’un élément. Comme l’homme, finalement, ce microcosme, qui n’est qu’une partie du macrocosme.
Donc, importance du chiffre trois : 3 croisées, 3 éléments de paysage (colline, fleuve, colline), 3 éléments de profondeur (la pièce, le paysage proche, les montagnes du lointain), 3 « murs » (croisées de gauche, croisées centrales, mur de droite) 3 personnages (le chancelier, la Vierge, l’enfant).
Parlons de ces personnages. Ils s’opposent par les couleurs. Celles-ci sont sombres pour le chancelier (habit et draperie qui recouvre le lutrin), vives pour la Vierge (rouge). Au centre, l’enfant Jésus est mis en évidence par sa blancheur. Remarquons que le carrelage reprend en les mélangeant les tons des habits. On y retrouve en effet à la fois les motifs bigarrés de l’habit du chancelier (en brun) ainsi que des traces de rouge (comme le vêtement de la Vierge), ce qui contribue à les rapprocher et renforce l’impression d’intimité de la scène. Ce carrelage offre aussi une perspective vers le paysage extérieur, dont il préfigure la fuite vers le lointain. Ainsi, l’esprit du spectateur lie les personnages, disposés de part et d’autre du carrelage qui est visible au centre et celui-ci invite le regard à s’échapper vers l’extérieur. Le « choc » mystique que l’on ressent en regardant les personnages enfermés dans la chambre prend de l’ampleur par l’incitation à trouver un ailleurs (vers le paysage extérieur et, via le fleuve, vers le lointain).
Notons que s’il y a trois personnages et trois croisées, il y a deux piliers et deux adultes. A chaque adulte correspond une croisée. A l’enfant, cependant, ne correspond pas la croisée centrale, ce qui aurait été ridicule pour le sens (l’enfant doit être près de sa mère) mais aussi pour la perspective (trop d’équilibre nuit). Par contre, si l’enfant n’occupe pas la croisée centrale, il est remplacé par deux petits personnages qui viennent mettre un peu de vie dans ce tableau fort religieux. Ils servent donc de transition à la fois symbolique (sacré/profane) et géographique (intérieur/extérieur ; proche/lointain).
Pour terminer, concentrons-nous sur le personnage de la Vierge. Elle n’est pas habillée de bleu, comme c’est habituellement le cas (le bleu symbolisant la virginité), mais de rouge. Par contre un ange se tient derrière elle, au-dessus à gauche. Lui, est habillé de bleu (mais un reflet rouge sur les ailes rappelle le vêtement de la Vierge, ce qui assure un rapprochement entre elle et lui : tous deux sont d’essence sacrée).
Cet ange est en fait le quatrième personnage de la scène. On pourrait dire qu’il est en surnombre et qu’il vient rompre le bel équilibre fondé sur la trinité. Il n’en est rien. En effet, il représente un contrepoids à l’enfant Jésus et renforce en fait l’impression d’équilibre. L’enfant est plus bas que le visage de la Vierge, l’ange est plus haut. Chez l’enfant, les couleurs claires prédominent, chez l’ange ce sont les couleurs foncées. N’étant pas humain, il n’appartient pas au trio présent. Par contre, étant d’essence divine, il préfigure la divinité de l’enfant, dont il est en quelque sorte la marque tangible dans le tableau. Notons encore qu’une autre trinité est créée par l’alignement des visages : enfant, Vierge et ange. Alors que sur un plan horizontal on assiste à une scène normale (homme, femme, enfant), sur le plan vertical (ou plutôt oblique), on a une scène mystique (enfant-Dieu, Vierge, ange).
L’ange ne couronne pas l’enfant mais la Vierge. L’esprit divin passe donc de l’ange vers la mère et enfin de celle-ci vers l’enfant.
Si on découpe maintenant le tableau en tranches horizontales, on remarquera trois personnages à l’avant-plan, puis trois croisées (avec trois paysages correspondant) et enfin, au niveau supérieur, deux vitraux colorés et carrés. Les personnages étant plus écartés que les croisées, on a donc une sorte de pyramide : à la base, les trois personnages, au milieu les croisées (déjà plus étroites) et au sommet les deux vitraux (fort rapprochés). Nouvel équilibre, donc, mais sur un autre plan, dans ce tableau qui décidément n’en manque pas. Rien d’étonnant donc, à ce qu’il nous inspire des impressions très fortes.
10:45 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : VAN EYCK, Vierge au chancelier Rolin
08/08/2007
Surimpression

Ainsi donc on a découvert un nouveau Van Gogh. La peinture se trouvait sous l’oeuvre « Ravijn » (qui appartient à la collection du musée de Boston), laquelle, passée aux rayons X, a laissé apparaître un autre thème, proche du tableau. Cela tombe bien car au même moment on apprend que la pièce maîtresse du musée de Melbourne, « Tête d’homme » ne serait pas de Van Gogh.

Tout cela laisse rêveur, surtout quand on connaît le prix des toiles du peintre hollandais. Nous nous retrouvons donc avec deux vrais Van Gogh sur une même toile et un faux. Mais ce faux n’en est pas vraiment un nous explique-ton. C’est une vraie peinture, peinte par un inconnu, sans intention d’en faire un faux Van Gogh. C’est donc un vrai, mais attribué par erreur à Van Gogh.
Tout ceci mérite quelques réflexions. D’abord on se demanderait bien si les experts ne jouent pas à créer les vrais et les faux. Sans doute sont-ils sincères et objectifs, mais il est certain que leur avis permet de multiplier le prix d’une toile par mille ou au contraire de le réduire à néant. Ceci dit, on regrettera que l’argent, une fois de plus, soit devenu la seule manière pour certains d’apprécier la valeur d’une toile. L’émotion esthétique semble en effet souvent passer au second plan. Quel est l’intérêt d’acheter une peinture pour l’enfermer dans un coffre à la banque ? Ne devrait-il pas exister une loi qui obligerait ces propriétaires à prêter leurs collections aux grands musées afin que le public puisse les admirer ? Il est vrai que ces mêmes musées disposent souvent d’un droit de préemption lors des ventes, mais les prix atteints ne leur permettent généralement pas de se porter acquéreurs. Il me semble pourtant que les tableaux des grands maîtres appartiennent quelque part au patrimoine de l’humanité et qu’ils devraient pouvoir être vus pas tous. Imagine-t-on le Colisée appartenir à un particulier ? Il est vrai qu’en son temps Berlusconi avait penser le vendre…
Mais ce qui me fascine surtout, dans l’histoire des deux Van Gogh sur une même toile, c’est cette notion de palimpseste. Le mot vient du latin palimpsestus, d’après l’adjectif grec palimsestoz, servant à désigner un parchemin que l’on gratte pour écrire de nouveau (palin ). Technique normale dans l’Antiquité, le mot est attesté chez Cicéron. Au XIX° siècle, il est repris par la paléographie avec le sens actuel. De leur côté, Baudelaire et Hugo définiront l’oubli comme un palimpseste.
Car le palimpseste ne caractérise pas uniquement la peinture. Toute œuvre littéraire, si on y réfléchit, est toujours un palimpseste puisqu’elle se nourrit des oeuvres antérieures déjà écrites. Chaque écrivain est avant tout un grand lecteur et nul ne peut prétendre être original au point de ne pas s’inspirer de ce qu’il a lu.
Notre vie elle-même n’est qu’une éternelle superposition d’impressions, chacune remplaçant la précédente sans l’effacer tout à fait. Ainsi on peut supposer que notre comportement actuel est déterminé par ce que nous avons vécu antérieurement (par exemple dans notre enfance, mais pas uniquement) et cela sans que nous en ayons vraiment conscience. Certains spécialistes parlent même de psychanalyse « transgénérationnelle ». Ainsi, tel problème rencontré aujourd’hui par un individu pourrait provenir de son éducation, ses parents ayant de leur côté intériorisé les conflits et les problèmes de leurs propres parents. Il faudrait donc remonter quatre-vingts ans en arrière et rechercher dans le comportement d’un grand-père depuis longtemps disparu et dans le non-dit qui a entouré ce comportement, l’origine du mal-être d’un enfant aujourd’hui par exemple. Tout ceci doit nous rendre très modestes. Nous qui avons souvent l’impression d’agir en fonction de nos convictions et après mûre réflexion, nous nous rendons compte que nous ne sommes que le fruit d’un déterminisme qui nous échappe. La question n’est pas neuve et elle a déjà fait couler beaucoup d’encre dans le domaine de la religion. Souvenons-nous de Luther et de Calvin. Face à l’Eglise romaine et à ses indulgences que l’on pouvait acheter (ce qui faisait que seuls les riches allaient au paradis), Luther avait permis à l’individu de lire la Bible et de réfléchir par lui-même (en se passant des prêtres) sur la meilleure manière de régler sa vie en fonction du livre saint. Chacun devenait donc responsable de sa vie et de son salut. Mais voilà Calvin qui vient annoncer que tout est prédestiné et que malgré tous ses efforts celui qui doit être damné le sera par volonté divine (et inversement). On n’échappe pas à son destin, en quelque sorte. Ce qui nous ramène aux Grecs et à leur conception de la divinité : les Dieux se jouent des hommes et Œdipe, malgré tous ses efforts, tuera son père et épousera sa mère.
D’ailleurs qui sommes-nous, finalement. Au moment où j’écris ces lignes il me semble le savoir clairement. Et pourtant je ne suis plus celui que j’étais il y a vingt ans (simplement parce que n’ayant plus le même âge mes préoccupations sont devenues autres) sans pourtant que je me sois rendu compte de la transformation. De plus, entre-temps l’époque a changé et les mentalités aussi. Du coup, tout en ayant l’impression d’être resté moi-même, il s’est opéré une double transformation, une double distorsion, un peu comparable à cet espace-temps courbe défini par Einstein. Tout est relatif. Je crois être moi-même mais je ne suis que le fruit de mon époque. Aurais-je vécu au Moyen-Age que j’aurais pensé des choses différentes. Et en grattant au fond de ma mémoire je retrouve des événements qui ont fait ce que je suis devenu. L’Histoire, notre histoire, n’est qu’un immense palimpseste, finalement.
Van Gogh le savait, lui qui peignait frénétiquement toutes ses impressions.
11:42 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Van Gogh, palimpseste
10/07/2007
Paysage (5)

Que connaissons-nous des campagnes d’autrefois ? Rien, sans doute. Les villes elles-mêmes, il n’est pas facile de se les représenter. Comment était Paris au Moyen-Age ou Toulouse ou Bordeaux ? Nous ne le savons pas vraiment et seule notre imagination permet de suppléer à cette carence. Il existe des documents, pourtant, qui représentent ces villes, des plans, des cartes, que sais-je encore. Il y a aussi les vestiges monumentaux qui nous viennent de ces époques lointaines et que nous avons conservés tant bien que mal : les châteaux-forts, les murailles de Carcassonne, mais aussi les rues sinueuses du vieux Rouen ou celles plus modestes de certains villages (Saint –Cirq Lapopie, dans le Quercy, Castelnou, dans les Pyrénées, etc.).

On parvient donc à se représenter tant bien que mal à quoi devaient ressembler ces villes et villages médiévaux. Je ne parle évidemment que de la configuration des lieux pas de l’ambiance qui devait y régner, car là c’est bien plus difficile.
Et les campagnes ? Les champs qui entourent le village, la forêt qui longe les champs, les chemins de terre qui relient un lieu à un autre ? Tout cela était-il désert, comme aujourd’hui ou au contraire était-ce peuplé par toute une population de paysans occupés à travailler ou de voyageurs en train de se déplacer ? Ici, point de vestiges, peu de croquis, pas de traces du temps passé. Des millions et des millions de personnes ont ainsi vécu du travail de la terre et nous n’en avons conservé pour ainsi dire aucun témoignage.
Notre conception contemporaine est faussée. Si je me promène aujourd’hui dans les Causses ou dans les paysages de la Haute-Loire, j’apprécierai, moi le citadin, le calme reposant de ces lieux. Mais la désertification ambiante, l’abandon de ces hautes terres par leurs habitants, ne doivent pas me faire oublier qu’il n’y a pas si longtemps, ces contrées étaient encore bien peuplées. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder la liste des noms inscrits sur les monuments aux morts. Tel village qui ne compte plus aujourd’hui qu’une centaine d’habitants avait pourtant « donné à la France » une bonne cinquantaine de ses fils. Cela veut bien dire que les habitants ont tous quitté leurs activités agricoles pour s’en aller vers les villes, où ils sont devenus « flics ou fonctionnaires » comme disait Ferrat dans sa chanson. Cela veut dire aussi qu’autrefois les champs étaient peuplés de ces travailleurs manuels, occupés à faucher le foin ou à mettre en gerbes la récolte de blé. Tout cela m’a encore été confirmé par mes parents. Il était impossible de sortir du village sans croiser des dizaines de villageois s’en allant ou revenant de leurs champs, tandis que si le regard se portait à l’horizon, il rencontrait une campagne animée et peuplée par tous ces paysans occupés à leurs tâches. On s’interpellait d’un lopin de terre à un autre, on prenait des nouvelles de la maladie d’un voisin, on voulait savoir si la petite Marie avait déjà accouché et si c’était un garçon. Bref, toute une vie sociale se déroulait à l’extérieur, là où aujourd’hui vous n’avez plus que le passage rapide et bruyant d’un unique tracteur.

Je ne dis pas que c’est mieux ou plus mal, je dis que c’est différent.. Et j’ajoute qu’il nous est difficile d’imaginer ce qu’étaient nos campagnes il n’y a pas encore si longtemps. Et pourtant… Et pourtant c’est une activité millénaire qui est venue mourir ainsi dans le courant de la deuxième moitié du vingtième siècle. Un fromage comme le cantal, la fourme d’Ambert ou le Saint Nectaire, que l’on fabrique encore de manière artisanale (mais de moins en moins) dans les fermes du massif central, ce fromage, dis-je, remonte au moins à nos ancêtres gaulois. C’est toute une tradition et un savoir-faire millénaire qui est ainsi arrivé jusqu’à nous, pour être remplacés par des laiteries industrielles aux produits insipides.
Mon but ici n’est pas d’être nostalgique, mais de faire comprendre que nous avons assisté, bien malgré nous, à la fin d’un monde et au remplacement de celui-ci par un autre. Il faudrait tout de même se souvenir que ces activités traditionnelles étaient finalement celles des agriculteurs-éleveurs du néolithique et qu’il n’y avait peut-être pas une différence aussi fondamentale qu’on pourrait le croire entre un paysan de 1930 et son ancêtre qui vivait en moins 3000 avant JC. Ou que cette différence était moindre qu’entre ce même paysan et un Parisien vivant dans son HLM et fréquentant assidûment les Mac Donald.
Alors, parfois, je me plais à imaginer cette vie d’autrefois. Sur les sentiers de terre des campagnes, il me semble voir les clercs du Moyen-Age se rendant d’une abbaye à l’autre afin d’aller étudier. Quand parfois une ombre se dessine à l’horizon, il me plait de penser que c’est peut-être Zénon, le héros de L’Oeuvre au noir de Yourcenar que je vais croiser. A l’approche du village, je finis par sentir l’odeur du pain que l’on vient de cuire dans le four banal et devant la vieille forge en ruine il me semble entendre le bruit des marteaux qui battent encore le fer.
Qu’êtes-vous devenus, frères humains qui avez été ? En quel lieu êtes-vous partis, avec tout votre savoir-faire et votre simple sagesse faite de bon sens ?

15:38 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (0)
29/06/2007
Ville à la campagne

De plus en plus de personnes vivent en ville, nous assure-t-on dans la presse. C’est une vérité incontournable, en effet, que ce soit dans notre vieille Europe ou dans des pays émergeants comme le Mexique ou la Chine. Répercutée dans la blogosphère, la nouvelle a débouché sur l’idée que de tels propos ne voulaient pas dire grand chose, la différence entre la ville et la campagne semblant être devenue particulièrement ténue de nos jours. C’est vrai, évidemment. Et pourtant…
Et pourtant il me semble qu’il n’y a pas si longtemps on pouvait encore faire une distinction bien nette entre ces deux mondes. Il y avait d’un côté la ville (avec ses cinémas, ses théâtres, son mode de vie nocturne) et de l’autre la campagne profonde, celle des paysans (avec ses coutumes, sa parcimonie, sa prudence, son bon sens, sa rudesse, etc.). Entre ces deux mondes, régnait une incompréhension totale, doublée d’une grande indifférence. De plus, là où le citadin en vacances regardait avec une condescendance amusée, voisine du mépris, le paysan en train de gratter la terre, ce dernier lui rendait la pareille (non sans une certaine envie devant celui qui avait accès au raffinement, à la culture et aux distractions), considérant avec réserve cet habitant de la ville en tout point semblable à la cigale de la fable.
Donc, quoi qu’en disent certains, il y avait bien deux modes de vie distincts. En ville, par exemple, on pouvait sortir en semaine, aller voir un film et repasser dans un café boire un verre ou déguster une pâtisserie. Une telle attitude aurait été inconcevable à la campagne, où il fallait attendre la fête au village pour manger un morceau de tarte, une ou deux fois par an (tarte par ailleurs cuite à la maison). D’un côté on avait donc l’insouciance et les loisirs, de l’autre la nécessité de travailler une terre au demeurant souvent ingrate. En ville l’argent venait naturellement et régulièrement d’une activité de salarié, à la campagne on n’était jamais sûr de rien, étant à la merci du moindre orage ou de la moindre gelée, ce qui à la longue rend prudent et économe.
Enfant, j’ai côtoyé ces deux mondes, très différents comme je l’ai dit. Les années passant, mon point de vue, inévitablement, est devenu plus citadin et j’ai commencé, moi aussi, à regarder de l’extérieur ce monde paysan. Le rapport à la nature était différent. Alors que les gens de la ville, dans une volonté écologique, voulaient la préserver en l’état où elle se trouvait, les habitants de la campagne, qui étaient lassés de vivre au milieu des champs et des bois, auraient presque souhaité voir une autoroute passer devant leur ferme. On peut les comprendre. Isolés au cœur de l’hiver, ils devaient emprunter de vieilles routes communales défoncées et étroites pour se rendre au magasin le plus proche. Pourquoi leur aurai-je refusé le droit d’avoir eux aussi une route convenable et sûre qui aurait diminué le temps de leurs trajets ? Moi-même, pour venir me ressourcer chez eux, j’avais bien emprunté l’autoroute. Lassés des buildings, rien n’était plus reposant pour moi que le petit village avec son église et son vieil arbre. Mais au nom de la modernité l’arbre a été coupé et la place devant de l’église s’est transformé en une esplanade de macadam. Je l’ai regretté. Ceux du coin, s’en sont félicités. Ce jour-là j’ai bien dû admettre que j’étais devenu un citadin.
Parallèlement à cela, la dépopulation a fait des ravages. Les maisons, vidées de leurs habitants, ont été rachetées par des touristes. Un autre mode de vie s’est alors introduit dans ces contrées reculées (reculées pas tant géographiquement que sociologiquement). Les dimanches, on pouvait voir les cultivateurs travailler dans leurs étables ou dans leurs champs tandis que les touristes se prélassaient dans les premières pelouses (avant il n’y avait jamais eu de pelouses, évidemment). Etant un peu du coin, je n’aurais pas trop osé m’afficher ainsi ostensiblement dans l’inaction. Je préférais donc les grandes marches dans la forêt profonde, ce qui convenait à ma solitude et me permettait par ailleurs de trouver du temps à consacrer à la réflexion (on ne dira jamais assez le côté apaisant que peut procurer une marche en pleine nature et comment nos idées prennent alors une tournure beaucoup plus équilibrée). Puis le temps passant, les touristes ont continué à affluer et les cultivateurs, ayant atteint l’âge de la pension, se sont mis à aménager les abords de leur demeure en les entourant de pelouses. Leurs enfants, devenus facteurs ou professeurs, les ont imités. Les champs à la limite du village sont devenus des terrains à bâtir. Un entrepreneur est venu s’installer, donnant du travail et massacrant le paysage avec ses pelles mécaniques et ses hangars.
Aujourd’hui on peut dire que l’esprit a changé et que la ville est à la campagne. Celle-ci demeure pourtant encore en moi, enfouie dans les souvenirs.

16:29 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (0)
25/06/2007
Paysage (4)

Qui dira jamais ce qui nous fascine devant le spectacle époustouflant de la marée haute ? Cette masse liquide qui, inlassablement, monte à l’assaut des terres devrait nous inquiéter, voire nous révulser, pourtant il n’en est rien. Plus l’eau gagne du terrain et plus notre enthousiasme grandit. C’est contre nous, pourtant, que l’océan lance ses assauts, contre le monde de la terre ferme, dont nous faisons partie. Elément hostile par excellence, la masse des eaux tente d’envahir notre univers. Nous devrions être au désespoir et c’est l’inverse qui se produit. Chaque vague qui dépasse la précédente suscite notre admiration. Nous laissant prendre au jeu, nous prenons parti pour la mer. Si en plus, à cette marée haute, vient s’ajouter la tempête, notre excitation est à son comble. La grande houle profonde, venue du fond, qui vient se briser en gerbes éclatantes contre les rochers semble éveiller en nous une sorte de vengeance. Ce combat des vagues est un peu le nôtre. Il semble correspondre à notre désir d’aller toujours plus haut, toujours plus loin. Brisés quelque part par la vie, qui ne nous a pas permis de réaliser nos rêves (ou de ne les réaliser que partiellement), condamnés à mener une existence ordinaire, il nous semble voir dans cette force de l’océan l’ultime possibilité d’accéder à la démesure. Ces vagues qui déferlent contre les falaises, dans un fracas d’enfer, deviennent un peu nous-mêmes, par procuration. Comme elles, nous souhaiterions anéantir tout ce qui s’oppose à notre extension et imposer enfin notre loi, dans le tumulte de la victoire.
Remarquons qu’une marée basse, même si l’eau est agitée, ne procure jamais le même sentiment de plénitude. Ici, on sent la mer vaincue, qui se retire inexorablement, malgré quelques grognements sauvages qui n’en imposent plus à personne. Non, il n’y a que la marée haute, surtout si elle est renforcée par une tempête, pour éveiller en nous ce sentiment de destin à accomplir, de lutte à mener, de victoire à remporter enfin. La mer transgresse les interdits, elle a toutes les audaces, elle entreprend tout ce que nous n’aurions même pas osé imaginer. Elle est nous-même dans sa violence bestiale, pure et belle dans sa lutte acharnée, merveilleuse dans son désir d’accomplissement.

J’ai connu ainsi, enfant, des soirées remarquables, dans la Bretagne du Nord. Juillet, là-bas, prend parfois des airs d’automne, surtout quand la lune est pleine et que la mer vient s’écraser contre les falaises avec une obstination inimaginable. Dans la pénombre, l’écume blanche jaillissait en grandes gerbes contre les rochers, avant de se retirer, emportant avec elle des milliers de galets dans un roulement de fin du monde. Ce bruit des galets, laissant deviner la puissance de la force qui les entraînait, m’a toujours semblé être celui de la création du monde. Qui pourrait résister à cette masse océane capable de déplacer ainsi en une seconde des milliers de pierres, les roulant dans tous les sens, les réduisant aux éléments d’un jeu dont elle seule a inventé les règles ? Eclaboussé parfois par les gerbes d’eau, tout couvert d’embruns, l’enfant de dix ans que j’étais regardait avec respect la nature à l’œuvre, en train de s’inventer de nouveaux mondes.
Dans l’univers littéraire, l’océan, on s’en doute, a inspiré les poètes, depuis le vieil Homère, et sa « mer aux flots tumultueux », jusqu’à Valéry (« La mer, la mer, toujours recommencée »), en passant par les poésies d’Ossian, sans oublier, bien entendu, Léo Ferré :
« La marée je l'ai dans le cœur
Qui me remonte comme un signe
Je meurs de ma petite sœur
De mon enfant et de mon cygne
(…)
Je me souviens des soirs là-bas
Et des sprints gagnés sur l'écume
Cette bave des chevaux ras
Au ras des rocs qui se consument
Ô l'ange des plaisirs perdus
Ô rumeurs d'une autre habitude
Mes désirs dès lors ne sont plus
Qu'un chagrin de ma solitude »
La mémoire et la mer
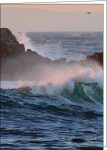
15:47 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (0)
22/06/2007
Art roman
On ne dira jamais assez de bien de la collection Zodiaque. Celle-ci a été créée par « l’abbaye de la Pierre qui vire », qui éditait et imprimait elle-même les volumes, perpétrant ainsi la tradition monastique de l’Occident médiéval.
http://www.abbaye-pierrequivire.asso.fr/
La collection zodiaque s’est rendue célèbre par ses ouvrages sur l’art roman en Europe, réalisés à la fois par les moines de l’abbaye et des universitaires de renom.
http://www.romanes.com/biblio/zodiaque_fr.html
J’ai été particulièrement impressionné autrefois lorsque j’ai lu le livre France romane, rédigé par Raymond Oursel.

D’abord, tout lecteur, même profane, ne peut qu’être admiratif devant la qualité des photographies proposées, certaines en couleur, d’autres en noir et blanc.
Ensuite, jamais comme dans ce livre je n’ai ressenti l’impression d’insécurité permanente qui devait être celle de nos ancêtres confrontés aux invasions barbares. Bien sûr, de par l’école, nous connaissons tous les Wisigoths et autres Ostrogoths, sans parler des Huns et du célèbre Attila (lequel, soit dit en passant, fut vaincu un 20 juin 451 aux Champs catalauniques, près de Troyes), mais il faut lire le texte d’Oursel pour comprendre de l’intérieur et comme si nous y étions, ce que représentait l’arrivée d’un bateau normand ou viking dans un village du Moyen-Age. Il en va de même pour le massif des Maures, si bien nommé. Si aujourd’hui ce terme évoque des vacances le long de la Méditerranée, il ne faut pas oublier que pendant des siècles ce massif a abrité des pirates mauresques, lesquels enlevaient tous les imprudents qui s’aventuraient seuls sur une plage ou dans la montagne. Ces malheureux finissaient souvent leurs jours comme esclaves dans un Orient qui, pour eux, n’avait rien de commun avec les Mille et une nuits.
Enfin, ce qu’il y a de plus remarquable dans le livre d’Oursel, c’est la manière dont il fait parler les pierres de nos vieilles églises romanes. Je dois dire que j’ai un faible pour cette architecture primitive et que je ne manque jamais d’aller en visiter une si d’aventure ma route m’amène à proximité. Derrière le mystère qui émane naturellement de ces vieilles pierres (doublé de la méditation qui s’empare de nous quand nous réfléchissons sur ces hommes qui nous ont précédés et qui ont construit ces merveilles), j’avais surtout été sensible, jusque là, à l’aspect esthétique de ces églises. Dans leur simplicité et parfois même leur naïveté, elles ont en effet quelque chose d’attachant qui parle au cœur. Mais Oursel a su me les faire voir avec les yeux des religieux qui les ont fait construire. Mon regard esthétisant s’est doublé d’un regard quasi mystique. Certes telle ogive peut être belle en elle-même, par ses courbes ou la couleur de la pierre qui la compose, mais au-delà de cet aspect purement matériel, il a su montrer ce qu’elles veulent dire, les faisant parler et libérant ainsi l’esprit qui a présidé à leur érection. Devenues poèmes de pierres, elles révèlent, dans leur majesté architecturale, l’aspiration de l’homme du Moyen-Age à dire le sacré.
Ce sacré, c’est sans doute ce à quoi aspirent les moines de l’abbaye de la Pierre qui vire. Sur le site donné en lien plus haut, on peut lire qu’ils se consacrent au travail pour subvenir à leurs besoins, mais qu’ils en limitent la durée à cinq heures par jours pour pouvoir s’adonner à leurs activités religieuses, ce qui est bien la moindre des choses de la part de religieux. Etrangement, du fond de mon athéisme (fût-il mystique), je les rejoins pleinement. Le travail devrait permettre à l’homme de survivre et ne devrait jamais devenir une fin en soi. Il faut du temps libre pour se consacrer à la pensée, à la recherche intérieure, à l’art, à la littérature. Si les hommes préhistoriques avaient dû passer toutes leurs journées à poursuivre le gibier, ils n’auraient jamais peint les murs de Lascaux ou la grotte de Gargas, si chère à Dominique Autié.
http://blog-dominique.autie.intexte.net/blogs/index.php/all?cat=47
A une époque où la compétitivité économique est à l’ordre du jour, dans une société marchande où seule l’acquisition de la richesse semble donner du prestige, il est peut-être bon, parfois, de prendre du recul et, tels les bâtisseurs des églises romanes, tenter de jeter un autre regard sur le monde, un regard plein d’admiration sur ce qui nous entoure. Car c’est à n’en pas douter l’harmonie qu’avaient trouvée ces moines du Moyens-Age. A une époque où la mort était partout et la vie ô combien fragile, ils étaient parvenus par leurs chants et leurs constructions, à dire la beauté de l’univers dont ils faisaient eux-mêmes partie.
Pour terminer, je voudrais reproduire ici le petit texte qui explique pourquoi c’est le nom « Zodiaque » qui a été donné à la collection des livres de l’abbaye de la Pierre qui vire :
…(P)arler de zodiaque, c'était parler du temps : du temps naturel, de celui que mesure le mouvement des planètes dans la sphère céleste. Cette question de temps nous paraissait l'une des plus cruciales de l'époque. L'accélération constante du progrès nous semblait un risque majeur. "En prônant le zodiaque, disions-nous, nous réclamons le retour à une vraie notion de temps basée sur les lois de la nature : à une vie normale, inscrite dans le déroulement, voulu par Dieu, du monde des choses." Nous pensions bien laisser entendre que l'art ne nous intéressait que dans la mesure où il débouchait sur l'humaine aventure, la révélant mieux que tout autre indice, l'engageant aussi. "On n'atteint la beauté que dans l'amour, et l'amour exige le temps et la liberté.
Un beau texte à méditer...

16:40 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : art roman, éditions zodiaque
31/05/2007
Paysage (3)
Pays de frontières, plein de contrastes, le Roussillon est étrange à plus d’un titre.
D’abord, il y a cette rencontre géologique improbable et peu commune entre la plaine, habitée depuis toujours, rectiligne et uniforme (tellement plate qu’on a l’impression que la mer, hier encore, s’avançait en ces lieux), et les montagnes pyrénéennes qui l’encerclent et qui bordent son horizon de leurs masses sombres et vertes. Habituellement, une zone montagneuse se signale par des contreforts qui laissent le temps au voyageur de se préparer à une modification du relief. L’Ardenne, par exemple, est précédée au Nord par le Condroz et la Famenne, au Sud par l’Argonne et les Côtes de Meuse. Il en va de même du Massif central, auquel on accède au Nord par une pente douce (les départements de l’Allier et de la Creuse) et dont le flanc Ouest n’est qu’une longue descente vers l’Atlantique tandis qu’au Sud, les Cévennes dévalent en dégradé vers la plaine languedocienne. Les Pyrénées, au contraire, se dressent fièrement d’un bloc, tranchant nettement avec le milieu environnant. Ce contraste est semblable à celui de la plaine du Pô, laquelle est ceinturée tout de son long par la chaîne des Alpes. Je me souviens ainsi d’un train de nuit dans lequel je roulais vers Venise. Quelle impression, après l’obscurité de la nuit, de découvrir aux premières lumières de l’aube cette plaine immense bordée ainsi, d’une manière ininterrompue, par la masse bleutée des montagnes. Il me semblait voir les pays du Sud s’offrir à moi sans résistance, tels qu’il se donnèrent à Hannibal et à ses éléphants.
Mais revenons au Roussillon. Sa deuxième curiosité, sur le plan botanique, c’est que les Pyrénées, qu’on connaît ailleurs pour leurs sommets et leur végétation montagnarde, sont revêtues ici d’une flore méditerranéenne. Ce ne sont partout que chênes-lièges, chênes-verts, châtaigniers, arbustes et maquis, qui donnent à la montagne un air de Provence. Sans parler de la mer toute proche, qui fait de cette région une étrange synthèse de deux mondes antagonistes. On passe en un quart d’heure des plages de sable fin aux sommets caillouteux et l’on peut, en juin, se baigner en admirant les sommets encore enneigés du Canigou.
Autre particularité, c’est que nous sommes dans un pays de frontières. Ici s’arrête en principe quelque chose, à savoir l’ère d’influence des rois de France. Pourtant, sur le versant espagnol, commence la Catalogne, qui est le véritable berceau culturel et linguistique de la Catalogne française. Cette frontière est une limite sans l’être vraiment, au point qu’on se demanderait parfois si le véritable partage ne se fait pas entre les autochtones catalans (de quelque côté qu’ils soient des Pyrénées) et les touristes venus du Nord, lesquels, tels les croisés venant conquérir Montségur, s’expriment en langue d’oïl. Cette dichotomie franco-française on la ressent dans les vieux villages, dont les maisons anciennes aux volets clos sont groupées autour de la place de la mairie, tandis que dans les alentours les résidences secondaires sont principalement occupées par des retraités normands ou parisiens venus passer leurs vieux jours au soleil.
Terre étrange donc, que ce Roussillon, écrasé de soleil entre terre et montagne, repeuplé de pensionnés et qui tente de son identité propre en cherchant dans ses souvenirs les vieilles techniques artisanales de ses ancêtres, aujourd’hui dépassées et révolues.
Tandis que sur la côte les firmes hôtelières étrangères vivent du commerce et de l’exploitation touristique, les gens du coin tentent de préserver ce que fut leur vie en se demandant à quoi demain ressemblera.

15:46 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (0)
30/05/2007
Paysage (2)
Moi qui avais visité les Pyrénées durant mon adolescence, j’aspirais à voir l’endroit où cette chaîne de montagnes se jette dans la mer. Cette rencontre contrastée entre le géant rocheux et l’élément liquide, méditerranéen de surcroît, ne devait pas manquer d’intérêt. La nature, en effet, semble parfois, par son spectacle, éveiller en nous tout un réseau de correspondances symboliques. Bachelard a bien décrit cela dans ses différents livres, montrant comment certains individus sont fascinés par le feu, d’autres par l’eau et ainsi de suite. Personnellement, je déteste l’eau (et encore plus les marécages) et il n’y a que les rochers écrasés de chaleur, dans la sécheresse de l’été, qui me parlent. Les masses montagneuses, par leur assise et par leurs sommets vertigineux me rassurent, sans doute parce qu’elles évoquent la stabilité, à l’inverse des zones marécageuses, qui elles me semblent renvoyer à un monde de l’entre-deux, à un univers du mensonge et de la fourberie. Rien de plus angoissant que ces terrains humides où naît une source et dans lesquels vous vous enfoncez irrémédiablement sans savoir comment vous en sortir. Avec les humains, il en va de même. Je préférerai toujours quelqu’un qui dit clairement ce qu’il pense (pour autant bien entendu qu’il fasse dans la nuance et qu’il ne réduise pas sa pensée à des idées toutes faites et inébranlables) à ces personnes qui vous captent dans leurs filets et qui vous mentent avec d’autant plus de conviction qu’elles finissent par ne plus savoir elles-mêmes ce qu’elles pensent vraiment.
On comprendra, dès lors, que les politiciens, quelle que soit leur couleur, n’ont pas vraiment ma sympathie, surtout quand ils arrivent au pouvoir et qu’on voit par leurs actions qu’ils n’ont fait que nous tromper.
Mais revenons à nos Pyrénées, lesquelles devaient, quelque part, imposer leur présence à l’élément liquide. Cette rencontre tant attendue, il ne me fallut attendre pas mal d’années avant de pouvoir l’observer. Ayant pris un jour d’été le train à Cahors en direction de Barcelone, je me suis retrouvé dans la plaine languedocienne, aride et étouffante de chaleur. Un enchantement pour qui vit habituellement dans un pays de pluie. Puis soudain, après Sète, surgirent les étangs et notamment le bassin de Thau.

A cet endroit (ou était-ce plus loin, près de l’étang de Leucate ?), le train circule entre mer et marais dans un paysage improbable, la terre ferme étant réduite à une bande étroite à peine suffisante pour les rails. Cette omniprésence de l’eau, après quelques jours passés dans le Lot, avait de quoi surprendre et je n’ai jamais connu ailleurs cette impression de rouler au milieu de l’élément liquide. Que l’on portât le regard à gauche ou à droite, l’œil ne rencontrait qu’une même étendue uniformément bleue, conférant au voyage une portée onirique encore renforcée par la fatigue qui commençait à se faire sentir.
Mais bientôt, à l’horizon, dans une brume de chaleur, apparurent enfin les Pyrénées. Seul élément solide de tout le paysage, leur masse si caractéristique en imposa aussitôt. Il est vrai qu’après tous ces marécages dans lesquels je pataugeais depuis une heure, la présence de ces roches dures et stables offrait un côté rassurant, comme quelque chose de connu à quoi enfin se raccrocher. Mes Pyrénées se rapprochèrent à la vitesse du train et bientôt les détails des contreforts furent visibles. A la gare d’Argelès, perdue au milieu de la végétation, les derniers voyageurs descendirent. Deux couples avec enfants, qui restaient là, sur le quai unique, se demandant à quelle extrémité du monde ils avaient atteint et comment ils allaient bien pouvoir gagner le lieu de leur villégiature avec tous ces bagages qui les encombraient.
Les laissant à leur désarroi, je repartis seul, dans un compartiment déserté, pour la rencontre tant attendue. Après avoir roulé quelques minutes encore sans se presser, comme s’il redoutait un obstacle, le train butta soudain contre le rocher, dans lequel il se fraya tant bien que mal un passage. La mer avait disparu et nous étions maintenant au cœur même de la montagne, tels les héros de Jules Verne de mon enfance. Après Cerbère (dont le nom, pour tout amateur d’Antiquité grecque, n’est pas sans symboliser l’entrée dans un autre monde), apparut enfin la gare de Port-Bou (qui, étymologiquement signifie « port de pêcheurs »), terme provisoire du voyage, la SNCF renonçant à explorer les terres plus méridionales. Port-Bou, avec sa gare internationale, donne donc l’impression d’être un cul de sac, un lieu au-delà duquel il n’y aurait plus rien, sauf si on accepte de changer de registre et de passer de la langue de Voltaire à celle de Cervantès, auquel cas le voyage peut continuer.
Cette impression de cul de sac est encore renforcée par la géographie de la ville, coincée entre la mer et la montagne ou plus exactement, poussée dans la mer par la montagne. J’eus tout le loisir d’observer ce phénomène, car les correspondances ne semblaient pas assurées entre la France et l’Espagne (du moins en ce temps-là) et il me fallut patienter quelques heures avant de poursuivre mon voyage. Je les passai donc à visiter cette ville minuscule, composée dans mon souvenir d’une seule rue commerçante à forte déclivité. Ayant peu de goût pour le lèche-vitrines, je me retrouvai assez vite assis sur un parapet devant la mer, laquelle est coincée entre les masses de la montagne qui occultent pratiquement tout l’horizon. Alors que partout ailleurs, des falaises de Bretagne aux grandes plages de l’Atlantique, le regard, dans ces zones côtières, embrasse l’immensité de l’espace, ici, la vue est réduite à gauche comme à droite par des pans de montagne qui font ressembler ce qu’on voit de la mer à un fleuve se faufilant entre une rangée de HLM. Sur une étendue de galets (car même le sable jaune avait été refusé à ce qu’il fallait pourtant bien se résoudre à appeler une plage) se trouvait une jeune dame avec sa petite fille, uniques vacancières insolites en ce lieu de nulle part, où la montagne semblait avoir annihilé tout ce qui nous était familier. Aurait-on voulu les aborder, qu’on n’aurait même pas su en quelle langue il aurait fallu le faire.

10:54 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, voyages
26/05/2007
Paysage (1)

D’abord, il y a la montagne
La montagne et le ciel
Et puis la mer qu’on devine
Ou qu’on imagine.
La mer.
Dans le ciel, si bleu, si pur, tourne un vautour.
Il tourne au-dessus des ruines d’un improbable château.
Il tourne depuis mille ans
Le gypaète barbu.
Nous sommes dans la montagne
Aux marches du royaume.
Midi scintille de tous ses feux
Tandis qu’une lézarde se chauffe au soleil
Sur une roche de schiste,
Les yeux ouverts, aux aguets,
La respiration palpitante.
Un ermitage est là, dans ce désert de pierres.
D’une source coule une eau froide,
Salutaire au voyageur.
Dans la chapelle à l’abandon
Point de chants liturgiques
Mais une musique obsédante qui emplit l’espace.
Celle des insectes qui, par milliers, crient leur certitude
Et leur volonté de vivre.
Sur l’autre versant, se dresse une tour
Qu’on appelle sarrasine car le Maure la construisit
En des temps reculés,
Quand ce pays était frontière d’un autre empire
A jamais disparu.
En bas, s’étend la plaine et ses villas romaines
La plaine antique et ses vignobles
La terre des hommes et du vin fou.
En bas c’est la plaine.
L’ombre du vautour a décrit un cercle plus étroit.
Il est midi et l’on reprend sa marche
Vers d’autres destinées
Vers d’autres montagnes
Où la vie n’est plus qu’un songe
Dans la chaleur de l’été.

00:55 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (2)
25/05/2007
L'invitation au voyage
Ces derniers temps, la politique est devenue déconcertante. Une majorité de la population semble aspirer à un régime fort, qui va pourtant réduire ses droits sociaux (généralisation des emplois précaires, diminution des indemnités de chômage, droit de grève remis en question,, démantèlement du service public, heures supplémentaires, etc.) et son pouvoir d’achat (la sécurité sociale comme les pensions basculant vers le secteur privé, il faudra bien cotiser auprès de ces nouvelles caisses). L’eau, le gaz, l’électricité ne seront plus vus comme des biens auxquels la population aurait droit, afin d’améliorer son confort de vie, mais comme des produits à vendre. Dans ce contexte, se chauffer en hiver pourrait bientôt devenir un luxe… Insensiblement, on assistera donc à une paupérisation manifeste d’une partie des citoyens et à l’enrichissement de quelques-autres.
Par ailleurs, le travail n’est plus présenté comme un moyen de gagner sa vie mais bien comme une fin en soi. Il faut se lever de plus en plus tôt, travailler davantage, faire des heures supplémentaires, soutenir un rythme quasi infernal… L’argent gagné au détriment du temps que vous auriez pu consacrer à votre famille ou à vos loisirs (et pour moi ce terme évoque d’abord la culture et la lecture) ne servira qu’à acheter des biens de consommation futiles, donc à faire tourner la machine économique et à permettre à quelques privilégiés de s’enrichir encore plus.
Comment peut-on approuver cela ?
Afin de garder le moral, en ces temps difficiles, prenons le large et réfugions-nous dans notre imagination. Notre monde intérieur n’appartient qu’à nous, on ne peut pas nous l’enlever, profitons-en.
Partons donc en voyage, non pas, comme Ulysse, pour dix années, mais seulement pour cinq, le temps que les choses se calment un peu du côté de l’occupant de l’Elysée. Voguons sur la vaste mer à la recherche d’une vérité improbable, découvrons des îles vierges, écoutons le chant des sirènes ou plus simplement le bruit des vagues. Laissons-nous séduire quelque temps par la belle Calypso puis retournons à Ithaque, la terre de nos ancêtres, où nous attend depuis toujours la belle Pénélope.

14:10 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (2)
10/04/2007
Naufrages
On peut considérer que Cabeza de Vaca fut, bien malgré lui, le premier ethnologue des populations indiennes d’Amérique du Nord. Il publia sous le titre Naufrages le récit de son aventure.
J’ai lu ce livre il y a des années déjà et j’en ai conservé une impression très forte, notamment à cause de la description que fait l’auteur des conditions de vie difficiles des Indiens durant la période hivernale. Pour ainsi dire privés de nourriture, affaiblis par le froid, beaucoup mourraient de maladie. On est loin de l’éden idyllique que tentera de répandre Rousseau avec le mythe du bon sauvage, lequel aurait joui d’une vie paisible au milieu d’une nature luxuriante.
Ce qui est sûr, c’est que Cabeza de Vaca, une fois retourné à la civilisation, se montra un grand défenseur des populations indigènes, avec lesquelles il avait dû vivre en symbiose pendant la durée de son voyage et dont il était parvenu à comprendre les spécificités. Il s’opposera très vite aux colons européens qui parvinrent à le chasser d’Amérique et à le contraindre à retourner en Espagne.
Voici un petit extrait :
Nous qui nous en étions tirés, nous étions nus comme à notre naissance et avions perdu tout ce que nous avions, et même si tout cela valait peu, pour le moment cela n'avait pas de prix. Et comme alors on était en novembre, qu'il faisait très froid et qu'on n'aurait pas eu beaucoup de mal à nous compter les os, nous étions devenus la vraie image de la mort. En ce qui me concerne je peux dire que depuis le mois de mai je n'avais rien mangé d'autre que du maïs grillé, et parfois je m'étais vu dans l'obligation de le manger cru (...). Je dis cela pour éviter de longs discours, pour que chacun puisse se rendre compte dans quel état nous étions.
11:10 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (2)
Foi et colonialisme
Ce théologien dominicain fera plus de quatorze fois la traversée entre les deux continents (ce qui, dans les conditions matérielles de l’époque, était un véritable exploit) afin de convaincre les autorités de se comporter avec un minimum d’humanité envers les populations indigènes. Le problème était de concilier les intérêts financiers de la nouvelle colonie avec son point de vue humanitaire. Il y parviendra en prouvant que pour être rentables, les exploitations américaines ont besoin de main d’œuvre et que ce n’est pas en faisant mourir les Indiens qu’elles pourront survivre. La métropole l’écoute un temps et prend des mesures en faveur de la population indigène. Sur place, malheureusement, ces directives sont peu appliquées et Las Casas lui-même doit faire face à l’hostilité des colons.
Revenu définitivement en Espagne, il n’arrêtera pas d’expliquer que cette conquête du nouveau monde n’est pas une guerre juste et que s’il fallait songer à évangéliser ces populations, il ne fallait pas le faire dans le sang et encore moins les réduire en esclavage dans le seul but de faire du profit. En démontrant qu’aucun roi indien n’a reconnu de son plein gré la domination espagnole, il prouve que celle-ci est illégale et que le pillage des temples aztèques ou incas s’apparente donc à un vol. On comprend que de tels propos ne lui ont pas fait que des amis.
10:15 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (5)
06/04/2007
Suite


21:18 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (0)
Art précolombien (2)

Tehotihuacan
21:00 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (0)
Art précolombien (1)
Nous en avons vu une belle illustration récemment, quand les musées de Bagdad ont été pillés lors de l’invasion américaine. Il s’agissait là manifestement d’anéantir jusqu’au passé d’un peuple afin de lui imposer plus facilement un autre ordre culturel.
Mais revenons à notre art précolombien. Au-delà des considérations purement esthétiques, j’ai été frappé par la représentation du regard dans les masques mexicains. Si certains ont des trous à la place des yeux, comme les masques de carnaval, d’autres n’ont pas d’yeux du tout. Entre le front et le nez se trouve un simple renfoncement, sans aucune représentation de l’œil ou des paupières. Et pourtant, paradoxalement, ces visages ont une vie et semblent vous regarder avec une intelligence autre, un peu comme Tirésias, le devin officiel de la ville de Thèbes (voir Euripide et Sophocle), qui pouvait prédire l’avenir bien qu’il fût aveugle. D’autres masques, plus angoissants, représentent en quelque sorte une orbite creuse, sans œil, mais avec l’os du crâne qui est visible au fond. Et puis il y a des mises en abyme, comme ce guerrier au visage découvert qui tient dans sa main son propre masque.
Enfin, les références animalières sont nombreuses (le jaguar, etc.), ce qui me renvoie à ma lecture des Mythologiques de Lévi-Strauss et à son analyse des mythes des peuples primitifs. En m’acheminant vers la sortie, je me souviens qu’on déboise la grande forêt équatoriale et que les derniers indiens sont en train de disparaître. Demain ils ne vaudront plus que pour avoir été.
15:20 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (1)








