16/09/2008
"Palestine" d'Hubert Haddad
Né à Tunis en 1947, Hubert Haddad à vécu son enfance a Ménilmontant. A vingt ans, il a fondé une revue de poésie le Point d'être, influencée par le surréalisme. Ecrivain (poète, romancier, nouvelliste, dramaturge et essayiste), il vit essentiellement des ateliers d'écriture qu’il anime dans les écoles mais aussi dans les hôpitaux et les prisons. D’origine à la fois juive et berbère, ce Français de l’immigration ne pouvait que se pencher un jour ou l’autre sur ses origines. Cela nous a donné ce très beau livre qu’est Palestine, où le conflit bien connu du Moyen-Orient est retracé sur un mode quasi poétique et dans une approche d’une grande humanité.
Le héros est un officier israélien qui tombe dans une embuscade. Il va perdre la mémoire et se retrouver du côté palestinien, vivant au jour le jour toutes les humiliations imposées à la population par Tsahal, qui défend, elle, les colonies juives de peuplement en Cisjordanie.
Rien que pour comprendre ce qu’est la vie quotidienne dans cette partie du monde, ce roman vaut la peine d’être lu car on découvre par l’intermédiaire du héros la difficulté de se déplacer (barrages militaires improvisés, chekpoints, etc.) ou même de survivre (maisons détruites en représailles, construction du mur, etc.). Pour ce qui est de ce côté « documentaire » et « reportage », Haddad me fait penser à Jasmina Khadra qui, dans son roman « L’Attentat », nous décrit aussi des situations particulièrement difficiles.
Mais « Palestine » est bien autre chose qu’une simple description de la réalité, c’est un livre rempli de symboles. Ainsi, c’est après avoir été jeté dans une tombe que le héros renaît à sa nouvelle vie et qu’il devient palestinien. Dès lors, il passe de son statut d’officier (à la situation relativement aisée) à celle d’un paria ne possédant rien, même plus sa mémoire. Belle métaphore pour désigner le peuple palestinien tout entier, à qui on ravit chaque jour un peu plus la terre et qui sombre dans la pauvreté et la misère. Son seul salut, c’est justement cette mémoire qu’on voudrait lui enlever et qui lui permet de se souvenir de son passé et donc de résister aux tentatives de l’occupant, lequel essaie de faire disparaître sa culture (villages rasés, maisons détruites, oliviers coupés, etc.). Le héros, lui, a perdu ses souvenirs judaïques et c’est avec un cœur neuf et sans préjugés qu’il découvre la triste vie quotidienne de ce peuple voisin du sien contre lequel il combattait encore le matin même.
Le voilà devenu Nessim, frère de Falastìn, étudiante anorexique, et fils d’Asmahane, veuve aveugle d’un responsable politique abattu dans une embuscade.
La cécité de la vielle dame est elle aussi tout un symbole. Sans doute préfère-t-elle ne plus voir les horreurs de la vie quotidienne depuis qu’on lui a tué son mari. Sa fille Falastin, jeune fille frêle et attachante, joue un peu le rôle d’une nouvelle Antigone en s’occupant de sa vieille mère. On notera que le mythe d’Œdipe est inversé puisque ici l’aveugle est une vieille femme et non plus un homme jeune. De plus elle n’a tué personne (au contraire on a tué son mari) involontairement mais c’est délibérément que les Israéliens assassinent son peuple. Loin de se laisser conduire sur les chemins, comme Œdipe guidé par l’antique Antigone, Asmahane reste cloîtrée dans sa maison et ne sort plus (symbole de l’enfermement de la Cisjordanie par le mur et Tsahal). Elle en sort tellement peu qu’elle y trouvera la mort le jour où l’armée vient raser l’immeuble car, étant aveugle, elle n’a évidemment pas pu lire l’ordre d’évacuation.
Si Asmahane est aveugle, sa fille est anorexique et refuse de se laisser vivre. Ainsi, elle n’a plus ses règles, malgré ses vingt ans, ce qui la plonge dans une stérilité qui renvoie elle aussi à celle, symbolique, de tout son peuple. D’ailleurs, d’une manière générale, de nombreux protagonistes ont un handicap. Ainsi un jeune berger devenu porteur d’eau boîte suite à une balle reçue dans la jambe. Qu’il s’agisse donc de voir, de se déplacer ou de procréer, tous ces actes qui font une vie normale semblent devenus impossibles.
A la fin du livre, Nessim est séparé de Falastin dont il est probablement amoureux (elle est la seule personne qui lui ait apporté un peu de douceur dans ce monde de fous où tout n’est que violences et brimades). Désemparé, il finit par se faire embrigader par des terroristes qui lui proposent d’aller se faire exploser à Jérusalem. Il accepte pour en finir, ne trouvant finalement aucun goût à la vie qu’il mène, laquelle n’a aucun sens. A la dernière minute, cependant, la mémoire lui revient mais c’est pour apprendre la mort de son frère (notons que le frère d’Hubert Haddad vivait à Hébron et qu’il est venu se suicider à Ménilmontant). On devine qu’il va se suicider avec la charge explosive qu’il porte sur lui, mais en ayant soin de ne faire aucune victime.
Beau portrait donc, dans ce livre, du peuple palestinien, pris entre radicalisme et résignation, entre Hamas et Fatah. La fatalité surtout domine, plus que la colère. On n’espère plus vraiment que la situation puisse évoluer, mais on reste sur place tout de même, par principe, par habitude, par respect de sa propre culture. Le lecteur vit tout cela de l’intérieur, comme s’il était l’un de ces personnages et c’est peut-être ce qui rend le livre si attachant et si humain. Le style de l’auteur est celui d’un poète. Il suffit de voir comment il décrit les levers de soleil pour comprendre que le regard qu’il porte sur cette terre est tendre. La présence de Falastin offre un contraste saisissant entre la barbarie du monde et la douceur intérieure de son être. Au fil des pages elle devient vraiment attachante et pour un peu le lecteur en deviendrait aussi amoureux que le héros a pu le devenir. C’est que malgré sa fragilité, tout repose sur les épaules de la jeune fille (s’occuper de sa mère, soigner Nessim, aider les enfants à aller à l’école en longeant les colonies juives, d’où on leur jette souvent des pierres, etc.). Alliant douceur et détermination, elle vit dans un monde de rêves (encore la poésie), un monde bien à elle qu’elle s’est créé et qui lui permet de ne pas voir l’horreur de la situation présente. On pourrait dire qu’elle s’échappe par l’imaginaire et c’est sans doute ce que Nassim aime en elle.
Un beau livre donc, que je qualifierais de reportage poétique et qui nous fait découvrir des hommes et des femmes, des soldats et des civils, des jeunes et des vieux, des aveugles et des voyants, des Arabes et des Juifs, des quasi-morts et des vivants. Un livre à lire, assurément.
Hubert Hadad, « Palestine », Zulma, mai 2007, 156 pages, 16,50 euros.

09:34 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature, hubert haddad, palestine
29/08/2008
Romans à lire
Avec 676 romans publiés à la rentrée 2008, il semblerait qu’on enregistre une baisse par rapport à 2007. On croit rêver. Quand pourrait-on trouver le temps de lire une pareille production ?
Ceci dit, si de tels chiffres donnent l’impression que le monde de l’édition se porte bien (je n’ai pas dit la littérature), il ne faudrait tout de même pas perdre de vue que la grosse majorité des ventes (et donc du chiffre d’affaires) tourne autour d’une bonne dizaine d’écrivains à succès. Et les autres, me direz-vous ? Ils rempliront les librairies quelques semaines avant de disparaître comme ils étaient venus.
Pour certains, ce n’est sûrement pas une grande perte, pour d’autres si. Chaque année je me dis qu’il y a sûrement quelques perles dans toute cette production, mais comment la dénicher ? Pas par la critique officielle, qui ne fait que renforcer le système publicitaire des éditeurs (volontairement sans doute, mais involontairement aussi : les critiques eux-mêmes sont noyés par l’abondante production et ils ne lisent que les livres dont on a bien voulu leur parler, autrement ceux sur lesquels les éditeurs, en marchands avisés qu’ils sont, ont misé).
Donc, tout cela, cela fait beaucoup de perte. Perte de temps et d’énergie pour l’écrivain qui ne sera quand même pas lu. Perte de temps pour l’éditeur puisque ces livres ne lui rapporteront rien et qu’ils ne serviront pas à établir sa réputation. Perte de temps pour moi ici qui bavarde sur des livres que je ne lirai jamais. Et je ne parle pas des arbres qu’on a dû couper pour réaliser ces milliers de pages.
Au moins ici, sur un blogue, on respecte la santé des arbres, on ne perturbe pas les éditeurs et on est obligé de faire court si on veut avoir quelques lecteurs. Certes, nous restons dans l’éphémère, mais finalement n’est-ce pas plus en adéquation avec notre destinée ? Tels des étoiles, nous brillons un instant avant de disparaître.
Bien sûr, si Homère, Sophocle, Montaigne ou Baudelaire avaient raisonné de la sorte, nous n’aurions pas le plaisir de lire leurs ouvrages aujourd’hui. Or nous sommes heureux de pouvoir les feuilleter sans cesse, ne serait-ce que pour ne pas devoir se pencher sur ces 676 romans dont on va nous rabattre les oreilles.
14:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (29) | Tags : littérature, rentrée littéraire
18/08/2008
Mahmoud Darwich (3)
Ainsi donc Mahmoud Darwich a bénéficié de funérailles nationales. C’est assez rare pour un poète et mérite que nous le soulignions. On pourrait comparer son enterrement à celui de Victor Hugo en France, lui aussi connu pour ses activités politiques. Car bien évidemment, c’est moins le poète que les Palestiniens ont célébré que l’infatigable défenseur d’un état palestinien. De même que les Occidentaux ont surtout vu en Soljenitsyne celui qui a condamné le goulag, beaucoup plus qu’ils n’ont vraiment apprécié l’écrivain.
Ceci étant dit, les différences entre les funérailles des deux hommes de lettres restent significatives. L’écrivain russe était retourné dans sa patrie, celle de ses jeunes années, qu’il avait trouvée changée (on peut tout de même espérer que c’était en mieux) et il a été enterré, comme il l’a voulu, selon le rite orthodoxe.
Mahmoud Darwich, lui, a reçu les honneurs d’un pays qui n’existe toujours pas. Quelque part, donc, cet hommage n’en est pas un puisqu’il émane du cœur des hommes mais n’est pas vraiment officiel.
De plus, s’il est bien revenu vivre en Palestine, c’est dans un pays étranger qu’il s’est retrouvé, en l’occurrence celui d’Israël (1). Sa situation est un peu comparable à celle d’un Alsacien d’expression française qui serait revenu en Alsace occupée en 1871. C’est chez lui et ce n’est pas chez lui.
Enfin, fait significatif entre tous, il a fallu demander l’accord de l’occupant israélien pour savoir où on allait l’enterrer. La logique aurait voulu que ce fût dans son village natal, en Galilée, mais ce privilège lui a été refusé. Il reposera donc bien en Palestine, mais pas dans son pays et encore moins dans son village, celui qu’il avait si bien chanté dans ses poèmes.
Ce village, c’était Birwa (Al-Birweh). Je dis « c’était » car il a été rasé en 1948 par les Israéliens et est devenu Akheï Ehud, à l’époque où ceux-ci construisaient leur état et jetaient sur les routes 750.000 Palestiniens. Il ne reste que le cimetière (2). Cela aurait tout de même suffi pour y inhumer notre poète, mais même cela lui fut refusé.
Il faut dire que si on se place du point de vue israélien, il était impossible de donner un tel accord. En effet, accorder une sépulture à un Palestinien en Galilée, c’était reconnaître que cette terre lui appartenait comme elle avait appartenu à ses ancêtres. En d’autres termes, outre le symbole politique dangereux qu’aurait représenté la tombe de Darwich, c’était prendre le risque de voir les descendants des 750.000 expulsés revenir prendre possession de leurs terres (je ne dirais pas de leurs biens puisque tout a été détruit).
Le cimetière lui-même est menacé. Son accès est contrôlé entièrement par deux municipalités juives, Yasur et Achihud, lesquelles ont pris possession de toutes les terres de l’ancien village.
Darwich savait que ce retour au pays natal lui serait refusé, aussi avait-il simplement manifesté le souhait d’être enterré en Palestine. D’où l’autorisation qui a été accordée de l’inhumer à Ramallah.
Pourtant, de son propre aveu, c’est le souvenir de ce village, d’où il a été chassé avec ses parents alors qu’il avait sept ans, qui est à l’origine de toute sa poésie, une poésie de l’absence, du souvenir et de la nostalgie.
Voici comme il s’exprimait :
« Je préfère garder les souvenirs qui s’attardent toujours dans des espaces ouverts, des champs de pastèques d’oliviers et d’amandiers. Je me souviens du cheval attaché au mûrier dans la cour et comment j’étais monté dessus avant qu’il me fasse tomber et que je sois puni par ma mère… Je me souviens des papillons et du net sentiment que tout était ouvert. Le village était sur une colline et tout s’étendait en contrebas.»
Plus rien n’est ouvert, aujourd’hui en Palestine. Ce qui n’a pas été détruit est maintenant isolé par le mur.
Certes, on aurait pu enterrer Darwich à Judeidi, le village arabe le plus proche de l’ancien Birwe (là où la famille du poète est revenue s’installer, le plus près possible de leurs anciennes terres). Mais comme disait son frère, Mahmoud n’était pas de Judeidi, il était de Birwe. Et sa mère, qui vit toujours (85 ou 95 ans selon les versions que j’ai consultées), avoue « Je voudrais que mon fils soit enterré ici, mais ce n’est pas que mon fils, c’est le fils du monde arabe tout entier.»
Sa mère !
J’ai la nostalgie du pain de ma mère,
Du café de ma mère,
Des caresses de ma mère...
Et l'enfance grandit en moi,
Jour après jour,
Et je chéris ma vie, car
Si je mourais,
J'aurais honte des larmes de ma mère !
Enfin, bref, voilà pourquoi Mahmoud, aujourd’hui, est enterré à Ramallah et non à Birwe.
Le comble, c’est que du coup les membres de sa propre famille ont dû demander des autorisations pour assister à l’enterrement. Comme Arabes ayant la citoyenneté israélienne, ils n’ont pas le droit de pénétrer dans des zones contrôlées par les Palestiniens telle que Ramallah.
Enfin, finalement, les difficultés furent aplanies et les Darwich purent voir le cercueil mis en terre. C’est déjà cela car Mahmoud, lui, après trois années consécutives d’assignation à domicile, avait été déchu de sa citoyenneté et on lui avait refusé le droit de voir sa famille jusqu’au milieu des années 90 (accords d’Oslo).
Quant à son œuvre poétique, elle est interdite dans les écoles israéliennes, même les écoles arabes.
Pauvre poète. Le voilà issu d’un village détruit et d’une terre confisquée. Enterré en dehors de sa Galilée natale, il repose certes en terre palestinienne, mais pas dans un état palestinien. Quant à ses textes, ils sont officiellement censurés chez lui, même s’ils sont lus par le monde entier. Car aucun mur, jamais, n’arrêtera la poésie et son message de liberté.
==========================================
1. Enfin pas vraiment. Depuis 2005, Israël a décidé de se désengager d'une partie de la Cisjordanie et de Gaza. Ces territoires sont donc « occupés par fait de guerre et ne font pas partie du territoire d’Israël, mais ils ne constituent pas non plus un état palestinien indépendant.
2. Pendant des années, les Palestiniens ont essayé d’empêcher les fermiers israéliens de faire paître leurs troupeaux dans le cimetière. Ils ont finalement pu mettre une clôture. Mais aujourd’hui, on construit une grande étable et celle-ci dresse sa structure métallique au-dessus des tombes. La maison du grand-père Darwich se trouvait près de l’entrée de ce cimetière. Des nombreux arbres fruitiers qu’il possédait, il ne reste qu’un grenadier. Un vieil habitant, qui avait 18 ans en 1948, conserve encore la clef rouillée de sa maison détruite et la montre à qui veut la voir.

23:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : littérature, mahmoud darwich
16/08/2008
Leo Ferré, "Le bateau espagnol"
Le Bateau Espagnol
J'étais un grand bateau descendant la Garonne
Farci de contrebande et bourré d'Espagnols
Les gens qui regardaient saluaient la Madone
Que j'avais attachée en poupe par le col
Un jour je m'en irai très loin en Amérique
Donner des tonnes d'or aux nègres du coton
Je serai le bateau pensant et prophétique
Et Bordeaux croulera sous mes vastes pontons
Qu'il est long le chemin d'Amérique
Qu'il est long le chemin de l'amour
Le bonheur ça vient toujours après la peine
T'en fais pas mon ami, je reviendrai
Puisque les voyages forment la jeunesse
T'en fais pas mon ami, je vieillirai.
Rassasié d'or ancien ployant sous les tropiques
Un jour m'en reviendrai les voiles en avant
Porteur de blés nouveaux avec mes coups de triques
Tout seul mieux qu'un marin, je violerai le vent
Harnaché d'Espagnols remontant la Garonne
Je rentrerai chez nous éclatant de lueurs
Les gens s'écarteront saluant la Madone
En poupe par le col et d'une autre couleur
Qu'il est doux le chemin de l'Espagne
Qu'il est doux le chemin du retour
Le bonheur ça vient toujours après la peine
T'en fais pas mon ami je reviendrai
Puisque les voyages forment la jeunesse
J' te dirai mon ami : à ton tour !
À ton tour...
Le thème du bateau, comme chez Rimbaud, symbolise le désir de partir au loin, vers des pays inconnus, des pays de rêve.
La Garonne elle-même, ce grand fleuve du Sud, contient déjà des éléments oniriques évidents. L’Amérique, dans l’imaginaire européen, est par définition le pays de tous les possibles depuis l’épopée de Christophe Colomb (voir aussi l’immigration italienne).
Le bateau de Ferré ne doit pas naviguer dans la légalité, on s’en doute. Il s’agit de prendre des chemins de traverse, d’où la contrebande.
Contrebande dont le bateau est « farci » histoire de montrer qu’il est rempli jusque dans ses moindres recoins de produits interdits. Ce terme « farci » connaît un prolongement avec le mot « bourré », qui dénote un aspect quantitatif.
Le thème de l’Espagne revient souvent chez Ferré. Dans son imaginaire, c’est l’Espagne de Garcia Lorca, de la guerre civile, bref un pays où, politiquement, on se bat contre le fascisme pour conquérir sa liberté. De plus, d’une manière générale, l’Espagne est un pays qui fait rêver (voir l’expression « bâtir des châteaux en Espagne »).
La Madone attachée en poupe par le col a de quoi surprendre. Habituellement, c’est une figure féminine à connotation érotique que l’on fixe à la proue du navire (notamment une sirène qui a de préférence les seins nus). Ici, il y a renversement de la situation classique : la statue se trouve à l’arrière du navire. Ainsi, au lieu de se dresser fièrement contre les flots et d’ouvrir symboliquement le passage , elle suit dans une attitude passive. D’ailleurs elle est pendue par le cou (allusion à la balade des pendus de Villon ?) et donc est balancée au gré des courants et des vents. De plus, il s’agit d’une madone, ce qui renvoie à un contexte religieux. Faut-il interpréter cela comme un acte de provocation de la part du capitaine du navire ? Sans doute. Au lieu de mettre son voyage sous la protection divine, en plaçant une statue de saint à l’avant, il fait suivre son bateau par cette madone qui pend ridiculement à l’arrière.
D’un autre côté, tout texte étant polysémique, le lecteur/auditeur est libre d’y trouver une autre interprétation. Ainsi la madone ne renvoie par forcément au contexte religieux. Elle est peut-être tout simplement un symbole de la virginité. Virginité de la jeune fille pure qui contraste avec les marins espagnols contrebandiers. Désir de tourner cette pureté en ridicule ? Peut-être, mais personnellement je pencherais plutôt pour une métaphore. Même si ce voyage est par définition répréhensible (on ne doit pas faire de contrebande comme on ne doit pas fait réaliser un pareil voyage au pays du rêve), il est placé tout de même sous le signe de la virginité. Non seulement il s’agit d’un premier voyage, mais le motif qui l’anime est pur : conquérir l’impossible.
Le but du voyage n’est pas d’aller fonder une colonie ou de piller ces contrées lointaines mais de « donner des tonnes d'or aux nègres du coton ». Une nouvelle fois on assiste à un renversement de la conduite habituelle. Ferré ne part pas en Amérique pour s’enrichir mais pour soulager les descendants des anciens esclaves. Comment ? En leur distribuant les « tonneaux d’or » que les Conquistadores ont volés aux Indiens.
Du coup, le bateau est dit « prophétique », ce qui replace l’expédition en cours sous le signe de la religion. Mais ici, il ne s’agira pas d’aller évangéliser les sauvages de force mais plutôt de soulager leurs misères. La bonté ne se trouve donc pas du côté des officiels (soldats ou religieux) mais du côté de ces contrebandiers au cœur tendre.
« Bordeaux » : allusion au port de l’Atlantique d’où partaient souvent les bateaux pour l’Amérique. Bordeaux c’est aussi la ville où Montaigne fut magistrat et même si rien n’indique que Ferré pensait à cela, rien n’empêche le lecteur, qui vient avec son propre imaginaire, de faire référence à cette haute figure de la littérature qu’était Montaigne.
Mais Bordeaux c’est aussi une ville indépendante, longtemps éloignée de la France puisque sous influence anglaise pendant une bonne partie du Moyen-Age. Bordeaux c’est le commerce du vin et une ville tournée vers le grand océan (idée de liberté).
« mes vastes pontons. » On s’attendrait plutôt à ce qu’il soit fait allusion aux larges quais de Bordeaux ou à ses embarcadères, mais une nouvelle fois nous assistons à un renversement des valeurs : c’est le bateau qui a de larges pontons et Bordeaux en sera tout ébranlé.
Ensuite, le poète nous indique bien que ce voyage vers l’Amérique n’est pas vraiment un voyage dans l’espace mais plutôt un voyage intérieur (initiatique ?). Il s’agit de conquérir l’amour, mais hélas, le chemin qui y mène est long.
Arrivé à ce stade, l’engouement du début semble marquer le pas et les marins découvrent la difficulté de leur entreprise. Comme chez Rimbaud, l’idée du retour surgit. («je reviendrai »)
« Rassasié d'or ancien » : idée de plénitude confinant au dégoût. Cet or est dit ancien probablement par référence à celui des conquistadores. « Les tropiques » renvoient à ce
monde mythique et imaginaire où le bateau est parvenu.
« Un jour m'en reviendrai les voiles en avant » : ici, pour le retour, les voiles sont en avant (on ne parle plus de la madone à la poupe).
« blés nouveaux » : le blé est le symbole par excellence de la germination. Ferré veut donc dire qu’il ramène des tropiques des souvenirs et des expériences qui vont fructifier dans sa nouvelle vie en Europe.
« je violerai le vent » : idée opposée à la virginité de la Madone. Le vent représente évidemment l’élément porteur mais il est aussi un élément hostile et dangereux. Le fait de le violer indique que c’est bien le marin qui est maître de sa destinée. C’est lui qui décide où ce vent va l’emporter.
Puis le voilà de retour au pays, « harnaché d'Espagnols, remontant la Garonne ».
« chez nous » est donc le foyer, le pays où on est né. Ferré revient chez lui, tel Ulysse revenant à Ithaque. Les gens saluent toujours la Madone, amis cette fois ils ne la contemplent plus, ils s’en écartent avec respect (ou crainte) car le poète est désormais porteur d’une vérité supérieure.
Madone qui est devenue d’une autre couleur à la suite du voyage. Effet de la mer et des grands vents ? Ou bien est-elle devenu une Indienne ?
« Qu'il est doux le chemin de l'Espagne » Car la Garonne prend sa source dans les Pyrénées espagnoles (massif de la Maladeta), ce qui permet de renvoyer à ce pays mythique pour Ferré. Le « chez nous » devient étrangement l’Espagne peut-être à cause du nombre d’Espagnols embarqués à bord, peut-être pour indiquer qu’on remonte jusqu’à la source. Dans tous les cas, il s’agit bien d’atteindre un pays hors du commun.
« Le bonheur ça vient toujours après la peine .» Sous la forme d’une sentence, Ferré indique que le bonheur est finalement ici, mais à condition bien entendu, d’être d’abord allé là-bas.
Conseil qu’il lance à son public : « A ton tour... »

01:52 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, léo ferré, le bateau espagnol
11/08/2008
Mahmoud Darwich (2)
« J’ai trouvé que la terre était fragile, et la mer, légère ; j’ai appris que la langue et la métaphore ne suffisent point pour fournir un lieu au lieu. (…) N’ayant pu trouver ma place sur la terre, j’ai tenté de la trouver dans l’Histoire. Et l’Histoire ne peut se réduire à une compensation de la géographie perdue. C’est également un point d’observation des ombres, de soi et de l’Autre, saisis dans un cheminement humain plus complexe. (…) Est-ce là simple ruse artistique, simple emprunt ? Est-ce, au contraire, le désespoir qui prend corps ? La réponse n’a aucune importance. L’essentiel est que j’ai trouvé ainsi une plus grande capacité lyrique, et un passage du relatif vers l’absolu. Une ouverture, pour que j’inscrive le national dans l’universel, pour que la Palestine ne se limite pas à la Palestine, mais qu’elle fonde sa légitimité esthétique dans un espace humain plus vaste. "
Mahmoud Darwich
Ainsi donc, cette Palestine qui lui a été refusée pour les raisons que l’on sait est devenue non seulement un pays concret qu’il convient de défendre et de revendiquer, mais aussi un lieu mythique et pour ainsi dire imaginaire (ou en tout cas qui ouvre les portes à l’imagination), la terre rêvée par tous les poètes du monde entier. Partant de son expérience personnelle (l’exil et la séparation) et de celle de son peuple (l’occupation), Darwich ne se contentera pas d’une revendication politique, il fera beaucoup plus en chantant d’une manière lyrique son pays perdu. Pays qui n’est plus simplement la Palestine dont on nous parle tous les jours à la télévision, mais une terre inconnue, une terre de poésie où règnent les mots et l’espoir d’un monde meilleur. De même que Pablo Neruda, dans son « Canto general » ne parle pas seulement du Chili mais de tous les opprimés en général, Darwich, dans son œuvre, nous invite à un voyage vers une terre plus belle, plus humaine, une terre, malheureusement qui n’existe que dans l’univers sacré de la poésie.
Sur le même thème, voir ici.
Les étoiles n’avaient qu’un rôle :
M’apprendre à lire
J’ai une langue dans le ciel
Et sur terre, j’ai une langue
Qui suis-je ? Qui suis-je ?
Je ne veux pas répondre ici
Une étoile pourrait tomber sur son image
La forêt des châtaigniers, me porter de nuit
Vers la voie lactée, et dire
Tu vas demeurer là
Le poème est en haut, et il peut
M’enseigner ce qu’il désire
Ouvrir la fenêtre par exemple
Gérer ma maison entre les légendes
Et il peut m’épouser. Un temps
Et mon père est en bas
Il porte un olivier vieux de mille ans
Qui n’est ni d’Orient, ni d’Occident
Il se repose peut-être des conquérants
Se penche légèrement sur moi
Et me cueille des iris
Le poème s’éloigne
Il pénètre un port de marins qui aiment le vin
Ils ne reviennent jamais à une femme
Et ne gardent regrets, ni nostalgie
Pour quoi que ce soit
Je ne suis pas encore mort d’amour
Mais une mère qui voit le regard de son fils
Dans les œillets, craint qu’il ne blessent le vase
Puis elle pleure pour conjurer l’accident
Et me soustraire aux périls
Que je vive, ici là
Le poème est dans l’entre-deux
Et il peut, des seins d’une jeune fille, éclairer les nuits
D’une pomme, éclairer deux corps
Et par le cri d’un gardénia
Restituer une patrie
Le poème est entre mes mains, et il peut
Gérer les légendes par le travail manuel
Mais j’ai égaré mon âme
Lorsque j’ai trouvé le poème
Et je lui ai demandé
Qui suis-je ?
Qui suis-je ?
10:35 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, mahmoud darwich
10/08/2008
Mahmoud Darwich
""Mais nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir de libération et d'indépendance. Espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros, ni victimes. Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école. Espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé vivant, dans un hôpital, et pas à un enfant mort devant un poste de contrôle militaire. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. Espoir que cette terre retrouvera son nom original : terre d'amour et de paix. Merci pour porter avec nous le fardeau de cet espoir. "
Mahmoud Darwich, poète palestinien, qui s’est éteint samedi à l’âge de 67 ans.
Décidément, ce blogue commence furieusement à ressembler aux pages nécrologiques des quotidiens. Après Soljenitsyne, c’est donc le plus grand poète de langue arabe, en tout cas le plus connu, qui est décédé. Nous avions parlé de lui ici.
De même que l’écrivain russe a d’abord été reconnu pour son opposition au régime de Staline, Darwich l’a été pour son combat contre l’occupation israélienne. Pourtant, l’un comme l’autre sont avant tout des hommes de lettres et leur pensée fut bercée par le souffle des mots. Darwich lui-même, qui pleurait son pays occupé, avait compris à un certain moment que son succès auprès de ses compatriotes palestiniens venait surtout de ses prises de positons politiques (voir le poème « l’Arabe ») alors que lui souhaitait retourner à des chants plus personnels et authentiques : peindre la beauté de sa terre de Galilée. Mais comment, évidemment, chanter cette terre si elle vous a été ravie et si chaque jour de nouvelles colonies viennent grignoter le peu qu’on vous avait laissé ? Comment se taire lorsqu’un mur sépare désormais les habitants d’un même lieu, accordant tout aux uns et rien aux autres et excluant arbitrairement ces derniers du droit de fouler le sol de leurs ancêtres ?
Bien sûr il y a les attentats. Mais pourquoi y a-t-il des attentas ? Le gouvernement israélien devrait le savoir puisque beaucoup de ses ministres historiques en avaient pratiqué eux-mêmes avant 1948 contre l’occupant anglais. Tout est question de succès, évidemment. Nos propres résistants qui faisaient sauter des ponts en 1943 étaient catalogués de terroristes par les Allemands. Ils ne devinrent des héros qu’à la libération.
En attendant, on est loin d’avoir trouvé une solution en Palestine et nos enfants ont beau demander à leurs parents pourquoi Juifs et Arabes ne parviennent pas à s’entendre, ces pauvres parents ne parviennent pas à donner une réponse, tant la situation est complexe. Il y a eu trop de morts de part et d’autres pour que chaque camp puisse oublier.
Et voilà, pour couronner le tout, que le peuple palestinien est maintenant divisé et plonge dans la guerre civile (Hamas/ Fatah) tandis que son plus grand poète vient de quitter définitivement la scène.

23:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, mahmoud darwich
07/08/2008
Soljenitsyne
Dommage d’ouvrir à nouveau ce blog et de devoir commencer par le décès de Soljenitsyne. C’était là assurément ce qu’on appelle un grand écrivain. Ce qui me dérange, cependant, c’est que l’Occident a surtout vu en lui l’opposant au régime communiste et c’est cet homme manifestement qu’il honore aujourd’hui, en insistant bien sur les chants orthodoxes qui sont désormais permis en Russie post-stalinienne.
En réalité, Soljenitsyne était beaucoup plus que cela. D’abord, ce fut un opposant aux régimes dictatoriaux, dont il a dû subir l’injustice. Il se fait que là où il se trouvait ce régime était communiste, mais eût-il été fasciste qu’il se serait indigné de la même façon, ne l’oublions pas.
Car c’est à cela qu’on reconnaît un grand homme, dans le fait qu’il ose s’attaquer seul à des systèmes puissants et surtout dans le fait qu’il reste fidèle toute sa vie à la ligne de conduite qu’il s’est tracée, sans jamais se laisser influencer.
Ensuite, il ne faut pas perdre de vue son génie d’écrivain. Il a fait autre chose que de dénoncer un pouvoir inique (ce qui est déjà beaucoup), il a su en parler en maniant les mots avec dextérité et en agençant son récit de main de maître.
Enfin, c’est quelqu’un qui se penchait avec compassion sur la vie des hommes, dont il a tenté de peindre la destinée dans ses romans. Je pense surtout au « Pavillon des cancéreux », qui constitue un sommet sur la réflexion devant la mort inéluctable qui approche.
Pour terminer, n’oublions pas qu’il se sentait profondément russe et qu’il est retourné vivre dans sa patrie dès qu’il l’a pu. N’en faisons donc pas un chantre du libéralisme, ce qu’il n’était pas. Lui, il luttait pour la dignité humaine, ce qui est un tout autre combat.

00:59 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, soljenitsyne
09/07/2008
Alina Reyes dans La Presse littéraire

Dans la note intitulée « De la fonction poétique », les commentaires vont bon train au sujet du site d’Alina Reyes. C’est l’occasion de citer mon article « Alina Reyes, de l’érotisme à l’esprit » paru dans la presse littéraire n° 15 (juin/juillet/août 2008), consacré essentiellement à son livre « Forêt profonde ».
Quelques explications s’imposent.
Alina Reyes (de son vrai nom Aline Chardonne) est née « quelque part aux confins du Médoc, entre l’Océan et l’estuaire de la Gironde, à « la Fin des Terres » (tout un programme). Elle y grandit en petite sauvageonne, en relation étroite avec la nature et jette déjà sur le monde un regard lucide, tandis que très tôt se manifeste l’éveil sexuel, qui ouvre d’autres portes. »
Ses parents sont communistes et très jeune, alors qu’elle termine ses études de lettres, elle publie « Le Boucher », un roman érotique qui lui ouvre les portes de la littérature mais qui l’enferme aussi dans un genre auquel elle ne veut pas se limiter.
Personnellement, je l’ai découverte voici deux ou trois ans via son blogue et j’ai été tout de suite sensible à ce qu’elle dit de la nature. Elle possède une petite grange restaurée dans les Hautes Pyrénées, où elle se retire de temps à autre, complètement coupée du monde (surtout en hiver) et où elle partage son temps entre les promenades en forêt et l’écriture.
J’ai lu son livre « Moha m’aime », qui s’inspire d’un séjour qu’elle fit au Maroc. Ce roman est plein de sensibilité et traite essentiellement des rapports humains et cela avec beaucoup de pudeur. Elle a publié toute une série d’autres ouvrages qui eurent un succès certain et qui furent traduits en de nombreuses langues.

Puis, en août 2007, vint « Forêt profonde » qui eut peu d’écho auprès de la critique, laquelle préféra privilégier le livre de Yannick Haenel « Cercle ». Mais voilà qu’Alina découvre dans ce roman de Haenel les thèmes fondamentaux de son propre livre. Il semblerait donc que l’éditeur (dont nous tairons charitablement le nom), qui avait eu le manuscrit d’Alina en main, l’eût confié à Haenel qui s’en serait inspiré. Je mets tout au conditionnel, car cette affaire est actuellement devant les tribunaux et la Justice tranchera.
Il m’avait donc semblé opportun de faire sortir «Forêt profonde » de l’ombre en en parlant un peu dans un article selon mes modestes moyens.
C’est un livre que j’ai aimé, qui parle de la vie, de la mémoire et de la nature. C’est aussi un livre qui se veut cathartique pour celle qui l’a écrit (laquelle se remet d’une déception amoureuse). Dans de nombreuses pages, on côtoie la beauté sauvage et celle-ci touche souvent au sacré.

Entre le moment où l’article a été écrit et celui où il a été publié, il s’est passé quelques mois, durant lesquels dame Alina, toujours très prolixe, en a profité pour écrire d’autres livres.
Il y a « La dameuse », qui raconte l’histoire d’un viol (lequel renvoie manifestement au viol symbolique qu’elle a subi avec cette affaire de plagiat). Je n’ai pas encore lu ce livre, mais je le lirai.
Il y a aussi « La jeune fille et la Vierge » sur les apparitions de Lourdes et là, j’avoue que je suis plus. Autant j’apprécie l’analyse du sacré (car la poésie touche au sacré et à l’indicible), autant les références soudaines à un catholicisme pur et dur me dérangent. Elles me dérangent et m’étonnent également car je lisais aussi parfois des articles d’Alina sur le site Bellaciao qui est très clairement laïque et orienté à gauche (ce qui me convenait assez bien). D’où mon étonnement en découvrant le délire mystique dans lequel elle a maintenant plongé. A la limite, moi qui adore les chants grégoriens (ou même en vieux romain) et qui me délecte de Palestrina ou d’Hildegarde Von Bingen, je peux comprendre que le sentiment d’appartenir à la grande nature (et d’être un microcosme dans un microcosme) peut soulager de toutes les angoisses car alors vous n’êtes plus vraiment seul, mais vous devenez un élément du vaste univers, autrement dit vous avez votre place dans le monde.
J’avais cru, tout d’abord, qu’Alina, si proche de la nature sauvage, avait poussé un peu plus loin son expérience et avait atteint une spiritualité qui, ma foi, pour autant qu’elle exalte son monde intérieur, ne pouvait que lui permettre de trouver un équilibre. Malheureusement, il ne s’agit pas de cela et c’est bien des références au catholicisme pur et dur qu’elle nous donne sur son blogue. Moi qui suis athée pour ainsi dire par essence (ma lucidité et mon pessimisme s’accordent mal avec la foi et la croyance en un monde meilleur, dans lequel nous irions folâtrer après notre mort), c’est trop pour moi. Alina, qui est manifestement en pleine crise de je ne sais pas quoi, est en train de se faire récupérer par les mouvements conservateurs. Dommage et je ne reconnais plus vraiment celle qu’on avait baptisée « « la baronne rouge » lors d’un passage chez Pivot.
02:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (60) | Tags : littérature, alina reyes, la presse littéraire
30/06/2008
Du roman poétique
Beaucoup pensent que le genre romanesque s’épuise. Je ne partage pas vraiment leur avis, mais bon, c’est vrai que devant la pléthore habituelle de romans qui va envahir les librairies dans les mois à venir, nous sommes en droit de nous demander si ce n’est pas plus ou moins la même histoire qu’on va nous raconter.
Le roman, disent certains, est mort avec le nouveau roman, quand on a supprimé l’intrigue. Il tenterait aujourd’hui de renaître de ses cendres, mais ce serait surtout pour se concentrer sur les problèmes intimes du romancier (sa vie privée ou bien son incapacité à écrire) beaucoup plus que pour dresser une fresque lucide de notre époque.
L’idée, les idées, ne semblent plus avoir droit de cité dans la littérature proprement dite. Si vous voulez développer des thèmes qui vous sont chers, mieux vaut écrire un essai qu’un roman, surtout si vous êtes sociologue, anthropologue, linguiste ou sémiologue. Un Zola, qui dénonce la cassure sociale, ne semble plus possible aujourd’hui (pourtant, on en aurait bien besoin car nous courons vers l’abîme et le nombre de citoyens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté ne cesse de croître), un Vallès, qui raconte ses expériences révolutionnaires non plus. Même un Balzac serait bien utile, pour dresser un panorama complet de notre société où l’ascension sociale par la richesse est de mise. Hélas, point de Balzac non plus, quant aux Flaubert, Maupassant ou autres Hugo, ils brillent par leur absence.
Pourquoi ? Et bien, je l’ai dit, les citoyens qui pensent doivent s’exprimer dans des essais et non plus dans la littérature. Sartre lui-même n’avait-il pas refusé le Nobel de littérature parce qu’il estimait qu’il n’était pas un écrivain mais un philosophe ? Depuis cette époque le roman semble donc vidé de sa substance et il ne sert plus qu’à raconter des historiettes sans grande envergure.
Dès lors, ne conviendrait-il pas de révolutionner le genre ? Soit en revenant à un contenu qui interpelle, soit en renouant avec le grand style. Pourquoi, par exemple, ne pas imaginer un roman qui serait également poétique ? Une sorte de fresque fondatrice ou initiatique, dans le genre de l’Odyssée ou de l’Enéide ? Après tout, voilà deux livres dans lesquels on raconte des aventures (et quelles aventures !) mais qui sont écrits en vers et dont la formulation est assurément poétique ? Alors, qui nous écrira un roman qui serait aussi un grand poème ? Ce serait peut-être une manière habille de redonner un nouveau souffle à ce genre qui se résume trop souvent à un intarissable bavardage.

02:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (31) | Tags : littérature, roman
28/06/2008
Rentrée littéraire
On apprend avec soulagement qu’il n’y aura que 676 nouveaux romans publiés cette année entre le mois d’août et le mois d’octobre. Même en admettant qu’il y a là-dedans deux mois à 31 jours, cela vous fait tout de même plus de sept romans à lire par jour. Même en ne dormant que quatre heures par nuit et en se contentant d’un sandwich unique à midi, cela va tout de même être dur pour les critiques littéraires. Quand on dit que la vraie littérature ne propose pas que des mots mais qu’elle bouleverse la vie, on n’a jamais aussi bien parlé.

15:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, rentrée littéraire
De la fonction poétique
Pourquoi la fonction poétique ne semble-t-elle plus avoir droit de cité dans notre société ?
On édite peu les poètes, leurs livres se diffusent d’une manière confidentielle et ceux qui les lisent osent à peine avouer en public qu’ils les apprécient. Imaginez-vous, en plein conseil d’administration d’une banque ou dans le bureau de votre directeur du personnel, dire que vous aimez la poésie. On va vous regarder soit comme un dangereux malade, soit comme un utopiste romantique un peu fou dont il convient de se débarrasser au plus vite.
Pourquoi donc la poésie a-t-elle perdu tout crédit officiel ? Les gens sont-ils moins sensibles qu’autrefois ? Je ne le pense pas. Alors ? Est-ce parce qu’elle se situe en dehors du circuit des échanges marchands qui caractérisent notre époque ? Probablement. La poésie est gratuite et esthétique. Elle n’est finalement qu’un jeu sur la langue, mais comme chacun sait, ce jeu peut être contestataire puisqu’il valorise le monde intérieur de l’individu et fort peu l’instinct grégaire du consommateur. A ce titre, la poésie est condamnable et donc condamnée par les boutiquiers qui nous dirigent. D’abord elle inquiète par sa gratuité, notion impensable pour ceux qui font de l’argent avec tout, ensuite elle recherche la beauté afin d’émouvoir, créant des mondes imaginaires qu’il est difficile de faire contrôler par la police d’état. Elevant l’esprit, proposant un univers différent, parallèle, elle inquiète, aussi préfère-t-on la ridiculiser en évoquant un sentimentalisme qu’on qualifie de ridicule.
Et puis ces gens ne pensent qu’à l’argent, argent qui leur permettra d’acheter des objets destinés à paraître (comme si la possession d’un objet pouvait grandir un individu !). Comment pourraient-ils comprendre la poésie, qui elle vise essentiellement l’être et même la profondeur de l’être ?
Comme ce sont eux qui ont le pouvoir, la poésie a donc pris le maquis, c’est sans doute pour cela que vous ne la rencontrez plus.

04:01 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (35) | Tags : littérature, poésie
25/06/2008
Quand un Goncourt devient immortel.
L'écrivain Jean-Christophe Rufin, 55 ans, qui avait obtenu le prix Goncourt en 2001 pour son roman "Rouge Brésil" a été élu jeudi dernier à l'Académie française.
On sait par ailleurs qu’il avait été nommé ambassadeur au Sénégal par Nicolas Sarkozy. C’est curieux, tout de même, le nombre d’écrivains que l’on trouve dans la diplomatie. Ces gens ont-ils du temps libre à revendre et s’ennuient-ils si profondément pendant la saison des moussons ou au cœur des tempêtes de sable, qu’ils sont pour ainsi dire contraints de prendre la plume ? Sont-ce les noms prestigieux de leurs prédécesseurs (Claudel, Saint-John Perse, Giraudoux, Morand), qui les poussent ainsi à écrire ? Ou bien peut-être est-ce que les grandes maisons d’édition sont plus disposées à lire leurs manuscrits… Il est vrai que les timbres exotiques qu’ils ont été contraints d’apposer sur leur enveloppe attirent davantage l’attention, mais les gens réalistes savent qu’il est bien rare qu’un manuscrit envoyé anonymement par la poste soit édité.
Que faut-il penser, alors, de cette capacité d’écriture chez nos grands diplomates ? Ayant parcouru le monde, auraient-ils plus de relations que les autres écrivaillons qui grattent du papier dans un coin perdu de Lozère ou de la Creuse ? Peut-être, mais dire cela, ce serait avouer que le jeu n’est pas égal. Pure médisance de ma part, donc. C’est comme si je vous disais que JC Rufin s’est fait élire à l’Académie parce qu’il avait le soutien de Sarkozy. Allons, ce n’est pas parce que Giscard est devenu immortel qu’il faut en déduire que la carrière politique et la carrière littéraire sont étroitement liées.

02:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, jc rufin
24/06/2008
Citation
"Il est beau de ne pratiquer aucun métier, car un homme libre ne doit pas vivre pour servir autrui."
Aristote
Belle citation, mais difficile à mettre en pratique si on n’est pas né rentier.
16:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature
23/06/2008
Villon, "La belle heaulmière"
Dans le texte de Villon, cité dans la note précédente, il est donc fait allusion à la beauté perdue de la belle heaulmière. Encore faut-il savoir ce qu’est une heaulmière.
Le terme nous semblera plus familier si on supprime la lettre « l » intermédiaire. Heaumière renvoie alors manifestement à heaume, c’est-à-dire au casque porté par les hommes d’armes du Moyen Age. Ce casque enveloppait la tête et le visage et était muni d’ouvertures pour les yeux.
Dans la Chanson de Roland, le terme est orthographié « helme » et vient de l’ancien francique « helm », qui signifie casque (voir allemand et néerlandais actuels). Le mot a été latinisé en helmus au VII° siècle et on le retrouver sous cette forme dans les Gloses de Reichenau.
Pour rappel, les Gloses de Raichenau sont un glossaire de mots romans interprétant des termes de la Vulgate (traduction latine officielle de la Bible) et qui prouve par ailleurs que le latin n’était plus compris puisqu’il fallait le traduire.
Dès lors, si le heaume est un casque, le heaumier désigne la personne qui fabrique ce casque. La heaumerie, quant à elle, renvoie à l’atelier de fabrication et la heaumière est la femme du heaumier .
Ici, Villon fait allusion à une dame qui, à Paris, avait été célèbre pour sa beauté à une certaine époque. Le thème qu’il développe est finalement assez courant : vanité des biens terrestres et égalité de tous devant la mort. Il faut se remettre dans le contexte du Moyen Age pour en saisir toute la portée : d’une part la vie y est précaire (absence de médecine, mortalité élevée, etc.) et d’autre part la religion prédomine tout le mode de pensée. Elle se présente en effet comme une consolation devant la misère ambiante en proposant une vie éternelle en laquelle tout le monde semble croire. Les gens modestes ou frappés par le sort y trouvent donc une sorte de consolation (voire de vengeance) : la mort abolit les différences sociales et traite tout le monde avec égalité. Il s’agit finalement d’une sorte d’idéologie communiste post-mortem, si on y réfléchit bien, l’aspiration à un régime égalitaire, une sorte de Grand Soir qui se concrétisera dans le paradis promis par le Christ.
Mais revenons au texte de Villon. Celui-ci-, habillement, feint de faire parler la belle heaumière, afin de rendre son texte plus vivant et dès lors plus poignant. Elle se révolte contre la vieillesse félonne et regrette de n’avoir pas joui davantage de sa jeunesse. Puis elle passe en revue son corps décrépi et le compare avec son aspect antérieur (« Qu'est devenu ce front poly ces cheveulx blons, sourcilz voultiz »),non sans à l’occasion risquer une pointe érotique (« ces belles levres vermeilles », les seins menus, les hanches bien développées faites pour « tenir amoureuses lisses », le sadinet (ce qui est gracieux, doux, agréable) dans son jardinet au haut des cuisses (qu’en termes galants ces choses-là sont dites…).
Le contraste est saisissant entre la situation d’antan et ce que la belle est devenue. Son front est ridé, le regard rieur qui attirait les marchands est éteint, le visage est pâle, etc. Villon ne se contente donc pas d’une réflexion théorique sur la fuite du temps, mais entre dans des descriptions physiques qui sont plus parlantes qu’un long discours. En agissant de la sorte et en faisant tenir tous les propos par la dame qui a perdu ses attraits, il renforce le côté dramatique de la scène.
De plus, la belle heaumière passe subitement à la première personne du pluriel. Elle ne se plaint donc pas seule mais s’exprime au nom de toutes les femmes, ce qui renforce la teneur de ses propos. La description physique ne concernait que son seul corps (ce corps merveilleux qui avait fait sa réputation), mais la conclusion se veut générale. Il n’y a pas qu’elle qui est touchée par la fuite du temps, mais c’est toute l’humanité qui est concernée.
Les vieilles parlent entre elles de leur passé (« Ainsi le bon temps regretons Entre nous, povres vielles sotes »). Elles ne semblent pas avoir d’autres interlocutrices qu’elles-mêmes, ce qui renforce leur solitude. Ce n’est pas à la jeunesse qu’elle font la morale. Isolées, rejetées peut-être, c’est avec d’autres vieilles qu’elles parlent de leur malheur, constituant ainsi un microcosme de personnes séniles. Cette mise à l’écart sociale renforce une nouvelle fois leur décrépitude.
Villon est donc passé de la description d’un corps jeune et beau à celui d’une ancêtre (sous la forme du monologue de la belle heaumière), puis il a étendu le procédé en imaginant ce dialogue entre les vieilles.
Tout est alors mis en œuvre pour renforcer leur décrépitude et leur malheur. Ainsi elles ne sont pas assises mais sont « à crouppetons » devant le feu. Peut-être faut-il y voir un signe de leur pauvreté matérielle (elles n’ont même plus de chaises) mais peut-être aussi est-ce pour elles une manière de mieux se réchauffer (la mort approchant, leurs membres sont déjà froids). Ce qui est sûr, c’est que leur position a quelque chose de misérable qui tranche avec leur beauté altière d’autrefois. Ramassées en tas, on se demande si elles ont encore forme humaine.
Notons qu’elles ne se réchauffent pas auprès d’un bon feu, mais d’un petit feu de chènevotte (partie ligneuse du chanvre. L’idée est celle de la minceur du matériaux : ce combustible s’enflamme vite mais ne dure pas longtemps).C’est peut-être pour cela qu’il leur faut s’accroupir : pour mieux jouir de cette flamme éphémère. L’idée renvoie à la beauté du corps, tout aussi éphémère que cette flamme. Les vieilles, rassemblées autour de ce feu aussi vite allumé qu’éteint, parlent de leur jeunesse trop tôt évanouie. Nous avons donc un phénomène de mise en abyme, le décor présent étant une métaphore du thème développé.
Par ailleurs, les rimes en « otes » rapprochent « pelotes » et « chenevotes », ce qui renforce encore le côté dramatique de la scène : on insiste d’un côté sur l’aspect éphémère de le jeunesse, tandis que la vieillesse semble s’éterniser dans ce « tas » de vieilles amassées comme pelote, vieilles qui par ailleurs ne parviennent même plus à se réchauffer à ce feu qui ne dure qu’un instant (pas plus qu’elles ne parviennent à se consoler avec leurs souvenirs).
Puis vient ce vers « Et jadis fusmes si mignotes! » qui rappelle d’une manière bouleversante ce qu’elles furent avant d’être devenues ce qu’elles sont. Faut-il y voire une sorte de résignation ? Peut-être. En tout cas le dernier vers «Ainsi emprent à mains et maintes » propose une sorte de consolation. Cette situation qu’elles connaissent concerne en fait tout le monde. Piètre consolation, on en conviendra, mais qui renvoie à une définition du destin commun.
Poème profond et tragique que ce texte de Villon, qui décrit en quelques strophes l’histoire d’un parcours individuel. Dans la poème suivant (« Ballade de la belle Heaumière aux filles de joie), il propose une sorte d’épicurisme : profitez de la vie et des plaisirs du corps pendant qu’il est encore temps car la vieillesse n’est que «monnoie qu'on décrie » .
16:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, villon, la belle heaulmière
21/06/2008
Du temps qui passe, inexorablement
Ainsi donc revoici le solstice d'été, qui nous rappelle, certes, que revient la belle saison, mais aussi que le temps n’en finit pas de s’écouler, inexorablement. Trompeur, celui-ci prend un aspect cyclique, nous donnant l’impression d’accéder à une espèce d’éternité. Illusion, évidemment, car la ligne du temps est linéaire et nous emporte avec elle. Les poètes, même anciens, ne s’y sont pas trompés :
Advis m'est que j'oy regreter
La belle qui fut hëaulmiere,
Soy jeune fille soushaicter
Et parler en telle maniere:
`Ha! viellesse felonne et fiere,
Pourquoi m'as si tost abatue
(…)
"Qu'est devenu ce front poly,
Ces cheveulx blons, sourcilz voultiz,
Grant entroeil, le regart joly,
Dont prenoie les plus soubtilz;
Ce beau nez droit, grant ne petit;
Ces petites joinctes oreilles,
Menton fourchu, cler vis traictiz,
Et ces belles levres vermeilles?
LIII
"Ces gentes espaulles menues;
Ces bras longs et ces mains traictisses;
Petiz tetins, hanches charnues,
Eslevées, propres, faictisses
A tenir amoureuses lisses;
Ces larges rains, ce sadinet
Assis sur grosses fermes cuisses,
Dedens son petit jardinet?
LIV
"Le front ridé, les cheveux gris,
Les sourcilz cheuz, les yeulz estains,
Qui faisoient regars et ris,
Dont mains marchans furent attains;
Nez courbes, de beaulté loingtains;
Oreilles pendans et moussues;
Le vis pally, mort et destains;
Menton froncé, levres peaussues:
LV
"C'est d'umaine beaulté l'yssue!
Les bras cours et les mains contraites,
Les espaulles toutes bossues;
Mamelles, quoy! toutes retraites;
Telles les hanches que les tetes.
Du sadinet, fy! Quant des cuisses,
Cuisses ne sont plus, mais cuissetes,
Grivelées comme saulcisses.
LVI
"Ainsi le bon temps regretons
Entre nous, povres vielles sotes,
Assises bas, à crouppetons,
Tout en ung tas comme pelotes,
A petit feu de chenevotes
Tost allumées, tost estaintes;
Et jadis fusmes si mignotes!
Ainsi emprent à mains et maintes."
François Villon, Le Testament (« Les regrets de la Belle Heaumière »)

Rodin
01:24 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, françois villon
13/06/2008
Flaubert et l'éducation non sentimentale.
Si nous connaissons bien les œuvres des grands écrivains, voire leur vie, il n’en va pas de même en ce qui concerne leurs idées. Bon, bien sûr, nous savons que Jules Vallès n’était pas du même bord que Bernanos, mais en dehors des cas typiques, nous ignorons souvent ce qu’il en est de leurs points de vue politique. Ainsi, dans les notes qui se trouvent en annexe du Dictionnaire philosophique de Flaubert, je trouve ceci, qui ne manque pas d’intérêt :
« Si la France ne passe pas d’ici peu de temps, à l’état critique, je la crois irrévocablement perdue. L’instruction gratuite et obligatoire n’y fera rien – qu’augmenter le nombre des imbéciles (…) Le plus pressé est d’instruire les Riches, qui en sommes sont les plus forts. Eclairez le bourgeois d’abord ! Car il ne sait rien, absolument rien. Tout le rêve de la démocratie est d’élever le prolétaire au niveau de la bêtise du bourgeois. Le rêve est en partie accompli. Il lit les mêmes journaux et a les mêmes passions. »
(Lettre à Georges Sand, 7 octobre 1871).
On notera :
1) l’idée habituelle qui consiste à dire que la situation présente est désespérée et que tout allait bien mieux avant.
2) Le postulat (qui nous semble scandaleux) qui pose comme principe qu’il ne sert à rien d’éduquer le peuple et qu’il faut se concentrer sur les riches.
3) En dehors de ce paradoxe, on pourrait se demander si Flaubert n’avait pas raison, quand on voit la situation aujourd’hui. Les gens modestes ont en effet le droit de faire des études, mais c’est bien le modèle marchand de la bourgeoisie qui prédomine. Quelque part, les critiques de Flaubert à l’encontre du mari d’Emma ou du pharmacien Homais ressemblent à celles que nous formulons à l’encontre de Sarkozy et de ce qu’il représente. Notre écrivain cite même les journaux comme moyen d’abrutissement des masses. Il nous dit en substance que si c’est pour élever le prolétaire au niveau de la mesquinerie bourgeoise, on n’y aura pas gagné grand chose. Finalement, s’il vivait de nos jours, il ne se sentirait pas dépaysé.
15:34 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, flaubert
09/06/2008
Sans nouvelles d'elle (suite et fin)
J’ai patienté pendant un bon mois et puis subitement il m’a semblé que j’avais un urgent besoin de vacances. La valise bouclée en un quart d’heure, j’ai pris l’autoroute du Sud, en direction des Pyrénées. Le soir-même je me trouvais dans un petit hôtel de Collioure. Par la fenêtre ouverte, on entendait le bruit calme et régulier de la mer qui venait mourir sur la plage. Cette rumeur monotone était pour moi comme une présence amie qui m’enveloppait et qui ne me quittait pas. Je pensais aussi que Collioure avait été la patrie du fauvisme et je me demandais ce qu’Yseut aurait bien pu dire sur Matisse. Je suis sorti boire un verre et j’ai flâné dans les rues étroites de la cité. Chaque fois que j’entendais un pas de femme, je me retournais avec l’espoir que ce fût elle. Attitude idiote, évidemment. Comment l’aurais-je reconnue ? Je ne l’avais même jamais vue.
Le lendemain, j’ai repris la voiture et j’ai commencé à gravir les contreforts pyrénéens en suivant les indications du GPS. Puisqu’elle m’avait donné autrefois son adresse, il fallait s’en servir. Arrivé à l’entrée du village, je me suis arrêté un bon moment. Le paysage était magnifique et même époustouflant. Comme il devait être agréable de vivre ici ! Et dire que je n’avais même pas emporté mes pinceaux, c’était un crime. Je commençais à mieux comprendre ce qu’elle me disait et certaines de ses phrases, qui me revenaient en mémoire, prenaient tout leur sens, ici, au milieu de ces montagnes grandioses. C’était un monde minéral dans lequel l’homme se sentait superflu. Pour survivre, il lui fallait donc trouver de bonnes raisons. En même temps, la beauté qui se dégageait de ces pics, le trouble qui vous prenait en contemplant ces gouffres, vous donnait l’impression d’avoir enfin atteint le bout du monde. Après cela, il ne pouvait plus rien exister, cet endroit était le terme où toute vie devait s’achever.
Le temps passait et si je me plongeais ainsi dans des considérations philosophiques, c’était aussi parce que j’avais peur de reprendre mon véhicule et de parcourir le dernier kilomètre qui devait encore me séparer de ma destination. Allons, il fallait bien y aller. J’ai repris le volant et, effectivement, après avoir traversé le village et gravi une pente, je me suis retrouvé sur le sentier signalé dans la fameuse lettre. Une maison, deux maisons, une troisième un peu en retrait, puis plus rien. J’ai encore roulé un peu, au pas, mais me suis vite retrouvé dans un chemin de terre qui semblait se perdre dans la montagne. Je suis sorti de la voiture pour tenter de distinguer quelque chose, mais non, il n’y avait pas d’autres habitations que les trois maisons que j’avais aperçues tout à l’heure. Autour de moi s’étendait la chaîne pyrénéenne, grandiose, majestueuse, silencieuse aussi et pour ainsi dire inhumaine. J’étais là avec mon angoisse de ne pas retrouver Yseut (et ma peur aussi devant la possibilité de la retrouver, il faut bien l’avouer) et je me sentais tout petit et dérisoire devant ces montagnes qui occupaient l’espace jusqu’à l’horizon, m’écrasant de leur masse de pierre et restant complètement insensibles à ma peine. Je crois que je ne me suis jamais senti aussi seul et aussi désemparé. Au-dessus de moi, seule trace de vie dans ce décor, un vautour tournoyait et, se laissant emporter par la seule force du vent, il parvenait à planer indéfiniment sans jamais donner un seul coup d’aile. C’était le dieu des cimes et il était ici chez lui, incroyablement majestueux. La vie, soudain, m’a semblé toute proche de la mort, comme si seule une mince paroi les séparait. Il suffisait, pour s’en convaincre, de contempler cet oiseau au vol superbe et de se rappeler, l’instant d’après, que ce n’était qu’un charognard. Troublé par cette pensée qui brisait mes certitudes, je remontai dans la voiture, fis demi-tour et me laissai descendre jusqu’aux maisons.
L’une portait le numéro 2, l’autre le 3 et la dernière, allez savoir pourquoi, le 7. Comme c’était le 4 que je cherchais et que son absence déclenchait en moi un immense découragement et même une sorte de peur, je suis aller frapper à l’une des portes. Une petite vieille m’ouvrit d’un air soupçonneux et réprobateur. Non, le n° 4 n’avait jamais existé. La commune était passée directement au 7 pour le cas où on construirait un jour sur le terrain disponible, mais ce n’était pas demain que cela arriverait. Le village se vidait, les jeunes partaient vivre en ville et à part quelques touristes qui passaient sur le chemin en été pour faire des randonnées, on ne voyait plus personne. Une nommée Yseut. Bien sûr que non qu’elle n’avait jamais entendu parlé d’elle. Avec un nom étrange comme cela elle ne l’aurait pas oubliée.
Je me suis retrouvé dans la voiture sans trop savoir comment. De grands coups sourds me résonnaient dans la tête et je n’arrivais plus à réfléchir. Je me suis arrêté sur la place du village et je suis entré dans le seul café existant. Il était vide, bien entendu. Quand le patron est entré, il m’a tout de suite dévisagé d’un air soupçonneux, mais alors quand j’ai commandé un cognac, vous n’imaginez pas la tête qu’il a faite ! Comme il restait là à son comptoir en train de m’épier (il avait peur que je lui vole sa bouteille ou quoi ?), je lui ai demandé s’il ne connaissait pas une certaine Yseut, qui se passionnait pour la peinture. D’un ton rauque, il a répondu que s’il y avait eu un peintre dans le patelin, tout le monde l’aurait su, mais que de toute façon ce n’était pas d’artistes qu’ils avaient besoin, les gens d’ici, mais d’un vrai peintre en bâtiment, pour rafraîchir un peu les façades. J’ai payé et sans un mot j’ai regagné la voiture.
La descente vers Collioure fut pénible. Il faisait chaud mais à l’horizon les montagnes étaient dissimulées par une brume blanche qui allait en s’épaississant. Manifestement, un orage se préparait et il promettait d’être violent. Je ne savais que penser. M’avait-elle menti en inventant une fausse adresse ? Savait-elle pertinemment que le numéro quatre n’existait pas ou bien avait-elle inventé un nom de rue au hasard, après avoir pointé un village sur la carte ? Cela ne lui ressemblait pas. Elle s’était montrée trop sincère et trop présente pendant tout le temps qu’avait duré notre correspondance. Avait-elle seulement existé et n’avais-je pas tout inventé ? Mais dans ma poche je sentais la copie de son dernier courriel, ce qui au moins prouvait que je ne devenais pas fou. Il fallait me rendre à l’évidence, mon bon génie avait disparu pour toujours. Un grand vide s’installait en moi, que je ne savais comment combler. Y parviendrais-je jamais ?
Il faisait complètement nuit quand j’ai garé la voiture à proximité de l’hôtel. Les premières gouttes, énormes, commençaient à s’écraser sur le pare-brise. J’étais parqué devant une galerie d’art et instinctivement, j’ai jeté un coup d’œil à la vitrine. Ce que j’ai vu alors m’a laissé sans voix. Bien en évidence, sur un chevalet, se trouvait une toile intitulée « Soleil couchant ». Elle représentait des montagnes avec un petit chemin de terre à l’avant plan. Dans le coin inférieur droit, une touffe de lavande irradiait de tout son éclat. C’est à ce moment que le premier éclair zébra le ciel et que l’éclairage public s’éteignit tout d’un coup. Il me fallut tâtonner dans le noir et raser les murs pour parvenir tant bien que mal jusqu’à l’hôtel. J’étais complètement trempé. Derrière son comptoir, la gardienne de nuit me tendit la clef de la chambre. Elle me dévisagea et, sans rien dire, me sourit d’un air étrange.
L’éclairage de secours donnait aux lieux un caractère insolite, pour ainsi dire fantastique. Bien entendu, l’ascenseur ne fonctionnait plus ! J’ai gravi l’escalier comme j’ai pu et je suis enfin arrivé au bon étage. J’étais exténué et me suis littéralement affalé sur le lit. Ce n’est pas pour cela que j’ai trouvé le sommeil, car des tas d’idées me trottaient en tête. A la lueur d’un éclair, j’ai aperçu mon portable qui traînait sur une table, bien en évidence. Avec un pareil orage, ce n’était pas le moment de l’ouvrir et puis, honnêtement, je n’en avais vraiment plus aucune envie. Ne me demandez pas pourquoi.
22:07 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, nouvelle
08/06/2008
Sans nouvelles d'elle.
Toute ressemblance avec des personnes existantes…
C’est un lundi que j’ai reçu sa première lettre. Etrange. Je ne la connaissais pas mais elle disait qu’elle était passée à la galerie et qu’elle avait apprécié mes peintures. Ma foi, cela fait toujours plaisir, mais j’avais beau faire un effort de mémoire, je ne parvenais pas à me souvenir que quelqu’un fût passé récemment. En fait, je travaille surtout à l’arrière du bâtiment, c’est là que se trouve mon atelier et toutes mes toiles en chantier. Quand un visiteur se présente au magasin, ce qui est assez rare, il faut bien le reconnaître, j’entends la sonnette et je vais jeter un coup d’œil, non sans m’être essuyé les mains au préalable, car la peinture, vous pouvez me croire, cela coule partout. Cette semaine il y avait bien eu quelques copains qui étaient passés et puis Michèle, pour l’exposition à la Cité, mais en dehors de cela, rien. Ma correspondante avait dû entrer et faire sa visite sans que je ne m’aperçoive de rien. Dommage.
Je n’y pensais plus quand j’ai reçu une deuxième lettre. Cette fois, il s’agissait d’une vraie analyse de mes toiles et surtout de celle que j’avais intitulée « Soleil couchant ». Elle y passait tout en revue, le ton des couleurs, les jeux d’ombre, la composition du paysage, les effets produits, et cela dans une missive qui ne faisait pas moins de cinq pages. Diable ! Si les critiques d’art et les journalistes pouvaient être aussi élogieux et surtout aussi bavards, je serais un peu plus connu. Ce n’est pas que je ne le sois pas, mais personnellement les mondanités m’ennuient or, c’est bien connu, pour réussir dans ce milieu, il faut se montrer : aller aux vernissages des collègues, serrer des mains, bavarder avec quelques députés, parler politique avec un ministre, lancer une galanterie à la femme d’un attaché culturel (sans aller trop loin, bien entendu, juste ce qu’il faut pour être sympathique et ne pas se faire oublier). Hélas, toutes ces réceptions m'agacent profondément et je préfère de loin rester seul avec mes pinceaux plutôt que de me gaver de petits fours tout en buvant du Martini.
Tout cela pour dire que si je ne suis pas un inconnu dans mon domaine, loin de là (j’ai tout de même quelques belles expositions à mon actif), je ne suis pas une célébrité non plus. En fait, je suis plus reconnu que connu, voilà la vérité. Il peut certes arriver qu’un critique mentionne mon nom dans un de ses articles, mais c’est plus pour se faire valoir lui, en étalant sa culture, que pour me valoriser en me consacrant une page entière. D’où mon étonnement, il faut bien l’avouer, en recevant cette deuxième lettre, qui constituait une véritable analyse de fond de mon œuvre.
Lorsque arriva le troisième courrier, je dois admettre que je l’attendais et même avec une certaine impatience. Le contenu était semblable au précédent, mais son auteur élargissait le champ de ses investigations à l’ensemble de la peinture contemporaine. Je n’avais jamais rien lu d’aussi percutant et d’aussi captivant. De plus, la dame me donnait son prénom : Yseut (avait-elle son Tristan ?), son adresse (un petit village des Pyrénées orientales) et même son adresse de messagerie (laquelle allait s’avérer fort utile). Ceci dit, comment, habitant si loin de mon antre, avait-elle pu passer par la galerie et voir mes tableaux, ça c’était une véritable énigme. J’avoue, cependant, que je ne me suis pas torturé les méninges avec ce problème : cela faisait partie du mystère général qui entourait Yseut, tout comme ses lettres, sa sagacité d’analyse ou le ton quasi affectueux qu’elle employait sans me connaître. Nous, les artistes, nous sommes comme cela, pas rationnels pour un sous. J’aurais dû me poser des questions ou tout au moins être étonné, mais non, j’acceptais que l’étrange fasse irruption dans mon existence sans me formaliser outre mesure. Il y avait là un petit côté insolite qui n’était pas pour me déplaire et qui, avouons-le, renforçait le charme qui émanait des lettres de la belle Yseut.
Enfin, je ne savais pas du tout si elle était belle, mais je ne pouvais l’imaginer autrement. Et puis je me suis dit que si elle m’avait donné son adresse de messagerie, c’était évidemment pour que je l’utilise. Ne pas le faire aurait été un crime : j’ai donc transmis le soir même un fichier de quatre pages (police Arial 9), dans lesquelles je manifestais mon contentement d’avoir « rencontré » une personne aussi sensible et aussi douée pour parler de la peinture.
Il s’ensuivit une correspondance régulière pendant plusieurs mois. J’écrivais et je recevais au moins deux messages par jour, quand ce n’était pas trois. Les sujets traités tournaient toujours autour de la peinture, mais derrière ce thème, on sentait poindre les questions existentielles. C’est que l’art, il faut bien l’avouer, n’est souvent qu’un moyen d’accéder à autre chose, en l’occurrence une vérité cachée que nous imaginons exister quelque part sans bien savoir où elle se trouve ni même si elle existe. Yseut, elle, ne peignait pas, non, mais elle écrivait. Oh, elle n’était pas publiée, mais on sentait que l’écriture était pour elle un besoin vital et qu’elle constituait pour elle un moyen de se connaître et de connaître le monde. La parole, disait-elle, il n’y a que cela de vrai. Nommer, c’est créer et créer, c’est toucher au divin. Quand elle s’exprimait de la sorte, elle éveillait en moi des échos insoupçonnés. C’est que quelque part, comme tous les peintres qui se respectent, je ne suis finalement qu’un manuel. Je travaille avec mes doigts, je mélange les peintures, je les étale sur la toile, je me bats avec elles et en bout de course, si tout se passe bien, j’arrive à créer un univers, un peu comme un maçon qui parvient à réaliser une maison en partant de rien. Yseut, elle, était davantage dans la réflexion théorique, mais ses mots que je lisais me faisaient découvrir une vérité que je connaissais bien : une vérité enfouie au plus profond de moi, une vérité qui se concrétisait dans mes peintures mais que j’aurais été bien incapable d’exprimer de vive voix.
Enfin, ici, il ne s’agissait pas de parler mais de lire, puisque c’était une correspondance virtuelle que j’avais sous les yeux. C’est cela qui était fascinant en fait. Si j’avais eu Yseut devant moi, il aurait fallu s’exprimer oralement et traduire par des paroles ce monde indicible dans lequel nous pénétrions chaque jour plus avant. Or, cela n’aurait pas été possible, sans que je sache bien pourquoi. Ici au contraire, par la magie des mots, nous parvenions insensiblement à nous dévoiler l’un à l’autre et la peinture ne m’apparaissait plus que comme un prétexte pour atteindre une autre vérité, que je que je qualifierais d’ontique. Comprenez-moi bien, je n’étais pas amoureux d’Yseut, mais ce qu’elle écrivait me renvoyait à une réflexion existentielle. Nous étions deux êtres humains face à face, en train de se demander leur raison d’être sur cette terre. Si nous parlions de nous, c’était moins de nos individualités propres que de notre appartenance à une espèce commune. Nos propos tournaient donc autour du destin et de ce qu’il convient de faire de sa vie. Fallait-il laisser des traces de son passage ? Moi qui en laissais avec mes peintures, j’avais tendance à dire que non et elle qui s’exprimait à travers des mots éphémères, elle affirmait le contraire.
Mais je ne vais pas vous raconter le détail de tous nos échanges, ils furent si longs et si fournis que cela deviendrait fatigant de vouloir les résumer et pour ainsi dire impossible. Tout ce qu’il faut retenir, et vous l’avez déjà compris, je crois, c’est qu’Yseut m’était devenue indispensable. Je vivais à travers ses yeux et tout ce que je réalisais, je le passais inconsciemment au crible de son jugement futur. Ainsi elle m’avait longuement écrit au sujet de ma toile « Soleil couchant », toile dont elle avait analysé les moindres détails, surtout la touffe de lavande dont on devinait les pourtours à l’avant plan. Et bien, croyez-le ou pas, dans les autres toiles que j’ai peintes depuis, j’ai chaque fois inséré cette touffe de lavande, dans laquelle elle voyait comme la quintessence du monde (des couleurs atténuées par le crépuscule et une senteur bien réelle mais qu’on ne faisait qu’imaginer à partir de la toile). Cette lavande représentait pour elle la vérité dissimulée qu’il importait de conquérir.
Elle me faisait aussi lire les poètes, que je croyais pourtant connaître mais que j’ai redécouverts à travers ses commentaires. Baudelaire, bien sûr, mais aussi Rimbaud et Jaccottet. A la fin, je ne peignais plus en reproduisant la réalité que je voyais mais en m’inspirant des poèmes qu’elle m’avait fait lire. On pouvait dire que j’étais sous son influence mais le contraire était vrai aussi. Je lui parlais de peintres dont elle ignorait à peu près tout et elle se documentait à leur sujet, avant de les aborder dans ses longs et judicieux commentaires.
Nous en étions là dans ce qu’il convient d’appeler notre relation quand un jour, sans raison, je ne reçus aucun message. J’en fus étonné, mais pas vraiment inquiet. Après tout, je ne savais pas grand chose de sa vie et elle pouvait fort bien avoir eu un empêchement. Les jours suivants, ce fut le même silence et aucune réponse ne me parvint malgré les nombreux courriels que je m’étais mis à lui envoyer. Là, il se passait vraiment quelque chose d’anormal. Après une semaine, j’écrivis à Google, puisque son adresse de messagerie était sur Gmail.com. Or voilà qu’on me disait qu’il n’y avait rien sous son nom, absolument rien, aucune archive, le vide. Ma chère Yseut s’était volatilisée. J’eus beau envoyer des copies de mes anciens courriels, avec son pseudo et son adresse mail, ils ont tout vérifié, il ne subsistait aucune trace.
(à suivre)

00:44 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, nouvelle
07/06/2008
Sur les "fautes" de Flaubert
Flaubert, on le sait, est un homme qui travaillait et retravaillait ses textes. Jamais content de la forme obtenue, il raturait, puis raturait encore. Après ce labeur épuisant, il se mettait à déclamer sa prose tout haut, en hurlant dans ce qu’il appelait son « gueuloir ». C’est à l’épreuve de l’oralité qu’il décidait si le rythme et la musicalité de ses phrases étaient satisfaisants.
Pour Flaubert, comme pour Maupassant d’ailleurs, il n’y a qu’une bonne façon de dire une chose. Mais si l’écrivain qu’il était se devait de trouver le mot juste, il ne pouvait pas toucher à la syntaxe. Celle-ci, immuable, appartient à la collectivité. Selon cette conception, l’écrivain est un homme qui maîtrise à la perfection la langue commune.
Le problème commence lorsque cet écrivain se permet une déviance. Emploie-t-il un terme avec une acceptation un peu particulière ou trouve-t-il une tournure quelque peu singulière, qui s’écarte de la norme habituelle, et aussitôt lecteur est sur ses gardes. La liberté d’un écrivain comme Flaubert s’arrête là. Il peut jouer avec la langue, mais il ne peut jamais aller trop loin. Voilà donc sans doute pourquoi Flaubert raturait à l’infini. C’est qu’il était persuadé qu’il n’y avait qu’une manière de tourner sa phrase afin que celle-ci exprimât au mieux sa pensée. Plus tard, au contraire, des écrivains comme Proust penseront qu’ils peuvent utiliser la syntaxe comme moyen de singulariser leur style, de le rendre unique et donc d’affirmer leur personnalité via leur style propre.
Puis, voilà qu’en 1919 survient un débat qui a embrasé le pays et qui concernait les « fautes » de Flaubert. Ce fut une révolution. Subitement on semblait se rendre compte que ces grands écrivains qu’on avait toujours admirés n’avaient pas toujours respecté scrupuleusement les normes grammaticales. Ils s’étaient permis des écarts que les élèves des lycées ne se permettraient pas. Ils avaient donc trahi la langue et dès lors ils ne pouvaient plus être ceux qui en garantissaient la pureté. Ce fut un choc.
D’un autre côté, quelqu’un comme Proust défendra Flaubert, en disant que ses « fautes » étaient voulues et qu’il s’agissait en fait pour lui de se forger un style propre. C’est donc le rapport à l’écriture s’est modifié ainsi que le rapport entre la grammaire et la littérature. On ne demande plus à l’écrivain de respecter les normes mais d’être original. Il lui faut donc explorer les possibilités de la grammaire plutôt que de la respecter.
C’est ce problème qui est analysé dans mon article « Sur les fautes de Flaubert » paru dans La Presse littéraire.
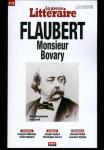
01:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, flaubert
06/06/2008
Flaubert et son dictionnaire (suite et fin)
Mer : n’a pas de fond. Image de l’infini. Donne de grandes pensées.
Mercure : tue la maladie et le malade.
Minuit : limite du labeur et des plaisirs honnêtes. Tout ce que l’on fait au-delà est immoral.
Moulin : fait bien dans un paysage.
Moustique : plus dangereux que n’importe quelle bête féroce.
Musique : adoucit les mœurs. Exemple : la Marseillaise.
Oasis : auberge dans le désert.
Optimiste : équivalent d’imbécile.
Ouvrier : toujours honnête quand il ne fait pas d’émeutes.
Poésie (la) : est tout à fait inutile. Passée de mode.
Pucelle : ne s’emploie que pour Jeanne d’Arc et avec Orléans.
Rime : ne s’accorde jamais avec la raison.
15:57 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, flaubert, dictionnaire des idées reçues
05/06/2008
Flaubert et son dictionnaire
Pour agrémenter notre journée, voici quelques citations extraites du Dictionnaire des idées reçues de Flaubert.
Bible : le plus ancien livre du monde.
Bouchers : sont terribles en temps de Révolution.
Epoque (la nôtre) : tonner contre elle. Se plaindre de ce qu’elle n’est pas poétique. L’appeler époque de transition, de décadence.
Etagère : indispensable chez une jolie femme.
Facture: toujours trop élevée.
Faubourgs : terribles dans les Révolutions.
Gothique : style d’architecture portant plus à la Religion que les autres.
Hippocrate : on doit toujours le citer en latin, parce qu’il écrivait en grec.
Homère : n’a jamais existé. Célèbre par sa façon de rire.
Hystérie : la confondre avec la nymphomanie.
Idéal : tout à fait inutile.
Imbéciles : ceux qui ne pensent pas comme vous.
Imprimerie : découverte merveilleuse. – A fait plus de mal que de bien.
Littérature : occupation des oisifs.
Livre : quel qu’il soit, toujours trop long.

Par ailleurs, si vous aimez ce genre de réflexions courtes et incisives, faites un tour par le blogue de Bertrand Redonnet, vous ne le regretterez pas.
22:43 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, flaubert
01/06/2008
Dominique Autié
J’apprends avec tristesse la disparition, à 59 ans, de Dominique Autié (voir blogue en lien ici à droite). Homme du Nord venu s’établir à Toulouse, il aura consacré sa vie au livre. Fils et petits-fils d’ouvriers typographes, éditeur, il avait dirigé les éditions Privat avant de fonder sa propre maison (InTexte), avec sa compagne Sylvie Astorg.
Comme auteur, il avait publié des essais (Approches de Roger Caillois, Privat) puis des romans (Le clavier bien tempéré et surtout Le Bec dans l’eau aux éditions Phébus).
Personnellement, c’est comme blogueur que je l’ai connu. Son site a toujours été d’une grande qualité et s’il ne répondait pas forcément aux commentaires qu’il m’est arrivé de laisser (avec parcimonie, car je ne voulais point rompre le charme qui émanait de ses textes), il lui arrivait souvent d’envoyer un petit mot en privé, remerciant avec gentillesse qu’on ait bien voulu le lire et réfléchir à ses paroles.
Pour lui, la place de l’éditeur était sur Internet, cela ne faisait pas l’ombre d‘un doute.
Outre le livre qu’il m’avait un jour envoyé (« La ligne de Sceaux »), j’ai surtout apprécié ses commentaires sur la grotte de Gargas. C’était un amoureux des livres, non seulement de leur contenu, mais aussi de tout ce qu’ils représentent. D’un tel homme on peut dire assurément que c’était un esthète.
Il a contribué à la parution de L’Ensemble conventuel des Jacobins de Toulouse de Maurice Prin, livre qui lui tenait autant à cœur que la restauration du site lui-même. Il adorait comme moi la défunte collection zodiaque, consacrée entre autre à l’art roman. C’était un mystique dans le sens où il savait ce que le terme sacré voulait dire, en art comme dans la vie. Moi qui suis athée, il m’est arrivé de me laisser porter par ses commentaires sur la lecture de la bible, trouvant dans ses mots comme un apaisement. C’est qu’il était à la recherche de plus de vérité.
Il était aussi formateur en BTS édition et en Master à l’université de Toulouse-Le Mirail.
Dominique, je ne sais assurément pas où tu peux bien être maintenant, mais ce qui est sûr c’est que tu nous manqueras, toi et ton blogue, dans lequel on n’entrait que sur la pointe des pieds, comme dans les anciennes bibliothèques.

23:43 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature, dominique autié
11/05/2008
Quand le poète parle de la mort
"On voudrait, pour ce pas qu’il doit franchir
-si l’on peut parler de franchir
là où la passerelle semble interrompue
et l’autre rive prise dans la brume
ou elle-même brume, ou pire : abîme-
dans ce vent barbelé,
l’envelopper, meurtri comme il est, de musique…"
Jaccottet, Plaintes sur un compagnon mort.
Belle description de la mort qui approche (« pas qu’il doit franchir »). Obligation inéluctable, donc, à laquelle on ne peut se soustraire. L’idée est celle, classique d’un passage (passerelle), mais cette idée-même est aussitôt mise en doute : il n’y a qu’une demi passerelle et de l’autre rive, on ne distingue rien car elle est dans la brume. Le poète insiste donc bien sur l’incertitude de ce qu’il y a « au-delà ». C’est un pays dont nous ne connaissons rien, puisque nous n’en distinguons aucun détail. Il nous faut portant y aller. De la rencontre de cette obligation et de cette absence de connaissance, naît l’angoisse.
Loin de nous rassurer, Jaccottet poursuit la logique de son raisonnement. Non seulement nous ne distinguons rien de cette rive, mais en plus elle est peut-être elle-même brume. Autrement dit, elle ne serait même pas un pays inconnu qu’on ne parvient pas à discerner, mais serait en fait elle-même néant. Rien de rassurant, donc, pour le voyageur qui se trouve engagé sur la passerelle…
Comme si cela ne suffisait pas, le poète continue : non pas brume, mais abîme. De l’inconsistant nous passons au gouffre sans fond qui s’ouvre sous nos pas. Du néant, nous passons à l’abîme qui nous engloutit, nous précipitant dans une chute sans fin.
S’il y a éternité, elle est dans ce plongeon qui n’en finit pas de nous anéantir.
La seule solution, le seul remède, c’est la musique. De même que le jour éclaire finalement les vallées les plus profondes, la musique, cet « écho de l’inouï », finit par nous faire oublier notre malheur d’être mortels en nous enveloppant dans un monde de sons mélodieux. Illusion sans doute, mais peut-être pas :
"Vous, lentes voix qui nouez et dénouez
Dans le ciel intérieur,
Si vous ne mentez pas, enlevez-le dans vos mailles
Plus limpides que celles de la lumière sur les eaux."
Jaccottet parle-t-il du chant funèbre qui accompagne le défunt ou de la musique intérieure qui a accompagné l’agonisant actuel tout au long de sa vie ? Je pencherais pour la deuxième solution. Cette musique intérieure qui est tout notre être devrait continuer à nous porter jusqu’à l’ultime souffle, niant du même coup la mort ou nous la faisant aborder avec une certaine sérénité puisque seul compte notre être que nous continuons d’affirmer au seuil même du néant.
01:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, jaccottet
07/05/2008
Ecrire?

Parler est facile, et tracer des mots sur la page,
en règle générale, est risquer peu de choses :
un ouvrage de dentellière, calfeutré,
paisible
(…)
Aussi arrive-t-il qu’on prenne ce jeu en horreur
qu’on ne comprenne plus ce qu’on a voulu faire
en y jouant, au lieu de se risquer dehors
et de faire meilleur usage de ses mains.
Cela,
c’est quand on ne peut plus se dérober à la douleur ,
qu’elle ressemble à quelqu’un qui approche (…)
Parler alors semble mensonge , ou pire : lâche
insulte à la douleur, et gaspillage
du peu de temps et de forces qui nous reste
Philippe Jaccottet, « Chants d’en bas », Parler.
16:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, jaccottet
23/04/2008
Défense de Césaire
Nous avons déjà parlé longuement de Césaire et je ne croyais plus y revenir. Cependant, en lisant le texte qui lui est consacré sur le blogue littéraire le plus lu de Hautetfort, je ne puis m’empêcher de réagir, tant il semblerait que le combat mené par le poète martiniquais est loin d'avoir porté tous les fruits qu'on escomptait et que lui-même comme ses idées doivent encore être défendus.
Selon cet article, Césaire, en revendiquant sa négritude, n’aurait fait que suivre l’air du temps, en l’occurrence la théorie nazie sur l’importance de la race. En bon opportuniste, il aurait profité de la décolonisation qui a suivi la guerre pour afficher son nationalisme. On parle de « la lourdeur de sa plume, la pauvreté de son inspiration et la redondance de ses thématiques » tout en signalant que sa révolte est bien modeste si on la compare à l’action menée par Fidel Castro. Cette dernière remarque politique n’est pas entièrement dénuée de fondement, Césaire n’ayant pas proclamé l’indépendance de son île (ceci dit, il état maire d’une commune, pas dirigeant suprême) mais elle fait sourire quand on sait que le site littéraire en question a généralement pour habitude de fustiger la révolution castriste qu’il prend ici comme modèle.
Plus loin, on nous redit ce que l’on savait déjà, à savoir que ce sont les deux vainqueurs de la guerre 40-45 qui ont plus ou moins obligé les puissances européennes à liquider leurs colonies dans le but, soit d’ouvrir de nouveaux marchés à leurs propres produits (USA), soit d’agrandir leur espace idéologique (Russie). Ceci étant dit, on ne comprend pas :
- pourquoi ce même site littéraire voue habituellement une admiration sans bornes aux Etats-Unis alors qu’il est le premier à reconnaître que ce pays a une bien curieuse conception de l’amitié en faisant passer ses intérêts économiques avant toute chose. Il est vrai que c’est surtout Moscou qui est ici accusé d’aller inciter nos anciennes colonies à la révolte. Il faut bien, dans cette histoire, qu’il y ait un méchant et un bouc émissaire et je me réjouis que l’auteur de l’article ait lu René Girard.
- Pourquoi on passe sous silence le rôle des populations indigènes elles-mêmes, qui ont cependant largement contribué à leur émancipation. Que je sache, ce n’est pas pour rien qu’on a parlé de guerre en Algérie et je ne sais pas ce que diraient les Algériens si on leur disait qu’ils n’ont pris aucune part à leur indépendance.
Poursuivons. Nous apprenons ensuite que Césaire ne fut qu’un bourgeois qui n’était pas prêt à sacrifier son train de vie à son idéal d’indépendance (c’est curieux, je croyais que ce terme de « bourgeois » était habituellement employé dans la dialectique marxiste et voilà que nos « amis » de droite se l’approprient)
« Profitant des subsides de l’État français, il détournera pendant plus d’un demi-siècle cette manne financière contre le pays qui l’a élevé, éduqué et nourri »
On croit rêver. Même au temps du colonialisme le plus dur on a rarement vu des propos aussi outranciers et haineux. Cela se passe de commentaires. Quant au fait que l’Etat français a ouvert ses écoles aux indigènes et a permis précisément cette prise de conscience nationaliste parmi les diplômés, je crois surtout qu’il faut s’en réjouir et y voir un bienfait de l’égalité républicaine plutôt que de venir fustiger ceux qui se sont révoltés. De plus, s’agissant de Césaire, on ne peut pas dire qu’on avait affaire à un terroriste sanguinaire mais plutôt à un homme de grande culture et de grande modération, qui a compris, précisément, ce que son pays avait à gagner à rester français tout en affichant fièrement sa singularité. Et quoi ? Césaire aurait dû prendre les armes et proclamer l’indépendance de son île ? Celle-ci serait aujourd’hui sous la coupe des Etats-Unis et je ne vois pas ce que l’on y aurait gagné.
L’article se termine en affirmant que « Césaire et sa négritude ont été récupérés à d’autres fins. Ce n’est pas un hasard si, de la gauche affairiste à la droite mercantile, l’hommage à Césaire rivalise de grandiloquence avec le culte stalinien de la personnalité. » Là, il faudrait voir s’il n’y a pas un fond de vérité. Moi-même j’ai ironisé sur la présence, aux obsèques, de la gauche et de la droite pour une fois réunies dans une fausse fraternité de façade.
Il se pourrait bien que le grand capital mondial continue son combat contre le colonialisme (et les protectorats qu’il a créés) en rappelant quand il faut aux Martiniquais qu’ils auraient pu être indépendants et aux Français qu’ils ont été d’affreux colonisateurs, le but de tout ceci étant de casser les échanges économiques privilégiés qui se font classiquement entre l’ancienne colonie et sa métropole. Mais au lieu de fustiger ce néocapitalisme, l’article déplore une volonté de « métissage de l’Europe », renouant sans s’en rendre compte avec une identité raciale qu’il convient de condamner fermement et reproduisant inconsciemment les thèses qu’il reprochait lui-même (à tort) à Césaire dix lignes plus haut. Bref, quand un Martiniquais revendique sa négritude, c’est un nazi, mais quand un Français accepte le métissage, c’est un traître qui renonce au prestige de sa race. Il faut savoir ! En attendant, on se croirait revenu dans la période d’avant la guerre, et si je ne me trompe c’est bien comme cela que l’on a commencé avant d’imposer l’Etoile jaune à certains.
Ce que l’on regrette, dans cet article, c’est que Césaire ne soit point resté un noir inculte et soumis, baissant la tête devant le prestige de ces hommes blancs venus de France qui ont daigné lui apporter au compte-gouttes les bienfaits leur civilisation. Comme théorie réactionnaire on ne fait pas mieux. La seule chose qu’il y a à espérer, c’est que ces horreurs ont été écrites dans le seul but de se singulariser et de se faire remarquer en choquant la galerie. Par contre si les vérités ici exposées reflètent l’opinion de leur auteur, il n’y a plus grand chose à espérer de l’humanité.
Pour conclure, je voudrais faire parler Césaire lui-même en reprenant quelques extraits de son Discours sur le colonialisme, publié en 1950 :
« Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que, chaque fois qu'il y a eu au Viêt-nam une tête coupée et un oeil crevé et qu'en France on accepte, une fillette violée et qu'en France on accepte, un Malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et "interrogés", de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette lactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe, et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent.
Et alors un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour : les gestapos s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. »
(…)
« Entre colonisateur et colonisé, il n'y a de place que pour la corvée, l'intimidation, la pression, la police, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie, des élites décérébrées, des masses avilies.
Aucun contact humain, mais des rapports de domination et de soumission qui transforment l'homme colonisateur en pion, en adjudant, en garde-chiourne, en chicote et l'homme indigène en instrument de production.
A mon tour de poser une équation : colonisation = chosification.
J'entends la tempête. On me parle de progrès, de "réalisations", de maladies guéries, de niveaux de vie élevés au-dessus d'eux-mêmes.
Moi, je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, des cultures piétinées, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificences artistiques anéanties, d'extraordinaires possibilités supprimées.
On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, de chemin de fer.
Moi, je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux qui, à l'heure où j'écris, sont en train de creuser à la main le port d'Abidjan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leurs dieux, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse.
Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme.
On m'en donne plein la vue de tonnage de coton ou de cacao exporté, d'hectares d'oliviers ou de vignes plantés.
Moi, je parle d'économies naturelles, d'économies harmonieuses et viables, d'économies à la mesure de l'homme indigène désorganisées, de cultures vivrières détruites, de sous-alimentation installée, de développement agricole orienté selon le seul bénéfice des métropoles, de rafles de produits, de rafles de matières premières. »

22:09 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : littérature, césaire, colonialisme, néocapitalisme
16/04/2008
Aimé Césaire
On apprend qu’Aimé Césaire, né en juin 1913, a été hospitalisé pour des problèmes cardiaques jugés très sérieux. A 95 ans, il ne faut plus espérer grand chose. Ce grand classique, en fait, appartient déjà au monde immortel de la littérature. Il aura tout connu : la colonisation mais aussi la possibilité de faire des études en France. C’est à cette époque qu’il se liera d’amitié avec Léopold Sédar Senghor, avec qui il inventera le mot « négritude », donnant ainsi naissance à un courant littéraire original hors de France. Maire de Fort-de-France, il a ensuite forgé le mot « départementalisation », pour remplacer le mot ambigu d'« assimilation ».
Le paradoxe, évidemment, c’est qu’il a assimilé mieux que d’autres la civilisation française, de par ses études, mais une fois son diplôme en poche, il utilise son instruction à promouvoir la culture de son peuple : tous ces anciens esclaves venus d’Afrique et oubliés par l’Histoire. On ne peut que se réjouir de cette réaction, qui visait d’une part à lutter contre la colonisation (surtout l’action culturelle beaucoup plus que politique) et d’autre part à redonner une dignité humaine à ses concitoyens. Il est parvenu à dépasser une vision raciale du monde (risque dans lequel il aurait pu tomber : voir la Serbie et les Balkans en général) et a toujours clamé qu’il était « de la race de ceux qu’on opprime ». Voilà qui est joli et qui nous prouve que la culture et la littérature ont manifestement un rôle à jouer dans notre univers qui ressemble à une jungle.
Quand il rentre en Martinique en 1930, il n’y a pas de littérature martiniquaise ou alors elle intériorise le regard exotique que le colonisateur peut porter sue l’île. Aussi, quand il publie en 1939 Cahier d'un retour au pays natal , l’œuvre est remarquée parce que remarquable :
« Au bout du petit matin, une autre petite maison qui sent très mauvais dans une rue très étroite, une maison minuscule qui abrite en ses entrailles de bois pourri des dizaines de rats et la turbulence de mes six frères et soeurs, une petite maison cruelle dont l'intransigeance affole nos fins de mois et mon père fantasque grignoté d'une seule misère, je n'ai jamais su laquelle, qu'une imprévisible sorcellerie assoupit en mélancolique tendresse ou exalte en hautes flammes de colère; et ma mère dont les jambes pour notre faim inlassable pédalent, pédalent de jour, de nuit, je suis même réveillé la nuit par ces jambes inlassables qui pédalent la nuit et la morsure âpre dans la chair molle de la nuit d'une Singer que ma mère pédale, pédale pour notre faim et de jour et de nuit. »
Plus tard il rencontrera Breton et certaines de ses œuvres seront préfacées par Sartre. Lui, il œuvre pour que son île soit dirigée par les Antillais et non d’office par les descendants des colons. Ceci dit, il ne réclame pas encore l’indépendance comme le fait le Viêt-Nam ou l’Algérie à cette époque, ce qui lui vaudra la réserve des partis de gauche indépendantistes (lui qui était pourtant sur les listes communistes). Plus tard il prendra ses distances avec le PCF et créera son propre parti, revendiquant alors l’autonomie.
Il a encore fait parler de lui récemment, en s’opposant à la Loi du 23 février 2005, laquelle consacrait le côté positif de la colonisation. Il avait aussi refusé de recevoir Nicolas Sarkozy, ce qui nous le rend bien évidemment sympathique. Ceci dit, il l’a fait l’année suivante, estimant qu’il faudrait attendre et juger le Président sur son oeuvre.

11:44 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, aimé césaire, négritude
02/04/2008
De l'équilibre intérieur (2)
Nous parlions l’autre jour de l’équilibre intérieur, qu’il est primordial de préserver, même s’il faut pour cela se tenir parfois à l’écart de la rumeur du monde.
Je dis cela, certes, mais on comprend bien que si on pousse une telle attitude à l’extrême, on se retrouve dans la philosophie extrême-orientale, où le Maître s’abîme dans la contemplation, restant indifférent à tout ce qui l’entoure. Cette « sagesse », qui en est certainement une, m’a toujours semblé inquiétante, car entre le fait de savoir conserver son calme et l’ataraxie la plus complète, il y a une marge. Cette philosophie qui est aussi une religion (méfiance donc) consiste à se détacher du monde pour ne pas souffrir. Tout lui devenant indifférent, le sage, en effet, ne souffre plus. Mais vit-il encore ? Ce qui est pour certains de la sagesse, peut confiner aussi à la bêtise la plus complète, car au nom de l’indifférence on finit par accepter (ou plus exactement par refuser de voir) les injustices ambiantes.
Donc, personnellement, je me suis toujours montré très réservé face à cette sagesse hindoue ou bouddhique. Je préfère une attitude lucide devant l’adversité (et donc devant notre condition mortelle). Cependant, le bruit et la fureur du monde risquent bien de nous détourner de cette vision essentielle. Le travail, la famille, l’actualité, tout ce que nous vivons (mais est-ce vivre ou tenir des rôles ?) nous occupe l’esprit en permanence. Mais qu’est-ce que vivre, finalement ? Telle est la question, comme disait un certain dramaturge anglais. Philosopher dans sa chambre, ce n’est pas vivre, mais être submergé par les tâches ménagères et les difficultés financière non plus. Il est clair que si je suis un réfugié subsaharien en exil à Paris ou ailleurs, je ne penserai qu’à ma survie matérielle, déjà bien content d’avoir échappé à la mort au cours d’une traversée maritime des plus dangereuses. Prêt à travailler quinze heures par jours, je cumulerai les petits boulots pour faire vivre ma famille, ce qui me laissera peu de loisirs pour apprécier les subtilités de la « Recherche du temps perdu ». A l’inverse, si je suis un fils de famille qui a tout reçu et que je n’ai même pas à gérer une fortune que des spécialistes gèrent pour moi, le loisir forcé où je me trouverai risque d’être bien stérile ou futile. Il faut donc un équilibre entre les deux situations. Point trop occupé par les tâches matérielles (mais un petit peu tout de même), il me faut du temps libre pour pouvoir le consacrer à ce qui m’intéresse vraiment, par exemple à la lecture. Ce temps libre, Montaigne l’avait ou se le donnait. Il avait hérité de son château et il dit quelque part dans les Essais qu’il ne lui sert à rien de vouloir amasser de l’argent, même en prévision de l’adversité (puisque cet argent risquerait bien, de toute façon, de ne pas suffire) et qu’il préfère jouir de sa fortune en voyageant. Ce qui ne l’a pas empêché de travailler au Parlement de Bordeaux, mais il faut sans doute voir là l’attrait d’une fonction honorifique un peu obligée plutôt que la recherche d’un travail rémunérateur. Car il est vrai que dans les siècles passés, pas mal de nos grands écrivains étaient fortunés, ce qui leur laissait le loisir d’écrire. J’ai cité Montaigne, on pourrait citer Proust ou Gide. Cela signifie qu’il faut avoir du temps pour se retirer, observer et être en dehors du monde.
D’une manière générale, j’aime bien ce décalage, qui me permet certes d’être dans l’action, mais en même temps un petit peu à côté. J’observe, je réfléchis, je prends du recul. D’autres préfèrent diriger, prendre les difficultés à bras le corps et agir. Peu importe ce qu’ils décident, à la limite, tant que ce soit eux qui aient pris la décision et qu’ils aient fait figure de chefs. Le sens de leur vie est là : dans le regard des autres, où ils peuvent lire qu’ils sont d’une race supérieure et à ce titre admirés. Belle illusion, évidemment, mais comme ils ont agi, ils sont contents.
A l’inverse, philosopher dans sa chambre n’amène certainement à rien non plus. De tels penseurs, coupés du monde et de ses réalités, finissent par vous développer des systèmes philosophiques certes cohérents sur le plan intellectuel, mais qui ne sont qu’une simple vue de l’esprit. Sans doute par cette « création » d’un système croient-ils avoir trouvé une échappatoire. Dommage pour eux, la mort les attend au bout de chemin comme les autres.
La difficulté consiste donc à se tenir suffisamment éloigné des événements extérieurs pour ne pas se perdre en eux, mais tout en les tenant du coin de l’œil, car il ne faut pas ignorer leur existence. Le nec plus ultra consisterait à parvenir à imposer aux événements extérieurs sa propre vision du monde et à transformer la réalité selon ses rêves. Bien peu y arrivent, on en conviendra.
Dans un tel contexte, décrire le monde tel qu’il est par l’intermédiaire d’une oeuvre d’art (peinture, sculpture, littérature, film, etc.) constitue sans doute un bon équilibre entre cette lucidité devant la vie et l’affirmation de sa propre vision des choses. Tout semble en effet se situer dans ce mouvement perpétuel de va-et-vient entre le monde et moi, entre la réalité et mon rêve.
Ce rêve, il me faut le cultiver et d’abord en le préservant. Il faut savoir s’arrêter de temps à autre (ce que hélas, pas plus que d’autres, je n’arrive que rarement à faire) et écouter la voix du monde qui est en moi (et non en dehors de moi) car finalement je suis un monde à moi tout seul, je suis mon monde. Point de narcissisme quand je dis cela, mais plutôt la recherche d’une vision intérieure. Ecouter du Palestrina ou les hymnes d’Hildegarde von Bingen y contribuera grandement, à la fois par l’architecture musicale mise en œuvre et par la spiritualité qui s’en dégage et qui ne déplaît certes pas à l’athée que je suis. Ensuite, réconforté, je pourrai de nouveau ouvrir les yeux autour de moi. 
00:58 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature, vie intérieure, hildegarde von bingen
31/03/2008
De l'équilibre intérieur
Il est des jours où l’agitation du monde vous semble dérisoire. A quoi bon faire le compte de toutes les injustices dont les informations nous abreuvent ? Il n’y aura jamais la paix en Palestine, le Tibet restera chinois et l’Irak continuera de se dissoudre dans une guerre civile fratricide pour le plus grand profit des marchands de pétrole (et nous en savons quelque chose quand nous passons à la pompe avec nos voitures : c’est notre manière à nous de contribuer à l’effort de guerre, même si nous condamnons farouchement cette dernière).
Plus près de nous, il y aura toujours des politiciens véreux, qui pensent plus à leur profit qu’à la gestion des affaires publiques. Et même s’il y en a quelques-uns d’honnêtes, nous savons tous qu’ils sont obligés d’entrer dans un système qui repose sur la duperie et le mensonge.
Nous aurons bon clamer haut et fort contre le libéralisme triomphant qui affame chaque jour un peu plus nos voisins immédiats, cela ne changera rien. Le combat est perdu d’avance, l’économie étant devenue mondiale. Ou votre pays fait de la résistance et il se fait manger, n’étant pas compétitif ou il approuve le nouvel ordre du monde et c’est vous, en tant que citoyen, qui vous faites manger (par exemple en devant payer une facture de gaz trente pour cent plus chère).
Donc, disais-je il est des jours où on a envie d’oublier tout cela et où on préfère plutôt se replier sur sa propre personne, non par souci d’égoïsme, mais simplement parce qu’on n’a qu’une vie et qu’elle est courte.
Que m’importe, finalement la marche du monde ? Seul compte le regard que je porte sur moi-même et l’équilibre que je peux ainsi trouver. C’est pour cela qu’un écrivain comme Montaigne est un ami précieux. Il sait d’abord parler de lui. Si par ailleurs il regarde le monde d’un esprit lucide, il le fait sans se départir de son bon sens habituel, sachant prendre certaines distances qui lui permettent de conserver son équilibre intérieur. C’est là une qualité rare, par les temps qui courent.
La poésie, à ce propos, me semble préférable au roman pour nous plonger dans ce qui est vraiment essentiel. D’un autre côté, je me dis parfois qu’elle est plus proche de l’enfance, justement par le fait qu’elle ne s’embarrasse pas de l’agitation du monde, préférant se concentrer sur la richesse intérieure de l’individu. Lire de la poésie nous empêche-t-il donc d’être lucide en n’étant pas axé sur les réalités extérieures ou au contraire cette activité nous réconcilie-t-elle avec nous même, ce qui est finalement le bien le plus précieux ?
16:43 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature, poésie, montaigne
22/03/2008
Foire du livre
La foire du livre de Paris est terminée et on se demande toujours s’il fallait ou non la boycotter.
Certains, par solidarité envers la population de Gaza, estimaient que la moindre des choses était de marquer sa désapprobation envers un état qui bombarde allégrement des populations civiles.
D’autres, au contraire, disaient que la littérature n’avait rien à voir avec la politique et que d’ailleurs rien ne disait que les écrivains israéliens invités approuvaient la politique d’ostracisme menée par leur pays.
Pierre Assouline, sur son blogue que je ne lis jamais, ne cache pas son ironie à l’égard des partisans du boycotte, estimant qu’ils ont manqué leur objectif et que s’il y a eu effectivement une petite désaffection du public, elle est surtout due au risque d’attentats et au mauvais temps (les mesures de sécurité ayant été renforcées à cause de tous ces méchants terroristes, les files d’attente étaient plus longues). Bref, selon lui, le public français ne s’est pas laissé impressionné ni influencé et il a montré tout l’engouement qu’il porte à la littérature israélienne.
Il a peut-être raison. Il n’empêche que je n’apprécie pas trop le ton persifleur qu’il emploie ici. Je n’attendais d’ailleurs rien d’autre de lui car je n’oublie pas l’article qu’il avait écrit en son temps contre le journaliste Alain Ménargues. Celui-ci avait écrit un livre dans lequel il s’opposait à la construction du mur de la honte en Palestine, ce qui avait fait dire à certains qu’il tenait des propos antisémites (et non antisionistes). Assouline avait alors donné raison aux rumeurs, qualifiant le mur de simple « barrière de sécurité » qui aurait servi de prétexte à Alain Ménargues pour se répandre en propos haineux envers le peuple juif.
C’est évidemment toujours l’éternel problème quand on parle de la politique israélienne. Oser la critiquer, c’est se faire taxer d’antisémite. Dans son livre, Ménargues regrettait que la religion juive, axée sur l’idée de pureté, incitât ce peuple à vouloir séparer le pur de l’impur, d’où l’ostracisme manifeste envers le monde arabe et le peuple palestinien en particulier. Du coup, on lui a reproché de ne pas simplement s’opposer à a construction du mur, mais d’être fondamentalement raciste envers les représentants du peuple hébreux, ce qui me semble aller un peu vite en besogne. Même le Monde diplomatique, dont j’apprécie les articles pour leur ouverture d’esprit, a demandé à ses sympathisants locaux de ne pas inviter Alain Ménargues Tout cela ressemble tout de même à une cabale qui ne dit pas son nom, car ce mur reste une honte, tout comme la politique de colonisation systématique ou l’enfermement de 3.00.000 de personnes dans la bande de Gaza. Certes, il y a les attentats, qui constituent un grave problème. Mais alors que tout le monde condamne à juste titre les extrémistes arabes qui voudraient voir disparaître l’état d’Israël, il n‘y a pas beaucoup de voix qui s’élèvent (ou en tout cas elles sont de peu de poids) pour désapprouver l’impérialisme israélien qui ne cesse de vouloir étendre ses frontières sous prétexte de garantir sa sécurité intérieure.
Pourtant, quand les Russes étaient partis autrefois à la conquête de l’Afghanistan, tout le monde occidental avait trouvé cela choquant. Comme on a trouvé choquant l’invasion de l’Irak par les troupes américaines sous un prétexte fallacieux (le terrorisme). Tout comme on désapprouve encore aujourd’hui l’annexion du Tibet par la Chine. Pourquoi ce qui peut être dit à l’encontre de l’impérialisme de certains états ne peut-il l’être quand il s’agit d’Israël ?
Parce que Israël est la victime (des attentats) me direz-vous. C’est vrai et on ne peut que le regretter. Mais est-ce en pratiquant cette politique du mépris que les choses vont s’améliorer ? Bush a-t-il éradiqué le terrorisme mondial en détrônant Sadam Hussein ? Bien sûr que non et il n’y a jamais eu autant de musulmans mécontents. Une majorité du peuple palestinien aspire à la paix, comme une majorité du peuple israélien. N’y aurait-il pas moyen de s’entendre plutôt que de se lancer dans une politique de fuite en avant qui amènera toujours plus de violence, laquelle débouchera sur plus de répression encore ?
On le voit, la situation n’est pas simple et pour revenir à la Foire du livre de Paris, le moins qu’on puisse dire, c’est que la question du boycotte pouvait au moins être posée. Quand un de nos politiciens s’en va en Chine signer des contrats commerciaux, nous ne trouvons pas normal qu’il fasse passer les intérêts économiques avant les droits de l’homme ou l’annexion du Tibet. Pourquoi alors l’annexion systématique et progressive d’une partie du territoire palestinien ne doit-il pas être dénoncé ?
Parce que, me direz-vous, une Foire du livre est une manifestation culturelle qui n’a rien à voir avec la politique. Si c’était vrai, je vous donnerais raison, mais malheureusement on sent bien que ce n’est pas un hasard si on a attendu le soixantième anniversaire de la naissance de l’état d’Israël pour inviter les écrivains israéliens. Je crois au contraire qu’on veut se servir de notre passion pour les livres pour justifier un événement politique et nous faire approuver indirectement la politique extérieure israélienne. C’est ce qu’on appelle de la manipulation.
Sans compter que si on invite un état, la moindre des choses est de donner un aperçu de toutes les composantes de cet état. Imaginerait-on inviter l’Espagne et nier la catalogne, l’Andalousie et le Pays basque ? Or ici, a-t-on vu des écrivains israéliens arabes musulmans ? Non bien sûr. A-t-on vu des écrivains arabes chrétiens ? Pas que je sache. L’explication qu’on nous donne relève du sophisme : on n’a invité que les écrivains s’exprimant en hébreux. Le critère serait donc devenu subitement linguistique. Mais pourquoi alors n’avoir pas intitulé ce salon « Salon de littérature hébraïque » ? Pourquoi pas ? Un peu comme on ferait un salon de langue arménienne ou kurde. Mais on n’a jamais vu un salon consacré à la langue kurde, puisque ce pays n’existe pas. C’est bien la preuve que c’est le pays politique qu’on invite et pas les représentants de telle ou telle langue (que se passerait-il d’ailleurs si on faisait un salon de langue anglaise ? On inviterait la moitié de la planète ?).
Tout cela pour dire qu’il y avait manipulation et que c’est bien l’état hébreu qui était à l’honneur beaucoup plus que sa littérature.
Maintenant fallait-il ou non le boycotter, c’est une autre question. Quel est l’impact d’une telle mesure ? Il est probablement fort mince. D’un autre côté, c’est en mettant autrefois l’Afrique du Sud au banc des nations que petit à petit l’apartheid a été vaincu. Et puis il faut être honnête. Tous ces bien-pensants qui verraient d’un mauvais œil un salon consacré au Cuba de Fidel Castro auraient été moins regardants si on avait invité le Chili du temps de Pinochet. Preuve supplémentaire que tout cela est bien politique alors qu’on ne vienne pas nous dire que cela ne l’est pas.
Bon, je parle, je parle, mais c’est surtout pour le plaisir d’être en votre compagnie, car dans le fond, n’habitant pas Paris, je ne vais jamais au salon du livre. Il fut un temps, cependant, où j’aimais me rendre dans celui de ma région, situé dans ma capitale à moi. Quand j’étais plus jeune je trouvais cela intéressant. On pouvait voir toutes les collections d’un même éditeur ou bien avoir une idée de la production de différents pays (le Québec, la Chine, etc.). J’y ai même vu, dans les années quatre-vingts, un stand israélien qui jouxtait un stand palestinien, comme quoi… Puis les années passant, je me suis lassé de ce genre d’événement, sans que je sache si c’est la qualité des salons qui a diminué ou si c’est moi qui me suis montré plus exigeant. Ce qui est sûr, c’est que les deux dernières fois il m’a semblé que l’aspect commercial avait pris de telles proportions, que j’en ai été dégoûté. Il ne s’agissait plus de montrer, mais de vendre. Les micros n’arrêtaient plus d’annoncer des séances de signatures et des débats. On avait l’impression qu’il fallait tout acheter et tout de suite. Si on ajoute à cela la chaleur, le bruit, le monde et l’impossibilité de flâner à son aise, j’en suis arrivé à la conclusion que je préfère butiner les rayons de ma librairie favorite, plutôt que de me rendre à ce genre d’événement où il s’agit surtout, pour les écrivains, de se faire voir et pour les lecteurs d’acheter et de consommer. Bref, on y vendrait des produits gastronomiques que ce ne serait pas fort différent.
Ah, au fait, qu’est-ce qu’ils ont comme spécialité culinaire, en Israël ?


01:32 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, foire du livre, alain ménargues
08/03/2008
Reflexions
Laissons parler Montaigne, qui a déjà tout dit :
Il est toujours plus plaisant de suivre que de guider.
Ce n'est pas la mort que je crains, c'est de mourir.
La plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi.
Il n'est description pareille en difficulté à la description de soi-même.
C'est un sujet merveilleusement vain, divers et ondoyant que l'homme.
Notre religion n'a point eu de plus assuré fondement humain que le mépris de la vie.
Ce grand monde, c'est le miroir où il nous faut regarder pour nous connaître de bon biais.
La plus subtile folie se fait de la plus subtile sagesse.
Philosopher, c'est douter.
Il se trouve autant de différence de nous à nous-mêmes que de nous à autrui.
22:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : littérature, montaigne







