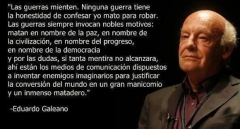05/08/2015
Rivière
Nous suivons notre chemin
Comme la rivière suit son cours.
Sait-elle où elle s’en va, trépidante et gaie ?
Sait-elle que là-bas, derrière l’horizon,
L’attend la grande mer salée
Où elle va se perdre et disparaître ?
C’en sera fini alors de bondir sur les rochers
Ou de flâner le long des berges herbeuses,
A l’ombre des grands arbres inclinés et pensifs.
Le voyage vaut mieux que son terme
Et la saveur du présent l’emporte sur la fin du parcours.
Ainsi en va-t-il pour nous, qui cheminons dans la vie,
Les yeux toujours braqués sur des lendemains improbables.
Profitons plutôt de l’instant,
Et toi, mon amie trépidante et gaie,
Assieds-toi sur l’herbe de la berge
Et donne-moi sans retenue tes lèvres,
Que j’en savoure le goût étrange et salé.

11:34 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature
24/06/2015
Obscurité (suite et fin)
10:16 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, obscurité
21/06/2015
Une critique de mon roman "Obscurité" par Jeanne R., romancière.
Je remets ici la belle analyse qu'une lectrice attentive et romancière par ailleurs vient de déposer en commentaire suite à mon article du 12.06.15 (sur mon roman Obscurité) car elle mérite d'être lue. Je suis heureux que ce roman puisse plaire, comme je suis heureux d'avoir des lecteurs(trices) de ce niveau. Merci à vous, Jeanne. Comme quoi Lyon reste un lieu où les femmes aiment la littérature et cela depuis Louise Labé et Pernette du Guillet.
==============
Jean-François Foulon, en conducteur attentif, nous balade avec des mots dans un parcours initiatique, lequel fait agir les héros du roman afin de se libérer du réel. Après le temps perdu, perdu à s'aimer mal, c'est le temps retrouvé que ce petit monde cherche durant des jours et des jours en pays de France pour réparer les bleus à l’âme.
Dès les premières images du livre, dans le noir profond d'une cachette qui voit l’obscurité dessiner les ombres de la nuit, comment ne pas penser à "La caverne de Platon" ? Mais, chez J.F. Foulon, le noir est profond et les ombres sont des fantômes d'où émerge la réalité d'un no man's land tandis que nous, lecteurs/lectrices, restons sur le seuil de cette caverne en attendant que l'histoire se déroule...
Il s'agit bien d'un huis-clos avec quatre personnages en partance pour un voyage au bout de soi-même : "la mère", ses deux enfants et une voiture, cette dernière a un rôle à part entière, assurément celui du refuge utérin.
Par un jeu intéressant, J.F. Foulon choisit de ne pas s'encombrer de noms ou de prénoms - seule - la petite fille est prénommée (Pauline), vu que c’est elle la lueur d’espoir, semble-t-il, et elle n’aura de cesse d’être protégée par les siens proches.
Dans cette grande aventure faite de petites aventures, tout le monde tente de se reconstruire, du plus petit au plus grand, et l'autorité se trouve transposée comme un passeur de témoin. L'unique garçon de l'histoire, appelé simplement "L'enfant", se présente ici sous un schéma œdipien, sauf que le regard de cet enfant en devenir n'est rien d'autre que notre regard, celui que nous posons sur un monde moderne cabossé qui va à vive allure comme la voiture, la voiture de l'histoire, la même qui se doit d'éviter d'autres écueils...
Il sera donc dit que le féminin s’avère très important dans ce beau roman triste au titre bien porté : "Obscurité".
Entre parenthèses, si l'un des lieux le plus récurrent du récit se trouve être "le camping", nous pourrions définir l’intériorité rêvée de chacun des protagonistes, grâce à l'épisode situé au frontière de l'Espagne, ainsi : Château de sable pour "l'enfant" / Château de contes de fées pour "Pauline" / Château de cartes pour "la mère".
Ce drame de la solitude à trois met surtout en lumière la question des règles de vie, celles édictées par la Société. Mais si une loi est mal faite, peut-on la transgresser ? Auquel cas, ce n’est pas sans risque…
Je salue bien bas Jean-François parce que dans ce "road movie", à la française, on sent très fort l'amour de la France que porte l'auteur en son cœur.
Littérairement vôtre,
Jeanne R.
(Lyon, le 21/06/2015)
http://jeannerromanciere.hautetfort.com/

21:58 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, obscurité
13/06/2015
Le puits du village.
Il y avait, sur la place du village, un puits où autrefois tout le monde venait puiser de l’eau. Les jours d’été, quand le soleil donnait toute son ardeur méridionale, cette place ne désemplissait pas. Par la force des choses, elle était devenue le cœur du village. C’est là qu’à l’ombre des platanes les femmes venaient discuter de leurs petites misères et que les hommes se rassemblaient le soir pour jouer à la pétanque (et pour regarder à la dérobée les hanches des jeunes filles qui venaient puiser de l’eau). Il en avait toujours été ainsi et nul n’aurait pu croire qu’il en serait un jour autrement.
Pourtant, après la guerre, celle de quarante, le maire du moment cru bien faire en faisant installer l’eau courante dans toutes les maisons. Tout le monde se réjouit de cette invention incroyable qui amenait l’eau directement dans votre cuisine. Il ne fallait plus se déplacer, ni se pencher pour puiser l’eau, ni revenir en portant deux grands seaux à bout de bras. Non, il suffisait de tourner le robinet et l’eau était là, qui jaillissait claire et belle au sein même de votre demeure. Inutile de dire que le maire fut réélu trois fois de suite, ce qui était sans doute ce qu’il cherchait en introduisant dans le village cette technologie diabolique.
J’emploie à dessein le terme «diabolique » car après quelque temps il fallut se rendre à l’évidence : les femmes n’allant plus puiser de l’eau au puits, la place perdit rapidement toute sa population féminine. Renfermées dans leur logis, les pauvresses ne communiquaient plus entre elle. Elles se désolaient toutes seules devant leurs fourneaux et plus d’une sombra dans un mal étrange qu’on n’appelait pas encore dépression. Quant aux hommes, ils désertèrent la place à leur tour, puisqu’il n’y avait plus aucune jeune fille à admirer ni aucune croupe ondulante qui se penchait au-dessus du puits. Petit à petit ils délaissèrent le jeu de pétanque et prirent leur quartier au bistrot des sports, où on vendait assez cher un vin infâme qui vous montait à la tête et qui fut la cause de bien des disputes et même de quelques bagarres.
Insensiblement, le village changeait, mais personne ne s’en apercevait encore. Les années passèrent et les enfants grandirent. Un à un ils revinrent du pensionnat avec des diplômes, mais aucun ne reprit la ferme de ses parents. Ils s’en allèrent à la ville et on ne les revit plus jamais. Les habitants vieillirent et un à un à leur tour ils s’en allèrent ailleurs, généralement derrière le mur du grand cimetière. A la fin, il n’y eu plus dans le village que trois vieillards, lesquels s’évitaient d’ailleurs soigneusement à cause d’anciennes disputes qui remontaient à l’époque du café des sports. Un jour, il n’y eut plus qu’un seul habitant, un nonagénaire voûté qui regardait le passé avec nostalgie et l’avenir avec terreur. Alors, un beau matin d’été, n’y tenant plus, il rassembla ses dernières forces et gagna comme il put la place du village. Et là, dans un effort surhumain, il grimpa tant bien que mal sur le petit muret circulaire et se jeta dans le puits.

00:55 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature
12/06/2015
Mon roman "Obscurité" (promotion-suite)
J'étais supposé me présenter sur le blogue des éditions Chloé des Lys. En pratique, j'ai plutôt parlé de mon rapport à l'écriture.
Voir ici
00:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature
27/05/2015
Cheminement intérieur
Il est bon parfois, de s’arrêter,
De s’arrêter au bord du chemin
Et de regarder, assis dans l’herbe,
Sans rien faire. Sans rien faire d’autre que
D’observer les arbres autour de soi,
Les grands arbres qui bordent le chemin.
Il est bon alors d’oublier le monde,
Le vaste monde, ses guerres et sa folie.
Il est bon, pour un instant, de ne penser qu’à soi,
Egoïstement, et de jouir du fait d’être en vie.
Il est bon d’oublier le chemin,
Qui finalement ne conduit nulle part.
Regarde !
Un oiseau saute de branche en branche,
Un insecte butine une fleur, une fourmi se promène,
Un papillon passe.
La vie est là, simple et tranquille.
Sois comme ce papillon,
Heureux d’être toi-même et d’être libre.
Va où tu as envie d’aller
Et pas forcément en suivant le chemin.
Coupe à travers prés, au hasard, et engage-toi dans la grande forêt.
C’est celle de ton enfance, elle te reconnait
Et ne t’a pas oublié.
Respire l’odeur suave des pins,
Ecoute le lent bruissement des hêtres,
Regarde les branches qui frémissent lentement au gré du vent.
Un écureuil t’observe et puis se sauve au haut d’un tronc,
Quelque part un oiseau crie et dans les fourrés, une bête a bougé.
Le vrai mystère est là, dans la profondeur des bois.
Marche au hasard, sans te presser,
Tu es chez toi, en paix avec toi-même.
Délaisse le monde et ses soucis,
Ne reviens jamais sur le chemin,
Reste toi-même.
C’est tellement plus important !

16:21 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : littérature
14/05/2015
Quadrature du cercle
Petite fille, tu contemplais le large fleuve,
Le large fleuve qui s’en allait vers l’inconnu.
Plus tard, bien plus tard, tu es revenue ici,
Sur la berge de sable fin,
Devant le château en ruine au-dessus de la falaise.
La vie, déjà, était passée
Et tes enfants grandis s’en étaient allés eux aussi vers des terres inconnues.
Tu as contemplé l’onde passante,
Seule,
Ne sachant toujours pas ce qu’il y avait derrière l’horizon,
Ni à quoi rimait cette fuite des heures
Qui t’avait ramenée vers toi-même,
Au bord du fleuve éternel de ton enfance.

La Roque-Gageac
00:18 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature
05/05/2015
Dernière demeure
Sur les pavés de la vieille ville
Résonnent les pas d’un cheval,
Bruit monotone qui égrène le temps,
Echo lugubre entre les façades mortes.
Derrière le corbillard, suit la foule,
Silencieuse et atterrée,
Qui se dirige vers le cimetière.
Et chacun se demande en lui-même
Combien de temps il lui reste encore
A suivre ainsi les enterrements des autres.
Et tous écoutent les pas du cheval
Et la fuite inexorable des secondes,
Qui résonnent entre les vieilles façades
Et viennent mourir devant le mur du cimetière.

00:20 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature
27/04/2015
Il y a
Il y a, quelque part, une forêt immense.
Il y a un petit village, perdu dans cette immensité.
Il y a une place, une église et un pont.
Il y a sous le pont, une rivière qui coule.
Il y a des enfants qui jouent le long de l’eau
Et de grandes herbes qui les cachent en partie.
Il y a devant une maison, un chien qui me regarde.
Il y a sur la place un petit café tranquille.
Il y a le dimanche, une foule qui sort de la grand-messe.
Il y a une fille qui attire mon regard
Et qui est grande et belle avec des yeux noirs.
Il y a des champs de blé qui sentent bon l’été.
Il y a partout des chemins qui mènent vers d’autres lieux.
Il y a en moi comme un désir inconnu
Et une envie folle de découvrir le monde.
Il y a, assise contre un arbre, cette fille qui me regarde.
Il y a ses yeux tranquilles et un grand trouble en moi.
Il y a l’odeur de l’herbe où l’on s’est couché
Et celle de sa peau nue, que je n’oublierai plus.
13:00 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
21/04/2015
Citations
"Il est aussi dans l’intérêt d’un tyran de garder son peuple pauvre, pour qu’il ne puisse pas se protéger par les armes, et qu’il soit si occupé à ses tâches quotidiennes qu’il n’ait pas le temps pour la rébellion »
Aristote
« Lorsqu’un gouvernement est dépendant des banquiers pour l’argent, ce sont ces derniers, et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au dessus de la main qui reçoit. […] L’argent n’a pas de patrie ; les financiers n’ont pas de patriotisme et n’ont pas de décence ; leur unique objectif est le gain. »
Napoléon Bonaparte .
« Le pouvoir des financiers tyrannise la nation en temps de paix et conspire contre elle dans les temps d’adversité. Il est plus despotique qu’une monarchie, plus insolent qu’une dictature, plus égoïste qu’une bureaucratie.»
Abraham Lincoln.
« Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. »
Etienne de La Boétie

22:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature
15/04/2015
In memoriam
Triste journée pour la littérature et pour la pensée de gauche, hier.
Outre le décès de Günter Grass, dont on a un peu parlé puisqu’il avait reçu le prix Nobel de littérature, il faut aussi déplorer la mort d’Eduardo Galeano, dont on a beaucoup moins parlé. Galeano est l’auteur de « Las Venas abiertas de America latina » (les veines ouvertes de l’Amérique latine), livre que j’avais lu à 22 ans et dont je n’étais certes pas sorti indemne, puisqu’il a été à la base de toutes mes convictions politiques. Dans cet ouvrage, l’auteur démontre que le continent Sud-américain, après s’être péniblement soustrait au colonialisme espagnol lors des guerres d’indépendance, n’est jamais parvenu à atteindre la moindre autonomie politique ou économique. En effet, ses richesses ont continué à être exploitées par l’Europe puis par les Etats-Unis, tandis que le peuple, soumis aux pires dictatures à la solde de l’Occident, continuait à vivre dans la misère.
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2015/04/13/l-e...
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2015/04/13/mor...
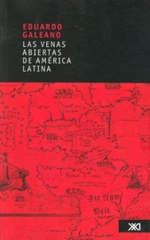
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature
07/04/2015
Midi
Le chemin conduit au village, où je pénètre enfin après deux heures de marche. J’ai laissé la voiture de l’autre côté du grand bois, pour arriver discrètement. Il est midi et il fait chaud. Sur la place de l’église, il n’y a personne. Tout est désert. Je remonte la rue principale où les rares magasins sont fermés. On est dimanche. En passant devant les maisons, j’entends le cliquetis des couverts et de vagues conversations. Dans une cour de ferme, un chien aboie, mais personne ne sort pour voir ce qu’il se passe. Je continue à marcher et j’oblique à gauche, par la petite ruelle qui descend vers le cimetière. Elle est bordée de murs très chauds, qui ont emmagasiné toute la chaleur du soleil. Il fait bon. Quelque part, un oiseau pépie et par-dessus le mur des branches de noisetiers se balancent doucement au vent. Le lieu est charmant, vraiment.
Arrivé devant la petite grille de fer, j’hésite un instant, puis je pose ma main tremblante sur la poignée. Elle est chaude, elle aussi, presque accueillante. Je parcours les allées et m’arrête là où il n’y a pas encore de tombe, rien qu’un amas de terre, sans un nom, sans une croix. L’enterrement était vendredi et la décence et les conventions m’ont empêché de venir. Je sais que tu es là et que je ne te reverrai jamais plus. Seul mon amour reste vivant.

00:05 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature
27/03/2015
Mon roman "Obscurité" vient de paraître.
J’avais promis de vous en reparler et je vous en reparle donc. A vrai dire et pour être tout à fait honnête, j’attendais même ce moment avec impatience. Mon livre « Obscurité » est enfin référencé. On peut donc se le procurer soit via les librairies, soit directement via le site de l’éditeur. C’est cette dernière solution que je vous conseille vivement puisqu’on vous fera alors une remise de trente pour cent. Certes vous devrez payer les frais de port (1,5 euros), mais vous l’obtiendrez à 26, 50 euros au lieu de 37,90. Ce dernier prix est assurément prohibitif et croyez que je suis le premier à le regretter. En tant que lecteurs potentiels, vous êtes en droit de savoir ce qui explique ce prix.
Les petits éditeurs qui éditent à leurs frais n’ont que deux solutions :
La première, c’est de faire imprimer beaucoup d’exemplaires (par exemple 1.000 ou 2.000) et de les diffuser à travers la France via un intermédiaire. Mais là, soit ce « diffuseur » réclame sa part de bénéfice qui n’est pas mince (et l’éditeur ne gagne presque plus rien), soit il refuse carrément de prendre en charge les livres d’une petite maison. Dans ce dernier cas, l’éditeur essaie alors de diffuser lui-même ses exemplaires auprès d’un certain nombre de librairies (sorte de réseau qu’il s’est constitué lui-même au fil du temps). Cela signifie qu’il doit supporter l’envoi de colis par la poste, ce qui vient déjà grignoter dangereusement sa marge bénéficiaire. Mais un malheur n’arrive jamais seul et après quelque temps, les libraires lui renvoient à peu près l’entièreté des 2.000 exemplaires imprimés, car peu de lecteurs se sont laissé séduire par un auteur totalement inconnu. Bref, il se retrouve avec 1.900 exemplaires qui sont bons pour le pilon. Autant dire qu’après avoir renouveler l’expérience trois ou quatre fois, il peut mettre la clef sous le paillasson.
La deuxième méthode (et c’est celle qu’a adoptée mon éditeur Chloé des Lys) consiste à imprimer au fur et à mesure des commandes. L’avantage, c’est qu’il n’y a aucun stock, aucun invendu et donc aucune perte. Cela permet à l‘éditeur de survivre. L’inconvénient c’est que l’imprimeur demande évidemment beaucoup plus cher par exemplaire (d’une part parce qu’il ne sait jamais combien d’exemplaires il aura l’occasion d’imprimer et d’autre part parce que cela lui prend pratiquement autant de temps de fabriquer deux livres que d’en fabriquer deux cents). Les seuls perdants, dans cette affaire, ce sont les lecteurs (qui se ruinent) et l’auteur (qui regrette que son livre ne soit pas beaucoup lu).
La solution de Chloé des Lys pour que tout le monde y trouve son compte c’est donc de faire une remise importante sur le prix du livre. Il y clair que si un prix de 37,90 euros est tout à fait prohibitif, le fait de vendre finalement l’exemplaire à 26, 5. Est déjà beaucoup mieux. Même si cela reste cher, j’en ai bien conscience. Soyons honnêtes, pour le même prix vous pourriez acheter quatre livres de poche. Mais bon, Obscurité fait quand même 491 pages (avec une police de caractère que j’ai voulue assez grande, par égard aux lecteurs de plus de cinquante ans aux yeux fatigués) ce qui n’est pas rien non plus.
Bref, trêve de discussion, voici le lien vers le site de mon éditeur :
http://www.editionschloedeslys.be/catalogue/870-obscurite.html

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : littérature, obscurité, roman
25/03/2015
De la première mondialisation
Au fil de mes lectures, je suis tombé sur ce passage qui m’a paru d’une singulière modernité puisqu’on y évoque déjà le recul des frontières et la mondialisation que nous connaissons aujourd’hui. Une fois que les navires ont cessé de longer les côtes et qu’ils se sont élancés sur la pleine mer, d’autres rivages ont été découverts et on a connu d’autres peuples. Les échanges commerciaux ont fait le reste.
Nos ancêtres ont connu des siècles d’innocence,
ignorant toute perfidie.
Chacun demeurait tranquillement sur son rivage
et vieillissait sur la terre de ses aïeux.
Le peu qu’il possédait suffisait à faire sa richesse ;
C’est de sa terre natale qu’il tirait tous ses biens.
Les frontières heureusement établies ont été effacées
Et le monde a été unifié
Par le vaisseau de pin construit en Thessalie.
Il a forcé la mer, l’a battue de ses rames,
Et cette mer dont on ne se souciait pas,
Il nous l’a imposée – nouveau sujet de crainte.
(…)
N’importe quel navire peut parcourir la haute mer.
Toutes les limites ont été repoussées
Et des villes ont édifié leurs murs
Sur de nouvelles terres.
Le Monde, désormais totalement accessible,
Na rien laissé à sa place d’origine :
L’Indien boit l’eau glacée de l’Arax,
Les Perses se désaltèrent à celle de l’Elbe et du Rhin.
Dans de longues années viendra un temps
Où Océan relâchera son emprise sur le monde,
Où la terre s’ouvrira dans son immensité,
Où Téthys révélera de nouveaux continents,
Où Thulé ne sera plus l’ultime terre connue.
De quand date ce texte ? Du XVIème et du XVIIème siècle, quand les galions espagnols ramenaient de l’or d’Amérique ? De l’époque de Christophe Colomb ? Non, ce texte est extrait de la pièce de théâtre « Médée » du philosophe Sénèque (-4 av. J-C ; 65 après J-C). Comme quoi il n’y a rien de neuf sous le soleil.
00:22 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature
16/03/2015
Ressac
Il y a souvent, sur les plages en hiver, des bateaux qui sommeillent.
Penchés, décolorés, parfois éventrés, ils semblent attendre on se sait quoi.
Sans doute rêvent-ils aux voyages d’autrefois,
Quand ils sillonnaient les mers du Sud aux eaux transparentes.
Certains ont longé les barrières de corail
Où de grands requins bleus venaient se frotter contre leur flanc.
D’autres ont navigué au large de Terre Neuve
Où ils ont croisé la route de milliers de baleines franches.
D’autres encore, plus modestes, se sont contentés de longer nos côtes,
Capturant dans leurs filets de quoi nourrir quelques familles.
Mais tous, grands ou petits, ont gardé le goût de la mer,
Ce goût âcre et salé comme celui qu’exhale la peau des femmes aimées.
Semblable à ces bateaux, je rêve aux jours d’autrefois,
Quand nous parcourions à deux les plages ensoleillées.
Un collier de coquillages ornait ton cou
Et ta robe transparente laissait voir tes flancs nus,
Promesse de voyages dans le bleu de nos nuits.
En l’hiver de ma vie, la plage est désormais déserte
Et contre les bateaux qui sommeillent
Viennent battre les vagues au ressac monotone.

00:05 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature
08/03/2015
Roland Thévenet, La Queue.
Je termine le livre « La Queue » de Roland Thévenet (mieux connu sur Internet sous le pseudonyme de Solko), le deuxième livre paru aux Editions du Bug.
Pour être tout à fait honnête, la première partie ne m’a attiré que moyennement, sans pour autant me déplaire. Mais une fois franchi ce cap, plus j’ai avancé dans la lecture, plus je suis devenu attentif et intéressé. Après coup, j’ai essayé de comprendre ce qui m’avait dérangé dans cette première partie et j’ai dû reconnaître que mes réticences ne provenaient ni de l’auteur ni de son style, mais tout simplement de ce qui y était raconté, à savoir notre monde moderne d’aujourd’hui, fade, insipide, sans autre valeur que celle de la recherche du profit. Le héros est un milliardaire mondialement reconnu et admiré tandis que sa belle-fille est Commissaire européen, ce qui vous situe un peu la problématique évoquée. On nous explique sur quelle idée farfelue, relayée par un marketing efficace, s’est constituée la fortune familiale. Car toujours il s’agit de vendre ce qui ne sert à rien, un objet ridicule en soi et sans aucune utilité pratique, mais qui va finir par apparaître aux yeux des gens comme une marque de reconnaissance qu’on ne peut pas ne pas acquérir et porter, afin de montrer qu’on n’est pas moins que les autres. Cet objet si convoité, c’est une queue d’étoffe, que le génial futur milliardaire a eu l’idée de coudre à l’arrière du pantalon. Plutôt que d’en rire, voilà toute la population mondiale qui se jette sur cette queue, avec l’illusion de renouer avec ses origines animales et l’intention d’être originale. En réalité il s’agit d’un produit commercial uniforme qui symbolise bien notre société mercantile, où on vend n’importe quoi, surtout si c’est dans le vent. L’auteur en fait dénonce notre mode de fonctionnement moutonnier où tout est axé sur l’apparence extérieure.
Après ce début « un medias res », les chapitres suivants replongent le lecteur en arrière, au début de la guerre 40, quand Félix, le futur milliardaire, n’a que quelques semaines. Orphelin (ses parents ont été tués dans des circonstances tragiques mal éclaircies), il est recueilli par un curé, qui se met à l’élever, ce qui nous donne quelques pages très humaines sur ambiguïté de ce prêtre qui sans s’en rendre compte se met à tenir le rôle paternel qu’il avait toujours dû refuser de par sa fonction sacerdotale mais auquel il aspirait au fond de lui-même. Il éduque le jeune enfant et lui donne des valeurs.
Le récit n’est pas linéaire et on retrouve le héros dans différents endroits : chez sa grand-mère après avoir été exclu d’un pensionnat ou apprenti jardinier dans un château, où il découvre l’amour auprès d’une jeune fille orpheline comme lui. Les parents de cette dernière ont été tués lorsqu’une voiture est entrée dans la foule aux Vingt-quatre heures du Mans. Comme les parents de Félix, victimes de la guerre, ils ont été victimes de la folie des hommes (les courses de voiture, la modernité, la vitesse).
Le héros s’en va encore et on le retrouve sur les trottoirs de Paris où il fait la connaissance de l’écrivain américain Kerouac. On sent là–derrière une pointe d’autobiographie de la part de R. Thévenet, qui a dû pas mal voyager dans sa jeunesse, comme l’auteur de « La Route » et qui a dû errer lui aussi dans le grand Paris.
Kerouac tente de donner un sens à sa vie en partant sur les chemins et en recherchant l’aventure, tout comme le prêtre (auquel il ressemble physiquement) cherchait une voie spirituelle pour vaincre l’absurde du monde. Mais ce sera une fausse piste pour Félix. Il aura beau suivre l’écrivain en Amérique, il se rendra vite compte que celui-ci est dans une impasse, alcoolique, sans illusion et victime de son succès. Finalement, mieux valait écouter le prêtre, qui était plus perspicace : « Ils éclataient du même feu, mais ne le jetaient pas dans la même direction » (page 190). La voiture décapotable avec laquelle il traverse l’Amérique aux côté du célèbre auteur lui fait penser à « la furieuse Mercedes de Levegh, sur le circuit du Mans » (page 192). La vitesse, la modernité et la fuite en avant ne semblent pas des solutions existentielles valables.
Reste l’amour. Félix mettra tout en œuvre pour retrouver Lisa, la jeune fille orpheline rencontrée lors de son adolescence. Il y parviendra et l’épousera. Celle-ci travaille comme journaliste au journal France-Soir du célèbre Lazareff. Riche et ne logeant que dans des palaces, mondain au possible, il est le contraire de Kerouac. Pourtant, comme ce dernier avait la passion de la route et le prêtre celle de l’Eglise, Lazareff a celle du journalisme. Mais quel journalisme ? Il recherche moins la vérité des faits que de pouvoir vendre des illusions à la multitude.
Décidemment, plus on avance dans la lecture, plus on se prend d’affection pour ce livre de B. Thévenet qui pose des questions existentielles et qui offre des réponses provisoires, très vite dépassées et sans cesse remises en cause. Et puis il y a le destin, qui frappe toujours sans prévenir. Lisa, l’épouse du héros, est victime d’une balle perdue lors d’un reportage en Irlande du Nord et elle reste paralysée. « Les éclats de tôle qui l’avaient épargnée, petite fille, sur le circuit du Mans, venaient de nouveau de rejoindre Lisa pour frapper dans le dos, alors qu’elle fuyait les soldats anglais » (page 231) Quel est le sens de ce destin ? Pourquoi tant d’injustice ? Même le prêtre qui avait autrefois élevé le héros n’aurait sans doute pas pu répondre et sa foi serait restée impuissante. Il n’avait d’ailleurs jamais pu donner de réponse sur la mort injuste des parents de Félix et avait préféré lui cacher la vérité. C’est pour cela, pour ce mensonge, que l’enfant était parti, on le découvre à la fin du récit.
Devenu vieillard et riche, il revient pourtant au terme de sa vie dans cette église de son enfance pour tenter encore une fois de trouver des réponses à toutes ses questions. Il n’arrive pas à croire, sa raison l’en empêche. Mais il semble entendre le prêtre lui murmurer que « le discernement entre le vrai et le faux, si estimable soit-il de la raison, n’aura jamais la limpidité, le charme, le Grâce d’un Pardon ni la légitimité d’un sacrement ! C’est en poète que je crois, moi (…). Je sais que ces mystères, dans leur ingénuité profonde, sont les derniers remparts contre la folie destructrice du monde et de l’ultra-libéralisme qui n’est, en terme religieux, que la ruse la plus aboutie du diable.» (page261).
Et moi, lecteur qui n’ai pas non plus la foi, je me dis que cette poésie du sacré, si irrationnelle soit-elle, vaut bien mieux, finalement, que ce monde mercantile du grand village global que l’on nous impose chaque jour un peu plus et où je ne trouve finalement aucune valeur humaine.

19:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature
24/02/2015
Tempête
Quand déferlent les marées d’hiver
Qui emportent tout sur leur passage
Il ne reste rien sur le sable nu
Même pas le souvenir de ce qui a été
Quand le vent parcourt la lande
Grande et belle en son immensité
Il emporte toutes nos illusions
Et nos rêves inassouvis
Quand les navires en perdition
S’échouent contre les falaises bleues
Il ne reste parmi les flots
Que des épaves flottant au hasard de la nuit

00:05 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
17/02/2015
Bertrand Redonnet, le Silence des Chrysanthèmes
Un beau livre que celui-là, assurément, un livre comme je les aime, qui sent bon la campagne d’autrefois et les souvenirs d’enfance. On retrouve les thèmes favoris de l’auteur, ceux que l’on a déjà rencontrés dans ses autres ouvrages, comme la fuite du temps, la difficulté de donner un sens à sa vie, mais aussi le rythme des saisons et ce passage des campagnes de l’ère néolithique au progrès motorisé. Ses souvenirs d’enfance à lui, qu’il retrace à petits coups de pinceau, le renvoie justement à une époque qui n’existe plus, celle des chevaux de labour et des fenaisons qu’on faisait à la main. On sent du regret derrière les mots employés, de la nostalgie sincère, mais toujours aussi une quête du sens de la vie, de cette vie qui s’est écoulée si vite et qui l’a conduit, lui l’auteur, à l’autre bout du continent, dans cette Pologne à la frontière biélorusse où il a réappris à dire son pays. Car il a fallu cette cassure, cet « exil volontaire » pour qu’il prenne conscience de ce qu’il avait perdu, à la fois la France et sa langue et ses propres origines, celle de sa tribu, frères et sœurs groupé autour d’une mère atypique qui, en l’absence de mari, dirigeait tout d’une main de fer.
Dans cette Pologne où il vit maintenant, Bertrand a découvert les hivers de neige dont il rêvait enfant. Le réel a rejoint l’imaginaire en quelque sorte et il était donc normal qu’il se mît à écrire sur son passé, d’autant plus que sa maison de bois ensevelie sous la neige ne pouvait que le conduire à devenir écrivain :
« Longtemps, très longtemps, trop longtemps, la première pensée que m‘inspirait une masure isolée au milieu d’une aimable campagne, surtout si c’était l’hiver et si toute chose y était muette, c’est qu’elle était un lieu idéal pour s’y retirer et pour y écrire. » (page 62)
Il nous parle aussi de sa seconde passion, la musique et nous raconte comment un frère bricoleur avait confectionné tant bien que mal une guitare, sur laquelle il s’était mis, lui, à dire sa mélancolie, avant de rencontrer l’œuvre de Brassens, ce poète qui a su mettre les mots en chanson.
Il nous parle de son instituteur et des cartes de géographie que celui-ci expliquait, ouvrant à l’enfant médusé des univers infinis et fantastiques. Ou bien c’étaient les cours d’Histoire, où on parlait de la grande Guerre, celle que le grand-père avait faite, mais dont il ne disait jamais rien, ayant noyé sa blessure dans le vin. Plus tard, ce sera le collège et l’internat, cette prison qui privera le jeune adolescent de ses promenades dans les bois et les prés ou encore de ses randonnées le long des rivières. Ce sera l’époque des premières contestations et des premiers affrontements avec l’autorité (surveillant, directeur, etc.) mais ce sera aussi cette école qui fera qu’il deviendra petit à petit différent de ses frères et sœurs, lesquels étaient plutôt manuels et avaient développés des dons certains pour le bricolage. Il aura fallu ce livre pour réconcilier des points de vue si différents :
« Hélas, il était bien tard quand j’ai su lire ce besoin que vous aviez de vouloir en découdre avec la matière, ce besoin de dessiner son âme sur les choses, moi qui voulus toute ma vie en découdre avec les mots, avec les gammes, les contraindre à faire du monde, mon monde. Vous ne cherchiez pas autre chose au bout de vos pointes rouillées et votre poésie était aussi auguste que prétendait être la mienne. (page 134).
Hommage à la fratrie, à l’enfance perdue, à l’époque où les choses avaient un sens et les fruits une saveur, ce livre est une quête, une manière de remonter le chemin à l’envers pour tenter de trouver un sens à une vie qui fut finalement fort décousue et éparpillée entre mille activités. Reste l’écriture pour dire tout cela, une belle écriture classique, qui permet de figer un instant tous ces souvenirs d’autrefois et de leur donner une cohérence. L’écrivain d’aujourd’hui n’existerait pas si l’enfant d’autrefois n’avait pas vécu ce qu’il a vécu. Mais d’un autre côté, cet enfant ne survit que grâce à l’écriture et maintenant, par la magie des mots, il appartient un peu aussi à notre imaginaire à nous lecteurs, qui nous sommes laissé guider par les phrases de l’auteur.
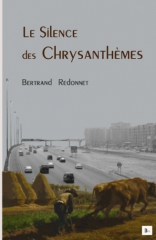
00:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature
12/02/2015
"Obscurité"
Ceux qui se souviennent avoir lu ici autrefois un roman qui s’intitulait « Obscurité » seront ravis car ils pourront bientôt se le procurer en version papier. En effet, « Obscurité » a trouvé un éditeur ! Le plus heureux de tous, c’est moi, évidemment, je ne le cache pas. S’agissant d’une édition à compte d’éditeur, avec une sélection des manuscrits reçus, je change du coup de statut et d’écrivant je deviens écrivain, ce à quoi j’aspirais depuis longtemps sans jamais y parvenir. En effet, alors qu’il y a des académies de peinture et des conservatoires pour consacrer les peintres et les musiciens, il n’y a pas d’écoles d’écrivains (fort heureusement d’ailleurs). Du coup, le fait d’être accepté par un éditeur reste la seule manière de se voir conféré le statut d’écrivain. Certes on me dira que certains publient n’importe quoi et c’est vrai, mais il n’en reste pas moins que c’est l’éditeur qui consacre l’écrivain, que celui-ci soit bon ou mauvais, finalement.
Je possède déjà des exemplaires chez moi, mais pour ceux qui habitent loin, il leur faudra encore attendre un ou deux mois, que le livre soit référencé dans les catalogues des libraires et surtout dans celui de l’éditeur.
Il faut savoir que pour survivre mon éditeur imprime en fonction des besoins, ce qui veut dire qu’on ne verra pas le livre dans les rayons des librairies (où il ne serait de toute façon resté que deux semaines avant que les invendus ne soient envoyés au pilon) mais on pourra le commander. Ceci dit, je vous donne un petit conseil : quand le moment sera venu, commandez-le plutôt sur le site de l’éditeur. Vous paierez certes les frais de port, mais on vous fera une remise de trente pour cent, ce qui n’est pas négligeable.
Je ne manquerai pas d’en reparler ici plus tard, quand ce sera le bon moment. Quant aux nouveaux lecteurs de Marche romane qui ne connaîtraient pas « Obscurité », je ne peux que les inviter à se procurer le livre.
Pour terminer, je tiens à exprimer ma gratitude à mes fidèles lectrices et lecteurs. En effet, certains se souviendront que ce qui constitue aujourd’hui le premier chapitre de ce livre était en fait une simple nouvelle. Puis certains m’ont demandé de lui donner une suite. Je me suis d’abord montré réticent puis finalement j’ai accepté de jouer le jeu. Sans eux, ce roman-là n’existerait pas aujourd’hui.
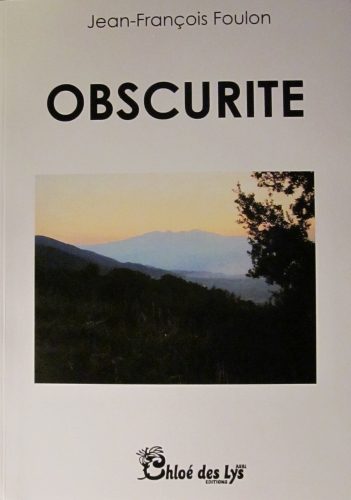
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature, obscurité
01/02/2015
Absence
Les grands oiseaux blancs qui sillonnent le ciel
Ont laissé sur le sable l’empreinte de leurs pas,
Mais la marée, qui va et qui vient
A tout effacé de sa rage écumante.
Seule demeure intacte ma blessure
Et mon manque de Toi
Lorsque tu m’apparais en songe
Encore et encore,
Eternellement absente.
Dans la nuit noire,
Au cœur des solitudes,
Le vent court sur la mer
Et m’apporte l’odeur de ta peau.
A l’aube, les nuages en sang
Oscillent comme des vagues.
Ils sont la houle de nos rêves
Les draps froissés de nos lits de sable.

00:57 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature
27/12/2014
Enfance (2)
Je suis revenu souvent chez cet oncle, pour ainsi dire une fois par an. Nous passions nos vacances en Bretagne et de là nous faisions un détour par les Deux-Sèvres avant de remonter vers nos contrées du Nord. Après avoir connu pendant trois semaines le climat agité des Côtes d’Armor (qui en ces temps anciens s’appelaient encore les Côtes du Nord), ce petit village du Poitou, à un jet de pierre de la Charente et de la Charente-Maritime, incarnait pour moi le Midi. Je me souviens des promenades dans les champs, des murets de pierres sèches si caractéristiques de la région et des rivières endormies qui coulaient si lentement qu’on se demandait si elles trouveraient un jour leur chemin. Il y avait aussi de vieux lavoirs et des villages blancs assoupis au milieu des vignes et des blés. Il faisait chaud, incroyablement chaud et les cultures étaient arrosées en permanence, ce que je n’avais certes jamais vu chez moi, où la pluie tombait en abondance. Point de forêts à cet endroit, mais des lignes de peupliers qui barraient l’horizon et qui le soir murmuraient doucement quand la lune se levait. Il y avait aussi « la prairie », sorte d’immense champ communal qui appartenait à tous et où tout un chacun pouvait se promener à son aise. J’ai su depuis que cette prairie avait servi pendant la guerre à la Résistance, qui y faisait atterrir de petits avions de tourisme au nez et à la barbe des Allemands.
La guerre, justement était toujours très présente dans les conversations. Pas seulement celle de quarante, mais aussi la guerre d’Algérie, qui venait à peine de se terminer. Mon oncle était boulanger et un de ses ouvriers revenait tout juste des djebels. Ca discutait donc ferme, à table, de l’Algérie française, du FLN, de De Gaulle et de toute cette politique à laquelle le gamin que j’étais ne comprenait rien du tout. Je n’avais d’ailleurs jamais vu autant de personnes rassemblées pour un repas. Outre mon oncle, ma tante et leurs cinq enfants, il y avait l’ouvrier de retour d’Algérie, un apprenti et un chauffeur (lequel faisait les tournées pour vendre le pain dans les fermes isolées). Ajoutez à cela mes parents et moi-même, nous étions donc treize à table.
Les plats servis étaient dignes des meilleurs restaurants. Je me souviens surtout du potage, qu’on appelait « mijo » et qui était un mélange d’eau et de vin dans lequel on avait fait tremper du pain. On le servait froid, au sortir du réfrigérateur. En écrivant ces lignes, j’ai encore en bouche sa saveur bien particulière. Il faut dire que j’adorais ce potage, qu’on me servait malgré mes dix ans, ce qui me classait immédiatement dans le clan des adultes, puisqu’il contenait du vin. Il y avait ensuite une entrée, suivie du plat principal et enfin venait le dessert. C’étaient de véritables festins gargantuesques et j’ai toujours admiré ma tante qui parvenait à préparer tout cela sans s’énerver le moins du monde et avec un calme olympien. Essayez, vous, de préparer chaque jour un repas pour treize personnes !
Pendant que les adultes continuaient à discuter, je m’éclipsais discrètement dehors. J’écartais légèrement les volets qui donnaient un peu de fraîcheur à l’intérieur de la maison (laquelle, du coup, était plongée dans une semi-obscurité permanente qui m’enchantait) et je me retrouvais dans la cour écrasée de lumière et de chaleur. De là, j’allais vers le fournil, qui était un lieu magique. On trouvait là un immense pétrin en bois, dans lequel on préparait la pâte à la main. Il y avait aussi un pétrin électrique. La farine tombait directement du grenier par une sorte de trémie. Et puis il y avait le four ! Le premier que j’ai connu fonctionnait au bois. D’immenses fagots qui servaient à le chauffer s’alignaient d’ailleurs dans la cour. On pouvait aussi le réchauffer avec une espèce de lance-flammes qui m’impressionnait beaucoup. Plus tard, l’oncle s’était modernisé et il avait installé un four qui devait fonctionner au fioul. Il y avait aussi une sorte de tapis roulant sur lequel on étalait les panetons avant d’enfourner le tout en quelques secondes. Pour retirer le pain, on utilisait des espèces de pelles en bois munies d’une longue perche. C’était un régal de déguster au petit-déjeuner une baguette qui venait juste d’être cuite et qui était encore toute chaude. Honnêtement, je n’ai plus jamais rien mangé d’aussi bon.
Durant la matinée, ça s’agitait beaucoup dans ce fournil et il valait mieux ne pas y mettre les pieds, mais après le déjeuner, il était désert et je pouvais m’y faufiler discrètement. J’aimais par-dessus tout l’odeur de farine, de pâte et de pain cuit. Il faisait chaud, forcément, le four attendant une dernière fournée. Mon plus grand plaisir était de me glisser entre celui-ci et le mur, où il y avait un passage d’environ cinquante centimètres. Là, je fermais les yeux et j’écoutais les grillons qui avaient élu domicile là, dans la chaleur permanente du fournil.
Je me souviens aussi être allé avec mon oncle faire les tournées des fermes. Il possédait une camionnette Citroën qui s’aventurait dans des chemins périlleux, cernés par deux murs de pierres sèches, et qui étaient si étroits qu’il fallait klaxonner à chaque tournant. On arrivait dans des maisons improbables, coupées du monde, où une petite vieille venait acheter sa baguette et un kilo de pâtes (car la boulangerie faisait un peu épicerie). Elle ne payait jamais, mais on inscrivait sur une feuille le nombre de pains achetés et on réglait le tout à la fin du mois. Autrefois, on se contentait même d’un bâton en bois sur lequel on faisait une entaille par baguette achetée, bâton qui restait près de la porte de la ferme. C’était manifestement une autre époque, où tout le monde faisait confiance à tout le monde.
Ce que j’aimais par-dessus tout chez mon oncle, c’est qu’il me considérait pour ainsi dire comme un adulte. Je veux dire par là qu’il ne s’adressait pas à moi comme à un enfant (ce que faisaient mes parents, qui me faisaient sentir que j’étais là pour écouter et obéir) mais comme si j’avais été son égal, ce qui évidemment me plaisait beaucoup.
Je me souviens que lorsque j’avais eu douze ans, j’avais dormi non plus dans le corps de logis proprement dit, mais de l’autre côté de la cour, dans une chambre qui venait d’être aménagée dans un ancien grenier. Je m’étais donc retrouvé là complètement seul et isolé de tous, ce qui avait enchanté le jeune adolescent que j’étais. J’avais pu lire jusque fort tard dans la nuit, tandis que l’horloge de l’église sonnait les heures et les demies. Avant de m’endormir, j’avais ouvert la porte pour contempler cette église, qui se trouvait juste en face, de l’autre côté de la route. C’était magnifique. J’étais là, seul, et je contemplais ce bâtiment de style roman éclairé dans la nuit. C’est une image qui ne m’a plus jamais quitté.
Une année, l’oncle était parti en vacances en même temps que mes parents et comme nous étions dans le massif central (la Creuse, la Corrèze, le Lot ? Je ne sais plus), nous étions allés le retrouver à Beynac, en Dordogne, où il campait. Il y avait un château perché sur une falaise. Il était magnifique, le matin, quand il émergeait de la brume. Le jour où nous sommes repartis, à cinq heures du matin, l’oncle s’était évidemment levé pour nous dire au revoir. Et là, je ne sais pas pourquoi, j’ai été subitement très ému car j’ai eu la certitude que c’était la dernière fois que je le voyais. C’était un pressentiment vraiment inexplicable mais qui s’est malheureusement confirmé. Il est mort deux ans après, sans que je l’aie revu, des suites d’un cancer de la gorge, contracté probablement par la cigarette et par la poussière de farine qu’il avait respirée toute sa vie. Il avait à peine plus de soixante ans.

02:16 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : littérature
22/12/2014
Tempête
Au creux de l’hiver, les vagues ont déferlé en des colères atlantiques, se fracassant contre les falaises, submergeant les rochers et se répandant au plus profond des terres. Elles ont déferlé avec fracas, coléreuses et vengeresses, furieuses d’avoir été trop longtemps contenues. Je les ai vues envahir mon jardin, pénétrer dans ma maison et ruiner le mobilier ancien qui avait survécu à toutes les guerres. Les livres, délaissant leurs rayons, se sont mis à flotter au gré de l’eau saumâtre, emportés par les flots aux quatre coins de la chambre, flottant comme des esquifs à la dérive.
J’ai repêché quelques volumes et je suis allé les porter à l’étage. Il y a avait là la Recherche et puis le Voyage. Ils dégoulinaient sur le plancher et c’était une pitié de les voir dans cet état, complètement trempés, ruisselants, avec de l’eau qui ressortait d’entre les pages quand j’appuyais sur la couverture. C’était une vraie désolation, j’en avais le cœur fendu.
De désespoir, j’ai abandonné la maison. J’ai enfilé mon manteau et suis parti vers le haut de la falaise pour contempler le spectacle de la nature en furie sans prendre le risque de me noyer.
La mer était enragée. Elle se précipitait contre les rochers à pic, qu’elle prenait littéralement d’assaut, terminant sa course en énormes gerbes d’écumes qui faisaient bien vingt mètres de haut. Je n’avais jamais rien vu de semblable et me sentais bien petit au milieu de ce déchaînement des éléments. Paradoxalement, à cause de cette démesure même, la vie me semblait prendre tout son sens. Comme si le fait de sortir de la routine quotidienne donnait une autre dimension à mon existence ou comme si le monde bien ordonné que j’avais toujours connu pouvait subitement être remis en cause par la sauvagerie de la nature.
Je suis resté là des heures, à contempler l’océan. Quand la nuit est venue, les phares de la côté ont tenté de trouer les ténèbres, tandis que les cornes de brumes criaient à l’envi leur désespoir.
Je suis redescendu et ai regagné ma maison. L’eau s’en était allée et il ne restait sur le parquet que les livres, épaves échouées et dispersées là par le hasard.
Une page de mon existence venait d'être tournée.

20:29 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature
16/12/2014
La maison des vacances (suite et fin)
Une salle immense s’ouvrait devant moi, qui devait bien faire trente ou quarante mètres de profondeur et même peut-être davantage. Mais ce qu’il y avait d’extraordinaire, c’étaient les murs, où étaient suspendus une bonne cinquantaine de portraits. Nous nous sommes avancés, Marie et moi, et je dois dire que c’était vraiment impressionnant ! On se serait cru au milieu d’une foule, tant tous ces personnages étaient nombreux. Les premiers portaient des habits d’un autre temps et une épée pendait à leur côté. D’autres avaient l’air de militaires du temps de Louis XIV ou de mousquetaires. Il y avait des capitaines de navires, dont les trois mats étaient peints en arrière-plan au milieu d’une mer agitée. Plus on avançait, plus l’habillement se rapprochait de celui de notre époque. Il y avait des notables habillés en grands bourgeois qui n’auraient pas déparé dans un roman de Balzac, des banquiers dressés derrière leur comptoir, des notaires au visage sévère et aux imposantes lunettes métalliques. Venaient ensuite des espèces d’industriels, des érudits, des politiciens haranguant une foule imaginaire. Plus nous progressions au milieu de cette galerie, plus nous nous sentions mal à l’aise car ces personnages au regard perçant semblaient tous nous fixer et nous examiner d’un air désapprobateur. Il nous a fallu un certain courage, observés comme nous semblions l’être, pour continuer notre visite jusqu’au bout. Là, sur le mur du fond, se trouvaient les derniers descendants de cette famille illustre : des chercheurs en blouse blanche, des écrivains, des professeurs de faculté, des médecins, quelques ingénieurs et même un informaticien. Au bas du portrait de celui-ci figurait une date de naissance, mais pas encore de date de décès, ce qui me troubla profondément.
Nous sentant de plus en plus mal à l’aise, nous avons retraversé cette grande galerie pour rejoindre la sortie, mais plus nous avancions, plus il me semblait une nouvelle fois que les yeux des portraits nous suivaient. Par exemple, si j’en observais un qui se trouvait devant moi, sur la droite, son buste était tourné dans ma direction et son regard était plongé dans le mien, comme si j’avais eu affaire à un individu vivant. Mais quand j’arrivais à sa hauteur, le personnage me regardait toujours et son buste curieusement semblait droit. Par contre, lorsque j’ai jeté un bref coup d’œil en arrière après l’avoir dépassé, j’ai été stupéfait de constater qu’il me fixait toujours et que son buste semblait à nouveau tourné dans ma direction.
Bref, c’est quasi en courant que nous avons atteint la sortie et là il s’est produit quelque chose de vraiment extraordinaire. Nous avions déjà quitté cette galerie, mais je me suis retourné encore une fois et là j’ai vu (ou en tout cas j’ai cru voir) tous les portraits qui étaient penchés dans ma direction, comme s’ils sortaient de la toile, et qui me fixaient. J’ai fermé les yeux un instant et quand je les ai rouverts, tout était normal, chaque personnage avait repris sa place initiale, celle que le peintre lui avait attribuée.
Nous avons regagné notre chambre et pour la première fois, je ne sais pourquoi, j’ai tourné la clef dans la serrure à double tour derrière nous. La réalité était que nous semblions aussi inquiets l’un que l’autre. Décidemment, la visite de cette maison nous avait plongés dans un drôle d’état. Pourtant, objectivement, il n’y avait rien de plus normal que de trouver les portraits des ancêtres dans une vieille demeure comme celle-ci. Marie s’est endormie une fois la lampe éteinte, mais son sommeil était agité et elle remuait sans cesse en gémissant sourdement. De mon côté, je ne parvenais pas à dormir et je gardais les yeux grand ouverts dans le noir, essayant de me souvenir à quelle famille illustre avait appartenu cette maison. A la fin, j’ai dû m’assoupir et j’ai fait un rêve étrange dans lequel apparaissaient plusieurs des personnages découverts dans la galerie des portraits. Ce rêve reste assez flou dans ma mémoire, mais j’en conserve le sentiment d’avoir été amené devant des juges et condamné irrémédiablement. C’est le notaire qui a lu le verdict final et devant les mousquetaires de Louis XIV qui riaient à gorge déployée, le capitaine au long cours m’emmena sur son bateau pour me conduire dans une île déserte où il devait m’abandonner.
Je me suis réveillé en sursaut et une sueur froide coulait sur mon front. J’avais au fond de moi un tel sentiment de solitude et d’abandon que j’en frémissais. J’ai allumé la lampe et à ma grande surprise j’ai vu que Marie était assise sur le bord du lit et ses yeux grand ouverts semblaient remplis de panique. « Ecoute » me dit-elle. Je prêtai l’oreille et j’entendis des voix qui provenaient du fond de la maison. On aurait dit que des dizaines de personnes s’étaient réunies là et qu’elles tenaient une assemblée politique ou un meeting. Ca parlait fort, ça criait, ça riait. Ce n’était pas possible ! Le propriétaire aurait-il loué une partie de la maison pour une fête ou un mariage et cela sans nous prévenir ? Cela n’avait aucun sens, d’autant plus qu’hier au soir, à part Marie et moi, cette maison était parfaitement déserte. Je me suis approché de la porte et précautionneusement j’ai tourné la clef. Une fois dans le corridor, les voix me parvinrent beaucoup plus distinctement. J’ai avancé lentement, sans faire de bruit, mais j’avoue que je n’en menais pas large. Marie, qui me suivait, est venue se blottir contre moi. Nous avons traversé le salon et la salle à manger découverts hier, mais ces pièces étaient vides. Les voix venaient de plus loin, probablement de la galerie des portraits. Nous avons donc pénétré dans les quatre salles vides, toujours sans faire le moindre bruit. Je sentais la main de Marie qui tremblait sur mon bras, ce qui ne me rassurait pas beaucoup. Les voix provenaient bien de la grande galerie aux portraits, dont la porte était fermée, mais un rai de lumière filtrait en-dessous. Nous nous sommes approchés et précautionneusement j’ai tourné la poignée. A la vue de ce qui s’offrit alors à moi, j’ai poussé un cri. Les personnages dont on avait peint autrefois les portraits semblaient être sortis de leur cadre en bois. Ils se penchaient à l’extérieur de celui-ci comme s’ils avaient été accoudés à une fenêtre Certains tenaient un verre en main, d’autres riaient, d’autres encore semblaient tenir entre eux une conversation animée. Quand ils nous virent, tous tournèrent la tête dans note direction. Cela ne dura qu’une seconde, puis la lumière s’éteignit brusquement. Je tâtonnai pour trouver l’interrupteur et quand la lumière réapparut, tout était normal : les portraits étaient immobiles dans leur cadre, comme ils avaient toujours été depuis des siècles.
Nous nous sommes regardés, Marie et moi, puis nous nous sommes mis à courir en direction de notre chambre où nous nous sommes enfermés. Nous avons immédiatement rassemblé nos affaires, fourré le tout dans les sacs à dos et trois minutes plus tard nous descendions comme nous pouvions la montagne en direction de notre voiture, dans le noir et sous la pluie battante qui continuait à tomber. En nous retournant, nous avons aperçu la maison. Elle était silencieuse et on la distinguait à peine dans l’obscurité. Pourtant, avant de mettre le moteur en marche, il m’a semblé entendre comme un grand éclat de rire, mais je ne saurai jamais si j’avais rêvé ou non.

00:05 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature
11/12/2014
La maison des vacances
C’était une grande maison.
Elle était beaucoup trop grande pour nous, mais nous l’avions louée comme cela, pas chère d’ailleurs, vu qu’il n’y avait ni eau ni électricité et qu’elle était loin de tout. C’est ça qui nous avait séduits, en fait. Pour l’atteindre, il fallait faire deux bons kilomètres à pied à partir d’une petite route communale où il ne passait jamais personne. Que rêver de plus pour passer des vacances tranquilles ? C’était l’idéal : pas de bruit, pas de voisins et une vue superbe sur les montagnes. Bon, le premier jour il avait fallu faire cinq allers-retours depuis la voiture pour acheminer dans des sacs à dos tout ce dont nous avions besoin. C’était un peu épuisant, je le reconnais, surtout après les mille deux cents kilomètres que nous avions derrière nous, mais il faut savoir ce que l’on veut dans la vie. En tout cas, ce soir-là, nous avons bien dormi, je peux vous le dire, sans savoir d’ailleurs si c’était à cause du silence environnant ou à cause de la fatigue, mais ce qui compte, c’est le résultat, non ?
Le lendemain, on s’est levé tard, mais dès qu’on a ouvert les volets, on s’est retrouvé au paradis. La montagne, la chaleur, le cri-cri des insectes, tout nous enchantait. On a pris le petit- déjeuner sur la terrasse (enfin sur une des trois terrasses) tout en admirant le paysage. Qu’est-ce que c’était beau ! Et qu’est-ce que cela nous changeait de la grande ville, avec tous ces passants qui vous bousculent sur les trottoirs, ces voitures bruyantes, ce stress permanent. Non, franchement, ni Marie ni moi ne regrettions d’avoir pris cette location. Puis nous avons mis une baguette et un saucisson dans un des sacs à dos et nous sommes allés faire une grande balade. Du haut des sommets, la vue était encore plus magnifique : derrière les montagnes, il y avait d’autres montagnes et tout derrière on apercevait la mer Méditerranée. Un véritable paradis, je vous dis. On est redescendu et quand on est arrivé à la maison, il faisait presque noir. On a mangé dans l’obscurité, sans lampe, pour épargner la bonbonne du Camping-gaz. Avec la lune qui s’était levée, on y voyait suffisamment. J’avais juste déposé une petite bougie sur la table et c’était romantique à souhait. La lumière tremblotante éclairait nos visages et Marie n’avait jamais été aussi belle. Cette nuit-là, nous avons fait l’amour comme nous ne l’avions plus fait depuis longtemps.
Puis le temps a commencé à défiler comme cela arrive toujours en vacances. Il faut dire que tous les trois jours il fallait redescendre au village pour faire les courses, puisqu’il n’y avait pas de réfrigérateur. A chaque fois, cela supposait plusieurs allers-retours entre la voiture et la maison. Autant dire que la nuit nous surprenait alors qu’on n’avait pas encore tout rangé dans les armoires. On s’endormait immédiatement et on ne se réveillait que vers dix heures du matin, tant on était épuisé par toutes ces marches. Il est vrai que les jours où nous étions libres (je veux dire quand il ne fallait pas faire les courses) nous n’arrêtions pas de gravir tous les sommets des alentours. Après deux semaines, nous avions escaladé les six pics qu’on voyait de la maison. Enfin, quand je parle de « pics » c’est un peu exagéré. Nous étions en moyenne montagne, avec des sommets qui ne dépassaient pas les mille huit cents mètres, mais cela nous faisait quand même des promenades avec des dénivellations de plus de mille mètres et avec cette chaleur, ce n’était pas toujours évident. L’eau était d’ailleurs notre principal problème. Pour faire notre toilette, il y avait la citerne d’eau de pluie (encore que nous l’utilisions avec parcimonie car j’avais constaté que le niveau d’eau était particulièrement bas à notre arrivée), mais pour boire, il fallait bien utiliser des bouteilles d’eau minérale. Evidemment, plus nous marchions en montagne, plus nous avions soif et plus nous buvions. Mais plus nous buvions, plus vite il nous fallait acheter des bouteilles et donc retourner au magasin, ce qui signifiait de nouveaux allers-retours entre la voiture et la maison, où nous arrivions de nouveau assoiffés.
Bref, après deux semaines à ce rythme-là, nous devions avoir perdu chacun trois kilos, ce qui s’expliquait par nos grandes randonnées, mais aussi par le fait que nous avions décidé de rationner la nourriture, afin de devoir faire les courses le moins souvent possible. Les sentiers environnants avaient été parcourus dans tous les sens et nous allions commencer à nous ennuyer quand le temps s’est gâté. Il y a eu un orage terrible, qui a rempli complètement la citerne et qui a fait tomber la température. Du coup, nous avions moins soif et c’était une bonne chose. Les jours qui ont suivi cet orage ont été franchement mauvais. De la maison, on ne distinguait plus les sommets, perdus dans la grisaille et les nuages. Impossible, donc, de faire la moindre balade sans risquer de se perdre. Alors on a sorti des placards les livres que nous avions eu la bonne idée d’emporter avec nous. J’adore lire, mais j’avoue qu’après être resté assis douze heures d’affilée, je n’en pouvais plus. C’était à peine si mes yeux parvenaient encore à lire les lettres. Visiblement, Marie n’en pouvait plus non plus, alors pour la première fois nous sommes partis à la découverte de la maison. Cela va peut-être vous sembler étrange, mais elle était si grande qu’à part quelques pièces que nous avions parcourues le premier jour, nous ne l’avions pas encore visitée.
Nous avons donc erré de salles en salles et avons arpenté des centaines de mètres de corridors. Nous nous sommes ainsi retrouvés dans de grandes salles à manger aux beaux meubles en chêne, dans des salons dont tous les fauteuils étaient camouflés sous des housses, dans des salles de bain immenses dont les murs, recouverts de miroirs, multipliaient à l’infini notre image étonnée dans une sorte de mise en abîme fantastique. Nous avons ainsi découvert une bibliothèque dont le rayonnage, qui montait jusqu’au plafond, recouvrait les quatre murs. Les livres qui s’entassaient là devaient dater d’un autre temps, si on s’en tenait à leur couverture en cuir ouvragé. L’œuvre la plus récente que j’ai pu découvrir était la correspondance de Voltaire. Par contre, tout le XVI° siècle était bien représenté, depuis les Dames galantes de Brantôme jusqu’au Don Quichotte de Cervantès, en passant par les poésies de Ronsard. Curieux quand même. On aurait dit que le temps s’était arrêté et que ce qui était postérieur au XVIII° siècle n’avait pas franchi les murs de cette maison. J’étais en train de me demander à quelle époque elle avait été construite quand Marie, qui avait pris de l’avance dans la visite pendant que je fouinais dans les livres, m’appela avec insistance. J’ai traversé en hâte quatre pièces vides qui communiquaient entre elles par des portes intérieures et quand je suis arrivé devant la cinquième, je suis resté bouche bée.
(à suivre)
14:53 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature
27/11/2014
Cimetière breton
Comme il y avait trop de monde sur la plage ce jour-là, j’avais décidé de me promener à l’intérieur des terres et de marcher jusqu’à une petite chapelle qu’on apercevait dans le lointain, perchée au-dessus d’une falaise à pic. Voilà déjà quelques jours que je la regardais et que je me disais que la vue devait être superbe, de là-haut. Me voilà donc en route, admirant au passage les maisons basses de pêcheurs, toutes en granite rose. Bientôt je me suis retrouvé dans la lande, complètement seul. C’était délicieux tout ce calme. Je voyais en contrebas la mer qui écumait gentiment contre les premiers rochers, tandis que de grands oiseaux blancs décrivaient de larges courbes dans le ciel pur de juillet. Intérieurement, je me moquais de la stupidité de tous ces touristes qui s’entassaient là-bas sur le sable et qui comme vue n’avaient que le dos rougi par le soleil d’un de leurs congénères.
Une heure se passa ainsi, à gravir lentement la pente qui montait vers le haut de la falaise. La petite chapelle devenait plus distincte et je m’aperçus alors qu’elle n’était pas si petite que cela. En fait, ce n’était pas une chapelle, mais plutôt une église. En m’approchant encore davantage, j’ai remarqué qu’un mur fort bas l’entourait et j’en ai déduit aussitôt qu’il devait s’agir là d’un cimetière marin, où étaient enterrés tous les pêcheurs dont le bateau avait sombré et dont la mer avait rejeté le corps sur le rivage. Quant à ceux qui n’avaient pas eu cette chance, une simple dalle de granite avec leur nom devait rappeler qu’ils n’étaient jamais revenus.
J’ai continué à marcher, tout en me remémorant le fameux poème de Valéry sur le cimetière marin de Sète :
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Entre les pins palpite, entre les tombes;
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencée
O récompense après une pensée
Qu'un long regard sur le calme des dieux!
C’est donc en rêvant un peu que je suis arrivé devant l’entrée du cimetière, dont la vieille grille était ouverte. Il y avait là une petite vingtaine de tombes, à moitié enfouies dans la végétation. A vrai dire, l’endroit était charmant et émouvant à souhait. Penser à tous les drames humains que cachaient ces pierres tombales vous touchait directement au cœur. Je m’apprêtais à parcourir l’allée centrale quand je me suis retourné. Là, appuyée contre une vieille barque, se tenait une jeune fille. Ma stupéfaction fut totale. D’abord la présence de cette barque ici, au haut d’une falaise, était assez insolite, mais finalement je me suis dit qu’on l’avait certainement amenée là pour symboliser le métier de tous les marins que la mer avait emportés alors qu’ils tentaient de gagner leur vie. Mais la jeune fille, elle, je ne l’avais vraiment pas remarquée en pénétrant dans le cimetière, où je m’étais vraiment cru seul.
Je l’ai saluée et me suis approché. Elle pouvait avoir dix-sept ou dix-huit et avait un air grave et sérieux. On a un peu parlé. Elle m’a dit s’appeler Jeanne Martin et m’a raconté le naufrage de l’un ou l’autre des pêcheurs qui étaient enterrés là. C’était toujours la même histoire en fait : ils partaient un beau matin quand la mer était calme, puis une tempête imprévue se levait et finalement le bateau ne rentrait jamais au port. Une semaine plus tard, on retrouvait des débris le long des rochers et parfois, mais pas toujours, un corps échoué sur la plage.
Elle se tut un bon moment et je sentais qu’elle avait encore quelque chose à dire, mais qu’elle n’osait pas poursuivre. Visiblement, il y avait au moins un accident qui sortait de l’ordinaire. Je lui ai alors demandé s’il n’y avait pas des imprudents qui partaient même quand la mer était grosse. Elle soupira et dit que oui, en effet. Après un autre silence, elle avoua que c’était ce qui était arrivé à son père. Il avait entendu dire qu’un banc de maquereaux se tenait au large depuis plusieurs jours. Il y avait une houle pas possible et le vent soufflait fort, mais il avait voulu partir quand même. Il fallait comprendre, il devait rembourser l’emprunt de la maison ainsi que celui de la voiture. Et puis il était courageux et s’en sortait toujours. Sauf que cette fois-là, cela avait tourné à la tempête. La mer était vraiment démontée. Il a d’abord tenté de regagner le port, mais le bateau déviait vers les falaises, alors, voyant qu’il n’arriverait à rien, il a préféré regagner le large, afin d’éviter les récifs. Malheureusement, la nuit est tombée et il ne savait plus où il était. Le navire a fini par se fracasser ici même, contre cette falaise où il est enterré aujourd’hui.
Je ne savais plus que dire après toutes ces révélations et j’avalais péniblement ma salive en cherchant une phrase de consolation qui ne venait pas. Quel discours tenir quand on parle de la mort et quelle consolation apporter à une pauvre orpheline qui a perdu son père ? Pour dire quelque chose, j’ai demandé quand cet accident avait eu lieu. Elle m’a répondu qu’il y avait eu quatre ans cet hiver. Puis elle m’a désigné la tombe, celle qui était tout au bout du cimetière. Autrement dit, le dernier naufrage en date. Je me suis donc avancé jusque-là et j’ai regardé la pierre de granite. Deux noms y étaient inscrits :
Jean Martin ( 05.06.1960 – 03.03.2010)
Jeanne Martin (02.07.1993-03.03.2010)
Et là j’ai commencé à compter tout en tremblant. Le père, le marin, avait cinquante ans quand il était décédé. Et une de ses filles était donc avec lui dans le bateau puisqu’elle était morte le même jour. Ca on ne me l’avait pas dit. Et elle avait quel âge au juste ? Dix-sept ans… Dix-sept ans ? Et elle s’appelait… Jeanne.
« Jeanne », criai-je en me retournant vers l’entrée du cimetière. Mais près la vieille barque de pêche, il n’y avait plus personne.

00:05 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature
16/11/2014
Le cercle
Elle lisait sur la plage. A côté d’elle, son enfant jouait. Petit seau, petite pelle, il faisait un château de sable, comme tous les enfants. Elle lisait et le soleil sur son corps était agréable. L’enfant, lui, était maintenant occupé à tracer un grand cercle autour de lui avec sa pelle. Il souriait. « Qu’est-ce que tu fais ? »lui demanda-t-elle distraitement. « Je trace un cercle magique », répondit-il. « Personne ne peut venir à l’intérieur, car je suis un magicien et ce cercle est une ouverture vers un autre monde. » « C’est bien, lui répondit-elle, amuse-toi. ». Elle replongea dons son livre. La chaleur du soleil était si agréable qu’elle ferma un instant les yeux. On n’entendait que le bruit des vagues, qui là-bas s’échouaient sur la plage. Elle était bien. Après quelques minutes, elle ouvrit les yeux. Dans le cercle magique, il n’y avait plus personne. L’enfant avait disparu.

12:47 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature
11/11/2014
Un enterrement pas ordinaire (5)
(FIN)
00:05 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature
06/11/2014
Un enterrement pas ordinaire (4)
Plus personne ne pensait à aller manger. Au contraire, tout le monde était dehors et attendait. Les conversations, cela va sans dire, allaient bon train. Certains ricanaient : et si Victor s’était perdu ? Lent s’empara de la foule. On se sentait revivre !
(...)
01:29 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature
30/10/2014
Un enterrement pas ordinaire (3)
...en travers de sa route, le destin s’en chargerait peut-être lui-même.
00:10 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature
25/10/2014
Un enterrement pas ordinaire (2)
(...)l
Quant à ses fils, n’en parlons pas. Ils avaient été élevés à la dure, c’est le moins que l’on puisse dire. J’entends par là qu’ils avaient littéralement été roués de coups quand ils étaient enfants. Là aussi, il aurait fallu porter plainte, mais qui aurait osé ? Un jour pourtant, l’instituteur, n’y tenant plus, avait décidé de parler à Victor. Il était allé jusque chez lui mais n’avait même pas eu l’occasion d’entrer. L’autre l’avait repoussé si violemment sur le seuil même de la porte que le pauvre était tombé des quatre marches du perron et s’était cassé un bras. Ce soir-là, pendant qu’il était à l’hôpital pour se faire soigner, son logement de fonction avait mystérieusement pris feu. Les pompiers avaient trouvé près du poêle le bidon d’essence que l’enseignant laissait toujours au garage et qu’il destinait à sa voiture. Il y avait eu une enquête, bien entendu, mais les gendarmes avaient conclu à une négligence, même si l’instituteur n’arrêtait pas de dire à qui voulait l’entendre que jamais, au grand jamais, ce fichu bidon n’avait quitté le garage. Une fois l’année scolaire terminée, dégoûté, il demanda sa mutation et on ne le revit plus jamais.
00:05 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature