27/02/2009
Sur les ruines de l'Histoire

Chacun, pour survivre, est obligé d’affirmer la pertinence de ses actes et le bien fondé de sa pensée. Forcément. On trouve toujours une justification à tout. Si j’ai telle opinion politique plutôt que telle autre, j’aurai mille arguments à avancer pour expliquer que j’ai raison et que ce sont les autres qui se trompent. Même chose pour les actes de la vie quotidienne et même pour la culture. C’est normal. Devant l’infini des possibles qui se présentent à nous, nous faisons des choix, choix qui servent à justifier notre position d’homme libre à nos propres yeux d’abord et aux yeux des autres ensuite.
Malheureusement, nous décidons souvent selon des critères qui nous échappent en grande partie et qui proviennent de l’éducation, du milieu social ou culturel dans lequel nous évoluons, de l’âge, du groupe ethnique, etc. Bref, nous sommes tellement influencés à notre insu dans ce qui préside à nos décisions que notre liberté est somme toute fort limitée, mais ce n’est pas grave car nous n’avons pas pleinement conscience de ce déterminisme (si c’était le cas, nous serions désespérés en permanence devant notre impuissance à formuler un raisonnement vraiment original). Non, ce qui compte, c’est que nous croyions vraiment à notre liberté et à notre capacité de prendre des décisions en toute indépendance. C’est nécessaire pour notre moral et notre santé mentale. La nature nous a ainsi programmés.
Le problème, c’est que cette propension à croire que ses propres choix sont forcément corrects n’est pas seulement l’apanage de l’individu. Les groupes humains, autrement dit les sociétés, fonctionnent de même. C’est ainsi que chaque peuple est persuadé de détenir « la » vérité et est tout à fait convaincu que sa civilisation est la meilleure. A bien y réfléchir, cette civilisation qui est la nôtre est tout simplement la meilleure à nos yeux d’abord parce que nous n’en connaissons pas forcément d’autres et ensuite parce qu’effectivement elle correspond à ce à quoi nous sommes habitués depuis l’enfance. C’est donc quelque part de bonne foi qu’il nous semble que notre culture dépasse celle des autres peuples : elle est celle qui nous convient le mieux parce que nous avons toujours baigné dedans que nous en sommes imprégnés.
Jusque là, rien de bien grave, on le voit. Les sociétés reproduisent à une grande échelle les convictions bien ancrées qui caractérisaient déjà les individus. Non, le vrai problème commence quand ces peuples décident d’imposer leur vison du monde à leurs voisins. Le motif initial de leurs conquêtes territoriales est rarement le désir d’étendre cette culture qui leur est propre, d’ailleurs. Les visées sont plutôt de nature politique, économique ou militaire. Cependant, une fois qu’on a pris possession de la terre de ses voisins, il faut bien se justifier à ses propres yeux et là la prévalence d’une certaine culture sur une autre vient souvent appuyer et expliquer les visées impérialistes, expansionnistes ou colonialistes.
C’est ainsi donc que les Espagnols débarquèrent en Amérique du Sud et furent à la base de la destruction de la culture indigène. Après tout il ne s’agissait que de sauvages moins évolués et en plus qui ne croyaient pas en Dieu. Pourtant, si les conquérants avaient parlé avec leur cœur, ils se seraient rendu compte que ces gens dits sauvages appartenaient simplement à autre âge historique que le leur. Ils en étaient encore à l’époque des cultivateurs-éleveurs, c’est tout, comme nos propres ancêtres l’avaient été avant nous. Viendrait-il à l’idée de quelqu’un de massacrer un enfant parce qu’il n’a pas atteint la pleine maturité ? C’est pourtant ce que firent les peuples d’Occident en massacrant les Aztèques et autres Incas. La foi catholique servit également de justificatif indirect à ces massacres et à part Las casas, on n’a pas vu beaucoup d’ecclésiastiques s’élever contre cette barbarie qu’on qualifierait aujourd’hui de génocide.
Bon, je ne suis pas ici en train de honnir la culture occidentale à laquelle je suis fier par ailleurs d’appartenir (pour les raisons expliquées ci-dessus), mais on ne peut pas non plus faire comme si tout cela n’avait pas existé. Maintenant je ne me fais aucune illusion. Les autres civilisations ne valent pas mieux de ce point de vue et c’est toujours celui qui est le plus fort qui domine et qui perpétue des massacres. Les Huns, les Vikings et autres Vandales ne se posèrent pas beaucoup de questions quand ils vinrent piller les ruines de l’empire romain, pas plus que Rome ne s’en était posées quand elle conquit les Gaulois, lesquels avaient fait trembler la même ville de Rome quelques siècles plus tôt (voir l’épisode des oies du Capitole en 390 avant JC, tel que le raconte Tite-Live). Les Arabes envahirent l’Espagne, les Turcs firent le siège de Vienne (1529), les Russes repoussèrent les frontières de la Pologne en 1945 après l’avoir en partie annexée quelques années plus tôt et l’OTAN bombarda bien Belgrade dans un conflit qu’il faut bien qualifier d’expansionniste (voir la position de l’écrivain allemand Peter Handke sur le sujet) et ne parlons pas de l’Irak et du pillage des musées de Bagdad, les faits étant trop récents pour que nous puissions les avoir oubliés.
Bref, l’histoire de l’humanité (celle qu’on apprenait autrefois dans les salles de classe en la présentant sous son meilleur jour et qu’on n’apprend plus du tout aujourd’hui, ce qui simplifie bien les choses) n’est faite que de sang versé et de conquêtes justifiées.
Le bon droit (ou ce que l’on a appelé tel) l’ayant emporté, il nous semble normal à nous qu’on s’exprime en espagnol (et en portugais ) en Amérique du Sud et qu’on parle anglais plus au Nord. Ce serait oublier les peuples qui vivaient là autrefois et qui ont quasiment disparu ( les Indiens d’Amérique du Nord) ou dont la culture survit de manière sous-jacente (Indiens quechuas, etc.). Ces peuples pourtant avaient aussi une civilisation à laquelle ils croyaient pour les mêmes motifs que nous croyons à la nôtre. A l’heure où certains se permettent de douter du massacre juif durant la dernière guerre, il est peut-être bon de rappeler que la terre entière n’est qu’un immense charnier et que ce ne sont pas les génocides qui ont manqué (Arméniens, Amérindiens, Rwandais, etc.)
Que dire en contemplant ces ruines imposantes des Andes ou du Mexique ? Que dire ? Rien, se taire tout simplement et ne pas oublier que l’homme est un loup pour l’homme. Je n’ai pas visité ces monuments d’Amérique, mais je me suis promené autrefois dans l’ossuaire de Douaumont, qui rassemble tous les ossements des soldats tombés à Verdun. Que dire devant autant d’horreur ? Quel est le sens de toutes ces jeunes vies détruites ? Aucun évidemment. Encore qu’ici les cultures française et allemande ont survécu. Ce n’est encore qu’un moindre mal, si on peut dire. Mais ailleurs, quand il ne reste plus d’une culture que des ruines de pierres ? Que faudrait-il dire ? Quels mots pourraient exprimer la tristesse devant ce qui fut et qui a disparu ? Quel est le sens de l’Histoire, si elle n’est qu’une accumulation de souffrances et de massacres ?

00:27 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : histoire
25/02/2009
Une vie
Toi qui es assise au bord du monde
et qui regardes la mer
a quoi penses-tu quand descend le soir
et que la marée monte?
Rêves-tu du temps infini de l’enfance
quand il te semblait voir dans l’onde du fleuve
des châteaux merveilleux
aux reflets troubles et bleus ?
Revois-tu la jeune fille que tu fus
et qui s’en allait par les chemins,
cueillant des fleurs étranges
qui ressemblaient un peu à l’amour ?
Penses-tu à l’amante des mille nuits
qui se donnait au roi
en son palais d’outre-mer ?
Es-tu, pour un instant, la mère jeune et belle
qui offrait à l’enfant nouveau né
la couronne de son sein ?
Toi qui es assise au bord du monde
et qui regardes la mer
a quoi penses-tu quand la nuit est venue
et que la marée a fini de monter ?
Es-tu de nouveau la jeune adulte
qui s’en va sur des chemins solitaires
chercher d’autres châteaux
dans une Espagne de rêve ?
Ressembles-tu à celle qui cueillit enfin une fleur
au bord du fleuve
en souvenir de son enfance
et de ce que peut-être elle fut ?
Ou bien, lassée de tout,
as-tu été séduite par l’onde merveilleuse
au reflet trouble
où disparaissent tous les châteaux ?
Que cherches-tu encore et toujours
dans la nuit noire, devant la mer
quand la marée déjà
n’en finit plus de descendre
et que tu restes là, au bord du monde ?
Oui, que cherches-tu, belle étrangère ?

Image Internet
01:00 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature, poésie
24/02/2009
Nocturne
Par les soirs d’été
je contemplais la mer
sa masse ondoyante
et ses vagues déferlantes.
J’y cherchais les traces du souvenir,
d’un temps qui n’est plus
ou qui peut-être jamais ne fut.
Comment savoir si ce qui fut
a été ailleurs que dans les rêves ?
Tout n’est-il pas inventé ?
Aboli aussitôt qu’apparu ?
Reste ma mémoire
garante du néant
pour témoigner de ces êtres
qui se sont tus.
Grosses déferlantes sur les rochers,
vagues ondoyantes, écume de la nuit.
Il faut scruter la mer, les soirs d’été
quand tombe la nuit…

Image Internet
00:39 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésie
22/02/2009
De l'enseignement des auteurs classiques
C’est devenu un peu la mode dans nos écoles, me semble-t-il, d’inviter des auteurs à venir parler de leur oeuvre ou de la manière dont ils écrivent. C’est assurément une bonne initiative et je ne vais pas m’insurger contre cette pratique. Cependant, je me demande si c’est la bonne manière de faire aimer la littérature.
La première question qui se pose, c’est celle de savoir si un écrivain vivant est plus intéressant qu’un écrivain mort. A partir du moment où c’est l’œuvre qui compte pour elle-même, on doit quand même se demander pourquoi tous les classiques sont un peu mis systématiquement de côté au profit de textes plus contemporains qui sont supposés être plus proches des centres d’intérêt des élèves. Pourtant, il y a tout de même des livres relativement abordables (soit par leur longueur, soit par les thèmes exposés) qui mériteraient d’être étudiés en classe. Certes la langue classique demande un effort, mais je n’ai pas dit non plus d’aborder racine ou Corneille à 12 ans. Les romanciers du XIX°, par exemple, devraient quand même pouvoir intéresser les grands adolescents.
Certes je comprends bien la démarche qui consiste à inviter un auteur et je ne la blâme certainement pas, mais il ne faudrait pas faire que cela. Le but est manifestement de montrer que la littérature n’est pas inabordable et qu’un écrivain, finalement, est quelqu’un comme tout le monde (enfin presque comme tout le monde). On peut le voir, le toucher et il peut parler de sa passion, de son travail, etc. toutes choses qui devraient susciter la curiosité. Donc, invitons les auteurs. Mais il faudrait que ceux-ci parlent de leur œuvre car c’est cela qui compte, non ?
Ce que je crains, en fait, c’est une solution de facilité. Ce n’est plus le jeune qui fait un geste vers le livre, c’est l’auteur qui se déplace pour venir parler de lui. Mais si c’est pour apprendre à quelle heure il se lève le matin, combien d’heures il travaille, s’il boit du thé ou du café, s’il a un plan préconçu pour son livre, s’il écrit à la plume ou sur son PC, et bien cela ne nous amène pas à grand chose. Ce qui compte, c’est le texte écrit et l’approche de ce texte écrit. Or un écrivain mort n’est pas dans sa tombe mais dans ses livres et à ce titre il a droit lui aussi au chapitre.
Je me demande s’il n’y a pas une volonté politique inavouée de reléguer le livre aux oubliettes.
La gauche est partie du principe que les enfants issus des classes sociales défavorisées avaient peu de chance d’obtenir un diplôme, ce qui allait les pénaliser dans leur existence. Elle n’a pas tort. Mais du coup, elle a misé sur la facilité. Il fallait baisser le niveau des études pour permettre à tout le monde de réussir. Dans cette optique, le niveau de langue (et on sait que dans les classes aisées, un bon niveau est généralement atteint pour ainsi dire naturellement) ainsi que la pratique de la lecture devaient être strictement réglementés. Plus d’auteurs classiques donc, jugés incompréhensibles puisque parlant une langue tout à fait inconnue pour certains jeunes. Le problème, c’est qu’autrefois l’école permettait justement à ces jeunes de progresser et de sortir en partie de leur milieu (en accédant à la culture dite bourgeoise). Aujourd’hui, je ne suis plus certain qu’elle le permette encore. Certes on aura obtenu un diplôme, mais que représente-t-il en fait ?
A côté de cette dérive de la gauche, la droite, elle, s’est toujours inquiétée de voir le savoir se répandre dans les classes subalternes. Car qui sait raisonner est capable de se rendre compte de l’iniquité d’un système qui l’exploite. Qui a fait des études est capable de revendiquer clairement ce qu’il estime lui être dû. Donc, le livre, là aussi, est devenu un objet dont il faut se méfier. Le résultat, on le connaît. La suppression des épreuves de culture générale dans les concours d’accession à la fonction publique est significative. Plus besoin d’avoir lu La Princesse de Clèves pour faire un bon douanier ou un bon postier, pense un certain président que je ne nommerai pas. C’est vrai évidemment. On a donc orienté la sélection sur les tests de personnalité (une bonne secrétaire doit d’abord être soumise, un bon vendeur doit être entreprenant, etc.), ce qui à mon avis est contestable mais tout aussi injuste que l‘inégalité devant l’école et le savoir. En effet, dans ce cas on ne me juge plus sur ce que je sais (et que j’ai fait l’effort d’apprendre) mais sur ce que je suis (or comment changer la personnalité pour correspondre au poste à pourvoir ?)
Puis, le système ayant sans doute montré ses limites, on en est maintenant à tester la compétence. L’enseignement a emboîté le pas en se disant que de toute façon on oublie à peu près tout ce qu’on a appris sur les bancs de l’école et donc qu’il vaut mieux ne plus rien apprendre. Ce qui compte, in fine, c’est de savoir faire. Certes, mais comment devenir un bon laborantin si je n’étude pas la chimie en profondeur ? Le système qui est en train de se mettre en place est vicieux car on ne donne pas toutes les bases nécessaires aux jeunes générations, mais on leur demande quand même de savoir résoudre le problème qui leur est posé à l’examen. A partir du dossier qu’ils ont sous les yeux (et donc ils ne connaissent strictement rien au départ sur le fond), les plus malins parviendront à proposer une réponse qui se tient. Ceux-ci seront recrutés car considérés comme intelligents et capables de s’adapter à des situations toujours nouvelles. A quoi cela sert-il d’avoir étudié le droit ? Les lois changent quand même sans cesse. Ce que le directeur du personnel (pardon, le Human ressources manager) qui m’engage désire surtout, c’est que je sois capable, par tous les moyens, de remporter les procès intentés contre sa firme. Moralité : à un système injuste, on en substitue un encore plus injuste car on naît intelligent dans certains domaines, on ne le devient pas. Et puis qu’est-ce que l’intelligence ? Il n’y a pas que l’intelligence livresque ou rationnelle (celle que veut développer l’école), il y a toutes les autres : affectives, intuitives, etc. Or on risque de me refuser un emploi parce que je n’aurais pas tel type d’intelligence alors que j’en possède peut-être de nombreux autres…
Enfin, bref, on me juge désormais sur une compétence supposée.
Dans une telle optique, la question de la culture (et donc de la lecture) devient tout à fait secondaire, on l’aura compris. Et puis de toute façon les usines vont continuer à fermer et à se délocaliser. Le nombre des chômeurs va croître d’une manière vertigineuse. Pourquoi dès lors passer son temps à former l’ensemble des citoyens ? Il suffit d’en former 20%, ce sera bien assez, les autres iront quand même au chômage, diplôme de lettres ou pas en poche. Et puis ce qui manque ce sont des chauffeurs de camions, pas des poètes ou des archéologues. Et que ferait-on avec un chauffeur qui lit la Princesse de Clèves, je vous le demande. Mieux vaut donc réduire les impôts (surtout ceux des sociétés, afin qu’elle soient concurrentielles) et ne plus dépenser bêtement de l’argent dans les écoles.
Conclusion : droite comme gauche sont tombées d’accord pour ne pas se poser la bonne question, qui est de savoir comment on pourrait transmettre le meilleur au plus grand nombre ?
Car si l’ancienne école était sélective sur les contenus, les plus courageux pouvaient encore espérer réussir par leur volonté. Maintenant la sélection est toujours aussi sévère mais on ne conserve qu’une tranche réputée « compétente ». Tant pis pour ceux qui n’en font pas partie. Pourtant il est évident que la culture conduit à plus d’humanité et à moins de barbarie. Mais en quoi une société qui fonde ses valeurs sur l’échange des marchandises a-t-elle besoin de la culture ? Du coup, l’apprentissage de la langue et les livres passent au second plan (ou au troisième).
Pourquoi les jeunes ne lisent-ils pas ? Parce que la littérature est trop difficile ? Non, parce qu’elle est trop difficile pour eux, ce qui n’est pas pareil. Et si elle est trop difficile, c’est parce qu’on ne leur a pas appris à lire. Une fois passé le cap de la première année primaire, on estime qu’un enfant sait lire. Mais c’est une capacité qui ne demande qu’à s’exercer. Il faut développer les potentialités de l’enfant, disent les programmes, partir de son vécu, de ce qu’il connaît et le pousser plus loin. Et bien justement, allons-y. Tout enfant de trois-quatre ans adore qu’on lui raconte des histoires. Une fois l’apprentissage de la lecture acquis, il faut continuer. Quelle joie pour l’enfant de pouvoir enfin lire tout seul ses histoires favorites, sans devoir attendre le bon vouloir d’un adulte (je me souviens encore de cette joie qui fut la mienne : acquérir une indépendance totale face aux histoires que je pouvais enfin lire autant de fois que j’en avais envie et quand j’en avais envie, sans parler de la fierté de savoir lire, évidemment). Or il semblerait bien que l’école ait fini par décourager cette petite flamme qui brillait au fond des yeux des bambins, si on en juge par le niveau de lecture des adolescents.
Maintenant, j’accuse ici l’école, mais n’est-elle pas le simple reflet de notre société ? Si elle s’adapte (et pas toujours dans le bon sens, comme on le voit), c’est simplement parce qu’elle essaie de suivre comme elle peut l’évolution de la société. On lui reproche d’ailleurs sans cesse de ne pas être assez en phase avec le monde professionnel. On retombe donc toujours sur la même problématique : la société a besoin de chauffeurs de camions et de vendeur d’aspirateurs, il nous faut donc des écoles qui préparent à ces métiers, disent certains.
Pourtant il me semblait qu’une rencontre personnelle avec les grandes œuvres de l’humanité ne pouvait pas faire de tort. Il est même des auteurs dont la lecture peut changer une vie et dont on ne sort pas intacts.
Evidemment, si la vie idéale consiste à regarder le football, à s’enrichir et à s’acheter le dernier modèle d’enregistreur vidéo, alors effectivement il ne sert à rien de lire. Mieux vaut apprendre à écraser l’autre que de se plonger dans les subtilités psychologiques de la Princesse de Clèves, non ?

01:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, auteurs classiques, enseignement
20/02/2009
Réflexion
"Il regardait la lumière révéler les contours de l’eau stagnante dans les champs de l’autre côté de la route.
- Où on va quand on meurt ? dit-il
- J’en sais rien dit l’homme. On est où en ce moment ?
Le soleil apparut au-dessus de la plaine derrière eux.
(…)
- Je suis né au Mexique. Je n’y suis pas retourné depuis bien des années.
- T’y retournes maintenant ?
- Non.
Billy acquiesça.
L’homme contemplait le jour naissant.
- Au milieu de ma vie, dit-il, j’en ai tracé le parcours sur une carte que j’ai longuement étudiée. J’essayais de voir le dessin qu’elle faisait sur la terre parce que je croyais que si je pouvais voir ce dessin et en connaître la forme alors je saurais mieux comment continuer. Que je saurais mieux ce que devait être mon chemin. Que je pourrais lire dans l’avenir de ma vie.
- Qu’est-ce que cela a donné ?
- Autre chose que ce que j’attendais."
Cormac Mc Carthy, « Des villes dans la plaine ».
09:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature, cormac mc carthy
19/02/2009
L'école buissonnière
En cette période de vacances scolaires (pour certains) ou de presque vacances (pour d’autres), les salles de classe étant vides, il serait intéressant de se pencher sur l’expression «faire l’école buissonnière ». Celle-ci signifie, comme chacun sait, « ne pas aller au cours » mais quelle en est l’origine ?
L’explication la plus logique, c’est évidemment la référence au mot « buisson » : les élèves qui ne se rendent pas à l’école vont se promener dans les champs et se cacher dans les buissons, où leur présence passerait inaperçue. Selon certains, l’expression remonterait au XV° siècle, époque où on en aurait donné la définition suivante : « promenade dans les chemins creux ou parmi les buissons qui cachent les fuyards. »
Le problème, c’est que certains philologues proposent une autre explication.
L’expression trouverait son origine dans le fait que les prélats qui devaient se rendre au Concile de Pavie, en 1423, refusèrent de s’y rendre parce que la peste sévissait dans cette ville. Ils seraient donc restés dans la campagne environnante. Comme argument, ceux qui proposent cette interprétation avancent cette phrase de Clément Marot.
«Vray est qu'elle fust buissonnière, l'escolle de ceux de Pavie ».
D’autres pensent au contraire que l’expression daterait plutôt du XVI° siècle, époque où les protestants auraient créé des écoles secrètes (nommées buissonnières parce qu’elles se situaient dans les campagnes) afin d’éviter les écoles de la ville de Paris, qui étaient toutes entre les mains du clergé catholique. Si cette interprétation est la bonne, l’école buissonnière impliquait donc qu’on aille aux cours, mais le fait d’être absent des écoles officielles de Paris où les élèves auraient dû se trouver, permettrait de comprendre le glissement de sens.
Une petite recherche sur Google m’a permis de trouver deux expressions espagnoles pour désigner le même phénomène.
1. Hacer novillos (hacer = faire ; novillo = jeune taureau) : en Andalousie les élèves qui ne suivaient pas les cours préféraient aller dans les prés afin de toréer les jeunes taureaux et tenter ainsi d’accomplir leur rêve de devenir un jour des toréadors professionnels lesquels, soit dit en passant, sont souvent issus des classes sociales les plus pauvres car il faut être pauvre pour risquer ainsi sa vie à chaque combat dans l’espoir de conquérir la gloire et de devenir riche.
2. Hacer campana (en catalan Fer campana), autrement dit, « faire la campagne». On ne confondra pas ce mot « campaña » (avec une tilde sur le n) avec le même terme (sans tilde sur le n) qui signifie « cloche » en castillan (campanella en latin). Ici, c’est un mot issu directement du latin campus- campi (campagne cultivée, champ) ou de l’adjectif campañeus, ea, eum (de la campagne, champêtre). Cet adjectif au neutre pluriel (campanea) est devenu un substantif et a pris le sens de « champs ».
On ne confondra pas non plus ce « campaneus » avec le nom propre Campania, qui a désigné d’abord la Campanie, en Italie, puis une province gauloise, aujourd’hui la Champagne.
08:02 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : langue française, expression, école buissonnière
17/02/2009
Giordano Bruno

Le 17 février 1600, le philosophe Giordano Bruno est brûlé vif à Rome, après avoir passé huit ans dans les geôles de l'Inquisition. Avant son exécution, ses bourreaux lui arrachent la langue, afin qu’il ne prononce plus des «paroles affreuses».
Né en 1548 près de Naples, Filippo Bruno est issu d’une lignée de gentilshommes aux revenus modestes. A l’école, il étudie les auteurs classiques ainsi que la langue et la grammaire latines. On le retrouve à 14 ans en train de suivre des cours à l'université publique de Naples. Il se passionne pour la mnémotechnique (art de la mémoire) et discute beaucoup de philosophie. A dix-sept ans, il rentre chez les Frères prêcheurs de San Domenico Maggiare, sans doute à cause de la réputation intellectuelle de cette institution dominicaine, peut-être aussi pour échapper à la misère, car les disettes et les épidémies sont fréquentes. Et puis à cette époque comment s’instruire et devenir un intellectuel sans passer par le clergé ? Il adopte le prénom de Giordano en hommage à un de ses maîtres en métaphysique (Giordano Crispo), ce qui laisse tout de même supposer qu’il n’était pas hermétique à cette discipline. D’ailleurs on le retrouve prêtre en 1573 puis lecteur en théologie en 1575 (thèse sur Thomas d'Aquin et Pierre Lombard).
Sa curiosité intellectuelle le pousse dans toutes les directions. Il lit Erasme, alors que celui-ci est déjà considéré comme hérétique, adore l’hermétisme et la magie et commence à s’intéresser sérieusement à la cosmologie, mais en dehors de toute considération théologique. Bientôt, il s’oppose à sa hiérarchie sur le dogme de la Trinité.
J’avoue qu’il y a là une subtilité que je n’ai jamais comprise non plus : ces trois dieux qui n’en sont qu’un relève d’une conception étrange. En fait Dieu est dit unique dans l’Ancien Testament, mais voici qu’arrive le Christ, qui se dit fils de Dieu, puis il y a aussi l’épisode de la Pentecôte, avec l’Esprit saint. L’Eglise devait donc concilier tous ces aspects si elle voulait promouvoir une religion monothéiste. Dieu a donc été déclaré le père et Jésus le fils, mais ne procédant pas du premier (étant éternel comme lui). Etrange. On a décrété que sa spécialité était le Verbe (parce que Jésus enseignait par des paraboles ?) tandis que l’Esprit se voyait attribué un rôle d’intercesseur ou d’intermédiaire. Trois missions, trois rôles, pour une divinité unique, on avouera que c’est assez compliqué et c’est finalement ce qu’a dit un jour G. Bruno, qui préférait s’appuyer sur son intelligence plutôt que sur le dogme catholique. Du coup, une instruction est aussitôt menée contre lui afin de le déclarer hérétique. En homme habile, Bruno prend les devants et renonce à son habit de Dominicain.
Malheureusement, cet épisode le conduit à une vie aventureuse et misérable. Au début, il parvient à rester en Italie, change tout le temps de domicile et survit en donnant des leçons de grammaire. On le retrouve à Genève où il espère enfin trouver la paix dans la patrie de Calvin. Malheureusement, là aussi, il entre en conflit avec la hiérarchie protestante (il conteste la compétence d’un des membres de cette hiérarchie). Le voilà donc de nouveau exclu, alors il repart, à Lyon d’abord, puis à Toulouse, où il enseigne la physique et les mathématiques. Un ouvrage sur la mnémotechnique (« Clavis Magna ») le fait connaître du roi Henri III (celui qui est resté célèbre par ses « Mignons »), qui devient son protecteur. Voilà donc Bruno à Paris et sa réputation n’arrête pas de croître. Philosophe officiel de la Cour, il enseigne au Collège des lecteurs royaux (futur Collège de France) et développe sa pensée. C’est l’époque où les tensions religieuses sont à leur comble entre Catholiques et Protestants, mais notre philosophe, sagement, renvoie dos à dos les extrémistes des deux camps.
En 1582, il écrit une comédie satirique « Le Chandelier », puis se rend en Angleterre, où ses idées suscitent beaucoup de controverses. Il répond à ses détracteurs par des livres : La cène des cendres, La cause, le principe et l'un, De l'infini, l'univers et les mondes. Dans ces ouvrages, il expose non seulement la version de Copernic mais il va même plus loin, en admettant un univers infini et peuplé par d’autres êtres vivants. On se doute qu’une telle conception ne pouvait pas plaire à l’Eglise, qui s’en tenait à la conception d’un univers fait par Dieu pour l’homme, ce dernier y occupant la place centrale.
Bon, à côté de ces traits de génie, il dit aussi quelques âneries, comme cette idée que la matière est animée et que c’est volontairement qu’une planète s’expose au soleil.
En 1585, il publie L'expulsion de la bête triomphante ouvrage dans lequel il oppose l’humanisme aux conceptions protestantes et catholiques. Puis, dans La cabale du cheval de Pégase il s’en prend à Aristote, qui apparaissait à l’époque comme la sommité la plus accomplie. Enfin, dans Les fureurs héroïques il précise que l’univers n’a pas de centre, conception qui n’a pu que choquer les théologiens car si la terre n’est plus le centre du monde, l’homme non plus. Fruit du hasard et non plus produit de la volonté divine, son existence est arbitraire. Scandale, évidemment, devant de tels propos !
De retour en France, les ennuis commencent. Le roi ne se risque pas trop à prendre position (on est en pleine querelle religieuse entre Catholiques et Protestants, il ne va pas, en plus, soutenir un hérétique). Nous le retrouvons donc en Allemagne, mais il est bientôt excommunié par les Luthériens. Il repart en exil une nouvelle fois, mais il continue à écrire: De immenso, De monade, De minimo (sur l’infiniment petit). Il revient en Italie (à Venise), espérant obtenir une chaire de mathématique à l'université de Padoue. L’homme qui l’avait aidé dans son retour (un certain Mocenigo) est vexé qu’il ne veuille pas lui apprendre la mnémotechnique et il finit par le dénoncer à l'Inquisition.
Les chefs d’accusation ne manquent pas :
- rejet de la transsubstantiation et de la trinité, blasphème contre le Christ, négation de la virginité de Marie
- pratique de l'art divinatoire
- croyance en la métempsycose
- vision cosmologique erronée
Le procès va durer sept ans et il subira la torture. Il lui arrivera de se rétracter, mais se sera pour se reprendre aussitôt. « Je ne crains rien et je ne rétracte rien, il n'y a rien à rétracter et je ne sais pas ce que j'aurais à rétracter» dira-t-il. Il est donc condamné au bûcher, il n’y a pas d’autre alternative pour le tribunal de l’Inquisition, qui risquait à la longue de perdre la face devant ce raisonneur obstiné. On dit qu’à l’annonce de sa sentence il se serait écrié : « Vous éprouvez sans doute plus de crainte à rendre cette sentence que moi à l'accepter ». Il est exécuté le 17 février 1600, sur un bûcher installé sur le Campo Dei Fiori à Rome.
Citation : « (...) Si j'erre, c'est contre mon gré. Quand je parle et quand j'écris, je ne dispute point par amour de la victoire (car j'estime ennemies de Dieu, des plus viles et des plus ignobles, toutes réputation et victoire dénuées de vérité). Mais c'est par amour fervent de la sagesse et de l'observation vraies que je m'épuise, m'inquiète et me tourmente (...)»
G. Bruno
Point de vue du Vatican :
« La condamnation pour hérésie de Bruno, indépendamment du jugement qu'on veuille porter sur la peine capitale qui lui fut imposée, se présente comme pleinement motivée.»
Le 3 février 2000, le cardinal Poupard, par ailleurs docteur honoris causa des universités de Louvain, Aix-en-Provence, Fu Jen, Quito, Santiago du Chili et Puebla de los Angeles et responsable au Vatican du "Pontificam consilium cultura" (qui réhabilita Jan Hus et Galilée) confirma que Bruno ne serait pas réhabilité. Il déplora tout de même qu’on ait employé contre lui l'usage de la force. Autres temps, autres mœurs.

23:26 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : histoire, inquisition, giordano bruno
La cabane dans les bois (9)
En sortant de l’hôtel pour prendre l’air, je suis tombé en arrêt devant la statue de Cristobal el Colon qui se trouve à l’entrée du vieux port. J’ai souri en voyant l’explorateur fixer l’horizon et tendre le doigt vers la mer, dans un geste qui résume bien tout son désir d’aller conquérir des terres nouvelles, malgré la difficulté qu’il y a à les atteindre. Je me suis dit qu’entre lui et moi il y avait comme un air de famille car finalement j’avais poursuivi mon rêve jusqu’au bout du continent et si je ne ramenais pas d’or, au moins avais-je accompli ce pour quoi j’étais parti. En plus, je revenais avec une richesse autrement plus importante puisqu’elle était tout intérieure. Alors, complètement rassuré, j’ai parcouru les Ramblas dans tous les sens puis j’ai visité la cité, avide de tout connaître. Tard dans la nuit, j’arpentais encore les ruelles louches de la vieille ville, passant d’un bar à tapas à un autre, sentant l’ambiance, percevant l’atmosphère, m’en imprégnant jusqu’à plus soif. Il était bien quatre heures du matin quand j’ai regagné mon hôtel et que je me suis endormi du sommeil du juste.

Après, tout a été très vite. A midi j’étais dans le train pour la frontière. Un vent brûlant s’engouffrait par les fenêtres ouvertes et on voyait la Méditerranée, la mare nostrum des Romains, qui resplendissait dans son éternité. C’est sur cette mer que le fier Ulysse avait accompli tous ses voyages, devenus désormais mythiques et c’est sur ces rivages qu’il avait aimé tant de femmes et de déesses. Il suffisait de fermer les yeux et de se laisser porter par le balancement du train, tout en respirant l’odeur acre des genets ainsi que celle des oliviers et des pins, pour l’imaginer aux commandes de son navire, parcourant la mer bleue et longeant les côtes à la recherche de sa patrie pour finir par découvrir l’amour dans des ports improbables. Mais au bout du voyage, il retrouve le chemin de sa maison et rentre dans son foyer, accueilli en premier par son chien fidèle, qui est le seul à le reconnaître.

Quand j’ai rouvert les yeux, le train se frayait un passage entre des masses de rocher. Il venait d’atteindre les Pyrénées. Il fallut franchir la frontière puis changer de convoi, l’écartement des rails étant différent d’un pays à l’autre. Ensuite, nous avons roulé sur une étroite bande de terre entre la mer et des étangs, dans un paysage irréel, un peu fantastique, tandis que dans le lointain les montagnes barraient l’horizon. Le train prit de la vitesse. Je laissais l’Espagne derrière moi, une étape était franchie. Puis nous avons continué encore et encore, pour ainsi dire sans aucun arrêt. Les villes défilaient, écrasées de soleil, avec leurs toits rouges et leurs murs ocres. Perpignan, Carcassonne, Toulouse, Montauban… C’est ainsi qu’à six heures du matin, je débarquais à Paris. Un sandwich, un métro, un TGV cette fois et j’étais déjà reparti. On a roulé longtemps puis en début d’après–midi je me suis retrouvé dans le vieux car brinquebalant que j’avais pris au départ. J’en suis descendu sur la place du village où régnait toujours le même calme impressionnant. J’ai mis mon sac sur mes épaules et j’ai continué à pied. En passant non loin du cimetière, j’ai vu que tous les habitants étaient rassemblés là. Je ne sais pas pourquoi j’ai pensé que c’était la petite vieille qui était décédée, celle qui autrefois m’avait jeté un regard noir en sortant du car. On entendait le curé qui psalmodiait un chant en latin. Toutes les têtes qui étaient penchées vers la tombe se sont relevées pour me voir passer sur la route. Moi j’ai continué. Il me restait seize kilomètres à faire et je voulais arriver avant la nuit.
La cabane était toujours là et la porte a à peine grincé quand je l’ai poussée doucement. J’ai allumé un feu et je me suis fait un thé bien chaud, que j’ai bu en tenant la tasse dans le creux des mains, pour me réchauffer car il faisait un peu froid. Des volutes de vapeurs s’échappaient du breuvage, formant des spirales aux formes étranges. Je les contemplais distraitement, regardant bien au-delà. Ce que je voyais, c’étaient tous ces paysages que j’avais traversés, ces routes que j’avais empruntées, ces trains qui m’avaient entraîné au bout du monde. Dans ces nuages de vapeur apparaissaient comme des flashes l’océan déchaîné sur la côte Atlantique, les rues en pente d’Almeria, un grand bateau blanc qui quittait le quai et enfin une fille extrêmement belle qui me souriait. La boucle était bouclée et j’étais revenu à mon point de départ. Epuisé, je me suis jeté sur le lit, tandis que les flammes crépitaient dans l’âtre et qu’une bonne chaleur accueillante se répandait dans la pièce. Je me suis endormi comme cela, tout d’un bloc et ce fut un long sommeil réparateur et sans rêves. Juste avant de sombrer, il m’a semblé entendre au loin les loups qui hurlaient, mais je n’en suis même pas sûr.

FIN
"Feuilly"
08:02 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature
16/02/2009
La cabane dans les bois (8)
Je suis resté sur mon banc pendant des heures. A un certain moment un bruit strident de sirène a retenti. C’était le « Ciudad de Sevilla » qui appareillait pour le Maroc. Peut-être était-elle à bord, mais cela n’avait plus aucune importance. Elle avait sa vie, son univers et j’avais les miens. Le plus extraordinaire avait été notre rencontre, finalement, à laquelle tout aurait dû s’opposer. Mais elle avait eu lieu et c’était le principal. J’avais parcouru plus de deux mille kilomètres pour que nos destins puissent se croiser un instant. J’avais obtenu ce que je cherchais, j’avais connu l’amour, même s’il avait été bref, j’avais connu son corps et aussi étrange que cela puisse paraître, je me sentais apaisé. Elle, je l’avais cherchée dans mes rêves et je l’avais trouvée, connue, aimée. Tout cela me semblait bien. C’était une belle expérience de vie, comme une initiation. Maintenant j’étais vraiment moi-même et je savais que quoi qu’il puisse m’arriver j’aurais cette force en moi qui ne me quitterait plus, cette force née du fait de l’avoir rencontrée et d’avoir vécu cette expérience unique. Plus tard, sans doute, j’expliquerais tout cela par écrit et j’y trouverais comme l’aboutissement d’une quête existentielle, mais pour le moment je ne sentais qu’un grand apaisement. J’étais bien c’est tout et je crois que je me suis assoupi à moitié, là, sur ce banc, alors que tombait le crépuscule. Quand j’ai ouvert les yeux un instant, le « Ciudad de Sevilla » n’était plus qu’un point à l’horizon. Je me souviens encore confusément que ce point devint de plus en plus petit et qu’à la fin il disparut complètement. Il ne restait que l’étendue de la mer, aussitôt remplacée dans mon rêve par une grande plaine enneigée, éclatante de blancheur et incroyablement belle.

Quand je me suis réveillé, il faisait nuit noire. Je me suis acheminé lentement vers la gare de la Renfe. Quand il fut six heures, j’ai pris un ticket pour Paris. L’employé derrière son guichet me regardait d’un air goguenard. Il devait me prendre pour un drogué ou un alcoolique.
Le train démarra dans l’air frisquet du matin, cet air propre à tous les ports de mer, chargé d’humidité, de sel et de saveurs étranges. Puis il prit de la vitesse, au milieu d’une campagne désertique, faite de rochers et de figuiers de barbarie. Encore quelques heures et cet endroit se transformerait en une fournaise impitoyable, mais moi je n’y serais plus.
Ce fut ainsi que je remontai vers le Nord, vers mes terres à moi, mon univers. Le convoi était désespérément lent. Il s’arrêtait on ne savait pourquoi dans des bourgades minuscules, si petites qu’on se demandait ce qu’elles faisaient là, toutes seules en pleine montagne aride. Ce n’était partout que caillasses et rochers, sans la moindre végétation. Pourquoi avait-on eu l’idée de construire là des habitations et pourquoi le train s’y arrêtait-il ? Sans doute par pitié, pour que ces habitants ne se sentent pas trop seuls, coupés du monde comme ils étaient. Je me disais qu’on leur devait bien cela. Après tout j’avais bien eu ma chance, moi, en rencontrant mon amour, ils méritaient bien eux aussi d’avoir la leur. Ce train qui s’arrêtait chez eux était une invitation au voyage, une possibilité qui s’offrait à eux de partir, de quitter ce désert et d’aller trouver un sens à leur vie ailleurs, dans des contrées inconnues.

Mais personne ne montait et le train repartait. Un peu plus loin il s’arrêtait en rase campagne sans que l’on sache pourquoi. Cela pouvait durer d’une demi-heure à une heure puis il repartait. Les noms de villes succédaient aux noms de villes. Il faisait nuit quand nous arrivâmes à Madrid Chamartin. Je me retrouvai dans le train de Barcelone et le trajet continua. On roulait dans la nuit noire, toutes fenêtres ouvertes tant il faisait chaud et on entendait le cri désespéré du klaxon qui se répercutait dans l’immensité du plateau de vieille Castille.
Dans la glace des WC je ne me suis pas reconnu. Je ressemblais à un bandit évadé de prison et j’ai essayé de remettre un peu d’ordre dans ma tenue. Puis je me suis étendu sur une banquette vide et je me suis endormi. Ce sont les haut-parleurs qui m’ont réveillé bien plus tard. Le train était arrêté en gare de Barcelone et le jour se levait.
Malgré cette nuit passée à dormir, j’étais trop fatigué pour continuer, aussi j’ai décidé de faire une pause dans cette ville qui était tout de même la capitale de la Catalogne. Je me suis mis à la recherche d’un petit hôtel et j’en ai trouvé un pas trop cher derrière la Grand Poste. Je suis resté une demi-heure sous ma douche, heureux de sentir l’eau claire et tiède parcourir mon corps, me purifiant de toute cette poussière accumulée au cours du voyage. Quand enfin j’ai fermé le robinet, il m’a semblé que j’étais devenu un autre, comme si une page avait été tournée et qu’une partie de mon passé, avec ses incertitudes, était maintenant derrière moi. J’ai dormi quelques heures d’un sommeil réparateur et sans rêves et à mon réveil je me suis senti fort et content de moi.

00:25 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
14/02/2009
La cabane dans les bois (7)

Puis, un beau matin, elle ne fut plus là. Le vide, l’horreur, l’inconcevable. Où était-elle ? Je voulais me rassurer et je me disais qu’elle était sans doute partie se promener seule, mais une telle initiative, qui n’avait pourtant rien d’inquiétant, aurait déjà marqué un changement radical dans son comportement. De plus je savais au fond de moi que cette hypothèse était fausse et que la vérité était bien plus grave. Néanmoins, je me mis à chercher comme un fou, inspectant chaque crique, arpentant toutes les plages, contournant tous les rochers. Rien. Pas la moindre trace de sa présence. Je me suis même éloigné du rivage et pour la première fois j’ai pénétré dans le désert de roches et de poussière qui nous entourait. Mais où chercher ? Et puis de toute façon il n’y avait rien. La journée s’est passée comme cela et je me suis retrouvé devant la mer quand le soir commençait à tomber. Ma chère inconnue avait disparu. C’est alors que je me rendis compte que je ne connaissais même pas son prénom. Quand nous nous appelions, nous utilisions ces petits mots tendres qu’inventent les amoureux. Il n’y avait rien de plus normal. En attendant, je me retrouvais seul et je me rendais compte qu’elle avait totalement disparu, non seulement physiquement et affectivement, mais même sur le plan symbolique, puisque que je ne pouvais même pas la nommer en lui donnant un nom. Il ne restait que le vide, un vide pascalien et au-dessus de moi ces milliards d’étoiles inconnues et indifférentes.

Je crois que j’avais de la fièvre d’avoir autant pensé. Le désespoir peut-il rendre malade ? En tout cas je me souviens que je tremblais de tous mes membres et que mes dents s’entrechoquaient. A la fin j’ai dû m’assoupir (on ne peut pas appeler cela dormir). Je me suis réveillé aux premiers rayons du soleil. C’était le deuxième jour sans elle qui commençait. Alors je me mis en route en direction d’Almeria. Le chemin était long, long et épuisant par cette chaleur. Pas un arbre, pas un rocher, pas la moindre ombre, rien que cette route qui n’en finissait pas et au-dessus de moi un soleil immense que je n’osais même pas regarder tant il faisait mal aux yeux. Après bien des kilomètres, je me suis assis devant une maison isolée, qui se trouvait là, allez savoir pourquoi, perdue dans ce désert. A ma grande surprise, elle était habitée. En effet, au moment où je m’apprêtais à partir, la porte s’ouvrit doucement et une petite vieille toute de noir vêtue montra le bout de son nez. Elle ne semblait pas plus étonnée que cela de me voir là, devant sa demeure. Je lui demandai si elle n’avait pas rencontré une jeune fille aux grands yeux noirs et à la chevelure d’ébène. Elle fit non de la tête puis, sans doute alertée par mon accent étranger, elle me montra la route qui continuait vers Almeria et rentra précipitamment chez elle. La porte claqua avec un bruit sec. On aurait dit que la petite vieille venait de refermer le couvercle de son propre cercueil, tant le silence qui suivit fut impressionnant. Quelque part, pourtant, c’était moi qui étais mort, complètement désespéré et incroyablement amoureux.
Alors, pour oublier, j’ai marché et j’ai marché. Des kilomètres et des kilomètres. J’avais soif. Faim aussi, bien entendu, mais surtout soif. Forcément, avec une telle chaleur (il devait faire plus de quarante degrés), il fallait être fou pour entreprendre un tel voyage. Et pourtant je continuais, car il me semblait qu’au bout du chemin je trouverais la réponse à ma question. Plus je marchais et plus je me rendais compte que je n’espérais même plus retrouver ma compagne, mais seulement comprendre où elle était partie et surtout pourquoi elle était partie. J’avançais comme un somnambule sur ce chemin poussiéreux, au milieu des cactus, des figuiers de barbarie et des cailloux. L’horizon était désespérément barré par des collines désertiques et au-dessus de moi le soleil continuait de darder ses rayons implacables.

Puis ce fut la nuit et la température s’est enfin mise à baisser. Moi, je continuais de marcher, fixant le mètre de route qui était devant moi. La nuit s’est passée ainsi, à avancer dans le noir. Sur ma droite, un croissant de lune éclairait faiblement les montagnes tandis que sur ma gauche je devinais une lueur opalescente qui devait être la mer. A six heures du matin, j’entrais enfin dans Almeria. Je me suis d’abord rendu à la station d’autobus et pendant des heures j’ai questionné les employés et les voyageurs. Evidemment personne n’avait vu une personne ressemblant à mon amour. De là je suis parti pour la gare des chemins de fer de la Renfe, où je n’obtins pas plus de résultats. Il était déjà midi et j’errais à travers les rues écrasées de chaleur, complètement désorienté et perdu, épuisé par le manque de sommeil. Pas rasé, trempé de sueur, je devais tout doucement ressembler à un clochard, c’est du moins ce que je me suis dit en remarquant le regard étonné des passants, qui me fixaient d’un air ahuri.

Almeria est une ville dont les rues dévalent vers la mer, ce qui fait que je me suis retrouvé sur le port sans même m’en rendre compte. Je me suis assis sur un banc et j’ai contemplé les deux grands navires qui étaient à quai. L’un, je m’en souviens bien, s’appelait le « Ciudad de Sevilla ». Derrière moi, dans une sorte de parking couvert, des centaines de voitures venant de l’Europe entière attendaient pour embarquer. Il y avait des Espagnols, forcément, mais aussi des Français, des Allemands, des Danois et même des Suédois. C’étaient tous les travailleurs immigrés du continent qui profitaient des vacances pour retourner au pays. Ils s’entassaient là, cinq ou six par voiture, dormant et cuisinant par terre, dans la chaleur étouffante, espérant faire partie du prochain voyage pour le Maroc. C’est là que subitement j’ai tout compris. Ma belle compagne au teint basané devait elle aussi être retournée dans son pays. Elle était probablement venue en Espagne comme travailleuse clandestine et était repartie comme elle était venue. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais j’avais l’intime conviction de détenir la vérité. Ce n’était même plus la peine d’aller interroger les employés du port.

00:27 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature
13/02/2009
La cabane dans les bois (6)
Nous sommes restés au Cabo de Gata une quinzaine de jours peut-être, vingt tout au plus. Nous vivions en pleine nature, absolument seuls, dormant à la belle étoile et nous réveillant le matin devant la mer immensément bleue. Je ne retournais au village (si on peut appeler cela un village) qu’une fois tous les deux jours pour les provisions. Elle, elle ne m’accompagnait jamais, je ne sais pas pourquoi. On aurait dit qu’elle craignait de se faire remarquer, comme si elle avait commis quelque acte répréhensible. De plus, elle était farouche de nature, méfiante et perpétuellement sur ses gardes. Avec moi, cependant, toutes les barrières étaient tombées rapidement dès le premier regard échangé. On aurait dit qu’elle savait que je la cherchais depuis des mois, on aurait dit qu’elle n’était venue là que pour m’attendre. Cependant, quand elle ne se savait pas observée, je décelais dans son regard comme une grande tristesse qui me faisait craquer encore plus.
Nous parlions peu (elle s’exprimait bien en français, pourtant, ce qui, vu l’endroit où nous nous trouvions aurait dû attirer mon attention ). La journée se passait comme dans un rêve, à marcher le long de la mer ou à se laisser flotter sur l’eau. Il faisait si chaud que nous n’avions pas le courage d’explorer l’intérieur des terres et le seul fait de savoir que derrière nous se trouvait un quasi désert suffisait amplement à nous contenter. De plus, ces kilomètres de terres arides qui nous séparaient d’Almeria et de la civilisation renforçaient notre délicieux sentiment d’isolement. Etre ensemble au bout du monde, rien qu’à deux et complètement isolés de tous me procurait une joie que je n’avais jamais connue. Il faut dire qu’il aurait fallu être difficile pour ne pas être comblé, ma compagne se montrant de plus en plus entreprenante au fur et à mesure que les jours passaient.
Là, tout n’était que luxe, calme et volupté, disait le poète. Si nous n’avions pas le luxe, nous avions assurément le calme et la volupté. Je me souviens de ces nuits étoilées, face à la mer. Nos corps enlacés n’arrêtaient pas de se chercher et nous finissions par rouler dans le sable jusqu’à glisser dans la mer. Alors l’eau salée excitait encore plus notre désir et nous entamions des courses poursuites au milieu des gerbes d’eau écumantes. Quand je parvenais à la rattraper (mais je me dis aujourd’hui qu’elle s’arrangeait bien pour que ce fût possible) elle poussait un cri strident et c’est dans l’eau qu’elle se donnait comme jamais je n’ai vu une femme se donner. Alors elle devenait loquace et tout en m’embrassant elle me disait qu’elle m’aimait vertigineusement. Je trouvais curieux cette expression « aimer vertigineusement », mais au fond c’étaient exactement les mots qui convenaient. Dans la pénombre, mes mains caressaient sa peau sombre de fille du Sud et quand un rayon de lune éclairait son visage, je voyais deux braises au fond de ses yeux, deux braises qui n’en finissaient plus de me contempler et de dire le désir qu’ils avaient de moi. Je redoublais alors de caresses. Quand elle jouissait, elle criait sans retenue dans la nuit noire, sachant qu’ici il n’y avait personne et que le monde nous appartenait. Je n’ai jamais rien entendu de plus beau que ces cris qui manifestaient tout le contentement d’exister et d’être au monde. Jamais je n’ai été aussi heureux, jamais la vie ne m’a semblé aussi pleine de sens que quand nous étions nus sur cette plage, seuls dans l’éternité des galaxies, fragiles sans doute, mais puissants en même temps car c’est nous qui commandions aux forces de l’univers. Nous étions devenus des dieux dans la chaleur andalouse, au bord du monde, face à la mer.

00:37 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : littérature
12/02/2009
La cabane dans les bois (5)
Puis le voyage continua comme dans un songe. A San Sebastian j’ai assisté à des manifestations indépendantistes. Je me suis retrouvé dans les rues étroites et perpendiculaires de la vieille ville, coincé dans une encoignure de porte, les manifestants d’un côté, la police de l’autre, qui chargeait à coup de gaz lacrymogènes. A Salamanca, j’ai médité sur le vieux pont romain qui enjambe le Rio Tormès et j’ai flâné entre les arcades de la Plaza Mayor. Dans les montagnes de la sierra de Francia, au-dessus de Bejar, je me souviens d’un village dont le nom enchanteur valait déjà à lui tout seul tout un poème : Miranda del Castanar. Il fallait une heure pour monter la-haut dans un autocar poussif et quand on arrivait sur la place du village, on croyait avoir atteint le ciel, tant celui-ci semblait proche. Il y avait des cerisiers partout et les paysans vous en vendaient des paniers entiers pour quelques pesetas. Sous la voûte des arcades d’une maison, appuyée à une colonne, une jeune fille en croquait quelques-unes de ses dents blanches et éclatantes. Nos regards se sont croisés dans un instant d’éternité. Puis j’ai repris l’autocar.

En Extremadura, j’ai longé un barrage sur le Tage. Le niveau de l’eau était tellement bas, en cette saison estivale, que le clocher d’une église émergeait du lac, dernier témoignage d’un village définitivement englouti. Des habitants, qui sait, continuaient peut-être à vivre là-bas, plongés dans des rêves aquatiques. En tout cas, au bord de la route, deux vieux paysans, un homme et une femme, regardaient eux aussi ce clocher sorti des ondes et dans leur regard se reflétait la nostalgie du temps perdu, du temps de leur jeunesse. Peut-être est-ce là tout au fond qu’ils s’étaient rencontrés un jour, à un bal du village et qu’ils avaient échangé leur premier baiser. Le progrès avait noyé leur rêve et leurs souvenirs.
A Caceres, j’ai visité une ville qui se croyait encore au XVI° siècle et où les bûchers de l’Inquisition semblaient à peine éteints, tandis que Merida, elle, s’était construite autour de son théâtre de la Rome antique, qu’elle encerclait jalousement. Plus bas, j’ai vu des prairies immenses qui ressemblaient à des forêts, tellement il y avait des arbres dispersés partout. Des troupeaux de taureaux y couraient en liberté, tout en vous observant d’un oeil noir et méfiant. Dans un village du Sud, j’ai pu observer le flamenco authentique, dansé par des filles à la beauté farouche. Endiablées, sensuelles et comme en extase, elles jouaient avec leur corps comme les musiciens avec leurs guitares, tandis que les hommes frappaient en cadence dans leurs mains, plongeant tous les protagonistes au bord de la folie, dans un délire quasi chamanique.

Un petit matin, au Nord de Sevilla, j’ai traversé des collines d’orangers et d’oliviers qui s’étendaient à l’infini. Ce fut l’aube la plus magnifique qu’il m’ait été donné de voir. La ville elle-même, capitale de l’Andalousie, se trouve dans une cuvette et ne bénéficie d’aucun souffle de vent. La visiter en pleine canicule, avec 44 degrés à vingt-deux heures, le soir, fut une épreuve physique sans précédent. Mes efforts, cependant, furent récompensés car c’est là qu’eut lieu ma première rencontre avec la civilisation arabe d’El Andalus et ce fut un choc dont je ne me suis jamais remis. Le raffinement, la beauté et la grâce de ces monuments sont restés à jamais gravés dans ma mémoire, comme tous ces patios des maisons particulières, avec leur végétation et leur petite fontaine, où l’ombre de Garcia Lorca semblait encore errer. Ensuite, j’ai visité Cordoba et sa mosquée, cette forêt de piliers de marbre que l’hégémonie catholique a tenté de transformer en cathédrale sans y parvenir le moins du monde. Puis ce fut Granada et son Alhambra, ce palais enchanteur des mille et une nuits, avec ses dépendances, les jardins du généralife. Dans une des salles du palais, il me sembla entendre encore les cris des Abencérages exterminés par Boabdil avant que celui-ci ne doive finalement remettre les clefs de sa cité à Isabelle, la grande reine de toutes les Espagnes.

J’ai vu les cimes enneigées de la Sierra Nevada, puis Jaen, Lorca et le désert de pierres où il ne pleut jamais. Après avoir dormi dans des bouges infâmes à Murcia et avoir failli perdre la vie dans une agression à Cartagena, je me suis retrouvé à Almeria à contempler la mer.
Il était impossible d’aller plus loin. Pour la première fois je m’arrêtais et je me demandais ce que j’étais venu chercher. La réponse n’était pas évidente. J’avais traversé la moitié de l’Europe pour me retrouver face à moi-même. C’est alors que j’ai compris que je fuyais, que je « me » fuyais et qu’à la fin du voyage c’était encore mon ombre que je voyais devant moi, projetée par la lumière du même soleil. Il n’y avait pas d’issues. J’aurais beau franchir la nouvelle mer qui s’étendait devant moi, visiter des mosquées, traverser des déserts, parler aux Touaregs, remonter le fleuve Congo ou contempler le Kilimandjaro, il ne se passerait jamais rien. Ce qu’il y avait à découvrir était en moi et rien qu’en moi. Là était le véritable voyage.
Pourtant un matin, dans un sursaut de révolte, j’ai repris le chemin, à pied cette fois, et je suis allé jusqu’à l’extrême pointe des terres, au Cabo de Gata. Là, on pouvait dire qu’il n’y avait vraiment plus rien. Ce pays n’était plus qu’un nuage de poussière et on ravitaillait en eau avec un camion citerne les trois maisons qui résistaient là comme elles pouvaient au soleil brûlant. La mer était partout. La mer, le sable et le ciel bleu. Le vent aussi et la chaleur. Rien d’autre. Je me suis avancé sur la plage et c’est là que je l’ai vue. Elle était appuyée au tronc d’un eucalyptus. Elle avait le teint mat des filles de l’extrême Sud, des cheveux d’ébène et deux grands yeux noirs, légèrement en amandes. Elle me fixait sans rien dire. Puis elle s’est appuyée davantage encore contre le tronc de l’arbre et là je l’ai reconnue à sa tristesse. C’était la fille de mon rêve, celle que j’avais fuie ou que j’avais désespérément cherchée, je ne savais plus. Elle a souri et cela a été le commencement du monde.

00:18 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature
11/02/2009
La cabane dans les bois (4)
Il serait vain, ici, de raconter par le détail ce voyage aussi incroyable qu’insolite. Je pris un billet au hasard et me retrouvai dans un train qui aussitôt fendit la nuit noire en direction des ports de l’Atlantique. Dans le petit jour blafard, l’océan m’attendait, marquant la fin des terres et du monde habité. Je suis resté trois jours à le contempler, fasciné par ses vagues immenses qui venaient mourir sur les rochers dans un fracas de fin du monde. Il y avait de la rage dans cette écume baveuse, qui semblait d’abord vouloir tout anéantir puis qui se rendait compte finalement de son impuissance. Elle se tordait alors de désespoir le long des pierres usées, les enlaçant d’une dernière caresse mauvaise et cependant résignée avant de retomber dans le néant de l’onde. Mais aussitôt, révoltée devant sa propre défaite, elle recommençait une nouvelle attaque, voulant imposer le règne de l’élément liquide à cette terre prétentieuse qui osait lui faire face. Hélas, c’était pour essuyer un nouvel échec, d’autant plus cuisant que l’attaque avait été forte. La vague se tordait alors de douleur et, dans un grognement de fauve, regagnait son antre liquide.

Pendant trois jours et trois nuits donc, je suis resté là, aussi patient que l’océan, pour tenter de savoir qui allait finalement remporter cette bataille au devenir improbable. Je dormais sur la plage, à même le sable, emmitouflé dans un sac de couchage de fortune et grignotant les quelques biscuits que j’avais emportés. Dans mon sommeil, il me semblait entendre le hurlement des loups, tout là-bas, dans la forêt que j’avais quittée. Je me réveillais en sursaut : ce n’était que le bruit de la mer qui lançait une nouvelle attaque, plus meurtrière encore que les précédentes, si on en jugeait par le bruit assourdissant et par les embruns qui arrivaient jusqu’à moi, laissant sur mes lèvres un goût amer et inconnu. Je me rendormais aussitôt et faisais d’étranges rêves, dans lesquels des bateaux démâtés partaient à la dérive, poussés par des courants inconnus. Au petit matin, la chaleur du soleil sur mes joues me réveillait. La plage était déserte et la mer, vaincue, avait reculé aussi loin qu’il était possible d’imaginer, laissant à découvert une vaste étendue de sable mouillé. Les mouettes s’y étaient donné rendez-vous. Elles se rassemblaient par centaines, cherchant leur nourriture avec une avidité inquiétante et lançant des cris assourdissants. Il me semblait vivre le premier matin du monde, avant même l’apparition de l’homme.
Puis je suis parti, longeant la côte vers le Sud dans des trains cahotants qui s’arrêtaient dans tous les villages. Après la Charente, ce fut Bordeaux « et ses vastes pontons » comme dit le poète et dans ma tête je fredonnais la chanson de Ferré. (« Je suis un grand bateau descendant la Garonne »). Du haut du pont d’Aquitaine, j’ai contemplé l’estuaire, qui n’en finissait pas de s’élargir en direction de l’horizon tandis que l’immense fleuve, imposant et majestueux, s’avançait gravement vers la mer sans savoir encore qu’il allait à la mort. Derrière moi, dans mon dos, je sentais la présence de dix mille hectares de vignoble qui venaient mourir par vagues successives et je pensais à tous ces hommes qui avaient travaillé cette terre et ces ceps depuis la plus haute Antiquité. Il me semblait être à la jonction de l’histoire et de la géographie, du temps et de l’espace. Paris était bien oublié.
Plus loin, dans la grande plaine, bien plus loin, devait se dresser le château de Montaigne et je me dis que c’était cela aussi voyager : retrouver les lieux décrits dans les livres que l’on a lus ou marcher sur les traces des écrivains qu’on a aimés. Et je me demandais si le paysage dans lequel ces génies ont vécu avait influencé leur pensée. On n’imagine pas un Pierre Loti sans la mer ni un Giono sans sa Provence. Qu’aurait écrit ce dernier s’il n’avait pas vécu à Manosque mais à Roubaix, Rennes ou Rouen ? Difficile à dire.
Puis ce fut la traversée des Landes, avec ses pins maritimes et ses odeurs de résine envoûtantes. Sur cent kilomètres, ce ne fut qu’un seul parfum, tenace et obstiné, qui se répandait dans la chaleur estivale.

A Hendaye, il fallait attendre pour prendre le train vers l’Espagne et pendant deux bonnes heures j’ai arpenté les bords de la Bidassoa. En son milieu, se trouve l’île des faisans. C’est là qu’autrefois les rois de France et d’Espagne mirent fin à la guerre de succession qui opposait leurs deux pays. En terrain neutre, au milieu de l’eau, cette île qui n’était pas plus française qu’espagnole avait permis de trouver un terrain d’entente et de concilier les susceptibilités des grands de ce monde, personne ne voulant mettre un pied chez son voisin ou avoir l’air de faire un pas en sa direction. Les Pyrénées barraient l’horizon, superbes, imposantes et complètement indifférentes à ces querelles humaines, fussent-elles royales. C’est qu’elles savaient qu’il n’y avait qu’une seule et vraie frontière entre les deux pays et que cette frontière, c’étaient elles qui l’imposaient. On se dit parfois, rien qu’en contemplant les paysages, que les querelles des hommes sont bien vaines et leurs ambitions bien stériles.
J’allais d’ailleurs avoir l’occasion de me rendre compte à quel point l’espèce humaine est étrange. J’étais enfin installé dans le petit train qui conduit à San Sebastian et à à peine avais-je traversé Irun qu’un bruit sec fit sursauter tous les passagers. Une des vitres du wagon avait failli voler en éclats. En son centre, on pouvait voir un trou circulaire : c’était un impact de balle. Bienvenue dans la guerre urbaine, bienvenue au pays basque.

00:31 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature
10/02/2009
La cabane dans les bois (3)
Je suis arrivé au village vers midi. Les rues en étaient désertes, les habitants étant probablement occupés à déjeuner chez eux. Il régnait un grand silence, qui me parut plus pesant que celui de la forêt. C’est que ce silence, même s’il pouvait se comprendre à cette heure, avait je ne sais quoi d’inquiétant, un peu comme si une épidémie avait emporté tout le monde ou comme si un commando des forces spéciales était intervenu pendant la nuit et n’avait laissé aucun survivant. Tout imprégné de cette ambiance macabre, je me suis assis sur l’unique banc de la place, le dos appuyé au mur de l’église. C’est là en principe que l’autocar qui passait une fois par semaine devait s’arrêter à treize heures précises pour me conduire à la ville. Il ne me restait donc plus qu’à attendre.
Le temps semble long dans ces cas-là. Moi qui ne m’ennuyais jamais, je me sentais comme mal à l’aise. Je n’avais aucune envie de lire. D’une maison proche, un bruit de vaisselle et de couverts me parvint, preuve que là on était occupé à manger. Un chien passa, sans même me gratifier d’un regard. Superbe dans son indifférence, il menait sa vie de chien consciencieusement, reniflant à gauche et à droite, levant la patte là où il fallait et finalement s’éloignant la tête bien droite, fier d’être ce qu’il était. Je me suis dit que finalement les animaux avaient en eux une dignité intrinsèque que les humains n’avaient pas toujours. Chez nous, beaucoup d’individus semblent résignés ou vaincus. Certains respirent l’ennui, d’autres semblent ne plus rien attendre de la vie. Ils marchent en baissant la tête, sans un sourire, soumis aux obligations qu’ils se sont eux-mêmes imposées. L’animal au contraire, s’il est moins intelligent et s’il se pose moins de questions existentielles (et probablement pas du tout), n’en est pas moins content d’exister. Il semble contenir en lui sa propre perfection. Avez-vous déjà vu un chat devenir dépressif parce qu’il n’a pas réussi à attraper une souris ? Non, il se concentre davantage et attrape la suivante, c’est tout. Un homme, dans des circonstances similaires, se met à douter de lui-même et pour s’apprécier il se croit obligé d’accomplir des exploits au-dessus de ses forces. Le chien que je venais de voir, lui, trouvait son équilibre en lui-même et non en dehors de lui.
J’en étais là de mes réflexions quand un bruit étrange se fit entendre. L’autocar arrivait dans un grand nuage de fumée. Bringuebalant, toussotant et râlant, il se traînait comme il pouvait. A la fin, il s’immobilisa devant moi dans un dernier hoquet, comme s’il venait de rendre l’âme. Une forte odeur d’huile et de gazole brûlés envahirent la petite place. Il fallait croire que le mécanicien de la compagnie avait pris sa pension et qu’il n’y avait plus personne pour régler le moteur. Tant pis pour la pollution ! Manifestement, dans cette campagne reculée, ce n’était le souci de personne. Les portes s’ouvrirent dans un grincement et une petite vieille descendit péniblement les trois marches qui la séparaient du sol, se tenant comme elle pouvait à une rampe métallique qui semblait devoir se détacher d’un moment à l’autre. Par miracle, l’ancêtre mit le pied à terre sans encombre, non sans me lancer au passage un regard noir et méfiant. Etait-ce ma jeunesse qu’elle enviait ? Ou bien avait-elle reconnu l’étranger de la cabane, celui qui vivait au milieu des loups et dont on devait parler le soir au coin du feu ?
Sans me poser de questions, je montai dans l’autocar, pris un ticket et allai m’asseoir sur la banquette du fond. Il n’y avait aucun passager et quant au chauffeur, il ne m’avait même pas salué et n’avait pas prononcé la moindre parole en me rendant la monnaie. Tout cela était assez lugubre et je n’étais pas fâché de m’en aller. Dans un râle étrange, le moteur se remit en marche. L’autocar fit deux ou trois bonds et s’achemina finalement vers la sortie du village. Nous fîmes un écart pour éviter la petite vieille qui trottinait au milieu de la route. A une des maisons, je vis distinctement un rideau bouger puis retomber vivement à notre passage. En me retournant, j’aperçus même quelques habitants : ils commençaient à sortir de chez eux et ils regardaient l’autocar s’éloigner. Etrange contrée tout de même !

Le lendemain dans l’après-midi, j’étais à Paris et je flânais au milieu de la foule le long des quais de la Seine. Le beau fleuve d’Apollinaire coulait calmement sous ses ponts et les librairies d’occasion étaient ouvertes. Le dépaysement était total, comme on s’en doute. L’autocar m’avait d’abord conduit dans une ville. De là j’avais pris un train, puis encore un train, de nuit celui-là, et finalement un TGV m’avait amené directement ici. On ne comprend pas comment deux mondes aussi différents peuvent cohabiter et être finalement aussi proches l’un de l’autre puisqu’une seule journée de voyage suffit à les relier. Ceci dit, il en est ainsi de tout. La nuit, qu’on a du mal à imaginer en plein midi, finit toujours par rattraper le jour et même par l’évincer, ce qui prouve que les contraires se rejoignent. Et, pour prendre un autre exemple, qui a-t-il de plus différents qu’un homme et une femme ? Ils vivent dans des mondes parallèles, opposés même et pourtant les rencontres existent, d’autant plus fortes qu’elles sont plus soudaines.
Tout cela pour dire que ma vie à Paris était à l’opposé de celle que je menais auparavant. Néanmoins, après une semaine, je dus constater que j’avais pris de nouvelles habitudes, tout aussi régulières finalement que les précédentes. La seule différence résidait dans le fait que la visite des musées remplaçait mes promenades en forêt, mais finalement je me sentais aussi isolé ici au milieu de la foule que je ne pouvais l’être là-bas au milieu des arbres. A la limite je me sentais même plus seul, car la nature m’apportait le calme et l’apaisement tandis que je me sentais exclu de cet attroupement de badauds, qui ne me voyaient pas et que je ne voyais pas. A la longue, un sentiment de malaise s’empara de moi, sentiment que je ne parvenais même pas à vaincre une fois rentré à l’hôtel. La lecture des livres me semblait plus fade, dans cette chambre de passage, et les histoires racontées moins essentielles, comme s’il avait fallu la chaleur et l’intimité de mon feu de bois pour leur donner tout leur sens.
Je n’étais pas parti pour m’enfermer dans une chambre d’hôtel mais pour découvrir le monde. Or Paris n’était pas le monde, même s’il en était le centre. Force fut donc de repartir.

00:07 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature
09/02/2009
La cabane dans les bois (2)
Ces nuits-là, je sombrais aussitôt dans le sommeil, que venait parfois interrompre le hululement d’une chouette, dans la clairière toute proche. Je savais que si je me levais, je la verrais sur la branche du grand chêne, les yeux écarquillés dans ma direction, semblant s’étonner sur le sens de ma présence en ces lieux. Mais à quoi bon me lever ? Il faisait froid dans la chambre et j’étais si bien sous ma couette ! Je me rendormais aussitôt, mais des rêves étranges souvent peuplaient mon sommeil. C’était toujours le même rêve, en réalité, mais sous des formes différentes. Il s’agissait d’une femme que j’aurais aimée autrefois (mais quand ?) et qui surgissait comme cela du cœur de la nuit. Elle avait les yeux en amandes comme une louve et me fixait intensément. Cette fixité même m’effrayait un peu et à chaque fois je croyais entendre les hurlements de la meute dans les lointains. Etait-ce le fruit de mon imagination ou y avait-il vraiment des loups occupés à chasser quelque part, je ne saurais le dire. Ce qui est sûr, c’est qu’à chaque fois je les entendais et je sentais mon sang se glacer tandis que la femme continuait à me regarder intensément. Que désirait-elle, quel message voulait-elle transmettre, dans quel but était-elle venue ? Mystère. Pourtant il me semblait percevoir vaguement comme un reproche dissimulé derrière ce regard intense. Comme si je l’avais abandonnée un jour, alors que je ne l’avais jamais vue en dehors de mes rêves. Souvent, je me réveillais en sursaut, saisi d’effroi, tremblant presque. Autour de moi, régnait l’obscurité la plus totale. En prêtant l’oreille, on entendait seulement le trottinement des souris, là-haut au grenier, qui devaient être occupées à grignoter mes réserves de pommes.
Alors je me rendormais, pour ne pas continuer à fixer l’obscurité. Mais aussitôt la femme revenait. Elle était plus jeune cette fois et me souriait. Moi, je ne savais que faire. Parfois, j’essayais de lui parler, mais elle mettait un doigt sur ses lèvres, me signifiant par-là qu’il ne fallait rien dire ou que tout, déjà, avait été dit. Dans son regard, il y avait maintenant une sorte de tendresse. Petit à petit, ma peur s’estompait et je me sentais en confiance. C’est moi, maintenant qui la regardais, tandis qu’elle ne semblait plus s’apercevoir de ma présence. Elle était là, se promenant dans la clairière, sans but précis. Parfois, elle appuyait son front contre le tronc du grand chêne et je sentais comme de la tristesse dans son attitude. J’aurais voulu lui venir en aide, la consoler peut-être. Alors dans mon rêve je me levais et marchais vers elle en vacillant, mais à chaque fois que je j’atteignais enfin l’arbre, elle avait disparu. Une grande tristesse s’emparait alors de moi et il m’est arrivé de me réveiller en pleurs.
Un jour j’en ai eu assez et j’ai décidé de partir. Ce n’était pas que ma vie dans la forêt ne me plaisait plus, bien au contraire, mais ces rêves récurrents devenaient des cauchemars. J’en étais arrivé à ne plus oser m’endormir de peur de me retrouver à nouveau devant ces yeux de louve qui me fixaient ou bien devant cette jeune fille évanescente. Il fallait réagir sinon j’allais devenir fou. Mes lectures, qui n’étaient que plaisir pur au début, étaient en train de devenir un moyen commode pour échapper au sommeil et donc aux rêves étranges qui les habitaient. Je lisais maintenant toute la nuit pour fuir mon tourment, mais c’était un mauvais calcul car alors je dormais toute la journée, terrassé par l’épuisement. Je me réveillais qu’il faisait déjà noir, je ne sortais plus en forêt (les loups me semblaient de plus en plus nombreux), me traînais jusqu’au matin suivant, bref, je vivotais et ne parvenais plus à trouver l’épanouissement que j’étais venu chercher ici. Il me fallait donc partir au plus tôt, tout quitter, tout abandonner et aller chercher dans un ailleurs improbable ce que ne me donnait plus ce lieu reculé.
Un matin, je refermai donc la porte et mis la lourde clef au fond de ma poche. Sans me retourner, je pris le chemin qui conduisait au village, distant de seize kilomètres. En passant près du grand chêne, je ne pus m’empêcher de poser mon front contre son écorce rugueuse, imitant ainsi le geste que j’avais si souvent vu faire à la jeune fille de mon rêve. En moi, nulle tristesse, mais plutôt l’impression qu’un jour je reviendrais, apaisé, après avoir couru le monde. Puisse le destin me faire découvrir ce que je cherchais et dont j’ignorais moi-même la nature.

00:40 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature
07/02/2009
La cabane dans les bois (1)
Autrefois j’habitais une petite maison, en bordure d’un grand bois. Personne aux alentours, rien que les loups qui parfois, en hiver, venaient renifler le seuil au milieu de la nuit.
Qu’auriez-vous voulu que je fisse, en cette contrée, si ce n’est me promener dans la forêt immense et tenter de me retrouver après m’y être perdu. Je marchais donc ainsi, des journées entières, observant les mélèzes résineux et odorants ou bien guettant le vol des oiseaux de proie, qui, tout là haut, lançaient dans le ciel leur cri de fin du monde. J’arpentais les sous-bois, empruntais les halliers, longeais des marécages aux limites imprécises, rampais sous les ronciers, débouchais dans des clairières inondées de lumière et revenais vers ma demeure par des chemins de traverse, passablement troublé de ces expéditions fantastiques, mais complètement heureux.
Le soir, pour me distraire, quand la grande nuit était venue, j’allumais un feu dans la cheminée, puis je m’installais devant l’âtre, à même le sol, me chauffant et m’éclairant tout à la fois grâce aux belles flammes qui crépitaient doucement. Quand j’avais bien songé, quand j’avais bien rêvé, quand tous les incidents de la belle journée s’étaient ordonnés comme il se doit dans les tiroirs de ma mémoire, je prenais un livre et entamais ma lecture. Les heures défilaient sans que je ne m’en rendisse compte, tant j’étais captivé par ces récits de voyage, et souvent l’aube naissante me surprenait là, grelottant légèrement devant l’âtre éteint. Alors, à regret, je fermais le livre aux enchantements et m’acheminais comme je pouvais vers mon lit, les yeux mi-clos, déjà tout endormi, tandis qu’à l’extérieur le cri du premier oiseau troublait l’éternel silence.
Ces jours-là, évidemment, je me levais tard, fort tard même parfois et il était impensable d’aller arpenter la grande forêt toute la grande journée. Alors, après avoir vaqué à mes menues occupations, je replongeais dans le livre comme dans un bain tiède et doux et poursuivais ma lecture. J’en étais resté au moment où la première croisade se mettait en marche ou bien j’avais laissé les soldats du roi de France en train d’assiéger le dernier château cathare. L’Histoire était là, dans ma chambre, et les Huns sanguinaires ou les Vandales intrépides n’en finissaient pas de déferler sur l’Europe, tuant et saccageant des peuples innocents, allumant des brasiers incroyables qui éclairaient encore ces siècles reculés. La marche du monde était là, dans ces événements du passé et je croyais entendre les pas des légions romaines sur les routes dallées ou les cantiques des moines dans le chœur des abbayes cisterciennes. Voici Napoléon partant vers la Russie, ne se doutant pas que l’hiver l’attend là-bas, au creux des steppes asiatiques, et voilà Hannibal traversant les Alpes avec ses éléphants, débouchant dans la plaine du Pô et contemplant la belle Italie inondée de lumière et offerte à lui comme un corps de femme.
Je lisais si longtemps et je vivais si intensément le contenu de ces livres que le soir me surprenait sans que j’eusse mis le nez dehors. Alors je me faisais un peu violence et laissais Roland à son sort, aux prises avec les Basques au col de Roncevaux et je m’enfonçais dans la nuit. Souvent il pleuvait et le bruit des gouttes sur les feuilles me rappelait l’écho sonore des cathédrales du Moyen-Age, au point qu’il me semblait entendre de nouveau les chants de ces moines dont j’avais lu la veille la vie recluse et tout entière tournée vers l’au-delà. « Aurais-je été moine, moi aussi, si j’avais vécu à cette époque reculée ? » me demandais-je en souriant intérieurement. C’eût été probable car après tout ma vie recluse dans cette contrée déserte s’apparentait un peu à leur démarche mystique. Ne voyant personne, sans cesse plongé dans mes lectures, il n’y avait pas grand chose qui me différenciait d’eux, finalement, si ce n’est cependant l’essentiel, leur croyance béate en un dieu de bonté dont ils n’arrêtaient pas de chanter la gloire.
Moi, c’est la nature que j’admirais et si je savais qu’elle était aussi grandiose que leur Dieu, je savais aussi qu’elle pouvait être cruelle. Souvent, à ce moment de mes réflexions, le hurlement des loups dans les lointains semblait me donner raison. La nature est belle, merveilleusement belle, mais elle est aveugle et ne fait pas de sentiment. Chacun chasse pour survivre et tant pis si on est né victime. Je décidais alors prudemment de rentrer car l’instant était mal choisi pour aller se perdre dans l’obscurité. Sait-on jamais comment cela pourrait finir ? Le vent se levait et je sentais dans mon cou les gouttes de pluie qui commençaient à s’infiltrer, froides et humides et c’est finalement avec soulagement que je me retrouvais chez moi. Je retirais mon manteau et me mettais au lit. Il était trop tard pour allumer le feu et recommencer à lire. Tant pis pour Roland, il continuerait à sonner du cor toute la nuit et devrait attendre l’aube pour mourir en beauté.

01:37 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature
06/02/2009
Blogues: de la longueur des notes.
Quand on rédige une note pour un blogue, il vaut mieux que celle-ci ne soit pas trop longue, afin de ne pas décourager les lecteurs potentiels, lesquels n’ont que leur écran pour en prendre connaissance. Donc, si les blogues offrent une belle opportunité pour tout un chacun de pouvoir s’exprimer, ils ne permettent toutefois pas des développements trop longs.
Il en va de même quand on propose un texte littéraire. Pour les poèmes ou les textes poétiques en prose, il n’y a pas de problème, ceux-ci n’étant jamais très longs, mais pour des récits proprement dits, cela devient plus compliqué. Jusqu’ici, j’étais parvenu à faire bref, mais il arrive qu’on se laisse emporter par la logique de son propre récit (au point qu’on se demande parfois si l’auteur maîtrise vraiment ce qu’il écrit et si ce ne sont pas les personnages eux-mêmes qui imposent le déroulement de leur histoire) et qu’on se retrouve avec un texte de plusieurs pages alors qu’initialement celui-ci avait été écrit pour le blogue.
Une solution consiste à faire comme avec tous les autres écrits, à savoir ranger ce nouveau texte dans un tiroir et ne plus l’en ressortir. Une autre solution, c’est tout simplement de le proposer ici par épisodes séparés. C’est ce que je me propose de faire à partir d’aujourd’hui. Bon, que les lecteurs qui n’aiment pas cette formule veuillent bien m’excuser. Ils ne sont d’ailleurs pas obligés de lire et ils peuvent en profiter pour aller butiner ailleurs pendant quelques jours et découvrir d’autres sites. J’ai bien conscience que cette formule du découpage n’est pas ce qu’il y a de mieux, mais après tout le XIX° siècle s’était bien singularisé par ses romans feuilletons et la littérature s’était adaptée à ces nouvelles contraintes éditoriales. Comme Internet est un outil neuf, il est normal que nous en soyons encore à chercher les formules les plus pertinentes.
15:30 Publié dans Blogue | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : blogue
04/02/2009
Désabusement
- Quand je pense à ce que je voulais quand j’étais gamin et à ce que je veux maintenant, ça fait une fichue différence. Sans doute que ce que je voulais, ce n’était pas ce que je voulais. (…)
- Et qu’est-ce que tu veux maintenant ?
- Je ne sais pas ce que je veux. Je l’ai jamais su. (…) Quand t’es gamin t’as des idées sur ce que tu feras de ta vie, dit Billy. En vieillissant t’es forcé d’en rabattre un peu. A la fin tout ce que tu peux faire, c’est essayer de réduire la casse au minimum. De toute façon le pays n’est plus pareil. Rien de ce qu’il y a dedans non plus. La guerre a tout changé. Je ne crois pas que les gens s’en sont encore aperçus. (…)
- En quoi est-ce que la guerre a changé le pays ?
- Ca l’a changé. Le pays n’est plus pareil. Il ne le sera plus jamais.
Cormac Mac Carthy, Des villes dans la plaine, Seuil Points, pages 87-88
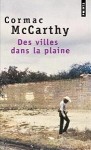
22:09 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, mac carthy
03/02/2009
Camus dans le Magazine des livres
Mon article «Camus ou l’ambiguïté d’une révolte» qui était paru autrefois dans la Presse littéraire est republié dans le dernier numéro du Magazine des livres. Il s’agissait de savoir si Camus n’était pas malgré lui le fruit du colonialisme. Certes il défend les Algériens contre les exactions commises par les Français, mais malgré ce discours très humain il ne remet jamais en question le fait que l’Algérie soit française et il n’envisage même pas son indépendance.
On a l’impression que pour lui il suffirait de prendre quelques mesures de surface (un peu de respect envers les Algériens) pour que l’ère coloniale puisse être justifiable.

16:52 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, camus, colonialisme, alégérie
02/02/2009
Chandeleur
Le deux février, autrement dit quarante jours après Noël, c’est la fête de la Chandeleur. Ce terme trouve son étymon dans le mot «chandelle» et fait référence à la «Festa Candelarum » (fête des chandelles) des Romains, cérémonie lors de laquelle on allumait des cierges à minuit en symbole de purification.
En fait, cette « Festa Candelarum » se fêtait le 15 février en l’honneur de Faunus, dieu de la fécondité et protecteur des troupeaux. Comme il les protégeait notamment des loups, on lui a donné le nom de Lupercus (d’après lupus, lupi, le loup) d’où le terme Lupercales pour désigner cette fête. Ce qui est amusant, c’est que le hurlement du loup finit par être une des caractéristiques de ce Lupercus, qui est vu comme un dieu prophétique dont la voix retentit la nuit pour prononcer des oracles.
Comme il émettait des sons terrifiants, on l’a représenté sous la forme d’un monstre aux jambes et aux cornes de chèvre, ce qui a facilité son assimilation au dieu Pan et comme celui-ci était habituellement entouré de satyres dans la mythologie grecque, on a imaginé de nombreux faunes courant autour de Faunus-Lupercus.
Mais revenons un instant aux Lupercales. Elles sont célébrées comme je l’ai dit le 15 février dans la grotte située au pied du mont Palatin (et appelée elle aussi le Lupercal). C’est dans cette grotte que selon la légende Romulus et Remus avaient été allaités par une louve. Le début de l’année étant le 1 mars à Rome, la deuxième moitié de février correspondait donc à la fin de l’année précédente (un peu comme Noël chez nous, qui correspond en fait au solstice d’hiver, autrement dit au moment où les jours commencent à rallonger de nouveau). Fête de purification, les Lupercales annoncent donc le printemps et le renouveau de la vie. Les douze luperques (les prêtres de Faunus-Luperque) sacrifiaient un bouc à leur dieu. Ensuite ils faisaient une incision au front à des jeunes gens qui étaient vêtus uniquement d'un pagne en peau de bouc. Le sang était essuyé avec de la laine de mouton (symbole des troupeaux à protéger) trempée dans du lait (idée des agneaux à naître). A ce moment, les jeunes gens devaient rire aux éclats (le bruit marquant souvent une rupture dans les célébrations. Voir notre carnaval où il s’agit de faire le plus de bruit possible). Ensuite, toujours vêtus de leur pagne en peau de bouc (la quasi-nudité comme l’image du bouc renvoient à un symbole de fertilité) ils couraient dans toute la ville de Rome en tenant en main une sorte de fouet fabriqué à partir de la peau d’un bouc. Avec celui-ci, ils frappaient les femmes qu’ils rencontraient et qui souhaitaient avoir un enfant dans l’année. La fertilité légendaire du bouc associée à la nudité des jeunes gens correspond bien dans l’imaginaire collectif à l’idée d’un renouveau de la vie (cf. aussi la symbolique du printemps qui est proche).
Mais pourquoi frapper les femmes avec un fouet ? Cela nous semble assez barbare comme coutume mais sans doute faut-il voir dans le fait de les toucher une sorte d’acte sexuel différé et peut-être que la douleur qu’elles devaient alors ressentir faisait référence à la perte de leur virginité (ou tout simplement à la domination du mâle qui impose aveuglément sa loi) à moins que cela ne soit une préfiguration des douleurs de l’accouchement (vie et mort étant finalement liées dans l’imaginaire, ce que semble dire aussi ce dieu protecteur des troupeaux qui a partie liée avec les loups sanguinaires). Peut-être aussi que la douleur permettait une sorte de purification (mais là, c’est peut-être notre imaginaire judéo-chrétien qui parle). Ce qui est certain, c’est que le thème de la grotte renvoie à la foi à la mort (tombeau, nuit) mais aussi au ventre maternel.
Bon, c’est très bien me direz-vous, mais quel est le rapport entre tout cela et nos crêpes de la Chandeleur ? Patience, j’y arrive.
A côté de ces Lupercales romaines, existait en Gaule celtique une fête de purification en l’honneur de la déesse Brigit ou Brigantia (habilement christianisée par la suite en sainte Brigitte par les premiers évangélisateurs de l’Irlande) qui avait lieu le premier février. Là aussi il s’agissait de mettre la fertilité à l’honneur en prévision du printemps qui approchait. Les paysans parcouraient les champs en procession, munis de flambeaux et priaient la déesse de purifier les terres avant les semailles (voir aussi les Rogations chez nous autrefois). La symbolique est donc la même que celle des Lupercales.
Evidemment, l’Eglise fut assez contrariée par toutes ces manifestations qui sapaient un peu son autorité spirituelle, c’est pourquoi, vers 490, le pape Gélase premier décida d’interdire les fêtes païennes. Il remplaça les Lupercales par la Saint Valentin (patron des amoureux et donc du désir amoureux) et décréta qu’on fêterait ce saint le 14 février (et non le 15, pour bien marquer la différence sans doute). Il associa aussi la « fête des chandelles » avec la présentation de Jésus au temple, telle qu’elle est rapportée dans la Bible. On sait que le 40° jour après sa naissance, le bébé devait être présenté à Dieu par sa mère (voir Luc 2, 21-24). Les anciennes torches qui éclairaient la grotte romaine de Lupercal ainsi que les torches que brandissaient les jeunes gens au pagne de bouc en courant dans la ville de Rome sont remplacées dans les églises par des chandelles bénites. Le symbole en est que la lumière éloigne le mal et rappelle que le Christ est la lumière du monde. Les chrétiens rapportaient ensuite les cierges chez eux afin de protéger leur foyer. On les rallumait en cas d’orage pour protéger la maison. Notons que j’ai encore vu ma grand-mère allumer un cierge bénit lors de violents orages, comme je sais aussi qu’elle obligea ma mère, qui avait pourtant subi une césarienne, à aller à l’église avec son enfant avant que celui-ci n’ait atteint son trentième jour (comme quoi ces vieilles croyances étaient encore bien vivaces il n’y a pas si longtemps).
Bon, voilà donc comment on est passé des flambeaux de Rome aux chandelles chrétiennes. Mais les crêpes alors ? Là, l’explication ne fait pas l’unanimité.
Certains pensent qu’on mettait de côté les grains de blé qu’on allait planter au printemps puis qu’on faisait de la farine avec le reste. C’était donc le moment d’utiliser cette farine en confectionnant un met spécial, en l’occurrence des crêpes. D’autres disent qu’il faut plutôt relier la forme circulaire de la crêpe au disque solaire et donc qu’on mangeait en fait des crêpes pour faire honneur au soleil qui allait revenir avec le printemps.
15:19 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : histoire, chandeleur







