30/03/2009
De l'altérité
Le langage poétique, on le sait, a tendance à inverser les valeurs. Soit il prend des termes et en modifie ou en inverse le sens, soit il prend le terme opposé à celui qu’on attendrait habituellement (exemple : le fameux « soleil noir de la mélancolie » de Nerval dans El Desdichado). Par cette technique, la poésie nous parle donc d’un monde autre, différent, une sorte d’univers parallèle qui n’est pas sans rappeler celui de la magie, tel que décrit par les chamans.
Alors que la prose privilégie le signifié (le contenu), la poésie se concentre surtout sur le signifiant (la forme). La meilleure illustration en est la versification, qui est comme une sorte de retour en arrière (on reproduit un son qu’on vient déjà d’entendre). Il s’agit donc moins d’aller de l’avant vers un sens à découvrir que de regarder en arrière sur ce qui vient d’être dit, tout en prêtant moins d’attention au sens qu’à la musicalité de la langue. Les mots eux-mêmes sont d’ailleurs choisis avec discernement car par leur longueur et leur sonorité ils doivent former un tout harmonieux. Ainsi, le vers de Mallarmé « le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui » commence par deux groupes de trois syllabes (le/vier/ge, le/vi/vace) pour se poursuivre par une groupe de six (et/le/bel/au/jour/d’hui). Il existe donc une progression harmonieuse, que n’aurait pas rendu « le vivace, le bel aujourd’hui et le vierge. »
A côté du nombre de pieds, la césure et l’enjambement assurent des pauses respiratoires qui contribuent à l’harmonie de l’ensemble. Il arrive aussi que certains vers soient repris comme dans une sorte de refrain, ce qui renforce encore le caractère musical du poème (comme le vers «Vienne la nuit sonne l'heure » dans « Le pont Mirabeau » d’Apollinaire). Ou bien le poète a recours à l’allitération (répétition de plusieurs consonnes identiques à l’intérieur d’un même vers) comme le célèbre « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? » dans l’Andromaque de Racine. Parfois, c’est un même son qui est reproduit dans le vers (on parle alors d’assonance) comme dans «Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire » (toujours Racine, mais dans Phèdre), où le son « i » est répété plusieurs fois.
Bon, on pourrait comme cela poursuivre encre longtemps et détailler tous les moyens techniques utilisés en poésie, mais ce n’était pas le but de mon propos. Tout ce que je voulais montrer, c’est qu’il existe un monde poétique, différent de la vie quotidienne ou du regard habituel que nous portons sur ce qui nous entoure. Ce monde parallèle, ce regard particulier, existe en soi, je veux dire en dehors du poème. C’est un état d’esprit ou une particularité de l’individu d’aborder l’univers autrement. Que cette vision soit finalement traduite ou non dans un poème (ou un poème en prose ou une prose poétique) importe peu par ailleurs.
Ce qu’il faut donc souligner, c’est cette notion de décalage entre le monde tel qu’on le regarde avec des yeux objectifs et le monde imaginé par le poète à partir de cette même réalité.
Maintenant, si un des moyens de rendre ce monde imaginaire un instant entrevu est d’inverser les valeurs habituelles ou le sens des mots, il se pourrait aussi que la recherche d’un ailleurs participe de la même démarche. L’étranger, les pays d’au-delà des mers, l’Orient mythique, sont autant de destinations réelles qui devraient permettre un dépaysement suffisant pour sentir ce décalage. C’est sans doute ce qu’allaient chercher les grands littérateurs du XIX° siècle en Egypte ou ailleurs. Là bas, tout était différent, les paysages, les coutumes, les lois, le climat, etc. Visiter ces pays étrangers aurait donc dû permettre de toucher du doigt ce monde « autre », ce monde décalé dont nous parlons ici. Cela voudrait donc dire que d’une manière générale, aller vers l’autre, vers l’étranger, participerait de ce mouvement poétique de la recherche d’un ailleurs. Loin du choc des civilisations, le regard curieux et humaniste porté sur l’altérité serait une manière d’atteindre cet autre univers. Cela reviendrait à dire que c’est par la culture en général et par la poésie en particulier qu’on peut espérer trouver une entente entre les peuples. Le poète, cherchant par nature ce qui est rupture par rapport au monde dans lequel il vit, aura tendance à regarder avec intérêt la culture de l’autre. Cette altérité fondamentale ne l’effraiera pas, au contraire il cherchera à l’explorer pour en saisir l’essence. Et puis dans cette culture autre, il découvrira aussi des poètes, s’exprimant dans une autre langue, véhiculant d’autres images, d’autres concepts. Derrière ces différences, cependant, il retrouvera un terrain qui lui est familier, celui de la littérature. Car les hommes sont partout les mêmes dans tous les endroits de la planète et ils sont confrontés aux mêmes problèmes : la vie, la souffrance, l’amour, la recherche du bonheur, la difficulté voire l’impossibilité de réaliser ses rêves et bien sûr la mort qu est tout au bout. Quel que soit le climat, quel que soit le pays, ces réalités sont partout présentes et si les diverses cultures ont proposé des solutions différentes, les poètes, partout dans le monde, parlent le même langage.
Le problème, malheureusement, c’est que les poètes ne sont pas légion et qu’ils semblent bien fragiles pour faire entendre leur voix aux marchands de canon qui, eux, savent exploiter habilement les différences entre les hommes. Et puis il y a les puristes, les intégristes (les Frères musulmans d’un côté de la Méditerranée, l’extrême-droite de l’autre), qui diront toujours qu’apprendre la culture de l’autre c’est perdre la sienne ou en tout cas courir le risque de la voir se métisser suffisamment pour devenir une culture autre. Ce risque de perte d’identité est un problème crucial. Personne n’a envie de renier ce qui le constitue et d’en programmer la perte en introduisant le ver dans le fruit, en ouvrant les portes à une autre culture. Et pourtant… Et pourtant il en a toujours été ainsi dans l’histoire il ne faudrait pas oublier que les cultures latine est grecque de l’Antiquité que nous admirons tant n’ont pu nous parvenir qu’en supplantant la culture celte de nos ancêtres laquelle s’est effacée pour ne subsister qu’à l’état de substrat. Et si beaucoup s’inquiètent de la forte présence arabe sur le sol européen (et dont les enfants de la troisième génération sortent de nos universités et commencent à occuper des postes clefs), que doit dire le Maghreb qui a été colonisé par la France durant une longue période ? Il semblerait donc que les interpénétrations culturelles soient déjà à l’œuvre de part et d’autre de l’ancienne « mare nostrum ». Bien sûr, nous n‘avons pas du tout envie que l’islamisme radical soit enseigné à nos enfants dans les écoles de la République, pas plus que les gens du Maghreb ne se réjouissent de notre civilisation marchande et matérialiste. Mais au-delà de ces deux points extrêmes, de ces deux antagonismes, n’y aurait-il pas moyen de trouver par la culture un langage je ne dirai pas commun, mais en tout cas un langage qui serait ouvert aux richesses de l’autre ?
Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore et qui souhaiteraient approfondir ce genre de réflexions, je les invite à aller se promener de temps à autre (mais tous les jours c’est mieux) sur le site de Jalel el Gharbi (voir par ailleurs le lien ici à droite) qui tente de concilier l’Orient et l’Occident et leurs cultures respectives. Personne ne s’étonnera du fait qu’il est précisément professeur de littérature, critique littéraire et poète. C’est donc bien par les livres qu’un dialogue interculturel semble possible. D’ailleurs ne lisons-nous pas les livres étrangers en traduction ? La littérature est universelle et on devrait, je trouve, proposer des cours de littérature comparée dans les lycées, cela aiderait peut-être à comprendre le fait que quel que soit l’endroit où il vit l’homme reste un homme avec ses espoirs et ses angoisses.
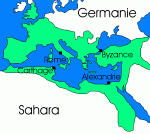
Empire romain et "Mare nostrum"
23:16 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, autres cultures
28/03/2009
De Mac Carthy et de son style
J’ai cité ici plusieurs extraits de romans de Cormac Mac Carthy et quelques commentateurs se sont étonnés à juste titre de l’accumulation de la conjonction de coordination « et », qui rend souvent la phrase un peu lourde, voire disgracieuse. Généralement, le nouveau lecteur est étonné devant ce procédé inhabituel, qui ne correspond pas à l’idée qu’on se fait d’un style d’écrivain, qu’on imagine forcément limpide. Au vu de la réputation de l’auteur, on en arrive vite à la conclusion qu’il ne peut s’agir d’une faiblesse mais bien plutôt d’un moyen stylistique original et peu commun. Encore faudrait-il comprendre quel est le but recherché par ce procédé.
La conjonction « et » n’est d’ailleurs pas le seul terme qui revient périodiquement chez Mac Carthy. En fait, il emploie souvent les mêmes mots, comme ces « d’accord » qui ponctuent souvent les dialogues. On en trouve déjà dans la « Trilogie des confins », mais surtout dans « la Route », où ce mot renforce encore le style dépouillé. Le fait de se dire d’accord avec quelqu’un exclut toute discussion. Même quand le fils n’obtient pas la réponse qu’il souhaitait ou quand la réponse du père ne le satisfait pas, il finit toujours par dire « d’accord » C’est à mon avis une manière de souligner l’affection qui les lie. Il fait confiance à son père, alors même que le monde qui l’entoure, plein de dangers, suscite surtout des questions. Il y a donc une dimension affective dans l’emploi de ce mot, mais aussi une démarche existentielle. Le fils ne comprend pas, mais il s’en remet à celui qui a de l’expérience. Le père agit de même avec son fils et à chaque fois que le petit lui demande quelque chose qui est en son pouvoir (ne pas l’abandonner par exemple), il dira lui aussi « d’accord ». Il s’ensuit donc une complicité certaine entre les deux protagonistes, qui illustre bien leur union face aux dangers traversés ensemble.
Dans ce roman « La Route », l’auteur ne désigne pas les deux héros par leurs prénoms, mais il utilise les termes «L'homme » et «le petit » pour bien exprimer le rapport adulte/enfant qui les lie, ce qui permet aussi de généraliser leur expérience à toute l’humanité et donc d’impliquer le lecteur (on est tous le père ou l’enfant de quelqu’un).
Je ne connais malheureusement pas la version originale en anglais, il serait intéressant, cependant, d’aller vérifier quels sont exactement les mots employés.
Mais revenons à notre conjonction « et » et à l'absence de virgules qui, comme je l’ai dit moi-même, gênent beaucoup au début. Dès qu’on accepte le fait qu’il ne peut s’agir d’une maladresse mais que c’est voulu, alors, insensiblement, non seulement on s’y fait, mais on finit par attendre ces longues énumérations. A quoi peuvent-elles bien servir ?
A créer une atmosphère, je suppose. Les faits et les actions s’enchaînent un peu comme on verrait un film au ralenti. Sans que je ne m’explique bien pourquoi, il me semble que cela donne une dimension tragique au récit (l’enchaînement inéluctable des événements comme dans la tragédie grecque). Remarquons que souvent il s’agit pourtant d’actions voulues par le héros (il se leva et pris sa couverture et monta sur son cheval et…) Dans ce cas, il y aurait une volonté délibérée d’agir, même contre le destin. Le héros tente de s’affirmer en faisant ce qu’il a décidé qu’il ferait. Mais en même temps on sent à chaque fois comme quelque chose d’inéluctable, comme si, par son geste déterminé, le héros s’en allait au devant d’un danger. Je crois que ce qui est mis en scène avec cette conjonction, c’est le rapport de l’homme au monde, le conflit entre les aspirations intérieures et l’univers extérieur.
Parfois, ces énumérations concernent des descriptions de paysages. Est-ce une manière de nous faire voir par les yeux des protagonistes, comme si on détaillait le décor de gauche à droite ? C’est du genre « Il y avait une rivière et une montagne et plus loin une autre plaine et dans le fond le soleil se couchait… » Là aussi il y a quelque chose d’inéluctable. Mais aussi une dimension poétique. On passe ce paysage en revue, détail après détail, mais en agglutinant nos impressions, jusqu’à en faire une totalité qui forme un tout et qui, peut-être, se donne comme une approche exhaustive de la réalité. L’auteur veut tout décrire, donner du monde une vision globale. Comme il ne peint pas un tableau et ne peut être synthétique, il est obligé, dans une démarche analytique, d’accumuler les détails pour définir le tout. D’où l’importance de la conjonction qui non seulement ajoute chaque fois un élément au précédent mais relie véritablement les éléments entre eux, les soudant en une entité indestructible.
Quelque part, Mac Carthy me fait penser à l’Anabase de Xénophon. Mes souvenirs scolaires sont un peu loin, mais il y avait aussi chez cet auteur une grande utilisation du « et » » :
"Cyrus ensuite fit vingt parasanges en quatre marches et vint sur les bords du fleuve Chalus, dont la largeur est d'un plèthre. Ce fleuve était plein de grands poissons apprivoisés, que les Syriens regardaient comme des dieux, ne souffrant pas qu'on leur fît aucun mal, non plus qu'aux colombes. Les villages près desquels on campait appartenaient à Parysatis et lui avaient été donnés pour son entretien. On fit ensuite trente parasanges en cinq marches, et l'on arriva aux sources du fleuve Daradax, large d'un plèthre. Là était le palais de Bélesis, gouverneur de la Syrie, et un parc très vaste, très beau, et fécond en fruits de toutes les saisons. Cyrus rasa le parc et brûla le palais. » (Livre I)
Ici, cependant, le procédé me semble être différent. C’est plutôt le déroulement de l’action qui est ainsi mis en évidence, leur succession chronologique. Chez Mac Carthy, c’est plus que cela. Certes les actions s’enchaînent aussi, comme dans un film, mais elles sont moins vues dans leur détail singulier que dans leur union finale. Chez Xénophon on cherche à nous faire voir ces actions individuellement, une après l‘autre, ici, on vise surtout un tableau d’ensemble (dont il a bien fallu au préalable dessiner les différents contours).

01:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, mac carthy
25/03/2009
Peu importe
Peu importent les jours et les nuits, les saisons qui défilent et l’équinoxe qui revient s’abattre sur nous en tempête de pluie battante et froide.
Peu importent la mer qui mugit et ses vagues en colère qui déferlent contre les falaises de la mort.
Peu importent ces navires au large qui tanguent dans la tourmente et pour qui tous les ports sont désormais hors d’atteinte.
Peu importent les heures qui passent et qui repassent au cadran de l’espoir.
Peu importent, vous dis-je, les départs sans cesse différés, les voyages toujours reportés et ces mille pas inutiles qui ne nous conduisent nulle part.
Parfois, une corne de brune hurle dans le noir et annonce des dangers imminents, tandis qu’un phare, au bout du monde, tente de trouer l’obscurité.
Peu importe, ils ne reviendront plus les exilés, ils auront péri en mer avant d’atteindre le port. Le poème sera leur tombeau et s’ils survivent, ce sera dans une chanson de marins, un de ces refrains qu’on reprend en pleine mer pour se donner un peu d’espoir, quand l’attente est trop longue et que la cause est perdue.
Peu importe la nuit au cœur de mon texte, peu importent cette page et ces mots qui s’envolent.
Peu importent ton cœur et ton sexe et tous tes mots qui m’ont fait rêver.
Peu importent les jours et les nuits.
Peu importe.
Reste le poème.
Je te le dédie.

16:03 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, poésie
24/03/2009
Dialogue (3)
Ils contemplaient le soleil qui se levait au-dessous d’eux. Les chevaux qui broutaient un peu plus loin sur un redan dressèrent la tête et le regardèrent. Rawlins but la dernière gorgée de son café et égoutta sa tasse et plongea sa main dans sa poche de chemise pour chercher son tabac.
Crois-tu qu’il y aura un jour où le soleil va pas se lever ?
Sûr, dit John Grady. Le jour du Jugement dernier.
Quand crois-tu que ce sera ?
N’importe quel jour qu’Il aura choisi.
Le jour du Jugement dernier, dit Rawlins. Tu crois à tout ça ?
J’sais pas. Oui. Sans doute. Et toi ?
Rawlins mit sa cigarette au coin de sa bouche et l’alluma et d’une chiquenaude il jeta l’allumette. J’sais pas, dit-il. Ca se peut.
J’savais bien que t’étais un mécréant, dit Blévins.
Toi tu sais foutrement rien, dit Rawlins. Ferme-la sans en rajouter à ta connerie.
John Grady se leva et traversa le bivouac et souleva sa selle par le pommeau et jeta sa couverture sur son épaule et les regarda. Allons-y, dit-il
Cormac Mac Carthy, « De si jolis chevaux »
14:23 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : littérature, mac carthy, de si jolis chevaux
22/03/2009
Mauriac
J’apprends qu’une nouvelle biographie de François Mauriac vient de voir le jour (mais je ne l’ai pas lue). L’auteur, Jean-Luc Barré, tente de comprendre la complexité du célèbre écrivain catholique et il a, paraît-il des révélations inédites à faire : François Mauriac. Biographie intime. Tome I de Jean-Luc Barré Fayard, 675 pages (je m’inspire pour cette note d’un article de jean d’Ormesson – écrivain que j’ai lu mais que je n’aime pas – paru dans Le Figaro –journal que je ne lis en principe jamais et sur lequel je suis tombé par je ne sais quel hasard lors de recherches sur Internet ).
On connaît en effet la complexité des personnages des romans de Mauriac, et nul peut-être mieux que lui n’a su rendre la lourdeur de cette atmosphère provinciale, faite de secrets inavouables, de tension entre les protagonistes, de haine assassine, de révolte larvée, d’apparences qu’il convient de sauvegarder et finalement de solitude désespérée. Dans cette bonne société bourgeoise bordelaise, l’argent ne manque pas, mais l’amour fait souvent défaut («Le Désert de l’amour ») ou s’il existe, il a souvent des effets pervers, comme dans « Thérèse Desqueyroux », où une femme étouffe son fils de son amour maternel. Une fois devenu veuf, celui-ci se détachera (enfin) d’elle pour s’enfermer dans le souvenir de son épouse décédée, ce qui nous fera finalement trois victimes : l’épouse qui est décédée au milieu de l’indifférence générale, le héros qui ne vit plus que de souvenirs et la mère qui voit son fils lui échapper. Tout cela sur fond de tradition familiale où le poids des ancêtres est encore bien présent.
Pour inventer des romans de cette trempe, il fallait bien que Mauriac ait eu lui-même une personnalité assez complexe. Orphelin de père, il est élevé par sa mère et sa grand-mère, toutes deux dévotes et puritaines. Le petit François apprend donc à vivre avec le regard d’un Dieu vengeur au-dessus de sa tête, ce qui, on s’en doute, le rendra obsédé par les notions de péché et de mal. A côté de cela, sa sensibilité exacerbée lui fait cruellement ressentir le manque d’amour apparent de sa mère, trop rigide et tout occupée à respecter les conventions.
Tout n’est pas négatif, pourtant, et dans son milieu aisé, on suit les cours de bons professeurs, notamment ceux du beau-frère de Gide et qui sera un des fondateurs de la NRF (Mauriac n’aura donc pas à chercher bien loin un éditeur quand il voudra être édité). Et puis il grandit dans un monde de livres et dévore Pascal, Racine, Baudelaire, Rimbaud, Gide, Régnier, Claudel, Francis Jammes et bien d’autres.
Le paradoxe de Mauriac, soutient son biographe, c’est d’un côté son humilité imposée par sa foi chrétienne et de l’autre son grand désir de gloire littéraire. Il est remarqué par Maurice Barrès, qui apprécie son recueil de poèmes « Les Mains jointes ». Il lui consacre un article élogieux dans la presse ce qui le range d’emblée dans le cercle des écrivains. Sans vouloir me montrer suspicieux, je me demande quand même si c’est la qualité littéraire de ce texte (que j’avoue n’avoir pas lu et sur lequel je ne me prononcerai donc pas) qui a propulsé Mauriac en avant ou si c’est le côté disons … catholique (avec un tel titre !) qui a ému Barrès.
Peu après, Mauriac connaît Cocteau, Radiguet, Proust et surtout André Gide, lequel règne sur la NRF. Et c’est là que notre biographe abat sa carte d’atout. Notant l’homosexualité manifeste d’au moins trois de ces écrivains, il en déduit que Mauriac n’aurait peut-être pas été insensible à cet aspect des choses. Etonnant, je n’avais jamais pensé à une chose pareille. Et le biographe de citer une phrase du propre fils de François, Jean, qui est troublante, il faut le reconnaître : «Homosexuel, mon père ? Non, certainement pas au sens où l'on entend ce terme quand on l'applique à Gide, Cocteau, Jouhandeau ou Montherlant. Mais de tendance homosexuelle, oui, bien sûr. »
Et le biographe d’insister sur les amitiés essentiellement masculines que Mauriac aurait entretenues à côté de son couple légal. D’ailleurs le romancier aurait affirmé un jour : «Il existe des affections légitimes : la famille, les amis, j'entends bien. Mais ces affections ne sont pas l'amour ; et, dès qu'elles tournent à l'amour, les voilà, plus qu'aucune autre, criminelles.»
Si cette hypothèse est vraie, on comprend d’autant mieux l’aspect torturé de Mauriac : «Je suis romancier, je suis catholique : c'est là qu'est le conflit ! Je crois qu'il est heureux pour un romancier d'être catholique, mais je suis sûr aussi qu'il est très dangereux pour un catholique d'être romancier…» Car si l’homme Mauriac recherche la grâce et la paix intérieure, le romancier donne libre cours à ses fantasmes, sans toutefois pouvoir les exprimer clairement, ce qui expliquerait le caractère torturé de tous ses personnages et le côté pesant des traditions et du silence. Maintenant, je ne sais pas s’il faut vraiment supposer une homosexualité refoulée pour comprendre tout cela. La lutte entre la chair et la grâce a souvent tracassé les bons catholiques et à mon avis une hétérosexualité classique suffit déjà amplement à expliquer cette angoisse. Ceci dit, cela m’a toujours un peu dépassé, je dois dire, ces tourments, et je ne comprends pas bien comment on peut voir le mal dans des choses finalement naturelles (le désir et les rapports sexuels) et que Dieu lui-même, si tant est qu’il existe, a voulues.
Mais bon, Mauriac, lui, semble rempli de remords, de repentirs et du coup il remplit ses romans de monstres amers et finalement pervers. Certains lui ont reproché de se complaire dans un «nouveau sensualisme trempé d'eau bénite» et Martin du Gard lui aurait dit : «Je rigole, mon cher Mauriac, je rigole quand on fait de vous un écrivain du catholicisme. Il n'y a pas d'œuvre d'incrédule ou d'athée où le péché soit plus exalté. Ce sont des livres à damner les saints (…) Il crève les yeux, que vos tableaux sont peints avec une frénésie, une complaisance, une évidente et charmante tendresse. »
Voilà, c’était le compte rendu d’un livre que je n’ai pas lu, d’après un auteur que j’ai peu lu, publié dans un journal que je ne lis pas et au sujet d’un écrivain que j’ai lu. Vous me suivez ? Comme quoi, ce n’et pas bien compliqué de parler de ce qu’on ne connaît pas, finalement.

11:16 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature, mauriac
19/03/2009
Fnac
Nous parlions l’autre jour de la Fnac et de sa politique culturelle. Aujourd’hui il convient de parler de sa politique sociale. Trouvant sans doute qu’elle ne faisait pas assez de bénéfices (j’avais cru comprendre pourtant qu’elle avait parfaitement intériorisé le concept de «consommation culturelle») ou constatant que lesdits bénéfices ne suffisaient pas à contenter la boulimie des actionnaires, il a été décidé de supprimer 400 emplois en France (150 en province, 50 au siège central et 200 dans les magasins parisiens proprement dits)
Que dire d’autre ? Je ne peux que renvoyer à l’appel à l’aide repris sur le site « Turbulence » d’Alain Freixe.
23:01 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : fnac
18/03/2009
Printemps, le retour
J’avais, au cours de ce long hiver, passé mes nuits à écrire. Que faire d’autre, en écoutant siffler le vent ? Rien, si ce n’est raconter ce que l’on a vécu ou imaginer ce que l’on pourrait vivre.
Un à un, les mots sont tombés dans mon cahier comme les flocons dans le jardin. Encre noire, tapis blanc, de longues phrases ont rempli les pages tandis que dehors s’épaississait la couche de neige.
Puis, un soir, le temps s’est soudain arrêté. Nature figée, immobile, au cœur du solstice.
Dans le petit matin gelé, un oiseau s’est envolé, effrayé de sa propre fragilité. Cri éphémère dans la pureté de l’azur. Blancheur et éternité.
De mon petit cahier, mes pensées frileuses se sont éparpillées, disant la beauté du monde, mais aussi ma peur et mon angoisse.
Ainsi donc, dans le grand silence de l’hiver, j’écrivais.
J’écrivais et décrivais ce que j’aurais voulu que fût le monde : un endroit où nul oiseau, le matin, ne serait effrayé par la blancheur éternelle de la mort. Un endroit où nul cri, jamais, ne devrait retentir si ce n’est pour dire la beauté fragile de l’azur.
Puis les jours, les semaines et les mois passèrent et un grand matin, ce fut le printemps. C’est l’oiseau qui me l’a dit avec ses mots à lui, qu’il inscrivait dans le grand cahier du monde. Alors j’ai déposé mon stylo, je suis sorti dans la douceur nouvelle et j’ai observé : le vol du premier bourdon, la beauté de la première fleur, la senteur du premier bourgeon. Tout était là, offert, donné, sans raison aucune.
Quand la nuit est tombée et que je suis rentré, toutes mes phrases, soudain, m’ont semblé bien vaines. Etalées là, noires sur le papier blanc, elles n’avaient ni la présence imposante du bourdon, ni l’éclat de la fleur, ni le parfum du bourgeon. Elles n’étaient finalement que des mots, des mots insignifiants et un peu tristes, qui cherchaient sans y parvenir à dire le manque, le vide et l’absence. Toute cette masse de papier inerte n’avait pas un grand intérêt et elle m’apparut pour ce qu’elle était dans toute sa futilité : un grand bavardage inutile, une logorrhée sans fin, un discours interminable.
Alors, tandis que la blanche lune se levait dans la nuit bleue, j’ai jeté dans les flammes de la cheminée le petit cahier avec toutes ses pages et toutes ses phrases devenues inutiles. Il s’ensuivit une grande chaleur qui pendant un instant m’a réchauffé le cœur.

16:45 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature, poésie, printemps
16/03/2009
Marc Villemain, "Et que morts s'ensuivent"
Onze petites nouvelles, voilà ce que nous propose Marc Villemain dans son livre « Et que morts s’ensuivent » (Seuil, février 2009, 165 pages, 17 euros).
Beaucoup de lecteurs se méfient des nouvelles car ils y voient des histoires trop courtes, pas suffisamment développées et sans liens aucuns entre elles. Le moins que l’on puisse dire c’est que ce recueil-ci va les réconcilier avec le genre car l’auteur est parvenu à ce tour de force qui consiste à rendre homogène un recueil composé pourtant de onze histoires différentes. C’est qu’elles ont toutes un point commun : comme dans la vie, la mort (réelle ou symbolique) est à chaque fois au rendez-vous à la fin de l’histoire. Comme par ailleurs les personnages mis en scène sont tous plus ou moins ordinaires, le lecteur ne peut s’empêcher de faire un rapprochement entre leur existence et la sienne propre, ce qui jette tout de même un froid, il faut bien le reconnaître.
A chaque fois Marc Villemain nous décrit des situations relativement banales (des jeunes femmes qui passent une charmante après-midi dans un institut de beauté, un noble qui surveille ses terres, une critique littéraire qui trempe sa plume dans l’acide, un père de famille qui revient avec sa fille sur le lieu de villégiature de son enfance, un employé fatigué de la monotonie de son existence), ou plus dramatiques mais pourtant ô combien familières (un jeune atteint d’un cancer, une amatrice d’art qui se fait enlever, un père incestueux, etc.). Ces situations, il les décrit très bien, dans un style pur et fluide. Nous nous prenons au jeu et quand nous sommes bien entrés dans le quotidien des personnages, le charme se rompt par un drame aussi brutal qu’inattendu. Pour être tout à fait honnête (ce que l’on peut faire plus facilement dans un blogue que dans un article, finalement), j’avoue que j’ai été un peu surpris par cette fin tragique dans les deux premières nouvelles. C’était tellement inattendu et surtout cela survenait de manière tellement étrange (aveugler son amie avec une fourchette, verser de l’acide dans un bain) que cela m’a semblé un peu forcé, comme si l’auteur voulait absolument s’assurer lé bénéfice d’une chute surprenante pour respecter le genre de la nouvelle, qui, si elle est courte, vaut surtout par sa fin. Mais cette impression un peu négative s’est vite dissipée à la lecture des autres textes, dont la fin, si elle reste surprenante, semble mieux s’accorder avec les faits racontés.
Mais reprenons note vue d’ensemble. Je disais que ce qui unissait tous ces textes, c’était leur fin morbide, mais il n’y a pas que cela. Un personnage, une certaine Géraldine Bouvier, se retrouve dans chaque histoire, créant ainsi une sorte de fil d’Ariane qui permet de guider le lecteur. Il faut dire que cette Mme Bouvier est chaque fois différente (par son âge, sa fonction, son statut social, son rapport au héros) et que ce n’est que par son nom, finalement, qu’elle parvient à assurer la cohésion du texte. Que faut-il comprendre par là ? Est-ce un clin d’œil pour signifier qu’il s’agit ici de personnages de papier, d’êtres inventés, qui n’existent que par leurs noms ? Est-ce une sorte de réflexion sur le langage, afin de montrer que les mêmes mots (y compris des noms propres) peuvent désigner une réalité différente ? Est-ce une manière de dire que nous sommes tous interchangeables, tous autant que nous sommes, n’occupant finalement que des fonctions (et pas vraiment des personnalités) dans la vaste comédie humaine ? Incarne-t-elle la Parque antique, cette Géraldine Bouvier et est-ce elle qui vient couper le fil de la vie dès qu’elle apparaît ? Il y a un peu de tout cela, à mon avis. En tout cas la trouvaille est intéressante et on se surprend à attendre son apparition, laquelle nous étonne à chaque fois, évidemment, car elle occupe les fonctions les plus insolites. Il y a là une sorte de dialogue entre l’auteur et son lecteur qui n’est pas déplaisant, une sorte d’humour et de connivence qui nous fait un peu oublier la mort qui rode sans cesse.
Le livre est intéressant aussi par ce qu’il nous dit sur notre société. C’est un véritable portrait de mœurs, mœurs qui sont décrites avec un côté pince-sans rire qui n’est pas déplaisant. Et puis il y a de vraies questions qui sont soulevées, comme celui de l’inceste et cette réponse originale : ce sont les enfants (les copains et copines du cours de catéchisme) qui jugent le père coupable et qui lui infligent un châtiment finalement fort logique, puisqu’ils l’émasculent sur le champ. Il y a aussi l’histoire de cette grande amatrice d’arts qui se fait enlever par un révolutionnaire idéaliste et qui finit par prendre la défense de son ravisseur, au point d’être la première à être tuée lorsque les forces spéciales de la gendarmerie interviennent.
Bon, je ne vais pas raconter les nouvelles les unes après les autres, ce serait déflorer le sujet, comme on dit pudiquement. Notons encore pour terminer une grande présence des enfants, qui contemplent le monde avec des yeux qui sont loin d’êtres naïfs, même s’ils conservent en eux cette part de rêve qui caractérise leur âge (et on sent bien que l’auteur, lui aussi, reste de plein pied dans le rêve) Mais cette présence enfantine contraste avec la fin chaque fois cruelle, établissant un raccourci saisissant entre les premières années de la vie, toutes de tendresse, et cette fin inéluctable qui arrive quand on s’y attend le moins. Le récit en devient cinglant, évidemment, grinçant, même, tout en procurant au lecteur une sorte d’étrange plaisir, mélange de sadisme, d’effroi et de peur. Le fait d’annoncer la mort finale comme une simple anecdote, sans la détailler outre mesure, en renforce encore l’aspect tragique car nous comprenons alors que cette mort appartient à notre quotidien et qu’elle est finalement banale. Affreusement banale, devrais-je dire et superbement mise en scène dans un livre qui lui ne l’est pas.

00:16 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, villemain, et que morts s'ensuivent
13/03/2009
Des consommateurs
Je tombe l’autre jour dans la presse sur l’expression «consommateur culturel», laquelle m’a laissé quelque peu rêveur, je l’avoue. Si l’idée est d’exprimer que la personne concernée est un grand amateur de culture, un boulimique de lecture, un passionné de musique ou de films de qualité, ma foi, je veux bien l’accepter. Ce qui me dérange, cependant, c’est cette notion de consommateur. Consomme-t-on de la culture ?
- Oui, dit le directeur de la Fnac, je peux vous dire que tel client, qui a sa carte de fidélité (payante) en ordre, a acheté l’année dernière pour xxx euros dans notre magasin, c’est donc un grand consommateur culturel.
- Non, dis-je, on ne consomme pas dans une librairie comme on consomme dans une brasserie.
- Mais la Fnac n’est pas qu’une librairie, pourrait me répondre le susdit directeur, elle est aussi un lieu de vente de disques et d’appareils électroniques, photographiques ou informatiques. Et en plus c’est aussi une brasserie puisque vous pouvez boire un café ou un coca après avoir fait vos achats.
- Sachez tout d’abord, cher Monsieur, que je ne m’assois jamais dans votre cafétéria. Comment voulez-vous qu’en un lieu aussi bruyant je puisse feuilleter à loisir les livres que je viens d’acheter ? Il me faut pour cela un endroit plus calme et je préfère de loin un banc public (en souvenir de Brassens peut-être) pour parcourir quelques instants ces fameux livres avant de regagner mon domicile ou mon bureau. Ensuite, est-ce qu’acheter un lecteur DVD est un acte culturel en soi? Ce n’est qu’un appareil, une vulgaire machine. Où est la culture là-dedans ? Disons que par cet achat je me donne le moyen de pouvoir regarder des films qui eux sont en effet de la culture, si je les choisis bien. Mais ne mélangeons pas tout, s’il vous plaît. Tenons-nous en aux livres, pour ne parler que de ce que je connais. Est-ce que lire beaucoup de livres fait de moi un consommateur ? Culturel, qui plus est. Non, si je lis, je me cultive, d’accord, mais je ne consomme pas. S’exprimer de la sorte serait ramener le livre à un vulgaire objet de vente et j’imagine que ce ne peut être votre propos, Monsieur le Directeur de la Fnac.
- C’est à dire que…
- De plus, il faudrait encore voir de quels livres nous parlons, bien entendu, car les livres à succès qui s’étalent bien en vue sur vos présentoirs ne relèvent pas tous pour moi du domaine culturel, loin s’en faut. Mais vous proposez aussi des poètes, je le sais. Leurs oeuvres se trouvent au niveau du tapis, obligeant le lecteur potentiel à des acrobaties pas possibles. Vous avez une conception fort terre à terre de la culture, il me semble.
- C’est que l’on manque de place et…
- Je comprends, les locations en ville sont chères et le moindre mètre carré se paie comptant. Il faut d’abord penser aux intérêts des actionnaires avant de réfléchir au confort des lecteurs.
- Des lecteurs ? Mais à quelle époque croyez-vous vivre ? On ne vient pas à la Fnac pour lire, cher Monsieur, ni même pour feuilleter, on vient pour acheter. Et là, croyez que tout est mis en œuvre pour assurer le confort des clients, enfin, je veux dire des consommateurs, vous m’avez compris. Vous avez déjà vu le nombre de caisses qui sont ouvertes aux heures de pointe ?
- Vous avez raison et d’ailleurs il est l’heure que je m’en aille et que je passe par vos caisses. Avec mes trois livres, là, vous croyez que je suis un bon consommateur culturel ?
- Avec trois livres de poche à 6 euros le livre, ce qui ne fait que 18 euros, non, il ne faut pas rêver, vous n’êtes pas pour moi un grand consommateur culturel, désolé de vous le dire. J’ai de bien meilleurs clients que vous. Il y a en a qui dépensent dans les 400 euros en une fois. Cela va vite. Le matériel informatique est cher. Voilà des gens cultivés.
- Vous voulez dire : voilà de gros consommateurs.
- Si vous voulez. De gros consommateurs culturels. Je vois que vous m'avez enfin compris!
15:40 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : consommateurs culturels
11/03/2009
Réflexion sur le terme "écrivain" (3)
Continuons donc notre relation épistolaire avec l’auteur et les commentateurs du site « L’exil des mots » sur la définition du terme écrivain.
Ph. Seelen nous fait remarquer à juste titre qu’avant de définir ce qu’est exactement un écrivain, il faudrait peut-être se pencher sur la notion de littérature. Si je lis bien ce qu’il écrit, il considère que la littérature telle que la concevait Balzac par exemple a été bien malmenée au cours du XX° siècle, notamment par la critique universitaire, au point que son existence même s’en trouverait mise en péril.
Sur ce dernier point, je suis rassuré, la littérature trouvera toujours un moyen pour s’exprimer, que ce soit sous une forme ou sous une autre, mais c’est vrai qu’en France elle a subi de rudes coups et qu’on en oublierait le plaisir de raconter simplement une histoire mettant en scène des destins humains. Car la littérature, c’est bien cela, n’est-ce pas ? Parler de l’homme, de la femme, de leur vie, de leur destinée, tout cela d’une manière poétique ou imaginaire, de manière à mettre sous les yeux du lecteur ce qui l’intéresse le plus, à savoir sa propre vie, sur laquelle il peut subitement s’interroger par l’intermédiaire de personnages de fiction. La littérature donne donc du plaisir mais elle fait aussi réfléchir au point qu’on peut dire qu’on ne sort pas toujours intact de certaines œuvres quand celles-ci nous remuent au plus profond de nous-même.
Celui qui écrit ces livres (ce fameux écrivain que nous essayons ici de définir) restait en effet fort discret autrefois, travaillant dans l’ombre et ne se faisant connaître que par ses oeuvres. Aujourd’hui, comme le fait remarquer Philippe, on met sa personne sous le feu des projecteurs et on lui demande de s’exprimer à peu près sur tout et surtout sur ce qu’il connaît le moins, à savoir l’actualité (car toute oeuvre littéraire demande toujours une certaine distance par rapport à l’actualité la plus immédiate, qu’il s’agira d’analyser et de représenter autrement par l’intermédiaire de l’imaginaire). Certes, l’écrivain, comme tout citoyen, a son idée sur les événements contemporains, mais je dirai que ce n’est pas ce que j’attends de lui car justement il s’exprime alors comme n’importe qui et son opinion personnelle sur tel fait politique ou tel conflit guerrier n’a pas plus de valeur que celle de n’importe quelle autre personne éclairée.
En résumé : d’un côté on détruit la littérature, de l’autre on fait de l’auteur un personnage médiatique et on lui demande de s’exprimer sur tout et n’importe quoi (mais surtout pas, à la limite, sur la littérature).
Que s’est-il passé ?
Autrefois, un auteur était supposé maîtriser la langue française à la perfection. Ce rôle, les grammairiens puis les linguistes le lui ont enlevé. C’est le problème dont on a déjà parlé au sujet des « fautes » de Flaubert. L’écrivain peut-il « tordre » la langue jusqu’aux limites de ses possibilités pour exprimer ce qu’il a à dire ? Oui, bien sûr et c’est ce que Flaubert avait fait de son vivant et personne ne lui en avait tenu rigueur, mais au début du XX° siècle, on lui reprocha subitement ses écarts (sur la manière dont il utilisait l’imparfait par exemple). Cela signifie concrètement qu’à cette époque les grammairiens s’approprient la langue une fois pour toutes. Puis vinrent les linguistes, qui dirent que tous les niveaux de langue se valaient d’un point de vue strictement linguistique. De plus, toute langue évoluant, il n’y pas de raison de préférer celle du moment à celle que l’on parlait un siècle plus tôt. D’ailleurs la langue d’aujourd’hui aura disparue demain au profit d’une autre qui sera aussi valable. C’est la mort du bon usage et de la seule forme correcte. Tout se vaut. L’écrivain, on l’a vu, n’avait déjà plus aucune autorité pour parler de la langue ou pour la faire chanter à sa guise. Tout était devenu affaire de spécialistes. De plus, si tout se vaut, que signifie encore un beau style ? C’est dépassé. Il lui restait donc l’histoire à raconter (s’il écrit un roman) pour se consoler. Mais là les théoriciens sont venus porter un dernier coup de butoir. Raconter une histoire, vous n’y pensez pas ? C’est dépassé. Après tout, un article de presse aussi raconte un événement qui s’est produit. Non, si la littérature a une spécificité, c’est ailleurs qu’il faut la trouver. Arrive donc le nouveau roman, qui parle en fait de lui-même, suivi par Barthes qui dit qu’un texte est littéraire si l’auteur a décidé qu’il le serait (c’est l’exemple de l’article de presse qui devient un poème si on change la disposition des mots et la ponctuation).
Dépossédé de la langue et de l’histoire, la pauvre auteur se cherche en vain. Alors il parle de lui et de son désir d’écrire (ma vie ne vaut rien si ce n’est par mon écriture et dans cette écriture je dis justement que ma vie ne vaut rien). Bref on tourne en rond et la littérature est devenue nombriliste, du moins en France, car à la même époque en Amérique du Sud le réalisme magique a un autre souffle et aux Etats-Unis on a encore de grands romans qui parlent de l’homme et du monde (Mac Carthy étant un de ceux-là, à côté de Styron, Penn Warren, Prokosch et quelques autres).
C’est que la « clique universitaire », comme dit Ph. Seelen, n’aurait regardé que le texte et pas le contenu. D’accord. Attention cependant à bien se comprendre. Plutôt que de s’égarer sans fin dans l’histoire littéraire (et vouloir par exemple comprendre une œuvre uniquement par le biais de la biographie de son auteur), on peut se pencher sur le texte, mais pour voir ce qu’il dit évidemment, par pour compter les figures de style et s’extasier sur l’occurrence des noms masculins et féminins. Mais on se comprend, ce qui est visé ici c’est l’approche universitaire qui privilégie la forme au fond. Or cette forme n’est qu’un moyen pour transmettre un message et c’est cela qui a été oublié. On a fait du moyen le but en soi, coupant le texte de ce qu’il disait, le privant ipso facto du lecteur qui en était le destinataire. Ou alors, si on a parlé du lecteur, c’est pour dire que celui-ci vient avec son propre bagage culturel, ses propres lectures antérieures, que cela influence sa compréhension du livre qu’il a en main (ce qui est vrai) et qu’à la limite, ce qu’a réellement voulu dire l’auteur importe peu (ce qui est faux) puisqu’il est de toute façon mal compris et que ses propos sont toujours déformés (ce qui est exagéré).
Donc, il faut revenir à une littérature qui parle de la condition humaine, je suis bien d’accord. La littérature doit être critique par rapport au monde, en dénoncer les insuffisances et les sophismes et nous permettre de prendre conscience de la manipulation permanente qui s’exerce sur nous, par exemple par le biais de cette civilisation marchande qui nous fait croire que le bonheur réside dans l’acquisition de biens de consommation.
Un auteur serait donc quelqu’un qui écrit dans ce sens (qu’il soit connu ou inconnu, finalement, édité ou non édité) et pas un de ces littérateurs qui ne fait que renforcer le rôle marchand de la société en se prêtant au jeu (produire beaucoup de textes, quitte à se faire aider pour cela, parader sur les plateaux de télévisons et permettre à certains de vendre le livre comme n’importe quel produit de consommation).
Maintenant, vouloir faire naître la littérature à la fin du 18è siècle, cela me semble un peu curieux. Certes, on comprend bien que Stendhal, ce n’est pas la Chanson de Roland et que Rimbaud n’est pas Du Bellay, mais que dire de Montaigne, de Rabelais, de Racine, de La Fontaine ? Ce ne serait pas des littérateurs ? Ils l’étaient manifestement plus que certains de nos contemporains.

15:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (39) | Tags : littérature, écrivain
10/03/2009
Réflexion sur le terme "écrivain" (2)
Sur son blogue "L'exil des mots", Bertrand Redonnet avait développé quelques idées suite à ma note précédente. Voici mon point de vue sur la question, qui prend sans le vouloir la forme d'un échange épsitolaire.
Bertrand, merci pour cette longue réponse.
Pourquoi je m’obstine sur ce thème ? Parce que si c’est le lecteur qui donne tout son sens à un texte écrit, de la même manière c’est le regard de la société (qu’on le veuille ou non) qui fait l’écrivain.
Un grand-père qui ferait les devoirs avec ses petits-enfants ne peut être qualifié d’instituteur, même si, peut-être, il explique mieux la matière qu’un enseignant officiel dûment diplômé. De même, celui qui cuisinerait chez lui avec grand art ne peut être qualifié de cuisinier. Pour cela il doit travailler dans le secteur de la restauration.
Mais je ne veux pas spécialement faire de l’art d’écrire un métier. D’ailleurs il n’y a heureusement ni école ni diplôme d’écrivain (je ne sais quels écrits académiques pourraient sortir de ce genre d’établissement). Il est donc logique que l’écrivain, en dehors de son activité d’écriture, trouve un moyen quelconque pour subsister, là n’est pas le problème.
Le problème, c’est de savoir à partir de quand quelqu’un qui a, comme tu dis, des velléités d’écriture, peut se qualifier d’écrivain (et on laissera le talent réel ou supposé de côté pour les besoins de notre démonstration).
L’écrivain est selon toi un homme qui écrit. Mais alors tous les adolescents qui tiennent un journal intime seraient des écrivains ? J’aurais tendance à dire, plus raisonnablement, qu’ils font œuvre d’écriture. D’ailleurs on sent bien que cette première définition ne te satisfait pas non plus puisque tu en propose aussitôt une deuxième, qualifiée très justement de «sociale » (preuve que c’est bien le regard des autres qui me positionne comme auteur). Ici, serait écrivain tout qui publie et touche des droits d’auteur.
C’est là que le bât blesse. En effet, pas plus qu’il n’y a d’école d’écrivains, il n’y a de profession officiellement reconnue. Et comme chaque auteur, en gros, tire ses revenus d’une autre activité, il y a confusion. Ecrire n’est pas un métier puisqu’on ne peut en vivre, mais bizarrement on a tendance à qualifier d’écrivain celui qui, par le nombre de livres parus et par la réputation qu’il s’est acquise, donne l’impression de ne pas avoir d’autre activité que l’écriture.
Tu me dis que je suis un écrivain. C’est très gentil, mais je n’arrive pas à y croire. Je serai écrivain le jour où des éditeurs auront bien voulu éditer quelques-uns de mes manuscrits (car ce sont eux qui délivrent le laissez-passer, en ayant estimé en tant que professionnels que mes écrits ont de la valeur).
Tu me diras que tu penses beaucoup de mal des éditeurs, qui ne font pas bien leur travail et tu auras raison. Malheureusement, en effet, ils viennent souvent avec des critères contestables, qui ne sont pas les nôtres, mais il n’en reste pas moins que ce sont eux qui dans un premier temps te sacrent écrivain. Après, il faut encore que le public suive.
Maintenant si tu me donnes un de tes textes à lire ou si Débla (puisque tu parles d’elle), fait pareil, il est évident que dans mon fort intérieur je vais vous considérer comme des écrivains. Mais Débla qui n’est pas encore parvenue à être publiée (pas plus que moi donc) peut-elle dire à sa voisine ou au boulanger du coin de sa rue qu’elle est un écrivain ? Non, bien sûr, ces personnes éclateraient de rire parce qu’ils n’auraient pas connaissance de l’existence du moindre manuscrit. C’est bien la preuve que pour pouvoir officiellement se dire écrivain, il faut donc une certaine reconnaissance du public. Je n’ai pas dit qu’il fallait passer tous les huit jours à la télévision et avoir trois millions de lecteurs, mais être reconnu par un certain nombre d’initiés me semble être le minimum. En fait, j’ai un peu l’impression qu’on est en présence de cercles concentriques. On est d’abord reconnu par quelques amis, puis on est publié. Ensuite, on peu avoir une certaine notoriété dans sa région (sans pour autant être un écrivain régionaliste), puis enfin être reconnu sur le plan national, voire international (avec ce paradoxe que les auteurs les plus connus ou les plus traduits ne sont pas forcément ceux qui offrent la meilleure littérature, du moins pas toujours).
C’est dans ce contexte déjà passablement embrouillé et qui manque de visibilité et de clarté, que sont apparus les blogues, qui ont permis à tout un chacun (et à moi le premier), de venir s’exprimer. Les quatre millions de blogueurs qu’il doit y avoir en France sont-ils tous des écrivains ? Non, nous sommes d’accord pour n’en retenir qu’un certain nombre, ceux qui font de l’écriture et de la transmission d’un certain message leur objectif. Pourtant, il faut tenir compte du fait que ces blogues non littéraires que nous classons un peu vite comme inintéressants ont tout de même permis à un certain nombre de personnes de (re)prendre la plume, depuis l’adolescent qui enfin aligne des phrases de plus de trois mots jusqu’à la mamy qui se croit de nouveau à l’école devant sa rédaction. Ces gens-là sont-ils des écrivains ? Mummm. Ils écrivent en tout cas. Et nous, avec nos blogues pompeusement qualifiés de littéraires, comment serions-nous perçus par des écrivains reconnus ? Comme de piètres imitateurs, comme des gamins qui veulent jouer dans la cour des grands, en tout cas pas comme de véritables écrivains.
Donc, bien sûr qu’on se moque du deuxième métier d’un auteur et il est évident que la vie militaire de Choderlos de Laclos ne nous intéresse pas comme telle et qu’elle ne porte pas ombrage non plus à sa qualité d’écrivain. Mais tu le dis toi-même, « le lecteur est souverain dans son plaisir». C’est donc lui qui me sacre écrivain. Encore faut-il avoir des lecteurs. Et pour en avoir (en dehors des blogues), il faut être édité. Et pour être édité…
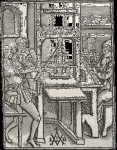
00:09 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : littérature, écrivain
08/03/2009
Réflexion sur le terme "écrivain"
Nous disions donc que les émissions littéraires, si on les préfère à des séries télévisées ou à des jeux idiots, ont cependant contribué à fausser quelque peu le monde des livres. En effet, certains auteurs sont finalement moins connus par leurs écrits que par leurs prestations sur le petit écran ou en tout cas, si leurs livres sont connus et lus, c’est via la publicité (in)directe qui leur a été faite. Nous sommes dans une société du paraître où ce n’est pas ce qui est authentique qui prime, mais ce qui brille et ce qui pourra se vendre. Dans une telle logique, la télévision invite les personnalités les plus médiatiques qui lui assureront une bonne audience (ce qui permettra par ailleurs de bonnes rentrées publicitaires), lesquelles devenant célèbres seront les seules à jouir d’un grand prestige auprès du public. Mais si cette célébrité ne repose pas directement sur la qualité des livres écrits (ceux-ci peuvent être bons par ailleurs, mais ce n’est pas une nécessité), nous pourrions légitimement nous demander ce qu’est finalement un écrivain.
Je reprends ici le thème que j’avais développé en commentaire sur le nouveau blogue littéraire que vous connaissez sans doute déjà, les sept mains (blogue tenu à tour de rôle par sept écrivains parmi lesquels on retrouve Bertrand Redonnet, qui est un habitué de Marche romane et Marc Villemain qu’on a déjà croisé ici de temps en temps).
Faut-il, pour être qualifié d’écrivain, consacrer tout son temps à la littérature et en vivre ? On comprend bien que si on accepte cette définition, 90% des auteurs vont passer à la trappe car bien peu vivent exclusivement de leurs écrits (ou alors ce sont des auteurs qui ont un grand succès commercial et qui se vendent beaucoup, mais ce n’est sans doute pas là la meilleure littérature, on en conviendra. Et encore, je suis gentil, certains diront ouvertement que ce n’est pas de la littérature du tout).
Alors, un écrivain est-il quelqu’un qui ne fait qu’écrire mais qui ne vit pas forcément de ses livres ? Il pourrait, comme Gide ou Proust, être rentier ou bien dépendre des revenus d’un conjoint ou encore être entretenu par un parent. C’est vrai que dans ce cas, il dispose comme dans l’exemple précédent de tout son temps pour écrire. Mais le fait qu’il ait occupé ses longs loisirs en rédigeant des manuscrits plutôt que d’aller jouer au golf ne nous garantit en rien que ses livres seront de bonne qualité. Donc, il ne suffit pas d’avoir le temps et l’argent pour être un bon écrivain.
Faut-il, dès lors, mourir de faim dans sa mansarde et vivre en solitaire en dessous du seuil de pauvreté ? Un tel personnage qui aurait tout quitté par goût de la littérature forcerait forcément notre respect et c’est déjà une preuve qu’il se sent impliqué par l’écriture, mais est-ce une garantie de la qualité de sa production ? Non, évidemment.
D’ailleurs le même écrivain pourrait être par exemple au chômage et plutôt que de mourir de faim dans ladite mansarde, il pourrait tout de même s’offrir un plat de pâtes les vingt premiers jours du mois. Mais en serait-il davantage écrivain pour autant ? Non bien entendu.
Le problème de fond, c’est qu’on ne peut pas vivre de sa plume, sauf cas exceptionnel. Du coup, la majorité des vrais écrivains (ceux qui produisent des livres de qualité et que nous aimons lire) ont un deuxième métier pour survivre (parfois dans l’édition ou le domaine culturel, mais pas toujours. Il y a des enseignants, des journalistes, des employés, des animateurs d’ateliers d’écriture et des chômeurs même, comme nous l’avons déjà dit).
Mais du coup, cela complique notre recherche de définition de l’écrivain. Un professeur de lycée qui a publié deux livres est-il vraiment un auteur alors que toute son activité est concentrée ailleurs et que ses livres édités font figure de passe-temps ? Pourtant, s’il n’avait pas d’autre profession (et s’il vivait comme on l’a dit d’un héritage ou des revenus de sa femme) serait-il plus écrivain par le fait qu’il ne ferait rien d’autre ? On aurait tendance à dire que oui, mais on a vu que ce n’était pas une preuve de qualité.
Et celui qui n’a rien publié alors ? Il pourrait avoir quarante œuvres maîtresses dans ses tiroirs… Serait-ce un écrivain ? Non, il semble logique qu’il faille au moins être publié. Mais cela ne suffit pas. Il faut vendre un minimum, sinon cela reste de l’amateurisme. Mais il ne faut pas vendre trop non plus, sinon on va vous accuser de fabriquer des best-sellers, des ouvrages sur mesure, sans rapport aucun avec la littérature.
Mais si la profession, la publication, la vente et les revenus ne sont pas des critères suffisants, qui dira ce qu’est un écrivain ? Un amoureux des mots ? Mais qui ne l'est pas. Alors?

23:17 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, écrivain
04/03/2009
De la célébrité des écrivains
L’autre jour, dans la note intitulée «De l’enseignement des auteurs classiques », j’avais souligné qu’il vaudrait peut-être mieux, dans les écoles, étudier des auteurs (et même des auteurs classiques) en se penchant sur leurs œuvres et le texte en main plutôt que de se contenter d’inviter un écrivain dans la classe. Cette dernière démarche peut être intéressante à l’occasion, mais le risque est de focaliser l’attention sur un personnage finalement médiatique (aux yeux des élèves, un auteur possède forcément une certaine aura prestigieuse) au détriment de ses écrits.
En y réfléchissant un peu plus, je me dis que l’école ne fait là que reproduire ce qui se passe dans la société. Il suffit, pour s’en convaincre, de regarder les émissions littéraires, dans lesquelles l’accent est surtout mis sur la personnalité de l’écrivain beaucoup plus que sur ses livres. C’est un fait connu et une évidence : il vaut mieux avoir un physique agréable et un bon bagout pour se faire remarquer sur un plateau de télévision. C’est un peu normal, me direz-vous. Non, pas vraiment en fait, puisque le propre d’un écrivain est d’écrire et non de venir faire le guignol devant une caméra. Si on attend en principe d’un animateur qu’il soit charismatique et qu’il sache emporter les foules, je considère au contraire qu’un bon écrivain n’a pas forcément à avoir ces qualités-là.
Le problème, c’est que pour être connu (et donc vendre suffisamment d’exemplaires de manière à ce que son éditeur accepte sans trop de problème son prochain manuscrit) il doit passer par la télévision. Nous sommes donc en présence d’un double paradoxe. D’une part c’est lui qui assure la publicité de ses écrits et non l’éditeur (lequel ne fait que récolter les fruits de la prestation télévisée de « son » auteur) et d’autre part il est jugé non sur ses livres mais sur la manière dont il fera bonne figure devant les téléspectateurs. Autant demander à un juriste de se singulariser dans une piscine olympique ou à un diplomate de faire ses preuves devant les fourneaux d’un grand restaurant trois étoiles, c’est la même chose.
Vous me direz qu’il n’est pas nécessaire de passer à la télévision pour être consacré auteur, mais je vous répondrai que par les temps qui courent ce n’est pas si sûr. En effet, qu’est-ce qu’un auteur ? Il y aurait mille définitions à proposer, mais il est certain que Bernard Pivot, dans son «Métier de lire » a pu dire que « tout auteur passé par « Apostrophes » était un écrivain et inversement, si l’on n’avait pas été invité à l’émission, c’est qu’on n’était pas écrivain. »
C’est donc l’émission qui accorde le titre d’écrivain et pas l’inverse. On n’est pas invité parce qu’on est écrivain, on le devient parce qu’on est invité. Le problème (encore un), c’est que ce sont toujours les mêmes que l’on revoit sur les plateaux. Ce ne sont pas forcément les meilleurs prosateurs (notons en passant qu’il y a peu de poètes dans ces émissions) mais ceux qui défendent mieux leur produit (oui, on en est là !). On tourne donc avec une trentaine de célébrités et de temps à autre on invite un petit nouveau. A lui de se montrer à la hauteur s’il veut revenir la prochaine fois. De plus, comme ces émissions ont souvent un thème (la culture, l’œnologie, la psychologie, etc.) on peut aussi faire venir des personnes célèbres dans un autre domaine et qui ont écrit sur le sujet du jour (à la demande probable d’un éditeur, qui, misant sur le fait que ces personnes étaient déjà connues, leur a demandé de traiter un thème porteur et qu’ils connaissent un peu : Sarkozy, Internet, l’inceste, etc.). Les voilà donc reconnues comme écrivains par le seul fait d’avoir écrit un livre et confirmées dans ce statut par le fait d’avoir été invitées à TF1 ou Antenne 2.
Et tous les autres me direz-vous ? Les 600 auteurs de le rentrée d’automne ? Les 59.400 qui se sont vu refuser leurs manuscrits en 2008 (on n’accepte qu’un texte sur cent, c’est bien connu) ? Et les 600.000 qui écrivent dans leur petit cahier ? Et bien ceux-là ne sont pas écrivains, voyons. Ils écrivent, c’est différent.

Du pouvoir exorbitant de la télévision…
16:32 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, écrivains, célébrité
03/03/2009
Dialogue (2)
Comment saurait-on qu’on est le dernier homme sur terre ? dit-il.
Je ne crois pas qu’on le saurait. On le serait, c’est tout.
Personne ne le saurait.
Ca ne ferait aucune différence. Quand on meurt, c’est comme si tout le monde mourait aussi.
Je suppose que Dieu le saurait. N’est-ce pas ?
Il n’y a pas de Dieu.
Non ?
Il n’y a pas de Dieu et nous sommes ses prophètes.
Cormac Mac carthy, La route
09:26 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature, mac carthy
02/03/2009
Dialogue (1)
Vous souhaitez mourir ?
Non. Mais je pourrais souhaiter être mort. Quand on est en vie on a toujours ça devant soi.
Ou vous pourriez souhaiter n’être jamais né.
Hé bien. Les mendiants ne peuvent pas faire les difficiles.
Vous pensez que ce serait trop demander.
Ce qui est fait est fait. De toute façon ça ne rime à rien de vouloir du luxe par les temps qui courent.
Sans doute que non.
Cormac Mac Carthy, La route
12:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, mac carthy







