29/06/2007
Ville à la campagne

De plus en plus de personnes vivent en ville, nous assure-t-on dans la presse. C’est une vérité incontournable, en effet, que ce soit dans notre vieille Europe ou dans des pays émergeants comme le Mexique ou la Chine. Répercutée dans la blogosphère, la nouvelle a débouché sur l’idée que de tels propos ne voulaient pas dire grand chose, la différence entre la ville et la campagne semblant être devenue particulièrement ténue de nos jours. C’est vrai, évidemment. Et pourtant…
Et pourtant il me semble qu’il n’y a pas si longtemps on pouvait encore faire une distinction bien nette entre ces deux mondes. Il y avait d’un côté la ville (avec ses cinémas, ses théâtres, son mode de vie nocturne) et de l’autre la campagne profonde, celle des paysans (avec ses coutumes, sa parcimonie, sa prudence, son bon sens, sa rudesse, etc.). Entre ces deux mondes, régnait une incompréhension totale, doublée d’une grande indifférence. De plus, là où le citadin en vacances regardait avec une condescendance amusée, voisine du mépris, le paysan en train de gratter la terre, ce dernier lui rendait la pareille (non sans une certaine envie devant celui qui avait accès au raffinement, à la culture et aux distractions), considérant avec réserve cet habitant de la ville en tout point semblable à la cigale de la fable.
Donc, quoi qu’en disent certains, il y avait bien deux modes de vie distincts. En ville, par exemple, on pouvait sortir en semaine, aller voir un film et repasser dans un café boire un verre ou déguster une pâtisserie. Une telle attitude aurait été inconcevable à la campagne, où il fallait attendre la fête au village pour manger un morceau de tarte, une ou deux fois par an (tarte par ailleurs cuite à la maison). D’un côté on avait donc l’insouciance et les loisirs, de l’autre la nécessité de travailler une terre au demeurant souvent ingrate. En ville l’argent venait naturellement et régulièrement d’une activité de salarié, à la campagne on n’était jamais sûr de rien, étant à la merci du moindre orage ou de la moindre gelée, ce qui à la longue rend prudent et économe.
Enfant, j’ai côtoyé ces deux mondes, très différents comme je l’ai dit. Les années passant, mon point de vue, inévitablement, est devenu plus citadin et j’ai commencé, moi aussi, à regarder de l’extérieur ce monde paysan. Le rapport à la nature était différent. Alors que les gens de la ville, dans une volonté écologique, voulaient la préserver en l’état où elle se trouvait, les habitants de la campagne, qui étaient lassés de vivre au milieu des champs et des bois, auraient presque souhaité voir une autoroute passer devant leur ferme. On peut les comprendre. Isolés au cœur de l’hiver, ils devaient emprunter de vieilles routes communales défoncées et étroites pour se rendre au magasin le plus proche. Pourquoi leur aurai-je refusé le droit d’avoir eux aussi une route convenable et sûre qui aurait diminué le temps de leurs trajets ? Moi-même, pour venir me ressourcer chez eux, j’avais bien emprunté l’autoroute. Lassés des buildings, rien n’était plus reposant pour moi que le petit village avec son église et son vieil arbre. Mais au nom de la modernité l’arbre a été coupé et la place devant de l’église s’est transformé en une esplanade de macadam. Je l’ai regretté. Ceux du coin, s’en sont félicités. Ce jour-là j’ai bien dû admettre que j’étais devenu un citadin.
Parallèlement à cela, la dépopulation a fait des ravages. Les maisons, vidées de leurs habitants, ont été rachetées par des touristes. Un autre mode de vie s’est alors introduit dans ces contrées reculées (reculées pas tant géographiquement que sociologiquement). Les dimanches, on pouvait voir les cultivateurs travailler dans leurs étables ou dans leurs champs tandis que les touristes se prélassaient dans les premières pelouses (avant il n’y avait jamais eu de pelouses, évidemment). Etant un peu du coin, je n’aurais pas trop osé m’afficher ainsi ostensiblement dans l’inaction. Je préférais donc les grandes marches dans la forêt profonde, ce qui convenait à ma solitude et me permettait par ailleurs de trouver du temps à consacrer à la réflexion (on ne dira jamais assez le côté apaisant que peut procurer une marche en pleine nature et comment nos idées prennent alors une tournure beaucoup plus équilibrée). Puis le temps passant, les touristes ont continué à affluer et les cultivateurs, ayant atteint l’âge de la pension, se sont mis à aménager les abords de leur demeure en les entourant de pelouses. Leurs enfants, devenus facteurs ou professeurs, les ont imités. Les champs à la limite du village sont devenus des terrains à bâtir. Un entrepreneur est venu s’installer, donnant du travail et massacrant le paysage avec ses pelles mécaniques et ses hangars.
Aujourd’hui on peut dire que l’esprit a changé et que la ville est à la campagne. Celle-ci demeure pourtant encore en moi, enfouie dans les souvenirs.

16:29 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (0)
28/06/2007
Ecrire pour survivre
Cherchant à s’exprimer, désirant faire du « neuf », l’écrivain veut avant tout atteindre à l’immortalité. C’est que l’acte d’écrire semble en effet indissociable de cet ancrage temporel dans un futur par ailleurs fort improbable. On écrit pour échapper à la mort et à l’oubli, espérant trouver dans le regard des générations futures (regard qu’on n’aura pourtant jamais l’occasion de croiser) une justification de sa vie d’aujourd’hui. Démarche illusoire s’il en est, car combien, en fait, parviendront à produire une œuvre assez importante pour marquer les générations futures ? Combien de Cervantès, de Rabelais, de Molière notre siècle comptera-t-il ? Très peu, sans doute. Encore faut-il se rendre compte que parmi les écrivains du passé qui ont eu la chance d’arriver jusqu’à nous, beaucoup sont appréciés pour des raisons différentes de celles qui avaient justifié leur succès auprès de leurs contemporains. Ainsi en va-t-il de Voltaire, qui se croyait un grand dramaturge. S’il est connu aujourd’hui, ce n’est certes pas en tant que dramaturge, mais plutôt par le rôle éminent qu’il a joué comme contestataire de l’Ancien Régime. De plus, si on prend son œuvre littéraire proprement dite, ce sont assurément ses contes qui nous enchantent le plus, situation qui le surprendrait probablement beaucoup. De son côté, Rabelais était avant tout un grand médecin et les aventures de Gargantua qu’il nous a laissées devaient sans doute relever pour lui du simple délassement. Théophile Gautier, quant à lui, s’est sans doute cru un poète de génie avec ses Emaux et Camées (voir sa théorie de l’art pour l’art : « C’est encore plus beau quand c’est inutile »), mais nous sommes plutôt sensibles aujourd’hui à ses écrits fantastiques.
Inversement, beaucoup de ceux qui ont eu du succès de leur vivant et qu’on croyait précisément immortels ne sont pas passés à la postérité. Il n’y a qu’à feuilleter la liste des membres de l’Académie pour ce rendre compte que bien des noms nous sont inconnus. D’autres, tels Lamartine, se sont imposés par le biais des anthologies scolaires, mais honnêtement, qui lit encore Lamartine aujourd’hui ?
Notons que cette recherche systématique de l’immortalité comme justification de l’acte d’écrire semble être liée au rôle primordial joué par l’individu dans notre civilisation contemporaine. Dans des sociétés plus primitives, telles notre Moyen-Age occidental (j’ai dit plus primitives, pas moins complexes), on voit que les chansons de geste sont anonymes. Les poèmes épiques sont faits pour être transmis oralement et chaque récitant y va de sa version personnelle. Les manuscrits que nous avons conservés ne sont finalement que de vastes compilations de chants préexistants, une magnifique synthèse, en quelque sorte, superbement rédigée. Celui qui l’a faite n’a pas trouvé utile d’y apposer son nom, tout simplement parce que seuls les exploits racontés avaient de l’importance et non la personnalité de l’écrivain. Il en a été de même dans la Grèce antique (certes on cite Homère comme auteur possible de l’Iliade et de l’Odyssée, mais que sait-on de lui, finalement ?), dans la civilisation nordique (Eddas) ou encore en Inde avec le Rig-Veda. C’est plus tard, quand le rôle du « clan » a été moins déterminant, que l’individu a pu s’affirmer pleinement, au point de vouloir s’imposer par son oeuvre personnelle. Dans cette optique, rien de plus logique que de vouloir écrire quelque chose d’inédit. Au lieu de perpétuer une tradition et d’imiter les anciens, il faut faire du neuf et de l’original, en exprimant sa propre spécificité.

16:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Littérature
26/06/2007
Apologie de l’antique
C’est devenu un fait évident et que plus personne ne conteste : en art, il faut faire du neuf. En littérature aussi, apparemment. A quoi bon, en effet, réécrire ce que d’autres ont déjà mieux exprimé que vous ? Inutile de donner une nouvelle Madame Bovary, que tout le monde connaît déjà, on en conviendra. On ne va pas non plus proposer une version personnelle d’Une saison en enfer ni imiter Philippe Jaccottet. Non, il n’y a que ce qui n’a jamais été dit qui peut être exprimé. Fiers de leur ego, les littérateurs s’en donnent donc à cœur joie. Chacun y va de sa rengaine propre, de ses souvenirs personnels ou de sa vision du monde forcément originale puisque c’est la sienne propre.
Tout cela est bien beau, sauf que cela nous donne sept cents romans à la rentrée d’automne, sept cents romans qui se ressemblent à peu près tous, tous les auteurs ayant misé sur la même modernité.
Pourtant, si on conçoit facilement qu’il ne sert à rien de réécrire les chefs-d’œuvre antérieurs, s’il semble évident que seule une vision personnelle et originale mérite d’être mise en avant, il n’en reste pas moins que cette course à la modernité comporte quelques dangers, parmi lesquels le refus des grands classiques n’est pas le moindre. A force de vouloir être modernes et résolument tournés vers l’avenir certains en ont oublié de regarder derrière eux. Privés du terreau originel, ils n’ont plus d’assises et leurs écrits semblent s’étioler comme des plantes poussant sur un sol caillouteux. Négligeant la richesses inouïe de leurs devanciers, ils préfèrent puiser en eux la source de l’inspiration, ce qui nous donne souvent des œuvres introspectives, tournées vers le dedans, où le nombril de l’auteur semble être devenu le centre du monde. Ces écrits-là manquent de souffle et sentent la philosophie en chambre. Seules les œuvres ouvertes sur le monde, reflétant la complexité de la société, cherchant à donner à l’individu une place dans l’univers, méritent en fait d’être publiées.
Or, s’il y a bien des livres qui ont fait leurs preuves, ce sont bien ceux du passé. S’ils sont parvenus jusqu’à nous et s’ils nous parlent toujours, c’est qu’ils possèdent en eux-mêmes un « je ne sais quoi » qu’on ne peut certes pas assimiler à un phénomène de mode. Et parmi ces livres anciens, il me semble que ceux de l’Antiquité sont particulièrement méconnus. Qui lit encore Virgile, Plaute ou Sénèque ? Sans parler des historiens comme Tite-Live, Tacite et quelques autres ? Les Humanités classiques ont quasi disparu de nos collèges et lycées. Il est vrai que dans notre société mercantile, mieux vaut un bon diplôme en « marketing » qui vous permettra non seulement de trouver un emploi mais aussi de vendre à un tas de gens (et pour votre plus grand profit) des produits dont ils ignoraient jusqu’à l’existence avant votre intervention, mieux vaut un tel diplôme, disais-je, plutôt que d’écouter le chant des sirènes avec Ulysse ou de vous pâmer sur les amours de Didon.
Et pourtant… Et pourtant, je plaiderai toujours, avec Jacqueline de Romilly, pour les études classiques, qui ouvrent des portes insoupçonnées. Outre la rigueur de l’analyse grammaticale (ah ! ces aoristes et ces verbes en « Mi » de la conjugaison grecque !), elles permettaient de se familiariser avec de grands textes littéraires à un âge où l’esprit était encore suffisamment malléable pour pouvoir en être imprégné. Les élèves parcouraient en imagination les plaines d’Asie mineure en suivant avec Xénophon la retraite des dix mille, ils s’initiaient à la démocratie en lisant les discours de Démosthène ou découvraient les horreurs du pouvoir en méditant sur les descriptions que Tacite nous donne de Néron.
Mais qui se souvient encore de tout cela aujourd’hui ? Quelques-uns, qui disparaissent les uns après les autres. N’ayant pas été initiés, les jeunes d’aujourd’hui ne se donneront même pas la peine d’ouvrir une traduction, tant il est vrai que pour eux tout ce qui précède le XIX° siècle leur semble inabordable et complètement révolu. Et je parle de ceux qui lisent, bien entendu, c’est-à-dire finalement d’une minorité, tant les jeux vidéo et autres joyeusetés ont supplanté l’écrit. Parlant de la sorte, je me fais l’effet de tenir le discours d’un vieillard décati, plein d’amertume et de rancune. Et pourtant ma propre jeunesse ne remonte pas encore si loin, même si elle commence, il est vrai, à prendre le large dangereusement. « Ύνωθι σεαύτον », nous disait Socrate. Connais-toi toi-même. Connais les autres, aussi, avec qui tu as la chance de vivre. Et cette connaissance, à mon sens, doit passer par les auteurs classiques, qui l’emportent, et de loin, sur certains de nos auteurs contemporains. Quant à tous ceux qui demanderaient quelle est l’utilité de se frotter ainsi aux textes antiques et quel profit ils pourraient bien retirer de l’apprentissage du latin, je répondrais, comme un certain professeur : « Cela sert à ce que vous ne me posiez plus la question. »

09:01 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Littérature, Antiquité
25/06/2007
Paysage (4)

Qui dira jamais ce qui nous fascine devant le spectacle époustouflant de la marée haute ? Cette masse liquide qui, inlassablement, monte à l’assaut des terres devrait nous inquiéter, voire nous révulser, pourtant il n’en est rien. Plus l’eau gagne du terrain et plus notre enthousiasme grandit. C’est contre nous, pourtant, que l’océan lance ses assauts, contre le monde de la terre ferme, dont nous faisons partie. Elément hostile par excellence, la masse des eaux tente d’envahir notre univers. Nous devrions être au désespoir et c’est l’inverse qui se produit. Chaque vague qui dépasse la précédente suscite notre admiration. Nous laissant prendre au jeu, nous prenons parti pour la mer. Si en plus, à cette marée haute, vient s’ajouter la tempête, notre excitation est à son comble. La grande houle profonde, venue du fond, qui vient se briser en gerbes éclatantes contre les rochers semble éveiller en nous une sorte de vengeance. Ce combat des vagues est un peu le nôtre. Il semble correspondre à notre désir d’aller toujours plus haut, toujours plus loin. Brisés quelque part par la vie, qui ne nous a pas permis de réaliser nos rêves (ou de ne les réaliser que partiellement), condamnés à mener une existence ordinaire, il nous semble voir dans cette force de l’océan l’ultime possibilité d’accéder à la démesure. Ces vagues qui déferlent contre les falaises, dans un fracas d’enfer, deviennent un peu nous-mêmes, par procuration. Comme elles, nous souhaiterions anéantir tout ce qui s’oppose à notre extension et imposer enfin notre loi, dans le tumulte de la victoire.
Remarquons qu’une marée basse, même si l’eau est agitée, ne procure jamais le même sentiment de plénitude. Ici, on sent la mer vaincue, qui se retire inexorablement, malgré quelques grognements sauvages qui n’en imposent plus à personne. Non, il n’y a que la marée haute, surtout si elle est renforcée par une tempête, pour éveiller en nous ce sentiment de destin à accomplir, de lutte à mener, de victoire à remporter enfin. La mer transgresse les interdits, elle a toutes les audaces, elle entreprend tout ce que nous n’aurions même pas osé imaginer. Elle est nous-même dans sa violence bestiale, pure et belle dans sa lutte acharnée, merveilleuse dans son désir d’accomplissement.

J’ai connu ainsi, enfant, des soirées remarquables, dans la Bretagne du Nord. Juillet, là-bas, prend parfois des airs d’automne, surtout quand la lune est pleine et que la mer vient s’écraser contre les falaises avec une obstination inimaginable. Dans la pénombre, l’écume blanche jaillissait en grandes gerbes contre les rochers, avant de se retirer, emportant avec elle des milliers de galets dans un roulement de fin du monde. Ce bruit des galets, laissant deviner la puissance de la force qui les entraînait, m’a toujours semblé être celui de la création du monde. Qui pourrait résister à cette masse océane capable de déplacer ainsi en une seconde des milliers de pierres, les roulant dans tous les sens, les réduisant aux éléments d’un jeu dont elle seule a inventé les règles ? Eclaboussé parfois par les gerbes d’eau, tout couvert d’embruns, l’enfant de dix ans que j’étais regardait avec respect la nature à l’œuvre, en train de s’inventer de nouveaux mondes.
Dans l’univers littéraire, l’océan, on s’en doute, a inspiré les poètes, depuis le vieil Homère, et sa « mer aux flots tumultueux », jusqu’à Valéry (« La mer, la mer, toujours recommencée »), en passant par les poésies d’Ossian, sans oublier, bien entendu, Léo Ferré :
« La marée je l'ai dans le cœur
Qui me remonte comme un signe
Je meurs de ma petite sœur
De mon enfant et de mon cygne
(…)
Je me souviens des soirs là-bas
Et des sprints gagnés sur l'écume
Cette bave des chevaux ras
Au ras des rocs qui se consument
Ô l'ange des plaisirs perdus
Ô rumeurs d'une autre habitude
Mes désirs dès lors ne sont plus
Qu'un chagrin de ma solitude »
La mémoire et la mer
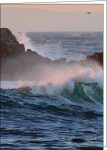
15:47 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (0)
22/06/2007
Art roman
On ne dira jamais assez de bien de la collection Zodiaque. Celle-ci a été créée par « l’abbaye de la Pierre qui vire », qui éditait et imprimait elle-même les volumes, perpétrant ainsi la tradition monastique de l’Occident médiéval.
http://www.abbaye-pierrequivire.asso.fr/
La collection zodiaque s’est rendue célèbre par ses ouvrages sur l’art roman en Europe, réalisés à la fois par les moines de l’abbaye et des universitaires de renom.
http://www.romanes.com/biblio/zodiaque_fr.html
J’ai été particulièrement impressionné autrefois lorsque j’ai lu le livre France romane, rédigé par Raymond Oursel.

D’abord, tout lecteur, même profane, ne peut qu’être admiratif devant la qualité des photographies proposées, certaines en couleur, d’autres en noir et blanc.
Ensuite, jamais comme dans ce livre je n’ai ressenti l’impression d’insécurité permanente qui devait être celle de nos ancêtres confrontés aux invasions barbares. Bien sûr, de par l’école, nous connaissons tous les Wisigoths et autres Ostrogoths, sans parler des Huns et du célèbre Attila (lequel, soit dit en passant, fut vaincu un 20 juin 451 aux Champs catalauniques, près de Troyes), mais il faut lire le texte d’Oursel pour comprendre de l’intérieur et comme si nous y étions, ce que représentait l’arrivée d’un bateau normand ou viking dans un village du Moyen-Age. Il en va de même pour le massif des Maures, si bien nommé. Si aujourd’hui ce terme évoque des vacances le long de la Méditerranée, il ne faut pas oublier que pendant des siècles ce massif a abrité des pirates mauresques, lesquels enlevaient tous les imprudents qui s’aventuraient seuls sur une plage ou dans la montagne. Ces malheureux finissaient souvent leurs jours comme esclaves dans un Orient qui, pour eux, n’avait rien de commun avec les Mille et une nuits.
Enfin, ce qu’il y a de plus remarquable dans le livre d’Oursel, c’est la manière dont il fait parler les pierres de nos vieilles églises romanes. Je dois dire que j’ai un faible pour cette architecture primitive et que je ne manque jamais d’aller en visiter une si d’aventure ma route m’amène à proximité. Derrière le mystère qui émane naturellement de ces vieilles pierres (doublé de la méditation qui s’empare de nous quand nous réfléchissons sur ces hommes qui nous ont précédés et qui ont construit ces merveilles), j’avais surtout été sensible, jusque là, à l’aspect esthétique de ces églises. Dans leur simplicité et parfois même leur naïveté, elles ont en effet quelque chose d’attachant qui parle au cœur. Mais Oursel a su me les faire voir avec les yeux des religieux qui les ont fait construire. Mon regard esthétisant s’est doublé d’un regard quasi mystique. Certes telle ogive peut être belle en elle-même, par ses courbes ou la couleur de la pierre qui la compose, mais au-delà de cet aspect purement matériel, il a su montrer ce qu’elles veulent dire, les faisant parler et libérant ainsi l’esprit qui a présidé à leur érection. Devenues poèmes de pierres, elles révèlent, dans leur majesté architecturale, l’aspiration de l’homme du Moyen-Age à dire le sacré.
Ce sacré, c’est sans doute ce à quoi aspirent les moines de l’abbaye de la Pierre qui vire. Sur le site donné en lien plus haut, on peut lire qu’ils se consacrent au travail pour subvenir à leurs besoins, mais qu’ils en limitent la durée à cinq heures par jours pour pouvoir s’adonner à leurs activités religieuses, ce qui est bien la moindre des choses de la part de religieux. Etrangement, du fond de mon athéisme (fût-il mystique), je les rejoins pleinement. Le travail devrait permettre à l’homme de survivre et ne devrait jamais devenir une fin en soi. Il faut du temps libre pour se consacrer à la pensée, à la recherche intérieure, à l’art, à la littérature. Si les hommes préhistoriques avaient dû passer toutes leurs journées à poursuivre le gibier, ils n’auraient jamais peint les murs de Lascaux ou la grotte de Gargas, si chère à Dominique Autié.
http://blog-dominique.autie.intexte.net/blogs/index.php/all?cat=47
A une époque où la compétitivité économique est à l’ordre du jour, dans une société marchande où seule l’acquisition de la richesse semble donner du prestige, il est peut-être bon, parfois, de prendre du recul et, tels les bâtisseurs des églises romanes, tenter de jeter un autre regard sur le monde, un regard plein d’admiration sur ce qui nous entoure. Car c’est à n’en pas douter l’harmonie qu’avaient trouvée ces moines du Moyens-Age. A une époque où la mort était partout et la vie ô combien fragile, ils étaient parvenus par leurs chants et leurs constructions, à dire la beauté de l’univers dont ils faisaient eux-mêmes partie.
Pour terminer, je voudrais reproduire ici le petit texte qui explique pourquoi c’est le nom « Zodiaque » qui a été donné à la collection des livres de l’abbaye de la Pierre qui vire :
…(P)arler de zodiaque, c'était parler du temps : du temps naturel, de celui que mesure le mouvement des planètes dans la sphère céleste. Cette question de temps nous paraissait l'une des plus cruciales de l'époque. L'accélération constante du progrès nous semblait un risque majeur. "En prônant le zodiaque, disions-nous, nous réclamons le retour à une vraie notion de temps basée sur les lois de la nature : à une vie normale, inscrite dans le déroulement, voulu par Dieu, du monde des choses." Nous pensions bien laisser entendre que l'art ne nous intéressait que dans la mesure où il débouchait sur l'humaine aventure, la révélant mieux que tout autre indice, l'engageant aussi. "On n'atteint la beauté que dans l'amour, et l'amour exige le temps et la liberté.
Un beau texte à méditer...

16:40 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : art roman, éditions zodiaque
21/06/2007
Quand le vin monte à la tête.
Avec deux jours de retard, il conviendrait de se souvenir du centenaire des incidents de Béziers. Il faut savoir que l’Aude, le Gard, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales survivaient au début du XX° siècle grâce à leur production viticole. Ils alimentaient toute la France en vin bon marché, boisson jugée antiseptique par Pasteur et finalement préférable à une eau peu potable. Après la crise du phylloxéra (1865), les viticulteurs, courageusement, reconstituent leur vignoble avec des ceps algériens. Dans les années 1900, la production devient excédentaire, d’autant plus qu’elle commence à être concurrencée par les vins espagnols, italiens et surtout algériens. Comme la Rome antique, la France devient donc la victime de sa principale colonie, laquelle parvient à vendre à des prix plus intéressants. Pourquoi ? Et bien simplement parce que dans ces vins étrangers, on ajoute du sucre pour élever le taux d’alcool et que le gouvernement français en a accepté le principe. Comme il fallait s’y attendre, avec cette surproduction, les prix chutent d’une manière vertigineuse et beaucoup de paysans français sont ruinés. Les Languedociens se mobilisent donc pour réclamer l'abrogation de la loi de 1903 qui autorisait l’ajout de sucre, mais Clemenceau refuse. On s’organise et un mouvement de contestation prend naissance avec à sa tête un certain Marcelin Albert. 150.000 personnes viennent l’écouter le 12 mai 1907 à Béziers. Il menace le gouvernement de faire la grève de l’impôt si aucun geste n’est fait avant le 10 juin. A la veille de cette date, le 09 juin, Montpellier rassemble 600.000 manifestants. De son côté, Clemenceau envoie 27 régiments (issus de régions éloignées afin d’éviter que les troupes ne prennent parti pour les vignerons), soit 25.000 hommes de troupe et 8.000 cavaliers.
Comme il fallait s’y attendre, la situation dégénère et le 19 juin, à Narbonne, les soldats tirent sur la foule, faisant deux morts. Le lendemain, c’est cinq morts qu’il faut déplorer. À Agde, 600 soldats du 17e régiment d'infanterie (bizarrement tous issus de la région, Clemenceau n’ayant sans doute pas été assez vigilant) se révoltent. Ils gagnent Béziers où ils sont acclamés par la foule. Pourtant, le 21 juin, Clemenceau peut annoncer à la Chambre que les mutins sont rentrés dans le rang. Ils seront expédiés au fin fond de la Tunisie. Plus tard, le même Clemenceau veillera à ce que ce régiment soit toujours en première ligne en 1914, dans l’Est de la France.
Dans le Languedoc, les principaux meneurs sont arrêtés. Marcelin Albert parvient à s’échapper. Il se rend à Paris où il rencontre Clemenceau. Celui-ci, autoritaire, lui fait la morale avant de lui remettre un billet de 100 francs pour le train du retour. Le pauvre Marcelin accepte, tout en promettant de rembourser le prix du billet. Discrédité auprès des siens, qui s’estiment trahis à juste titre, il devra s’exiler en Algérie et finira ses jours dans la misère. De son côté, le gouvernement établit une surtaxe sur le sucre et réglemente sévèrement le négoce du vin, donnant ainsi raison aux manifestants.
Au-delà du geste de « ces braves soldats du 17° », on retiendra le choc qu’a constitué pour la production locale languedocienne la venue des vins étrangers. Prémices à l’actuelle mondialisation du commerce, les incidents de Béziers symbolisent la confrontation entre un mode de production ancestral (la culture de la vigne remonte à l’époque romaine dans ces régions) et les premiers produits « industriels ». Un problème bien d’actualité, finalement. Il n’est pas étonnant qu’on n’en ait pas beaucoup parlé.

15:12 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Histoire, Béziers
20/06/2007
De l'usage d'Internet.
On connaît la difficulté qu’il y a à lire des textes longs à l’écran. Pourtant, certains journaux sont parfois écrits en petits caractères et les textes qu’ils nous proposent défilent souvent en longues colonnes parallèles. On conviendra que ce n’est pas très reposant pour le regard et pourtant nous lisons tous ces articles. Le confort de l’œil ne serait donc pas seul en cause dans notre refus de rester de longues minutes devant notre écran. La souris qui est à notre disposition en permanence pourrait bien être la responsable. Elle est en effet un incitateur à aller cliquer sur tous les liens qui se trouvent généralement à gauche et à droite de toute page Internet qui se respecte. Distraits dans notre lecture (ce que nous ne sommes pas quand nous lisons un journal puisque nous le tenons en main), nous ne résisterions pas à l’envie de saisir la souris, dans une sorte de geste mécanique machinal. Ensuite, l’esprit, qui est avide de découverte, nous pousserait inconsciemment à aller cliquer sur tous les liens mis à notre disposition, abrégeant du coup la lecture commencée. Celle-ci nous apparaît subitement rébarbative et nous passons à autre chose.
Il faut d’ailleurs souligner le danger qu’il y a à « surfer » ainsi, faisant défiler les écrans les uns après les autres sans rien approfondir, dans une recherche aussi vaine que désespérée. Outre le fait que dans une telle démarche nous n’avons généralement rien retenu des articles entrevus, quand nous quittons notre ordinateur c’est souvent un sentiment d’impuissance qui s’est emparé de nous. Impuissance devant l’impossibilité qu’il y a à lire le contenu des dizaines de sites entrevus. Il est loin le temps de la Renaissance où l’homme s’imaginait encore pouvoir acquérir tous les savoirs. Relégués dans une branche, notre spécialité se réduit habituellement à presque rien. Et pourtant, ce presque rien est encore de trop pour nous puisque nous n’arrivons même pas à prendre connaissance de la millième partie.
D’un autre côté, pour nous rassurer et ne pas finir sur une note trop pessimiste, il faut se dire qu’on trouve de tout sur Internet, le meilleur et le pire. Notre incapacité physique à tout ingurgiter est sans doute un bienfait de la nature, qui nous évite ainsi de nous abrutir sur des sites remplis d’erreurs ou peu dignes d’intérêts.

15:50 Publié dans Actualité et société | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Internet, lecture à l'écran
14/06/2007
Grandes surfaces du livre
Lors de ma dernière visite à la FNAC, j’ai été surpris, une fois de plus, par la place occupée par la littérature, laquelle semble se réduire à chaque fois comme une peau de chagrin. J’en suis arrivé au point où j’aurai bientôt peur de mettre un pied dans ce magasin, tant j’en ressors à chaque fois déconfit et désespéré.
Il n’y avait pourtant pas si longtemps que les spécialistes en rayonnages et les diplômés en marketing avaient complètement restructuré l’ensemble. Dans la bataille, on avait déjà perdu pas mal de mètres de rayonnages, sans compter que les parties biographie, critique et poésie s’étaient retrouvées décalées par rapport à l’ensemble de la production littéraire, reléguées qu’elles étaient dans une allée à grand passage.
L’autre jour, donc, qu’elle ne fut pas ma surprise de constater que ce rayon poésie avait complètement disparu. En cherchant bien, j’ai retrouvé, coincé entre les nouvelles sorties romanesques et la rubrique théâtre (comprenez : les pièces de théâtre qu’on fait lire aux lycéens), un présentoir qui offrait royalement dix titres de poètes contemporains. Pour le reste, rien. N’en croyant pas mes yeux, j’ai poursuivi mes investigations au milieu de la foule toujours abondante durant la pause de midi Finalement, c’est pour ainsi dire à quatre pattes que j’ai fini par découvrir la collection de poche Poésie Gallimard, laquelle devait se limiter à une bonne soixantaine de titres (parmi les plus célèbres, bien entendu). En dehors de cette collection de poche, que j’aime bien par ailleurs, le vide absolu. Encore faut-il parvenir à la découvrir au ras du sol, tout en se faufilant entre les jambes des jeunes clientes qui viennent en ces lieux passer un moment au sec en ce printemps pluvieux (opération périlleuse par ailleurs et qui vous distrait vite de votre investigation première).
Donc, des poètes qui sortent un peu de l’ordinaire, disais-je, vous n’en trouverez pas ou fort peu. Et quand je dis qui « sortent de l’ordinaire », je ne demande rien d’extraordinaire, bien entendu…
Tout ceci nous amène à un autre débat, celui des librairies de qualité, lesquelles me semblent se faire de plus en plus rares. Elles disparaissent les unes après les autres, nous laissant la nostalgie de temps révolus qui pourtant ne sont pas encore si lointains. Est-ce cela, vieillir ? Commencer à regretter un monde qui meurt et se réfugier dans les souvenirs ? Ou bien est-ce l’époque elle-même qui devient boutiquière au point de ne plus proposer que ce qui se vend bien ? Un peu les deux, sans doute.
Demain, peut-être, on ira à la FNAC pour faire ses emplettes. Entre les plats surgelés et les boîtes de Coca on pourra peut-être encore découvrir le dernier Goncourt. Un livre écrit sur commande et signé par une célébrité ? A moins que vous ne préféreriez un CD reprenant les meilleurs discours de Sarkozy ?
En attendant j’achète et je stocke chez moi des livres pour les années à venir. On n’est jamais assez prudent.
19:38 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature, Fnac
08/06/2007
De la consécration littéraire
Dans ses Carnets du grand chemin, déjà cités, Julien Gracq fait remarquer que la seule consécration littéraire qui ait quelque valeur à ses yeux, doit être le fait d’un écrivain réputé. Les critiques comme les lecteurs avisés ne le convainquent pas. Pourtant il reconnaît que les propos tenus par ceux-ci comme par ceux-là sont souvent profonds et non dénués d’intérêt. Mais il n’y a rien à faire, rien ne vaut l’approbation et l’encouragement d’une sommité littéraire.
On sait que son Château d’Argol avait reçu les éloges de Breton avant même sa publication. Pour le jeune Gracq, le fait d’être ainsi reconnu par une personnalité aussi importante, qui faisait figure de « pape » des lettres, constituait une sorte de laissez-passer qui l’autorisait à entreprendre une carrière littéraire.
Il regrette d’ailleurs dans les Carnets (soit en 1986) qu’il n’y ait plus personne dont l’opinion lui importe encore. Breton, Malraux, Gide et Valéry s’en sont allés depuis longtemps. Les quelques écrivaillons contemporains le laissent indifférent, concentrés qu’ils sont sur leurs propres sillons. Quant aux critiques et aux lecteurs, leurs éloges ne font pas autorité pour l’assurer de la valeur de sa production récente. Il compare en fait cette reconnaissance par des gens du métier qui ont fait leur preuve à une sorte d’adoubement moyenâgeux. Tels les Compagnons, qui devaient produire une pièce maîtresse et recevoir l’avis positif des maîtres de la corporation, il estime qu’il n’y a que les vieux routiers de l’écriture, ceux qui ont vécu le fait littéraire de l’intérieur, qui peuvent avoir un avis pertinent.
Tout ceci est évidemment un peu frustrant pour les lecteurs et les critiques que nous sommes tous un petit peu. Quelque part, cependant, il doit avoir raison. Il faut avoir écrit soi-même une œuvre pour mieux cerner la difficulté qu’il y a à en agencer tous les rouages. D’un autre côté, il me semble que cette recherche systématique d’approbation de la part d’un aîné (ce qui est difficile à trouver quand on a plus de quatre-vingt-dix ans) repose davantage sur la réputation de ce donneur d’avis que sur sa capacité réelle à juger de l’œuvre d’autrui. De plus, n’y a-t-il pas là une attitude quelque peu puérile de vouloir à tout prix être reconnu par ses aînés ? Rimbaud attendait-il les éloges du Parnasse pour écrire Une Saison en enfer ? Il est vrai qu’il eut les encouragements chaleureux de Verlaine, ce qui n’était pas rien.
00:42 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Littérature, Gracq, critique littéraire
06/06/2007
Littérature et peinture
Si on s’interroge sur les différences qui existent entre un écrivain et un peintre, on en trouvera plusieurs.
D’abord, le peintre, s’il est artiste, est avant tout un artisan. Il lui faut savoir manier le pinceau avec une certaine dextérité, ce qui est la condition première à la réalisation de tout tableau de qualité, on en conviendra. Quelque part le peintre est donc un « manuel ». L’écrivain, lui, n’a besoin d’aucune disposition particulière, si ce n’est d’avoir appris à écrire à six ans et de savoir utiliser le clavier et la souris de son ordinateur. S’il n’est vraiment pas doué, un simple stylo fera l’affaire.
Ensuite, le peintre (qui ne peut, comme un romancier, décrire le paysage et les personnages avant de raconter finalement une histoire, laquelle comporte habituellement de nombreux rebondissements) doit choisir un moment « in medias res » pour illustrer au mieux l’action représentée. Si on reprend le célèbre tableau « Le radeau de la Méduse » de Géricault, on se rend compte que la scène choisie se trouve à la fin du drame. Par le radeau on comprend qu’il y a eu un naufrage et par l’air hagard des personnages, on devine que leur calvaire dure depuis plusieurs jours. Les gestes désespérés qu’ils font en direction de l’horizon indiquent qu’un bateau vient d’apparaître mais que celui-ci ne les voit pas, ce qui les renvoie à leur désespoir et à leur sauvagerie. Un romancier, lui, aurait d’abord raconté pourquoi tel personnage avait décidé de prendre le bateau, aurait décrit l’embarquement, aurait imaginé une histoire à bord (intrigue entre les soldats par exemple), nous aurait fait frémir sur le naufrage proprement dit avant de nous angoisser davantage encore en décrivant la situation de plus en plus scabreuse de tous ces hommes. Les rapports psychologiques entre les survivants auraient été analysés méticuleusement, avant d’arriver aux scènes d’horreur de cannibalisme. Enfin, quand un bateau serait apparu à l’horizon, il nous aurait fait vibrer d’espoir avant de nous replonger, avec les naufragés, dans l’abandon le plus absolu. Bref, tout cela, qui aurait pu compter quatre cents pages bien serrées, Géricault, parce qu’il est peintre, nous le révèle en un instant, dans une scène statique qui résume le tout. Il existe donc en peinture une économie de moyens qui oppose cet art à la littérature, laquelle demande finalement un esprit analytique.
Enfin, il existe encore une autre différence entre le peintre et le romancier. Elle est de taille et pourtant on ne l’envisage pratiquement jamais. C’est ce qu’il advient de leur production respective. Ainsi un tableau, à la différence d’un livre, se caractérise par son unicité. Il peut être endommagé ou détruit, ce qui ne doit pas manquer d’angoisser l’artiste. Une fois vendu, il disparaît à jamais et physiquement de son univers. A peine s’il parvient à se souvenir de la technique qu’il a employée ou des effets de couleurs qu’il est parvenu à rendre. En cas de doute, il lui sera bien difficile de procéder à des vérifications si le tableau a été acquis par un particulier. D’ailleurs ce particulier unique, qui est-il ? Mystère. Pourquoi a-t-il acheté précisément ce tableau-là ? Le peintre ne le saura jamais. L’auteur de littérature, lui, peut à loisir contempler ses œuvres sur les rayonnages des librairies ou des bibliothèques (y compris dans la sienne propre). Son livre, par la magie de l’imprimerie, s’est multiplié à des milliers d’exemplaires, ce qui lui assure une certaine pérennité. Veut-il en relire un passage qu’il n’y a rien de plus facile, il n’a qu’à tendre le bras.
Pourtant, d’un autre côté, l’œuvre écrite et éditée lui échappe autant que la toile du peintre. Elle n’est plus vraiment sienne. Dans son travail d’écriture, il en avait amélioré la forme et le fond à plusieurs reprises avant de se décider d’arrêter à un certain moment cette recherche de perfection. Imprimé, le livre devient immuable, « tel qu’en lui-même, l’éternité le change». S’il le relit, l’auteur pourra le trouver imparfait. Il souhaitera peut-être le modifier, faire des retouches, améliorer certains passages. Trop tard, le livre appartient désormais aux lecteurs, qui pourront lui reprocher de l’avoir laissé en cet état d’imperfection alors que déjà lui-même pense le récrire autrement. Jamais fini, imparfait à ses yeux, il doit bien pourtant le laisser vivre sa propre vie. Si par hasard, à l’occasion d’une seconde édition, il décide d’y apporter des corrections importantes, il écrit en fait une nouvelle œuvre.
Le livre écrit, bon ou mauvais, reste donc physiquement dans l’entourage de l’écrivain, à la différence d’une toile. Ecrivain qui ne pourra pas faire comme s’il ne l’avait jamais écrit. Quelque part, cette « présence » des livres (en tant qu’objets, mais aussi en tant que symboles occupant un espace dans l’imaginaire personnel de l’auteur) définissent l’écrivain. Jamais il ne pourra plus être comme s’il ne les avait pas écrits.

00:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Littérature
01/06/2007
L'académicien immortel
Max Gallo a été élu à l’Académie française. Il est vrai qu’il y a beaucoup de fauteuils vides, en ce moment, parmi les immortels. Les places de Bertrand Poirot-Delpech, Jean-François Deniau, Henri Troyat, Pierre Moinot et René Rémond sont d’ailleurs encore à vendre.
Max Gallo, manifestement, est un homme qui se lève tôt, car il a écrit une centaine de livres (romans, biographies et études historiques). Voilà qui ne devait pas déplaire à Monsieur Sarkozy. Né en 1932 dans une famille d’immigrés italiens, il incarne donc à suffisance les « bons étrangers » parfaitement intégrés qui ont su se faire une place à la force du poignet. D’historien, il s’est transformé en romancier, et nous a donné des biographies historiques à succès. Rien de tel pour se faire connaître du grand public. De plus ces biographies ont un accent franco-français, ce qui est encore mieux (Napoléon, De Gaulle, etc.).
Bien sûr, nul n’étant parfait, il avait commencé comme militant communiste, mais qui s’en souvient encore ? Porte-parole du gouvernement socialiste au début des années quatre-vingts, il avait rallié récemment les troupes du petit Nicolas. Le hasard fait bien les choses.

16:41 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, Académie française, Max Gallo
Vocabulaire
N’allez pas confondre une Nigériane avec une Nigérienne, les mots ayant leur importance Mais encore faudrait-il que vous sachiez où se trouvent ces deux pays et lequel se situe au Nord-Est de l’autre… Hé hé !
Comme il ne faut pas confondre un Hindou avec un Indien. Tous les Indiens ne sont pas hindous, mais est-ce qu’il y a des Hindous qui ne sont pas indiens ?
En tout cas il y a plusieurs Indiens, ceux d’Inde et ceux d’Amérique. Dans ce dernier cas on parle alors d’Amérindiens, par commodité. Encore faut-il distinguer ceux du Nord et ceux du Sud. Il est facile de les différencier. Ceux du Sud sont en voie de disparition tandis que ceux du Nord ont déjà disparu.
Une Indienne sera donc une femme vivant en Inde (qu’elle soit hindoue ou non) ou en Amérique (pour autant, bien entendu, qu’elle soit de race indienne. Georges Bush, par exemple et comme chacun sait, n’est pas un Indien même s’il joue souvent au cow boy). Mais une indienne (sans majuscule) est une toile de coton légère et colorée. Tout le monde peut s’habiller d’une simple indienne, les Indiennes hindoue d’Inde, mais aussi les Nigérianes du Nigeria.
Et les hommes dans tout cela ? N’allez pas confondre le substantif bonhomme avec l’adjectif homonyme. Un bonhomme (qui n’est pas forcément un homme bon) est une personne jugée sympathique ou au contraire qui inspire la réserve ou la méfiance. Ainsi, on dira : « Ce bonhomme me fait peur ». Le féminin est bonne femme (en deux mots). Par contre, pour un dessin représentant grossièrement l’être humain, on parlera toujours de bonhomme. L’adjectif bonhomme, quant à lui, signifie « qui exprime la franchise, la simplicité » (avoir un air bonhomme). Le substantif correspondant est évidemment bonhomie (avec un seul M), qui signifie « caractère d’une personne bonhomme » (et non bonne).
Bon, bon. Nous en aurons fini quand nous aurons parlé des bons-chrétiens, mot qui ne désigne pas les supporters de Benoît XVI mais une variété de poire.
On dit d’ailleurs « C’est une bonne poire » pour dire finalement qu’une personne a tellement l’air bonhomme qu’elle se fait toujours avoir. Etant trop bonne, elle en devient bonasse (le substantif correspondant est bonasserie, à ne pas confondre avec bonneterie, lequel soit-dit en passant s’écrit sans accent sur le « e »)
J’en ai fini et ne vais pas vous ennuyer avec la bonace, terme vieilli qui désignait le calme plat en mer (du latin malacia lequel a été contaminé par « bon »).
Il suffit maintenant de mettre tout cela en musique :
Une bonne femme nigériane se rendant au Niger vêtue d’une indienne rencontra un bonhomme bonasse. C’était un Indien hindou qui travaillait dans une bonneterie. « Que votre indienne est jolie », dit l’Indien à la Nigériane, « ne voudriez-vous pas me la céder pour mon épouse? ». « Merci pour le compliment, vous êtes trop bon », répondit la dame, mais ma religion m’interdit de parler aux hommes, qu’ils soient bons ou pas et encore moins de me dévêtir devant eux. ». « Je comprends », répond l’Indien, de mon côté je suis hindou et apprécie votre pudeur. Allons, n’en parlons plus. Comme je suis bonne-poire, je vous offre quelques bons-chrétiens pour la route. » « J’espère qu’ils sont bons », répond la bonne femme d’un air bonasse.
Ps. : je connais une ville qui possède une rue « de la bonne femme ». Ce terme n’est pas à opposer à "bonhomme » et pour en comprendre le sens il faut remonter à l’étymon latin : mala fama. Cette notion de « mauvaise réputation » fut ensuite transformée, par ironie ou par discrétion, en bonne réputation. On retrouve là l’hypocrisie habituelle de la bourgeoisie qui n’ose pas désigner les réalités par leur nom, ici en l’occurrence le monde de la prostitution.

13:52 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : langue française, vocabulaire







