30/11/2009
Réflexions posthumes
Certes, il était mort, mais qu’est-ce que cela changeait, finalement ? Il retrouvait ici les mêmes injustices que celles contre lesquelles il avait lutté toute sa vie et la seule différence, en fait, c’est qu’il n’y avait plus aucun espoir de changement. En ce lieu, la corruption et le passe-droit étaient institutionnalisés pour l’éternité. Comment conserver le moral dans de pareilles conditions ?
Il repensait à toutes ces belles pages de la bible qu’on lui faisait lire quand il était enfant et qui revenaient toutes à dire que les premiers seraient les derniers et inversement. Une belle foutaise, oui ! Il suffisait de les voir arriver, les nouveaux trépassés… Un peu perdus le premier jour, comme tout le monde, certes, et pas trop à l’aise dans leur nouvel habit. Mais après une semaine les jeux étaient faits. Ceux qui avaient laissé des richesses sur terre les faisaient valoir pour obtenir de menus avantages tandis que les autres, les roublards, les sophistes, les arrivistes, se débrouillaient déjà pour être les premiers dans les files d’attente. Après un mois, on les retrouvait tous à des postes enviables. Les uns étaient devenus de grands chefs, autrement dit de parfaits petits tyrans, d’autres jouissaient en toute impunité des biens immobiliers que le Très-Haut leur avait confiés, d’autres encore étaient devenus célèbres d’une manière ou d’une autre et les foules, toujours aussi stupides, leur portaient une admiration sans borne.
Les politiciens continuaient à faire de la politique, ce qui revenait à gérer bien peu les affaires publiques et à parler beaucoup pour se faire remarquer, tandis que les écrivains les plus en vue s’étaient tous transformés en historiographes officiels. Leur rôle consistait à transcrire sur l’ordinateur central tous les faits et gestes de ce petit monde, ce qui devait être un peu fastidieux, il faut bien le reconnaître, mais la récompense était sans commune mesure avec le peu d’efforts qu’ils avaient dû fournir. Lors des dîners officiels, ils se retrouvaient assis à la droite de Dieu, ce qui déjà n’était pas rien, mais en plus ils continuaient à gérer leurs affaires terrestres. Leurs livres continuaient à se vendre dans les grandes surfaces de France et de Navarre, leur rapportant de substantiels bénéfices et ils s’arrangeaient bien pour faire éditer leurs œuvres posthumes, histoire d’entretenir dans la mémoire des hommes le souvenir qu’on avait d’eux.
Respectés de tous, au ciel comme sur la terre, ils passaient leur temps à se quereller entre eux, imaginant, pour se départager, des prix littéraires aussi futiles que prestigieux. Le jeu consistait à composer des jurys sur mesure et à acheter les électeurs, ce qui est particulièrement facile quand on a de l’argent et qu’on se sait soutenu par le pouvoir en place. Evidemment, il y avait toujours un zozo ou l’autre pour croire que ces prix étaient honnêtes et qu’ils récompensaient le talent. On voyait donc des écrivains dits de seconde zone passer des nuits entières dans le froid de leur mansarde à essayer de composer des poèmes épiques. Ils alignaient ainsi dix mille vers octosyllabiques assonancés dans lesquels ils dépeignaient les souffrances qu’ils avaient endurées durant leur vie terrestre. D’autres, aussi fous qu’eux, parlaient du pays de leur enfance, là-bas, au bord de l’océan ou bien ils décrivaient dans des nouvelles sublimes leur apprentissage de la vie le long d’une Dordogne de rêves. Evidemment, aucun de ceux-là ne remportait le prix et ce dernier était décerné, comme il se doit, à celui qui en avait été l’instigateur, le mécène et le grand argentier.
Bref, ce fameux paradis dont on avait tant parlé était franchement décevant car il ne faisait que fixer pour l’éternité tous les travers contre lesquels le héros de cette histoire s’était battu de son vivant. En réalité, il avait eu beau s’insurger contre l’injustice, il n’avait pas obtenu beaucoup de succès. Pour être franc, il n’en avait même obtenu aucun, de succès. Et puis dans le fond il ne s’était pas vraiment battu non plus. Disons plutôt qu’il avait beaucoup réfléchi, beaucoup écrit, qu’il s’était emporté souvent contre l’iniquité ambiante, qu’il avait souffert de l’état déplorable du monde, mais finalement tout cela n’avait servi strictement à rien. Ce même monde avait continué à tourner et à être dirigé par quelques cyniques sans foi ni loi. Certes, il ne s’était jamais fait aucune illusion sur la situation et s’était plutôt réfugié dans une sorte d’espoir, attendant un changement futur, toujours possible. Et voilà que non seulement il était mort sans qu’aucun de ses rêves ne se fût réalisé, mais en plus il devait bien constater maintenant que tout cela avait été vain. Pourquoi avait-il vécu en fait ? Pour rien, strictement pour rien. Il avait cru pouvoir modifier la société, mais c’était impossible et c’était la petite lumière qui brillait en lui qui était finalement incongrue. Dans la dichotomie qui séparait sa vision personnelle des choses du monde ambiant, force était de reconnaître maintenant que c’est lui qui avait eu tort puisque même Dieu en son paradis donnait raison à ses ennemis.
Le plus dur, en fait, ce n’était ni cette déception, ni la conscience d’avoir eu tort, mais l’impossibilité où il se retrouvait de conserver le moindre rêve. Tant qu’il avait été sur terre, en effet, il avait pu croire en un ailleurs, mais il devait bien reconnaître maintenant que cet ailleurs était le fruit de son imagination. Le monde idéal auquel il aspirait dans son cœur, ce monde où la beauté et l’amour auraient été présents, n’existait tout simplement pas. Il avait bâti sa vie sur une illusion et l’attitude de Dieu, maintenant qu’il le voyait bien à l’œuvre, était là pour lui rappeler jusqu’à quel point il s’était fourvoyé.
Comment vivre sans rêves ? C’était la question qu’il se posait désormais et pour un peu, devenu mélancolique, il aurait voulu trouver refuge dans le suicide. Mais comment se suicider quand on est déjà mort ? C’était impossible ! Et comment être pour l’éternité un fantôme sans espoir ? C’était tout aussi impossible. C’est alors qu’il comprit ce qu’était l’enfer et comme ce terme n’était pas un vain mot. L’enfer, c’était l’absence de rêve et la soumission aux lois iniques des autres. L’enfer, c’était comprendre que la petite flamme qui l’habitait n’avait pas de raison d’être et qu’il devrait ressasser cette idée jusqu’à la fin des temps. Alors il sut qu’il était vraiment mort.

00:30 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (30) | Tags : littérature
24/11/2009
La musique
La musique me prend dans ses vagues
ses grandes vagues océanes
et m’emporte dans une gerbe d’écumes
aux portes de l’univers
aux confins de moi-même.
Elle m’emporte au pays des songes et des brumes
dans ces embruns laiteux où brille une étoile morte.
Je suis un grand voilier emporté par le vent,
je fends une mer de notes,
j’affronte des récifs,
je glisse au creux des flots…
Dans les mers boréales s’est noyé le cygne de Sibelius
alors que sous les tropiques,
Paul Gauguin n’en finit plus de peindre des femmes lascives,
couchées sur des plages d’infini.
Dans le vent des tempêtes
j’entends une symphonie de Debussy
tandis que claquent les voiles du grand mat d’artimon.
Puis la nuit est venue,
la grande nuit des commencements du monde.
Le vaisseau souffre, gémit
et se tord au-dessus des gouffres profonds.
La mort n’est pas loin.
Une corde de violon s’est brisée dans un cri.
Ce n’est qu’une mouette qui lutte avec elle-même.
Elle s’est posée là-haut dans les haubans
où elle a trouvé un refuge
et jouit du grand calme enfin revenu.
La mer n’est plus qu’un miroir démesuré
où se réfléchit le monde.
La mer est un miroir
où mon image s’est perdue.
La belle musique est morte,
vaincue par le silence
et quand se tait la dernière note,
il ne reste plus que mon désespoir
et l’éternel silence.

08:39 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature
21/11/2009
Automne profond
Quand est tombée la dernière feuille,
quand il n’est plus resté, dans la forêt,
que des branches nues
et de grands troncs démunis,
quand les pluies de l’automne eurent effacé jusqu’au souvenir du bel été
et que dans les sentiers nos traces eurent disparu,
quand il n’est plus rien demeuré de ce lit de fougères
où nous nous retrouvions pour apprendre à nous connaître,
encore et encore,
quand la boue et le froid eurent transformé le sous-bois en marécage
tandis que des oiseaux migrateurs traversaient le grand ciel noir,
quand il n’y eut plus, pour habiter ces lieux,
que des bêtes inquiètes et sauvages, à la recherche d’elles-mêmes
et fuyant une horde de chasseurs sans cesse à leur poursuite,
quand dans l’immensité de la nuit les étoiles se furent évanouies,
occultées par les nuages, les lourds nuages d’automne,
quand il n’y eut plus, dans la forêt dénudée,
que la présence de la mort,
alors il fut difficile, oui, de croire en un autre printemps,
alors il fut difficile, assurément, d’imaginer que nos mains pussent encore s’effleurer
un jour.
Sentier trempé qui serpente dans la forêt profonde,
silence posthume des êtres qui y vécurent
souvenir des jours passés.
Je marche seul entre les troncs noirs et nus,
Cherchant celui que sans doute je fus.
Il pleut.
Sur le bord de la dernière feuille,
une goutte d’eau hésite un instant puis tombe
dans son propre néant.
Bruit sourd qui marque la fin d’un monde.
Je marche et la nuit envahit
la forêt d’automne
que même les chasseurs ont désertée.
Il ne reste que le silence et la peur de la mort.
Il ne reste que le silence.
Le silence.
00:20 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, poésie
18/11/2009
Le reflet
Dans la chambre se trouve un miroir, un miroir qui ouvre sur les portes de la mort.
Je m’y contemple souvent mais l’image qu’il me renvoie n’est jamais tout à fait la même.
C’est que le temps, imperceptiblement, a progressé et que la vie, implacable, a déposé dans mon cœur son lot de tracas, usant ce corps qui, il n’y a pas si longtemps, était encore jeune.
Je me regarde et c’est un autre que je vois. Un autre qui à chaque fois est un peu différent et qui pourtant me ressemble. Ombre éphémère de moi-même, image évanescente et floue de celui que je suis en train de devenir.
Un jour, peut-être, quand je ne serai plus, une sorte de lumière vacillante habitera encore le miroir, une espèce de fantôme qui viendra effrayer les survivants, lesquels regarderont, incrédules, celui que je serai enfin devenu pour l’éternité.
X
X X
Dans la chambre il y a des livres, beaucoup de livres.
Certains parlent de pays inconnus où je ne suis jamais allé et où je n’irai jamais (la chambre est une fenêtre ouverte sur le monde).
D’autres racontent des histoires ou parlent de poésie (toutes ces images qui s’adressent à mon cœur…)
Dans la chambre il y a des livres. Ils sont la mémoire du monde et comme une partie de moi-même. J’en ai lu beaucoup, mais il en reste davantage encore à découvrir.
Dans le miroir, mon image me dit, ironique, que je n’en aurai pas le temps et qu’il est trop tard déjà. Beaucoup trop tard…
X
X X
Dans un coin de la chambre, il y a un lit, rien de plus normal en cet endroit.
Un lit où se reposer et partir en rêve vers des pays inconnus, ces pays découverts dans les livres.
Un lit où se réciter intérieurement des poèmes, ces poèmes appris dans les recueils entassés sur les étagères.
Un lit d’où on aperçoit son image dans le miroir. Une image parfois inconnue, comme les pays étrangers qu’on n’a pas visités, une image parfois émouvante, comme les poèmes qu’on récite avant de s’endormir pour l’éternité.

00:18 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, poésie, reflet
15/11/2009
Ovide dans le "Magazine des livres"
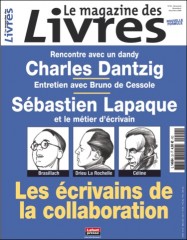
Je signale l’existence, dans le « Magazine des livres » n° 20 de novembre-décembre, de mon article sur Ovide, suite à la parution, l’année dernière, de « Tristes Pontiques » ( traduit du latin par Marie Darrieussecq, P.O.L., 2008, 424 pages, 25 euros). A vrai dire, mon texte a été rédigé en janvier 2009 déjà, mais sa publication a plusieurs fois été reportée, les écrivains antiques devant manifestement s’incliner devant l’actualité littéraire, toujours foisonnante comme on sait. Bon, je ne vais pas m’en plaindre et Ovide, qui avait bien attendu 2000 ans, n’était plus à quelques mois près, on est bien d’accord. Mais, tout de même, cette parution tardive est un signe des temps. Ce n’est pas à la revue que je lance la pierre (pour survivre, elle doit s’adapter aux goûts du jour et ses lecteurs cherchent forcément des renseignements en phase avec l’actualité), mais j’en veux à notre époque, toujours pressée, toujours agitée, toujours à la recherche d’une soi-disant nouveauté et qui, à force de courir sans cesse, n’arrive plus à analyser le monde avec calme et tempérance. En d’autres termes, je regrette que l’actualité littéraire tourne toujours autour du dernier roman à la mode ou autour de tel auteur fortement médiatisé, alors que les classiques sont souvent délaissés. Il me semble pourtant qu’ils ont beaucoup à nous dire et beaucoup à nous apprendre.
Ainsi, les deux textes d’Ovide dont il est ici question (« Tristes » et « Pontiques ») et qui ont été traduits par Darrieussecq (qui les a joliment dépoussiérés en employant une langue compréhensible par les hommes et les femmes du XXI° siècle), reprennent les poèmes écrits par l’auteur lors de son exil. Banni de Rome par l’Empereur Auguste pour une histoire de mœurs assez trouble, il se retrouve chez les Barbares le long de la Mer Noire (en Roumanie actuelle, dans le delta du Danube). Ce ne sont donc pas des vers mondains qu’il nous offre, mais une poésie du désespoir écrite avec son sang. Dans un premier temps il se contente de décrire ce qu’il a sous les yeux, en regrettant Rome. Puis, pour survivre, il essaie de repenser aux amis qu’il a laissés en Italie, espérant qu’ils parviendront à fléchir l’Empereur et à le faire revenir sur sa décision. A la fin, les années passant, il se rend compte que son exil sera définitif et qu’il ne reverra jamais les rivages de la mer Tyrrhénienne. Sa poésie devient alors carrément désespérée et c’est à ses lecteurs éventuels qu’il s’adresse (nous en l’occurrence), ce qui rend son texte bouleversant.
Extrait de l’article :
(…) Cette réflexion constante d’Ovide sur la nécessité d’écrire nous touche énormément. Il ne parle pas en théoricien de l’écriture qui réfléchirait devant sa page blanche sur le sens de sa démarche. Non, pour lui, perdu dans son éloignement, littéralement nié dans son existence d’homme et d’écrivain, il n’a plus que cette dernière ressource pour ne pas sombrer. C’est le seul fil qui le relie encore à la terre natale et le seul moyen qu’il ait trouvé pour survivre et continuer à être ce qu’il a toujours été, un poète. Ecrire de chez les barbares relève donc pour lui d’une démarche ontologique et on comprend qu’il y va de sa survie.
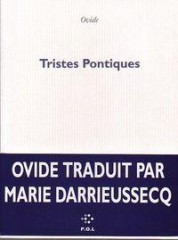
00:43 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : littérature, ovide, magazine des livres
11/11/2009
Automne historique
Il y a un arbre, seul au milieu des champs.
Il y a un arbre.
Ses feuilles sont d’un jaune éclatant, avec des reflets rouges et or.
C’est l’automne.
On sait que c’est l’automne parce qu’il y a un arbre, sinon il n’y a rien ici, rien que la plaine, la grande plaine.
La plaine et un arbre, un arbre tout jaune qui dit que c’est l’automne.
On n’a jamais vu un paysage aussi vide.
Mais c’est l’automne, l’arbre l’a dit et cela explique les tempêtes, le grand vent, les nuages gris amoncelés à l’horizon et puis surtout la pluie, l’éternelle pluie, qui n’en finit pas de tomber.
Les feuilles jaunes et or sont emportées par les bourrasques. Elles virevoltent dans le ciel et s’en vont à l’horizon, se perdre dans le gris des nuages.
Il n’y a rien ici. Rien que l’arbre. Et bientôt il n’aura plus de feuilles.
Je regarde la plaine, la grande plaine muette, immense, monotone.
Qu’en dire ? Rien. Il n’y a rien à en dire.
Alors, devant ce vide de l’espace, j’en viens à réfléchir au temps.
Je change d’axe, j’oublie le présent, l’arbre et son automne et je contemple l’Histoire.
J’imagine la plaine en d’autres temps.
Il faut pour cela faire un effort de mémoire et d’imagination et mettre bout à bout les récits des grands-parents et les pages lues dans les livres, à l’école ou plus tard.
Et voilà que tout s’anime, que la plaine se peuple de milliers et de milliers de personnes.
Car c’est bien ici qu’ils sont tous passés autrefois.
Ici, dans cette plaine, dont il n’y a rien à dire, si ce n’est justement qu’ils y sont passés.
Il me semble les voir, venant d’Est ou d’Ouest et ne faisant que passer.
Ils sont des milliers, des millions, à traverser la plaine, d’un côté ou de l’autre, tuant, violant, massacrant.
Ils sont des millions à se rendre ailleurs, à conquérir un ailleurs, et à passer par ici, traversant la plaine, la plaine avec son arbre.
Cet arbre-ci ou un autre avant lui, peu importe.
Il y a toujours un arbre, dans la plaine. On s’assoit, on s’appuie contre son tronc et on contemple de loin la marche de l’Histoire.
Et je les vois s’avancer. D’abord les plus récents : les panzers de 1940 avec leurs croix gammées. Ils viennent de l’Est et s’en vont vers l’Ouest.
Ils passent et rien ne les arrête car il n’y a jamais personne ici.
Un enfant peut-être les regarde passer. Assis comme moi contre cet arbre, il regarde. Et eux ils passent.
Avant, leurs pères étaient déjà venus. En 1914. Ils étaient à pied et marchaient aussi vers l’Ouest. Guerre de tranchées. Le soir, on entend le canon de Verdun, là-bas, plus loin, où on n’est jamais allé. On entend le canon et on sait que notre armée les a arrêtés.
Alors on attend. On attend qu’ils repassent. Mais il a fallu du temps: quatre longues années au moins, pour les revoir dans l’autre sens, fatigués, épuisés, vaincus. Ils passent et rentrent chez eux.
Avant encore, ce sont les pères de leurs pères. 1870, la fin de l’Empire. Ils arrivent, baïonnette au canon, sûrs de leur victoire. Celle-ci est écrite dans les livres ou va l’être très bientôt. Ils passent et ne s’arrêteront que devant Paris.
Plus on remonte dans le temps, plus les faits sont imprécis, comme si un brouillard était tombé sur la mémoire des hommes.
Mais c’est toujours la même plaine et le même arbre. Cette fois ils viennent de l’Ouest et s’en vont vers l’Est. Ce sont les nôtres qui vont conquérir la Russie, emmenés par Napoléon. Bientôt, on les verra aussi repasser dans l’autre sens. Enfin, ceux qui ont pu revenir, quelques-uns seulement, fourbus, crottés, malades. Il n’aura fallu qu’un hiver pour les voir à nouveau, mais quel hiver !
Avant cela, c’étaient les troupes de la Révolution et avant encore celles de Louis XV, qui suivaient de peu celles de Louis XIV. Ancien Régime ou Révolution, c’est du pareil au même : des soldats qui passent dans la plaine et qui vont combattre les autres, ceux de l’Est, parce qu’ils ne pensent pas comme nous.
Assis contre son arbre, l’enfant les regarde. Il n’en revient pas. Voilà déjà trois siècles que les troupes traversent sa plaine, dans un sens ou dans l’autre. Quel est le sens de tout cela ? Quel est le sens de l’Histoire, s’il faut toujours tout recommencer et refaire passer les mêmes soldats dans la même plaine et devant le même arbre ?
Et avant ? Avant Louis XIV ? Plus personne ne sait trop. La mémoire est incertaine. Les Autrichiens, sûrement. Les Espagnols peut-être. Puis les Français entre eux : Catholiques contre Protestants. Sedan, la petite Genève. Et des massacres, encore et toujours.
Plus loin encore, dans la nuit des temps, les Carolingiens, les Mérovingiens, les Francs. Attila, aussi, en route pour ses Champs catalauniques. Ils sont tous passés ici, absolument tous. Dans cette plaine où il n’y a rien, sauf un arbre où s’appuyer. Personne ne s’en souvient vraiment, pourtant ils sont bien passés par ici. C’est que dans la poussière du chemin, les pas de leurs chevaux se sont effacés. Il y a si longtemps !
Et avant eux, il y avait eu les légions romaines, avec leurs manipules et leurs centuries. Des soldats bien ordonnés, ceux-là, des soldats faits pour gagner et pour agrandir les empires. En ce temps-là la grande plaine fut un peu méditerranéenne. En ce temps-là l'arbre rêva d’être comme un olivier. Des routes furent construites, de Rome à Colonia Agrippa, la place forte à la frontière, sur le Rhin. Des routes furent construites, mais pas ici. La plaine resta une plaine, où il ne se passe jamais rien. Enfin presque rien.
Au-delà de Rome il n’y a pas d’écrits pour nous dire les migrations celtes. L’enfant imagine quelque barde, appuyé contre son arbre, et chantant des hymnes à la gloire de son peuple. Là-bas, un village aux toits de chaume et un laboureur avec sa charrue, déjà. Le premier, peut-être, à fendre cette terre avec un soc, le premier peut-être, à semer un grain de blé, ici même, dans l'immensité de la plaine.
Quant aux peuples néolithiques, qui pourrait en parler ? Bien sûr qu’ils passèrent aussi par ici. L’enfant le sait, qui retrouva un jour dans une grotte, près du fleuve, d’étranges dessins. C’était comme une ronde d’animaux fantastiques, des animaux comme on n’en avait jamais vu : des ours, des bisons, des aurochs. Et puis des mammouths aux grandes défenses. Eux aussi semblaient marcher dans la plaine ou courir, poursuivis par les chasseurs. Eux aussi étaient donc passés par ici, prédateurs ou victimes, attaquants ou attaqués. Comme les hommes et bien avant eux, ils s’étaient déplacés, à la recherche d’un ailleurs. C’est pour cela que le peintre les a immortalisés sur la paroi de la grotte et qu’il en a fait des dieux. C’est parce qu’ils ont marché dans la chaleur des tropiques ou dans la neige des grandes glaciations, c’est parce qu’ils ont marché vers un ailleurs, sans jamais s’arrêter.
L’enfant est appuyé contre le tronc de l’arbre et il regarde à l’horizon comme un tourbillon de poussières. Est-ce le vent d’automne qui emporte quelques feuilles ? Est-ce un peu de terre arrachée à la plaine et qui tourne sans raison ? Ou est-ce un peuple en marche pour une autre destinée ?
L’enfant ne le saura pas, lui qui reste assis contre son arbre, dans la grande plaine où il ne se passe jamais rien.

00:57 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature
08/11/2009
Leo Ferré et l'Italie (2)
J’ai déjà eu l’occasion, ici, de parler des chansons de Léo Ferré qu'il a lui-même interprétées en italien. Voici «Col tempo ( Avec le temps) ». Même si on ne comprend pas tout, ce texte possède manifestement une force extraordinaire, une nostalgie bouleversante, bien rendue par cette langue romane douce et chantante qu’est l’italien.
00:48 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leo ferre et l'italie
06/11/2009
Microcosme
L’arbre
Le ciel
La rivière et la terre
Etre
La forêt
Sa faune et sa flore
L’éternité du monde
L’infini
Demeurer
Les vagues sur les rochers
L’écume de ma vie
La mer, l’océan
Espérer
La grande ville
Ses artères, ses boulevards
Le chaos des choses
L’agitation
S’imposer
Un café quelque part dans la cité
Deux verres sur une table
La nuit profonde
Ton regard perdu
Aimer
Des trains qui traversent l’obscurité
Ma main qui cherche en vain la tienne
La chaleur de l’été
Un orage soudain
La pluie sur la vitre
Accepter
Les rues dans l’aube mouillée
Les premières voitures, les premiers camions
Un oiseau qui chante sur le toit d’une maison
Un pont, un fleuve, une traversée
Continuer
Une clef longtemps cherchée
La porte qui s’ouvre en grinçant
Un café noir qu’on prépare
Le lit où sombrer dans le rêve
Oublier
00:01 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature
04/11/2009
Claude Lévi-Strauss
On ne peut pas, ici, passer sous silence la disparition de Claude Lévi-Strauss, qui restera une des grandes figures du XX° siècle. Je l’ai découvert lorsque j’étais étudiant, dans le cadre de mon mémoire de fin d’étude et je dois dire que ses écrits m’ont profondément marqué. Dans la presse d’aujourd’hui, je constate qu’on cite beaucoup « Tristes Tropiques », livre admirable, certes et que j’ai beaucoup aimé, mais il me semble qu’on ne peut résumer la pensée de notre anthropologue à ce seul livre. Personnellement, c’est par les « Mythologiques que je l’ai abordé » et j’ai tout de suite été subjugué par la manière dont il parvenait à réduire tous les contes et mythes étudiés à une structure simple qui leur donnait un sens insoupçonné jusque là.
Depuis, on a beaucoup critiqué le structuralisme mais il me semble que les excès dont celui-ci s’est rendu coupable est plus le fait des successeurs (qui voulurent pousser à l’extrême le décorticage des textes, jusqu’à en oublier la valeur humaine ou esthétique) que du maître lui-même. Car Lévi-Strauss, lui, a su justement donner un sens aux mythes étudiés en dévoilant les lois sous-jacentes qui en composaient la charpente. Du coup, il est parvenu à relier tous ces mythes entre eux, nous donnant le fil d’Ariane qui permettait d’en faire une lecture globale. C’est donc à une analyse de la pensée humaine, envisagée dans son ouverture vers l’imaginaire, qu’il nous a conviés. En montrant comment les mythes de peuples qui n’ont eu aucun contact historique entre eux disent finalement la même chose (ou juste le contraire, ce qui revient au même car alors on brode toujours sur le même thème), il en arrive à la conclusion que l’esprit humain produira toujours la même pensée au même stade de son développement.
Etudiant tour à tour les règles de parenté, le mariage, la nourriture, les totems, les mythes, les échanges économiques et la création artistique, il a su, à chaque fois, percevoir la lame de fond qui animait tout cela. C’est donc à une analyse complète de l’ensemble des activités humaines qu’il parvient, nous offrant une synthèse des archétypes mentaux. Cette synthèse, il l’a souvent représentée sous la forme d’une symphonie. Chaque instrument joue dans son coin, mais l’ensemble forme un tout cohérent et harmonieux, un tout qui a un sens. Face à la nature et à l’animalité, l’homme a donc su inventer des histoires, des coutumes, des rites, pour dire qui il était vraiment et pour tenter de justifier à ses propres yeux son existence sur terre.
Bien sûr, avec Lévi-Strauss, l’auteur (ou les acteurs si on prend par exemple les danses rituelles des Amérindiens) disparaît au profit d’une vérité plus grande qui le dépasse. Par le biais de l’anthropologie culturelle, nous renouons donc avec notre propre Moyen-Age où la littérature était essentiellement orale et anonyme. C’est une époque où l’auteur s’effaçait devant le message à transmettre. Et ce message reposait essentiellement sur la tradition (laquelle servait à fonder la société dont elle émanait), et ne visait pas, comme de nos jours, à créer systématiquement du neuf pour le plaisir de se montrer original. C’est donc à beaucoup de modestie que nous conduit l’œuvre de notre anthropologue, car il nous dit en fait que nos créations que nous croyons singulières ne sont en fait que l’émanation de la société toute entière à un certain stade de son développement.
Et ces structures cachées (même si elles sont parfois réductrices et même si on peut dire aussi autre chose des mythes analysés), en mettant en parallèle et en reliant des centaines et des centaines de mythes, qui se renvoient les uns aux autres, ces structures cachées, dis-je, nous font toucher du doigt la manière dont notre pensée fonctionne. Elles nous montrent aussi l’importance que prend l’imaginaire dans notre volonté de dire notre présence au monde.

00:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (22) | Tags : claude lévi-strauss, mythologiques
01/11/2009
Rutebeuf
En cette période d'automne, quoi de plus naturel qu'un poème sur le vent qui emporte les feuilles et pas seulement les feuilles...
Reste la mémoire, qui nous constitue puisqu'elle nous permet de nous souvenir de ceux que nous avons aimés et qui ont disparu, sans qu'on sache bien pourquoi, finalement.
La vie est un chemin étrange. Un jour, on rencontre des personnes qui deviennent importantes pour nous, puis le lendemain on ne les voit plus. Le plus étonnant est qu'on parvienne à survivre.

Qua j'avais de si près tenus
Et tant aimés
Ils ont été trop clairsemés
Je crois le vent les a ôtés
L'amour est mort-e
Ce sont amis que vent emporte
Et il ventait devant ma porte
Les emporta
Avec le temps qu'arbre défeuille
Quand il ne reste en branche feuille
Qui n'aille à terre
Avec pauvreté qui m'atterre
Qui de partout me fait la guerre
L'amour est mort-e
Ne convient pas que vous raconte
Comment je me suis mis à ho
En quelle manière
Que sont mes amis devenus
Que j'avais de si près tenus
Et tant aimés
Ils ont été trop clairsemés
Je crois le vent les a ôtés
L'amour est mort-e
Le mal ne sait pas seul venir
Tout ce qui m'était à venir
M'est avenu
Pauvre sens et pauvre mémoire
M'a Dieu donné le roi de gloire
Et pauvre rente
Et droit sur moi quand bise vente
Le vent me vient
Le vent m'évente
L'amour est mort-e
Ce sont amis que vent emporte
Et il ventait devant ma porte
Les emporta
Les emporta...
01:52 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature









