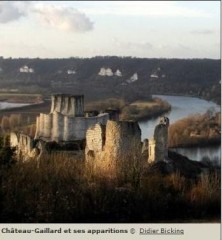28/02/2011
Là-bas (suite)
Mais il fallait partir et poursuivre notre route. Après avoir traversé un autre petit bois, nous parvenions enfin au but de notre voyage. A un détour du chemin, les bâtiments surgissaient soudain devant nous, impressionnants, dans ce lieu où on n’entendait aucun bruit. Le théâtre était quasi en ruine et seules trois colonnes tenaient encore debout. Les herbes avaient envahi les gradins de pierre, mais on devinait encore facilement la forme de l’hémicycle.
A l’entrée, deux statues de marbre blanc nous regardaient de leurs yeux fixes. La première, un homme, tenait dans ses mains un rouleau déplié pour que nous pussions y lire notre destinée. Mais les inscriptions, s’il y en avait eu, étaient inexorablement effacées et le sens de ce message nous restait à chaque fois inconnu. L’autre statue représentait une femme. De la main gauche, elle soutenait une sorte de petite harpe dont elle pinçait les cordes avec la main droite. Mais une nouvelle fois nous avions beau prêter l’oreille, aucun son ne s’échappait de l’instrument et le silence profond qui régnait parmi les ruines accentuait encore la perte irrémédiable de cette musique qui n’avait pu être que divine. Seul le vent, parfois, gémissait sourdement et il nous semblait alors entendre comme le murmure évanoui d’un chœur antique. Mais ce n’était qu’une illusion de plus, comme ce théâtre dont il ne restait presque rien. Quant aux tragédies qu’on avait jouées ici autrefois, elles avaient relaté l’histoire de héros malheureux à jamais disparus et dont malheureusement nos mémoires fatiguées n’avaient conservé aucun souvenir.
Plus loin, se dressait un bâtiment de style classique et qui devait dater probablement du XVIIe siècle. Il semblait avoir été conçu pour être le palais d’un prince, du moins si l’on en croyait les armoiries ouvragées, taillées dans le trumeau de la porte principale. Plus tard, quand les révolutions avaient fait basculer le cours de l’histoire et que les têtes couronnées étaient tombées les unes après les autres, ce palais privé était devenu une bibliothèque publique. Les milliers de volumes qui y avaient été rassemblés aux cours des siècles appartenaient maintenant à la nation, dont ils constituaient le patrimoine culturel. Les livres les plus anciens, à ce qu’on disait, remontaient à ces fameux moines du Moyen Age dont il nous semblait encore parfois entendre les chants étranges et les voix mystiques. Ce n’était pourtant déjà plus qu’un souvenir qui s’évanouissait chaque jour inexorablement dans nos mémoires.
Nous imaginions des Bibles enluminées aux dorures raffinées et des hagiographies relatant la vie fantastique ou la mort plus étrange encore de saints aux noms improbables. Tout en haut des rayons, sur des étagères inaccessibles, s’alignaient les romans de chevalerie, où tout était conté des aventures des quatre fils Aymon, de Lancelot du lac ou de guillaume d’Orange. Là, entre ces pages, Merlin l’enchanteur n’en finissait plus de hanter la forêt de Brocéliande et Tristan murmurait à l’oreille d’Yseut des choses qu’elle n’aurait jamais dû entendre. Dans un coffre fermé à clef, on avait caché à la vue de tous les poèmes d’amour que des troubadours en plein délires avaient composés pour des princesses à jamais inaccessibles.
Voilà donc ce que la bibliothèque avait pu sauver, disait-on, de ce lointain Moyen Age. Mais il n’y avait pas que cela. Au XVIe siècle, des érudits au nom désormais oublié avaient ramené de Grèce ou de Rome des manuscrits antiques à la valeur inestimable. La vie des douze Césars côtoyait là l’Art d’aimer et les Tacites et les Tites-Lives rivalisaient en sagesse avec les écrits des Epicuriens ou des Stoïciens. Dans ces pages, Rome n’en finissait plus de brûler sous l’œil indifférent de quelques Nérons pendant que des Barbares aux noms imprononçables déferlaient en bandes enragées sur la Gaule transalpine.
On racontait que le dernier prince à avoir occupé ces lieux, et qui avait un sens du tragique assez prononcé, avait conservé là un exemplaire de toutes les pièces jouées devant le Roy durant le Siècle d’Or et que sur les rayons les œuvres originales et manuscrites du grand Corneille y avaient côtoyé celles de l’entêté Racine. Puis vint la Révolution et les privilèges des temps anciens tombèrent, par une logique implacable du grand balancier de l’Histoire. Nous qui n’étions rien et qui n’avions jamais rien été, nous nous réjouissions en secret de ces revirements inespérés et pour un peu nous aurions remercié les dieux, auxquels pourtant nous ne croyions guère, d’avoir ainsi renversé l’équilibre social.
Malheureusement, ces révolutions amenèrent également leur lot de malheur et l’incendie qui ravagea un beau soir la bibliothèque ne fut pas le moindre. On se sut jamais s’il fut allumé volontairement par quelque rebelle qui voyait dans ces livres l’esprit de l’Ancien Régime ou si au contraire une maladresse seule en fut la cause, mais le résultat fut épouvantable : des milliers d’ouvrages disparurent dans un brasier incroyable et pendant quatre semaines on put pu voir le ciel nocturne ensanglanté par les lueurs d’un gigantesque brasier. Les étincelles montaient jusqu’aux étoiles et l’on retrouva à des kilomètres des pages calcinées et noircies sur lesquelles tout message avait été effacé. Adieu donc la sagesse antique et l’amour courtois. Adieu la quête du Graal et les lettres d’Abélard. Quant à celui qui fut peut-être pendu à Montfaucon, il mourut ainsi une deuxième fois, quand ses poèmes disparurent dans les flammes de l’enfer.
Après cette catastrophe, la palais-bibliothèque servit d’écurie pour les chevaux de l’empereur puis de caserne pour la soldatesque. Aujourd’hui, ce n’est plus qu’une ruine et seuls des pans de murs noircis rappellent encore aux visiteurs que se trouvait ici la plus grande bibliothèque d’Occident.
07:00 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature
23/02/2011
Là-bas
Il fallait marcher longtemps, pour parvenir à ces bâtiments, car aucune voie carrossable n’y donnait accès. On se levait de bon matin, ces jours-là. En voiture, on quittait la grande ville, sa circulation et ses fumées, puis, après une bonne heure de route, on se garait sur un parking, près d’une maison en ruine qui avait dû être un restaurant. Les volets en étaient clos depuis des années et nul ne se souvenait y avoir jamais vu la moindre activité. Le patron devait être parti sous d’autres cieux ou peut-être même était-il mort. Personne n’en savait rien. En tout cas, il y a avait des décennies qu’aucun voyageur ne s’était arrêté là. Des herbes folles avaient envahi les parterres et de petits bouleaux poussaient même sur la façade, entre les pierres de taille. Près de la porte, une vieille enseigne pendait toujours au bout de sa chaîne, ballottée au gré du vent : « Aux délices de… » Le reste avait été effacé et nous ne saurions jamais à quels délices il était fait allusion.
En fait, rien ne prouvait que cette maison isolée, en pleine campagne, fût bien un restaurant. C’était peut-être un lieu de rendez-vous secret pour des amoureux illégitimes. Il me plaisait d’imaginer un couple arrivant là, discrètement, et montant, main dans la main, les marches du perron. Dans la grande chambre, surpris, ils apercevaient soudain leur image dans le miroir d’une antique garde-robe. Ils étaient d’abord un peu impressionnés, un peu intimidés, par l’atmosphère désuète qui régnait là. On sentait que des générations entières avaient dû défiler en ce lieu, et les meubles semblaient en avoir conservé le souvenir. Mais bientôt chacun ne voyait plus que l’être aimé à côté de lui. Subitement, une robe glissait à terre et c’est le souvenir d’Eve en son paradis que le miroir réfléchissait alors. Le reste appartient à ces amoureux, le secret de leurs gestes comme le secret de leurs cœurs.
Nous, une fois la voiture garée, comme abandonnée, nous empruntions le petit chemin de terre qui prenait naissance près de l’hôtel et qui se dirigeait ensuite vers la forêt. Il fallait compter une bonne heure de marche avant d’arriver à destination. Nous devions d’abord longer des champs, où invariablement des vaches placides nous regardaient passer, puis ensuite il nous fallait traverser à gué le petit ruisseau. On abordait enfin la grande forêt de pins où l’odeur suave de la résine nous enveloppait aussitôt. C’était un parfum « étrange et pénétrant » qui évoquait en moi le Sud profond. Il suffisait de fermer les yeux pour se croire aussitôt en Provence, au cœur du massif des Maures, et il ne manquait que le chant des cigales pour que l’illusion fût parfaite. Le silence qui régnait là était impressionnant. Nous cheminions sur un tapis d’aiguilles qui amortissait nos pas et personne n’aurait osé proférer la moindre parole, par respect pour l’aspect sacré de ce lieu. Parfois, s’il y avait un peu de vent, on entendait juste comme un murmure dans les frondaisons. Ce devait être le souffle des dieux qui vivaient là, des dieux oubliés par la civilisation et qui avaient dû trouver refuge dans ces solitudes.
Un bon quart d’heure était nécessaire pour traverser la forêt, peut-être même davantage. Cela dépendait du nombre de haltes que nous faisions, car parfois l’envie nous prenait d’écouter le silence. Alors on s’asseyait sur le tapis d’épines et on tendait l’oreille. Rien, il n’y avait rien à entendre. Rien qu’un vide comparable à celui de l’espace infini. Il nous semblait alors être non seulement à mille années lumière, mais même hors du temps. En été, au moment des fortes chaleurs, on percevait pourtant comme un murmure lointain. C’était celui de milliers de mouches qui bourdonnaient dans les sous-bois et qui faisaient comme un écho à nos rêves éveillés. Invisible, la vie était pourtant là, présente et obsédante. Inquiétante aussi. Car quels êtres étranges étaient ces insectes qu’on ne voyait jamais ? De quel monde venaient-ils ? Dans quelles frondaisons se tenaient-ils cachés ? Toujours, le mystère restait entier et quand nous nous relevions, des fourmis dans les jambes, rien n’avait été élucidé.
Il nous restait alors à parcourir deux petits kilomètres, à travers un paysage sauvage de landes et de prairies à l’abandon. A une époque très lointaine, ces terres avaient dû être entretenues par la main de l’homme, puisque la forêt y avait été défrichée. Nous imaginions alors des moines bénédictins occupés à sarcler les champs, dans un Moyen Age quasi mythique. Si nous tendions bien l’oreille, il nous semblait presque entendre des chants grégoriens issus d’une abbaye aussi improbable qu’inconnue. Était-ce le fruit de notre imagination ou bien cette abbaye avait-elle vraiment existé ? Et se pouvait-il que ces chants mystiques eussent continué à glorifier la création à travers les siècles malgré la disparition des moines ? Si nous voulions nous montrer rationnels, nous devions reconnaître qu’un tel raisonnement ne tenait pas la route. Pourtant, les lieux que nous traversions étaient si mystérieux que nous n’étions pas loin de croire à ces histoires que nous venions d’inventer.
10:45 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature
18/02/2011
De la "littérature" en ligne
Je n'aime pas trop parler de statistiques, mais il faut bien passer par-là si on veut se rendre compte de la diffusion d'un texte en ligne.
Je me demandais l'autre jour quel avait été l'impact d'« Obscurité », qui nous a tous occupés pendant quasi une année. Ce texte a été lu sur Marche romane bien entendu (entre 120 et 150 lectures par jour en moyenne) mais pas uniquement. Mon site était également répertorié sur le site « Paperblog » et, si l’on en croit leurs statistiques, il y aurait eu là une centaine de lecteurs par jours ( ???).
|
|
Article |
Lectures via le blog |
Lectures via Paperblog |
Total |
Voir l'article |
|
|
? |
108 |
108 |
||
|
|
? |
177 |
177 |
||
|
|
? |
280 |
280 |
||
|
|
? |
163 |
163 |
||
|
|
? |
134 |
134 |
||
|
|
? |
97 |
97 |
||
|
|
? |
100 |
100 |
||
|
|
? |
36 |
36 |
||
|
|
? |
98 |
98 |
||
|
|
? |
124 |
124 |
On pourrait juste regretter que ce roman ait été classé dans la rubrique « Humeur », là où j’aurais évidemment préféré qu'il soit répertorié dans « talents » ou dans « littérature », mais on ne peut pas tout avoir, n’est-ce pas ? Et puis cela oblige à rester modeste...
http://www.paperblog.fr/3839120/obscurite-61/
Par ailleurs, j’avais été contacté par le blogue "Ideoz". Je n’avais tout d’abord pas bien compris ce que je serais allé faire sur un site, certes fort intéressant, mais qui traitait essentiellement de voyages (conseils pratiques, expériences des personnes qui se sont rendues dans des pays proches ou lointains, comptes-rendus, impressions, journaux de route, etc). En fait, il existait une rubrique consacrée aux voyages imaginaires, ceux qu’on ne fait qu’en rêve, en tenant une plume à la main. Là, cela rentrait plus dans mes cordes, évidemment, mais j’avais répondu que je n’avais pas trop de temps pour m’investir dans un site qui n’était pas le mien (ce qui n'est pas très courtois, je l'avoue). Bref, il ne fallait pas compter sur moi pour écrire des articles sur "Ideoz"…
On m'a alors proposé de venir copier les articles de Marche romane qui sembleraient intéressants, ce que j'ai accepté. C’est comme cela qu’Obscurité s’est retrouvé sur Ideoz où il a forcément été lu également.
Heureusement, on se déplaçait beaucoup dans cette histoire de l’enfant, de sa mère et de Pauline et notre trio a finalement traversé tout le pays. De plus, les paysages étaient à l'honneur (ce qui n'était pas prémédité) et du coup mon texte n'a pas trop déparé dans ce site consacré aux voyages.
Si on regarde les chiffres, on a entre 50 et 80 lecteurs pour les premiers chapitres et plus de 150 pour les derniers. On peut donc estimer, qu'en moyenne, une centaine de personnes ont lu le texte.
Je découvre aujourd’hui avec surprise que les notes sur l’origine des mots se trouvent également sur Ideoz.. Nous voilà pourtant loin des voyages, même imaginaires, mais il est vrai qu’il s’agit ici d’un voyage dans la langue dont on tente de retracer l’évolution. Un voyage dans le temps, en quelque sorte.
Merci en tout cas à Ideoz d’avoir accueilli Obscurité et de s’être montré particulièrement persévérant malgré mes refus successifs.
http://voyages.ideoz.fr/author/feuilly/
http://voyages.ideoz.fr/de-lorigine-des-mots-suite/
Conclusion : si on en croit les chiffres, Obscurité aurait donc été lu par environ 300 personnes, ce qui est tout de même inespéré pour un roman en ligne. Il n’est pas du tout certain qu’une édition « papier » aurait rencontré un tel succès.

07:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, roman en ligne
14/02/2011
De l'origine des mots (suite et fin)
Nagier : n’a pas le sens de « nager » comme on pourrait le croire naïvement. En effet, jusqu’au XVIe siècle ce verbe, qui vient du latin « navigare »signifiait « aller en bateau ».
Il nagierent tant qu’il ariverent desox le cite de Cartage, et quand Nicolete vit les murs del castel et le païs, ele se reconut, qu’ele y avoit esté norie et pree petis enfes ,mais ele ne fu mie si petis enfes que ne seust bien qu’ele avoit este fille au roi de Cartage et qu’ele avoit este norie en le cite. (« Aucassin et Nicolette, ch XXXVI »)
Ceci dit, je ne suis pas trop d’accord avec cette date du XVIe siècle que donne Dufournet car en cherchant chez Montaigne, je retrouve bien notre sens actuel de nager :
Il avoyt cette mesme opinion que la science de nager estoit tresutile à la guerre et en tira plusieurs commoditez : s’il avoyt à faire diligence, il franchissoit ordinairement à la nage les rivières qu’il rencontroit. (Livre II, chapitre XXXIV)
Le Robert historique, quant à lui, donne la date du XIIe pour la première apparition du sens moderne. Nager se met alors à concurrencer « noer » (nager) qui s’emploie, lui, effectivement jusqu’au XVIe siècle. Ce « noer » était issu du latin « notare », lui-même provenant du latin classique « natare » (cf. « natation » aujourd’hui). La proximité formelle avec « noyer » explique sans doute la disparition de ce verbe « noer » au profit de « nager ». Mais il y avait aussi une collision homonymique avec un autre verbe « noer », qui lui signifiait « nouer, faire un noeud » « Noer » ne pouvait donc survivre et « nagier » s’est imposé.
Mais du coup, cette nouvelle signification de nagier (se déplacer dans l’eau sans couler) a rendu difficile son emploi dans le sens premier (naviguer, voyager sur la mer). Pour ce faire, on a donc recréé un mot à partir de « navigare » et c’est notre « naviguer » (écrit « naviger » dans un premier temps).
Notons que « nager » au sens de naviguer demeure dans l’expression « nager entre deux eaux » qui signifiait en fait « refuser de s’engager ».
Notons aussi que Nagier (naviguer) a pu prendre, assez logiquement, le sens de « ramer », ce que l’on retrouve aujourd’hui dans l’expression « nager sec ».
Ce qui est sûr (et la Dufournet et el Robert historique tombent d’accord), c’est qu’au XVIe, en effet, « nager » s’est définitivement imposé définitivement dans son sens actuel. Petit à, petit, des expressions vont en élargir le sens, comme « nager dans son sang » (XVIIe) ou « nager dans un vêtement » (XVIIIe).
Travailler : ce verbe avait le sens de « torturer, tourmenter », sens qu’il a conservé jusqu’au XVIe siècle. Il a alors remplacé « ouvrer », que nous avons encore dans des expressions comme « du fer ouvré », « un jour ouvrable » (jour où l’on travaille) et bien entendu dans notre substantif « ouvrier ». Le vieux verbe « ouvrer » venait lui du latin « operare » qui avait donné dans un premier temps « obrer » après la chute de la voyelle avant de devenir « ovrer » (cf. œuvre, œuvrer, etc.), puis ouvrer. Mais une confusion était possible avec le verbe « ouvrir » et c’est pour cela qu’il a été remplacé par «travailler ».
Remarquons qu’une composition savante, à partir du latin « operare », a donné « opérer ».
Mais revenons à notre verbe « travailler. Il provient du latin populaire « tripaliare » autrement dit torturer avec un trepalium (instrument qui servait à ferrer les bœufs). L’idée était bien celle de souffrance infligée et on l’employait pour parler des condamnés qu’on torturait mais aussi pour les douleurs ressenties par une femme qui accouche (dont on dit aujourd’hui qu’elle est en plein travail). Mais dès l’ancien français le verbe travailler a pris la signification d’une transformation acquise par un effort. En moyen français, l’idée de transformation efficace l’emporte sur celle de fatigue ou de peine et petit à petit le sens actuel s’impose (accomplir une action, réaliser quelque chose pour gagner sa vie).
Ce qu’il y a de remarquable, dans tous les exemples que nous avons vus dans cette rubrique, c’est cette disparition des verbes qui possédaient une forme trop proche de verbes ayant un sens complètement différent. Petit à petit, la langue s’est adaptée en éliminant les « doublons » et les formes trop rapprochées qui prêtaient à confusion. Personnellement, j’en retiens la leçon suivante : la langue que nous connaissons aujourd’hui et qui, depuis le XVIIe siècle est bien équilibrée, n’a pas toujours été ainsi. Il est des époques beaucoup plus troubles. Certains auteurs hésitent sur les termes à employer et ils le disent parfois. La clarté et la précision que nous connaissons aujourd’hui signifie que la langue a atteint un équilibre. Mais tout équilibre est précaire et provisoire. L’ancien français avait mis du temps pour passer des déclinaisons latines au système à deux cas puis finalement au système prépositionnel. Cet équilibre était à peine atteint que l’évolution rapide de la langue orale a débouché sur le moyen français, lequel s’est encore transformé jusqu’à notre français d’aujourd’hui. Respectons donc notre langue, ne la maltraitons pas. Les périodes d’équilibre sont souvent le fruit de plusieurs siècles d’effort.
Crédit photo : Azurs point net http://www.azurs.net/
00:52 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (6)
11/02/2011
De l'origine des mots (encore et toujours)
Avaler : ce verbe désigne tout d’abord l’idée de descendre, d’aller vers le « val » (cf. l’expression « aller par monts et par vaux », donc des sommets vers la vallée, autrement dit un peu partout). De l’idée de « descendre », avaler est passé à celle de « faire descendre », puis, par restriction sémantique, on en est arrivé à notre sens actuel : « faire descendre un aliment dans le gosier ».
Par le cuerbé : ce juron n’a rien à voir avec le corbeau (latin « corvus »), comme on pourrait le croire. Le « bé » qui termine le mot est une déformation de « Dé » autrement dit de Dieu. Par le cuerbé, c’est donc « par le cœur de Dieu ». De la même manière nous avons « corbleu » (par le corps de Dieu), morbleu (par la mort de Dieu), palsambleu (par le sang de Dieu). Pour ceux qui aiment les gros mots, je les renvoie à la chanson de Brassens « La Ronde des jurons », où en en trouve de toutes les sortes :
Tous les morbleus, tous les ventrebleus,
Les sacrebleus et les cornegidouilles,
Ainsi, parbleu, que les jarnibleus
Et les palsambleus,
Tous les cristis, les ventres saint-gris,
Les par ma barbe et les noms d'une pipe,
Ainsi, pardi, que les sapristis
Et les sacristis,
Sans oublier les jarnicotons,
Les scrogneugneus et les bigree et les bougree,
Les saperlottes, les cré nom de nom,
Les peste, et pouah, diantre, fichtre et foutre,
Tous les Bon Dieu,
Tous les vertudieux,
Tonnerre de Brest et saperlipopette,
Ainsi, pardieu, que les jarnidieux
Et les pasquedieu
Ah Brassens… J’en profite pour signaler que chaque semaine, sur le site de Bertrand Redonnet, on peut lire des extraits du livre qu’il avait consacré autrefois à ce poète-troubadour. Mais qu’on ne vienne pas m’accuser ici de plagier son blogue, comme je l’ai ouï dire. Cornegidouille (juron inventé par Jary dans Ubu Roi), on ne pourrait donc plus parler d’étymologie sans se retrouver avec un procès d’intention sur le dos sous prétexte qu’ailleurs, autrement dit en Pologne (« La scène est en Pologne, c’est-à-dire nulle part » comme disait le même Jary), une connaissance s’amuse également à jouer avec les mots ? « Honni soit qui mal y pense » (comme disait un roi angloy, en parlant, lui, de la jarretière de la mariée).
Puisque nous évoquions plus haut le corbeau, parlons-en. Le mot vient de « corbiaus » et est issu du latin populaire corbellus. Celui-ci est un diminutif de corbus, lequel avait donné de son côté « corp » au singulier et cors au pluriel, mais ce terme a finalement disparu au profit de notre corbeau, sans doute pour éviter la confusion avec « corps » ou « cor ».
Corbus lui-même était issu du latin classique corvus.
Le sens a évolué. Ainsi, par analogie avec le bec de l’oiseau, le mot corbeau a désigné en architecture une grosse pierre en saillie et qui sert à soutenir une partie qui dépasse (« encorbellement»). Il faut attendre la XIXe siècle pour voir le mot corbeau prendre différents sens négatifs (liés à la couleur noire de l’oiseau) et désigner tantôt un prêtre, tantôt un croque-mort, tantôt un homme sans scrupule et finalement un auteur de lettres anonymes.
Gésir : en ancien français, ce verbe signifiait aussi bien « être couché » que « être en couches, accoucher ». On fait là plutôt allusion à la position couchée de la jeune mère, après ses couches, plutôt qu’à la position adoptée pendant l’accouchement proprement dit. En effet, si je me souviens bien de mes lectures, au Moyen Age les femmes accouchaient plutôt debout ou accroupies.
Es canbres la roine : dans la chambre de la reine. On remarquera la construction du complément du nom (ancien génitif) qui pouvait encore se faire sans préposition au début du XIIIe siècle. On disait donc « le cor le conte » et « le fix le conte ».
Oïl : adverbe d’affirmation qui provient de « o » et il (pronom personnel de la troisième personne du singulier). Mais on avait aussi oie (o + ie, c’est-à-dire « je »). En Occitanie, on avait évidemment la forme « oc » (du latin « hoc », cela. Le sens était donc « oui, c’est cela »).

07:00 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (14)
07/02/2011
De l'origine des mots (suite de la suite)
Errer : il existe deux verbes « errer » en ancien français. Un qui vient du latin « iterare » et qui signifie, aller, cheminer, marcher et un autre qui provient de « errare », se tromper, s’égarer (voir « erreur » et « erroné » en français moderne). De la famille du premier, il ne subsiste que des expressions souvent mal comprises comme « chevalier errant » (qui s’en va à l’aventure) ou Juif errant (condamné à marcher sans fin).
Cière ou chière : ce mot désignait le visage (latin « cara »). « Faire bonne chère », c’était donc accueillir les gens avec un visage souriant. De là, forcément, le mot a été employé pour désigner un accueil chaleureux, puis le bon repas que cela impliquait souvent.
La prime était une subdivision temporelle de la journée. Cette division, qui est restée dans le langage ecclésiastique, remonte en fait aux Romains, qui avaient divisé en 12 heures la durée qui va du lever au coucher du soleil. « Prime » est donc la première heure du jour (6 heures du matin). La haute prime, c’est quand l’aube est déjà bien passée, soit à 8 heures. La « tierce » ou troisième heure correspond donc à 9 heures du matin. La « none » ou neuvième heures correspond à 15 heures (6 + 9 = 15). Quant à la « sieste », ou 6° heures, elle désigne donc midi (6 + 6 =12). Le terme est resté pour désigner le petit somme que l’on fait à midi après le déjeuner.
Se partir : toujours utilisé à la forme réfléchie dans Aucassin et Nicolette, ce verbe signifiait « séparer, diviser, partager ». Il nous reste l’expression « avoir maille à partir », la « maille » étant une petite monnaie sans grande valeur. Il s’agissait donc de diviser entre plusieurs personnes une piécette qui ne valait déjà pas grand-chose en elle-même, ce qui ne manquait pas de provoquer des querelles. A la fin du Moyen Age, « se partir » a signifié « s’en aller, se séparer de quelqu’un » (le sens n’est donc plus un objet que l’on divise, mais une personne dont on se sépare), de là notre « partir » qui signifie s’en aller. On retrouve donc des mots comme « départ » et « en partance » qui véhiculent l’idée de départ et des mots comme « partage », « part », « partie », qui conserve l’idée de partager.
Souple (du latin supplex, supplicis, qui plie les genoux en suppliant les dieux) désignait au Moyen Age une personne humble puis finalement une personne triste, abattue. A partir de « humble », le sens à glisser à « qui se plie facilement », car celui qui demande et implore n’est pas en position de force et doit forcément faire des concessions. Aujourd’hui, souple désigne des objets qui plient avec facilité.
Notons que le terme « supplice » vient lui aussi de « supplex », ce qui peut se comprendre car celui qu’on torturait avait tendance à implorer sa grâce à genoux .
08:12 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (8)
05/02/2011
De l'origine des mots (suite)
Uis (ou huis), que l’on retrouve dans « huissier » et « juger à huis clos », désignait la porte de la demeure, tandis que le mot « porte » était réservé aux grandes portes des villes, qui s’ouvraient dans les remparts.
Noise : bruit, querelle. Du latin « nausea » (mal de mer, d’où « nausée »), le mot prend le sens de situation désagréable et pénible. De là, il dérive vers le sens de « querelle », celle-ci étant par définition bien peu agréable. En français moderne, on trouve l’expression « chercher noise à quelqu’un ».
Traire : le sens premier était « tirer, tirer vers, se diriger ». Le mot a connu une restriction sémantique évidente puisqu’il ne signifie plus que « tirer le lait d’une vache, d’une brebis ou d’une chèvre. Les linguistes expliquent cela par une collision homonymique entre « moudre » le grain (du latin molere) et un autre « moudre », qui signifiait traire (du latin mulgere). Pour éviter la confusion entre les deux « moudre » on a employé de préférence le verbe « traire » quand il s’agissait de tirer le lait des vaches et « tirer » a donc pris la place de ce dernier verbe dans le sens général qui était le sien initialement.
Destrier (cheval de combat). Le terme vient du mot « dextre » car l’écuyer le tenait à droite quand il n’était pas monté. N’oublions pas que le contraire de dextre était « senestre », (gauche – latin sinister-) qui a donné sinistre.
Sengler : sanglier. En fait, c’est le porc solitaire, le « porcum singularem »). Ici, c’est l’adjectif « singularem » qui a prit la place du substantif pour désigner l’animal, puis le suffixe en « er » a été remplacé par un autre en « ier ». Notons qu’en patois on retrouve « sainguié » (Meurthe-et-Moselle), « sanler » (Morvan), singlé (wallon) sanglire (Languedoc), singlar (Midi), singuié (Vosges), etc. Le féminin « sanglière » a existé en ancien et moyen français puis a disparu au profit de « laie ». C’était pourtant joli, la sanglière, non ? Personnellement, j’ai toujours un peu de nostalgie pour tous ces mots qui ont existé et qui n’existent plus, même si je ne les ai pas connus. On touche là du doigt la potentialité extraordinaire de la langue, qui, devant le foisonnement qui s’offrait à elle, a finalement taillé, découpé et réduit. La belle forêt vierge est devenue un parc policé.

01:42 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : ancien français
03/02/2011
De l'origine des mots
Parmi les lectures de ces dernières semaines, citons « Aucassin et Nicolette » , célèbre chantefable du Moyen Age. Voilà un livre qui ne relève pas vraiment de l’actualité éditoriale, me direz-vous, mais qui traite gentiment de la passion amoureuse, de manière guillerette et sans jamais être lourd ni pesant. La langue, celle du début du XIII° siècle, se comprend relativement facilement, en tout cas j’ai connu des textes plus ardus. Mais si je parle de tout ceci ici, c’est pour les notes de Jean Fourniret, qui complètent le livre dans la collection Garnier-Flammarion. Des notes axées sur la langue, évidemment, et qui nous font mieux comprendre le sens caché des mots que nous employons quotidiennement. Car la langue vient de loin, de très loin, même, et nous avons trop souvent perdu de vue le sens premier, que nous ne percevons plus que de manière intuitive ou inconsciente. Voici quelques exemples.
Valet : c’est un adolescent de famille noble qui sert à la cour d’un grand pour apprendre les armes. Il portera les armes du seigneur, l’aidera à revêtir sa cuirasse, se verra chargé d’un message important à aller transmettre, etc. C’est l’idée de jeunesse qui prime. Dès lors, le terme a pu s’employer pour désigner un adolescent non noble, puis, finalement, c’est le sens « d’être au service de » qui a prévalu. Notons qu’en patois wallon, valet désigne le fils (l’idée de jeunesse est donc restée par archaïsme). Dans le Poitou, on dit « drôle » et « drôlesse »… Comme quoi il n’y a rien de plus amusant que d’étudier la langue.
Caitive : autrement dit, captive, prisonnière. De là, le terme a pris le sens de « malheureuse, misérable », ce qui se comprend aisément. Ensuite, par restriction sémantique, la langue en a limité l’emploi à « de faible constitution », autrement dit chétive. Captif et chétif ont donc le même étymon.
Estrange : pouvait signifier en ancien français à la fois « étranger » et « étrange », (comme messager pouvait désigner le message ou la personne qui portait le message). Cette confusion n’était pas fort pratique, c’est pourquoi on a utilisé le suffixe « er » pour différencier les termes : étrange/étranger et message/messager.
France (= franche) : au départ le terme désigne l’ethnie des Francs, puis il a pris le sens de « libre » en désignant les nobles, puisque c’était l’aristocratie franque qui dirigeait le peuple gallo-romain (d’où des expressions comme « avoir les coudées franches » ou le « franc arbitre », le « franc parler », etc.). Ensuite, au sens social s’est ajoutée l’idée de noblesse morale.
Maleoite ou maldite (maudite) est l’antonyme de benoite (bénie ou bénite), lequel survit dans le prénom Benoît et dans les adjectifs benoît (bon, doux voire même doucereux) et benêt. Aujourd’hui, il n’est pas si évident que cela de se rendre compte que béni (idée de bien) est l’opposé de maudit (idée de mal), tant le sens religieux a prévalu dans le premier terme.
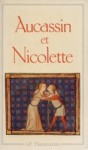
07:00 Publié dans Langue française | Lien permanent | Commentaires (2)
02/02/2011
Réveil
Pour le lent réveil de Marche romane, une petite touche d’humour. Je ne parle jamais ici des statistiques du blogue, cependant quelque chose m’a interpellé dans les chiffres de janvier. Alors que le site était à l’arrêt complet et qu’il n’y avait rien à lire, il n’y a jamais eu autant de visiteurs, ce qui est un comble. On peut interpréter la situation de deux manières. Soit certains attendaient la reprise avec impatience et venaient régulièrement voir s’il y avait du nouveau, soit au contraire mon silence était plus apprécié que mes écrits, ce qui laisse tout de même rêveur…
Pour le reste, l’hiver est toujours là (moins sept degrés hier matin et verglas généralisé le soir) mais la planète se réchauffe, dit-on. En tout cas cela chauffe beaucoup en Tunisie et en Egypte où les peuples se soulèvent. On ne comprend d’ailleurs pas pourquoi ils ne se sont pas soulevés plus tôt, écrasés qu’ils étaient par des dirigeants plus soucieux de plaire à l’Occident que de s’occuper du bien-être de la population. Reste à savoir à qui ces révolutions vont profiter. Il ne faudrait pas que la chute de ces régimes forts ouvre la voie à un libéralisme économique aveugle qui plongerait pas mal de personnes dans une misère noire tandis que quelques-uns tireraient avantageusement leur épingle du jeu.
En attenant cela fera réfléchir les dirigeants du monde entiers, qui se rendront compte que leur pouvoir peut être précaire et que la base qu’ils méprisaient allégrement peut se révolter. Certes la situation est meilleure chez nous ou en tout cas moins explosive (car les caisses de chômage, de maladie-invalidité et les retraites permettent de ne pas mourir de faim), mais l’écart se creuse tout de même tous les jours entre une bourgeoisie d’argent qui tire les ficelles et le reste de la population qui s’appauvrit de manière irréversible. Entre une droite sarkozienne autoritaire et fière d’elle-même et une opposition de gauche bientôt représentée par le financier du FMI, DSK, l’avenir me paraît assez sombre.
Quand l’élastique sera trop tendu, il se pourrait bien que peuples d’Occident descendent eux aussi dans la rue. Malheureusement, faire tomber un dirigeant ou un gouvernement ne sert plus à grand chose puisque l’économie restera mondiale et qu’il faudra bien se plier au dictat de la haute finance et des spéculateurs. A moins que la révolte ne se transforme en révolution et qu’elle devienne mondiale elle aussi … Mais ce n’est pas demain la veille.

09:58 Publié dans Actualité et société, Blogue | Lien permanent | Commentaires (7)