30/09/2009
Regrets
L’homme, qui se croit intelligent (et qui l’est peut-être, par ailleurs, je ne dis pas le contraire), oublie trop souvent qu’il n’est finalement qu’un animal. Ainsi, bien des émotions de notre vie sont à relier non pas à notre aptitude à résoudre des problèmes, mais tout simplement à nos cinq sens. Tout ce que nous percevons de la réalité extérieure, nous nous imaginons que c’est grâce aux capacités de notre cerveau, mais celui-ci, en fait, ne fait que centraliser toutes les impressions qu’il a reçues. Or, les indications que nous donnent les sens s’imprègnent en nous de manière beaucoup plus profondes que les raisonnements intellectuels. Si on y regarde d’un peu plus près, on s’apercevra que la mémoire vivace que nous avons de certains événements précis est en fait reliée directement à notre perception physique des événements. Marcel Proust le savait bien quand il a raconté la saveur de sa petite madeleine et comment cette saveur lui permettait de retourner dans son passé et de revivre un moment privilégié enfoui au plus profond de sa mémoire.
Je crois qu’on peut affirmer sans trop se tromper qu’une bonne part de ce qui nous constitue est fait ainsi d’impressions passées qui nous ont bouleversés à un moment donné de notre vie. La chaleur d’un rayon de soleil sur notre peau, la saveur de tel plat, l’harmonie enivrante et transcendante d’un morceau de musique, le bruit de la mer sur les galets, un jour, quelque part en Bretagne, l’odeur des pins dans la forêt des Landes, le chant des cigales dans la plaine languedocienne, les exemples ne manquent pas. Chacun a ainsi en lui une réserve d’émotions qui peuvent resurgir à n’importe quel moment. Il suffit d’un élément déclencheur pour que des souvenirs très précis, qui évoquent tout un pan de notre vie, refassent surface.
Evidemment, la période la plus propice pour engranger toutes ces émotions, c’est l’enfance puisqu’à cet âge le petit homme se comporte comme l’animal qu’il est vraiment et qu’il n’a pas encore subi le dressage ultérieur qui lui imposera de tenir un rôle dans la société et de ne rien exprimer de ce qu’il ressent. Petit à petit, il se fermera comme malgré lui aux impressions directes du monde extérieur, qu’il captait pourtant si bien et qui le rendaient si heureux, pour rationaliser tout et refuser d’écouter le langage si direct de ses sens. Du coup, tout ce qui est plaisir immédiat lié à ce contact du corps avec le monde sera définitivement banni.
Heureusement, les impressions premières sont restées bien gravées en nous et, comme je l’ai dit, il n’est pas rare qu’un rayon de soleil, une odeur, la subtilité d’un parfum ou une note de musique éveillent en nous des sensations oubliées et avec elles c’est toute l’époque où nous les avons connues qui refait surface, nous bouleversant d’autant plus.
Et quand on parle des sens, on pense immédiatement à la vue et à l’ouïe, mais l’odorat peut lui aussi jouer un rôle essentiel. Ainsi, quand je suis rentré en première primaire pour apprendre à lire, nous occupions des bâtiments en bois qui venaient d’être construits à la sortie de la ville et qui étaient situés au milieu des champs. Ces bâtiments avaient été traités à la lasure (ou au carbonil, je ne sais pas trop) et les jours de forte chaleur l’odeur acre qui s’en dégageait m’enivrait complètement au point que j’ai fini par associer cette école avec cette odeur. Plus tard, je suis parti, j’ai quitté ma campagne pour la grande ville et j’ai connu pas mal de lieux d’enseignement, si bien que petit à petit le souvenir de cette première école s’est estompé. Pourtant, il suffit qu’au hasard d’une promenade je repasse devant un bâtiment fraîchement repeint ou dont les volets, tout simplement, ont été repassés à la lasure, pour qu’immédiatement cette première école refasse surface et avec elle toutes les impressions que j’ai connues ces années-là, comme le plaisir de la lecture, l’odeur de l’encre dans les encriers, le touché doux des feuilles de buvard, la beauté mystérieuse des grandes cartes géographiques qui ornaient le mur ou la chaleur de juin, quand nous attendions en rang dans la cour pour rentrer en classe.
Le jour où j’ai quitté cette école, deux ans plus tard, je l’ai englobée d’un seul regard, sachant que je la quittais pour toujours et qu’un pan entier de ma vie s’arrêtait là. En juillet de cette année, je suis repassé dans cette région pour la première fois depuis toutes ces années. J’ai voulu aller revoir l’école au milieu des champs et la montrer aux personnes qui m’accompagnaient. J’ai retrouvé le chemin, j’ai reconnu les maisons qui bordaient la route, la grande prairie qui servait d’espace de jeux lors des beaux jours était toujours là, mais l’école avait disparu ! Rasée, anéantie, volatilisée, il n’en restait plus rien, comme si elle n’avait jamais existé. Elle demeurera donc à jamais dans mes souvenirs, il n’y a plus que là qu’elle subsiste ou dans la mémoire de quelque condisciple de l’époque, mais que sont-ils tous devenus ? Et les années passeront et chaque fois que me pénétrera l’odeur de lasure, la petite école en bois survivra encore un peu, du moins pour moi. Jusqu’au jour où, évidemment, elle disparaîtra vraiment à jamais.
Je voudrais citer un autre exemple de l’importance de l’odorat dans la structuration de nos impressions et de nos souvenirs. Il m’est déjà arrivé de croiser une inconnue qui portait un parfum que je suis capable de reconnaître entre tous et qui me renvoie aussitôt à une histoire d’amour vécue lorsque j’avais vingt ans. Alors, tous ces souvenirs que je croyais oubliés et auxquels je ne pensais plus se mettent à resurgir en vagues successives et avec une précision dans les détails que je n’aurais pas crue possible. Des scènes de ma vie d’alors refont surface et je me revois en train d’attendre une certaine jeune fille sur la place de la cathédrale ou bien en train de discuter avec elle dans un café, à quatre heures du matin ; je revois sa main posée sur la mienne ou les larmes qui un soir coulaient sur son visage… Je revois même l’impasse où elle habitait, étudiante ou, plus tard, cette rue en pente, à flanc de colline, que je gravissais, alerte, heureux parce que j’allais la retrouver. Et tout cela parce que j’ai croisé une inconnue que je n’ai même pas regardée et qui avait le même parfum que le sien. Alors, quand j’arrive à mon bureau, je suis tout étonné de me retrouver là car il me semble être encore des années en arrière. Il faut pourtant se mettre à travailler, malgré les regrets qui commencent à m’envahir et malgré la nostalgie que je peux avoir de ces temps irrémédiablement perdus.

Photo Internet
00:36 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : littérature
27/09/2009
Tempête dans un encrier
Aujourd’hui, comme c’est dimanche, j’invite tous les lecteurs à faire une petite balade. En effet, « Marche romane » est l’invitée du site « « Tempête dans un encrier », qui poursuit l’expérience commencée par les « Sept mains ». Le principe en est simple : six écrivains se relaient pour proposer chaque jour un texte (le lundi Emmanuelle Urien, le mardi Bertrand Redonnet, le mercredi Aglaé Vadet, le jeudi Stéphane Beau, le vendredi Manu Causse, le samedi Thomas Vinau). Et le dimanche, me direz-vous ? Et bien, ce jour-là, c’est à un invité surprise que l’on donne la plume. Il vous faudra donc vous déplacer pour lire mon texte du jour, texte qui est à la fois une balade dans le temps puisque je vous propose une relecture d’un conte que vous lisiez quand vous étiez enfant, mais aussi une balade dans l’espace puisque les protagonistes se promènent le long d’un chemin.
Notez aussi que nous avions déjà abordé ce thème autrefois ici, mais d’une manière disons plus sérieuse.
10:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, tempête dans un encrier
25/09/2009
La remise
J’ouvre la porte de la remise, tout au fond du jardin et je suis immédiatement envahi par l’odeur du bois de chauffage, qu’on a entreposé là, en belles piles régulières. C’est pour cette odeur, que je suis venu jusqu’ici. Je ferme les yeux et je respire, sans plus penser à rien. L’odeur chaude et tendre m’envahit complètement et des images de forêts profondes s’imposent à mon esprit. Puis je revois les stères de bois, tels qu’ils étaient alignés le long du petit chemin forestier, les myrtilliers épars, l’étendue des fougères… Il me semble presque percevoir sur mon visage la chaude brise du dernier mois d’août et entendre les feuillages qui s’agitent légèrement. Leur bruit me parvient par vagues successives, comme la houle d’une mer intérieure. Un geai a crié, cri d’alarme dans la quiétude du lieu. Un promeneur se serait-il aventuré jusqu’ici ? Non, dans la clairière, c’est un renard qui s’avance, l’œil aux aguets, concentré sur sa tâche de chasseur. Il s’arrête et renifle un petit tas de sciure fraîche au pied d’une souche. On le voit bien, dans cette mise à blanc : son pelage roux, ses yeux vifs… Puis il s’en va, trottinant, et disparaît dans le sous-bois.
Dans la remise, j’ouvre un instant les yeux, puis je les referme et respire de nouveau la bonne odeur du bois. Cette fois, c’est le bruit de la circulaire hurlante qui s’impose à moi. Il me semble voir les grosses bûches que l’on coupe une à une et les rondins plus petits qui s’amoncellent à terre, en un tas irrégulier. L’homme, devant la machine, est méconnaissable, car il porte un foulard sur le visage et de grosses lunettes protectrices. Mon rôle consiste à ramasser les rondins et à les empiler sur la brouette. Puis il y aura le rangement proprement dit. Les rondins que je prends un à un et que j’empile comme je peux, en tentant de ne pas perdre de place, de ne pas laisser le moindre espace vide. Parfois il faut tout recommencer, enlever deux trois morceaux de bois et les agencer autrement. Le tout doit former un mur bien droit, bien stable. Sur ma peau nue, sans gants, je sens la rugosité de l’écorce, les petites échancrures pointues laissées par la lame sur les bords de la bûche, les nœuds du bois, ces protubérances aux formes variées. Parfois, il me semble reconnaître un des rondins que je viens de charger sur la brouette. Puissance de la mémoire affective, puissance des choses, qui s’imposent à nous, malgré nous.
Plus tard, ce sera l’hiver et il aura neigé. Il faut mettre de grosses bottines pour traverser le potager et atteindre la remise. Je revois le grand panier d’osier, tressé à la main à partir d’écorce de noisetier. On le remplit de rondins, comme on peut. Ce n’est pas facile à cause de l’anse qui gêne les mouvements. Il fait froid, très froid et par la petite fenêtre un timide rayon de soleil donne un peu de clarté, juste ce qu’il faut pour que l’enfant puisse voir les volutes de vapeur qui s’échappent de sa bouche. L’odeur du bois a disparu, figée par la froidure, sans doute. Il faudra déposer le panier dans la cuisine près du gros poële pour qu’elle réapparaisse, plus discrète qu’à l’origine, mais bien présente quand même. Avec elle, c’est un peu de nature sauvage qui est entrée dans la maison. Le feu crépite doucement dans le foyer et il fait bon, tandis que dehors, la neige n’en finit plus de tomber. Déjà, dans le sentier, les traces de mes pas sont en train de disparaître.
Photo personnelle
00:02 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature
23/09/2009
De l'automne
On nous l’avait bien dit dès les premiers bourgeons en avril, que cela ne durerait pas et que l’automne, inexorablement, finirait par arriver. Je le savais pertinemment aussi et pourtant j’avoue que c’est d’une oreille distraite que j’ai écouté tous ces annonciateurs de mauvaises nouvelles, tous ces prophètes de mauvais augure, moi pourtant si vigilant et si peu porté aux extases injustifiées. Certes, je savais que le ver était dans le fruit depuis le premier jour de l’été, à savoir le vingt et un juin, mais je me suis dit qu’il fallait tout de même profiter un peu de ce qui nous était donné, même si c’était pour une durée fort limitée. Et il faut reconnaître que la période estivale fut belle et largement ensoleillée et que cela aurait été dommage de ne pas se comporter en épicurien, fut-ce temporairement.
Mais voila qu’hier le calendrier nous a asséné la vérité inexorable : l’automne est là et bien là. Ce n’est plus qu’une question de jours avant de renouer avec le vent et la pluie et même si le soleil nous gratifie encore de quelques rayons, les arbres vont prendre inexorablement cette couleur jaune et or si caractéristique avant de se replier sur eux-mêmes et de camoufler dans leurs racines tous les rêves dont ils sont capables.
Ceci dit, fin août déjà, alors que la température atteignait encore les trente degrés, quelques petites feuilles jaunes provenant d’un bouleau du voisinage étaient venues se regrouper sur ma terrasse, annonçant discrètement mais inéluctablement le désastre qui se préparait. Depuis, cela ne s’est pas amélioré. Il y a eu quelques nuits fraîches, un peu de pluie, rien de bien sérieux en fait, mais juste ce qu’il fallait pour nous avertir que les beaux jours étaient désormais derrière nous.
Ainsi en va-t-il dans la vie, bien entendu. Adolescents, nous savions déjà que l’histoire se terminerait mal et c’est avec délectation que nous lisions Nizan et d’ailleurs nous approuvions fort sa phrase : «J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie. »
Lucides, nous l’étions donc tous, enfin la plupart ou du moins quelques-uns. Dans des cafés enfumés, nous discutions jusqu’à l’aube et refaisions le monde, lequel pourtant ne s’est guère amélioré depuis lors, au contraire (il faut croire que nous n’avons pas assez discuté…)
Mais à côté de cet échec sur l’organisation de la société idéale (il faut bien parler d’échec puisque le monde actuel ne correspond en rien à celui que nous avions rêvé et que nous conservons toujours enfoui au plus profond de notre cœur) il faut ajouter notre absence de clairvoyance sur notre devenir. Certes nous nous savions mortels et nous invectivions les dieux de nous avoir joué un aussi mauvais tour, mais quelque part nous parlions de ces réalités d’une manière par trop détachée car nous savions au fond de nous que l’échéance n’était pas pour demain. Nous discourions, en quelque sorte et nous discourions bien, il faut en convenir, mais cette angoisse existentielle qui nous nouait tout de même les tripes trouvait une certaine consolation quand nous pensions qu’un bon demi-siècle au moins s’ouvrait devant nous.
Or le temps a passé et de même que quelques feuilles mortes nous annoncent l’automne, de petits signes physiques encore discrets nous font comprendre qu’une bonne partie du chemin est maintenant derrière nous. Nous voilà donc à un tournant, à l’équinoxe de notre vie, en quelque sorte. Le bel automne s’installe lentement en nous et c’est même avec un certain émerveillement que nous en admirons les splendeurs. Maturité, tempérance, raisonnement bien assuré, tout ce que nous avons patiemment acquis au cours de notre existence rayonne maintenant de mille feux.
Mais que se passera-t-il demain ? Demain ce sera l’hiver pour de bon, un hiver éternel qui ne sera suivi par aucun printemps. Alors, dans la lucidité qui nous restera, nous nous demanderons le pourquoi de tout cela. Quel aura été, en effet, le sens de ce parcours ? L’enfant de deux ans dont je parlais hier et qui se dressait dans son lit dès les premiers rayons du soleil afin de conquérir le monde et de ne pas perdre une minute de cette vie qu’on venait de lui offrir sur un plateau, cet enfant, dis-je, qu’a-t-il réalisé, dans le fond, qui en valait vraiment la peine ? Et s’il peut aujourd’hui, dans le panache de l’automne qui s’annonce pour lui, admirer une dernière fois les beautés de l’existence, que lui restera-t-il demain quand l’hiver sera venu ? Il lui restera la honte de n’avoir pas été assez lucide.
Avec le temps qu'arbre défeuille
Quand il ne reste en branche feuille
Qui n'aille à terre
Avec pauvreté qui m'atterre
Qui de partout me fait la guerre
Au temps d'hiver
Ne convient pas que vous raconte
Comment je me suis mis à honte
En quelle manière …
01:09 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : automne
22/09/2009
La chambre
Maison-poème (fin)
De la chambre, il n’y a pas grand chose à dire, si ce n’est que c’était un endroit où on s’ennuyait profondément. L’enfant se souvient de ces réveils de grand matin (lui qu’on avait couché tôt au lit) où il se retrouvait dans un lit cage qui ressemblait à une prison. Du haut de ses deux ans, il se dressait comme il pouvait pour contempler le monde qui s’étendait au-delà de ces barreaux que les adultes lui avaient imposés avec un sens inné de l’autorité qui le laissait complètement pantois. Ainsi donc, à peine né, il se retrouvait incarcéré, entravé dans ses mouvements et cela sans avoir commis le moindre délit. Dans sa petite tête où les idées commençaient à se mettre en place, les concepts de liberté, de libre-arbitre et d’injustice se faisaient tout doucement un chemin. Pourquoi, en effet les parents, ces dieux omniscients au pouvoir absolu, pouvaient-ils aller dormir quand ils en avaient envie alors que lui devait aller au lit quand il n’avait pas sommeil ? Et pourquoi ces mêmes parents pouvaient-ils maintenant paresser dans leur chambre alors qu’il faisait déjà presque clair ? Soupir.
Il n’y avait donc rien d’autre à faire qu’à contempler pendant un temps indéfini qui semblait une éternité le petit canard en relief qui ornait la tête du lit et dont l’enfant suivait les contours avec ses doigts fragiles. Il regardait donc ce canard, le caressait, lui parlait, lui racontait des histoires et allait même parfois jusqu’à se disputer avec lui quand le stupide volatile semblait ne rien comprendre à ce qu’on lui disait.
Il fallait alors se tourner vers une autre activité et à vrai dire, dans cette prison, il n’y en avait qu’une. Elle consistait à regarder attentivement la tenture sur laquelle le soleil donnait déjà et à essayer d’imaginer ce que représentaient les formes géométriques qui y étaient dessinées. Objectivement, ces formes n’avaient rien d’extraordinaires en elles-mêmes et il suffisait de la présence d’un adulte dans la pièce pour qu’elles ne sortent pas de leur rôle. Mais là, quand l’enfant était seul, elles prenaient subitement des contours étranges, en partie probablement à cause des rayons du soleil qui traversaient le tissu. Alors, ce qui n’était pourtant la veille qu’un carré ou un losange devenait subitement une tête de lion rugissant ou quelque horrible monstre baveux et à la langue fourchue. Certes, on pouvait se raisonner et le petit homme ne s’en privait pas. Il savait pertinemment que tout cela n’était que le fruit de son imagination, il n’empêche qu’à un certain moment la peur l’emportait sur la raison et c’est véritablement pris de panique qu’il se réfugiait au fond du lit, sous les couches de couvertures.

Il faut dire qu’il faisait froid, dans la chambre. A cette époque, le chauffage central n’existait pas ou alors seulement chez les riches (lesquels, vous l’aurez remarqué aussi, possèdent toujours tout avant tout le monde). La maison n’était chauffée que par le gros poële de la cuisine et évidemment, la nuit, en hiver, quand le gel sévissait et que la neige avait imposé sa loi implacable, il ne faisait pas bon rester dans la chambre. Plonger sous la couette était donc une nécessité qui relevait du simple bon sens de survie. L’enfant, effrayé par les monstres qui s’agitaient sur la tenture, retrouvait donc une certaine quiétude une fois réfugié sous l’amas de couvertures et de coussins qui lui sauvaient ainsi deux fois la vie. Là, dans la douce tiédeur du lit, il retrouvait peu à peu ses esprits et sentait les palpitations de son cœur se calmer. Alors, timidement d’abord, puis avec de plus en plus d’audace, il repartait affronter les fameux monstres. Souvent, ceux-ci avaient disparu entre-temps et leurs gueules grimaçantes n’ornaient plus le haut de la tenture. Le soleil avait sans doute été caché par un nuage et la lumière s’étant affaiblie, elle n’avait plus la force suffisante pour animer ce bestiaire infernal qui semblait rappeler à l’enfant l’époque où il n’était pas encore né. Car il lui semblait avoir connu dans un autre monde ces créatures diaboliques et pour lui il ne faisait pas de doute qu’il existait quelque part un pays étrange où il avait séjourné avant de naître. Car peut-on concevoir qu’on soit ici aujourd’hui et qu’hier on n’ait pas été ? Non, cela ne se pouvait et l’enfant tentait désespérément de se souvenir de cet univers d’avant la vie, univers qui était encore bien proche, pour lui qui n’avait que deux ans.
Mais la mère arrivait, interrompant ces réflexions angoissantes sur l’origine de l’être et l’existence des présences infernales. D’un geste sûr, elle ouvrait les tentures et, si on était en été, le bon soleil entrait dans la pièce, reléguant définitivement les monstres aux oubliettes. Par contre, si on était en hiver, c’est une autre découverte qui attendait l’enfant. Ce n’était pas la rue et ses maisons familières qui apparaissaient à travers le rideau, mais une vitre opaque, aux mille dessins géométriques stylisés. Dans le froid matinal, l’enfant qu’on avait enfin fait sortir de son lit courait vers la fenêtre et de son petit doigt il suivait les contours de ces roses de glace que le froid avait dessinées dans le givre.
Mais il fallait vite descendre en bas, et s’habiller près du gros poële de fonte, qui déjà ronronnait en emplissant la maison d’une bonne chaleur douillette, tandis que dehors il neigeait sans arrêt.
00:17 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature
15/09/2009
Le promeneur solitaire
Le promeneur solitaire parcourt la dune, perdu dans ses pensées, entre la rumeur de la mer et les montagnes empourprées du couchant.
Il marche, rêveur, dans l’infini des sables, et songe à ces cités englouties dont parlait le poète.
Vivent-elles encore au fond de l’eau, les belles sirènes d’autrefois ou ne sont-elles plus qu’un souvenir dans la mémoire des hommes ?
Il marche le promeneur, dans le bleu du soir et pense à tous ces peuples qui ont foulé le même sable, depuis la nuit des temps, depuis que le monde est monde. Que reste-t-il aujourd’hui de leurs conquêtes, de leurs rêves, de leurs aspirations ? Il n’en reste rien et tout cela ne fut qu’un reflet éphémère, comme ce scintillement passager au crépuscule, sur la mer.
Il fait noir maintenant et le mendiant s’est arrêté sur le sommet de la dune. Il a tout perdu, même son ombre, qui s’en est allée rejoindre les flots verts qui s’agitent dans l’obscurité.
Le voilà perdu, le promeneur solitaire, en ce désert de sable. Sur les rivages de la nuit, il cherche son chemin, n’ayant pour se guider que l’éternel grondement de la mer et la rumeur des vagues.
D’autres sont passés avant lui, qui ont disparu. D’autres passeront après lui, qui découvriront peut-être dans le sable les os blancs anonymes d’un promeneur éphémère. C’est sa mémoire, sans doute, qu’honore le vent, quand il siffle en gémissant, les soirs de tempête et qu’il emporte le sable en tourbillons fantastiques.

00:03 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : poésie
13/09/2009
Intermède musical: Léo Ferré et l'Italie
On ne le sait pas toujours, mais Léo Ferré, qui a tout de même conduit la chanson française à des sommets rarement atteints, a aussi chanté en italien. Si son père était directeur du personnel du Casino de Monte-Carlo, sa mère, Marie Scotto, était une couturière d'origine italienne. D’ailleurs, à neuf ans, il se retrouvera chez les Frères des Ecoles chrétiennes au collège St Charles de Bordighera, en Italie, où il sera en pension pendant huit ans (cf. son livre Benoît Misère).
Attention tout de même qu’il s’agit ici d’une école française des Frères de l’instruction chrétienne (le collège St Charles de Marseille, en fait), exilée en Italie, suite la suppression légale de l'ordre en France le 7 juillet 1904. Si les Frères avaient été appuyés du temps de Napoléon III, ils avaient commencé à perdre de leur influence sous Jules Ferry (lois laïques) avant de se voir interdits d'enseignement en 1904. Du coup, beaucoup d’écoles passèrent la frontière et s’établirent dans le Nord-Ouest de l’Italie, à une distance encore raisonnable du lieu de domicile des élèves.
Mais revenons à Ferré. Si celui-ci a toujours aimé l’Italie, c’est surtout après son mariage avec Marie-Christine Diaz qu’il s’installe près de Florence. En 1972, il enregistre d’ailleurs son premier disque en italien, ce qui n’est pas courant pour un poète français. Notons encore que c’est à Castelina qu’il se réfugiera quand il sera malade et que c’est là qu’il décédera en 1993, ce qui en dit long sur son amour pour la Toscane, où il se sentait chez lui.
Il n’est jamais facile de traduire un texte, surtout si ce texte est un poème. Il semblerait que Ferré, lorsqu’il chantait en italien, ait usé de sa voix pour faire passer tous les sentiments qu’il avait mis dans le texte initial en français, comme s’il voulait par-là compenser une éventuelle perte de sens. C’est ainsi que ce très beau texte qu’était « Tu ne dis jamais rien» est à mon avis chanté avec encore plus de force quand il devient «Tu non dici mai niente ». Le poète y exprime à vif tous ses regrets et sa sensibilité y est à fleur de peau.
Jugez vous-même :

http://www.youtube.com/watch?v=nLd1c7FTrEY
02:02 Publié dans Errance | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : léo ferré
07/09/2009
Le propriétaire
Préambule :
Puisque nous avons parlé, dans un texte précédent, de ce propriétaire qui ne déliait pas facilement le cordon de sa bourse, même pour des travaux de première nécessité, il serait intéressant d’en donner une description plus détaillée, tant il ressemblait, comme je l’ai dit, au Père Grandet de Balzac. On sait que le héros de ce livre est devenu (avec l’avare de Molière, bien entendu), le prototype de l’homme avare, radin et près de ses sous, mais le mien n’avait rien à lui envier. Evidemment j’étais très jeune quand je l’ai croisé et forcément les faits que je raconte ici sont déformés par mes yeux d’enfant. Je ne dis pas que c’est la réalité, mais plutôt la réalité telle que j’ai pu la percevoir à cet âge. De plus, une partie de la description provient de ce que la rumeur publique pouvait colporter sur le personnage et on sait ce qu’il en est de la rumeur publique. Enfin, c’est bien connu, l’acte d’écriture transforme inévitablement ce que l‘on a vécu, en l’amplifiant, en le déformant, en le faisant rentrer dans la grille de lecture de notre subjectivité, ce qui fait qu’entre la situation de départ et ce que l’on retrouve couché sur le papier il y souvent un abîme. Mais cet abîme est aussi la trace du regard spécifique qui est le nôtre et je crois que c’est finalement ce que l’on cherche dans la littérature. Ni des faits réels, ni des histoires destinées à nous amuser, mais plutôt la manière unique dont un de nos semblables peut voir le monde. Parfois il le voit comme nous (et nous nous sentons confortés dans la pertinence de notre être), mais souvent il le voit différemment (ce qui nous ouvre alors d’autres horizons et nous fait percevoir ce que nous n’avions jamais perçu). Et comme la littérature n’est pas un jeu (comme les surréalistes ont pu parfois le croire) mais une réponse à nos angoisses existentielles (ou plus exactement une tentative de réponse car la littérature ne résout rien et ne fait que poser encore plus de questions), elle participe pleinement à nous rendre plus humains, par le fait qu’elle provoque en nous une prise de conscience de notre destinée.
= = = = = = = = = = = = = = =
Ce vieux monsieur, qui dépassait les quatre-vingts ans, tenait à avec sa fille (une demoiselle restée célibataire qui flirtait avec la soixantaine), une petite épicerie dans le haut de la ville. Il avait économisé toute sa vie, ce qui fait qu’il possédait au moins une vingtaine de maisons, peut-être une trentaine, je ne sais pas exactement. Son avarice était légendaire. On disait qu’en hiver, par exemple, il ne chauffait pas sa maison, à part le magasin qui accueillait ses clients, sinon évidemment tout le monde aurait déserté son établissement et son chiffre d‘affaire s’en serait ressenti. Alors, quand la froidure se faisait par trop sentir et que ses mains commençaient à s’engourdir, il venait se réchauffer dans la boutique. Je le revois encore, pendant que sa fille servait derrière le comptoir, assis sur une vielle chaise pliante récupérée je ne sais où, tendant ses doigts transis devant le petit poële de fer blanc qui diffusait une chaleur timide. Il était enveloppé dans une couverture rapiécée et contemplait la petite casserole de soupe qu’on avait mise à réchauffer là, afin sans doute d’épargner la cuisinière à gaz qui devait se trouver quelque part dans le logement.
Il restait là sans rien dire, répondant d’un simple signe de tête aux nouveaux arrivants qui le saluaient et s’enquéraient de sa santé. Il semblait éteint, moribond et avait des gestes d’une lenteur de tortue. Pourtant, quand la caisse enregistreuse faisait son déclic caractéristique et qu’elle s’ouvrait pour engloutir les petits sous, il fallait voir alors comme son œil pétillait. On aurait dit que toute la vie qui lui restait s’était concentrée dans ce regard, dont la vivacité offrait alors un contraste étonnant avec sa vieille carcasse décatie. En attendant, les hivers passaient les uns après les autres et il était toujours là, tandis que certains clients avaient déjà rejoint l’autre rive, terrassés par l’une ou l’autre de ces maladies étranges et terribles qui faisaient chuchoter les ménagères à mi-voix quand elles attendaient dans la boutique leur tour pour être servies.
- Et vous savez Un Tel, il est mort en trois jours sans que le médecin ait pu faire quoi que ce soit. Pourtant il fallait voir la force qu’il avait !
- Non ? C’est pas vrai ! Remarquez qu’au moins il n’aura pas souffert longtemps. Ce n’est pas comme le grand Joseph de ma rue, qui est resté alité pendant cinq longues années et qui ne se souvenait même plus qui il était. Même que sa femme n’en pouvait plus de toujours le soigner au point qu’elle est partie avant lui, d’épuisement probablement .
Le gamin que j’étais écoutait tous ces malheurs dont se délectaient littéralement les commères, lesquelles, leur cabas à la main, semblaient intarissables. On aurait dit qu’elles se complaisaient dans ces drames et plus c’était horrible, plus elles semblaient contentes. Je jetais un œil discret vers le vieillard en me disant que tout de même elles auraient pu lui épargner la description de toutes ces agonies, lui qui avait déjà un pied dans la tombe… Mais il ne semblait rien entendre, comme si tout cela ne devait jamais le concerner et il se contentait de tourner de temps à autre dans son potage avec une vieille cuillère en bois, sans jamais perdre de vue ce qui se passait au comptoir. Pendant que cela discutait ferme des malheurs du monde, lui il calculait mentalement le bénéfice que lui rapportait chaque salade que sa fille sortait d’un cageot ou chaque paquet de café qu’elle allait chercher en haut d’un rayonnage, montée sur une échelle branlante à laquelle il manquait un échelon.
Evidemment, les temps étaient durs, même pour lui, car il devait avoir en tête d’acheter d’autres maisons et on sait bien que pour cela il faut de l’argent, beaucoup d’argent. Alors, comme il n’avait que son petit magasin pour vivre (en plus de tous ses loyers, évidemment), il avait trouvé un moyen très simple pour faire fructifier ses affaires. L’art du commerce, c’est bien connu, consiste à vendre très cher au détail ce que l’on a acheté bon marché en gros, cela il l’avait toujours su. Mais là où il dépassait tous ses collègues et concurrents en ingéniosité, c’est qu’il avait imaginé de rogner sur les quantités des produits qu’il vendait. Ainsi, tous les paquets d’une demi-livre de beurre étaient délicatement ouverts et il en retirait une fine lamelle avant de refermer le tout. Après avoir répété la même opération une bonne dizaine de fois, il parvenait ainsi à vendre un onzième paquet qu’il n’avait pas dû acheter. Il procédait de même avec les paquets de café en grains ou encore avec le sucre fin.
Cette pratique un peu scandaleuse, il faut l’avouer, était connue de tous, mais en ces temps où les voitures étaient encore rares et où il n’était pas facile de se déplacer, chacun trouvait son compte dans ce petit magasin de proximité. Si on désapprouvait cette manière de faire, on le chuchotait en rue, mais jamais dans la boutique, par une sorte d’accord tacite entre tous. Pourtant, certaines clientes étaient plus difficiles et il y en avait parfois une qui se montrait récalcitrante au point de rompre le pacte. Je me souviens ainsi d’avoir vu une brave dame refuser une bouteille de limonade qui avait été ouverte et dans laquelle il manquait manifestement un peu trop de liquide. Mais bon, ces incidents regrettables étaient rares et d’une manière générale le vieux monsieur parvenait tout de même à arrondir subtilement ses fins de mois.
L’argent qu’il gagnait, on s’en doute, ne servait pas à améliorer son existence quotidienne, mais prenait tout droit le chemin de la banque. On avait l’impression qu’il craignait pour ses vieux jours et qu’il se constituait pour plus tard un petit magot rassurant, à l’abri des regards. Le problème, c’est qu’il avait déjà plus de quatre-vingt ans, ce qui fait que tout le monde se demandait à quel âge il envisageait de mourir. A ceux qui lui disaient qu’il serait temps qu’il profitât un peu de la vie, il répondait par le silence, se contentant de lever une main dans un geste dubitatif, comme pour signifier qu’on ne savait jamais ce que le hasard pouvait bien réserver et qu’il valait mieux être prudent. On ne pouvait pas dire qu’il travaillait pour ses petits-enfants, puisqu’il n’en avait pas, sa fille unique ne s’étant jamais mariée, par crainte sans doute des maris dilapidateurs de fortune. Quant à elle, seule héritière du patrimoine immobilier que constituaient les trente maisons, elle semblait à l’abri du besoin, d’autant plus qu’elle n’était déjà plus si jeune.
Pourtant, la rumeur disait que dans cette maison on ne mangeait pas à sa faim. Les visites chez le boucher étaient rares et se limitaient aux grandes fêtes du calendrier, encore parvenait-on à se contenter de bien peu, comme cent grammes de saucisses ou quelques pieds de porc (lesquels allaient cuire interminablement dans une marmite sur le poële de la boutique, ce qui, ces jours-là, écourtait considérablement la conversation des ménagères, avides pourtant de mille ragots à colporter). Parfois, on voyait le vieux monsieur se lever de sa chaise comme à contrecœur et d’un pas lent et résigné aller prendre une boîte de petits pois sur un rayonnage avant de disparaître dans sa cuisine. Manifestement, cette boîte constituait tout le repas de cet étrange couple, le père et la fille, si bien assortis qu’on finissait par les confondre. Il était même à craindre que ce ne fût là le seul repas de la journée car on n’avait jamais vu le moindre boulanger s’arrêter devant la boutique et quant à aller chercher eux-même leur pain, ils n’en avaient pas le temps, évidemment. Quand on tient soi-même un commerce, il faut savoir se consacrer aux clients, c’est bien connu, n’est-ce pas ?
Bon, j’arrête là la description de mon père Grandet local, n’ayant pas beaucoup d’autres éléments à rapporter. Quand il eut repris la maison que nous occupions (avec la nouvelle serre), j’ai déménagé puis un peu après j’ai changé de région, ce qui fait que j’ai perdu de vue tout ce petit monde. J’ai appris plus tard que le vieux monsieur était mort à cent trois ans, fort étonné, probablement, que la vie ne lui ait pas laissé le temps de profiter de son petit capital.

Le Père Grandet (dessin de Henri Monnier)
23:03 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature
03/09/2009
Les cercles magiques.
Sur la plage, l’enfant trace un cercle avec un bâton, puis un autre et encore un autre. Trois cercles concentriques qui délimitent un disque d’un mètre de diamètre environ, dont il aplanit maintenant délicatement la surface avec les mains. Puis il va chercher quelques branches de pins odorants qu’il dispose religieusement le long du premier cercle. Ensuite, il parcourt le rivage et revient avec des galets blancs, qu’il place uns à uns sur le périmètre du deuxième cercle. Le voilà maintenant parti tout la-bas, à la limite de plage et des grandes dunes qui circonscrivent l’espace marin. Je le distingue à peine, silhouette minuscule au pied d’un grand arbre. Puis le voilà qui revient en courant, rayonnant, car il a trouvé ce qu’il cherchait. Tout autour du troisième cercle il dispose alors des feuilles d’eucalyptus, dont l’odeur entêtante envahit tout l’espace. Ensuite, très sérieusement, l’enfant se tient debout devant son chef d’œuvre et marmonne quelque chose, cela pourrait être une chanson ou une prière, on ne sait pas bien, mais ce sont des paroles qui pour lui prennent la tournure d’une formule magique, c’est évident. Puis, d’un bond, il saute à pieds joints au centre du cercle et reste là, tout penaud, étonné qu’il ne se passe rien.
Je souris de sa naïveté et replonge dans mon livre. Quelques instants plus tard, intrigué par le grand silence qui règne autour de moi, je lève les yeux et à ma grande surprise je constate que l’enfant a bel et bien disparu.
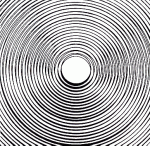
00:37 Publié dans Prose | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature
02/09/2009
La mer (suite)
Derrière la dune que je gravis pieds nus, des cris se font entendre, sorte de gémissements plaintifs tels ceux d’une fille en pleurs. Mais je suis loin, si loin.
Derrière la dune que je gravis aussi vite que je peux, je perçois la plainte du vent et le claquement des câbles contre le mat des navires. C’est du moins ce qu’il me semble.
Derrière la dune, tandis que mes pieds n’en finissent plus de s’enfoncer dans le sable, j’imagine des départs vers des ailleurs ultramarins, des tropiques incroyables, des caps Horn mystiques. Trois grands bateaux prennent le large, tandis qu’une femme, sur la plage, pleure l’absence de son capitaine, seule, irrémédiablement seule. C’est que c’est un voyage sans retour et elle le sait.
Quand j’arrive au sommet, quand je franchis la ligne, quand je laisse enfin derrière moi la dune et son sable, je découvre la mer et la plage immense, déserte comme au premier jour. Il n’y a personne ici. Dans le ciel, seule plane une mouette, dont le cri strident, tel un long sanglot, se répercute à l’infini dans ce lieu solitaire.
A l’horizon, trois petits points, comme trois voiles mystérieuses, semblent voguer de concert avant de disparaître dans l’immensité bleue.
C’est du moins ce qu’il m’a semblé.

Photo Internet : Bruno Monginoux /
Photo-Paysage.com (cc-by-nc-nd)
00:56 Publié dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature










